Contre le protectionnisme européen
Les avantages du libre-échange
Le protectionnisme : bonnes questions, mauvaises réponses
La réponse aux bonnes questions posées par les protectionnistes : le renforcement de l’action de l’UE
La recherche et l’innovation
Le financement de l’innovation
L’harmonisation des normes et des règlements nationaux
La coordination des politiques macroéconomiques
Annexes
Depuis le déclenchement de la crise bancaire et financière en 2007 et, plus encore, depuis sa transmission à l’économie «réelle » à partir de 2008, des voix de plus en plus fortes se sont élevées pour demander l’instauration de mesures protectionnistes à l’échelle européenne. Ces voix émanent essentiellement de deux sources :
– les gouvernements, qui voient dans ces mesures un moyen de protéger certains secteurs industriels de la concurrence des produits importés ou des délocalisations ;
– certains experts (le plus souvent non-économistes, mais démographes comme Emmanuel Todd, géographes comme Hakim El Karoui, journalistes comme Philippe Cohen), notamment réunis sous la bannière du site « Pour un protectionnisme européen » (www.protectionnisme.eu).
Les résurgences protectionnistes sont fréquentes en temps de crise, la tentation du repli sur soi est naturelle. La thématique protectionniste connut un regain d’intérêt dans les années 1930, bien sûr, mais aussi au milieu des années 1970, après le premier choc pétrolier (Jean-Marcel Jeanneney publie Pour un nouveau protectionnisme en 1978). On comprend bien l’avantage que les politiques peuvent en tirer. En «protégeant » une industrie au moyen de barrières douanières (comme les États-Unis ont été tentés de le faire récemment avec l’acier, jusqu’à ce que Barack Obama fasse retirer de son plan de relance la clause dite « Buy American »), un État fait montre de son volontarisme et de sa capacité à agir dans la tempête. Les emplois préservés sont en outre parfaitement identifiables. Si l’on avait par exemple fermé le secteur de l’acier à la concurrence non américaine, il aurait été facile de mettre en avant les emplois d’ouvrier préservés, au moins à court terme. À l’inverse, les avantages du libre-échange (croissance plus forte, prix plus faibles) sont dispersés dans une grande partie de la population et donc moins facilement perçus par l’opinion. Le but de cette analyse est de montrer que :
– l’Union européenne ne saurait adopter une politique protectionniste sans payer un prix très supérieur aux avantages qu’elle pourrait en retirer ;
– les problèmes soulevés par les défenseurs du protectionnisme trouvent des réponses dans quatre actions principales de politique économique : le développement des capacités européennes de recherche et d’innovation ; le renforcement du financement de l’innovation; l’harmonisation des normes et des règlements nationaux ; la coordination des politiques macroéconomiques.
Les avantages du libre-échange
N. G. Mankiw, Principes de l’économie, Paris, Economica, 1998.
P. R. Krugman, La mondialisation n’est pas coupable. Vertus et limites du libre-échange, Paris, La Découverte/ Poche, coll. «Essais », 2000.
P. R. Krugman, « Trade and wages, reconsidered », projet pour la réunion de printemps du Brookings Panel on Economic Activity, février 2008.
J. D. Sachs et A. Warner, « Economic reform and the process of global integration », Brookings Papers on Economic Activity, 1995.
F. Rodríguez et D. Rodrik, « Trade policy and economic growth : a skeptic’s guide to the cross-national evidence », in B. S. Bernanke et K. Rogoff (dir.), Macroeconomic Annuals, NBER, Cambridge, The MIT Press, 2000.
J. D. Sachs, The End of Poverty. Economic possibilities for our time, New York, Penguin Books, 2005.
Plus de deux siècles d’analyse économique et de recherche ont abouti à quelques résultats bien établis, en termes tant théoriques qu’empiriques. En termes théoriques, la supériorité du libreéchange sur le protectionnisme repose notamment (mais pas seulement) sur l’analyse des avantages comparatifs. Considérons deux pays, par exemple la France et l’Allemagne. La France a une productivité supérieure à celle de l’Allemagne dans la fabrication de biens de consommation. En revanche, l’Allemagne a une productivité supérieure à celle de la France dans la production de biens d’équipement. Dans ce cas, il est clair que la France a intérêt à se spécialiser dans la production et l’exportation de biens de consommation et à importer les biens d’équipement dont elle a besoin. À l’inverse, l’Allemagne se spécialisera dans la production de biens d’équipement et importera des biens de consommation. Supposons maintenant que, à la suite d’un certain nombre de décisions malheureuses en matière de politique économique en France, l’Allemagne devienne plus productive à la fois dans le domaine des biens d’équipement et dans celui des biens de consommation. Cette évolution ne devrait pas modifier fondamentalement les flux commerciaux entre les deux pays. En effet, si la France demeure plus productive dans les biens de consommation que dans les biens d’équipement, elle aura intérêt à rester spécialisée dans les biens de consommation, de la même façon que l’Allemagne aura intérêt à demeurer exportatrice de biens d’équipement. Pour illustrer cette notion, l’économiste américain Gregory Mankiw se demande par exemple si le basketteur Michael Jordan doit tondre lui-même son jardin, dans la mesure où ses capacités physiques lui permettent d’effectuer une tonte plus rapide et meilleure que celle qui serait faite par toute autre personne1. En réalité, il est évident que Michael Jordan maximise ses revenus en payant sa voisine pour tondre sa pelouse, même si elle effectue l’opération en quatre heures (contre deux heures pour Michael), tandis qu’il emploie le temps ainsi libéré à tourner des spots publicitaires. Bien entendu, le monde apparemment merveilleux de la théorie des avantages comparatifs perd de son charme lorsqu’on passe de l’abstraction à la réalité. En effet, ceux-ci évoluent avec le temps. Un pays peut avoir intérêt à se spécialiser dans le textile, puis dans le tourisme et enfin dans l’aéronautique. Cela pose d’importants problèmes de reconversion, qui obligent à un effort de formation important (formation initiale généraliste, capacité de la formation continue à spécialiser rapidement sur de nouveaux métiers). La spécialisation d’un pays dans les secteurs à forte valeur ajoutée qu’impose l’ouverture au commerce mondial peut conduire à une augmentation des inégalités salariales. En effet, la montée en gamme des entreprises génère une demande de travail qualifié, alors que les tâches demandeuses de travail moins qualifié peuvent être localisées à l’étranger. Ainsi, le «prix» du travail qualifié augmente relativement à celui du travail non qualifié. Cet effet du libre-échange sur les inégalités existe en théorie, et il est largement mis en avant par les avocats du protectionnisme. Mais ceux-ci ne le mesurent jamais, et pour cause! Tous les exercices de quantification de cet effet ont accouché d’une souris. Le prix Nobel d’économie 2008, Paul Krugman, avait défendu de longue date l’idée selon laquelle le libre-échange avait peu de responsabilité dans la formation des inégalités2. En 1995, Krugman a montré que l’accroissement des échanges internationaux expliquait 3% de l’accroissement des inégalités de salaire aux États-Unis. En 2007, Krugman a souhaité actualiser ses travaux, potentiellement rendus obsolètes par l’augmentation du poids de la Chine dans les échanges internationaux et par la fragmentation de la chaîne de valeur des entreprises, qui a conduit à la délocalisation d’activités à faible productivité des pays riches vers les pays émergents. En février 2008, Krugman déclare que l’état actuel de ses recherches ne permet pas de conclure à une évolution importante du rôle de la mondialisation en matière d’inégalités depuis son article de 1995 (« How can we quantify the actual effect of rising trade on wages? The answer, given the current state of the data, is that we can’t »3). Si l’on n’a jamais pu établir de lien empirique important entre libre-échange et inégalités, il en va de même du lien entre libre-échange et emploi. Toutes les études sur le sujet ont en effet montré que l’impact de la place croissante des pays à bas salaires dans le commerce international sur l’emploi des pays développés reste mineur. D’ailleurs, à l’intérieur de l’Union européenne, certains pays, relativement fermés (comme la France) sont bien plus touchés par le problème du chômage que certains pays ouverts (comme les Pays-Bas). Au-delà de la théorie des avantages comparatifs, la seconde vertu du libre-échange tient à la possibilité pour les entreprises présentes sur un territoire donné de réaliser des économies d’échelle grâce à leurs exportations. Supposons que la France et l’Allemagne disposent exactement de la même productivité dans les biens de consommation et les biens d’équipement. Chacune aurait tout de même intérêt à se spécialiser dans un secteur, quitte à le choisir au hasard, pour bénéficier d’un marché plus important que son simple marché national, et réaliser ainsi des économies d’échelle. Le corollaire de toutes ces analyses, c’est que le libre-échange permet aux consommateurs et aux entreprises de se procurer des produits à des prix inférieurs à ceux qui auraient cours si la production s’effectuait exclusivement sur le sol national. La baisse des prix de l’électroménager ou des vêtements au cours de ces dernières années a été permise, notamment, par la mondialisation. Et, même assemblé sur le sol français, un Airbus contient beaucoup de pièces électriques et électroniques fabriquées à l’étranger, de plus en plus loin, d’ailleurs. Autrement dit, le retour à une certaine dose de protectionnisme aurait pour conséquence immédiate une augmentation des prix à la consommation pour les ménages, et des coûts de production pour les entreprises. L’analyse des avantages du libre-échange sur le protectionnisme trouve une solide confirmation empirique. Dans un article de référence, Jeffrey Sachs et Andrew Warner ont constitué deux groupes de pays : les pays «ouverts » et les pays « fermés»4. Durant la période 1970-1995, les pays ouverts ont bénéficié d’une croissance annuelle moyenne de 4,5%, contre 0,7% pour les pays fermés. Les travaux de l’économiste américain Dani Rodrik vont plus loin. Selon lui, l’ouverture au commerce international offre moins de prise au népotisme et à la corruption qu’une économie fermée. Ouverture au commerce et qualité des institutions se renforcent mutuellement, car le libre-échange pousse à l’efficacité, et donc à la bonne gouvernance. À l’inverse, Dani Rodrik et Francisco Rodríguez rappellent qu’aucune étude n’est jamais venue démontrer que le protectionnisme pouvait être un facteur de croissance5. L’exemple de la Chine est particulièrement spectaculaire – et riche d’enseignements – pour les économies développées, au premier rang desquelles l’Europe. Au début du XVIème siècle, la Chine était la superpuissance économique du monde, et ce depuis un millénaire. Selon Jeffrey Sachs, le pays a perdu son leadership en 1434, quand l’empereur Ming a fermé le pays au commerce international, démantelant une flotte exceptionnelle de navires, et empêchant ainsi la circulation des marchandises6. Quand Adam Smith mentionne la Chine dans La Richesse des nations (1776), il évoque un pays tourné vers lui-même, encore riche, mais beaucoup moins que s’il avait entretenu sa vocation commerçante. À l’inverse, les réformes entreprises dans la seconde partie du XXème siècle (libéralisation agricole à la fin des années 1970, puis libéralisation du commerce international et des investissements) ont généré un afflux d’investissements étrangers, qui a débouché sur des réexportations énormes et sur l’augmentation de la position de la Chine dans l’économie mondiale.
Le protectionnisme : bonnes questions, mauvaises réponses
D. Spector, « Textiles chinois, le bon marché », Libération, 6 juin 2005.
Il existe de nombreux arguments en faveur du protectionnisme. Certains ne passent pas le test d’une analyse sérieuse. Déjà, il faut garder à l’esprit le fait que la mise en place de toute mesure protectionniste expose à des mesures de rétorsion. En 1930, les États-Unis adoptèrent la loi Smoot-Hawley, qui augmentait de 50% les droits de douane à l’entrée du pays, en dépit des avertissements consignés dans une pétition signée par plus de mille économistes. Rapidement, le Canada et les pays européens prirent des mesures de rétorsion. Les exportations comme les importations des États-Unis chutèrent alors d’environ deux tiers. Certains arguments défendus par les avocats du protectionnisme ont pourtant le mérite de poser des questions pertinentes. En voici cinq parmi ceux qui reviennent le plus souvent.
– Nous ne pouvons concurrencer les pays à bas salaires. Nous avons déjà répondu à cet argument. Dans un monde d’avantages comparatifs, il n’a pas de valeur. Il s’agit non pas, pour les entreprises des pays riches, d’entrer en compétition avec les entreprises des pays émergents par les coûts, mais en se différenciant. Rappelons également que les importations des pays à bas salaires représentent généralement moins de 10% des importations totales des pays développés.
– Il faut fermer nos frontières aux pays qui n’ouvrent pas les leurs. Cet argument est celui de la réciprocité. Il guide les négociations des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lesquels ne conçoivent d’ouvrir leurs frontières que si les autres le font. Logique en apparence, cet argument fait pourtant peu sens pour une raison simple : ce n’est pas parce que certains pays souhaitent limiter les importations en provenance d’Europe qu’il faut nous interdire de leur acheter des biens de consommation ou d’investissement à des prix inférieurs au prix de production sur le sol européen. Il y a quelques années, David Spector a montré que l’invasion de l’Hexagone par les textiles chinois, qui permet aux consommateurs d’acheter des vêtements à un prix beaucoup plus bas qu’auparavant, constituait l’équivalent d’un plan de relance de 1,5 milliard d’euros par an, soit plus que l’argent nécessaire pour indemniser jusqu’à leur retraite les 7000 salariés menacés de voir disparaître leur emploi7.
– Il faut limiter nos importations si notre indépendance est menacée. Cet argument est correct. Il ne vaut toutefois que pour un nombre limité de secteurs – et pour lesquels, souvent, une telle politique existe déjà. Cela a longtemps été le cas, par exemple, de l’agriculture avec la politique agricole commune (PAC) : subvention des exportations lors de la «première » PAC de 1962, subventions accordées selon la surface cultivée lors de la «deuxième » PAC de 1992.
– Il faut protéger les industries naissantes. Il s’agit ici de protéger certains secteurs de la concurrence étrangère afin qu’ils puissent se développer en taille et en rentabilité. Une fois qu’un secteur aurait atteint une taille critique, il pourrait être ouvert aux importations et jouer le jeu de la compétition internationale. Dans la pratique, tous les gouvernements du monde souhaitent développer des secteurs dits «prioritaires». Il peut s’agir du tourisme, de l’aéronautique, des nouvelles technologies, de la santé… Certains, à l’instar de Singapour, ont même mis en place de véritables stratégies de politique industrielle à long terme, en étalant leur soutien dans le temps, afin de laisser aux entreprises et aux secteurs le temps de monter en gamme. Mais, le protectionnisme, qui expose à des mesures de rétorsion commerciale et fait monter le prix des intrants (facteurs de production importés), n’est pas le meilleur moyen d’atteindre cet objectif. Mieux vaut subventionner un secteur ou lui donner accès à des financements privilégiés, par exemple garantis par l’État.
– Il faut se donner les moyens de mener des plans de relance de manière autonome. Cet argument revêt deux formes. La macroéconomie keynésienne montre que l’impact d’un plan de relance conjoncturel (hausse de la dépense publique, allégement de la fiscalité) est d’autant plus fort que les importations sont faibles (l’idée sous-jacente est que, en économie ouverte, la relance bénéficie en partie aux produits importés, et donc aux industries étrangères, ce qui constitue une « fuite »). Ce point est formellement juste. En revanche, l’idée selon laquelle il faut accompagner un plan de relance de limitations aux importations pour maximiser son impact est pernicieuse. Comme nous le verrons plus loin, il est possible de résoudre ce problème sans passer par des mesures protectionnistes. Plus généralement, le respect du libre-échange contraint les gouvernements nationaux à la mise en place de mesures de soutien pour certains secteurs d’activité. Ce point est apparu clairement en France lors de la mise en place du plan de soutien au secteur automobile. Ce plan consiste essentiellement en un prêt de l’État de 6 milliards d’euros, assorti de contreparties pour les deux constructeurs français. C’est non pas le crédit, mais la nature des contreparties – en particulier l’engagement de ne pas délocaliser d’usines implantées en France – qui a pu inquiéter nos partenaires européens.
La réponse aux bonnes questions posées par les protectionnistes : le renforcement de l’action de l’UE
Certaines des questions posées par les avocats du protectionnisme sont pertinentes. Mais la réponse protectionniste est inepte. Au freinage forcé de nos échanges avec les pays non européens, il faut opposer le renforcement des politiques communautaires dans quatre domaines : la recherche universitaire, le financement de l’innovation, l’harmonisation des normes et des règlements nationaux, la coordination des politiques macroéconomiques. C’est là, et non dans le repli sur soi, que se trouvent les réponses aux questions posées par les opposants au libre-échange.
La recherche et l’innovation
À un an de l’échéance de la stratégie de Lisbonne, force est de constater que l’Europe est loin d’être devenue « l’économie fondée sur le savoir la plus compétitive du monde ». Les États-Unis restent leaders en matière de recherche et d’innovation, et les pays émergents sont entrés en phase de rattrapage accéléré. Quelques chiffres (OCDE) suffisent à le montrer. La productivité du travail (mesurée par le ratio du PIB au nombre d’heures travaillées) a augmenté de 1,3% par an dans l’Union à quinze depuis 2001, soit 0,9 point de moins qu’aux États-Unis et 0,5 point de moins que dans l’ensemble de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En 2006, le ratio des investissements en R&D a été inférieur à 1,8% dans l’Union à vingt-sept. À la même date, ce chiffre s’élevait à 2,7% aux États-Unis et à 3,4% au Japon. Ce dernier investit aujourd’hui environ dix fois plus que l’Union à quinze dans les biotechnologies et les nanotechnologies. Ce faible niveau d’innovation en Europe tient beaucoup à l’absence de nouvelles entreprises innovantes en forte croissance. L’Europe est exclue des secteurs des biotechnologies ou des nanotechnologies non pas à cause du libre échange, mais du fait de la mauvaise coordination entre recherche publique et recherche privée et du fait de l’étroitesse des sources de financement. Une grande partie des difficultés de l’Europe à faire émerger de nouveaux avantages comparatifs vient de l’incapacité de la recherche académique à constituer un réservoir d’idées pour les créateurs d’entreprise. On sait que beaucoup de grandes entreprises américaines de biotechnologies sont nées sur des campus universitaires. Rien de tel en Europe, où la recherche ne se mue quasiment jamais en opportunité commerciale. C’est pourquoi, plutôt que de se barricader derrière des frontières commerciales, l’Europe doit absolument se doter d’un système de recherche sélectif (les plus gros financements aux plus performants) et plus intégré (la coopération transnationale plutôt que la concurrence).
Le financement de l’innovation
Les entreprises européennes innovantes manquent singulièrement de financements, et cela ne va pas s’arranger avec les difficultés que les banques connaissent, consécutives à la crise financière. Il n’existe pas d’Intel, de Cisco ou de Google en Europe. C’est pourquoi il est urgent de faciliter l’accès des nouvelles entreprises aux financements privés. Qui se souvient que le venture capital a été inventé après la Seconde Guerre mondiale par les présidents du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de Harvard? Aujourd’hui, le capital-risque américain est six fois supérieur à celui de l’Europe. Là encore, une harmonisation européenne est nécessaire, qui pourrait concerner la levée des barrières à l’entrée dans le capital des jeunes entreprises pour les fonds de pension et les assurances, le soutien à la création de sociétés européennes de capital-risque, etc. Les instruments de la Banque européenne d’investissement (BEI) devraient être davantage mis au service des projets innovants. Enfin, la création d’un marché boursier des entreprises innovantes au niveau de la zone euro pourrait être envisagée.
L’harmonisation des normes et des règlements nationaux
Plutôt que de fermer le marché européen, mieux vaudrait l’agrandir et le fluidifier. Le marché européen des biens et des services reste en effet fragmenté. Les coûts administratifs, juridiques et financiers des opérations économiques transfrontalières demeurent trop élevés, ce qui a les mêmes conséquences que le protectionnisme (non souhaité). Beaucoup de réglementations sont encore nationales (dans les services en particulier), ce qui contraint les entreprises à mettre en place des filiales dans différents pays, alors qu’il serait plus pertinent pour elles de croître à partir d’une base nationale. En effet, nous avons besoin d’entreprises plus grandes (ce qui, au passage, pourrait militer en faveur d’un assouplissement des règles de concurrence). Or, la taille du marché que ces entreprises peuvent servir influe sur leur dimension et sur le montant de leurs investissements. Ce point est particulièrement vrai pour le secteur des services, qui représente environ 70% de l’économie européenne, et pour lequel l’intégration est moins achevée que celle des produits industriels. Certes, l’intégration économique est souvent mal vécue par nos concitoyens, surtout dans une Europe élargie à des économies encore émergentes (celles d’Europe de l’Est), où le coût du travail est nettement plus faible que dans les pays les plus riches comme la France. Le psychodrame autour de la directive Bolkestein en témoigne. Pourtant, il convient de répéter que le Marché unique, en permettant à nos entreprises d’investir et de grandir, constitue sur le long terme une protection bien plus efficace que des barrières protectionnistes.
La coordination des politiques macroéconomiques
Lettre de mission de M. Nicolas Sarkozy, président de la République, adressée à Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, 11 juillet 2007.
Renforcer l’efficacité des plans de relance à court terme constitue une préoccupation légitime. Nous savons qu’une relance par la consommation (par exemple en diminuant le taux de TVA) serait de peu d’effet dans un petit pays, surtout si celui-ci connaît déjà un déficit de son commerce extérieur. En effet, dans ce cas, le surcroît de biens consommés se traduirait surtout par un flux supplémentaire d’importations. La résolution de ce problème passe non pas par le protectionnisme, mais par la relance concertée. Si les pays de la zone euro s’étaient entendus pour pratiquer, tous ensemble, une relance par la consommation (en diminuant, par exemple, la fiscalité sur les ménages les plus modestes à hauteur de 1% du PIB), on aurait pu s’attendre à un effet positif très net sur la conjoncture économique européenne. Les « fuites » en importations extra-européennes auraient été très faibles, la zone euro étant vaste et, par là même, relativement fermée. C’est pourquoi il est nécessaire de renforcer la coordination des politiques conjoncturelles des pays de la zone euro. Bien entendu, il existe déjà un Eurogroupe. Mais, si nous avons l’institution, sa politique reste minimaliste, voire inexistante. Non seulement la politique économique ne relève pas de décisions communes, mais elle est à peine concertée. Il ne s’agit évidemment pas de transférer à l’Eurogroupe les politiques budgétaires des États. Dans bien des circonstances, l’échelle nationale se révèle pertinente. Mais on pourrait envisager la possibilité pour l’Eurogroupe d’adopter, à la majorité qualifiée, des décisions de politique économique qui s’imposeraient aux États membres de la zone euro dans certaines circonstances prédéfinies, par exemple en cas de crise économique grave. Une efficacité accrue de la politique macroéconomique à l’intérieur de la zone euro passerait également par le renforcement de la coopération entre l’Eurogroupe et la Banque centrale européenne (BCE). Il ne s’agit pas de remettre en cause l’indépendance de la BCE, laquelle constitue un « actif » macroéconomique à ne surtout pas déprécier. Mais, même dans l’Allemagne d’avant l’euro, où l’indépendance de la Bundesbank était quasi sacrée, le ministre des Finances constituait pour la BCE un correspondant privilégié. La politique macroéconomique devrait résulter de la concertation de ses deux composantes : d’une part, la politique monétaire et, d’autre part, la politique budgétaire, qui doit être concertée – les deux éléments étant finalement complémentaires. Autre avantage de cette coordination : elle permettrait de parler d’une seule voix, quand les questions de taux de change sont en cause. Ces dernières années, le taux de change de l’euro par rapport au dollar s’est considérablement apprécié, entraînant une perte de compétitivité – prix énorme pour les industriels implantés dans la zone euro. La BCE peut, en théorie, intervenir sur le marché des changes, dans le respect des mécanismes du marché, en vendant des euros et en achetant des dollars. Face à la difficulté de convaincre les autres banques centrales du bien-fondé d’une telle intervention, elle y a pour l’heure renoncé. D’après l’article 111 de la version consolidée du traité instituant la Communauté européenne, « le conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler des orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies ». Il existe donc bien une fenêtre juridique, certes étroite, pour une intervention. Toutefois, la BCE doit encore l’accepter. C’est pourquoi la demande formulée par Nicolas Sarkozy à Christine Lagarde dès 2007 d’examiner « dans quelle mesure pourrait être élaboré un accord entre l’Eurogroupe et la Banque centrale européenne permettant de préciser les conditions de ce dialogue et les modalités de mise en œuvre d’une politique de change » est économiquement justifiée8.
Annexes





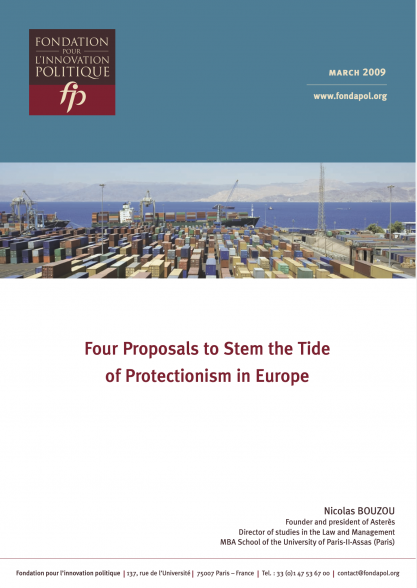












Aucun commentaire.