Le tandem franco-allemand face à la crise de l’Euro
Introduction
Du plan Werner à l’opération de sauvetage de l’euro
Le serpent monétaire
Le système monétaire européen (SME)
Vers la monnaie unique
L’opération de sauvetage de l’euro
Les institutions franco-allemandes de coopération
Les réactions franco-allemandes à la crise financière
Des structures différentes
Des réactions divergentes
Les dégâts collatéraux de la crise financière et économique
Une dégradation préoccupante des finances publiques
Le ratio de la consolidation budgétaire
La politique financière dans l’UEM
Options pour la consolidation budgétaire
Le gouvernement économique européen comme alternative institutionnelle
Etats-Unis et Japon : La bombe à retardement
États-Unis : dette et dépendance internationale
Le Japon : une situation financière préoccupante
La sortie de crise
La réforme du Pacte de stabilité et de croissance
Le renforcement du mécanisme de marché
Le risque systémique
Conclusion
Résumé
L’histoire de l’intégration européenne est aussi celle de l’intégration monétaire. La coopération franco-allemande a toujours joué un rôle décisif dans la politique monétaire européenne. C’est dans ce domaine que l’on constate des désaccords persistants entre les deux pays, mais aussi une volonté de parvenir à un compromis sans lequel l’euro n’existerait pas.
La question monétaire ne prend de l’importance en Europe qu’avec l’intégration croissante dans le Marché commun et l’effondrement du Système monétaire international. Une coopération plus étroite au sein du Serpent monétaire européen échoue à cause de l’absence de synchronisation des politiques économiques. Par la suite, le Système monétaire européen (SME) connaît des débuts difficiles mais se stabilise après «le tournant de la rigueur» décidé par François Mitterrand.
Cette évolution suscite en France les premières réflexions visant à créer une monnaie européenne commune, auxquelles font écho des idées similaires du côté allemand. Cependant, maintes divergences franco-allemandes persistent et le traité de Maastricht correspond plutôt à une conception allemande de la stabilité.
Ces idées ne sont pas pleinement mises en application au cours des dix premières années d’existence de l’euro. Les divergences économiques entre les États membres conduisent au printemps 2010 à des turbulences sur les marchés financiers et à la menace d’une défaillance de la Grèce. L’Allemagne doit abandonner tous les principes qu’elle défendait jusque-là lors de l’opération de sauvetage de l’euro.
De la même manière, l’adoption de la réforme du Pacte de stabilité et de croissance exigeait une entente franco-allemande. C’est la conception française du primat du politique qui a prévalu sur les règles budgétaires strictes préférées par l’Allemagne. La question de la stabilité de l’euro à long terme se pose. Si cette dernière n’est pas assurée, le choix d’une union de transferts financiers deviendra inévitable, avec toutes les conséquences que cela impliquerait dans le domaine de la politique intérieure (radicalisation de la droite en Allemagne notamment). Le tandem franco-allemand est donc appelé à une coopération étroite afin d’empêcher une telle situation, qui serait critique pour l’ensemble de l’Europe.
Wolfgang Glomb,
Économiste, ancien directeur des Affaires européennes au ministère des Finances allemand et membre du conseil d’orientation de l’Institut Thomas-More.
Introduction
Christian Stoffaës, Convergences et divergences économiques franco-allemandes : une perspective, Le Cercle des économistes, L’Allemagne, un modèle pour la France ? Cahier l’Allemagne, 2008
«L’Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas.» (Jacques Rueff, haut fonctionnaire et économiste français, 1949)
«Si l’euro échoue, l’Europe échoue et par conséquent l’idée de l’unification européenne.» (Angela Merkel, chancelière allemande, mai 2010)
Soixante années séparent ces deux citations, mais toutes deux témoignent du rôle prédominant de la monnaie dans la construction européenne et donc dans les relations franco-allemandes si ces deux pays sont amenés à jouer un rôle de moteur pour une Europe unie.
En même temps, la monnaie est source de désaccords profonds et éternels entre Français et Allemands. Le 9 mai 1950, c’est le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, qui prend l’initiative de la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et par conséquent, à terme, de l’Union européenne. Soixante ans plus tard, jour pour jour, le Conseil européen, sous la présidence française, viole dans une opération «coup de poing» tous les principes de stabilité de l’euro auxquels l’Allemagne est attachée.
La coopération franco-allemande dans le domaine monétaire n’a cessé d’être minée par de nombreux désaccords. On se souvient en particulier de la crise du Système monétaire européen de septembre 1992, au cœur de laquelle la Bundesbank (Buba) doit soutenir le franc français pour un montant d’environ 100 milliards de marks allemands (DM), soit 50 milliards d’euros. Paris reproche alors à l’Allemagne d’avoir financé l’unité allemande en recourant au marché des capitaux, ce qui aurait entraîné une hausse des taux d’intérêt au détriment de la France et des autres partenaires de l’Allemagne.
La cause principale de ces incompréhensions profondes entre les deux pays se trouve dans leurs conceptions divergentes du rôle de la monnaie dans l’économie. Pour les Français, la monnaie est – en tout cas selon les Allemands – un instrument de pouvoir politique, au service de l’État. À l’opposé, en Allemagne, la monnaie ne sert pas des objectifs politiques et n’est pas à la disposition du politique ; elle est placée hors du jeu politique. La seule prérogative dans ce domaine est la stabilité monétaire, dont seule la Bundesbank est responsable. Son indépendance n’est pas un mythe, mais un élément fondamental et pérenne de l’ordre économique en Allemagne. Jacques Delors a dit à juste titre que «les Allemands ne croient pas tous en Dieu, mais ils croient tous à la Bundesbank». L’aversion de la population allemande à l’égard de toute déstabilisation monétaire s’explique par les difficultés monétaires (hyperinflation et réforme monétaire) qu’a connues l’Allemagne dans la première moitié du xxe siècle. Le nouveau DM stable devient alors le symbole de la résurrection de l’Allemagne sortie des décombres de la Seconde Guerre mondiale, de sa nouvelle position au sein d’une communauté d’États démocratiques et libres et de son miracle économique. Or cet attachement de la population allemande à sa monnaie est rarement compris par ses voisins français.
En fin de compte, les dissensions entre les deux pays trouvent leur explication dans des convictions divergentes en ce qui concerne le bon fonctionnement de l’économie. En Allemagne, cet ordre est inséparablement associé au nom de Ludwig Erhard, premier ministre de l’Économie sous la chancellerie d’Adenauer. Sa politique était fondée sur une confiance totale dans les forces du marché, qui exigent pour leur plein déploiement autant de liberté que possible et pas plus de régulation que nécessaire ; une question qui se pose de nouveau aujourd’hui dans le cadre de la régulation des marchés financiers. Au contraire, en France, on considère à l’époque que c’est à l’État d’organiser l’économie, et la formule magique est «moderniser par le haut», d’où la place accordée à la planification. Les planificateurs établissent soigneusement des plans de secteurs et définissent les industries stratégiques. Ce qui est resté de cette attitude, c’est une politique industrielle très active de la part du gouvernement, d’une ampleur inconnue en Allemagne, et des projets d’État prestigieux comme le TGV et le Concorde. De tels projets se sont faits au détriment des petites et moyennes entreprises (Mittelstand) qui, dans l’après-crise financière et du fait de leur plus grande flexibilité, sont le moteur des exportations allemandes.
Compte tenu de ces divergences profondes entre les deux voisins, une défiance latente est souvent à l’ordre du jour. En Allemagne, on craint toujours une Europe «à la française», et en France une «germanisation» de l’Europe. Paradoxalement, la coopération franco-allemande n’a jamais été mise en danger, et elle est au contraire plus vivante que jamais, comme en témoigne, entre autres, l’Agenda 2020 adopté par les deux gouvernements lors de leur rencontre au printemps 2010. L’origine de cette constance se trouve probablement dans la signature du traité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), en 1952, et du traité de Rome, en 1957. La France, dont l’industrie a vécu jusque dans les années 1950 à l’abri de ses frontières, se convertit au libre-échange dans les années 1960, puis à la désinflation et à la rigueur monétaire dans les années 1980. La parité franc-mark exige alors l’abandon du laxisme budgétaire, des excès de l’endettement public et de la boucle prix-salaires. Finalement, dans les années 1990, les directives de dérégulation1 encouragent la France à lancer une démarche de privatisation des entreprises publiques. Dans l’ensemble, ce sont donc plutôt les conceptions allemandes qui s’imposent sous la pression des marchés. L’Allemagne sert régulièrement de pays de référence, comme encore récemment lors de la présentation de la loi de finances 2011, au cours de laquelle le ministre français du Budget, François Baroin, a affirmé qu’il était indispensable de suivre le modèle allemand pour redresser les finances publiques en France.
Cette étude exposera, dans son premier chapitre, un aperçu de l’histoire de l’intégration monétaire en Europe, qui a sans cesse accordé un rôle crucial à la coopération franco-allemande, et soulignera dans un deuxième chapitre les réactions divergentes de la France et l’Allemagne à la crise financière et économique mondiale. Le troisième chapitre traitera de la crise des dettes d’État en Europe ; le quatrième abordera le rôle d’un gouvernement économique comme instrument institutionnel de coordination des politiques économiques ; le cinquième donnera une vision des déclins américain et japonais, tandis que le sixième et dernier chapitre énoncera des recommandations pour une sortie durable de la crise de l’endettement, en concluant sur les défis et opportunités pour le couple franco-allemand de donner à l’Europe la place qui lui appartient dans un monde en plein changement.
Du plan Werner à l’opération de sauvetage de l’euro
Le serpent monétaire
La genèse de l’intégration monétaire européenne reflète de manière forte les accords et désaccords entre la France et l’Allemagne. Peu connus, les rapports Marjolin et Barre, du nom de deux membres de la Commission européenne, ont déjà dessiné, au début des années 1960, les étapes vers une monnaie unique. Les troubles monétaires de cette décennie – réévaluation du mark allemand (DM) en 1962, dévaluation du franc français en 1969 – nuisent au bon fonctionnement du Marché commun et des politiques de la Communauté, en particulier de la Politique Agricole Commune (PAC). En réaction, lors du sommet de La Haye de décembre 1969, les chefs d’États et de gouvernements des Six adoptent le principe d’une union économique et monétaire et chargent Pierre Werner, Premier ministre et ministre des Finances luxembourgeois, de faire des propositions précises et de fixer un calendrier par étapes. Le rapport Werner est adopté par le Conseil des ministres en octobre 1970, mais seule la première étape de ce plan de mise en place de l’Union économique et monétaire (de 1970–1972) entrera en vigueur, les étapes suivantes étant ajournées du fait de l’effondrement du système monétaire international. En août 1971, le président américain Richard Nixon décide de suspendre la convertibilité du dollar en or; les marges de fluctuation des monnaies sont élargies par rapport au dollar de 0,75% à 2,25% et, par conséquent, à 4,5% entre les monnaies du système de Bretton Woods. La fluctuation maximale d’une monnaie à l’intérieur de la bande de fluctuation peut atteindre 9%, ce qui contredit l’idée de stabilité des taux de change, qui est pourtant une condition préalable à l’essor du commerce intra-européen. C’est par le prétendu «Accord de Bâle», en avril 1972, que les Six décident de limiter à 2,25% les marges de fluctuation de leurs monnaies entre elles. Le Serpent monétaire dans le tunnel est né, mais il se transforme, un an plus tard, en un Serpent hors tunnel en raison de la dévaluation du dollar et de l’abandon par les autorités américaines de leur obligation d’intervenir sur le marché des devises. Le système de Bretton Woods prend fin.
En mai 1972, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté économique européenne (CEE), les monnaies de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et du Danemark rejoignent le Serpent monétaire. S’il est vrai que ce dispositif a permis de conserver une certaine stabilité des taux de change entre 1973 et 1977, le système connaîtra tout de même de nombreuses vicissitudes, en particulier à la suite du premier choc pétrolier de 1973. Les réactions des pays membres de la CEE à la crise pétrolière diffèrent alors très fortement, de sorte que les balances courantes deviennent déficitaires dans de nombreux pays, provoquant des tensions fortes sur les marchés de devises. Les monnaies des nouveaux pays membres sont alors exclues. Le franc français quitte le Serpent, y entre de nouveau pour en ressortir définitivement en 1976. À ce moment-là et jusqu’en 1979, seules subsistent au sein du Serpent les monnaies de l’Allemagne, du Danemark et des pays du Benelux (bloc Deutsche Mark).
Le système monétaire européen (SME)
Durant les années 1970, les fortes fluctuations des monnaies européennes, dues entre autres à la faiblesse du dollar, perturbent la mise en place du Marché commun et en particulier de la Politique Agricole Commune (PAC). Les risques liés aux taux de change limitent les bénéfices provenant des actions de l’intégration économique de la CEE. C’est pour cette raison que voit le jour une nouvelle tentative d’établir un système de taux de change un peu plus stable. Dans une action discrète, qui n’associe du côté allemand ni le Ministère des Finances ni la Bundesbank, le président Valéry Giscard d’Estaing et le chancelier Helmut Schmidt dévoilent leur plan de création d’une zone de stabilité monétaire lors d’un dîner à l’issue d’un Conseil européen à Copenhague, en avril 1978. Après de longues négociations qui aboutissent à une décision du Conseil européen de Bruxelles en décembre 1978, le SME entre en vigueur le 13 mars 1979. Le but commun de Giscard d’Estaing et de Schmidt est d’arriver à une plus grande indépendance de leur politique monétaire à l’égard des États-Unis et des fluctuations du dollar, qui renforcent les tensions entre les monnaies européennes, mais aussi de réintégrer la France dans la coopération monétaire européenne.
Cependant, les espoirs de stabilité monétaire placés dans le SME sont anéantis dès ses premières années d’existence. Le consensus de stabilité n’est pas encore aussi affermi qu’on le croit, et il faut ajuster plusieurs fois les parités des cours centraux au sein du SME. Entre 1979 et 1983, on compte sept réalignements des cours centraux des monnaies, et le mark allemand est réévalué de 30% par rapport au franc français pendant cette période. Les tensions vis-à-vis du franc ont été provoquées en premier lieu par le président François Mitterrand et son Premier ministre Pierre Mauroy, qui se tournent, après leur victoire contre Valéry Giscard d’Estaing en 1981, vers une politique interventionniste et de renationalisation des entreprises privées. Un revirement de la politique économique et financière française se dessine pourtant dès 1983. La nouvelle politique est présentée aux représentants allemands par le ministre des Finances, Jacques Delors, sous sa propre responsabilité, en échange d’une réévaluation du mark de 10% au sein du SME. Le nouveau ministre des Finances du chancelier Helmut Kohl, Gerhard Stoltenberg, nouvellement élu, n’est pas en position d’accepter une réévaluation bilatérale de cette ampleur du mark allemand. Des négociations tenaces de réalignement au sein du SME pendant deux jours mènent finalement à une réévaluation du mark de 5,5% et à une dévaluation du franc de 2,5%, le 31 mars 1983. Ce compromis du côté allemand facilite le retour de la France à l’austérité économique et à un changement profond de sa politique économique et financière, préparant, en fin de compte, l’introduction d’une monnaie commune en Europe.
Vers la monnaie unique
Néanmoins, la création de l’Union économique et monétaire (UEM) ne va pas de soi au cours des années suivantes. Le chemin est semé d’embûches et de «soubresauts» monétaires, en particulier en 1992 et 1993, lorsque la Bundesbank est tiraillée entre la lutte contre l’inflation par le maintien d’un taux d’intérêt élevé et la défense du SME par le rachat massif de francs français, au risque d’augmenter la masse monétaire. En 1992, la Buba doit soutenir le franc français pendant plusieurs mois par des interventions massives sur le marché des devises, la France refusant catégoriquement l’offre allemande d’une réévaluation du DM. C’est également le cas en 1993, alors que la parité franc-mark est devenue sacro-sainte pour la France, la politique du «franc fort» étant à l’ordre du jour depuis 1985. La Bundesbank privilégie alors clairement ses intérêts nationaux et refuse de racheter des francs français de manière illimitée. Le conflit se résout finalement par un élargissement des marges de fluctuation des monnaies de 2,25% à 15%, résultat d’un compromis entre Berlin et Paris. Ces années-là sont marquées par une collaboration étroite et confiante entre les ministres des Finances Pierre Bérégovoy et Theo Waigel.
Cette politique du «franc fort» exige cependant un rapprochement étroit entre la politique monétaire et économique de la France et celle de l’Allemagne. Le DM sert alors de monnaie d’ancrage au sein du SME. L’indépendance de la Banque de France est de plus en plus limitée, ce qui est difficile à supporter pour la France. C’est pour cette raison que l’idée d’un remplacement du DM par une monnaie commune commence à gagner du terrain en France. Cette approche trouve des échos en Allemagne, où certains souhaitent promouvoir l’intégration monétaire comme complément nécessaire du marché intérieur, une idée soutenue par les grands partis politiques et par le chancelier Kohl. Le ministre des Affaires étrangères, Hans Dietrich Genscher, propose, dans un mémorandum de février 1988, la création d’un espace monétaire européen et d’une banque centrale européenne. Celui-ci considère la politique monétaire comme le moteur de l’intégration et le vecteur de l’union politique en Europe. Ce mémorandum est à la base de la décision du Conseil européen sous présidence allemande, à Hanovre en juin 1988, qui convoque un comité, conduit par Jacques Delors (devenu entre-temps président de la Commission européenne) afin de développer un plan d’étapes vers une monnaie unique. Le rapport de ce comité, composé des présidents des banques centrales nationales, propose un schéma pour l’introduction de l’euro en 1999, après la signature du traité de Maastricht sous présidence néerlandaise, en 1993.
Cet épisode historique réfute clairement l’opinion, qui a encore cours aujourd’hui, selon laquelle l’abandon du DM était le prix que l’Allemagne devait payer pour la réunification allemande. À cette époque, en effet, personne ne prévoit la chute du mur de Berlin, en octobre 1989. Il est vrai que le processus de l’unification allemande a assuré et accéléré le chemin vers l’UEM. Mais le train était déjà sur les rails dès le printemps 1988, sous l’impulsion de la coopération franco-allemande.
L’entente étroite n’empêche pas une tension spectaculaire entre les deux pays à l’occasion de la nomination du premier président de la Banque centrale européenne (BCE), en mai 1998. En réunion extraordinaire pendant un déjeuner du Conseil européen, les chefs d’États et de gouvernements doivent prendre les décisions finales concernant les participants à l’UEM et les membres du directoire de la BCE. La France, représentée par le président Chirac, insiste en faveur de son candidat, Jean-Claude Trichet, prétendant avoir reçu des signaux favorables de la part de la chancellerie allemande. Le chancelier Kohl, prêt à consentir au vœu du président Chirac, rencontre cependant une opposition massive du côté du ministre des Finances, Theo Waigel, et du ministre des Affaires étrangères, Klaus Kinkel, ainsi que du président de la Bundesbank, Hans Tietmeyer, menaçant d’une démission collective si le chancelier accède aux demandes françaises. Ils soutiennent plutôt Wim Duisenberg, à l’époque président de la Banque centrale néerlandaise, qui représente un petit pays. Après des négociations tenaces et tendues, un compromis est trouvé à 3 heures du matin : Duisenberg est élu, mais il s’engage à ne pas exercer son mandat pendant huit ans. Cette réunion du Conseil européen devait entrer dans l’histoire européenne comme «le déjeuner le plus long».
De même, l’adoption en 1995 du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) résulte d’un compromis entre les deux pays. L’Allemagne, auteur du pacte, est alors en position de force dans les négociations. Le secrétaire d’État aux Finances de l’époque, Jürgen Stark, aujourd’hui chef économiste de la BCE, fait clairement comprendre à ses collègues que la participation de leurs pays à l’UEM dépend de leur soutien à la proposition allemande. Celle-ci est donc adoptée avec des corrections marginales. Le seul amendement que le côté français parvient à imposer est l’addition du terme «croissance» au titre du pacte, qui devient donc le Pacte de stabilité et de croissance.
L’opération de sauvetage de l’euro
Après la défaillance de la Grèce, au printemps 2010, des doutes s’installent sur les marchés financiers quant à la soutenabilité des dettes publiques de l’Espagne et du Portugal. Le plan de sauvetage grec, d’un volume de 110 milliards d’euros, n’a pas calmé les marchés. Au contraire, on est rapidement passé d’une crise de la dette grecque à une déstabilisation menaçante des marchés financiers de la zone euro. Les mêmes signes qu’après la faillite de Lehman Brothers sont réunis : taux obligataires en hausse, indices boursiers en baisse et difficultés de refinancement sur le marché interbancaire. Compte tenu de l’intégration de la Grèce au système financier européen (les seules banques et compagnies d’assurances françaises détenant des obligations grecques pour un volume de 80 milliards d’euros sur une dette totale grecque de 300 milliards), il faut alors élaborer un plan d’urgence pour éviter une implosion de la zone euro. On craint, en effet, que le risque systémique de la Grèce ne mène à un effondrement du secteur bancaire européen. Les chefs d’État et de gouvernement n’hésitent donc pas à ignorer tous les sacro-saints principes du Pacte de stabilité, sans aucune considération des règles européennes. Les ministres des Finances de la zone euro mettent en place pour trois ans un fonds doté de 440 Md€, à la disposition des pays membres de la zone euro en cas de difficultés graves. Son financement sera assuré par des emprunts sur les marchés financiers garantis par les gouvernements des pays de la zone euro ; la part allemande de 150 Md€ équivaut aux dépenses sociales du gouvernement fédéral, et la part française s’élève à 112 Md€. Par ailleurs, la BCE décide de racheter des titres de dettes publiques de pays fragilisés de la zone euro, jouant ainsi le rôle du prêteur en dernier ressort, en achetant dorénavant sur le marché secondaire des emprunts d’États en difficultés qu’elle ne voulait, jusqu’à présent, même pas accepter comme garantie pour les crédits concédés aux banques d’affaires. Cela permet aux banques et aux investisseurs de se délester de ces actifs «toxiques». Si la Grèce n’est pas en mesure de rembourser ses emprunts à l’échéance, ce sera aux pays membres de la zone euro d’assumer le service de sa dette. En fin de compte, ce ne sont donc pas les propriétaires des banques, c’est-à-dire les actionnaires, qui subiront les conséquences de la politique budgétaire des pays surendettés, mais les contribuables des pays stables. Les turbulences de mai 2010 sur les marchés financiers ne représentent pas une crise de l’euro, mais plutôt une crise de l’endettement d’État.
Après cette opération d’urgence, le président Sarkozy estime avoir atteint 97% de ses objectifs. Le point de vue de la chancelière allemande est différent : elle a obtenu une opération intergouvernementale sans créer de nouveaux fonds communautaires, une date d’expiration du fonds fixé à trois ans et la participation du Fonds monétaire international au fonds de «sauvetage» pour l’euro. Ce compromis ne masque pas les divergences profondes de vues qui subsistent entre les deux pays. Pierre Lellouche, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, se félicite d’avoir changé en un week-end les règles de Maastricht, qui existent depuis vingt ans ! Pour la France, il est naturel que l’article 125 du traité (clause de non-renflouement) s’incline devant l’urgence et l’exigence de solidarité politique2. Au contraire, pour le Pr Hans-Werner Sinn, président du réputé Institut de recherche économique allemand, l’opération de sauvetage de l’euro représente un risque incalculable pour l’Allemagne et un frein à la croissance. Selon lui, ce n’est pas l’euro qui était en danger, mais les créanciers des emprunts des États surendettés, c’est-à-dire les banques3. Cinq professeurs et économistes allemands déposent d’ailleurs un recours devant la Cour constitutionnelle allemande contre le prétendu plan de soutien à la Grèce, dénonçant le caractère «putschiste» des décisions adoptées. Ainsi, l’opération de sauvetage de l’euro a commencé par une lourde hypothèque sur la coopération franco-allemande.
Les institutions franco-allemandes de coopération
La coopération franco-allemande a été scellée par le traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, puis ratifié par les deux Parlements. Un Conseil économique et financier franco-allemand, créé à l’initiative du Premier ministre Jacques Chirac, le 22 janvier 1988, est inséré par un protocole additionnel au traité de l’Élysée et par conséquent ratifié. Il vise à renforcer et approfondir la coopération économique et monétaire entre les deux pays. Ses membres sont les ministres des Finances et de l’Économie, ainsi que les gouverneurs des banques centrales.
Selon le protocole, le Conseil devrait se réunir quatre fois par an et faire un rapport aux Conseils des ministres franco-allemands qui se réunissent deux fois par an. Les doutes initiaux de l’Allemagne, selon lesquels la France aurait eu l’intention d’influencer la politique économique, en particulier monétaire, sont intégrés au protocole, qui prévoit un objectif consistant à «examiner et coordonner aussi étroitement que possible» ces différents domaines ; le Conseil n’est donc pas en mesure de prendre des décisions, et l’indépendance de la Bundesbank n’a jamais été compromise par ses travaux. Au total, il y a aujourd’hui dix forums de coopération franco-allemande, dont, entre autres, un forum de coopération entre les Parlements français et allemand.
Les réactions franco-allemandes à la crise financière
Des structures différentes
La faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, événement souvent considéré comme le début de la crise financière généralisée, a lieu sous la présidence française de l’Union européenne. Cette période est marquée par maints malentendus, mais aussi par de nombreuses convergences franco-allemandes. Le président français se plaît dans son rôle de gestionnaire de crise, mais un certain nombre de ses initiatives se heurtent à des hésitations, voire à des refus allemands : plan européen de sauvetage de banques, ampleur du plan de relance, opportunité d’un gouvernement économique de la zone euro, fonds souverains européens4. Ces réticences allemandes se renforcent lors du sommet européen du G4, le 4 octobre 2008 à Paris, puis s’atténuent lors du sommet de la zone euro convoqué par le président français pour trouver un accord sur un plan de maîtrise de la crise financière. In fine, le Conseil européen adopte, vers la fin de la présidence française, un plan de relance européen de 200 Md€ pour 2009 et 2010, ce qui représente 1,5% du PIB de l’UE.
C’est principalement sur la dimension macroéconomique de la crise que les différends franco-allemands quant aux mesures adoptées apparaissent, bien que les deux gouvernements interviennent selon les mêmes modalités pour soutenir le secteur bancaire. Ces divergences s’expliquent en premier lieu par des situations différentes pour les deux pays avant la crise.
La France entre dans la crise financière avec des déficits budgétaires structurels de presque 4% de son PIB5 (le déficit le plus élevé de la zone euro après celui de la Grèce), malgré un environnement économique favorable, ce qui est en pleine contradiction avec la philosophie du Pacte de stabilité et de croissance. Ni la Commission ni le Conseil n’interviennent. Dès le début de la crise, la marge de manœuvre française pour des mesures anticycliques est limitée et le déficit explose à 8% en 2009 et en 2010. De son côté, l’Allemagne entre dans la crise financière avec un budget équilibré, de sorte que le déficit budgétaire ne dépasse pas 3% en 2009 et 5% en 2010.
La croissance allemande est tributaire de son commerce extérieur, tandis qu’en France elle est soutenue par la consommation des ménages ; la contribution de la balance commerciale à sa croissance est négative depuis 2002. Par conséquent, l’Allemagne subit de plein fouet le recul de la demande mondiale et est davantage forcée de réagir que la France.
Enfin, les structures du secteur bancaire dans les deux pays sont bien différentes. En Allemagne, presque la moitié des institutions bancaires sont de droit public, en particulier les caisses d’épargne et les Landesbanken, dont les propriétaires sont des communes et des gouvernements de Länder. Or, ce sont ces Landesbanken qui subissent les plus de grosses pertes, tandis que parmi les banques privées durement touchées ne figurent que la banque hypothécaire Hypo Real Estate et la Commerzbank. Hypo Real Estate doit être nationalisée à 100%, la Commerzbank à 25%. En France, le pourcentage des banques privées est beaucoup plus élevé, et elles subissent moins de pertes que les banques allemandes.
Des réactions divergentes
C’est en raison de ces divergences apparues avant la crise que les réactions à la crise financière mondiale diffèrent dans les deux pays. En soutien à sa demande interne, l’Allemagne met en place un second plan de relance de 50 Md€, après un plan initial de 32 Md€, critiqué par le président français pour sa faiblesse («La France agit, l’Allemagne réfléchit», aurait-il dit). Les réticences de la chancelière allemande s’expliquent par les expériences défavorables que l’Allemagne a connues, dans les années 1970 et 1980, avec des plans de relance qui n’ont eu pour effet que d’allumer des feux de paille. Si l’on ajoute aux mesures de relance la création d’un fonds spécial de 100 Md€ accordant des crédits et des garanties à des entreprises de production (Deutschlandfonds), on arrive à des stimuli discrétionnaires de 4,1% du PIB, selon les données de la Commission européenne pour 2009 et 2010, ce qui dépasse largement la norme moyenne du plan de relance européen de décembre 20086. Pour la France, les chiffres correspondants s’élèvent à 3% du PIB. L’un des rares points sur lesquels les deux gouvernements s’accordent est de ne pas abaisser la TVA, option choisie par la Grande-Bretagne.
Les plans d’aide aux banques reflètent également les spécificités nationales du secteur bancaire. En Allemagne, les prises de participation de l’État sont plus élevées que les mesures de recapitalisation en France. Elles augmentent le ratio de la dette publique sur le PIB de 2 points en 2008 et de 4 points en 2009, selon les calculs de la Commission européenne7, alors que ces chiffres sont en France de moins de 1 ces mêmes années.
Les garanties en faveur du secteur bancaire sont restées dans les deux pays en-dessous de 1% du PIB en 2009 et 2010, mais sont montées en Irlande à 200% du PIB, toujours selon les données de la Commission.
Les deux pays rapprochent leurs points de vue sur la réforme de la régulation financière dans le cadre des réunions du G20. La chancelière Merkel et le président Sarkozy se disent favorables à l’introduction d’une taxe bancaire et à la création d’une taxe sur les transactions financières ; ils défendent ensemble leurs idées lors du G20, fin juin 2010 au Canada. Ils s’opposent également à la volonté américaine de reporter la régulation financière et de poursuivre une politique de déficits budgétaires, et ils indiquent leurs attentes dans une lettre commune adressée au président américain Barack Obama.
Par rapport aux divergences du début de la crise financière, ce sommet est donc l’occasion d’entamer un renouveau de la coopération franco-allemande, en partageant le leadership européen sur la scène internationale en matière de régulation financière.
Les dégâts collatéraux de la crise financière et économique
Une dégradation préoccupante des finances publiques
La crise financière et économique de 2008 a laissé des traces profondes dans les économies des pays de l’UE et du reste du monde. La Pologne est le seul pays où le PIB a cru de 1%, tandis qu’il a chuté fortement dans tous les autres pays européens, en moyenne dans l’UE de 4,2% par rapport à l’année antécédente : en France de 2,2%, en Allemagne de 5% et en Lettonie de 18%. Le taux de chômage moyen dans l’UE a augmenté de 2% pour arriver à 9%, et atteint 18% en Espagne.
Dans l’ensemble, les États membres prennent des mesures de soutien conjoncturel en 2009 et 2010, de l’ordre de 3% du PIB en moyenne selon les statistiques de la Commission européenne (4,1% en Allemagne et 3% en France). Ainsi, l’Allemagne fait plus que répondre aux exigences de ses partenaires et contribue au-delà de la moyenne de l’UE à la stabilisation de la situation économique en Europe.
En raison de l’effet contracyclique conjoncturel des stabilisateurs automatiques, des mesures fiscales discrétionnaires de stabilisation, mais aussi du soutien massif apporté au secteur financier, la situation des finances publiques s’est fortement dégradée en 2009 dans presque tous les États membres de l’UE. Selon les données de la Commission européenne, le déficit total de l’UE devrait tripler à 7% du PIB et atteindre 7,5% en France (soit une multiplication par plus de deux) et 3% en Allemagne (après un budget à l’équilibre en 2008). Les prévisions laissent augurer d’une légère augmentation des déficits pour la France et pour l’Allemagne en 2010.
Selon la moyenne de l’UE, les dettes des États sont appelées à croître de 12 points en 2009 et de 18 points en 2010 par rapport à 2008. La Commission européenne a lancé une procédure de déficit excessif à l’encontre de 24 des 27 États membres.
Le ratio de la consolidation budgétaire
Banque centrale européenne, Bulletin mensuel, septembre 2010, pages 85-86.
Il ne fait pas de doute que la forte détérioration des finances publiques nécessite des mesures correctives de stabilisation afin que l’activité économique ne soit pas menacée. Il faut par ailleurs prendre en compte les répercussions du développement démographique et du changement climatique sur les finances publiques dans ce débat sur les effets d’un redressement sur la croissance économique.
Pour l’Allemagne, il n’y a pas de conflit entre la consolidation budgétaire et la croissance économique. Il est vrai qu’à court terme l’assainissement budgétaire réduit la demande interne, ce qui a une incidence négative sur la croissance. Mais parallèlement, la mise en œuvre de réformes budgétaires structurelles renforce les anticipations de croissance future, induisant des réactions économiques susceptibles de compenser les effets sur la demande à court terme8. Si l’État se met à épargner (en réduisant ses dépenses), les ménages et les entreprises pourront dès lors consommer et investir davantage. Les attentes des acteurs économiques et des marchés financiers à l’égard d’un retour à l’équilibre des finances publiques pouvant les conduire à cela, un consensus s’est établi entre la France et l’Allemagne pour encourager ainsi la croissance économique. Sans cette perspective, les consommateurs et les entreprises devront s’attendre, tôt ou tard, à des augmentations d’impôts, les citoyens ayant clairement compris que les dettes d’aujourd’hui sont les impôts de demain ; ils réduiront donc leurs dépenses de consommation et d’investissement. Les marchés financiers suivent l’évolution des risques budgétaires avec attention et exigeront des primes de risque plus élevées pour leurs placements financiers. Une pression à la hausse des taux d’intérêt sur les marchés des capitaux handicapera les investissements des entreprises.
En revanche, une consolidation budgétaire durable fait baisser les taux d’intérêt en assouplissant le service de la dette d’État, ce qui soutient à son tour le redressement des finances publiques. Le cercle vertueux qui se met en marche a été clairement confirmé par des données empiriques. Récemment, les obligations de l’État allemand à échéance de cinq ans ont pu être émises avec un taux d’intérêt de 1,5%, soit le niveau le plus bas de l’histoire allemande. A l’est du Rhin, on ne voit aucune raison pour que la France ne puisse pas également profiter de ce cercle vertueux.
La consolidation budgétaire est donc une condition préalable à une croissance économique durable. Cette affirmation est également confirmée par l’expérience allemande. En 2003, l’ancien chancelier Schröder a lancé son Agenda 2010, qui prévoyait des réductions des dépenses sociales et des mesures visant à flexibiliser le marché de travail. Cette politique, qu’il a menée contre l’opposition de son propre parti, a eu deux conséquences. D’une part, la croissance économique a atteint 3% en 2006-2007, un chiffre rare pour l’Allemagne. D’autre part, il a été battu par Angela Merkel lors des élections législatives à une très courte majorité. De ce fait, on peut tirer une autre conclusion : une politique de réformes devrait être introduite en début de mandat, car le timing est crucial pour le succès des réformes impopulaires.
La politique financière dans l’UEM
En outre, des politiques budgétaires saines et soutenables constituent une nécessité indispensable, en particulier pour l’Union économique et monétaire européenne (UEM). L’UEM dispose d’un cadre d’action institutionnel unique, qui combine une politique monétaire centralisée au niveau supranational et une politique financière décentralisée relevant de la compétence des États membres, mais qui se doit d’être étroitement coordonnée avec la première9. La différence fondamentale par rapport à d’autres zones monétaires, comme celle des États-Unis, repose dans la prédominance, en Amérique du Nord, de l’État central, alors que le budget de l’UE se situe au niveau d’un peu plus de 1% du PNB de l’Union européenne, ce qui à cet égard, est insignifiant.
Le bon fonctionnement de l’UEM suppose donc l’interaction sans heurts et efficace entre politique financière et politique monétaire, ce qui exige de la discipline budgétaire. Une augmentation excessive de l’endettement public, en particulier des grands États membres, peut enclencher des pressions inflationnistes et une augmentation de la demande pouvant contraindre la Banque centrale européenne (BCE) à maintenir des taux d’intérêt à court terme à un niveau plus élevé que s’il n’y avait pas d’endettement public excessif10. L’augmentation des taux d’intérêt n’est pas sans incidence sur les investissements privés, et peut ainsi freiner la croissance économique. Sur le plan politique, ce n’est plus la politique budgétaire des États membres qui est alors rendue responsable de la perte de croissance, mais la politique des taux d’intérêt de la BCE. Son indépendance et la garantie qu’elle apporte à la stabilité des prix se trouvent dès lors menacées. Il est donc crucial de maintenir l’équilibre des finances publiques pour un meilleur fonctionnement de l’UEM et pour la stabilité de l’euro.
D’autre part, une coordination des politiques budgétaires en vue d’une plus grande stabilité au niveau communautaire est nécessaire puisque des politiques budgétaires incontrôlées peuvent favoriser les déficits. En adhérant à la zone euro, le lien existant entre l’État membre qui entretient des déficits budgétaires et les réactions des marchés financiers est rompu. Les mécanismes d’adaptation des marchés à une politique budgétaire laxiste, comme la dévaluation, le risque inflationniste et la hausse des taux d’intérêt, sont affaiblis dans l’UEM, voire complètement neutralisés. Un pays membre peut alors, le cas échéant, financer ses dettes à un taux d’intérêt largement déterminé par les conditions macroéconomiques de l’UEM sans prime de risque adaptée au pays concerné, ce qui permet de poursuivre une politique de déficits excessifs. De même, l’UEM peut créer des incitations à s’endetter à l’excès, si le pays ne se considère pas comme seul responsable de la solidité de ses finances publiques, mais peut compter, en cas de difficultés financières, sur la solidarité des autres membres contraints d’intervenir en tant que «prêteur en dernier ressort» de la Communauté. Celle-ci passerait alors du rôle d’union monétaire à celui d’union de transferts. Si ces incitations au laxisme financier ne sont pas fortement limitées, elles peuvent se renforcer mutuellement et entraîner une forme de contagion à l’ensemble des pays de l’UEM; contagion marquée par la hausse des déficits budgétaires, celle des taux d’intérêt sur le marché des capitaux et, au final, par une fragilisation de leurs finances publiques.
C’est pour prévenir le risque d’un comportement de free rider (resquilleur) ou d’effets spill over (effets d’engrenage) que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (nom officiel du traité de Lisbonne), interdit expressément le financement des dettes publiques par la Banque centrale ; la clause qui prévoit que ni la Communauté ni les États membres ne répondent des engagements des autres États membres (ce que l’on appelle no bail out clause ou clause de non-renflouement) a un caractère préventif, tous les États membres étant tenus d’éviter les déficits budgétaires excessifs. Le traité lui-même et le droit dérivé découlant du Pacte de stabilité et de croissance offrent un cadre de surveillance budgétaire efficace.
Le bon fonctionnement de l’UEM exige des règles strictes pour la politique budgétaire et un large renoncement à la souveraineté nationale en matière budgétaire. L’Allemagne a satisfait cette exigence en ancrant son frein à l’endettement dans sa Constitution. En France, en revanche, le politique prévaut, et il paraît donc inacceptable de subordonner les choix politiques à une règle budgétaire contraignante. Ceci est une source importante de différends entre la France et l’Allemagne. Pour les Allemands, le bon sens économique interdit tout compromis ; la stabilité de l’euro et la pleine autonomie budgétaire nationale sont inconciliables.
Options pour la consolidation budgétaire
Richard Kogan, Will the tax cuts ultimately pay for themselves? Center on Budget and Policy Priorities, Washington, mai 2003
Le consensus règne quant à la nécessité de mettre en œuvre des mesures correctives à l’encontre de la dérive des finances publiques. Se pose toutefois la question de savoir comment les gouvernements peuvent mettre en place des dispositifs visant à stabiliser les soldes budgétaires.
Le rétablissement des équilibres devrait être abordé de préférence sous l’angle des dépenses ; même si, le plus souvent, une telle démarche n’a d’effets que sur le long terme, elle reste très favorable à la croissance. Compte tenu du niveau actuel de la pression fiscale en Europe, l’effort d’assainissement devra passer par une meilleure maîtrise des dépenses publiques. Une telle politique a d’ailleurs été particulièrement efficace dans le passé, comme le montrent les exemples irlandais et danois dans les années 1980, lorsque ces pays ont atteint des taux de croissance supérieurs à la moyenne et des taux de chômage en recul; à l’inverse, la Belgique et la Suède sont trop intervenues sous l’angle des recettes, de sorte que les prélèvements sociaux et fiscaux ont porté atteinte aux perspectives d’emploi et à la croissance. Ceci ne signifie pas qu’il faille réduire systématiquement toutes les dépenses. Les dépenses de formation, de recherche, ainsi que les investissements dans les infrastructures favorisent la croissance et devraient donc être exclues des restrictions. L’impératif d’un assainissement des finances publiques par la réduction des dépenses vaut en particulier pour la France, où celles-ci représentent 55% du PIB, un record pour les pays de l’UE qui n’est égalé que par le Danemark. Une augmentation des impôts et des charges sociales affaiblirait en revanche les déterminants économiques et influencerait négativement la compétitivité internationale et la croissance potentielle. En revanche, en cas d’allègements d’impôts sans contrepartie dans les dépenses, les effets de remboursement possibles ne combleraient pas, selon des études empiriques11, une hausse du déficit. Les Reaganomics pratiquées aux États-Unis dans les années 1980 ont montré que les allègements financés par crédit d’impôts ne conduisent pas efficacement à l’objectif recherché. Aujourd’hui, aggravant cet état de fait, la crise économique et financière a entraîné une diminution des bases d’imposition, et par conséquent une chute des recettes fiscales.
Le gouvernement économique européen comme alternative institutionnelle
En raison des interdépendances renforcées entre les économies nationales de l’UE, un besoin considérable de coordination existe. La crise grecque, en secouant l’UEM, a mis en évidence les failles dans la surveillance budgétaire et économique des États de la zone euro et a conduit à une certaine renaissance de l’idée traditionnelle française, jamais concrétisée, de doter l’UE d’un gouvernement économique ou d’une gouvernance économique. Cette conception française a longtemps été contrée par l’Allemagne, qui y voyait une tentative d’ériger un contrepouvoir politique face à la politique monétaire totalement centralisée de la «technocratique» BCE, de remettre en cause son indépendance pour influencer sa politique monétaire et ses taux de change, et d’exercer à l’échelle de l’UE une politique budgétaire et économique.
Cette idée fondamentale méconnaît, de l’avis de Berlin, les principales règles de fonctionnement de l’UEM. Avec le transfert complet de la conduite des politiques monétaire et de change au niveau communautaire et la mise sous contrainte des politiques budgétaires nationales aux règles du Pacte de stabilité et de croissance, les États nationaux n’ont plus beaucoup d’instruments pour agir. Or, il est tout aussi important de laisser aux États membres la responsabilité d’instruments politico-économiques pour leur permettre de prendre des mesures adaptées à leur pays, contracycliques ou face à des chocs exogènes. Avec une large communautarisation des paramètres politico-économiques, les disparités économiques s’aggraveraient, les forces centrifuges pourraient se déchaîner et même, au final, remettre en question la cohésion de l’Union monétaire. En Allemagne, on ne comprend pas alors comment un gouvernement économique européen pourrait exercer une pression plus efficace pour éviter des dérapages budgétaires et économiques.
Un compromis, plus verbal que de fond, a été trouvé récemment. Pour la chancelière allemande, le gouvernement économique sera organisé à l’échelle du Conseil européen des 27 pays membres, sans créer d’obligations propres à la zone euro. Le président français a obtenu qu’on entérine la pratique qui veut que les dirigeants de l’Eurogroupe ne se réunissent «qu’en cas de nécessité», selon l’expression incertaine utilisée par les deux dirigeants.
La contrepartie des déséquilibres massifs, en particulier des pays du Sud de l’Europe, réside dans les excédents commerciaux allemands. De plus en plus, l’Allemagne est la cible de critiques de la part de ses partenaires européens. On la qualifie de «Chine de l’Europe». Elle devrait abandonner sa modération salariale, consommer et investir davantage12. Cette opinion oublie que le gouvernement allemand ne peut pas poursuivre une politique salariale, puisque les augmentations des salaires sont le résultat des négociations entre le patronat et les syndicats, sachant que le pouvoir de ces derniers est de plus en plus affaibli à cause de l’érosion des conventions collectives en faveur d’accords individuels d’entreprise. Ce sont les ouvriers qui dictent aux syndicats leur politique salariale, une pratique inimaginable en France. En outre, les excédents de la balance commerciale trouvent leur contrepartie dans les sorties de capitaux contribuant au financement des investissements à l’étranger. Les déficits des investissements directs allemands vers la France et d’autres pays en sont la preuve. Ce capital a manqué en Allemagne, baissant le taux d’investissement privé au niveau le plus bas de tous les pays de l’OCDE et le taux de croissance économique à un niveau inférieur à celui de la France13. Les critiques formulées en France à l’encontre des politiques économiques menées par l’Allemagne prouvent de nouveau le malentendu profond entre les doctrines économiques des deux pays.
Etats-Unis et Japon : La bombe à retardement
États-Unis : dette et dépendance internationale
Niall Ferguson, An Empire at Risk, Newsweek, 28 novembre 2009
Les séquelles de la crise financière révèlent également des défis historiques en matière d’assainissement des finances publiques pour d’autres pays. Les États-Unis et le Japon sont confrontés à des déficits budgétaires colossaux, respectivement de 13% et 9% de leur PIB en 2010.
Maints experts prédisent déjà le déclin des États-Unis et la fin du siècle américain du fait des problèmes de financement de la dette d’État14. Selon les prévisions du Congressional Budget Office, les déficits devraient décli- ner à environ 3% en 2012, mais rester à ce niveau les années suivantes. Par conséquent, la dette d’État continuera à grimper, et devrait atteindre 68% du PIB en 2019. Même si les Américains arrivaient à maintenir le statu quo, les paiements d’intérêts devraient monter de 8% à 17% en 2019. Dès 2010, seuls 60% du budget américain seront couverts par les impôts, le reste devant être financé par l’endettement. Si l’on prend en compte les charges budgétaires dues au vieillissement de la population, le ratio de la dette pourrait exploser à 435% du PIB en 2050 selon des prévisions récentes de l’agence de notation Standard & Poor’s.
Le point le plus sensible reste cependant la dépendance internationale des États-Unis, dont les échanges économiques avec le reste du monde sont déséquilibrés. Depuis trente ans, l’Amérique consomme plus qu’elle ne produit. Le maintien du déficit commercial n’est possible que grâce à des afflux de capitaux étrangers, mais ceux-ci ont fait de ce pays le plus grand débiteur au monde. Le principal créancier est la Chine, qui détient environ un quart des obligations à long terme de l’État américain. Les achats ont été financés par les réserves monétaires, qui ont explosé du fait des interventions chinoises sur le marché des devises pour empêcher une réévaluation de sa monnaie. Cette relation symbiotique paraît fonctionner de manière parfaite : les États-Unis épargnent moins et consomment beaucoup ; en Chine, c’est l’inverse.
Cette surabondance de l’épargne asiatique a empêché une montée des taux d’intérêts en dollars, ce qui a facilité la consommation publique et privée et le boom de l’immobilier en Amérique; ce dernier phénomène a à son tour aggravé le déficit commercial. La poursuite de la politique américaine d’expansionnisme monétaire et budgétaire ne peut que nourrir les attentes inflationnistes des détenteurs de dollars, qui demanderont, tôt au tard, une prime de risque plus élevée sur leurs placements en dollars. Vu la croissance exponentielle de la dette américaine, chaque montée des taux d’intérêt risque d’alourdir la dette fédérale.
L’histoire démontre que des dettes d’État explosives peuvent avoir des effets considérables sur les relations entre les puissances. Les conséquences géopolitiques, militaires et monétaires sont claires. L’influence de la puissance mondiale des États-Unis devrait décliner. Il est également possible que l’époque du dollar comme seule monnaie de réserve touche à sa fin, à l’instar de la livre sterling au début du xxe siècle. La dette colossale du Royaume-Uni dans la première moitié du siècle dernier avait provoqué une longue agonie de la monnaie britannique comme monnaie de réserve. C’est pour cette raison que nombre d’experts prédisent la fin de l’empire américain. Les distorsions entre les puissances internationales en faveur des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) donnent à l’Europe une chance historique de prendre la place qui lui revient dans l’ordre mondial. Ceci impliquerait cependant des finances saines de l’Europe dans son ensemble et que le Vieux Continent soit prêt à prendre ses responsabilités. Le tandem franco-allemand pourrait alors jouer un rôle de précurseur au sein de l’UE.
Le Japon : une situation financière préoccupante
Kai A.Konrad, Holger Zschäpitz, Schulden ohne Sühne ? Warum der Absturz der Staatsfinanzen uns alle trifft, München 2010, p. 65 ff.
La situation du Japon est également préoccupante, mais moins dramatique malgré une dette d’État de 200% du PIB (soit presque le double de la Grèce). Les prévisions de Standard & Poor’s sont alarmantes : l’endettement pourrait atteindre 750% du PIB en 2050 si aucun revirement radical n’intervient dans la politique budgétaire. La situation est donc fragile : les dettes s’élèveraient à 11000 milliards de dollars, et une augmentation des taux d’intérêts de 1 point alourdirait le service de la dette de 100 milliards. Le placement des obligations ne rencontre pour l’instant pas de problèmes. Les détenteurs des obligations libellées en monnaie nationale sont des investisseurs japonais institutionnels et privés. Malgré un taux d’intérêt de 1%, le rendement est positif du fait de la déflation. En outre, le taux d’épargne des ménages est toujours élevé, de sorte que le gouvernement n’a pas besoin de recourir à l’épargne étrangère. L’excédent de la balance commerciale de 3% du PIB fait entrer chaque année 150 milliards de dollars au Japon. Les réserves monétaires dépassent 1.000 milliards de dollars. Selon les calculs de l’OCDE, la dette nette du Japon se réduit donc à 100% de son PIB15.
D’autre part, le recul du taux d’épargne des ménages devrait s’accélérer si la population âgée veut conserver son niveau de vie et dépenser son épargne. Par ailleurs, le pourcentage des jeunes par rapport à la population totale continue de régresser. Tôt ou tard, la question se posera donc de savoir qui absorbera l’endettement de l’État. Les marchés financiers étrangers commencent déjà à s’inquiéter de cette évolution. Il ne fait pas de doute qu’ils demanderont des taux d’intérêt plus élevés pour couvrir le risque lié au taux de change si le gouvernement nippon commence à solliciter les marchés financiers étrangers. Un redressement des finances publiques au Japon n’est pas perceptible. Dans l’ensemble, une situation critique similaire à celle des États-Unis n’est plus à exclure à moyen terme : la suprématie industrielle japonaise des années 1970 et 1980 pourrait s’effondrer définitivement.
La sortie de crise
La réforme du Pacte de stabilité et de croissance
Jacques Delpla, Réduire la dette grâce à la Constitution, Fondation pour l’innovation politique, 2010
La situation des marchés financiers s’est stabilisée à l’automne 2010 après les tempêtes du printemps et de l’été. Cette accalmie ne doit pas être prise pour un retour à la normale. Les problèmes d’endettement des Etats ne sont nullement résolus. Avec l’installation du filet de sécurité d’un montant de 750 milliards d’euros en mai, on n’a fait que gagner du temps pour renforcer le Pacte de stabilité et de croissance.
Plusieurs possibilités de réforme ont été présentées. La Commission européenne a proposé fin septembre des mesures rendant automatique le déclenchement des sanctions contre un État incapable de respecter ses engagements budgétaires. Mais les États membres réunis dans un groupe de travail, direction du nouveau président permanent du Conseil européen, se sont prononcés pour un automatisme mixte, reprenant ainsi le compromis entre la chancelière Merkel et le président Sarkozy lors de leur rencontre à Deauville, le 18 octobre 2010. Des sanctions financières seront donc déclenchées automatiquement si elles ne sont pas rejetées par le Conseil à la majorité qualifiée (majorité qualifiée renversée). En revanche, la procédure de déficit excessif elle-même ne peut être ouverte que si elle est votée à la majorité qualifiée du Conseil européen. Quelques pays membres disposant d’une minorité de blocage pourraient contrecarrer cette décision. Comme c’est le cas actuellement, il revient alors aux États de décider eux-mêmes de se sanctionner, ce qui ne s’est jamais produit, rendant de facto caduc le Pacte de stabilité, car tant que la procédure n’est pas déclenchée, un débat sur les sanctions est obsolète.
Cet accord ne confirme que la situation juridique actuelle. Le talon d’Achille du traité n’a pas été éliminé. La Grèce, en dix ans d’intégration à la zone euro, a dépassé neuf fois la marge de 3% du PIB, le Conseil n’ayant réagi qu’une seule fois, qui plus est sous la pression des marchés financiers. Les pays ne respectant pas les règles budgétaires européennes ont fonctionné sous forme de cartel. La chancelière allemande a été sévèrement critiquée par d’autres pays membres, des députés du Parlement européen et même par le ministre des Affaires étrangères, son propre partenaire de coalition, pour la concession qu’elle a faite au président français. L’avenir dira si la première pierre pour une stabilité durable de l’euro a été posée le 18 octobre 2010…
Ainsi, le «compromis» franco-allemand reflète parfaitement la différence profonde dans la conception de l’État entre les deux pays. La France veut conserver un contrôle politique sur les sanctions, ménager des marges de manœuvre aux États avant d’aller vers ces sanctions, en vertu du principe selon lequel le politique ne doit pas abdiquer devant les règles. L’Allemagne veut éviter que la discipline budgétaire ne devienne le jouet des opportunités politiques. Avec 27 États membres et des mandats de gouvernement entre quatre et cinq ans, des élections législatives ont lieu presque tous les deux mois au sein de l’UE. L’Union est en campagne électorale permanente, un contexte peu propice à la prise de mesures impopulaires. Le caractère unique de la zone euro comme union monétaire, avec une politique centralisée et des politiques fiscales décentralisées, exige des règles fiables pour une rigueur budgétaire. Pour l’Allemagne, il s’agit d’une question de bon sens économique et non du reflet d’une rigueur «prussienne». Cependant, l’accord de Deauville a également permis de prouver la bonne disposition à des compromis de part et d’autre.
Sur le plan national, l’Allemagne s’est subordonnée, de son propre gré, à une règle budgétaire contraignante, le fameux «frein à l’endettement», qui interdit des déficits structurels dépassant 0,35% du PIB à partir de 2016. En Allemagne, on constate avec beaucoup d’intérêt que la discussion en France sur des règles correspondantes a commencé16. Outre l’Allemagne, de nombreux pays européens ont déjà introduit des contrôles budgétaires nationaux. Étant donné le refus de la France de se subordonner aux règles européennes, on n’attend pas l’introduction d’une règle budgétaire nationale dans l’immédiat. La France se prive ainsi de la confiance des marchés financiers, en refusant d’adopter des budgets de rigueur comme celui de 2011, ce qui orienterait ses taux d’intérêt à la baisse.
Le renforcement du mécanisme de marché
Dans le passé, la pression du Conseil à Bruxelles – peer pressure – n’a pas été efficace. Les efforts de réforme du Pacte de stabilité et de croissance ne permettent pas non plus d’attendre des résultats satisfaisants pour l’instant, car ces efforts échouent à dépolitiser la procédure. En revanche, les événements du printemps 2010 sur les marchés financiers ont montré clairement qu’un mécanisme de discipline fiable et efficace était déjà disponible, à savoir le mécanisme du marché. Ce mécanisme impose des sanctions inévitables, sous forme de taux d’intérêt croissants et force les États surendettés à adopter des réformes rapides et drastiques pour consolider leur budget. Aucun État ne peut se soustraire à cette discipline. Les programmes rigoureux d’assainissement des finances publiques en Italie, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni n’auraient pas été votés par leurs gouvernements et Parlements sans la pression des marchés financiers. On pourrait s’en servir, même sans révision du traité.
Le bon fonctionnement de ce mécanisme suppose toutefois que le risque d’une faillite d’État redevienne réaliste. Afin de renforcer la discipline budgétaire imposée par les marchés financiers, une condition préalable doit être remplie, qui consisterait à ne pas pérenniser le fonds de stabilisation établi en mai 2010. S’il n’expire pas comme prévu en 2013, il créera des incitations pour les États membres chroniquement déficitaires à renoncer à tout effort de consolidation. La chancelière Merkel, elle, veut éviter que l’Allemagne ne devienne le trésorier de la zone euro et rejette l’idée lancée par la Commission européenne et d’autres États membres d’établir un fonds durable pour les pays désargentés. À Paris, on considère que ce n’est que par la garantie d’un tel fonds que l’insolvabilité d’un État membre peut être évitée. L’Allemagne propose au contraire d’installer un mécanisme de traitement des faillites d’État, pour assurer un traitement ordonné des crises dans le futur, et que le secteur privé participe aux pertes en cas de faillite d’un État, et non pas les seuls contribuables.
Les conclusions du Conseil européen du 28 octobre 2010 résultent encore une fois d’un compromis entre la France et l’Allemagne. Un nouveau mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro sera établi sans toucher à l’article 125 du traité (no-bail-out clause). Il doit se substituer, en 2013, à l’actuel Fonds de stabilisation. Angela Merkel a obtenu gain de cause sur un autre point, à savoir une procédure régulière pour les défaillances souveraines. Elle est parvenue à convaincre ses partenaires de faire supporter à l’avenir les coûts de la crise financière des États par les créanciers privés, les banques en particulier. L’implication du secteur bancaire dans ce nouveau dispositif devrait l’amener à participer aux efforts pour résoudre l’insolvabilité d’un État membre. Pour ce faire, l’Allemagne, soutenue par la France, souhaitait une modification du traité de Lisbonne, ratifiée au plus tard à la mi-2013, selon les conclusions du Conseil. Après un rééchelonnement ordonné ou un haircut des dettes publiques, l’État concerné n’aurait plus accès aux marchés de capitaux pendant des années. Dans ce cas, le recours à ce nouveau dispositif de résolution des crises serait inévitable et finalement justifié.
Le risque systémique
Wolfgang Glomb, Crise bancaire, dette publique, une vue allemande, Fondation pour l’innovation politique, Paris, juillet 2010, p. 19.
Dans ce cadre réglementaire pour une restructuration des dettes d’État – si jamais il est adopté –, les acquéreurs d’emprunts d’État assumeront in fine le risque de défaut. Ils prendront en compte ce risque et demanderont des rendements plus élevés, ce qui forcera les États à marquer un tournant dans leur politique budgétaire et économique. C’est ce mécanisme de marché qui joue pleinement son rôle disciplinaire, sans qu’il soit nécessaire de prendre des décisions politiques.
Cette discipline du marché pourrait être renforcée si la nouvelle Agence européenne de supervision bancaire imposait aux établissements bancaires qui n’ont pas observé les exigences du PSC, de détenir des capitaux propres réglementaires pour les emprunts d’État dans leurs portefeuilles17. Le risque systémique de faillite d’un État membre serait atténué, une telle faillite ne paralyserait plus l’ensemble du système bancaire en Europe, ni ne déclencherait de turbulences financières ou d’effets de contagion chez d’autres États membres. La stabilité financière de la zone euro serait alors achevée et la possibilité de chantage par un État insolvable exclue. La zone euro n’aurait même plus besoin du filet de sauvetage, comme en mai 2010, pour éviter des secousses dans l’ensemble de la zone euro. On pourrait même se demander si l’on aurait besoin d’un renforcement des sanctions et d’une révision du traité. Par ailleurs, une procédure réglementaire sur les défaillances souveraines pourrait être utile en structurant les attentes des créanciers. Enfin, la discipline du marché pourrait être encore renforcée si la Banque centrale européenne n’acceptait plus des emprunts d’État des pays en faute comme garantie pour les crédits aux banques commerciales. Les coûts de refinancement auprès de la BCE devraient monter, en augmentant le rendement nécessaire des États surendettés. Ce seraient les marchés financiers qui dicteraient la vitesse et l’ampleur des mesures d’assainissement des finances publiques. Si l’on peut douter que la France accepte un tel arbitre neutre pour l’orientation de la politique budgétaire, un compromis entre Paris et Berlin devrait être possible.
Conclusion
Andreas Schockenhoff, «La crise financière internationale et son impact sur la politique étrangère de l’Allemagne». Petit-déjeuner débat du 11 mars 2009, Comité d’études des relations franco-allemandes.
Hans Stark, « France – Allemagne : Une relation complexe », Fondation Konrad Adenauer, Paris 2010
Les turbulences de l’été 2010 sur les marchés financiers ont démontré que l’Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas. Les décisions prises lors du Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010 marquent de nouveau une étape historique pour la construction européenne. L’Europe vit une phase décisive pour son avenir. Les défis pour le tandem franco-allemand sont énormes. Sans accord entre la France et l’Allemagne, il ne se passe rien en Europe. Dans le même temps, le bilatéralisme franco-allemand prête en permanence le flanc aux critiques d’un «diktat franco-allemand», plus nuisible que profitable à l’idée européenne.
Les objectifs des deux pays ne peuvent qu’être semblables. La crise financière propose une chance unique de les réaliser ensemble. Pour l’Allemagne, trois principes sont gravés dans le marbre : la stabilité de la monnaie commune, l’indépendance de la Banque centrale, ainsi que la responsabilité de chaque État pour ses propres finances. Le refus allemand d’une zone euro inflationniste et d’une union de transferts financiers est non-négociable. L’Allemagne a connu deux périodes d’hyperinflation ; la seule unification allemande a coûté au gouvernement fédéral 1,3 billion d’euros en vingt ans, soit plus de 60% d’un PIB annuel du pays. Dans le système allemand actuel de péréquation financière, seuls trois Länder sur seize subventionnent les autres. Les intérêts du contribuable et de l’épargnant français devraient être les mêmes que ceux de leurs voisins allemands. La zone euro comme union inflationniste ou de transferts financiers serait une bombe sociale à retardement pour l’Europe. En Allemagne en particulier, la tentative de réduire la construction européenne à une union de transferts financiers risque de déclencher la montée d’un radicalisme de droite et la formation d’un parti politique à la droite de la CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands). L’Allemagne deviendrait alors ingouvernable. Le nationalisme, déjà de plus en plus populaire au Pays-Bas, en Hongrie, en Suède, au Danemark et en France, constituerait une grande menace pour l’UE.
L’euro est déjà très discrédité en Allemagne. Selon des sondages récents, 60% de la population allemande soutiennent l’idée d’une réintroduction du DM. Mais il est incontestable que la crise financière aurait pris une plus grande ampleur sans l’euro. En l’absence d’une monnaie commune, une spéculation intra-européenne aurait été beaucoup plus dangereuse et aurait réévalué le DM au détriment des exportations allemandes18.
La crise de l’euro est une épreuve pour la coopération monétaire franco-allemande. Ceci exige que Paris et Berlin renoncent à entretenir des stéréotypes qui ont cours aujourd’hui, opposant le «colbertisme borné» à la française au «néolibéralisme égoïste» à l’allemande, et qu’ils élaborent une stratégie qui n’opposerait plus le souci de stabilité à l’impératif de croissance19. C’est dans le domaine de la coopération monétaire que le besoin d’un consensus s’est fait le plus urgent, sur le plan européen comme international. Il faut des projets communs des gouvernements et des Parlements, ce que Robert Schuman appelait, en 1950, une solidarité de fait : «L’Europe ne se fait pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait.» Et c’est de nouveau, soixante ans plus tard, que le ministre fédéral des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, écrivait le 2 novembre 2010 dans une longue tribune publiée par le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung : «La France et l’Allemagne doivent être en mesure de présenter des propositions et des concepts convaincants sans se laisser guider, pour ce faire, par les voix les plus prudentes et hésitantes». Et d’ajouter que «l’entente franco-allemande est une condition nécessaire mais pas suffisante pour réaliser des progrès en matière d’intégration européenne». Il appelait ainsi les deux pays à se faire les «porte-parole de leurs voisins respectifs et à assumer un rôle charnière, pour la France en direction de l’espace méditerranéen et pour l’Allemagne en direction du Nord et de l’Est de l’Europe».


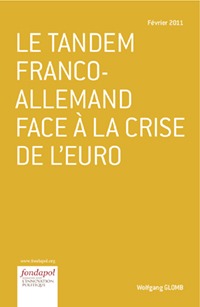



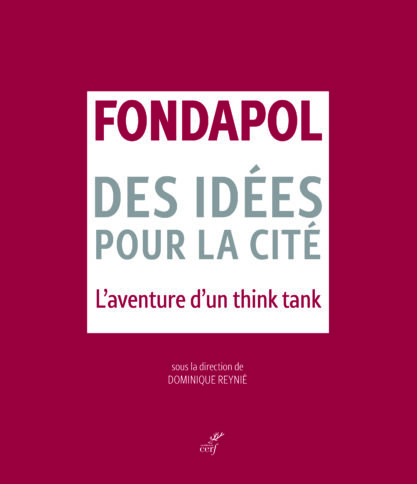



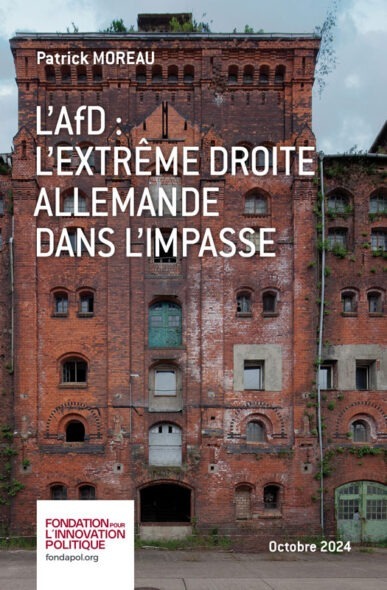



Aucun commentaire.