Où en est la droite? L’Italie
Du mouvement social italien à alliance nationale1
Un parti antisystème
L’émergence d’Alliance nationale
Un parti de gouvernement
Un nouveau parti de centre droit : Forza Italia
La naissance du « parti-entreprise »
De la révolution libérale à une redécouverte de la tradition
Un parti territorial : la ligue du nord
Politisation de la fracture Nord-Sud
Entre sécession et fédéralisme
Le peuple de la liberté, fusion de Forza Italia et d’Alliance Nationale
La naissance d’un parti unique
Une cohabitation difficile
Un parti en mal d’organisation
Une droite en difficulté
La « présidentialisation » du système politique italien
Qui vote pour le centre-droit ?
Bibliographie
Dans l’histoire de l’Italie républicaine, c’est seulement depuis 1994 que l’on fait référence à une droite politique et partisane qui s’oppose à la gauche. Pour retrouver cette distinction explicite entre une droite et une gauche, vues comme deux forces politiques en compétition, il faut remonter aux années 1861-1876, c’est-à-dire aux quinze premières années du Royaume d’Italie. La Destra Storica (Droite historique), représentée par le parti libéral, modéré – expression des aspirations et des intérêts d’une classe bourgeoise à l’époque marquée par une certaine hétérogénéité –, achève alors la construction d’une Italie unie et reposant sur le modèle de la monarchie représentative. Lui fait face au Parlement la Sinistra Storica (Gauche historique). Toutefois, ni l’un ni l’autre de ces mouvements ne prend jamais la forme de réel parti organisé; ils restent de simples rassemblements parlementaires (C. Ghisalberti, 1983). Plus qu’une réelle alternance, la défaite de la droite et l’arrivée au pouvoir de la Gauche ouvre la longue phase dite du «transformisme», où droite et gauche se confondent souvent au sein de la majorité parlementaire. La politique de Giovanni Giolitti illustre ainsi cette confusion. Selon l’historien Giampiero Carocci (2002, p. viii-ix), ce mélange entre éléments de droite et de gauche se retrouve au sein même de sa politique :
«Surtout entre 1903 et 1909 [il] mena sa politique traditionnelle de gauche, d’élargissement des bases sociales de l’État, en utilisant des instruments de droite, à savoir les tendances conservatrices, en général dominantes au sein de sa majorité de gouvernement, et la bureaucratie, conservatrice presque par définition.» Quoi qu’il en soit, durant cette phase de l’Italie libérale – c’est-à-dire du système politique antérieur à l’avènement du fascisme –, un parti conservateur réel, capable de prendre la tête de l’État, ne réussit jamais à émerger. De toute évidence, l’hostilité de l’Église à l’égard du nouvel État italien, au moins jusqu’aux premières années du xxe siècle, n’est pas étrangère à ce phénomène.
La période de l’après 1945, qui voit l’instauration de la République, reste fortement marquée par le souvenir de l’expérience fasciste, ce qui conduit à assimiler droite et fascisme. À partir de 1948, année de l’approbation de la Constitution et des premières élections législatives, le système politique italien est dominé par le centre, représenté par la Démocratie chrétienne, formation d’inspiration catholique, s’alliant, au gré des rendez-vous électoraux, avec divers petits partis. Après la nette défaite de l’Uomo Qualunque (l’Homme quelconque, un mouvement comparable au parti poujadiste en France) aux élections législatives de 1948 et sa disparition, les deux principaux représentants de la droite sont le Mouvement social italien (MSI), d’inspiration fasciste, et le Parti monarchique. Mais l’instauration de la République et l’approbation de la Constitution, qui prévoit que la forme républicaine de l’État ne peut faire l’objet d’une révision constitutionnelle, rendent ce dernier relativement anachronique, et il disparaît quelques années plus tard. (G. Mammarella 1993, p. 177)
Il faut également mentionner le petit Parti libéral italien (PLI), qui obtient des résultats relativement stables, autour de 4% à 5% des voix. En 1954, l’élection de Giovanni Malagodi au poste de secrétaire marque le renforcement de son aile la plus conservatrice, liée aux intérêts industriels et agraires, de laquelle se détachent, en 1955, les représentants d’un courant plus progressiste. Ces derniers donnent naissance au Parti radical (ibid, p. 215). Le PLI a toujours affiché des positions plutôt conservatrices, notamment sur le plan économique, cela ne l’empêchant pas, cependant, de promouvoir la laïcité et la défense des droits civiques. Toutefois, il faut souligner que le libéralisme, et plus particulièrement la conception libérale de l’État et des institutions, ont toujours constitué des tendances relativement marginales en Italie. Ce courant de pensée s’est trouvé à la fois pris en étau entre les deux doctrines – catholique et communiste –, et conditionné par l’idéalisme hégélien, introduit en Italie par Giovanni Gentile et le philosophe «libéral» Benedetto Croce. Un idéalisme qui a marginalisé des intellectuels de grande valeur, représentants d’une pensée empirique et anti-idéaliste, tels que le constitutionnaliste libéral Giuseppe Maranini. (A. Panebianco, 1995, p. ii)
Jusqu’à la crise du début des années 1990, la compétition politique se joue entre un centre inamovible – pour des raisons liées à la fois aux caractéristiques du système politique et à la position géopolitique de l’Italie –, et un parti communiste qui, bien que condamné à rester dans l’opposition, est devenu, depuis la fin des années 1960, dans une nouvelle version de la vieille politique transformiste, un interlocuteur politique de poids. Ce n’est qu’à partir des années 1990 que le paysage politique prend une physionomie radicalement nouvelle. Comme nous le verrons, au vide crée par la crise – en particulier du point de vue de l’offre politique de tendance modérée –, répond l’initiative politique de l’entrepreneur et magnat de la télévision Silvio Berlusconi. Celui-ci réussit à construire une nouvelle alliance entre le Mouvement social en cours de transformation, le parti territorial d’Umberto Bossi (Ligue lombarde, puis Ligue du Nord), qui prend alors son essor, et le nouveau parti qu’il crée en 1993, Forza Italia. Cette nouvelle alliance se positionne à droite sur l’échiquier politique, en opposition à la gauche : pour la première fois depuis la chute du régime fasciste, l’idée d’une droite politique redevient tangible.
Du mouvement social italien à alliance nationale1
Un parti antisystème
Le Mouvement social italien (MSI) est né le 26 décembre 1946, à l’initiative de quelques «entrepreneurs politiques» qui entendent donner un contour légal à des groupes nostalgiques de l’époque fasciste, apparus dans plusieurs régions d’Italie.
Idéologiquement liée à la République sociale italienne (le régime fantoche dirigé par Mussolini pendant l’occupation allemande, de 1943 à 1945), et donc au «fascisme de gauche», la droite d’inspiration fasciste fait son entrée dans le système politique – tout en restant néanmoins cantonnée à une position relativement marginale.
Le MSI se présente aux élections de 1948 avec un programme «de gauche», rejetant le modèle capitaliste au profit d’un modèle de participation des travailleurs à la direction de l’entreprise et aux profits, et opposant aux institutions libérales et démocratiques un modèle de représentation corporatiste. Cependant, l’anticommunisme fondamental du MSI justifie, aux yeux de ses dirigeants, son positionnement à droite de l’échiquier politique. Par ailleurs, dès ses débuts, il se caractérise par une critique très dure à l’encontre du système des partis. À côté du courant principal, conduit par le leader du parti, Giorgio Almirante, il faut noter que se développe également une tendance minoritaire, plus conservatrice et ouverte sur l’Occident. Le conflit entre ces deux positionnements caractérisera longtemps la vie du Mouvement social.
L’adoption de positions plus modérées permet au MSI d’ouvrir, dans les années 1950, une phase d’alliances à droite, en particulier avec les monarchistes, et de collaboration avec la Démocratie chrétienne. Cette période est cependant de courte durée et s’achève avec la chute du gouvernement de Fernando Tambroni, premier et unique gouvernement italien dirigé par les démocrates-chrétiens avec le soutien explicite du parti néofasciste (1960). S’ouvre alors une période de marginalisation pour le Mouvement social, de laquelle il ne commencera à sortir qu’à partir des années 1980. C’est l’apaisement progressif du conflit politique et idéologique, dont l’apogée se situe au cours des années 1970, qui rend possible ce dégel dans les rapports avec la droite du MSI. Le début d’une relecture moins idéologique et partisane de l’expérience fasciste, à partir des travaux de l’historien Renzo de Felice, participe également de ces changements.
Les forces politiques, en particulier les partis laïcs (c’est-à-dire extérieurs aux deux grandes doctrines : catholique et communiste), envoient par ailleurs des signaux d’ouverture et commencent à être considérées par le parti d’Almirante comme de possibles interlocuteurs. Le MSI profite aussi de sa position d’extériorité par rapport au système des partis : la polémique contre la «partitocratie», depuis longtemps cheval de bataille des intellectuels libéraux et en particulier de Giuseppe Maranini2, commence à toucher l’opinion publique et devient un argument politique d’une grande efficacité. Le parti néofasciste ne parvient pourtant pas à tirer profit de ces opportunités pour remettre radicalement en question ses valeurs de référence. À cette inertie idéologique répond, en outre, une incapacité à imaginer une nouvelle trajectoire politique et de nouvelles alliances.
La fin des années 1980 se caractérise ainsi par l’immobilisme du parti et une forte conflictualité interne. En dépit du dégel, le MSI reste donc, jusqu’au début des années 1990, un acteur politique sans réelle influence. Mais la situation évolue très rapidement entre 1993 et 1994, lorsqu‘il est confronté à la crise et aux changements soudains et radicaux qui ébranlent le système politique et partisan italien.
L’émergence d’Alliance nationale
Grâce notamment à ses critiques à l’encontre des partis traditionnels, le MSI obtient de bons résultats aux élections législatives de 1992 (les dernières de la Première République), qui voient un net recul de la Démocratie chrétienne et des résultats modestes pour les deux mouvements nés de l’ancien Parti communiste : le Parti démocratique de la gauche (PDS) et le Parti de la refondation communiste (PRC). L’année 1992 est également celle où l’on commence à parler explicitement d’une nouvelle alliance nationale à opposer à la gauche. Le politologue Domenico Fisichella, de tendance conservatrice, lance l’idée d’un nouveau rassemblement à droite. Une idée qui n’est, en fait, pas neuve, et qui correspond au projet déjà tracé, dans les années 1980, par une personnalité de premier plan du MSI, Pinuccio Tatarella. Les rencontres et les initiatives se multiplient autour de ce projet de création d’une droite plus ouverte et modérée, s’offrant comme alternative à la gauche. En avril 1993, le jeune secrétaire du MSI, Gianfranco Fini, depuis longtemps dauphin d’Almirante, fait son entrée sur la scène politique nationale et annonce la création d’une Alliance nationale pour la république présidentielle.
Cette époque est marquée, rappelons-le, par les développements de la crise du système politique et partisan italien. S’appuyant sur plusieurs consultations référendaires et sur un fort soutien de l’opinion publique, une réforme des modes de scrutin est votée pour les élections municipales et législatives. La loi électorale pour les communes instaure l’élection directe du maire. Le secrétaire du MSI, Gianfranco Fini, se présente ainsi à Rome. Au premier tour, il recueille 21,04% des voix, dans une ville où son parti affiche habituellement des scores aux alentours de 12%. Entre les deux tours, l’entrepreneur et magnat de la télévision, Silvio Berlusconi, déclare aux journalistes qu’entre Fini et son adversaire à Rome, Francesco Rutelli, candidat de la gauche, il choisirait Fini. Il envoie ainsi un signal sans ambiguïté aux électeurs : le moment est arrivé pour une coalition modérée qui fasse barrage à la gauche. Rutelli gagne au second tour, mais Fini, avec un résultat de 46,9%, a réussi à glaner les voix de nombreux électeurs centristes et modérés.
À partir de cette date, le processus de transformation du Mouvement social (même si, selon certains chercheurs, tel Piero Ignazi, ce processus n’entraîne pas une révision profonde et radicale du positionnement de ses membres) se confond de plus en plus avec les prises de position de son leader, lesquelles déroutent souvent, y compris au sein même du parti –, la référence au fascisme constituant encore, en 1990, un important ciment identitaire du MSI. (P. Ignazi 1998, p. 430)
Le résultat de Fini à Rome accélère l’essor du projet d’Alliance nationale, également servi par les bouleversements qui affectent alors le système des partis : en particulier la disparition des partis traditionnels (notamment Démocratie chrétienne et le Parti socialiste italien) et l’arrivée sur la scène politique de Silvio Berlusconi avec son nouveau parti, Forza Italia (FI). Créé en quelques semaines, ce parti va devenir le pivot d’un nouveau rassemblement associant, entre autres, le MSI sous sa nouvelle identité d’Alliance nationale.
Un parti de gouvernement
Pino Rauti ne rejoindra pas Alliance nationale, et il créera avec d’autres dissidents une formation d’extrême droite, le Mouvement social-Flamme tricolore.
Peu avant les élections de mars 1994, qui inaugureront un nouveau mode de scrutin, se tient la première convention d’Alliance nationale. En réalité, il s’agit alors moins d’un nouveau parti que d’une autre étiquette sous laquelle le MSI, auquel se sont ralliées quelques personnalités de premier plan, se présente aux élections. Cette étiquette doit donner une image renouvelée d’un parti qui s’est cependant peu réformé sur le plan idéologique. Les élections sont remportées par la coalition «à géométrie variable», entre Forza Italia et Alliance nationale, dans le Sud, et entre Forza Italia et la Ligue du Nord. AN recueille un résultat historique de 13,5%. Le MSI-AN accède pour la première fois au pouvoir, au sein du premier gouvernement Berlusconi, avec des personnalités extérieures au parti, mais également avec l’un de ses dirigeants historiques, Giuseppe Tatarella, qui devient vice-président du Conseil.
À l’occasion du débat sur le vote de confiance au gouvernement, Gianfranco Fini réalise un revirement notable en reconnaissant que l’antifascisme a représenté un passage historique essentiel pour le rétablissement des valeurs démocratiques en Italie. Ces propos contrastent cependant avec une déclaration faite peu après, qui lui vaut de vives critiques, notamment à l’étranger, par laquelle il qualifie Mussolini de «plus grand homme d’État du siècle».
En janvier 1995, à Fiuggi, le Mouvement social italien se dissout, donnant effectivement naissance au nouveau parti, Alliance nationale. Parmi les points essentiels affirmés par les thèses du congrès de Fiuggi, on retrouve l’idée que les valeurs de droite ont préexisté au fascisme, que l’antifascisme a constitué une phase nécessaire au retour des valeurs démocratiques, et qu’il est crucial, au sein de la culture politique de droite, de concilier les principes de liberté et d’autorité. À cette occasion, toutes les formes de racisme, d’antisémitisme et d’antijudaïsme sont par ailleurs reniées. La transformation du MSI en AN ne se fait pas sans conflits internes. L’ex-secrétaire du MSI (1990-1991), Pino Rauti3, dénonce l’abandon de la continuité spirituelle d’antan et le glissement vers une force libérale-démocratique et conservatrice. Beaucoup voient se dessiner, non sans une certaine inquiétude, la perspective d’un grand parti démocratique de droite, tel qu’il a été préfiguré par Pinuccio Tatarella. C’est en effet ce qui se produira plus tard, avec la naissance du Peuple de la liberté (PDL).
Il ne fait alors plus de doute que la droite est sortie de son ghetto et fait désormais partie intégrante du nouveau système bipolaire. Alliance nationale s’allie à Forza Italia aux élections législatives de 1996, 2001 et 2006, tandis que Gianfranco Fini prend ses distances avec le passé de façon de plus en plus marquée. Au congrès de Bologne, en 2002, il pose comme objectif «une droite moderne, ouverte, européenne et surtout “dialoguante”». L’année suivante, il lance une provocation qui le place en contradiction avec la Ligue du Nord, mais également avec certains dirigeants de son parti, en proposant le droit de vote des immigrés aux élections locales. La même année, il se rend en Israël. Durant ce voyage, après une visite au mémorial de Yad Vashem, il qualifie de «mal absolu» tout ce qui a conduit à l’Holocauste, ce qui inclut les décisions qui aboutirent aux lois raciales de 1938 et à l’expérience de la République sociale italienne, qui qualifiait les Juifs d’«ennemis de guerre». Retranscrites de façon simpliste, ces paroles provoquent de vives polémiques au sein de son parti et conduisent au départ d’Alessandra Mussolini (la petite-fille du Duce), qui fonde le mouvement de coalition Alternative sociale.
En 2005, à l’occasion du référendum populaire sur des dispositions de la loi 40-2004 relative à la procréation médicalement assistée – loi approuvée par le gouvernement de centre-droit –, les prises de position de Fini créent de nouvelles divisions, plus profondes encore. Cette loi avait rencontré la contestation d’une partie de l’opinion publique et du monde politique, au-delà de la seule opposition de gauche, en raison de son caractère répressif. Fini déclare, avant la tenue du référendum, qu’il répondra oui à trois sur quatre des questions posées, s’exprimant ainsi en faveur de l’abrogation partielle de la loi. Cette prise de position, en contradiction avec les idées plus conservatrices qu’il défendait lui-même jusqu’alors, marque une rupture durable dans ses rapports avec une large part des dirigeants du parti.
La fondation Fare Futuro créée en 2006 et présidée par Fini lui-même, se présente comme un lieu de réflexion voué à l’élaboration d’un nouveau projet culturel. Pour son directeur scientifique, Alessandro Campi, elle s’est fixé comme objectif de «mieux connaître (et faire connaître) l’Italie, qui s’identifie, d’un point de vue politique, au centre-droit, de faire entendre sa voix dans le débat public national, de la soustraire aux stéréotypes négatifs, voire méprisants, de la culture de gauche, d’en guider les choix et les orientations sur les grands thèmes aujourd’hui au centre de la discussion politique.» (A. Campi 2008, p. 97). Fare Futuro, qui regroupe des intellectuels et des représentants politiques proches de Fini, est cependant une entité distincte d’Alliance nationale, et les points de divergence restent considérables entre, d’un côté, les proches du président du parti et, de l’autre, les autres dirigeants et une partie des cadres et des militants, qui conservent souvent des positions plus conservatrices et traditionalistes.
En conclusion, il est intéressant de noter que la création d’AN est le résultat d’un changement de circonstances dû à des mutations plus larges de l’environnement politique. Ainsi, ce parti n’a pas été réellement en mesure d’élaborer un nouveau projet culturel. (C. Moroni 2008, p. 75-77) Pourtant, les tentatives n’ont pas manqué, en son sein, de donner forme à une autre façon de penser la droite. Celles-ci, souvent en concurrence entre elles au sein d’AN, se sont poursuivies dans le nouveau parti, le Peuple de la liberté, trouvant là de nouvelles occasions de confrontation.
Un nouveau parti de centre droit : Forza Italia
La naissance du « parti-entreprise »
Le terme pentapartito fait référence à la coalition au pouvoir dans les années 1980 : Démocratie chrétienne, Parti socialiste, Parti libéral, Parti républicain et Parti social-démocrate.
Au début de l’année 1994, à l’initiative de Silvio Berlusconi, un nouveau parti fait son entrée sur la scène politique : Forza Italia. Il vient combler le vide laissé par la dissolution de la Démocratie chrétienne, du Parti socialiste et des petits partis laïcs. Berlusconi, magnat des médias, qui compte parmi les plus riches entrepreneurs italiens et possède trois chaînes télévisées, a déjà tenté en vain, fin 1993, de convaincre les leaders des petits partis centristes issus de la DC, et le leader de la Ligue du Nord, Umberto Bossi, de créer une coalition pour s’opposer à la gauche et en particulier au PDS, l’ancien Parti communiste. Ce dernier apparaît en effet, à l’époque, comme la seule force politique capable de gagner les élections législatives.
Forza Italia se structure en quelques semaines, sa naissance ayant été précédée d’une série d’initiatives, parmi lesquelles, en septembre 1993, la création par le politologue de l’université Bocconi de Milan, Giuliano Urbani, de l’association «À la recherche du bon gouvernement». Réunissant un groupe d’intellectuels et d’entrepreneurs, cette association publie, en novembre de la même année, un fascicule intitulé : Alla ricerca del buon governo. Appello per la costruzione di una Italia vincente (À la recherche du bon gouvernement. Appel pour la construction d’une Italie qui gagne). Ce document s’inspire des thèmes de la Nouvelle Droite, représentée alors sur le plan international par Margaret Thatcher et Ronald Reagan : réduction du rôle de l’État, modernisation et simplification de la bureaucratie, déréglementation économique, rigueur budgétaire et réduction des déficits publics, allègement de la pression fiscale et rationalisation de l’utilisation des ressources publiques et de l’Etat providence.
L’ouvrage d’Urbani et de son association constitue un document de référence pour les clubs Forza Italia, lancés en novembre 1993 par Angelo Codignoni, ex-directeur de La Cinq, la chaîne télévisée créée en France par Fininvest, holding contrôlée par Silvio Berlusconi. Ces clubs, qui ne sont pas formellement intégrés dans le nouveau parti, n’en jouent pas moins un rôle de premier plan dans cette phase d’organisation du mouvement. La première convention de FI se tient à Rome, le 6 février 1994, offrant davantage de visibilité au consensus que Silvio Berlusconi parvient à recueillir (E. Poli, 2001, p. 43-49).
Ainsi Berlusconi parvient-il à former, dans la perspective des élections législatives de mars 1994, une coalition à géométrie variable, MSI-AN, s’alliant, au nord, avec la Ligue de Bossi et, au sud, avec le parti de Fini. Pour la première fois dans l’histoire de l’Italie républicaine, une droite et une gauche (les progressistes, conduits par le PDS) s’opposent, et on commence à considérer la droite non plus comme une force marginale exclue du système politique, mais comme l’une des deux principales composantes de ce système. Bien qu’il ait été créé en un temps record, sur un modèle entrepreneurial et grâce aux ressources financières, humaines et organisationnelles mises à disposition par Silvio Berlusconi, Forza Italia est très vite devenu le principal parti italien (en termes de suffrages) et, tout en s’institutionnalisant, il s’est progressivement émancipé de son image initiale de «parti-entreprise». Il a cependant conservé une structure «allégée», s’appuyant principalement sur le rôle des élus et fortement centralisée. En effet, il ne faut, pas oublier que Forza Italia a été créé à l’initiative d’un leader charismatique, qui est resté solidement installé à sa tête jusqu’à sa dissolution, en 2009, avant de prendre les rênes d’une nouvelle formation : le Peuple de la liberté.
Comme l’a écrit la sociologue politique Chiara Moroni : «Si des formes de démocratisation des instances organisationnelles de Forza Italia sont prévues par les statuts, en pratique, elles ne remettent pas en cause la nature charismatique de l’organisation, avec toutes les conséquences que cela entraîne : une forte centralisation des processus opérationnels et décisionnels, un système de promotion interne fondé sur la cooptation par le leader et déterminé par le degré de loyauté envers lui, l’absence de débat interne et de formes de participation démocratique.» (C. Moroni, 2008, p. 35)
Avec le succès de Forza Italia dès sa création, c’est ainsi un parti d’essence fondamentalement charismatique qui s’affirme. Le leadership de Silvio Berlusconi tire sa force de sa nature antipolitique, des critiques qu’il formule à l’encontre des partis traditionnels et de la professionnalisation de la politique. Il reprend également à son compte, au moins dans un premier temps, les thèses d’un État minimal et de la défense des libertés individuelles, par opposition à un État envahissant (D. Campus, 2006, p. 144-147). Berlusconi s’efforce également de légitimer cette position de droite en se situant, dans le spectre politique, à une place que la Démocratie chrétienne – qui avait préféré, dès les débuts de la Première République, s’inscrire au centre –, n’avait jamais réellement occupée. Revendiquant donc fortement l’appartenance au camp de la droite – une orientation longtemps dénigrée en Italie –, il rompt ainsi avec la tradition politique républicaine instaurée en 1946 (M. Lazar, 2007, p. 23).
Grâce aux alliances que Forza Italia réussit à nouer et à ses victoires électorales successives de 1994, 2001 et 2008, une droite italienne s’affirme donc, avec son offre partisane spécifique et son électorat propre. Un électorat stable, modéré, constitué, pour une large part, d’électeurs du pentapartito4 des années 1980, mais qui reste hétérogène et porteur de revendications diversifiées. Ilvo Diamanti a ainsi noté que l’on peut distinguer deux «zones bleues» où Forza Italia l’emporte : le Nord et le Sud (le Centre étant une zone «rouge», dominée par la gauche). Le Nord «rassemble des zones métropolitaines de la nouvelle économie et des services, systèmes locaux en quête d’affirmation et de reconnaissance (…), des provinces dont l’économie repose sur le commerce et le tourisme». Il recouvre des milieux variés, mais qui partagent un arrière-plan culturel laïco-socialiste, ou à tout le moins modéré, nettement anticommuniste, et bénéficiant d’une qualité de vie élevée ; leur principal objectif est de garantir les niveaux de bien-être et de développement qu’ils ont acquis. Au contraire, la région « bleue » du Sud, dont les bastions se situent en Sicile et dans les provinces méridionales de la Sardaigne, «propose un modèle économique dépendant encore de l’intervention de l’État, caractérisé par un fort taux de chômage et par le poids significatif de l’administration publique». Dans cette région, la principale préoccupation est le chômage, ce qui entraîne une forte demande d’intervention de la part de l’État (I. Diamanti, 2009, p. 128).
De la révolution libérale à une redécouverte de la tradition
Cité par Moroni (2008, p.109).
D’un point de vue idéologique, comme on l’a vu, Forza Italia se présente, au départ, comme un parti qui entend réaliser en Italie une révolution libérale, en particulier sur le plan économique, au moyen d’une politique de libéralisation et d’une politique fiscale plus avantageuse pour les particuliers et les entreprises. Cependant, si certains mots d’ordre, en particulier la mise en œuvre d’un système fiscal plus équitable et d’une baisse des impôts, sont toujours d’actualité, au fil du temps, l’idéal de l’État minimal a perdu de l’importance au sein d’une plate-forme programmatique qui se présente, de plus en plus, comme le réceptacle de différents courants conservateurs. Un phénomène qui peut s’expliquer par l’hétérogénéité de l’électorat de Forza Italia et par la demande de protection de la part des régions méridionales (D. Campus, 2006, p. 147).
Après des premières années marquées par la culture de son leader et l’approche managériale de la politique qui lui est propre, Forza Italia cherche ensuite à définir son modèle culturel de façon plus explicite. Cette réflexion débouche sur la charte des valeurs de 2004. Ce document, qui témoigne de la volonté d’élaborer une synthèse entre différentes tendances, entend proposer un contre modèle face à une culture de gauche hégémonique. Il s’agit d’une synthèse anti-idéologique, qui cherche à faire dialoguer libéralisme populaire et libéral-socialisme Au cœur des valeurs du parti, on trouve l’idée de la prévalence de l’individu sur l’État – d’où l’importance donnée au principe de subsidiarité. La liberté individuelle se conçoit cependant en relation avec la dimension collective et en particulier avec le sentiment du bien commun. (C. Moroni, 2008, p. 106-108).
La façon dont est traitée la tension entre individu et société révèle l’importance grandissante que l’on accorde à la tradition, en particulier à la tradition catholique. Ce n’est ainsi pas un hasard si au terme d’«individu» on substitue de plus en plus celui de «personne», un concept central dans la doctrine de l’Église catholique. Cette tendance se développe notamment à la suite des attentats du 11 septembre 2001 et avec la réflexion qui s’ensuit autour de l’idée d’Occident, que l’on identifie de plus en plus à la tradition chrétienne. Ferdinando Adornato, écrit par exemple, en 2003, que le concept d’Occident doit se fonder sur trois idées-forces : «La reconnaissance du socle de valeurs qui, depuis la révélation biblique, règle l’ordre naturel de nos vies. La centralité de la personne dans l’histoire. Le rapport d’autonomie amicale entre foi et raison»5. Cette position, qui a pu être qualifiée à plusieurs reprises de «conservatisme libéral», révèle l’influence exercée par certaines fondations proches de Forza Italia : Liberal de Adornato (qui par la suite s’éloignera de Berlusconi et rejoindra l’Union du centre) et Magna Carta, créée en 2002 et animée par Marcello Pera, alors président du Sénat, et par l’historien Gaetano Quagliarello, aujourd’hui sénateur et vice-président de groupe du PDL.
Le glissement vers des positions de plus en plus conservatrices et très soucieuses du magistère de l’Église catholique (qui a, ces quinze dernières années, influencé de façon toujours plus directe la politique italienne), se traduit également par des initiatives législatives très controversées du gouvernement Berlusconi – telle la loi 40 de 2004, qui impose des limites très strictes au droit de recourir à la fécondation assistée –, ainsi que par une ferme opposition à des mesures comme la reconnaissance des couples non mariés et en particulier des couples homosexuels.
D’un point de vue plus institutionnel, la position centrale donnée à la figure du leader, ainsi que l’influence des thématiques libérales et du principe de subsidiarité, contribuent au développement, au sein de Forza Italia, d’opinions réformistes prônant, d’une part, le renforcement de l’exécutif et l’élection directe du président, et, d’autre part, une réorganisation de l’État dans le sens d’un fédéralisme renforcé. Cependant, le parti aura du mal à formuler des projets cohérents, qu’il s’agisse de la réforme de l’État ou de celle du gouvernement.
Un parti territorial : la ligue du nord
Politisation de la fracture Nord-Sud
L’apparition d’un parti territorial, au nord du pays, est liée à la crise qu’a connue la Démocratie chrétienne dans les années 1980. Ce parti se révèle en effet incapable d’intégrer le renouveau du localisme, un phénomène qui se développe dans différentes zones de l’Italie septentrionale. Le succès des premières ligues au nord-est, surtout en Vénétie (Liga Veneta, Lega Lombarda, notamment), puis dans les provinces lombardes situées aux contreforts des Alpes (Brianza, Bergamo, Sondrio) ainsi que dans certaines provinces du Piémont (Cuneo, Asti), témoigne ainsi de l’émergence d’intérêts localistes et d’une question septentrionale. Ces territoires ont en commun une économie en forte croissance, fondée sur un tissu de petites entreprises, une ouverture aux marchés extérieurs et un modèle d’organisation sociale et culturelle fondé sur le rôle de l’Église locale et des paroisses. Réservoirs électoraux traditionnels de la Démocratie chrétienne, ils se reconnaissent de moins en moins dans ce parti, et commencent à percevoir l’État comme une contrainte et un frein à leur développement (I. Diamanti, 2009, p. 69).
Dans la seconde moitié des années 1980, Umberto Bossi, leader de la Ligue lombarde, s’emploie au rassemblement des différentes ligues. La Ligue du Nord (Lega Nord) apparaît ainsi, en 1991, et fait irruption sur la scène politique nationale en 1992 à l’occasion des élections législatives : elle recueille 3.395.000 voix (8,65%), élargissant son audience au-delà des territoires où elle a pris naissance, jusqu’en Émilie (Centre-Nord).
Après les succès de 1992 puis de 1994 – la Ligue entre au gouvernement, alliée à Forza Italia et Alliance nationale –, le thème du fédéralisme, cheval de bataille du parti d’Umberto Bossi, s’inscrit durablement sur l’agenda politique italien. (Baldi et Baldini, 2008, p. 86). Mais, dès la fin des années 1990, la Ligue enregistre un premier recul, dû en grande partie à la concurrence exercée, au nord, par Forza Italia, qui se présente, elle aussi, comme une force antipolitique. Pourtant, après un score d’environ 4% aux élections de 2001 et de 2006, elle se renforce sensiblement, doublant son résultat aux législatives de 2008 et dépassant les 10% aux européennes de 2009.
La Ligue donne ainsi, pour la première fois dans l’histoire de l’Italie républicaine, une expression partisane au conflit centre-périphérie, en particulier à l’antagonisme entre, d’un côté, un Nord productif et, de l’autre, une capitale inefficace (Rome) et un Sud assisté. Ses points forts sont, depuis ses débuts, une organisation partisane capillaire et répartie sur le territoire, la promotion d’une classe politique diffuse, un réseau de groupes sectoriels spécialisés, et une identité forte s’articulant autour de thématiques territoriales. La Ligue s’est donc dotée d’une forme d’organisation bien plus proche du modèle d’un parti de masse, d’intégration sociale (représenté, par exemple, par l’ancien Parti communiste), que de celui de Forza Italia, faiblement structuré. (I. Diamanti, 2009, p. 81)
À l’exception du scrutin de 1996, la Ligue s’est toujours présentée aux élections législatives alliée aux autres forces du centre-droit, et ses dirigeants ont occupé des fonctions élevées au sein du gouvernement. Sa présence dans la coalition a pesé en permanence sur la politique de gouvernement du centre-droit, en faveur, notamment, de la décentralisation et du fédéralisme, ainsi que, ces dernières années, d’une politique plus dure à l’encontre de l’immigration clandestine (au moins sur le plan du discours).
Entre sécession et fédéralisme
Notons tout d’abord que si la Ligue s’est toujours caractérisée par sa volonté de défense des territoires, ses positions et propositions ont cependant évolué au fil du temps. Après la première phase des ligues, marquée par l’affirmation du leadership charismatique d’Umberto Bossi et par une offre politique très localiste, entre 1992 et 1995, la Ligue, qui obtient des mandats exécutifs aux niveaux local et national, adopte une position plus modérée, s’articulant autour de la préconisation du fédéralisme. En 1995, quittant la coalition, elle provoque la chute du gouvernement Berlusconi. Elle prend alors la défense de thèses ouvertement sécessionnistes, et c’est avec un programme de séparation des régions du Nord qu’elle se présente seule aux élections de 1996, rencontrant une large adhésion des électeurs. (B. Baldi et G. Baldini, 2008, p. 84-85)
Par la suite, avec le nouveau rapprochement entre la Ligue et Forza Italia, en 1999, ces positions extrémistes, qui s’accompagnent d’une mythification du Nord de l’Italie à travers les notions de «Padania» et de «nation padane», sont progressivement abandonnées au profit d’un retour à l’idée fédérale, désormais défendue par la revendication de la dévolution aux régions d’un grand nombre de compétences assumées par l’État central.
Néanmoins, à partir de la fin des années 1990, la Ligue commence également à intégrer dans son programme les peurs qui se développent dans les territoires septentrionaux face aux phénomènes de la mondialisation et de l’immigration. Afin d’offrir des réponses à ces nouvelles craintes, elle adopte des positions conservatrices et traditionalistes sur le plan social, économique et religieux, passant d’un «parti des producteurs» à un «parti de la sécurité». (I. Diamanti, 2009, p. 76-79 ; p. 212)
En ce qui concerne le processus d’intégration européenne, il faut enfin noter que la Ligue du Nord se démarque des autres composantes du centre-droit, qui s’insèrent dans la tradition européiste italienne. À l’inverse, la Ligue a toujours défendu une position très critique à l’égard de la construction européenne, et si, dans la période récente, elle a modéré son discours et la vigueur de ses propos, ses opinions ont peu évolué sur le fond. Tout en se déclarant favorable à l’idée d’une fédération entre les peuples européens – en particulier d’une Europe qui reconnaisse la spécificité des régions et des territoires –, elle dénonce ce que serait devenue, selon elle, l’Union européenne, à savoir un super État continental, présentant un fort déficit démocratique.
En lien avec les évolutions les plus marquantes de ces dernières années, la Ligue a dénoncé les risques potentiels de l’élargissement à l’Est, en particulier liés à l’entrée dans l’Union de pays comme la Bulgarie et la Roumanie, qui a favorisé l’arrivée en Italie de nombreux immigrés et de populations roms. À la différence des autres partis et de la politique actuelle du gouvernement Berlusconi, la Ligue maintient par ailleurs son opposition à l’entrée de la Turquie dans l’Union, pour des raisons tant géographiques et économiques (les dommages qui pourraient en résulter pour le système des PME italiennes) que culturelles et identitaires (l’appartenance de la Turquie au monde musulman). À ce propos, il faut en effet noter que la Ligue continue d’appuyer l’introduction dans le Traité de l’Union de la référence aux racines chrétiennes de l’Europe, rejoignant en cela les autres partis du centre-droit.
Après les élections régionales de mars 2010, le poids de la Ligue au sein de la coalition de centre-droit semble s’être encore renforcé. Elle a remporté un succès considérable dans le Nord, en devenant le premier parti en Vénétie, – acquis aux dépens du parti de Berlusconi –, et elle a renforcé sa présence dans les régions du Centre du pays (Émilie-Romagne et Toscane). Grâce aux accords avec le PDL, elle a obtenu la présidence de la Vénétie et du Piémont. Forts de ces résultats, les ministres et les dirigeants de la Ligue ont revendiqué de façon explicite leur légitimité à jouer un rôle accru au sein de la coalition de gouvernement, et mis en avant les thèmes de la réforme constitutionnelle et du fédéralisme fiscal.
Le peuple de la liberté, fusion de Forza Italia et d’Alliance Nationale
La naissance d’un parti unique
La nouvelle formation de la droite italienne, le Peuple de la liberté, qui tient son premier congrès en mars 2009, est née de la fusion entre Alliance nationale et Forza Italia. Les deux partis sont cependant organisés très différemment. Le premier, avec une structure en sections réparties sur tout le territoire, un système de congrès et d’élections pour désigner les responsables aux différents échelons, relève d’un mode d’organisation assez traditionnel. Forza Italia, en revanche, présente une structure à la fois moins «charpentée» et organisée selon une logique de contrôle par le sommet plus étroit. Aussi pouvait-on penser, avant la création du PDL, que FI serait absorbé par AN. Ce n’est pourtant pas ce qui va se produire. L’initiative de la formation d’un grand parti de centre-droit revient en effet à Silvio Berlusconi, qui capte ainsi un sentiment déjà présent au sein de l’électorat modéré – les sondages montrant, depuis plusieurs années, la présence d’une opinion publique très favorable à la création d’une telle formation.
Mûrie donc depuis quelques années, l’idée est lancée par Berlusconi en novembre 2007 – à la surprise même de ses plus proches collaborateurs qui n’en avaient même pas été avertis –, au cours d’une manifestation à Milan, Piazza San Babila, qui regroupe des militants de Forza Italia appelant à la signature d’une pétition pour la démission du gouvernement de Romano Prodi. En arrivant sur les lieux, Berlusconi, entouré par la foule, sort de sa voiture et, dans un discours passé à la postérité comme le discours du predellino (le marche-pied de la voiture sur lequel il est juché), il annonce la dissolution de Forza Italia et la formation d’un nouveau parti, le «Parti du peuple italien des libertés», invitant ses alliés, Fini et Casini (leader du parti centriste UDC, à l’époque allié avec la droite) à le rejoindre.
Cette déclaration permet à Berlusconi de réaffirmer son leadership face à l’appareil d’un parti, Forza Italia, de plus en plus institutionnalisé et à l’encontre duquel il ne cache pas son irritation. En vrai chef charismatique, il considère avec méfiance la consolidation de la structure du parti et l’apparition en son sein de «clans» de pouvoir. Une nouvelle fois, il se présente comme un leader antipolitique, hostile au pouvoir des partis traditionnels et capable de porter directement la voix du peuple italien.
Fini et Casini font d’abord preuve d’une forte hostilité à l’égard de ce projet, craignant de se voir phagocytés par le charisme de Berlusconi. Ils accusent le leader de mener une politique plébiscitaire, reposant sur la personnalisation du pouvoir. Dans les jours qui suivent cette annonce, les deux hommes multiplient les rencontres avec d’autres personnalités politiques, afin d’évaluer la possibilité de créer une nouvelle formation, distincte de Forza Italia. Mais, face à des sondages défavorables, Fini revient sur sa position et décide, au bout de quelques semaines, de rejoindre Berlusconi dans son projet de parti unique. (L. Della Pasqua, 2009, p. 97)
Une cohabitation difficile
Partito unico under construction, Charta Minuta, novembre 2008
Après la fin prématurée du gouvernement Prodi, en janvier 2008, en raison de conflits au sein de la coalition, les deux partis (FI et AN) décident de se présenter ensemble aux élections parlementaires du mois d’avril. Forts de leur victoire, ils forment à la Chambre des députés et au Sénat deux groupes unitaires, sous la bannière du PDL. Le processus de fusion, qui mènera au congrès de mars 2009, est donc entamé. Il ne se fait pourtant pas sans heurts, en raison principalement d’une défiance réciproque entre FI et AN, qui rend très difficile la réalisation d’un accord sur les règles de fonctionnement du nouveau parti. De plus, Gianfranco Fini, qui a été élu président de la Chambre des députés et a laissé les rênes d’Alliance nationale à un de ses colonels, est visiblement soucieux du rôle qu’il pourra jouer dans le nouveau parti et adopte des positions qui l’éloignent de plus en plus de Berlusconi.
Dès avant la naissance du PDL, Gianfranco Fini dénonçait, en tant que président de la Chambre, l’avilissement du Parlement et l’abus que le gouvernement faisait du recours aux décrets-lois et au vote de confiance. Pendant la phase de construction du nouveau parti, il se prononce également sur la question de son organisation et sur la nécessité d’instaurer des règles de fonctionnement interne démocratiques. En novembre 2008, il dénonce ouvertement le danger de césarisme qui se développe au sein du parti émergeant. Paraît alors un numéro de la revue Charta Minuta (éditée par la fondation qu’il préside, Fare Futuro), dédié au PDL «en construction». La plupart des contributions y soulignent la nécessité de former un parti fonctionnant selon des règles démocratiques, et de poser la question de la succession, qui reste un sujet tabou dans l’entourage de Silvio Berlusconi6. Fini adopte en outre, à plusieurs reprises, une attitude plus ouverte sur la question de l’immigration, se plaçant ainsi en nette opposition par rapport à la Ligue du Nord et suscitant des tensions au sein même du PDL, une large part de ses dirigeants souhaitant maintenir de bonnes relations avec le parti de Bossi.
La volonté du président de la Chambre de ne pas se cantonner aux seconds rôles au sein du PDL et de chercher à représenter une tendance plus libérale par rapport aux positions conservatrices et traditionalistes qui se sont progressivement affirmées ces dernières années apparaît clairement lors de son discours au congrès fondateur du parti, en mars 2009. Adoptant la posture d’un vrai leader politique, Fini trace à cette occasion une vision du futur de l’Italie. Il met l’accent sur la nécessité de moderniser de façon globale les institutions italiennes, au-delà de simples mesures ponctuelles et partielles, et de repenser le pacte fondateur de la communauté nationale. Il aborde des thèmes tels que l’immigration, l’intégration des immigrés et la laïcité de l’État, sur lesquels il se distingue nettement d’une large part des dirigeants du PDL. Cette attitude lui attire les sympathies de groupes minoritaires, de tendance libérale, socialiste ou radicale, qui commencent à voir en lui un possible successeur de Berlusconi.
Il apparaît de plus en plus clairement que les différentes sensibilités coexistant au sein du parti ne reflètent pas systématiquement l’appartenance passée à l’un ou l’autre des partis cofondateurs, AN et FI. De nombreux dirigeants du premier ont désormais choisi de suivre Berlusconi (par exemple le président du groupe PDL au Sénat, Maurizio Gasparri, et le ministre de la Défense, Ignazio La Russa), tandis que certains représentants du second, tel le député Benedetto Della Vedova, économiste libéral issu du Parti radical, se rapprochent très nettement de Gianfranco Fini.
Une fois le PDL créé, les prises de position hétérodoxes de Fini, de sa fondation et de personnalités politiques qui lui sont proches continuent de se multiplier : au sujet, notamment, du respect des prérogatives du Parlement, de l’intégration des immigrés, et de la laïcité de l’État.
Un parti en mal d’organisation
Voir à ce propos les statuts du PDL
Roberto D’Alimonte, «La fusion fonctionne au niveau des urnes, mais il manque encore une direction» (« La fusione funziona nelle urne ma la dirigenza ancora non c’è »), in Il Sole 24 Ore, 4 mars 2010
À l’heure où nous écrivons, les seules données officielles, communiquées par le parti, sont celles des pré- adhésions, c’est-à-dire des déclarations d’adhésion faites en ligne. Elles doivent encore se matérialiser, d’un point de vue administratif, par l’envoi de justificatifs (envoi par la poste ou par fax de la copie d’une pièce d’identité) avant de se transformer en réelle adhésion. Les pré-adhésions s’élèveraient à 286 Avant la fusion, on comptait environ un million d’inscrits à Forza Italia et à Alliance nationale (Il Sole 24 Ore, 4 mars 2010).
Voir à ce propos le commentaire de la loi par Giovanna Lauro, Cittadini e integrati: perché e come serve che gli stranieri diventino italiani, in Libertiamo.it.
Des think tanks tels que Fare Futuro et Libertiamo ont affiché, sur les questions liées à la bioéthique et aux droits civiques, des positions plus libérales et respectueuses de la liberté de choix individuelle, de même qu’ils adoptent une attitude plus ouverte sur l’immigration et la citoyenneté. Voir à ce propos le numéro de février 2010 de la revue Charta Minuta. Pour des positions plus traditionalistes, nous renvoyons aux sites de la fondation Magna Carta et à sa revue en ligne, L’Occidentale
Pour connaître les positions de Fini sur ces différents thèmes, voir son ouvrage récent Il futuro della libertà (2009).
Outre le groupe qui gravite autour de Libertiamo (avec notamment l’économiste et ex-ministre Antonio Martino), on y retrouve également les prises de position de plusieurs chercheurs de l’Institut de recherche Bruno Leoni, d’inspiration libérale (mais qui n’est lié à aucun parti).
En réaction à cette initiative, le ministre de la Défense, Ignazio La Russa, issu lui aussi d’Alliance nationale, mais également très proche de Silvio Berlusconi, a créé un nouveau groupe baptisé La Nostra Destra (Notre Droite), affichant ainsi clairement une attitude polémique vis-à-vis de son ex-allié, Gianfranco Fini.
Les fondations et associations récemment créées autour du centre-droit sont les principaux protagonistes des débats qui se font jour au sein du PDL. Outre Magna Carta et Fare Futuro, d’autres fondations apparaissent, toutes liées à des personnalités de premier plan du parti – même si leur visibilité médiatique et leur capacité à influer sur le débat public est variable : Libertiamo, de Benedetto Della Vedova ; l’Italia protagonista, de Maurizio Gasparri; Punto Italia, du ministre de la Défense, Ignazio La Russa; Nuova Italia, du maire de Rome, Gianni Alemanno ; Free Foundation, du ministre de la Fonction publique, Renato Brunetta ; Riformismo e libertà, du président du groupe PDL à la Chambre, Fabrizio Cicchitto; ainsi que Res Publica, du ministre de l’Économie, Giulio Tremonti.
La fusion entre Forza Italia et Alliance nationale s’est donc faite sous l’impulsion de Silvio Berlusconi, et du point de vue de l’organisation, le Peuple de la liberté est plus proche de la première formation que de la seconde : il se présente comme un parti charismatique à la structure à la fois pyramidale et «allégée», avec des espaces de démocratie interne très limités et des modalités de recrutement et de choix des cadres contrôlées par le sommet7. Pourtant, en dépit de cette structure pyramidale, le PDL reste marqué par de forts conflits internes, qui s’expriment tant au niveau du sommet que des échelons territoriaux. En particulier, si la fusion entre AN et FI a donné de bons résultats d’un point de vue électoral – comme en témoignent les élections législatives de 2008 et les européennes de 2009 –, elle apparaît encore incomplète sur le plan de l’adaptation de l’organisation.
Comme l’écrit le politologue Roberto D’Alimonte : «La fusion n’a pas fonctionné au niveau du parti. Il manquait une vision commune, une organisation partagée, une confiance réciproque. Le parti est encore divisé en deux grands segments que Berlusconi a du mal à faire concorder.»8 Le nouveau parti, tout en subissant les pressions de potentats locaux, tel l’ex-Forza Italia sicilien, semble avoir des difficultés à s’implanter de façon homogène sur tout le territoire et à susciter la participation de ses sympathisants. La campagne d’adhésion au Peuple de la liberté, qui a manqué d’une réelle stratégie de communication, a ainsi obtenu des résultats assez décevants : bien que l’on ne connaisse pas encore le nombre exact d’inscriptions, il semble clair que le résultat sera bien en deçà du pronostic affiché par Berlusconi, à savoir 1 million d’adhérents9. À cela s’ajoute l’exaspération, déjà mentionnée, qu’éveillent chez le leader charismatique les conflits internes et les clans de pouvoir, ainsi que sa tentation permanente de révolutionner la structure et la classe dirigeante d’un parti par ailleurs relativement peu structuré. Ainsi s’explique le lancement d’une structure parallèle, créée à la veille des élections régionales pour en gérer la campagne, voulue par Berlusconi et confiée à l’une de ses plus fidèles collaboratrices, la ministre du Tourisme, Maria Vittoria Brambilla.
Dans ce contexte, la création d’associations et de fondations est devenue le principal instrument de discussion sur les thématiques les plus importantes du débat politique. Ces think tanks doivent cependant être distingués de ceux qui aux États-Unis : en effet, bien qu’étant formellement autonomes par rapport au parti, elles restent étroitement liées aux personnalités fondatrices et sont ainsi devenues des lieux, non seulement du débat, mais également de la confrontation politique.
Sur des questions majeures, touchant à des domaines variés (politique économique, immigration, biopolitique et droits civiques), le centre-droit apparaît encore divisé, et l’intervention des think tanks met en avant ces divergences. Nous avons déjà fait allusion au thème de l’immigration. En septembre 2009, une proposition de loi sur la citoyenneté, signée par un député du PDL, proche de Gianfranco Fini, et par un député du Parti démocratique, a été présentée à la Chambre. Ce projet bipartisan, qui proposait un assouplissement des conditions et des délais d’acquisition de la citoyenneté italienne10, a rencontré une opposition très ferme de la part de nombreux représentants du PDL et de la Ligue. De même, un texte sur le testament biologique, qui, à l’heure où nous écrivons, est en discussion à la Chambre des députés et a déjà été approuvé par le Sénat, fait l’objet d’affrontements très dur au sein du PDL. Les débats autour de ce texte – limitant fortement la capacité d’un patient à accepter ou à refuser un traitement dès lors que ses facultés d’entendement et d’expression d’une volonté seraient affectées – voient s’affronter des conceptions opposées de l’autonomie et de la liberté de la personne, ainsi que des limites de l’intervention de l’État dans la vie des individus11. Cette dernière question s’inscrit dans la thématique plus générale de la laïcité de l’État, qui représente une ligne de clivage majeure en Italie, à droite comme à gauche.
Au sein du PDL s’opposent ainsi deux positions : la première, traditionaliste et très sensible aux revendications de l’Église catholique, est partagée – ou à tout le moins tacitement acceptée – par la majorité des dirigeants et des élus nationaux du parti ; la seconde, minoritaire, privilégie l’idée d’une autonomie réciproque entre les sphères religieuse et politique ; elle a trouvé un représentant en la personne de Fini12.
En ce qui concerne la politique économique, on a vu comment Forza Italia, se présentant à l’origine comme une force libérale et militant en faveur de l’économie de marché et des libéralisations, a au fil du temps nettement modéré son discours. De même, le PDL semble aujourd’hui avoir pris ses distances avec les thèses les plus libérales, qu’Alliance nationale n’a jamais soutenues, mais qui sont toujours défendues par une minorité de libéraux souvent critiques par rapport à la politique économique du gouvernement actuel13 – au profit d’un protectionnisme renforcé et d’une intervention de l’État dans l’économie. Le cas d’Alitalia illustre ainsi une situation paradoxale, dans laquelle la gauche, se faisant le défenseur des mérites du marché, a soutenu le rachat de la compagnie italienne par Air France, tandis que la droite réclamait une intervention de l’État, au nom de la défense de l’intérêt national. (C. Petrarca, 2008, p. 180)
Dans son ouvrage La peur et l’espérance (La paura e la speranza), qui a globalement reçu un bon accueil au sein du parti, le ministre de l’Économie, Giulio Tremonti, a synthétisé et théorisé ces deux mots d’ordre : interventionnisme étatique renforcé et politique traditionaliste en matière sociale et éthique. Il revendique, en effet, dans ce livre «une vision qui n’exclut pas Dieu et qui ne diabolise pas l’État et la dimension publique», ainsi qu’une politique «opposée à la dictature du relativisme» et fondée sur des mots-clés tels que «valeurs, famille, identité, autorité, ordre, responsabilité, fédéralisme». (G. Tremonti, 2008)
À la suite des élections régionales et au vu du rôle de plus en plus évident joué par la Ligue dans l’élaboration de certaines positions de la coalition de centre-droit, les dissensions se sont renforcées au sein du PDL, jusqu’à éclater au grand jour lors de la réunion de la Direction du parti du 22 avril 2010 (élargie à tous les parlementaires). Un conflit ouvert a alors opposé Gianfranco Fini et Silvio Berlusconi, le premier revendiquant un droit à l’expression de positions dissidentes sur certaines thématiques et à l’existence de courants minoritaires au sein du PDL. Cependant, la réaction du président du Conseil et le document voté par l’écrasante majorité de la Direction ont démontré l’opposition des dirigeants du parti à la possibilité d’une articulation plus claire entre les différentes tendances qui le traversent.
Au moment où nous écrivons, la confrontation ne s’est pas apaisée : à l’initiative des proches du président de la Chambre (en particulier quelques dizaines de parlementaires), visant à créer un groupe organisé au sein du PDL, une nouvelle structure, Generazione Italia14, a été lancée au mois d’avril 2010. Son but était d’établir des relais dans les territoires, mais cette initiative rencontre une forte résistance de la part des dirigeants du parti.
Une droite en difficulté
La « présidentialisation » du système politique italien
En dépit des difficultés que connaît aujourd’hui la droite italienne, elle s’est affirmée depuis 1994 comme une force centrale dans le nouveau système politique. Pour la bonne compréhension de la réalité politique italienne, on peut, en conclusion, revenir sur deux éléments majeurs : les transformations du système politique consécutives à l’affirmation d’un nouveau centre-droit, et la présence, au sein de l’électorat, d’une composante de tendance modérée, peu encline à voter à gauche, et représentant la majorité des électeurs.
Avec l’entrée en politique de Silvio Berlusconi, la naissance de Forza Italia et la création d’une nouvelle coalition de centre-droit, le système politique et partisan italien a adopté, pour la première fois, une nature bipolaire, la compétition ne se basant plus sur le centre, mais sur la confrontation entre droite et gauche – cette dernière étant elle-même contrainte de s’organiser pour répondre au nouveau défi lancé par Berlusconi. Comme cela se passe dans les démocraties majoritaires, depuis 1994 la compétition pour la conquête du pouvoir se fait entre deux principales options politiques alternatives, et on peut ainsi qualifier la quasi totalité des gouvernements qui se sont formés, depuis lors, de «pré-électoraux», en ce sens qu’ils s’appuient sur une majorité choisie par les électeurs lors des élections législatives.
Les coalitions en lice se sont présentées aux électeurs en indiquant clairement le leader de la coalition, candidat au poste de président du Conseil. Ces évolutions ont en retour favorisé l’émergence d’une dynamique de personnalisation et de présidentialisation de la politique (S. Ventura, 2010). Mauro Calise a ainsi montré que le cas italien présente toutes les caractéristiques de la présidentialisation telles qu’elles ont été décrites par Thomas Poguntke et Paul Webb dans leur célèbre étude, The Presidentialisation of Politics : renforcement de la position du leader au sein de son parti, contrôle croissant sur l’exécutif et autonomie croissante de l’Executive Office, campagnes personnalisées. (M. Calise, 2005, p. 88).
Le phénomène de présidentialisation est plus évident à droite de l’échiquier politique. Nous l’avons vu, Forza Italia, puis le Peuple de la liberté ont tous deux été créés à l’initiative de leur leader, Silvio Berlusconi, et tous deux peuvent être qualifiés de partis «présidentialisés». La communication politique, elle aussi, connaît des changements radicaux. De party-centered, les campagnes électorales sont devenues candidate- centered. À une forte personnalisation de la politique s’est ajouté un nouveau style de communication. Le langage abstrait et autoréférentiel de la Première République, construit plus pour les négociations entre élites des partis que pour s’adresser à un public vaste et hétérogène, est remplacé par un langage plus simple, direct, jouant sur les émotions, plus propice à créer un rapport direct avec l’électorat. Et la télévision a pris un rôle central dans les stratégies de communication.
À gauche, les changements, moins radicaux, n’en sont pas moins significatifs. Cependant, en dépit d’une personnalisation plus forte qu’auparavant et de la présence d’une certaine dynamique de présidentialisation au sein du principal parti de gauche – le Parti démocratique, créé en 2007 –, la méfiance à l’encontre de ces phénomènes est restée vive. (S. Ventura, 2010)
Qui vote pour le centre-droit ?
D’après les données du Cise (Centre italien d’études électorales) pour les élections législatives de 2008, alors que le Peuple de la liberté a recueilli 45% des voix dans le Sud, dans le Nord-Est et le Nord-Ouest, il n’affiche qu’un résultat de respectivement, 34,7% et 31,1% (Il Sole 24 Ore, 4 mars 2010, 6).
La seconde tendance de fond est donc bien une sensibilité de l’électorat majoritairement orientée vers le centre-droit. Cette situation est perçue par les acteurs politiques italiens comme relevant quasiment de facteurs structurels, et ainsi le Parti démocratique, qui a échoué dans sa tentative de se présenter, avec l’ex-secrétaire Walter Veltroni, comme un parti à vocation majoritaire, semble aujourd’hui chercher à s’allier avec le petit parti centriste et d’inspiration catholique de Pierferdinando Casisi, l’UDC. Le vote modéré, non orienté à gauche, est un vote national. Si l’on prend l’exemple des élections à la Chambre et au Sénat de 2008, le PDL, la Ligue, le petit «parti de la droite» (né d’une scission au sein d’Alliance nationale) et l’UDC (qui ne s’était alors allié avec aucun des grands partis) ont obtenu au total 59% des suffrages exprimés dans les régions du Nord et du Sud, 53% dans celles du Centre-Sud (Lazio, Abruzzes, Molise) et, s’ils n’ont pas obtenu la majorité dans les régions «rouges» (Émilie-Romagne, Toscane, Marques), historiquement dominées par la gauche, ils y ont cependant recueilli 43% des voix. Le Parti démocratique et la liste de la gauche ont ainsi affiché un résultat de 55% dans les régions rouges (ce qui constitue d’ailleurs leur plus mauvais résultat depuis 1994), mais ils n’ont atteint que 39% dans le Nord et le Sud. Il faut cependant noter que le principal parti de centre-droit, le PDL, se révèle beaucoup plus fort dans le Sud, tandis que, dans les régions septentrionales, son poids électoral a été redimensionné, ces dernières années, par un nouvel essor de la Ligue15. (I. Diamanti, 2009, p. 208-209)
Mais qui vote pour le centre-droit ? En se basant toujours sur les résultats de 2008, une étude de l’ITANES (Italian National Elections Studies) a montré que le Parti de la liberté, bien que bénéficiant du soutien de catégories très hétérogènes de la population – comme on peut s’y attendre pour un parti présentant une base électorale aussi large –, est surreprésenté au sein de certaines couches sociales: les femmes (et notamment les femmes au foyer dont la moitié ont soutenu le PDL), les jeunes entre 25 et 34 ans, les seniors de plus de 75 ans, les personnes ayant un faible niveau d’études, la bourgeoisie (et notamment la petite bourgeoisie urbaine) et les catholiques pratiquants. Toutefois, ces données reflètent probablement aussi l’influence du facteur religieux, 60% des femmes au foyer se déclarant catholiques pratiquantes, ce qui en fait le segment social le plus religieux.
En ce qui concerne le niveau d’éducation des électeurs, si le PDL est sous-représenté parmi les personnes ayant les plus hauts niveaux d’études (diplôme universitaire en particulier), et surreprésenté au sein de l’électorat le moins éduqué (études primaires), la corrélation entre orientation du vote et niveau d’éducation est cependant plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. Cette plus forte propension à voter pour le PDL observée chez les personnes ayant un faible niveau d’études est en effet notable au sein de l’électorat âgé (personnes nées avant 1955), mais elle diminue pour les générations suivantes, jusqu’à disparaître chez les trentenaires. En revanche, elle augmente à nouveau chez les jeunes d’une vingtaine d’années.
Parmi les personnes ayant un niveau d’études élevé, le plus enclines à voter à gauche sont celles qui ont connu les événements de 1968 et des années suivantes. À l’inverse, les électeurs nés après 1966 sont davantage orientés à droite. Cette tendance s’observe également chez les jeunes ayant un faible niveau d’éducation, ce qui confirme la plus forte capacité du PDL à toucher les jeunes, comparé au Parti démocratique. (M. Maraffi, 2008)
En ce qui concerne le positionnement par rapport aux grands thèmes de société, les électeurs du centre-droit (PDL et Ligue) sont plus favorables au libre jeu du marché que ceux de gauche. Toutefois, les premiers comme les seconds approuvent clairement l’intervention de l’État dans l’économie. Ce positionnement par rapport aux thématiques économiques semble donc moins déterminant pour expliquer l’orientation du vote que les facteurs de type éthico-sociaux. Dans ce dernier domaine, les différences sont plus importantes et les électeurs du centre-droit se révèlent sensiblement plus traditionalistes que les sympathisants du centre-gauche, plus libertaires (C. Petrarca, 2008).
Pour finir, il semble qu’il existe également un lien évident avec le sentiment d’insécurité. Toujours d’après les données de l’ITANES, 4,7% des électeurs considéraient, en 2008, que le principal problème que le
gouvernement devait traiter était l’immigration. Ce petit pourcentage est composé à 80,5% d’électeurs de droite (PDL, Ligue et Droite). Parmi les interviewés qui ont indiqué comme principale préoccupation la criminalité (12,8%), 67% votent à droite. Et contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ce vote est également majoritaire chez ceux qui disent ne pas se sentir en sécurité non pas en raison de l’immigration ou de la criminalité, mais à cause de la situation économique (cette orientation est cependant moins marquée : 50,5% d’entre eux votent à droite, contre 37,3% pour les partis de gauche). Il est d’ailleurs intéressant de noter que les électeurs accordent une plus grande confiance au centre-droit qu’au centre-gauche en ce qui concerne la capacité à traiter les problèmes économiques. En effet, parmi ceux qui ont exprimé des préoccupations d’ordre économique, 81% des électeurs du centre-droit considèrent que le parti qu’ils soutiennent est capable de résoudre ces problèmes, tandis que seuls 64% des électeurs du centre-gauche font confiance à leur coalition. Chez les personnes qui placent l’immigration et la criminalité au premier rang de leurs préoccupations, le manque de confiance envers le centre-gauche est encore plus marqué, jusqu’au sein même de son électorat. (N. Cavazza, P. Corbetta et M. Roccato, 2008).
En conclusion, on peut donc affirmer que le centre-droit semble plus à même que le Parti démocratique de pénétrer dans toutes les classes et groupes sociaux; il se présente comme plus hétérogène et plus «populaire» (M. Maraffi, 2008, p. 96) ; de plus, il apparaît aux yeux des électeurs comme davantage en mesure de répondre à leurs différentes attentes et préoccupations. Une forte demande pour une offre politique de centre-droit semble donc exister aujourd’hui en Italie. Cependant, en dépit de sa force électorale et du soutien considérable dont bénéficie Berlusconi dans l’opinion publique – largement supérieur à 50% selon tous les instituts de sondage –, le centre-droit, et en particulier le PDL, traverse aujourd’hui une importante crise politique et organisationnelle, qui pourrait conduire à une restructuration de l’offre partisane. La capacité du centre-droit et du principal parti de gouvernement, le Peuple de la Liberté, de proposer pour le futur une offre politique adaptée aux demandes de ses électeurs potentiels, reste donc une question ouverte.
Bibliographie
B Baldi e G. Baldini, Italia, in S. Ventura, Da stato unitario a stato federale. Territorializzazione della politica, devoluzione e adattamento istituzionale in Europa, Bologna, Il Mulino, 2008,
A Baldoni, Storia della destra, Firenze, Vallecchi, 2008.
M Calise, Presidentialisation, Italian Style, in T. Poguntke, P. Webb (sous la direction de), The Presidentialisation of Politics, Oxford, Oxford University Press, 2005.
D Campus, L’antipolitica al governo, De Gaulle, Reagan, Berlusconi, Bologna, Il Mulino, 2006.
C Petrarca, Declino del mercato e tradizionalismo etico, in ITANES, Il ritorno di Berlusconi, Vincitori e vinti nelle elezioni del 2008, Bologna, Il Mulino, 2008.
T Poguntke, P. Webb (sous la direction de), The Presidentialisation of Politics, Oxford, Oxford University Press, 2005.
E Poli, Forza Italia. Strutture, leadership e radicamento territoriale, Bologna, Il Mulino, 2001.
G Tremonti, La paura e la speranza, Milano, Mondadori, 2008.
S Ventura, Il principe democratico. Presidenzializazione della politica e caso italiano, in Rivista di Politica, n°3, mars 2010.
A Campi, La destra in cammino, Soveria Mannelli, Rubettino, 2008.
G Carocci, Destra e sinistra nella storia d’Italia, Bari-Roma, Laterza, 2002.
N Cavazza, P. Corbetta, M. Roccato, Il colore politico dell’insicurezza, in ITANES, Il ritorno di Berlusconi. Vincitori e vinti nelle elezioni del 2008, Bologna, Il Mulino, 2008.
L Della Pasqua, La svolta del predellino. Storia, segreti e retroscena della nascita del Popolo della Libertà, Roma, Bietti Media, 2009.
I Diamanti, Mappe dell’Italia politica, Bologna, Il Mulino, 2009.
C Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia, 1983.
P Ignazi, Il polo escluso, Bologna, Il Mulino, 1998.
M Lazar, Democrazia alla prova. L’Italia dopo Berlusconi, Bari-Roma, Laterza, 2007 (édition originale 2006).
G Maranini, Storia del potere in Italia, 1995.
C Moroni, Da Forza Italia al Popolo della Libertà, Roma, Carocci, 2008.
G Mammarella, L’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1993.
M Maraffi, Chi ha votato chi ? in ITANES, Il ritorno di Berlusconi. Vincitori e vinti nelle elezioni del 2008, Bologna, Il Mulino, 2008.
A Panebianco, Prefazione, in G. Maranini, Storia del potere in Italia, 1995.




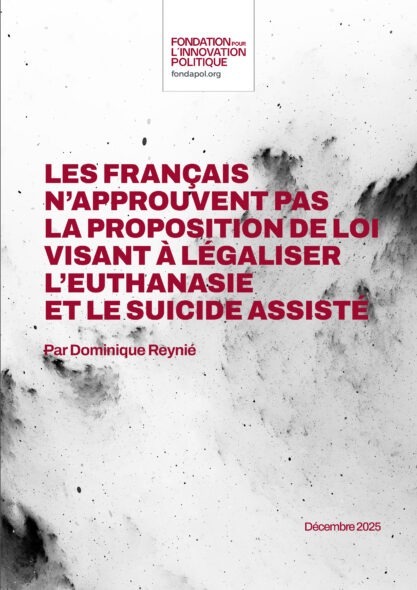



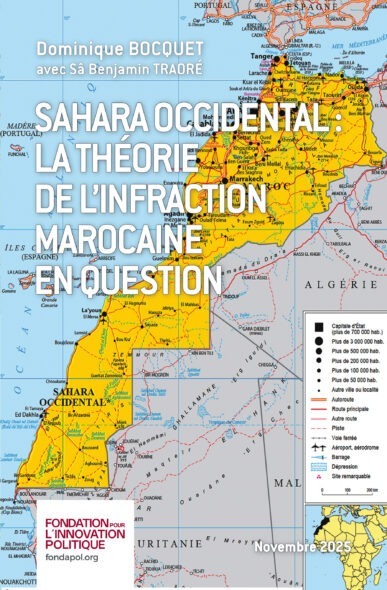


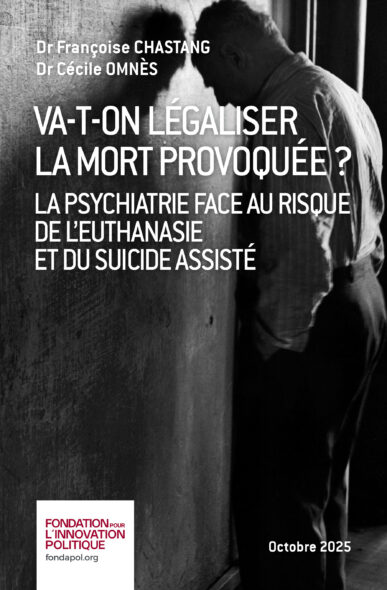

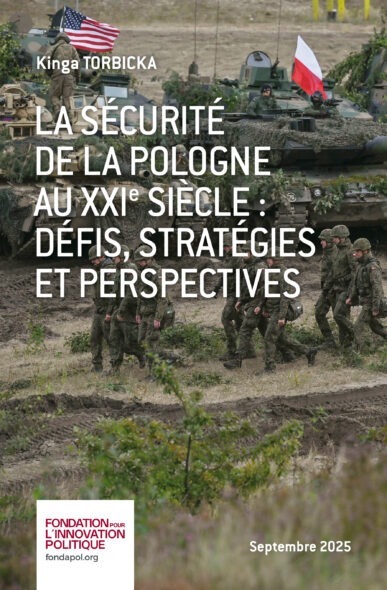

Aucun commentaire.