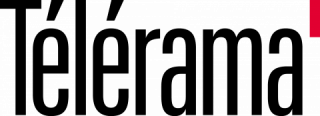
Envie d'un corps tout neuf ? Attendez 2050
Sophie Lherm | 08 août 2008
Article présentant l’article de Jean-Didier Vincent « Chronique d’un voyage en transhumanie », paru dans 2050 (n°8, avril 2008), la revue de la Fondation pour l’innovation politique, dans lequel il relate les dangers de la convergence des NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives), lorsqu’elles sont utilisées à des fins d’«amélioration» de l’homme.
En 2050, nous changerons de corps à volonté et serons immortels, parole d’ingénieurs ! Des nanorobots circuleront dans notre sang et dans notre cerveau pour éliminer les toxines, corriger les erreurs de notre ADN, améliorer notre bien-être physique… Info ou intox ? Qu’en pensent les philosophes et les neurobiologistes ?
D’ici cinquante ans, l’homme sera devenu immortel. A cette date, il sera capable de réparer toutes les défaillances de son organisme et d’en augmenter indéfiniment les performances. Voilà la conviction réitérée par Ray Kurzweil, l’un des inventeurs informaticiens les plus primés des Etats-Unis, devenu star de la prospective lors du World Science Festival qui s’est tenu à New York au printemps dernier. Après la quête des alchimistes, rêve fondateur de la science, voici donc les « espoirs » de ceux qui s’autoproclament « transhumanistes ».
De quoi s’agit-il exactement ? Jean-Didier Vincent, éminent neurobiologiste, membre de l’Académie des sciences, peu suspect a priori de technophobie, a effectué au printemps 2007 une série de visites dans les principales institutions scientifiques américaines. De retour à Paris, il a écrit Chronique d’un voyage en transhumanie, dont la revue 2050 vient de publier de larges extraits. Il raconte sa rencontre avec les auteurs d’un rapport rendu public en juin 2002, et présentant un projet dit « de convergence des NBIC », quatre initiales pour nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives. Le rapport dresse un panorama des perspectives envisageables dans ces quatre domaines. « C’est un moment unique dans l’histoire des réalisations techniques, expliquent les auteurs. L’amélioration des performances humaines devient possible par l’intégration des technologies. » Pêle-mêle y sont évoqués des capteurs susceptibles d’informer les individus qui les portent de leur condition physique ou de la qualité de leur environnement, des robots de taille moléculaire capables de circuler dans le corps humain, pour y nettoyer les artères ou lutter contre le processus du vieillissement, ou des interfaces cerveau-machine qui permettraient de contrôler usines et automobiles par la pensée, mais aussi de communiquer entre humains, via l’interconnexion des cerveaux. Certains ont pu parler du « small bang » des NBIC, par référence au big bang de la physique des particules…
Ce projet, doté d’importants fonds du gouvernement fédéral, a été lancé par Kim Eric Drexler, un chercheur du MIT (Massachussets Institute of Technology), sous l’impulsion de Marvin Minsky, patron du programme de l’intelligence artificielle. Pour ce dernier, le cerveau est une « meat machine » (machine de viande), et le corps humain un « bloody mess of organic matter » (sacré fouillis de matières organiques). A ses yeux, ce qui importe dans l’humain, c’est l’esprit. On peut envoyer le corps au diable pour acquérir enfin l’immortalité ! C’est aussi le point de vue de James Hughes, auteur du best-seller Citizen cyborg et professeur au Trinity College, où il enseigne la politique publique en matière de santé, de drogues et de technologies émergentes. Jean-Didier Vincent rapporte sa discussion avec cet homme engagé dans le mouvement transhumaniste depuis une dizaine d’années – il est aussi directeur exécutif de l’Institute for Ethics and Emerging Technologies, un think tank actif au niveau international en matière de transhumanisme, dont il constitue la façade ouverte vers le grand public. Pour Hughes, « une vision mauvaise d’un monde meilleur est une perversion de l’esprit ». Pourquoi refuser la santé et le bonheur pour tous, et la mort de la mort, ce noir souci ?
Il suffit de se plonger dans le livre de Ray Kurzweil Humanité 2.0 pour comprendre l’origine de ce fol objectif. Dans cette « bible du changement », il explique que d’ici un demi-siècle nous aurons les moyens de transformer nos corps, grâce à des milliards de nanorobots qui circuleront dans notre sang et dans notre cerveau. Ils « détruiront les agents pathogènes, corrigeront les erreurs de notre ADN, élimineront les toxines et effectueront toutes sortes d’autres tâches pour améliorer notre bien-être physique ». Ils interagiront avec nos neurones biologiques, avant de pouvoir les remplacer et de générer des organismes plus performants et à peu près inusables. Se dessinera ainsi la version 2.0 du corps humain où les organes biologiques, comme le coeur ou les poumons, seront remplacés par « d’autres ressources nécessaires au fonctionnement des systèmes nanorobotiques ».
L’attachement au corps sera alors archaïque et nous aurons toute latitude pour en changer à volonté. Kurzweil prédit là, sérieusement, l’émergence du corps humain version 3.0 – un corps équipé d’ordinateurs quasi invisibles qui capteront des signaux venant d’environnements virtuels, aussi réels pour eux que s’ils venaient du monde des corps physiques. Le cerveau les interprétera au même titre que les stimuli sensoriels constitutifs de toute expérience. Autrement dit, plus besoin de corps, et plus besoin non plus du monde réel ! Un scénario que des films comme Matrix ou Johnny Mnemonicnous ont rendus familiers. Leur point commun ? Ce sont des adaptations de romans de William Gibson, pape de la science-fiction version cyberpunk. Alors, la SF déteindrait-elle sur la science du futur ? C’est ce que l’écrivain Thimothy Leary soutenait. Il avait même forgé un terme, « science faction », pour désigner les mythes inspirés de la science dans le but d’agir sur la conscience collective. La nouveauté avec les transhumanistes, c’est que cette science faction est le fait non plus d’écrivains, mais d’ingénieurs, qui ont plus de moyens d’agir…
Si les neurobiologistes et les spécialistes des sciences cognitives accueillent ces prédictions avec scepticisme, d’autres s’attachent à mettre au jour les impensés qui structurent ce type de discours. Pour Jean-Michel Besnier, titulaire de la chaire de philosophie des technologies de l’information à la Sorbonne, et qui publie Demain les posthumains, « il y a beaucoup de naïveté dans ces représentations. Il n’est pas sûr qu’en éliminant ainsi le hardware on sauvegarde le logiciel. D’autant qu’un individu-logiciel serait évidemment très décevant… ». Le présupposé massif de ces spéculations n’est pas nouveau : il y aurait l’esprit d’un côté et le corps de l’autre. Autant dire que « la représentation platonicienne et judéo-chrétienne selon laquelle l’âme est dans le corps comme dans un tombeau a trouvé une nouvelle jeunesse ».
Loin d’être à l’avant-garde de la postmodernité, le transhumanisme serait le prolongement de toutes les spéculations sur les anges et la résurrection des corps. Quant à la séparation corps-esprit, Jean-Michel Besnier rappelle que les travaux de neuroscientifiques comme Antonio Damasio et la phénoménologie nous ont donné à comprendre combien le dualisme est erroné. « Nous n’avons pas un corps, nous sommes implacablement notre corps ! » Il ne s’agit pas pour autant de craindre l’irruption de la technologie dans nos corps et l’avènement des cyborgs (diminutif de cyberorganismes) : ils sont parmi nous ! Nous vivons déjà avec les stimulateurs cardiaques, les prothèses, les implants auditifs. Pour Bernard Andrieu, professeur d’épistémologie du corps et des pratiques corporelles à l’université de Nancy-I, le corps n’est pas dans ce cas augmenté mais complété, les prothèses et implants venant le réunifier en l’aidant fonctionnellement.
Dire adieu au corps naturel, c’est alors l’humaniser par l’incorporation de techniques qui sont appropriées et adaptées à chaque corps particulier en fonction de ses besoins et de ses incapacités à s’autoréparer. Problème : est-il possible de faire une différence entre l’utilisation des techniques à des fins médicales de réparation (redonner la vue à un aveugle) et à des fins d’amélioration du corps humain (donner à un soldat la possibilité de voir de nuit) ?
Sans méconnaître les objections de leurs adversaires, les transhumanistes revendiquent le dépassement de l’éthique humaniste. Pour preuve, ce dialogue imaginaire que Ray Kurzweil fait figurer dans son livre entre lui et un écologiste qu’il nomme Bill :
« — Ray : Je demande encore une fois : jusqu’où pouvons-nous aller ? Les humains remplacent déjà des parties de leur corps et de leur cerveau par des dispositifs non biologiques qui réalisent mieux leurs fonctions « humaines ».
— Bill : C’est mieux de ne remplacer que les organes et les systèmes malades ou endommagés. Mais vous remplacez en essence toute notre humanité pour améliorer les capacités de l’être humain, et ça, c’est profondément inhumain.
— Ray : Alors peut-être que notre désaccord vient de la nature de ce qu’est l’être humain. Pour moi, l’essence de l’humain n’est pas dans nos limitations – même si nous en avons beaucoup – mais dans notre capacité de les dépasser. Nous ne sommes pas restés cloués au sol. Nous ne sommes pas restés sur notre planète. Et déjà nous ne nous contentons pas des limitations de notre biologie.
— Bill : Mais nous devons utiliser ce pouvoir technologique avec une grande précaution. Au-delà d’un certain point, nous perdrons la qualité inexplicable qui donne un sens à la vie. » On ne saurait mieux dire.
Lisez l’article sur telerama.fr.












Aucun commentaire.