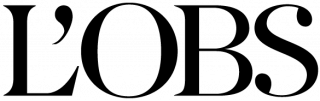
Aux sources du dépérissement démocratique
Dominique Reynié | 27 avril 2017
La confiance dans les institutions recale, le militantisme est en fort déclin et l’abstention progresse, de même que le vote en faveur de pants populistes. Pour comprendre la crise, il faut admettre qu’elle combine deux protestations : l’une pour la défense du niveau de vie, l’autre pour celle d’un style de vie à préserver. Les nouveaux populistes ont su prendre en charge ces deux protestations ;
Il faut poser l’hypothèse d’un dépérissement démocratique. Dans l’opinion, la valeur du principe démocratique est encore largement admise, mais c’est la forme qu’il prend dans le cadre institutionnel du gouvernement représentatif qui est remise en cause par une part croissante de la population (I). Les données attestent de phénomènes d’érosion de la culture civique démocratique. La confiance dans les institutions recule ; l’affiliation électorale aux partis de gouvernement est en fort déclin de même que l’adhésion aux organisations politiques et au militantisme. Par opposition, l’abstention progresse de même que le vote en faveur de partis populistes ou plus largement antisystème, réduisant la légitimité des partis appelés à gouverner en réduisant leur base électorale.
La réalité de ces tendances n’est pas contestée. L’interprétation est discutée. La perspective d’un monde fermé au choix alimente la critique, voire le rejet, de la démocratie. Il faut compter dans les causes la disparition de l’URSS, en 1991. Depuis, le monde démocratique est entré dans une histoire d’où l’alternative semble avoir disparu. Il existe une thèse qui considère ces évolutions comme le signe d’une déconsolidation démocratique ; une autre analyse privilégie l’idée d’un effet de génération, les nouvelles générations se caractérisant par un processus de désengagement politique moins en raison d’un affaiblissement de leur intérêt qu’en raison d’un progrès de la critique des formes classiques du civisme et de la politisation. Remarquons que les deux thèses se complètent plus qu’elles ne s’excluent.
De l’alternance à la rupture
Depuis le milieu des années 1980, chaque gouvernement s’est trouvé dans la nécessité de participer de plus en plus activement à un double processus de globalisation de l’économie et de déconstruction de l’État-providence. Jugées régressives, les réformes fragilisent les partis de gouvernement. La gauche est particulièrement à contre-emploi lorsqu’elle reprend à son compte le programme de l’austérité, comme si elle était désormais condamnée à choisir entre le retour aux radicalités d’hier, sans perspective, et le passage à droite pur et simple. La raréfaction des ressources publiques fait surgir de nouvelles tensions. On voit plus souvent s’exprimer des contentieux sur le fonctionnement des politiques de solidarité, le procès des « profiteurs » du système, celui d’élites jugées incapables et corrompues, de chômeurs soupçonnés de ne pas chercher un emploi, d’immigrés accusés de prendre une part indue de la solidarité nationale… Les classes populaires ont perdu quelques raisons fortes de soutenir les partis de gauche.
La poussée populiste que l’on observe partout en Europe depuis le milieu des années 1990 résulte pour une large part du basculement des classes populaires dans le vote de rupture On a pu affirmer que la droite populiste était devenue la nouvelle gauche pour les ouvriers abandonnés par les partis socialistes (2). Le rôle du travaillisme blairiste en particulier (3) et de la gauche de la Troisième voie en général, a été pointé du doigt. On a reproché à cette gauche de n’avoir été qu’une expression adoucie des partis de droite. Pour autant, l’abandon du vote de gauche par les classes populaires est antérieur à la Troisième voie. Si les ouvriers se détournent des sociaux-démocrates pour leur préférer les nouveaux populistes, ce n’est pas parce que les partis de gauche sont passés à droite, mais parce qu’ils ne défendent plus les classes confrontées au monde de la globalisation et de l’immigration. La crise de l’État providence annihile les capacités de la politique social-démocrate tandis que l’universalisme internationaliste des partis de gauche leur interdit de préférer les ouvriers nationaux aux ouvriers immigrés. L’immigration, le multiculturalisme et l’insécurité sont des thèmes de préoccupation devenus majeurs ; ils placent d’autant plus en porte-à-faux la gauche universaliste et redistributrice que la globalisation expose les travailleurs et que la crise de l’État-providence réduit les capacités nationales de protection sociale. La réaffirmation d’un nationalisme social peut donc séduire les ouvriers. Les nouveaux populistes ont suscité l’adhésion des classes populaires en proposant une sorte d’ethno-socialisme dont la préférence nationale est l’expression programmatique. Profitant de l’affaiblissement des partis de gouvernement, les populistes ont œuvré à faciliter les transferts électoraux en leur faveur, d’abord en modérant leurs critiques de l’État providence, puis en assumant un discours social.
Du pluralisme au multiculturalisme ?
La démographie est l’autre déterminant majeur de la crise. Depuis 2015, en Europe, le nombre des décès est supérieur à celui des naissances. Prospères, les démocraties sont aussi devenues des pays âgés. Le vieillissement entraîne une forme de conservatisme, l’aversion au risque, la disponibilité aux thèmes sécuritaires, une moindre tolérance au changement ou à la différence. Ce déficit des naissances appelle l’immigration. Une recomposition ethnoculturelle des sociétés démocratiques est à l’œuvre. Les écarts entre les systèmes de valeurs se creusent à nouveau; le nombre des incompréhensions et des malentendus augmente, leur intensité aussi. La multiplication de conflits interculturels à fondement religieux altère la sécularisation et les valeurs essentielles du corpus démocratique : la liberté d’opinion, la liberté d’orientation sexuelle, l’égalité homme/femme, la laïcité, etc.
Or la démocratie n’est pas qu’une affaire d’institution, mais autant et peut-être davantage une question de culture. Aucune institution ne peut engendrer la démocratie en l’absence de culture démocratique. Ce qui inquiète dans l’idée de multiculturalisme, c’est précisément l’image d’une socié- té dans laquelle cohabiteraient non seulement des systèmes culturels différents mais, plus encore, incompatibles entre eux et en contradiction avec le réfèrent commun, ouvrant le risque de substituer un séparatisme conflictuel au pluralisme démocratique. Il est certain que la question religieuse fait un retour inquiétant en régime démocratique.
Au fil du temps, à travers une immigration principalement musulmane, on voit réapparaître ces contentieux qui par nature sont capables d’une intensité maximale et dont la régulation semble hors de portée. Les musulmans sont mis en cause en bloc; certains d’entre eux s’en prennent à la société qui les accueille ou à laquelle ils appartiennent, contestent ses valeurs, voire les combattent, réclament des amendements. En témoignent l’assassinat de Pim Fortuyn, en 2002, celui de Theo Van Gogh, toujours aux Pays-Bas, en 2004, l’affaire des caricatures du prophète Mahomet, au Danemark, en Europe et dans le monde, en 2005 et 2006, ou encore l’attentat contre Charlie Hebdo, en 2015.
Partout en Europe, dans une confusion qui ne peut surprendre, le thème de l’immigration se mêle à la question des réfugiés, à l’Islam et au terrorisme islamique dont le déchaînement depuis 2001 a favorisé la fusion des discours de fermeture et la montée en puissance d’une opinion autoritariste. Certains gouvernements n’hésitent pas à prendre appui sur ce climat pour opérer une transition politique à rebours, une transition autoritaire, comme on peut craindre de le voir en Pologne ou en Hongrie. D’autres démocraties s’habituent à vivre dans un état d’urgence permanent, comme en France.
La dislocation médiatique, l’autre crise de la représentation
La crise de la démocratie procède aussi de la dislocation du monde médiatique. La multiplication des chaînes de télé- vision et de radio, associée à la propagation de l’information continue, électrise les informations et les débats, tandis que les réseaux sociaux font de chacun un média capable, à tout instant, de prendre une part active à la production et au partage d’informations et de messages.
Les nouveaux médias font subir aux médias classiques le procès en illégitimité que les populistes adressent aux partis de gouvernement. Des phénomènes de polarisation et de radicalisation se déploient sur les deux versants. Les courants populistes se coagulent sur la Toile avec une efficacité particulièrement grande, par une sorte de dynamique logarithmique des communautés qui voit des sympathisants de plus en plus croyants finir par se replier sur eux-mêmes, dans une radicalisation de leurs opinions qui rend non seulement très improbable la production d’un accord avec une partie adverse mais aussi tout échange avec elle (4). Il est difficile d’imaginer la démocratie sans un ordre médiatique relativement stable et légitime.
Que faire ? Les illusions de l’économisme et du souverainisme
La vigueur démocratique ne sera pas restaurée par le retour au plein-emploi. Parmi les pays les plus touchés par la crise populiste, certains se portent très bien : l’Autriche, les Pays-Bas ou encore les pays Scandinaves. Ce n’est pas non plus l’appartenance à l’Union européenne qui fournira la clé. Ni la Suisse ni les États-Unis n’en sont membres et pourtant, ils connaissent un puissant vote populiste. Les Britanniques n’étaient pas membres de la zone euro. La croissance, l’emploi ou l’État-providence ne sont évidemment pas sans importance; mais si l’on veut comprendre la crise, il faut admettre qu’elle combine deux protestations, l’une au nom d’un niveau de vie, un patrimoine matériel que l’on croit menacé et que l’on veut défendre ; l’autre, au nom d’un style de vie, une sorte de patrimoine immatériel, que l’on veut préserver. Les nouveaux populistes ont su habilement prendre en charge ces deux protestations. C’est le populisme patrimonial.
Dans une étude portant sur les électorats des principaux partis populistes européens, Daniel Oesch a déterminé le rôle respectif des variables économiques et des variables identitaires ou culturelles dans le vote populiste. Il conclut ainsi : « Les électeurs des partis de la droite populiste semblent plus sensibles à l’influence négative des immigrés sur la culture du pays que sur l’économie du pays. Plus encore, au sein de l’électorat des partis populistes de droite, les griefs contre l’immigration sont également plus importants au plan culturel qu’au plan économique, y compris au sein des deux catégories sociales occupant la position la plus faible sur le marché du travail : les ouvriers de l’industrie et des services. Ce résultat est cohérent avec les résultats précédents qui montrent que les scores des partis populistes de droite ne sont pas liés à des niveaux élevés de chômage. Les enjeux culturels autour de l’identité sont plus importants que les enjeux économiques autour de la question des ressources. La formule du succès électoral des Blocher, Dewinter, Hagen, Haider ou Le Pen semble claire : « C’est l’identité, idiot ! » » (5). L’analyse de l’élection présidentielle américaine de 2016 suscite des interprétations de même type (6).
Le monde démocratique est entré dans une crise profonde. Il peut ou bien ne pas s’en relever ou en bien sortir régénéré. La condition minimale pour une issue heureuse est de prendre la menace au sérieux et d’ouvrir le grand chantier de cette renaissance.
(1) Voir Roberto Stefan Fao et Yascha Mounk, « The Danger of Deconsolidation », Journal of Democracy, vol 27, n°3, juillet 2016, p. 617.
(2) lan Buruma : « Right is the New Left », The Guardian, 26 mars 2002.
(3) Cf. Anthony Giddens, Beyond Left and Right, Cambridge, Polity Press, 1994.
(4) Voir Agi Lev On et Bernard Manin, Internet : la main invisible de la délibération, h2006/5, Esprit, mai 2006, p. 195 212.
(5) Daniel Oesch, Explaining Worker’s Support for Right Wing Populist Parties in Western Europe: Evidence from Austria, Belgium, France, Norway, and Switzerland, International Political Science Review, vol. 29, if 3,juin 2008, p. 373 (traduction personnelle). « It’s the identity, stupid» est une référence a « it’s the economy, stupid» expression forgée par James Carville, stratège de la victoire de Bill Clinton contre George H. W. Bush en 1992. La phrase de Carville était destinée aux membres de l’équipe de campagne. Clinton avait ainsi réussi à retourner la situation en sa faveur en focalisant le débat sur la récession américaine tandis que George H. Bush misait sur ses succès à l’international.
(6) Alana Semuels, « It’s Not About the Economy. In an increasingly polarized country, even economie progress can’t get voters to abandon their partisan allegiance », The Atlantic, 27 décembre 2016.
DOMINIQUE REYNIE est professeur de science politique (Sciences-Pô, Paris) et directeur général de la Fondation pour I’innovation politique (www.fondapol.org). Auteur, entre autres, du Vertige social nationaliste La gauche du Non, La Table ronde 2005), et de Populismes : la pente fatale (Plon, 2011), prix du Livre politique, 2012, prix des Députes, 2012, réédité en 2013 sous le titre Les Nouveaux Populismes, (Pluriel / Fayard)
Lisez l’article sur nouvelobs.com.












Aucun commentaire.