
Ce traité qui favorise l’immigration des Algériens en France: l'héritage secret du général De Gaulle
Henri-Christian Giraud | 19 août 2023
GRAND RÉCIT - L'accord du 27 décembre 1968, qui facilite l'immigration des Algériens en France, a eu raison de ce qui avait été le cœur de la politique algérienne du général De Gaulle : éviter la submersion de la France par l'immigration.
Alors que se succèdent crises et rebondissements dans les relations franco-algériennes sous l’égide d’Emmanuel Macron et de son homologue Abdelmadjid Tebboune, l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, a jeté en mai dernier un pavé dans la mare en révélant, dans une note destinée à la Fondapol (Fondation pour l’innovation politique), l’existence d’un traité international dont l’opinion française ignorait tout : celui qui lie depuis le 27 décembre 1968 la France à la République algérienne et institue pour ses ressortissants un système préférentiel de séjour et d’immigration.
Destiné à favoriser l’immigration de travailleurs algériens en France, celui-ci a institué en effet un titre de séjour qui leur est propre et qui n’a jamais été, à ce jour, remis en question : le certificat de résidence administrative, valable dix ans pour tout immigré algérien titulaire d’un visa de plus de trois mois ; il a dans le même temps facilité pour les mêmes Algériens le regroupement familial en les dispensant de l’exigence d’intégration dans la société française. Permettant aux étudiants de transformer leur visa en titre de séjour permanent, il prévoit en outre la régularisation de tout Algérien sans papier pouvant attester de dix ans de résidence en France, ou de son mariage avec un conjoint français. Toutes dispositions exorbitantes du droit commun mais impossibles à changer par la loi puisque, en vertu de la hiérarchie des normes, les traités internationaux, dans l’ordre juridique français, l’emportent sur la législation.
Le pays a dès lors appris avec stupeur que les lois françaises successives sur l’immigration ne concernaient jamais les Algériens, alors même qu’ils constituent la première nationalité étrangère en France.
Conscient – un peu tard – du caractère scandaleux de ce particularisme, l’ancien premier ministre Édouard Philippe, s’est empressé d’appeler à la révision de l’accord « qui offre aux ressortissants algériens des avantages plus favorables que le droit commun ». D’autres se sont engouffrés à sa suite dans le même sens : Gérard Larcher, Hubert Védrine et même Manuel Valls qui n’hésite pas, désormais, à préconiser « un bras de fer avec l’Algérie ».
La précipitation des uns et des autres à s’emparer du sujet est le signe d’un grand trouble au sein d’une classe dirigeante qui cherche ses marques sur un sujet dont les émeutes de juin-juillet ont montré le caractère explosif. Une chose est sûre, comme le dit l’historien Pierre Vermeren, « un tabou sur un accord hérité du général De Gaulle est en train de sauter ». Il n’aura fallu après tout que cinquante-cinq ans…
Quand les accords d’Évian encourageaient l’immigration
Le 26 octobre 1961, le ministre de l’Intérieur, Roger Frey ayant évoqué en Conseil des ministres la présence de 400.000 Nord-Africains en France, le général De Gaulle déclare : « Quand la situation en Algérie sera réglée d’une manière ou d’une autre, il faudra aussi régler cette affaire à fond. C’est une fiction de considérer ces gens-là comme des Français pareils aux autres. Il s’agit en réalité d’une masse étrangère et il conviendra d’examiner les conditions de sa présence sur notre sol. » (Éric Roussel, De Gaulle, 2000). Or, à son départ du pouvoir en 1969, la population algérienne en France aura plus que doublé.
Fondé, semble-t-il, sur le souci louable d’éviter à la France une algérianisation progressive de son territoire et de ses mœurs (empêcher que « Colombey-les-Deux-Églises ne devienne Colombey-les-Deux-Mosquées »), la politique algérienne du général De Gaulle avait ainsi paradoxalement abouti à son contraire. Pourquoi ?
La réponse est dans la lettre des accords d’Évian. Et très précisément, dans celle de leurs annexes : l’article 2 des dispositions générales de la Déclaration des garanties (« Sauf décision de justice, tout Algérien muni d’une carte d’identité est libre de circuler entre l’Algérie et la France »), et l’article 7 de la Déclaration relative à la coopération économique et financière, selon lequel « les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l’exception des droits politiques ». Notons, pour la petite histoire, que les articles 1 et 2 du texte soumis au référendum du 8 avril 1962 se sont référés « aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 », alors que seule avait été communiquée aux électeurs la Déclaration générale du 19 mars 1962, à l’exclusion des deux autres textes. « Les électeurs français ont ainsi approuvé “des déclarations” dont, pour la plupart, ils n’avaient eu aucune connaissance ! » a, dès alors souligné le futur prix Nobel d’économie Maurice Allais (L’Algérie d’Évian, 1962).
Ces dispositions particulièrement généreuses d’Évian ne furent, paradoxalement, pas appliquées aux harkis – le « magma »,dans la bouche du chef de l’État, qui s’opposa à leur sauvetage, allant jusqu’à ordonner de les désarmer, d’en renvoyer manu militari, et par bateaux entiers, en Algérie, et même de punir les officiers qui avaient tout fait pour les sauver… On connaît le résultat : un bilan humain que les historiens évaluent à 70.000 morts. Il fallut attendre la note du 19 septembre 1962, de Georges Pompidou à Pierre Messmer, estimant « nécessaire le transfert en France des anciens supplétifs », pour qu’un certain nombre d’entre eux soient sauvés : environ 42.000 sur un total de 250.000.
D’autres, en revanche, allaient amplement profiter des largesses gaulliennes et continueraient à le faire : ceux que l’on n’attendait pas. En effet, les heurts violents qui opposent les nationalistes algériens au lendemain de la proclamation de l’indépendance, suivis de l’orientation communisante du pays sous la férule d’un Ben Bella s’affichant avec Fidel Castro et s’alignant de plus en plus sur l’URSS, déclenchent, au rebours du « mythe du retour » des immigrés au pays – credo de la Fédération de France du FLN –, un pic migratoire sans précédent : du 1er septembre 1962 au 11 novembre inclus, 91 744 entrées d’Algériens sont enregistrées en France. Au dernier trimestre de 1962, le nombre de ressortissants algériens aura augmenté de 10 % dans le seul département de la Seine et, à la migration temporaire, aura succédé, dans de nombreux cas, une migration définitive, les travailleurs, accompagnés de leurs familles souhaitant désormais s’établir définitivement en France.
Concrètement, la politique gaulliste refuse ainsi l’entrée en France à ceux qui ont pris les armes pour la défendre au profit de ceux qui ont été ses ennemis, mais qui se sont disputé le pouvoir lors de l’indépendance ; l’exode des pieds-noirs en cache un autre, qui va s’étaler dans le temps et atteindre des proportions considérables.
Atermoiements, concessions, démissions
Pour limiter l’afflux, Paris soumet aux autorités algériennes un projet préparé par trois ministères (Intérieur, Travail et Affaires étrangères) au terme duquel les travailleurs qui souhaitent venir en France pour s’y établir devront préalablement obtenir un contrat de travail auprès d’une des délégations de l’Office national de l’immigration (ONI) implantées en Algérie. Contrat de travail qui leur donnera le droit de recevoir, à leur arrivée, une « attestation d’établissement ».
Non seulement le gouvernement algérien rejette le projet, mais Bachir Boumaza, le ministre du Travail, entend créer un Office algérien d’émigration qui se chargera sur place du recrutement des travailleurs. Pour Paris, un tel office consacrerait un état de fait : seuls seraient envoyés en France les travailleurs dépourvus de qualifications et peu utiles à l’Algérie.
L’affaire traînant en longueur au profit de l’Algérie, l’ambassadeur Jean-Marcel Jeanneney ne cesse de pointer « l’attitude dilatoire » de Boumaza. Aussi, dans la perspective de la visite en France, fin novembre 1962, du ministre des Affaires étrangères algérien, Mohamed Khemisti, l’ambassadeur appelle-t-il le gouvernement à rechercher d’urgence une « solution ». Empêtré dans sa mauvaise conscience d’ancien colonisateur, celui-ci ne la trouvera pas.
Pompidou tente certes de réagir en confiant au Comité des affaires algériennes la mission d’élaborer rapidement une nouvelle réglementation assez coercitive puisque, pour pouvoir rentrer en France, les travailleurs algériens devraient, selon ses termes, obligatoirement être en possession soit d’une attestation justifiant qu’ils y sont domiciliés, soit d’un contrat d’embauche, soit d’un certificat de logement. « La réglementation restera lettre morte, constate le géopoliticien Ardavan Amir-Aslani. L’Algérie saura exploiter avec talent les aigreurs, les sentiments contradictoires et ambigus de l’opinion comme de la classe politique française à propos de la question algérienne. Sans compter que la France, sous l’autorité de Pompidou, vient d’amorcer un virage et d’engager un vaste programme infrastructurel, des autoroutes aux centrales nucléaires, des villes nouvelles au redéploiement de l’industrie sidérurgique. Tous ces chantiers ont un besoin urgent d’une main-d’œuvre de faible qualification. Dans ce contexte, les immigrés qui arrivent d’Algérie sont une manne inespérée pour le patronat français. Le gouvernement algérien n’ignore rien de ces données, ce qui lui confère de facto un sérieux avantage dans les négociations. »(L’Âge d’or de la diplomatie algérienne, 2015).
« En réalité, poursuit Ardavan Amir-Aslani avec une lucidité impitoyable, les relations avec Paris constituent un champ idéal d’expérimentation diplomatique : jusqu’où peut-on aller dans un bras de fer, sans jamais baisser sa garde ? C’est bien ainsi qu’il en ira, et les négociateurs algériens parviendront à faire céder leurs homologues français bien plus souvent que ceux-ci ne sauront les obliger à plier. L’âge d’or de la diplomatie algérienne a été ce savant dosage entre quelques principes idéologiques obstinément revendiqués et un pragmatisme impérieux, machiavélique ou calculé. »
De retour le 18 octobre 1962 d’un voyage à La Havane qui lui a fait un accueil triomphal, Ben Bella reçoit le 27 octobre Jeanneney venu se plaindre des atteintes multiples à la politique de coopération mise en œuvre depuis l’été. Mais il lui est répliqué que les Algériens sont en droit de faire valoir le transfert complet de l’ensemble des biens de l’État français à l’État algérien le jour de l’indépendance. Résultat : la France n’obtiendra même pas un transfert de propriété officiel de ses immeubles et, au terme de discussions vaines, l’ambassade se décidera à adopter une attitude « pragmatique » afin d’éviter un conflit ouvert.
La situation économique de l’État algérien enregistrant un déficit de l’ordre de 200 milliards d’anciens francs, Valéry Giscard d’Estaing, ministre de l’Économie et des Finances, s’emploie à réaliser la séparation des Trésors français et algérien prévue dans les accords d’Évian. Ce ne sera chose faite que le 12 novembre. Quatre longs mois après l’indépendance… Bien qu’annoncée à plusieurs reprises, la décision française provoque une vraie panique au sein du gouvernement algérien et, le 24 novembre, Ben Bella entreprend personnellement une démarche auprès de Jeanneney pour l’assurer de l’importance à ses yeux de la coopération avec Paris, mais aussi pour lui demander une quarantaine de milliards d’anciens francs pour compléter la provision de 10 milliards épuisée. Avec, bien sûr, promesse de mesures d’austérité budgétaire à la clé. Jeanneney se souvient avoir dû rappeler à son interlocuteur : « N’oubliez pas que, depuis le 6 juillet (sic), la France est indépendante de l’Algérie. » (Jean-Marcel Jeanneney, Une mémoire républicaine, 1997).
Le 16 novembre, lors de la réunion du Comité des affaires algériennes, l’ambassadeur croit devoir tirer la sonnette d’alarme : « Les autorités algériennes ont pris une série de dispositions d’une gravité croissante qui, appliquées sur le plan local par des fonctionnaires trop zélés, revêtent un caractère exorbitant et conduisent progressivement à la spoliation des biens français. »
De Gaulle répond alors en substance ce qui suit, que Jeanneney transcrit aussitôt : « À divers moments on a pu s’attacher à des mythes, maintenant les réalités profondes apparaissent ; la principale est l’incompatibilité de la présence côte à côte des Français et des Algériens, c’est ce qui explique et justifie ce que j’ai appelé le “dégagement”. (…) Une autre réalité qui apparaît, c’est qu’il n’y a pas d’État en Algérie parce qu’il n’y en a jamais eu contrairement au Maroc. (…) On aurait pu en Algérie faire une Assemblée algérienne digne de ce nom, lui transférer peu à peu les pouvoirs de telle manière qu’il y eût des organes de l’État le jour de l’indépendance, mais cela n’a pas été fait et ce fut la guerre. Quand nous avons cessé d’écrabouiller les Algériens, nous leur avons dit “débrouillez-vous”. Ainsi devons-nous continuer à les aider. Ce que nous pouvons faire de plus utile pour eux, c’est les former, les instruire, les élever de toute manière et surtout en accueillant leurs étudiants et leurs stagiaires en France. Ainsi pourrons-nous établir entre Français et Algériens des contacts étroits, mais sous une forme complètement différente du passé. (…) Pour ce qui est de l’immigration algérienne “ça suffit comme ça”, il ne faut pas que nous nous trouvions envahis. Là-dessus il n’y a pas d’accords d’Évian qui tiennent (sic). Quant à l’aide économique, nous devons la continuer, mais couper les vivres chaque fois qu’ils ont manqué. C’est la gymnastique de cette opération. » (CHSP, JMJ, carton 9). La suite montrera cependant que la fermeté du propos est fortement à relativiser.
Le 22 novembre, la négociation concernant le domaine immobilier de l’État français se heurtant définitivement à la politique algérienne du fait accompli, celui-ci n’invoque plus les accords d’Évian, ou ce qu’il en reste, que pour tenter d’assurer le respect de certains intérêts stratégiques français concernant principalement l’utilisation des sites sahariens (le temps nécessaire à l’expérimentation de la force de frappe) et l’exploitation partagée du pétrole saharien découvert et financé jusqu’ici, pour l’essentiel, par des sociétés françaises pour un coût de 6,8 milliards de nouveaux francs. Accessoirement, de maintenir une influence culturelle française.
« Au-delà de ces objectifs, précise l’historien Charles-Robert Ageron, le général entendait affirmer aux yeux du monde la réalité de la décolonisation française et démontrer la portée de sa nouvelle politique de coopération. Il ne s’agissait pas de tenter de ligoter le nouvel État en maintenant, d’ailleurs à grands frais, des liens de dépendance, mais bien d’aider à la réussite d’une Algérie indépendante. La France manifesterait, par une politique généreuse, son ambition d’ouverture au tiers-monde et de réconciliation avec le monde arabo-musulman. L’Algérie, qui se voulait elle-même la porte ouverte sur le tiers-monde, serait la vitrine de la politique d’aide et de coopération de la France et, comme le général le déclara, “un exemple mondial”. »(De Gaulle en son siècle, t. 6, 1992).
Une inépuisable générosité
Pari périlleux en face d’une Algérie révolutionnaire qui se donne ouvertement pour vocation d’être une sorte de Cuba africain prêt à ouvrir la base de Mers el-Kébir à l’URSS, considère publiquement la politique de coopération française comme « l’expression la plus typique du… néocolonialisme (sic) » et est décidée, d’entrée de jeu, à piétiner ses engagements !
La volonté de le tenir n’en fera pas moins l’objet, de la part de De Gaulle, d’une incroyable surenchère dans la générosité : malgré les atteintes portées aux biens et aux personnes des Français, mais aussi de la France, aucune rétorsion, jamais, ne sera décidée, et De Gaulle procédera, tout au contraire, à la restitution immédiate des fonds saisis par les autorités judiciaires françaises (5,2 millions de nouveaux francs). Après avoir maintenu pendant quatre mois après l’indépendance l’union des trésoreries française et algérienne, il versera une aide financière massive et régulière : 2,85 milliards de nouveaux francs en 1962, 1,673 milliard en 1963, 1,104 milliard en 1964, 796 millions en 1965, 699 en 1966, 633 en 1967, 177 en 1968 et 160 en 1969. De l’indépendance au départ du général De Gaulle du pouvoir, cette aide à un pays communisant procédant au massacre de nos supplétifs et de nos ressortissants atteindra ainsi, selon Charles-Robert Ageron, la somme globale de 22.306 millions de dollars ! Sans compter la mise à disposition dès 1963 de quelque 100.000 fonctionnaires français (dont 76.000 au titre de la coopération technique et 25 000 au titre de la coopération culturelle) payés à hauteur de 60 % par Paris… Durant cette même période, l’Algérie parvient dès lors à se faire attribuer, en moyenne, par an, 22 % des crédits publics et privés destinés par la France aux pays du tiers-monde. Cette proportion atteignant 75,5 % dans le cas des Etats nord-africains.
À noter que cette aide continue et massive relève de la seule volonté présidentielle. En effet, l’Algérie ne dépend pas du ministère de la Coopération, mais fait toujours partie du domaine réservé du chef de l’Etat, car après sa victoire au référendum du 8 avril 1962, De Gaulle a fait voter la loi du 13 avril 1962 qui autorise le président à conclure les accords établis conformément aux Déclarations gouvernementales du 19 mars 1962. Retirant ainsi « toute compétence directe au Parlement en matière de conclusion d’accords avec l’Algérie dans le cadre d’Evian ».
Ce gros effort financier, précise Bouhout El Mellouki Riffi, est d’ailleurs doublé d’un autre : l’adoption par De Gaulle d’une « politique d’indulgence » à l’égard des dirigeants algériens, nationalistes ombrageux, souvent animés par le ressentiment antifrançais et le radicalisme révolutionnaire. A croire, dit l’universitaire marocain, que l’Algérie, longtemps considérée par le président français comme une « entrave », une « boîte à chagrin », un « boulet » s’opposant à l’action internationale de la France et au déploiement de son influence, avait été, après sa décolonisation, et grâce au prestige acquis auprès des peuples déshérités, « promue au rang de parrain, pour ne pas dire d’étoile polaire de la politique d’ouverture sur l’extérieur, notamment sur le tiers-monde, préconisée par le général De Gaulle, à la suite des échecs subis par sa diplomatie en Occident (tentatives d’insertion de la France dans le directoire des Grands)et en Europe (plan Fouchet destiné à rendre la France indépendante des Etats-Unis au sein de l’Alliance atlantique)… »(De Gaulle en son siècle, t. 6, 1992).
À la fin de cette année 1962, frappé par « la rapidité de ce qu’on pourrait appeler la “défrancisation” comparé à ce qui s’est passé en Tunisie et au Maroc », Jeanneney croit néanmoins pouvoir indiquer que « le pire a été évité (sic) ». C’est une façon de voir les choses : on ne compte « que » 1 850 disparitions parmi les « lascars » (c’est ainsi que le chef de l’Etat appelle les Français d’Algérie).
Le 9 janvier 1963, Georges Gorse succède à Jeanneney comme ambassadeur de France et Ben Bella lui souhaite la bienvenue à sa manière en déclarant que « les accords d’Evian ne sont pas le Coran ». 382 Français seront encore enlevés au cours de l’année et l’on ne retrouvera les corps que de 41 d’entre eux. Entre-temps, le massacre des harkis et autres supplétifs se poursuit sans interruption et dans l’indifférence générale. A l’issue du Conseil des ministres du 9 octobre, De Gaulle a confié une fois pour toutes à Peyrefitte : « S’ils s’entretuent, ce n’est plus notre affaire. Nous en sommes débarrassés, vous m’entendez. Les Arabes, les Kabyles, c’est une population fondamentalement anarchique, que personne ne contrôle et qui ne se contrôle pas elle-même. » Ce qui n’empêche pas la France, malgré les nationalisations sans indemnisations et l’« opération labours » (la réforme agraire algérienne, qui se traduit par la mise en place d’une économie socialiste à marche forcée qui spolie les exploitants français), de respecter scrupuleusement ses « obligations » financières et d’assurer son effort de coopération technique et culturelle : en 1965, il y aura encore 300 médecins civils et militaires français en poste en Algérie.
Le 31 janvier 1964, De Gaulle déclare que la coopération est devenue « une grande ambition de la France », ce qui se traduit par une « inépuisable bonne volonté » (Ageron) vis-à-vis d’un État algérien particulièrement exigeant. Ainsi, le 13 mars 1964, au sortir d’un entretien avec Ben Bella au château de Champs, au cours duquel il lui a dit « observer avec bienveillance le cours des événements et souhaiter sincèrement la réussite des efforts de l’Algérie », l’intérêt de la France étant que celle-ci s’affirme « car nous avons toutes raisons de souhaiter qu’elle ne sombre pas dans la misère et dans l’anarchie », De Gaulle confie à son entourage : « Cet homme ne nous veut pas de mal. » (Hervé Bourges, L’Algérie à l’épreuve du pouvoir, 1967).
Sous la férule du président algérien, le climat d’insécurité est cependant tel en Algérie que les demandes de réintégration de fonctionnaires qui avaient signé des contrats de coopération se sont multipliées et qu’il faut compenser leur défection par l’envoi de… militaires du contingent volontaires comme coopérants techniques.
Le rêve tiers-mondiste du général De Gaulle
La raison de cette magnanimité ? « L’Algérie, déclare De Gaulle lors d’une conférence de presse en novembre 1964, est aussi et surtout la “porte étroite” par laquelle nous pénétrons dans le tiers-monde. Une brouille entre la France et l’Algérie dépasserait les limites des relations franco-algériennes et risquerait de miner les efforts de notre diplomatie dans le monde entier. »
« En somme, constate l’historien américain Matthew Connelly, les Algériens n’avaient pas seulement internationalisé leur guerre de libération, mais aussi la paix qui l’avait remplacée. » La victoire du FLN est complète.
Dans le cadre des accords d’Évian, « l’aide financière privilégiée à l’Algérie » doit s’interrompre en 1965, mais malgré l’ampleur du contentieux, Boumediene, qui a renversé Ben Bella le 19 juin 1965, obtient une rallonge de 2,65 milliards le 28 juillet suivant. Une aide, révèle Ageron, que le gouvernement français s’abstient de faire connaître à l’opinion publique, et qui s’accompagne d’un accord qui contraint la France à acheter un pétrole plus cher et l’oblige à fournir des crédits considérables. « Repoussé à deux reprises par le Sénat, indique encore l’historien, il ne fut que difficilement voté et seulement pour des raisons de politique étrangère. »
Recevant le nouvel ambassadeur, Redha Malek, De Gaulle lui déclare vouloir maintenir la coopération avec l’Algérie, « quelles que soient les péripéties qui peuvent se produire ». Le propos ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd.
Pendant la période qui va de juillet 1965 à avril 1969, le « réajustement révolutionnaire » visant à inscrire son régime dans une stratégie anti-impérialiste contre les intérêts du capitalisme français n’empêche pas le dictateur algérien, cette fois au titre de« réparation due pour le pillage du pays par le colonialisme », d’exiger de Paris une aide financière accrue qui ne puisse être remise en question par sa politique de nationalisations. C’est le ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, qu’il charge de l’affaire. Reçu à plusieurs reprises à l’Élysée, celui-ci dit espérer du président de la République « une attitude seigneuriale (sic) ». Il s’agit tout simplement d’obtenir une renonciation par Paris au règlement des créances d’État, des prêts et emprunts des collectivités publiques et des avances consolidées du Trésor faites après mars 1962, car le gouvernement algérien n’entend pas « racheter l’Algérie avec l’argent, après l’avoir rachetée par le sang de ses martyrs ».
Simultanément, précise Ageron, Alger multiplie les revendications les plus diverses : l’accroissement de l’émigration algérienne, voire la liberté totale des mouvements de populations telle qu’elle a été prévue par les accords d’Évian (40.000 « faux touristes » algériens sont venus s’installer en France au cours des quatre premiers mois de 1966 portant à 600.000 le nombre d’Algériens présents en France, dont seuls 52.200 ont le statut de Français musulmans « rapatriés »), la renégociation du statut des coopérants, l’augmentation des importations françaises de vins algériens, l’augmentation de l’aide libre, etc.
Irrité de la durée des négociations, Boumediene procède à une série de nationalisations, celle des mines et des compagnies d’assurances appartenant à des sociétés françaises, et annonce la dévolution définitive des biens français dits vacants à l’Etat algérien. Sans indemnisation. A Alger, on parle de butin de guerre. « Finalement, remarque Ageron, un accord fut signé le 23 décembre 1966, à des conditions royales, puisque la dette était réduite de 7 milliards à… 400 millions. L’accord fut tenu secret en France, pour éviter les réactions de l’opinion. »
Le traité du 27 décembre 1968
Malgré cette concession importante, les relations franco-algériennes se tendent de nouveau en 1967 autour de deux questions : l’importation de vins d’Algérie sur le marché français et l’entrée des travailleurs algériens en France. Dans les deux cas, Alger obtient largement satisfaction. Malgré les pressions des viticulteurs français, sur l’intervention directe de De Gaulle auprès de Georges Pompidou, le gouvernement français accepte de maintenir le courant d’achat des vins algériens aux prix intérieurs français. Il en sera de même l’année suivante (octobre 1968).
Le dossier de l’immigration est quant à lui l’objet du désormais fameux accord du 27 décembre 1968, qui s’inscrit ainsi comme une étape décisive de la succession de concessions et de renoncements qui caractérise la politique française depuis les accords d’Évian : le contingent annuel de nouveaux travailleurs autorisés à venir en France est porté de 12.000 à 35.000, l’entrée des Algériens en France est facilitée tandis que leur sont octroyés la liberté d’établissement commercial ou indépendant et un accès plus rapide à des titres de séjour valables dix ans.
La lettre du traité sera en outre largement dépassée par son application : au cours des trois années suivantes, 1969, 1970 et 1971, ce sont 127.000 nouveaux Algériens qui viendront s’installer en France. Soit 20 % de plus qu’il n’était prévu en 1968, sans compter l’immigration clandestine. Au départ de De Gaulle, le nombre des Algériens installés en France avoisinera (familles comprises) le million d’individus.
Lors du Conseil des ministres du 1er mai 1968, plusieurs ministres français, excédés par les surenchères algériennes et une nouvelle vague de nationalisations d’entreprises françaises, avaient osé faire valoir la nécessité d’une négociation globale sur toutes les questions litigieuses. Mais De Gaulle s’y était refusé et avait ordonné un règlement à l’amiable. Le maintien de la coopération, souligne Ageron, avait donc une fois encore été imposé par De Gaulle et cela dès avant les agitations de mai 1968 qui auraient, dit-on, affaibli sa position internationale. Et, dit encore l’historien, ce fut après les élections triomphales de juin que la France décida de renoncer à la direction bicéphale de l’Organisation de coopération industrielle (OCI) faisant du gouvernement algérien le seul maître de cette institution par laquelle transitait une partie de l’aide financière française.
Les importations de vins reprennent quant à elles en 1969 à hauteur de 5 millions d’hectolitres au prix de 84 francs l’hectolitre, l’URSS l’achetant au prix de 32,50 francs.
« Il reste à l’historien, se demande Ageron, lui-même partisan déclaré de l’indépendance de l’Algérie, à chercher pourquoi et comment [la politique de coopération] put être maintenue. »
« Pour dire les choses avec simplicité, précise-t-il, il apparaît que s’il n’y avait eu la volonté bien arrêtée du général De Gaulle de promouvoir une coopération privilégiée avec l’Algérie, République démocratique et populaire, ce qui n’était pas tellement bien vu en France, cette politique aurait été très vite arrêtée. Certes, le général n’a pas suivi dans le détail, pendant cette période, les affaires algériennes, comme il le faisait dans la période du conflit. Mais ses consignes orales ou écrites concernant la coopération avec l’Algérie restèrent toujours les mêmes et peuvent se résumer à peu près ainsi : la France est disposée à poursuivre la coopération avec l’Algérie quelles que soient les vicissitudes de celle-ci. »
En effet, chaque fois qu’il y a eu blocage dans les négociations, le chef de l’État est intervenu « discrètement ou même par écrit ». Abdelaziz Bouteflika l’a d’ailleurs reconnu devant la presse française : « Si l’Algérie a tiré profit des accords franco-algériens, elle le doit à l’aide du général De Gaulle. »
Évoquant cette étonnante indulgence à l’égard des dirigeants algériens, un observateur français, dont on croit comprendre qu’il était un familier de l’Élysée – mais dont Ageron ne cite pas le nom – a parlé de la « mystérieuse attention de De Gaulle pour l’Algérie ».
«Réparations coloniales»
Ce « mystère De Gaulle », plusieurs observateurs ont tenté de l’approcher. Très tôt, dès août 1964, le Pr William Zartman de l’université de Caroline du Sud s’est posé la question : « Mais pourquoi la France a-t-elle consenti à poursuivre la coopération ? Après l’exode des Européens, la France n’avait plus les mêmes raisons qu’auparavant d’aider une Algérie hostile. L’hypothèse selon laquelle il n’y avait pas de véritable raison en dehors de la force d’inertie ou de l’attitude correspondant à “l’habitude française” en Algérie mérite sans doute qu’on s’y arrête. Cet élément existe : l’homme auquel on a coupé une jambe continue à gratter le membre disparu. » Parmi les autres raisons, le professeur américain cite aussi : 1) le souci de la France de rendre aux Algériens l’affection qu’ils ont pour elle ; 2) le sentiment que la France a déjà tant fait en Algérie qu’il est trop tard pour se dégager ; 3) l’Algérie constitue une ouverture sur le monde socialiste selon le mot de De Gaulle : « Il n’y a encore jamais eu de coopération aussi importante entre un pays capitaliste et un pays socialiste » ; 4) la France n’a pas voulu tenter avec l’Algérie une « expérience guinéenne » : si la coopération échouait par sa faute « toute l’affaire algérienne se solderait par une défaite totale, tandis que le succès de la coopération pouvait fournir un nouveau modèle pour les relations postcoloniales et effacer l’impression défavorable qu’avait laissée la politique algérienne de la République précédente ».
Ce faisant, De Gaulle a contribué à inaugurer la politique de « réparations coloniales » donnant ainsi acte à Frantz Fanon qui écrivait : « Cette aide doit être la consécration d’une double prise de conscience : prise de conscience par les colonisés que cela leur est dû et par les puissances capitalistes qu’effectivement elles doivent payer. »(Les Damnés de la terre, 1961).
L’accord que, après Édouard Philippe, toute une partie de la classe politique française veut désormais remettre en question n’apparaît ainsi nullement comme une aberration, un acte politique marqué par un manque singulier de sens de l’anticipation. Il s’inscrit bien plutôt dans une logique politique qui avait consisté à acheter la bienveillance du tiers-monde, fût-ce au prix des intérêts du pays, dans la perspective du nouveau rôle que le général De Gaulle rêvait de jouer sur la scène internationale. L’illusion a été payée, depuis cinquante-cinq ans au prix fort. Elle constitue l’héritage le moins connu du gaullisme. Les émeutes qui ont secoué la France en ce début d’été 2023 montrent qu’il n’est pas sûr que ce soit le moins lourd de conséquences pour la France.
Retrouvez l’article sur lefigaro.fr
Xavier Driencourt, Politique migratoire : que faire de l’accord franco-algérien de 1968 ?, Fondation pour l’innovation politique, mai 2023
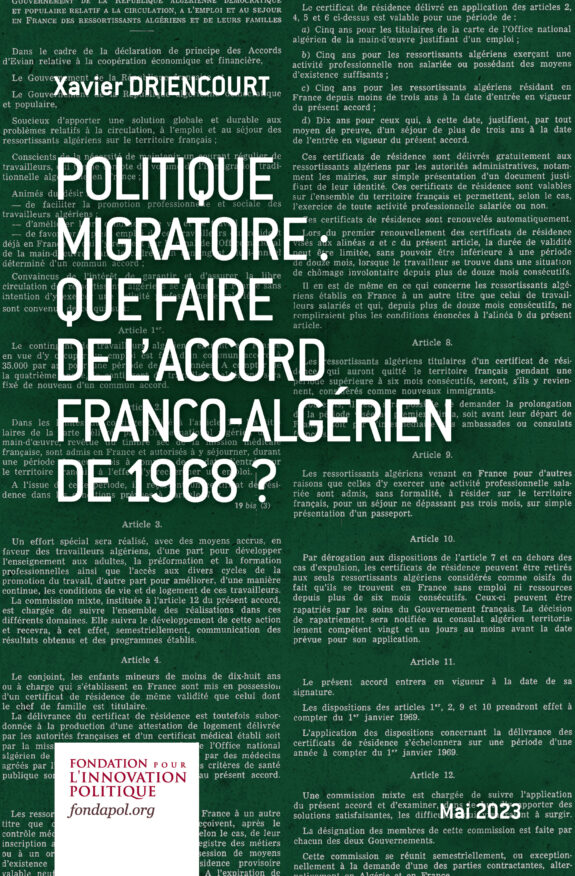












Aucun commentaire.