
La démocratie menacée par le terrorisme
Cyrille Bret | 14 avril 2021
Frappées par des attentats islamistes, les sociétés occidentales sont tentées d’adhérer à la rhétorique des djihadistes opposant Islam et Occident. Une illusion dangereuse. Mais la démocratie est moins fragile qu’il n’y paraît.
Au XXIe siècle, l’attentat terroriste est devenu synonyme d’attaque contre l’Occident. Explicitement désigné comme cible principale par les organisations djihadistes internationales telles que le groupe État islamique (El) et al-Qaida, l’Occident a le sentiment d’être une victime indéfiniment exposée à une menace impossible à éradiquer. Des attentats de 2001 à New York aux meurtres de l’automne 2020 à Paris, Conflans-Sainte-Honorine et Nice, le terrorisme a constamment changé ses modes d’action. Imprévisible, il est devenu le talon d’Achille des démocraties occidentales. Ainsi, depuis 20 ans, les relations internationales paraissent structurées par une lutte planétaire entre, d’une part, les terroristes islamistes et, de l’autre, les États occidentaux.
Le combat mondial entre Islam et Occident est le credo des organisations terroristes. De communiqués de presse en revendications d’attentats, ces mouvements armés placent leurs crimes sous le signe d’une contre-croisade à mener contre les Occidentaux, leurs valeurs, leurs États, leurs cultures et leurs intérêts. Ils prétendent hâter le déclin des sociétés d’Europe et d’Amérique du Nord. Et, à la différence des mafias, ils se disent investis d’une mission historique : abattre une civilisation pour en promouvoir une autre. Cependant, par-delà les déclarations idéologiques et les réquisitoires sectaires, qu’en est-il au juste ? L’Occident est-il le seul visé aujourd’hui par le terrorisme contemporain ? Et ce dernier s’impose-t-il à lui comme un corps étranger et une menace extérieure ? La réalité se révèle plus complexe et dépasse l’affrontement binaire Islam-Occident. Ce qui se joue est en fait une tension entre la politique démocratique et le refus violent de la politique.
La tentation de restreindre les libertés…
Si l’Occident est devenu la victime désignée de l’islamisme armé, la forme de terrorisme la plus visible, c’est parce que les djihadistes ont su exploiter les marges de liberté garanties par les sociétés occidentales comme autant de vulnérabilités. Les libertés de circuler, de communiquer, de commercer, de s’exprimer, de créer des associations, de pratiquer les cultes sont les armes de leur combat. La mémoire douloureuse des attentats commis à Londres le 7 juillet 2005 en donne une illustration tragique : métropole mondialisée attirant et protégeant des populations du monde entier, la capitale britannique s’est sentie piégée par sa propre ouverture internationale lorsque quatre explosions dans les transports en commun y ont fait 52 morts et 784 blessés. Immédiatement après, bien des voix se sont élevées au Royaume-Uni et en Europe pour critiquer la tolérance (et le laxisme supposé) du Londonistan à l’égard des musulmans. Dans ces attentats comme dans bien d’autres, non seulement les djihadistes ont retourné les libertés contre les démocraties d’Occident, mais ils les ont fait douter d’elles-mêmes et les ont poussées à renier leurs principes.
Pour défendre l’Occident, certains responsables politiques n’ont pas hésité à adopter cette vision binaire des relations internationales. En déclenchant en 2001 une guerre mondiale contre le terrorisme (Global War on Terror), l’administration américaine de George W. Bush a fait sienne une version simplifiée du Choc des civilisations de Samuel Huntington (paru en 1996 aux États-Unis), et réduit l’histoire du monde contemporain à un affrontement entre un Occident dirigé parles États-Unis et un terrorisme intrinsèquement islamiste. Une grille de lecture renforcée par les djihadistes à coups d’explosifs et de mitraillages. Si bien qu’à l’issue de deux décennies d’attentats, l’Occident considère que le combat contre le terrorisme prime sur la lutte contre le réchauffement climatique, la révolution numérique ou le retour de la puissance chinoise.
Les sociétés démocratiques se sentent enfermées dans cette alternative insoluble. C’est pourtant une illusion diffusée à des fins de propagande par les agences de presse d’al-Qaida et de l’EI. Et une simplification grossière du terrorisme aujourd’hui. Pour s’en convaincre, faisons tout d’abord un pas en arrière dans l’histoire de l’Occident. Ce dernier a été longtemps touché par des terrorismes qui n’avaient rien d’islamistes. Combattu pour son colonialisme après la Seconde Guerre mondiale, il a subi de nombreux attentats de la part des mouvements de libération nationale, en Europe, en Asie et en Afrique. Il a aussi été frappé, à partir des années 1970, par des organisations communistes armées comme les Brigades rouges en Italie, Action directe en France ou la Fraction armée rouge en Allemagne. Autrement dit, le djihadisme est loin d’avoir le triste monopole du terrorisme.
En outre, l’Occident n’est pas la seule cible des terroristes islamistes. C’est ce que montre la banque de données de la Fondation pour l’innovation politique : entre 1979 et 2019, les organisations islamistes ont perpétré 18,8 % des attentats et ont fait 39,1 % des victimes du terrorisme dans le monde. Mais la majorité de ces victimes sont des musulmans (91,2 %) vivant dans des pays musulmans.
D’autres événements incitent à changer de perspective sur les relations entre Occident et terrorisme. Plusieurs pays non-occidentaux font l’objet de campagnes terroristes de longue durée et de haute intensité à travers le monde, comme le Pérou, la Russie, l’Indonésie ou les Philippines. En particulier, la démocratie indienne est elle aussi en butte aux attentats de mouvements djihadistes basés au Pakistan qui prétendent défendre la forte minorité musulmane du sous-continent. Les attentats de novembre 2008 à Bombay ont changé la politique indienne et bouleversé la donne régionale. Le pays est aussi frappé par les attentats des naxalites, qui réclament une réforme agraire au profit des paysans pauvres.
… et le risque de céder à la violence
Certains Occidentaux organisent eux-mêmes des attentats au nom de la défense de l’Occident. La tuerie d’Utoya, en Norvège, le 22 juillet 2011, a incité les sociétés occidentales à revoir leur conception du terrorisme. En effet, ce jour-là, un Norvégien, Anders Behring Breivik, a assassiné à l’arme automatique 69 personnes appartenant aux jeunesses socialistes pour défendre son pays contre son supposé laxisme face à l’invasion musulmane en Europe. Le paradoxe est ici sanglant : c’est l’Occident qui se fait terroriste contre des Occidentaux pour lutter contre l’islam.
Ainsi, même si, pour les Occidentaux, les attentats djihadistes contre leurs propres sociétés sont les plus douloureusement perceptibles, ils ne doivent pas céder à l’illusion de l’« occidentalocentrisme » et penser qu’ils sont les victimes principales (si ce n’est uniques) du terrorisme contemporain. Le terrorisme est pluriel dans ses manifestations, car il est devenu une forme, aujourd’hui en essor, de la violence politique.
Profondément choquées par les attentats, les démocraties se croient plus fragiles que les régimes autoritaires face aux terroristes. Il est vrai que la liberté de la presse permet de propager très rapidement le choc médiatique des attentats dans les sociétés ouvertes. Il est avéré que les règles de l’État de droit n’offrent pas aux forces de police les mêmes latitudes de surveillance, d’investigation et d’action dans les démocraties et dans les régimes policiers. Il est enfin certain que l’union sacrée se fait plus immédiatement sous la houlette d’un pouvoir fort que dans une société où l’État ne contrôle pas tout. Est-ce à dire que les démocraties en général et les sociétés occidentales en particulier sont plus démunies pour résister aux attentats terroristes ?
Des ressources pour résister
La résilience des démocraties ne doit pas être sous-estimée, car elle repose précisément sur l’autonomie dont y jouit la société civile. Selon le régime politique, le terrorisme n’a pas la même portée : pour les régimes autoritaires, les attentats sont des offenses à la puissance de l’État, alors qu’en démocratie ils sont avant tout des atteintes aux citoyens et à leurs droits. L’antiterrorisme n’a par conséquent pas la même finalité dans les deux cas : pour un pouvoir fort, l’urgence est de rétablir l’autorité de l’État face à des rebelles ; pour une démocratie, l’objectif est de supprimer une menace pesant sur les droits fondamentaux : circuler, travailler, s’exprimer, etc. Lutter contre le terrorisme a un sens particulier pour les démocraties. Celles-ci ne peuvent se contenter de rétablir l’ordre. Il leur faut aussi réparer le lien social, un moment troué par l’irruption de la violence. Les démocraties ont une vulnérabilité accrue à court terme, mais aussi des ressources et des résiliences bien plus grandes à long terme. La lutte contre le terrorisme ne peut se résumer aux enquêtes, aux procès et aux condamnations pénales, aussi indispensables soient-ils. En effet, l’attentat ébranle l’édifice social, car il prétend anéantir un modèle de société, un régime politique et même une civilisation. Pour surmonter cette agression, un sursaut autonome de la société civile est nécessaire pour manifester son refus, construire un récit collectif et se mobiliser.
Après les attentats de la gare d’Atocha en 2004, les citoyens espagnols ont montré la vigueur de leurs aspirations démocratiques : contre les consignes de prudence des autorités politiques, ils se sont massivement rassemblés pour manifester à travers le pays plusieurs jours durant. Mais ils ont également contesté la version officielle des attentats les imputant d’emblée aux terroristes de l’ETA. Non seulement l’ordre a été rétabli par les services spécialisés, mais le refus de la violence politique a été porté au centre du débat politique par la société elle-même. Face au terrorisme, les démocraties occidentales peuvent s’appuyer sur la résilience de leurs propres sociétés civiles.
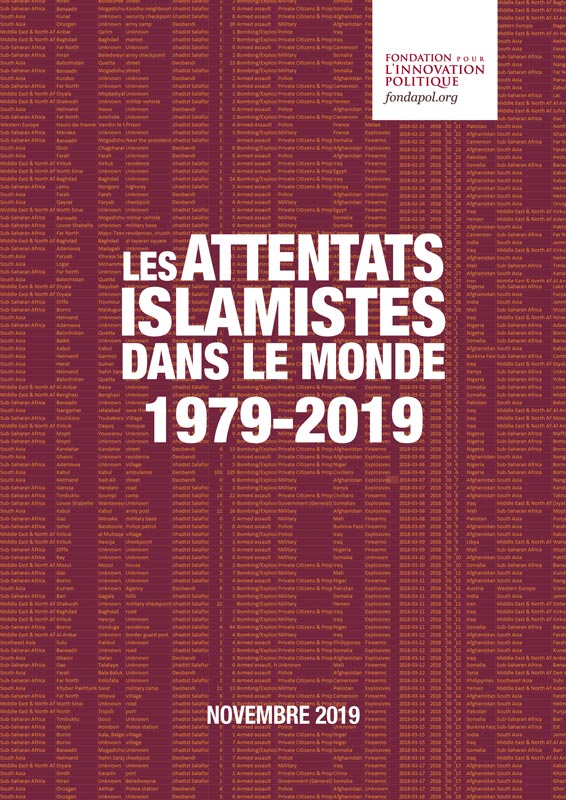
Dominique Reynié (dir.), Les attentats islamistes dans le monde 1979-2019, (Fondation pour l’innovation politique, novembre 2019).












Aucun commentaire.