
L’abstention: quelles causes ? Quels moyens d’y remédier ?
Guillaume Tabard | 16 novembre 2021
Remise au président de l’Assemblée nationale, une étude de la Fondation pour l'innovation politique analyse les raisons du recul de la participation électorale, et préconise des remèdes davantage politiques que techniques.
« L’abstention est entrée dans notre démocratie. Elle fait désormais partie de notre vie politique. » Ce constat, régulièrement dressé au soir de chaque scrutin, est étayé par une longue étude de la Fondation pour l’innovation politique, le think-tank « libéral, progressiste et européen » , dirigé par Dominique Reynié. C’est au lendemain des régionales de juin, marquées par un record de 66,72 % de non-participation au vote, que le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, avait lancé une mission d’information sur l’abstention. C’est dans le cadre de cette mission que la Fondation pour l’innovation politique s’est livrée à une enquête approfondie dont les conclusions, assorties de suggestions concrètes, viennent d’être remises.
Une abstention en hausse depuis trente ans
Remontant à l’instauration du suffrage universel en France, en 1848, les auteurs du rapport de la Fondapol constatent une grande stabilité de la participation aux scrutins majeurs, autour de 80 %, jusqu’en 1988. Ils situent la césure au lendemain de la réélection de François Mitterrand, avec une première alerte dès les municipales de 1989, avec une abstention atteignant déjà 27,2 %, inhabituelle pour ce scrutin de proximité prisé des Français. Moins identifiées, les départementales et les régionales ont été les premières frappées par une désaffection significative. Mais même la présidentielle, « élection reine sous la Ve République » , a été touchée, avec un taux de 28,4 % au premier tour de 2002, l’année qui vit s’opposer en finale Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Au second tour, l’abstention est passée de 16 % en 2007 à 19,6 % en 2012 et 25,4 % en 2017, année de l’élection d’Emmanuel Macron.
Le rapport souligne que les abstentionnistes ne constituent pas un bloc homogène. Ainsi, selon une analyse de l’Insee portant sur les quatre tours successifs de 2017 – deux à la présidentielle, deux aux législatives -, 14 % des Français « seulement » ont boudé systématiquement tandis que 51 % sont restés chez eux au moins un de ces quatre dimanches.
Aux régionales enfin, le nombre d’abstentionnistes a quasiment doublé de 2004 (16,4 millions) à 2021 (30,65 millions).
La sécession des jeunes et des CSP
L’étude de la Fondapol distingue « l’abstention permanente » , estimée autour de 10 % des inscrits, de « l’abstention intermittente » , tendant à devenir la règle, relevant de considérations politiques et sociologiques.
La première catégorie s’explique essentiellement par une non-inscription sur les listes électorales, ou la « mal-inscription » , un déménagement ne s’accompagnant pas toujours d’une réinscription sur le nouveau lieu de domicile. « La non-inscription, illustrant une forme de mise hors jeu, est d’autant plus forte dans les quartiers ou zones géographiques les moins favorisées, atteignant parfois jusqu’à 30 % d’adultes en droit de voter absents des listes électorales » , écrit ainsi le rapport.
Sans surprise, les plus jeunes et les catégories les moins favorisées sont plus enclines à l’abstention. Aux régionales de 2010 par exemple (d’après une étude de Pascal Perrineau), 70 % des 18-24 ans, contre 28 % des plus de 60 ans, et 65 % des employés et ouvriers, contre 45 % des cadres et professions intellectuelles supérieures.
Mais au-delà des chiffres, la Fondapol souligne des causes profondes comme « la lassitude de l’électorat à l’encontre des alternances politiques et la diminution de la croyance dans la capacité du pouvoir à agir » , et, bien entendu, l’expression d’un choix protestataire, « ne pas se rendre aux urnes offrant la possibilité de manifester un refus de participer à un système dans lequel on ne croit plus » . 30 % de ceux qui envisagent de s’abstenir à la prochaine présidentielle disent ainsi « avoir le sentiment que c’est la même politique qui est menée quel que soit le parti au pouvoir » (enquête Fondapol sur « Le risque populiste en France » ).
Redonner ses lettres de noblesse au vote
L’intérêt majeur de cette étude n’est toutefois pas descriptif mais prospectif. L’équipe animée par Dominique Reynié formule vingt et une propositions.
Certaines touchent à l’organisation des scrutins. Classiques comme la facilitation de l’inscription sur les listes, éventuellement jusqu’au jour même d’une élection, ou l’octroi du droit de vote dès 16 ans ; plus originales comme la proposition de bureaux de vote itinérants, circulant d’un lieu à une autre sur l’ensemble de la journée électorale.
Mais la Fondapol prend le contrepied de bien des suggestions à la mode, à commencer par la généralisation du vote à distance via internet. Le transfert du geste électoral vers l’espace privé ou professionnel ne ferait qu’ouvrir aux risques de pressions de toute sorte (viol du secret, que garantit l’isoloir, menaces, voire corruption). De même, « le vote obligatoire est à proscrire » , écrivent les auteurs. D’abord parce que cela rend l’électeur responsable unique de l’abstention alors qu’il « revient aux gouvernants et aux élus de faire en sorte que l’on retrouve l’intérêt pour le vote » ; ensuite parce que l’obligation peut « favoriser la radicalisation des comportements électoraux » .
Ces illusions pointées, l’étude en appelle à une réflexion de fond sur la nature du vote. En redorant son blason par rapport à d’autres procédures délibératives. Ils critiquent par exemple le choix d’une Convention citoyenne au lendemain de municipales marquées par une trop forte abstention. « On pouvait y lire l’expression d’un déclassement de la procédure électorale, d’une préférence pour une modalité non élective de désignation des assemblées, y compris en donnant le sentiment que le tirage au sort allait orienter le travail des élus. Le suffrage universel et la fonction législative pouvaient s’en retrouver sinon disqualifiés, à tout le moins déclassés. » Plus politiques, ils soulignent qu’il est « paradoxal et maladroit de stigmatiser et de disqualifier moralement les choix électoraux des classes populaires, lorsque celles-ci votent pour des partis qualifiés d’antisystème, d’extrêmes ou de populistes ». On l’a compris pour la Fondapol, la lutte contre l’abstention n’appelle pas une boîte à outils mais un meilleur respect des citoyens.
Lire l’article sur lefigaro.fr.
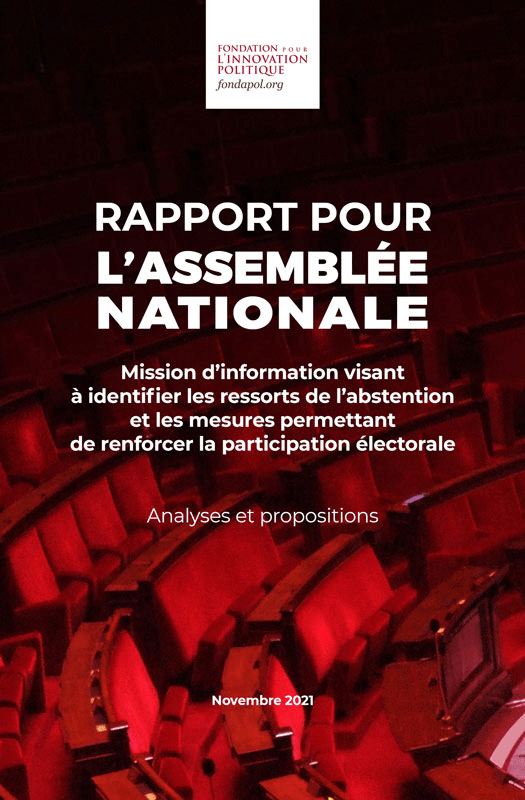
Dominique Reynié (dir.), Rapport pour l’Assemblée nationale. Mission d’information visant à identifier les ressorts de l’abstention et les mesures permettant de renforcer la participation électorale, (Fondation pour l’innovation politique, novembre 2021).
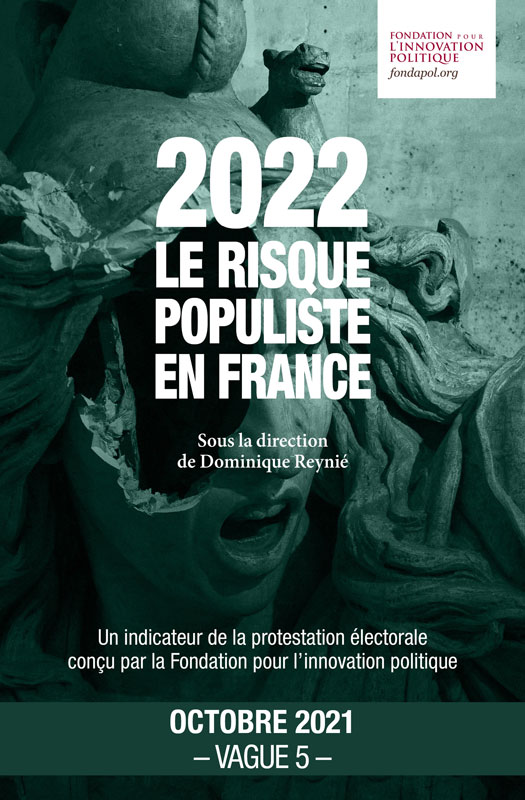
Dominique Reynié (dir.), 2022, le risque populiste en France (vague 5), (Fondation pour l’innovation politique, octobre 2021).












Aucun commentaire.