Dessine-moi un monde
Jean Sénié | 17 avril 2017
 Les réflexions sur la mondialisation ont popularisé l’image d’un monde devenu uniforme, homogène ou encore plat, à la suite des travaux de Thomas Friedman, où tous les espaces seraient désormais interchangeables, un simple ensemble de coordonnées identiques. L’anthropologue Marc Augé a forgé le concept de « non-lieu » pour définir ce type d’espace. Cette vision de la mondialisation alimenterait le moulin de ceux qui voient dans ce phénomène complexe un rouleau compresseur de la diversité des lieux et, donc, de la richesse du monde. Contre cette vision simpliste, Michel Lussault a entrepris de rappeler l’importance de la géographie. Il opère à deux niveaux, en rappelant que l’action humaine s’inscrit toujours dans un espace, avec lequel elle entretient une relation d’interdépendance, et que l’imaginaire des hommes est aussi un imaginaire de l’espace. Cette réflexion, commencée en 2007 avec L’homme spatial, poursuivie en 2013 avec L’Avènement du Monde. Essai sur l’habitation humaine de la Terre, touche à son terme, avec un dernier ouvrage intitulé Hyper-lieux. Les nouvelles géographies de la mondialisation.
Les réflexions sur la mondialisation ont popularisé l’image d’un monde devenu uniforme, homogène ou encore plat, à la suite des travaux de Thomas Friedman, où tous les espaces seraient désormais interchangeables, un simple ensemble de coordonnées identiques. L’anthropologue Marc Augé a forgé le concept de « non-lieu » pour définir ce type d’espace. Cette vision de la mondialisation alimenterait le moulin de ceux qui voient dans ce phénomène complexe un rouleau compresseur de la diversité des lieux et, donc, de la richesse du monde. Contre cette vision simpliste, Michel Lussault a entrepris de rappeler l’importance de la géographie. Il opère à deux niveaux, en rappelant que l’action humaine s’inscrit toujours dans un espace, avec lequel elle entretient une relation d’interdépendance, et que l’imaginaire des hommes est aussi un imaginaire de l’espace. Cette réflexion, commencée en 2007 avec L’homme spatial, poursuivie en 2013 avec L’Avènement du Monde. Essai sur l’habitation humaine de la Terre, touche à son terme, avec un dernier ouvrage intitulé Hyper-lieux. Les nouvelles géographies de la mondialisation.
Le géographe vient rappeler que, loin d’effacer les différences locales, la mondialisation les enrichit. D’une part, elle réinvestit d’anciens lieux d’une nouvelle signification spatiale et d’autre part elle contribue à en créer de nouveaux. La mondialisation est donc génératrice d’aspérités, de « lieux singuliers, inscrits dans un ici insubstituable et dispersés dans l’ailleurs » (p. 16), qui sont autant de démentis d’une vision aplanissante. L’auteur s’intéresse plus particulièrement dans ce livre à ce qui constitue les lieux les plus caractéristiques de cette nouvelle géographie. Il définit ces « hyper-lieux » en fonction de cinq critères : « intensité et la diversité », l’ « hyperspatialité », l’ « hyperscalarité », la « dimension expérientielle » et enfin l’ « affinité spatiale » (p. 55-60). L’exemple paradigmatique, qui lui permet d’illustrer son concept d’« hyper-lieu », est Times Square. L’analyse peut ensuite dériver depuis le mall de Bloomington dans le Minnesota aux gares de Shibuya et de Shinjuka à Tokyo, en passant par un aéroport comme Roissy-Charles-De-Gaulle. Toutefois, l’intérêt de la définition de l’« hyper-lieux » est d’ajouter une dimension à la réflexion du géographe, liée aux événements qui font lieu. C’est le cas de Fukushima, qui est devenu un lieu mondialement connu en raison de l’accident nucléaire de mars 2011. C’est aussi valable pour la jungle de Calais, devenue l’illustration même de ces « hyper-lieux » et des enjeux qu’ils posent. Le cas de Calais et de sa jungle permet en outre à l’auteur d’introduire la dimension politique à sa recherche autour du concept. Michel Lussault vient ainsi rappeler l’existence de la dimension spatiale, de ses spécificités et de l’indispensable prise en compte du local dans toute analyse de la mondialisation. Il prend d’ailleurs bien soin de distinguer la mondialisation comme « une mutation de l’ordre de l’habitation humaine de la planète » (p. 21) de la globalisation, processus économique et financier. La mondialisation apparaît ainsi comme une dimension essentielle, même si non exclusive, de notre perception de l’espace, de plus en plus marquée par la conscience d’habiter le Monde.
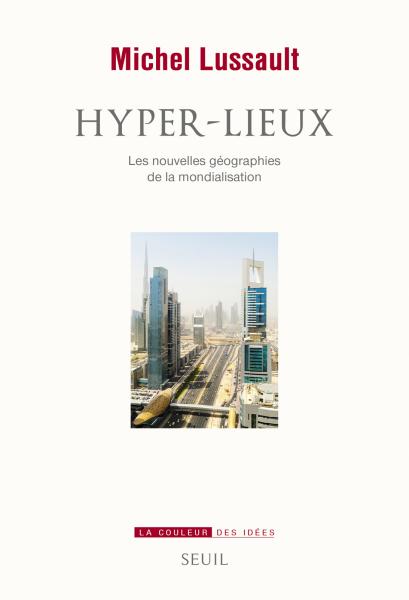 L’auteur s’attelle aussi à dresser une typologie des lieux. On retrouve ainsi dans son livre les « hyper-lieux » mais aussi les « alter-lieux » et les « contre-lieux » où se dessine l’idée d’une critique virulente de la mondialisation capitaliste, comme dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou dans la vallée de la Suse avec les NO TAV. A cet égard, il faut savoir gré au spécialiste de rappeler que la géographie est une science sociale traitant de l’action humaine dans l’espace et des rapports qu’elle entretient avec celui-ci et de mettre en avant la question fondamentale de l’« habiter ». L’intérêt porté à ces mouvements inédits montre que le renouveau des pratiques politiques implique une inscription spatiale réinventée de ces mêmes pratiques. C’est sur ce point que la réflexion de Michel Lussault est à la fois la plus novatrice et, en même temps, la plus discutable. Elle pose, en effet, la théorie que la jungle de Calais, la Puerta del Sol, occupée par les Indignados, ou encore Zuccotti Park, sont autant de lieux où s’invente une nouvelle forme de cohabitation. Comme il l’écrit à propos de la jungle de Calais, « un lieu de vie différent était en passe de se construire dans cette fraction du Monde implantée à Calais, une sorte d’alter-lieu donc, incident, non intentionnel, certes, mais portant en lui une autre vision de la co-habitation urbaine : plus spontanée, informelle, souple, sobre, autoconstruite ». (p. 194). L’auteur se défend de toute vision irénique ou naïve de la mondialisation et il réaffirme les difficultés des conditions de vie dans la jungle. Pour autant, persiste toujours l’impression que son discours finit par préférer ceux qui sont en mouvement à ceux qui sont déjà là, ou plutôt par refuser de considérer ces caractérisations pour leur préférer une définition spatiale, fondée sur la coprésence. Cela revient à dire que le commun serait déterminé par la présence commune d’individus dans le même lieu. Le lieu imposerait ainsi une nouvelle définition spatiale de la société qui, au final, serait la plus positive. Pourtant, dans le cas de Calais, la critique de la municipalité et des autorités administratives, à commencer par le préfet, oblitère la question des enjeux et des comportements politiques français[1].
L’auteur s’attelle aussi à dresser une typologie des lieux. On retrouve ainsi dans son livre les « hyper-lieux » mais aussi les « alter-lieux » et les « contre-lieux » où se dessine l’idée d’une critique virulente de la mondialisation capitaliste, comme dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou dans la vallée de la Suse avec les NO TAV. A cet égard, il faut savoir gré au spécialiste de rappeler que la géographie est une science sociale traitant de l’action humaine dans l’espace et des rapports qu’elle entretient avec celui-ci et de mettre en avant la question fondamentale de l’« habiter ». L’intérêt porté à ces mouvements inédits montre que le renouveau des pratiques politiques implique une inscription spatiale réinventée de ces mêmes pratiques. C’est sur ce point que la réflexion de Michel Lussault est à la fois la plus novatrice et, en même temps, la plus discutable. Elle pose, en effet, la théorie que la jungle de Calais, la Puerta del Sol, occupée par les Indignados, ou encore Zuccotti Park, sont autant de lieux où s’invente une nouvelle forme de cohabitation. Comme il l’écrit à propos de la jungle de Calais, « un lieu de vie différent était en passe de se construire dans cette fraction du Monde implantée à Calais, une sorte d’alter-lieu donc, incident, non intentionnel, certes, mais portant en lui une autre vision de la co-habitation urbaine : plus spontanée, informelle, souple, sobre, autoconstruite ». (p. 194). L’auteur se défend de toute vision irénique ou naïve de la mondialisation et il réaffirme les difficultés des conditions de vie dans la jungle. Pour autant, persiste toujours l’impression que son discours finit par préférer ceux qui sont en mouvement à ceux qui sont déjà là, ou plutôt par refuser de considérer ces caractérisations pour leur préférer une définition spatiale, fondée sur la coprésence. Cela revient à dire que le commun serait déterminé par la présence commune d’individus dans le même lieu. Le lieu imposerait ainsi une nouvelle définition spatiale de la société qui, au final, serait la plus positive. Pourtant, dans le cas de Calais, la critique de la municipalité et des autorités administratives, à commencer par le préfet, oblitère la question des enjeux et des comportements politiques français[1].
L’auteur ne cache pas sa circonspection à l’égard des formes de « néolocalismes ». Il déplore la volonté d’isolement qui parcourt une partie de la société française (p. 294). Il voit bien que l’apologie du local est souvent une façon de « dresser en creux le portrait d’un Monde métropolisé, fabriqué de mouvements aliénants et mensongers » (p. 266). La critique de la mondialisation se fait souvent de manière paresseuse au nom d’un imaginaire de la nature fantasmé. Mais, il en vient à critiquer l’autochtonie, le désir d’enracinement auquel il préfère celui de l’ancrage, puisque ce dernier laisse toujours subsister la possibilité de prendre le large. On peut alors se demander si l’ouvrage ne passe pas sur un autre plan, entraînant le lecteur du descriptif au prescriptif. La mondialisation, dont Michel Lussault expose avec patience et rigueur les traductions spatiales et les innovations géographiques, devient alors un processus, peut-être trop unilatéralement, positif. Cette interrogation n’interdit pas d’apprécier le livre de Michel Lussault à sa juste valeur, c’est-à-dire celle d’une réflexion théorique d’ampleur, pour saisir la nouvelle géographie qui se met en place à l’heure de l’Anthropocène.
[1] http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-calais-miroir-francais-de-la-crise-migratoire-europeenne-1/












Aucun commentaire.