« Je selfie donc je suis » : les métamorphoses du moi à l’ère du virtuel
Farid Gueham | 19 janvier 2017
 Je selfie donc je suis – Les métamorphoses du moi à l’ère du virtuel de Elsa Godart, Editions Albin Michel, 2016, 224 pages, 16 €
Je selfie donc je suis – Les métamorphoses du moi à l’ère du virtuel de Elsa Godart, Editions Albin Michel, 2016, 224 pages, 16 €
« Ainsi, ce moment où le sujet humain a basculé par le biais du numérique dans un nouveau rapport à lui-même et au monde, on pourrait aujourd’hui l’appeler le stade du selfie, tant c’est moins, en réalité, le monde qui a changé que la perception que nous en avons et, tant ce changement de perception est illustré par l’immixtion entre lui et nous de cet objet hybride omniprésent à la fois téléphone, écran, appareil photo et ordinateur, que nous qualifions d’intelligent et que nous appelons smartphone ».
Le selfie, une révolution technologique
Dans son essai, Je selfie donc je suis, Elsa Godart prend la mesure d’un rituel au premier abord anecdotique mais qui bouleverse, néanmoins, nos modes de vie : le selfie. Une rupture majeure de nos usages portée par la démocratisation et l’avènement du téléphone portable. Nos smartphones nous rendent joignables, partout et tout le temps, un accroissement de la disponibilité inversement proportionnel à la pauvresse de nos échanges par sms. La perche a remplacé la main, cette main qu’Aristote décrivait comme le prolongement de la raison et de l’intelligence humaine. Un remplacement peu rassurant, tant les dérives et dangers du selfie ponctuent chaque jour l’expérience d’événements aussi tragiques que pathétiques : accidents, images morbides, publicité déguisée.
La révolution humaine, les métamorphoses du moi
La banalisation du selfie, c’est aussi le sacre de l’immédiateté qui aplanit le désir et la perspective de son devenir, c’est à dire, sa satisfaction. Une nouvelle ère que le politologue Zaki Laïdi décrit comme l’ère de « l’homme présent ». Encapsulés dans nos smartphones, le temps et l’espace se retrouvent ainsi pliés et repliés sur eux-mêmes. « L’immédiat connectique, c’est le temps virtuel. C’est une réduction de ces trois dimensions (passé, présent et avenir), à une seule par l’effet de la connexion : l’immédiat. Ainsi, en deux ou trois clics, nous sommes hic et nunc, ici et maintenant, connectés dans l’espace et dans le temps », précise Elsa Godart.
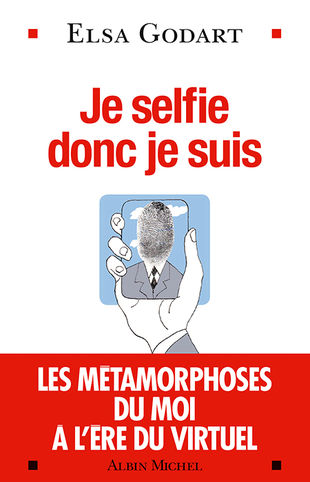 Une révolution sociale et culturelle : vers le marketing de soi
Une révolution sociale et culturelle : vers le marketing de soi
Dans le sillage du selfie, un nouveau mode de promotion se met en place : le selfbranding, vecteur d’une image de soi travaillée et finement mise en scène au sein de « l’égosphère ». Une vitrine qui n’est plus l’apanage des personnalités médiatiques ou des starlettes de téléréalité. Chacun peut, à travers les réseaux sociaux, construire et façonner l’image qu’il souhaite donner à montrer. « Si Kim kardashian a fait du selfie sa marque de fabrique et surtout un véritable business, tout le monde ne se retrouve pas dans la même démarche. Et l’autopromotion, dans un registre plus anonyme, peut prendre une autre forme que celle de la publicité pure : celle de l’estime de soi ». Revers de cette quête à l’exposition, le selfie est aussi le révélateur d’une fragilité narcissique, car la mise en scène et l’iconisation de son identité n’est pas sans conséquence sur l’équilibre de chacun. Et cela, car le selfie a bien fait émerger une nouvelle dimension de notre personnalité, que l’auteur décrit comme l’expression du « soi digital ». Cette nouvelle identité, nous pouvons la modifier, la magnifier, par des effets, des filtres, comme sur l’application « Instagram » : « le soi digital s’appréhende sous une forme qui apparaît comme régressive : on accède à soi par le toucher et non plus par la pensée, l’identification ou la projection. On joue à soi comme un enfant qui vient de naître apprendrait et découvrirait le monde par le toucher ».
Institutions et administrations ont bien saisi le pouvoir de cet ego-marketing, des campagnes publicitaires aux accents de propagande, qui présentent l’avantage d’être gratuites et de surcroit portées par la puissance des réseaux sociaux. Le 27 novembre 2015, au lendemain des attentats, l’Elysée lance un appel maladroit, sans recul temporel face aux drames en cours, dans la lignée du principe d’immédiateté que nous avons déjà évoqué. Le message des services de la Présidence était le suivant : « Attentat de Paris. Participons tous à l’hommage national. 1. Mettez un drapeau bleu blanc rouge à votre fenêtre. 2. Faites un selfie (ou une photo) en bleu blanc rouge. 3. Publiez-le sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #fiersdelafrance et mettez-le en photo de profil Vendredi 27 novembre à 8h00 ». Un selfie qui n’en est plus un, dans la mesure ou la spontanéité est l’un des éléments essentiels de la démarche.
La révolution éthique par l’amour 2.0
Les changements de paradigmes induits par l’immédiateté de l’image impactent également nos relations amoureuses. L’amour 2.0 n’est plus tant celui de l’engagement que celui du consommable. Au delà du jugement de valeur sur les applications de rencontres, l’auteur relève notre nouveau rapport à la vision du couple : « l’heure n’est plus au couple au sens courant et classique du terme, à savoir deux personnes qui vivent ensemble et s’engagent dans la durée (cela impliquerait une conception traditionnelle de l’espace et du temps), qui nouent un pacte réel ou symbolique (…). Le passage au monde hic et nunc aussi implique l’urgence, la consommation rapide, la volonté d’être satisfait avant même que ne surgisse le désir ».
Paradoxe ultime : le selfie qui simplifie la représentation de soi, la diffusion de notre image rêvée, renforce le repli. Il reste, comme le souligne Elsa Godart, un acte solitaire, sans altérité. Une résonnance sans fin, faite d’étourdissantes mises en abyme. Dans cette spirale égocentrée, celle du prolongement de soi, difficile d’introduire les manques, les contraires et les absences au cœur des liens humains.
Pour aller plus loin :
– « Tous Selfie », Pauline Escande-Gauquié, Editions François Bourin.
– « Le Selfie : aux frontières de l’égo portrait », Agathe Lichtensztejn, Editions l’Harmattan.
– « L’Etre et l’écran : comment le numérique change la perception », Stéphane Vial, Editions PUF.
« Crédit photo Flickr: Benjamin Linh VU »












Aucun commentaire.