La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur
Edern De Barros | 06 mai 2016
 La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur
La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur
Par Hadia Baïz et Edern de Barros
La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur, Dominique Moïsi, Éditions Stock, 2016, 198 pages, 18€
Le nouvel essai de Dominique Moïsi est la continuité de son ouvrage de 2009, La géopolitique des émotions, où il se proposait de prendre cette dernière comme outil d’analyse des relations de pouvoir à l’échelle internationale. Or pour saisir les émotions du monde, il s’agit à présent d’explorer le monde artistique, et notamment les arts de l’image (cinéma, séries télévisées, etc.) qui fournissent un panorama des émotions d’une époque pouvant servir de base de travail au géopoliticien. Dans cette perspective, les médias font office « de caisse de résonance et de loupe grossissante », écrivait-il déjà en 2009. Dans La Géopolitique des séries, il se propose d’approfondir cette piste, en prenant plus spécifiquement le cas des séries télévisées, œuvres de fiction omniprésentes dans notre quotidien, qu’il étudie comme « un matériau primaire pour comprendre les émotions du monde ».
Dominique Moïsi en choisit cinq particulièrement utiles pour cette entreprise, sélectionnées selon quatre critères, à savoir leur succès, leur relation à des thèmes géopolitiques, leur actualité et leur qualité : Games of Thrones, Downtown Abbey, Homeland, House of Cards et Occupied.
De la géopolitique des émotions à la géopolitique des séries
Dominique Moïsi reprend la définition du géographe Yves Lacoste pour définir la géopolitique comme « l’ensemble des observations et des raisonnements stratégiques, géographiques et historiques qui permettent de mieux comprendre les conflits ». Avec La Géopolitique des séries en prenant l’émotion comme grille d’analyse géopolitique du pouvoir à l’échelle internationale, il s’agit à la fois d’étudier l’impact de la politique internationale sur les séries et réciproquement. En effet, les séries télévisées apparaissent comme des outils participant à la fabrication des émotions, tout en étant elles-mêmes le produit des émotions du monde.
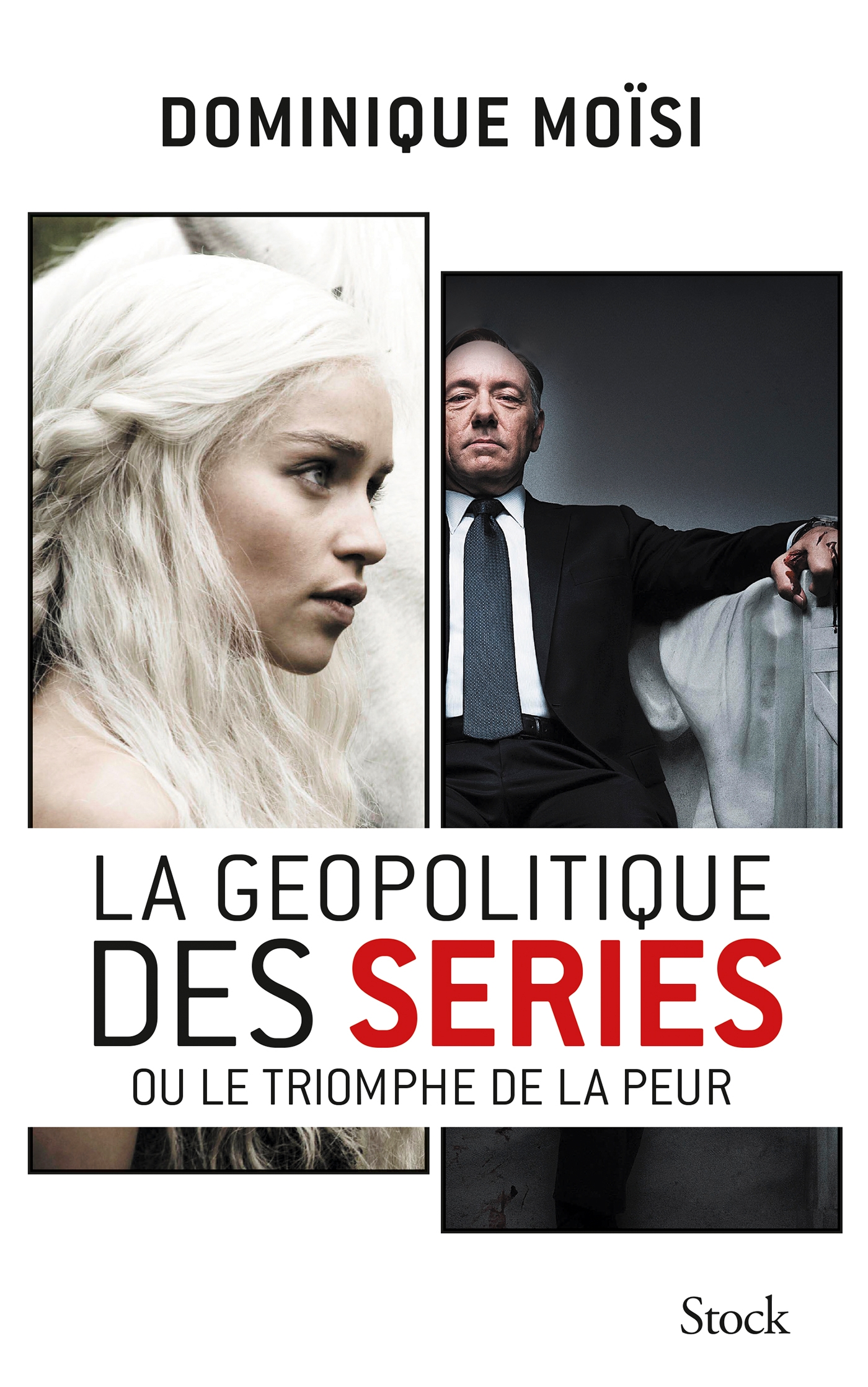 L’approche géopolitique des séries télévisées permet de les envisager non pas seulement comme des produits culturels, mais plus encore dans une perspective politique comme des outils idéologiques, ou des « softs power ». Dans les années 1980-1990, la série américaine Dallas par exemple, en présentant le luxe et l’étalement des richesses de son personnage principal JR, contribuait à promouvoir à l’échelle internationale le modèle de la croissance au fondement du mode de vie consumériste américain. La série allemande L’inspecteur Derrick quant à elle, en offrant une représentation du mode de vie à l’Ouest aux allemands de l’Est, a pu apparaître comme un contre-discours dans le contexte de la Guerre froide, « en érodant les fondements du discours de la RDA ».
L’approche géopolitique des séries télévisées permet de les envisager non pas seulement comme des produits culturels, mais plus encore dans une perspective politique comme des outils idéologiques, ou des « softs power ». Dans les années 1980-1990, la série américaine Dallas par exemple, en présentant le luxe et l’étalement des richesses de son personnage principal JR, contribuait à promouvoir à l’échelle internationale le modèle de la croissance au fondement du mode de vie consumériste américain. La série allemande L’inspecteur Derrick quant à elle, en offrant une représentation du mode de vie à l’Ouest aux allemands de l’Est, a pu apparaître comme un contre-discours dans le contexte de la Guerre froide, « en érodant les fondements du discours de la RDA ».
Aujourd’hui, nos séries télévisées sont plus noires, plus marquées par le pessimisme ambiant et le sentiment de déclin de la civilisation dans le contexte de la mondialisation. C’est alors le thème de la peur qui domine dans ces œuvres de fiction. L’univers de Games of Thrones par exemple, n’est-il pas une représentation du désordre de notre époque, transposé dans des époques reculées au travers de la fiction, où le réchauffement climatique devient un refroidissement inéluctable de la planète par renversement ? La série House of Cards, en dressant un tableau qui désacralise la politique aux États-Unis en présentant les luttes de pouvoirs dans toute leur vulgarité, ne témoignent-elle pas de notre sentiment de méfiance à l’égard d’un monde de plus en plus machiavélien ? Pour autant, toutes ces séries ne sont pas que des photographies de notre temps, mais plus encore des instruments qui forgent notre représentation du monde et nos sentiments. Au-delà du pessimisme, House of Cards porte une vision des États-Unis comme celle d’un acteur cynique et décomplexé, assumant sa transparence, apparemment autocritique et prenant les devants sur les lanceurs d’alerte et les fuites d’informations, par contraste avec des régimes plus opaques en Chine ou en Russie. Ainsi, l’approche géopolitique des séries télévisées apporte un regard distancé, en saisissant le pouvoir de ces dernières sur nos émotions qui constitue les ressorts de leur soft power.
Le pouvoir émotionnel des séries télévisées
Les séries actuelles n’ont plus grand chose à voir avec Dallas ou l’Inspecteur Derrick. Elles sont aujourd’hui devenues des superproductions qui mobilisent des investissements considérables, des scénaristes ou des acteurs de renom comme John R.R. Martin. En ce sens, « les séries cessent d’être le parent pauvre du genre noble qu’est le cinéma », pour devenir un genre à part entière dont l’impact sur nos émotions est plus fort qu’auparavant.
Les séries télévisées se déploient sur un temps long, plus proches de la littérature que le temps du cinéma, en plusieurs saisons constituées chacune de 12 épisodes en moyenne : ainsi le format est plus proche du temps réel, ce qui permet de mettre en place des intrigues secondaires multiples, lesquelles permettent à leur tour d’explorer toute la richesse des personnages principaux et secondaires, leurs rapports, les lieux où se déroule le récit, etc. Tous ces éléments qui constituent l’univers des séries télévisées ne sont plus seulement découverts en surface comme dans le format du cinéma classique, mais intimement fréquentés par le spectateur, lequel est immergé dans une ambiance.
Or ce rapport au temps dans les séries télévisées change notre rapport affectif à l’image qui devient plus passionné. Le spectateur tisse des liens affectifs plus forts avec le récit qui lui est présenté, démultipliant le pouvoir de ces œuvres de fiction sur nos émotions, et accroissant ainsi leur rôle comme instrument géopolitique : l’immersion rendue possible par le format accroît en quelque sorte leur soft power, et donc leur influence sur la scène internationale. C’est pourquoi, les séries télévisées comme miroir des émotions, ont un rôle politique à jouer qui ne doit pas être seulement de propager la culture de la peur : « Leur centralité est devenue telle qu’il est légitime de leur demander d’influer de façon positive et non pas seulement négative sur les émotions du monde. »
Dans cette perspective, l’ambition du livre de Dominique Moïsi est d’inviter le lecteur à réfléchir sur les séries télévisées, et plus encore sur son propre rapport à elles, et ainsi d’analyser les peurs du monde à travers ce média de masse pour « mieux les comprendre et peut-être ainsi contribuer à les transcender. »
crédit photo Flickr: Jozsef Neller








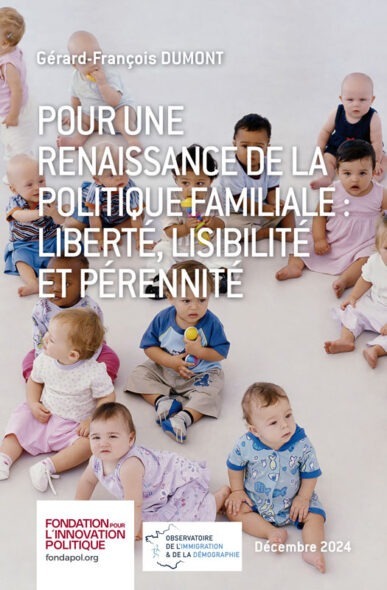
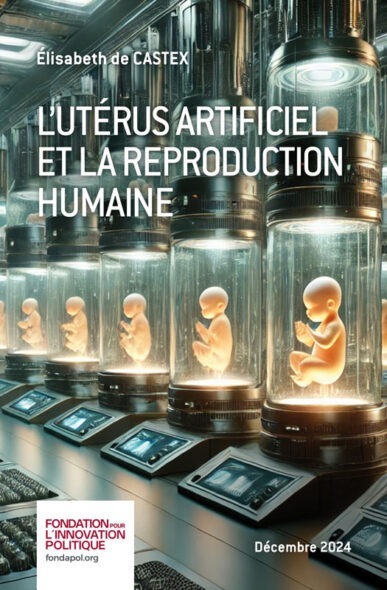
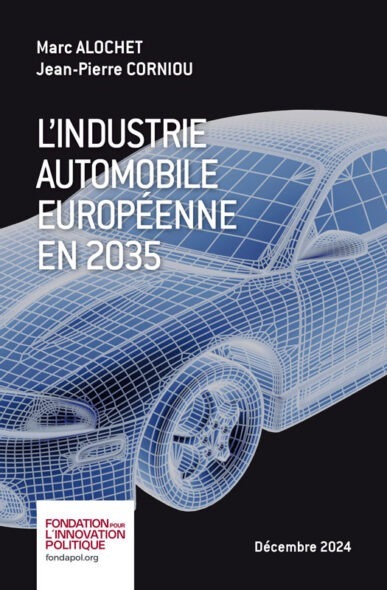
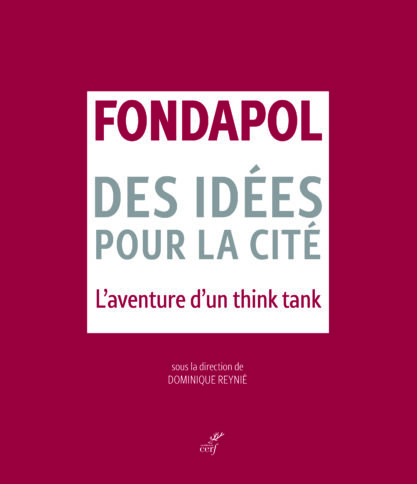
Aucun commentaire.