Le désastre de l’école numérique : plaidoyer pour une école sans écrans.
Farid Gueham | 23 mars 2017
 « L’école numérique, c’est un choix pédagogique irrationnel car on n’apprend pas mieux, et souvent moins bien, par l’intermédiaire d’écrans. C’est le gaspillage de ressources rares et la mise en décharge sauvage de résidus dangereux à l’autre bout de la planète. C’est une étonnante prise de risque sanitaire quand les effets des objets connectés sur les cerveaux des jeunes demeurent mal connus. C’est ignorer les risques psychosociaux qui pèsent sur des enfants happés par le numérique ». Pas d’alarmisme, mais un parti pris sans concession : le miracle de l’école numérique n’aura pas lieu à en croire Philippe Bihouix et Karine Mauvilly, auteurs du « désastre de l’école numérique ».
« L’école numérique, c’est un choix pédagogique irrationnel car on n’apprend pas mieux, et souvent moins bien, par l’intermédiaire d’écrans. C’est le gaspillage de ressources rares et la mise en décharge sauvage de résidus dangereux à l’autre bout de la planète. C’est une étonnante prise de risque sanitaire quand les effets des objets connectés sur les cerveaux des jeunes demeurent mal connus. C’est ignorer les risques psychosociaux qui pèsent sur des enfants happés par le numérique ». Pas d’alarmisme, mais un parti pris sans concession : le miracle de l’école numérique n’aura pas lieu à en croire Philippe Bihouix et Karine Mauvilly, auteurs du « désastre de l’école numérique ».
Aux origines de l’école numérique.
Outre les équipements, l’école numérique, c’est aussi un ensemble de pratiques. De l’usage des salles informatiques, aux TBI ces tableaux blancs interactifs, en passant par les ENT ces espaces numériques de travail, et autres tablettes, les partisans du tout numérique ne manquent pas d’arguments pour défendre leur cause. Mais depuis l’annonce en grande pompe du « grand plan numérique pour l’école de la République » censé lutter contre les inégalités sociales à l’école, le premier point d’étape n’est pas aussi glorieux. Pire, les auteurs assument la charge de leur constat en parlant de désastre. « La réalité est loin de cette vision idyllique. Alors un ordinateur ou une tablette par élève, la panacée ? Nous assumons le mot désastre. L’école numérisée, c’est d’abord un choix irrationnel, domaine où toute nation d’innovation a été confisquée par la fascination pour la technique ».
Du côté des enseignants : pas d’avis unanime, mais autant d’appréhensions que de sensibilités et d’usages : en fonction des matières enseignées, de la situation financière de chaque établissement, de l’engagement ou du scepticisme des enseignants, l’adoption du numérique à l’école se fait à un rythme différent. Seule certitude, les professeurs ne sont pas franchement consultés. « A l’école supérieure du professorat et de l’éducation ( Espé, ex-IUFM), on apprend que l’innovation doit être au cœur de toute pratique pédagogique. « Osez, soyez inventifs innovez ! », répètent inlassablement inspecteurs et formateurs aux jeunes professeurs. Mais que signifie innover quand on n’a jamais eu l’occasion d’exercer de manière « classique » ?
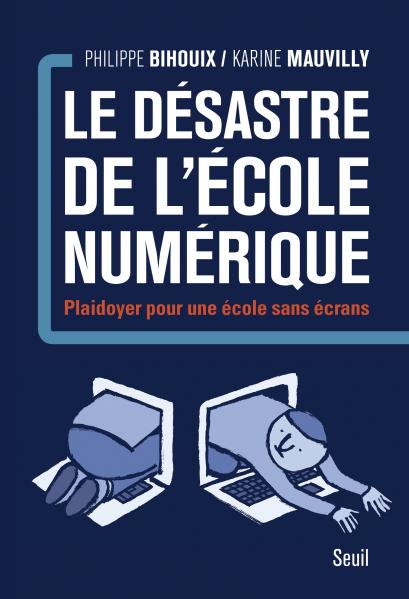 Un choix pédagogique remis en question.
Un choix pédagogique remis en question.
« A la Waldorf School of the Peninsula, école privée de los Altos en Californie, on peint, on récite au tableau, on fait des expériences scientifiques, on jardine, sculpte et tricote – garçons et filles. Il n’y a pas d’ordinateurs en classes primaires et un usage très limité des technologies dans le secondaire. Même la sonnerie de l’école se fait avec une cloche manuelle ». Cette école, c’est celle qui accueille une grande majorité d’enfants des cadres de la silicon valley. Plus édifiant encore, les résultats de l’enquête PISA 2015 montrent qu’en moyenne, au cours des dix dernières années, les pays qui ont consenti d’importants investissements dans les technologies de l’information et de la communication dans le domaine de l’éducation n’ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences (OCDE/PISA « connectés pour apprendre ?, les élèves et les nouvelles technologies », 2015). Sur le terrain, les résultats ne sont pas plus encourageants. Outre atlantique, le journaliste Matt Richtel menait, en 2011, une enquête pour le New York Times « le pari éducatif high tech » afin d’évaluer les résultats au regard des sommes investies. Ainsi, en Arizona, dans le district de Kyrene où 33 millions de dollars ont été investis entre 2005 et 2011 pour les équipements numériques des classes, les résultats scolaires stagnent, lorsqu’ils progressent dans le reste de l’état, aussi bien en lecture qu’en mathématiques. Enfin, il convient de cherche la source de motivation qui serait la valeur ajoutée première de ce nouveau mode d’apprentissage : par quoi l’élève est-il motivé dans l’école numérique : par la tâche d’apprentissage, ou par l’outil lui-même ? De la même façon, la fracture numérique s’est déplacée : elle ne réside plus sur le taux d’équipement des établissements, mais sur la compétence dans l’utilisation du numérique. L’argument de l’égalité des chances ne se vérifie pas non plus à en croire les auteurs.
Des alternatives pour une école sans écran.
Et si l’école restait une zone de refuge ? L’école sans écran pourrait ainsi venir s’interposer entre les enfants et une culture de l’immédiateté qui le sollicite, chaque jour, un peu plus. « C’est une force sociale, un contre-pouvoir à la soif de vitesse de l’économie. A contre-courant de l’idée à la mode d’invitation de la société dans l’école, il nous semble que l’école soit, précisément, le royaume de la concentration, quand dehors, on cherche à se divertir, le pays des savoirs de long terme, quand à l’extérieur règnent les informations, le lieu où découvrir son histoire, quand on mime la société américaine dans les fast-foods et les centres commerciaux ».
Des idées alternatives à l’école numérique :
Au delà d’un « livre-noir », plaidoyer contre l’école numérique, l’ouvrage se veut également force de proposition : la motivation des élèves ne passe pas exclusivement par les « serious games ». L’évaluation de ces derniers peut se faire par un contrat de confiance. Le choix des activités par le vote a démontré une plus grande implication des élèves dans leurs travaux. La mise en place d’un système à options dès le primaire, sur le modèle des Pays-Bas, permettrait à chaque élève de se retrouver dans des options complémentaires au tronc commun des enseignements. De la même façon, l’école numérique n’a pas eu raison des fractures sociales, elle les a simplement déplacées. Les auteurs préconisent donc le port de l’uniforme, la fin de l’affectation des enseignants débutants dans les établissements les plus difficiles, ou une partie conséquente de l’année de troisième consacrée à la découverte des métiers, moyen de lutter contre l’autocensure.
Une responsabilité partagée pour éviter le désastre.
Les ratés du plan numérique ne sont pas irrémédiables. Philippe Bihouix et Karine Mauvilly affirment que la surenchère technologique ne résoudra en rien les problèmes de l’école, contrairement aux promesses du gouvernement. « On n’automatise pas la « fabrication » d’un petit d’Homme comme on le ferait d’un produit industriel ! Digitaliser les enfances, c’est non seulement renoncer à la prérogative d’éduquer nous-mêmes nos enfants, mais aussi ouvrir la boîte de Pandore internet à un âge ou les risques encourus sont supérieurs aux bénéfices espérés ».
Pour aller plus loin :
– « Fracture numérique, fracture sociale : aux frontières de l’intégration et de l’exclusion », Sociologies.
– « Bilan du plan ENR : financement de tableaux numériques à l’école », tableauxinteractifs.fr
– « Numérique à l’école : 40 ans de politique publique », Francetvinfo.fr
– « Numérique à l’école, quels résultats ? », La Croix.












Aucun commentaire.