Libéral, l’Abbé?
Fondapol | 01 mai 2011
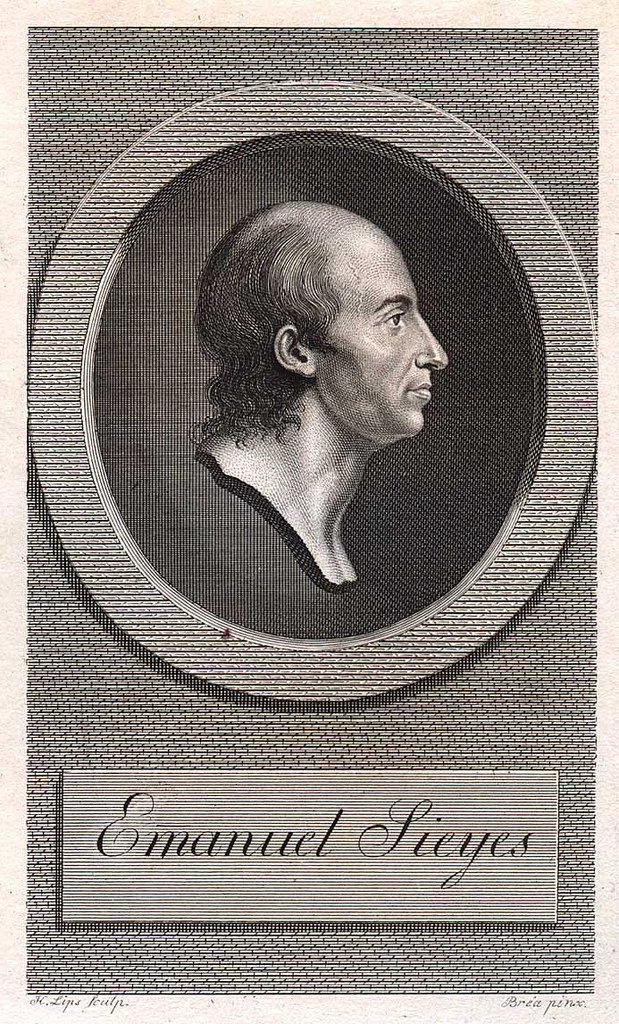 Erwan Sommerer, Sieyès. Le révolutionnaire et le conservateur, Paris, Michalon, coll. « Le bien commun », 2011.
Erwan Sommerer, Sieyès. Le révolutionnaire et le conservateur, Paris, Michalon, coll. « Le bien commun », 2011.
Les adversaires du libéralisme ont longtemps prétendu qu’il était, en France, produit d’importation. Ce faisant, ils négligeaient Constant et Guizot ; méprisaient Montesquieu et Tocqueville ; ignoraient Say et Bastiat.
C’est notamment autour de Raymond Aron que se manifesta un nouvel intérêt pour ces auteurs, à partir de la fin des années 1970. Depuis, les efforts d’un Pierre Manent ou d’un Pierre Rosanvallon ont payé. Nul ne peut plus aujourd’hui réduire la pensée libérale aux dimensions – certes considérables – des Etats-Unis ou des îles britanniques. Des éditeurs ont joué un rôle important dans ce mouvement de redécouverte : ainsi des Belles Lettres et de leur collection « Bibliothèque classique de la liberté », dont les efforts ont permis d’éclairer des branches méconnues dans la généalogie du libéralisme français. Yves Guyot ou Edouard Laboulaye, par exemple.
Et Sieyès ? Les historiens connaissent bien le personnage et le rôle capital de ses écrits dans le déclenchement de la Révolution française. Mais l’œuvre de Sieyès n’est pas que de circonstance. Elle fut admirée par Benjamin Constant, qui en tira peut-être sa fameuse distinction entre liberté des Anciens et liberté des Modernes. Elle a suscité dès longtemps l’intérêt en Allemagne par exemple. Elle relève enfin de la philosophie politique et du droit constitutionnel. Et de l’histoire du libéralisme ! Le petit livre d’Erwan Sommerer le rappelle brillamment.
« La cause finale de tout le monde social doit être la liberté individuelle »
Il est peu de textes dont on peut dire qu’ils ont fait l’histoire. L’Essai sur les privilèges et le Qu’est-ce que le Tiers Etat de Sieyès en font partie. Or, la pensée d’Emmanuel Sieyès puise largement, dès 1788-1789, à la source de John Locke, en ce qu’elle met la préservation des droits naturels au cœur du contrat social.
Chez Sieyès, « l’état social est [en effet] au service des individus[1] ». Il leur permet de sécuriser leur liberté et leur propriété[2], mais aussi de mieux réaliser leurs buts personnels. En ce sens et sans craindre l’anachronisme, on peut dire de Sieyès qu’il esquisse une lecture utilitariste du contrat social[3]. Il se distingue de Rousseau en refusant « l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté ». Le potentiel autoritaire du contrat social rousseauiste ne lui a peut-être pas échappé…
Sieyès se méfie dans les faits de toute « épiphanie du contrat social ». Quel que soit son développement, l’Etat qui en procède ne doit, selon lui, jamais perdre de vue son objectif premier : garantir que les individus puissent jouir également de leurs droits naturels. Avis à tous ceux de nos contemporains qui voient d’abord l’Etat –l’établissement public pour Sieyès- comme un instituteur du social, au risque de l’autoritarisme !
Une conception exigeante du contrat social et de la nation
Ici intervient un des aspects les mieux connus de la pensée de Sieyès – et des plus controversés. Celui que Robespierre surnomme « la taupe de la Révolution » ne s’en tient pas à une vision très souple du contrat social. Il estime que, pour le conclure, les individus doivent impérativement accepter le principe d’égalité dans la liberté. Quiconque prétendrait dès lors avoir plus de droits que d’autres ne pourrait souscrire au contrat social. Pis, il se trouverait de facto en « état de guerre » avec la nation née de ce contrat.
Ce point vise les aristocrates qui, en 1789, refusent par exemple l’abolition des droits féodaux. Dès cette époque, Sieyès va jusqu’à envisager de déchoir de leur nationalité française tous les nobles qui n’accepteraient pas le nouvel ordre révolutionnaire. Une telle radicalité peut surprendre chez un auteur volontiers classé parmi les modérés[4].
Or, Sieyès ne mésestime pas l’importance de ce qui s’accomplit avec le contrat social. Il montre même que, pour que celui-ci soit possible, les contractants doivent « partage[r] un substrat moral qui est le ciment de leur appartenance à la communauté nationale[5] ». On est très loin d’un libéralisme abstrait, qui n’aurait d’autre horizon que l’individu « atomisé ».
Mais quel est le contenu de ce « substrat moral » posé en préalable du contrat social ? Nos contemporains, aiguillés par le populisme ambiant, en adopteraient volontiers une lecture culturelle, voire ethnique. Et de crier : haro sur Sieyès ! Erwan Sommerer s’inscrit en faux contre cette interprétation. Il affirme, arguments à l’appui, que « la nation dont Sieyès décrit les contours ne s’appuie pas sur des attributs innés ou biologiques[6] ».
Pas de liberté sans représentation
Le lecteur contemporain trouvera chez Sieyès un véritable antidote contre le populisme. L’auteur de Qu’est-ce que le Tiers Etat affirme en effet qu’il n’est pas de liberté sans représentation. Or, les populistes rejettent, on le sait, les règles de la représentation. Ils plaident souvent pour une démocratie plus directe.
Sieyès comprend au contraire la représentation comme un des principes de la vie en société. Pour pouvoir se consacrer à leurs activités, les individus doivent en effet confier l’exercice de certaines tâches à d’autres qu’eux. Sieyès distingue à cet égard le « laisser faire » du « faire faire ». En matière politique, quand les hommes laissent à certains la capacité d’exercer le pouvoir, la voie est ouverte pour une évolution despotique. Mais quand ils font exercer le pouvoir par d’autres qu’eux, la liberté se trouve garantie. Avec cette condition que le choix des gouvernants doit alors être le plus rationnel possible.
Les idées de Sieyès quant aux modes de scrutins évoluent toutefois au rythme de la Révolution française ; les élections ont pour but, à ses yeux, de choisir, des experts ; la capacité des électeurs à évaluer la compétence des candidats étant inégalement répartie, le suffrage censitaire lui semble dès lors le moyen le plus adapté, comme à beaucoup de libéraux après lui.
Délibération et émergence de la volonté générale
Sieyès plaide enfin pour que les élus du peuple disposent d’une grande capacité d’appréciation dans l’exercice de leur mandat. En clair, il est un adversaire résolu du mandat impératif, qui fait des représentants du peuple de véritables marionnettes. C’est que l’ancien vicaire assigne à la délibération la tâche de faire émerger une volonté générale « qui n’existe pas antérieurement aux débats ». La possibilité théorique qu’un élu change d’avis au cours d’un débat devrait donc être garantie – contre les mots d’ordre partisans ou les pressions préalables aux débats, traduirons-nous en langage contemporain. La brièveté des mandats, la limitation de la rééligibilité et l’incompatibilité avec des fonctions exécutives permettraient, selon Sieyès, de s’assurer que la délégation de pouvoir n’est pas entendue de manière exorbitante par ceux qui la reçoivent.
Cette théorie de la représentation interroge naturellement le fonctionnement de nos démocraties et l’organisation du débat politique autour des formations partisanes. Rien de moins sieyèsien par exemple que ces séances publiques où les membres d’un même groupe votent comme un seul homme à l’Assemblée nationale, au nom de la « loyauté à la majorité » ou d’une « opposition systémique » !
« Ces idées exagérées dont on s’est plu à revêtir ce qu’on appelle souveraineté »
Comment faire cependant pour que cette « liberté de délibérer » accordée aux représentants du peuple n’autorise pas des abus qui iraient de la corruption au despotisme ? Chacun se souvient en effet des recommandations de Montesquieu, pour qui il fallait penser les institutions pour des hommes immoraux et non pour des êtres parfaits. Y a-t-il contradiction chez Sieyès entre, d’une part son souci de borner strictement la portée du contrat social et, d’autre part, une vision de la délibération autorisant une « souveraineté absolue » du pouvoir politique ?
Sieyès pose une première borne à cette « souveraineté » des élus de la Nation lorsqu’il souhaite qu’« on ne met(te) en commun, sous le nom de pouvoir public ou politique, que le moins possible, et seulement ce qui est nécessaire pour maintenir chacun dans ses droits et devoirs ». D’où il ressort que limitée en amont, la souveraineté des institutions ne peut s’étendre au-delà des objectifs du contrat social, soit la garantie de l’égalité dans la liberté.
Il y a donc, chez Sieyès, deux souverainetés : celle de la Nation, qui n’est pas absolue ; et celle des institutions, qui est limitée. Celle-ci une souveraineté seconde : en principe, elle ne saurait dériver en souveraineté absolue.
L’inventeur du contrôle de constitutionnalité?
Comment s’assurer pourtant que le pouvoir politique n’excède pas les limites que le contrat social lui assigne ? L’auteur de Qu’est-ce que le Tiers Etat se préoccupe pour cela des procédures de révision et de contrôle de la Constitution – comme Condorcet. Initialement partisan d’une procédure de révision régulière de la loi fondamentale opérée par une Assemblée constituante, Sieyès évolue après la Terreur sur ce sujet.
En juillet 1795 – soit six ans après l’entrée en application de la Constitution américaine, qui institue une Cour suprême – il envisage d’instituer un gardien permanent de la Constitution, qu’il nomme « jury constitutionnaire ». Cet organe, toujours selon Sieyès, pourrait être saisi par la minorité parlementaire ou par des citoyens pour contrôler que la Constitution est bien appliquée par les gouvernants.
On ne saurait mieux illustrer la méfiance de Sieyès à l’égard d’un pouvoir politique qu’il conviendrait de borner afin d’éviter qu’il empiète sur les droits naturels de l’homme, ou compromette la sécurité juridique. Nul n’est pourtant prophète en son pays ! Il a fallu attendre de Gaulle pour qu’un Conseil constitutionnel soit créé en France en 1958 ; Valéry Giscard d’Estaing pour que la minorité parlementaire puisse le saisir après 1974 ; et Nicolas Sarkozy pour que ce droit soit étendu au citoyen à travers le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité…
Quelque part entre les Lumières et Benjamin Constant
Alors, libéral, l’abbé Sieyès ?
Voilà un penseur qui borne strictement la compétence du pouvoir politique à ce qui relève des droits naturels ; qui se méfiant du rêve d’une démocratie directe comme de la démagogie, loue les vertus de la représentation politique ; qui se soucie très précisément de mécanismes permettant de contrôler que le pouvoir n’excède pas les limites qui lui sont posées par la Constitution. Et on en passe… N’en jetez plus ! L’Abbé est bien de la famille, comme un jalon oublié dans l’histoire du libéralisme, quelque part entre les Lumières et Benjamin Constant.
David Valence
[expand title = « Notes »]
[1] P. 25.
[2] « Celui-là est libre qui a l’assurance de n’être point inquiété dans l’exercice de sa propriété personnelle et dans l’usage de sa propriété réelle ». Sieyès, « Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen », 20 et 21 juillet 1789, in Orateurs de la Révolution française, t. I : Les Constituants, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1989, p. 1009.
[3] Le contrat social crée en effet, d’après Sieyès, « une société fondée sur l’utilité réciproque ». Sieyès, ibid., p. 1007.
[4] Jean-Pierre Rioux en fait même un « centriste ». Les centristes, de Mirabeau à Bayrou, Paris, Fayard, 2011, p. 24-25.
[5] Nous citons ici Erwan Sommerer, p. 27.
[6] P. 34
[/expand]
Crédit photo, Flickr: Stifts- och landsbiblioteket i Skara












Aucun commentaire.