Sécurité alimentaire : un enjeu global
La crise alimentaire, révélateur des conséquences du désinvestissement dans l’agriculture
Des causes conjoncturelles : sécheresse et emballement des marchés
Des causes structurelles : la baisse des investissements et le plafonnement des rendements
Les erreurs des politiques économiques
La recrudescence de la malnutrition remet en cause les politiques agricoles
Un milliard de personnes souffrent de la faim
L’agriculture vivrière oubliée des politiques publiques et délaissée par les investissements privés
Pour satisfaire les besoins alimentaires en 2050, il faut accroître les rendements et réinvestir dans l’agriculture
L’Europe partage des intérêts agricoles avec l’Afrique du Nord
La priorité est maintenant d’aider l’Afrique subsaharienne à réussir sa révolution verte
L’Afrique de l’Ouest pourrait satisfaire ses besoins alimentaires
Les déclarations de la communauté internationale non suivies d’actions
Le secrétariat des Nations Unies et son programme-cadre
Le Comité de sécurité alimentaire réformé
Les États-Unis prennent le leadership et s’appuient sur la Banque mondiale
La régulation des marchés agricoles ne traiterait qu’une partie du problème
L’instabilité des prix dans les pays en développement dépend de facteurs endogènes
Peut-on satisfaire à la fois les producteurs et les consommateurs ?
La conception de nouvelles politiques agricoles est aussi cruciale que les financements pour les mettre en oeuvre
Des politiques agricoles favorables à l’investissement et à l’esprit d’entreprise
Proposition pour une approche économique « pro-business » ou « pro-entreprises »
Pour un G20 alimentaire consacré à la sécurité alimentaire
Résumé
A l’heure où la France prend pour un an la présidence du G20, la question de la sécurité alimentaire est plus que jamais d’actualité. En 2008, la flambée des prix des denrées alimentaires avait conduit à l’apparition d’« émeutes de la faim » dans les pays en développement. Les mauvaises récoltes et la spéculation ne suffisent pas à expliquer ces évènements dramatiques, qui trouvent leurs racines dans l’évolution des politiques agricoles depuis une vingtaine d’années. Dans les pays les plus pauvres, la réduction de l’effort budgétaire en faveur de l’agriculture, le maintien des prix à bas niveau et l’abandon de la politique d’augmentation des rendements ont freiné le développement des agricultures locales et développé le risque d’insécurité alimentaire. Face à ces défis, malgré les déclarations de principe de la communauté internationale, peu d’initiatives concrètes ont été prises, notamment de la part de l’Union européenne.
Afin que les 9 milliards d’êtres humains qui peupleront la planète en 2050 puissent se nourrir, il est indispensable de relancer les investissements dans la production vivrière. Cela passe par la redéfinition des politiques agricoles, en vue d’une augmentation des rendements et de la productivité, par une meilleure commercialisation des produits sur les marchés régionaux et enfin par une structuration des filières de production. Les financements extérieurs, qu’ils proviennent de la solidarité internationale ou du secteur bancaire doivent être amplifiés. Loin de ressusciter l’agriculture d’Etat, la présidence française du G20 est l’occasion de replacer la question de la sécurité alimentaire au plus haut niveau.
Bernard Bachelier,
Directeur de la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM).
La crise alimentaire qui a frappé le monde en 2008 a ramené la question agricole au premier plan des priorités de la communauté internationale. Nous savons que de nouvelles pénuries sont possibles. La faim ne régresse pas comme on l’avait espéré. Depuis le printemps 2008, toutes les réunions internationales ont consacré un point de leur ordre du jour à la sécurité alimentaire et annoncé la mobilisation de financements nouveaux. Pourtant, les actes ne suivent pas les déclarations. L’opinion publique peine à comprendre ce qui se passe et à distinguer ce qui relève des effets d’annonce de ce qui amorce de réelles actions.
Depuis le mois de novembre, la France préside le G8 et le G20 pour un an. La sécurité alimentaire figurera à l’ordre du jour du Sommet mais sera traité comme le suivi technique du dossier laissé à des experts. C’est sur la régulation des marchés que la présidence française entend faire peser le poids politique. Annoncée par Nicolas Sarkozy, elle prépare une initiative pour le G20 sur la volatilité des prix des produits agricoles. Le président de la République a retenu en premier lieu la régulation des marchés des matières premières, agricoles parmi les quatre priorités la présidence française. Cet objectif se traduira par une réunion des ministres du G20 chargés de l’agriculture, une première dans un univers dominé par les financiers.
On peut comprendre cette insistance sur la question des prix. La crise alimentaire a en effet été déclenchée par leur envolée. Mais il s’agissait là du symptôme d’un mal plus profond, comme une fièvre signale une maladie. La principale cause qui du déséquilibre alimentaire de la planète est la baisse des investissements en faveur de l’agriculture, notamment de l’agriculture vivrière dans les pays pauvres. Si l’on veut traiter le mal en profondeur, il faut envisager de nouvelles politiques agricoles dotées de financements qui assurent leur mise en œuvre. Encadrer la volatilité ne suffira pas à donner aux paysans des pays en développement les moyens qui leur permettront d’accroître et de stabiliser les niveaux de production nécessaires à la sécurité alimentaire de leurs concitoyens.
À l’heure où la communauté internationale se réunit pour traiter de nouveau ces questions, un retour sur les faits permettra de mieux comprendre les enjeux.
La crise alimentaire, révélateur des conséquences du désinvestissement dans l’agriculture
Banque Mondiale « Rapport sur le développement dans le monde 2008. « L’agriculture au service du développement » » Washington – Banque Mondiale – 2007
La crise alimentaire de 2008 a révélé aux médias et, à travers eux, à l’opinion publique le désintérêt dont souffrait l’agriculture depuis de nombreuses années. Depuis longtemps, cette situation inquiétait les experts. La Banque mondiale avait décidé dès 2006 de consacrer son rapport annuel 20081 sur le développement à la question agricole. Cette décision avait été prise avant la crise. La rédaction du rapport fut achevée au printemps 2007 et le rapport rendu public en novembre 2007. Mais ce sont les émeutes de la faim qui, fin 2007 et, surtout, au printemps 2008, mirent fin à à l’indifférence médiatique. Ces émeutes qui frappèrent des dizaines de villes des pays pauvres furent provoquées par l’envolée des prix, notamment des prix du blé, c’est-à-dire du pain, et du riz, la céréale des pays pauvres. Rappelons que les prix du riz ont triplé durant les trois premiers mois de 2008. Cette montée des prix tient autant à des causes conjoncturelles qu’à des causes structurelles.
Des causes conjoncturelles : sécheresse et emballement des marchés
Parmi les causes conjoncturelles, on compte d’abord des phénomènes climatiques qui se se sont traduits par une succession de mauvaises récoltes en Australie et en Europe orientale. Cependant, la sécheresse n’explique pas tout. Les marchés financiers ont amplifié ce phénomène. En effet, le début de l’année 2008 correspondait à la première phase de la crise du crédit marquée par une méfiance à l’égard des marchés financiers et une augmentation des prix de toutes les matières premières. Dégagées des marchés financiers, des liquidités ont été utilisées pour spéculer sur les marchés agricoles. À cela s’ajoute ce que l’on peut appeler une « spéculation d’État » résultant de l’interdiction des exportations décidée unilatéralement par quelques pays. C’est le cas du marché du riz dont les mouvements ont été amplifiés par la fermeture des frontières de l’Inde, de la Thaïlande et du Vietnam, principaux fournisseurs de l’Afrique subsaharienne.
La troisième cause que l’on cite souvent à l’origine de la crise alimentaire de 2008 est la production de biocarburants. Une part de l’opinion publique a dénoncé leur montée en puissance et les a accusés de détourner la production de son usage alimentaire et de gonfler les prix : « manger ou conduire, il faut choisir », proclamaient certains médias. En réalité, la chute des cours de 2009 a montré que la production de biocarburants n’avait pas de réel impact sur les prix. Seuls trois ensembles économiques ont une politique volontariste de biocarburants : le Brésil, qui produit à partir de la canne à sucre ; les États-Unis, qui utilisent principalement du maïs; et l’Union européenne, qui a misé sur la betterave à sucre et les oléagineux. L’Union européenne a fixé un objectif d’incorporation de 10% des biocarburants dans l’ensemble des carburants destinés aux transports d’ici 2020. Les États-Unis, eux, veulent quadrupler leur production d’ici 2022. Quant au Brésil, il introduit déjà 20 à 25% d’éthanol dans son essence. Ces objectifs restent modérés. La production de bio- carburants occupe actuellement 2% des terres cultivables. Ce chiffre s’élèvera à 4 % d’ici 2050, selon la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Les analyses ont montré que l’essentiel de la transmission des prix des cultures à biocarburants vers les denrées alimentaires provenait du maïs américain, qui est aussi une base de l’alimentation de l’Amérique latine. Les quantités de maïs américain destinées aux biocarburants ont doublé entre 2005 et 2007, passant de 40 à 80 millions de tonnes. Mais le rôle du biocarburant à base de maïs doit lui-même être relativisé, car les quantités destinées à l’alimentation animale et à l’alimentation humaine sont restées stables. Quoi qu’il en soit, accuser les biocarburants revient à se tromper de cible. Leur consommation est stable, elle augmente de façon progressive et programmée, et ne favorise pas la volatilité mais au contraire l’amortit. De plus, l’Europe et les États-Unis conservent le potentiel agricole nécessaire à la satisfaction des besoins des marchés, même si, à terme, le monde ne se nourrira certes pas de leurs excédents.
Des causes structurelles : la baisse des investissements et le plafonnement des rendements
Il existe donc aussi des causes structurelles. Les stocks mondiaux de céréales ont été en 2007 exceptionnellement bas, et cette situation n’était pas due seulement aux mauvaises récoltes. Elle résultait des politiques agricoles suivies depuis une vingtaine d’années : c’est le résultat du désinvestissement dans l’agriculture. Sans doute, les pays riches ont continué de soutenir leur agriculture par des transferts publics massifs. Ainsi, le budget européen de la Politique agricole commune a été sanctuarisé jusqu’en 2013 par l’accord entre Jacques Chirac et le chancelier Gerhard Schröder, tandis que, de leur côté, les États-Unis ont voté en 2008 un nouveau Farm Bill, la loi sur l’agriculture, qui maintient l’aide budgétaire à l’agriculture américaine. Cependant, les politiques agricoles ont fait l’objet d’inflexions majeures dont les conséquences ont été considérables. Elles ont ainsi contribué à éliminer les stocks en régulant la production par la mise en jachère de terres agricoles. Cela a l’avantage, en temps normal, d’éviter de déséquilibrer les marchés en bradant les excédents. Mais, en l’absence de stocks de référence, le négoce ne dispose plus d’alerte et, en cas de crise, ne peut plus réagir rapidement.
La politique dont les conséquences ont été les plus graves demeure le ralentissement de l’augmentation des rendements. À l’échelle de la planète, de 1960 à 2000, les rendements en céréales ont augmenté de 2,5% par an, multipliant ainsi la production par 2,6. Depuis le début des années 2000, les gains de productivité se sont ralentis et plafonnent à 1% par an en moyenne. Il existe plusieurs raisons à ce phénomène. D’une part, les pays développés, en particulier l’Europe, ont focalisé leur attention sur la protection de l’environnement, rejetant ainsi l’intensification de l’agriculture et condamnant le productivisme, devenu source de tous les maux et de toutes les pollutions. Ils ont oublié que c’est grâce à l’amélioration des rendements par la technique que leur alimentation était devenue aussi bon marché et aussi sûre du point de vue sanitaire.
Ce plafonnement des rendements ne concerne pas uniquement l’Europe. Il est dû à la baisse drastique des financements publics consacrés à l’agriculture et à la recherche agronomique, ainsi que la Banque mondiale l’a noté dans son rapport 2008. La part de l’agriculture est tombée à 4% de l’aide publique en 2006, alors qu’elle avait atteint près de 20% à la fin des années 1970. Les pays d’Afrique subsaharienne n’y consacrent pas plus de 4% de leurs budgets nationaux.
Les erreurs des politiques économiques
Cette chute de la part agricole dans les budgets publics est une conséquence des politiques d’ajustement structurel imposées par le Fonds monétaire international (FMI) pour accorder des réductions de dettes. Sous son influence, le financement public de l’agriculture ainsi que les services publics agricoles ont été démantelés et figurent parmi les victimes des réformes économiques. L’agriculture ne peut pas toujours être financée par le seul secteur privé, comme n’importe quelle autre activité économique. Si un tel cas de figure est envisageable dans des pays qui disposent de capitaux comme le Brésil, le désengagement des pouvoirs publics place les productions vivrières des pays pauvres dans une impasse. La faiblesse de la rentabilité, les risques climatiques, les incertitudes économiques, l’émiettement de la production, l’absence de législation foncière ne peuvent que dissuader les investisseurs.
De plus, les doctrines dominantes privilégient des prix le plus bas possible pour les consommateurs. Et, pour y parvenir, la solution de facilité est de recourir à des importations bon marché. Or les prix des marchés internationaux ont été à la fois stables et de faible valeur pendant plus de vingt ans. Les importations de blé, de riz et de lait bon marché satis- font à la fois les consommateurs urbains; les gouvernements, à qui ils assurent la paix sociale ; les importateurs, souvent proches du pouvoir ; et les financiers internationaux, puisqu’ils limitent les charges pour les budgets nationaux. Au fond, presque tout le monde a des raisons d’être content, sauf les paysans. En effet, ces stratégies ruinent les agricultures locales, découragent les investisseurs et empêchent que se créent des filières commerciales nationales. Cet équilibre nocif fonctionne tant que les prix mondiaux sont bas. Si les prix s’envolent, le système explose. Et le négoce urbain ne peut se retourner vers les producteurs locaux qui, coupés des marchés et de l’accès au crédit, ne peuvent profiter de ces opportunités.
C’est cette approche que la crise alimentaire a remise en question. Elle l’a ébranlée temporairement, car l’abondance de la production des pays exportateurs en 2009 a permis de retrouver rapidement des prix plus bas, mais elle a tiré une sonnette d’alarme. Mais tout le monde ne semble pas avoir conscience des risques qui pèsent sur la sécurité alimentaire de la planète si rien de change.
La recrudescence de la malnutrition remet en cause les politiques agricoles
FAO « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde » Rome – FAO – 2008.
En 2008, la malnutrition est repartie à la hausse. Qu’entend-on par mal- nutrition? La sécurité alimentaire définit l’accès de chaque individu, à tout moment, à une nourriture en quantité et en qualité suffisante pour mener une vie saine et active. C’est la définition adoptée par le Sommet mondial de l’alimentation organisé par la FAO en 1996. Cette définition repose sur quatre piliers :
- la disponibilité physique des aliments qui renvoie à la production agricole et aux échanges commerciaux : l’offre ;
- l’accès physique et, surtout, économique qui renvoie à la capacité des individus d’acquérir les aliments et donc aux rapports entre les prix agricoles et les revenus : la solvabilité des consommateurs ;
- l’utilisation des aliments, l’adéquation avec les besoins en fonction des individus, de leur état, de leur environnement, des carences locales et des habitudes de consommation;
- la stabilité, c’est-à-dire la régularité de l’accès et l’absence de pénuries : la gestion durable, qui renvoie aux politiques publiques évitant les aléas.Chaque année, la FAO publie un rapport sur l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde qui évalue le nombre de personnes souffrant de la faim en fonction d’indicateurs tenant compte des différentes caractéristiques de groupes d’individus telles que l’âge, le sexe ou l’activité.2
Un milliard de personnes souffrent de la faim
La première conférence mondiale de l’alimentation s’est réunie en novembre 1974. À cette époque, 900 millions de personnes souffraient de la faim. Vingt-deux ans après, lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996, ce chiffre est encore de 850 millions. Les participants du Sommet proclamaient « [leur] volonté politique et [leur] engagement commun et national de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous […] et dans l’immédiat, de réduire de moitié le nombre de personnes sous alimentées d’ici 2015 au plus tard ». Cet engagement sera repris dans les objectifs du Millénaire adopté par le Sommet du Millénaire réuni à New York, du 6 au 8 septembre 2000. Pourtant, dès 2002, le « Sommet mondial de l’alimentation : cinq ans après » constatait que le nombre de personnes souffrant de la faim restait supérieur à 800 millions. Tout le monde sait que l’objectif du Millénaire ne sera pas atteint.
C’est dans ce contexte qu’est survenue la crise alimentaire, puis la crise économique. La sous-alimentation est repartie à la hausse : 915 millions de personnes en 2008, plus de 1 milliard en 2009, sous l’effet conjugué des hausses des prix agricoles et de la baisse des transferts Nord-Sud. La FAO espère un léger reflux en 2010. Ce chiffre reste néanmoins inacceptable pour le monde où nous vivons.
Deux continents sont victimes de la faim : l’Asie, avec 640 millions de personnes, soit plus de 60% du total; et l’Afrique subsaharienne, avec 260 millions de personne, soit un quart du total. Et c’est en Afrique que la proportion par rapport à la population totale est la plus élevée : 36%. Les trois quarts des personnes qui souffrent de la faim habitent dans les zones rurales. Une grande partie d’entre eux vit de l’agriculture. On sait que la malnutrition est une conséquence de la pauvreté. On oublie quelquefois qu’elle est étroitement liée à la pauvreté rurale.
L’agriculture vivrière oubliée des politiques publiques et délaissée par les investissements privés
Or cette situation résulte d’une conception réductrice de l’agriculture vivrière qui la tient à l’écart de l’économie. Pour sortir de la pauvreté, les agriculteurs doivent avoir accès au marché. Ils doivent pouvoir agir en acteurs économiques : accéder au crédit, acquérir les moyens de production, les intrants agricoles et le petit équipement, vendre leur production. Pour faire face aux pénuries ou pour accéder à une alimentation plus diversifiée, ils doivent pouvoir acheter ce qu’ils ne produisent pas grâce à la vente de leurs excédents.
Deux causes expliquent cette situation : la conception des politiques agricoles en faveur de l’agriculture vivrière et la baisse des financements publics destinés à l’amélioration de cette agriculture. Pourtant, la conception de l’agriculture de subsistance qui prévaut depuis plu- sieurs décennies dans les instances internationales et une partie du monde des ONG se traduit par un blocage de fait. La satisfaction des besoins familiaux par l’assistance extérieure maintient les ménages dans la dépendance. La méfiance à l’égard de l’économie, des marchés et de l’innovation empêche tout progrès durable. Concrètement, l’aide extérieure agit à travers des projets qui soulagent temporairement les plus démunis par la distribution d’engrais ou de semences et quelques conseils techniques. Ces projets ne concernent qu’un pourcentage très faible d’agriculteurs et sont limités dans le temps. Ils ne conduisent pas à une accumulation d’un peu de capital qui assurerait aux paysans et à leurs organisations leur autonomie. Ils fonctionnent plus comme un affichage pour les pays riches que comme une stratégie cohérente de développement. Les financements engagés par la solidarité internationale en faveur de l’agriculture vivrière des pays pauvres sont dérisoires par rapport aux besoins réels. La façon de les dépenser en réduit encore la portée. Les mauvais résultats de la lutte contre l’insécurité alimentaire sont la conséquence directe de la façon de traiter cette question.
Pour satisfaire les besoins alimentaires en 2050, il faut accroître les rendements et réinvestir dans l’agriculture
Les besoins futurs conduiront à une nouvelle dégradation de l’équilibre alimentaire mondial si l’on s’en tient au statu quo. La FAO estime qu’il faudra augmenter la production alimentaire de 70% d’ici 2050 pour nourrir les 9 milliards d’habitants que comptera alors la planète ; 90% de cette augmentation devra se faire dans les pays en développement et 80% devra provenir d’un accroissement des rendements. Ce point est capital. Il ne faut pas attendre l’augmentation de la production d’une extension des surfaces cultivées. Celle-ci restera faible. Or il ne faut pas avoir peur des mots : c’est d’une intensification de la production que la planète a besoin. Une intensification d’une nouvelle forme, mais bien une intensification.
L’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique vivent des situations contrastées. Avec des terres, de l’eau et des capitaux pour les mettre en valeur, l’Amérique du Sud, le Brésil en tête, sera encore plus qu’aujourd’hui l’une des grandes régions exportatrices. Les pays d’Asie, la Chine et l’Inde, seront confrontés au double défi de franchir un nouveau saut de production tout en limitant les risques environnementaux qui brident déjà les effets de la révolution verte. D’autant que leurs réserves de terre sont limitées. La croissance économique exercera un effet positif sur les marchés. Elle permettra d’absorber une partie des migrants de l’agriculture sachant que l’on peut à tout moment craindre des déséquilibres démographiques et sociaux qui retiendront l’attention des gouvernements. Mais la croissance économique conduira aussi à une diversification des habitudes alimentaires vers les produits d’origine animale plus gourmandes en sur- faces cultivées. Quoi qu’il en soit les gouvernements asiatiques devront à la fois financer et protéger leur agriculture et veiller à assurer leur approvisionnement. C’est ce qui justifie les investissements indiens, chinois ou coréens en Afrique ou dans les pays de l’ex-Union soviétique. Ils devront aussi améliorer le fonctionnement intérieur des marchés comme le montrent les difficultés auxquelles se heurte l’Inde qui se trouve dans la situation paradoxale de souffrir de graves famines et d’enregistrer les pertes importantes de récoltes, faute de circuits commerciaux efficaces.
L’Europe partage des intérêts agricoles avec l’Afrique du Nord
L’Afrique du Nord et le Proche-Orient resteront structurellement déficitaires en raison des limites imposées aux terres cultivables par la sécheresse et les concurrences sur les ressources en eau. Les quantités de céréales qu’ils importent chaque année varient en fonction de la pluviométrie. Elles dépendent aussi de la capacité des budgets nationaux à subventionner les produits de base pour contenir les prix à la consommation. Le Maroc, grâce à la dynamique de son économie, et l’Algérie, grâce à son pétrole, ont évité la répercussion de la crise alimentaire. Il n’en a pas été de même en Égypte. Ce pays demeure un des plus vulnérables en raison de sa fragilité économique et de ses tensions politiques. Ce qui en fait sans doute un des plus sensibles à la fermeture des exportations décidée unilatéralement par la Russie au cours de l’été 2010.
L’Union européenne doit considérer que le sort des populations de la rive sud de la Méditerranée relève en partie de sa responsabilité. Les besoins alimentaires constituent certes un marché pour les producteurs européens, mais la modernisation des structures agraires grâce au développement des marchés intérieurs est la priorité des priorités. Cette modernisation passe par la diversification des productions. Le succès de la production de lait au Maroc est un exemple du mouvement coopératif local. Et les filières françaises peuvent participer à la création de filières économiques, dans le domaine des oléagineux par exemple.
Comment l’Europe peut-elle imaginer qu’elle puisse gérer les flux migratoires et favoriser une meilleure gestion des écologies fragiles sans contribuer à l’amélioration de la situation de millions de paysans pauvres ? L’initiative d’Union pour la Méditerranée (UPM), voulue par Nicolas Sarkozy et Henri Guaino, se heurte à bien des réticences politiques. S’il ne faut pas attendre des miracles des échanges régionaux contraints par les difficultés politiques, l’UPM pourrait offrir un lieu de concertation sur les enjeux agricoles partagés, incluant non seulement les échanges Nord-Sud et Sud-Nord mais aussi les partenariats économiques entre filières agricoles et agro-industrielles.
La priorité est maintenant d’aider l’Afrique subsaharienne à réussir sa révolution verte
L’Afrique subsaharienne mérite une attention particulière. Proche de l’Europe, elle reste une région pauvre dont l’économie est essentiellement agricole. Or cette agriculture ne s’est pas encore engagée dans l’intensification. Les rendements céréaliers restent les plus faibles du monde, de l’ordre de 13 quintaux par hectare, à comparer avec la moyenne mondiale de 32 quintaux et aux 50 quintaux des pays industrialisés. Pourtant les paysans sont nombreux. Seuls 230 millions d’hectares sont exploités sur un potentiel de terres cultivables estimées par la FAO à plus de 1 milliard. Les ressources en eau sont abondantes, même si elles sont inégalement réparties. Ce sont les moyens qui manquent pour les mettre en valeur.
En fait, l’Afrique subsaharienne est la région du monde qui a le plus souffert des politiques d’ajustement structurel et du désengagement des États. Les taux de croissance de ces dernières années, de l’ordre de 6%, proviennent essentiellement de l’exportation de matières premières. En l’absence d’investissements productifs, l’Afrique subsaharienne ne possède pas les moteurs qui ont tiré l’économie agricole dans les pays émergents.
De nombreuses raisons sont avancées pour expliquer cette situation : la faiblesse des gouvernements, les conflits et les guerres, les taux de change qui, dans la zone euro, pénalisent les exportations, le morcellement politique du continent, les contraintes climatiques, sans oublier les problèmes sanitaires qui pèsent lourdement sur les classes actives. Cependant, il ne faut pas négliger les conséquences des politiques économiques imposées par les bailleurs de fonds. Rien n’a été substitué aux politiques publiques dirigistes et coûteuses qui ont été remises en cause, à juste titre. Les pouvoirs publics nationaux et internationaux ont laissé tomber l’agriculture. Les productions d’exportation, comme le cacao ou le coton, ou bien celles qui faisaient l’objet d’une transformation industrielle, comme l’huile de palme, ont tiré leur épingle du jeu, mais les cultures vivrières se sont retrouvées de fait dans un angle mort. Et cette situation repose la question de la conception des politiques publiques et du financement de l’agriculture.
L’Afrique de l’Ouest pourrait satisfaire ses besoins alimentaires
Blein R., Goura Soulé B., Faivre-Dupaigre B., Yérima B.« Les potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) » Paris – FARM – 2007
Comme l’ont montré les études de la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde, l’Afrique de l’Ouest pourrait tout à fait satisfaire ses besoins alimentaires.3 Au cours des vingt-cinq dernières années, alors que la population a doublé, la production régionale de productions végétales a plus que triplé. La production vivrière est passée de 59 millions de tonnes en 1980 à 212 millions en 2005. Mais ces résultats ont été gagnés pour 70% par l’extension des surfaces cultivées et pour 30% par l’augmentation des rendements. Ce ratio est inverse du ratio du reste du monde. L’agriculture ne s’est pas intensifiée. Selon la FAO, la région dispose de 236 millions d’hectares cultivables, mais seul 24% de ce potentiel est cultivé, soit 55 millions d’hectares, non compris les 119 millions d’hectares de pâturage.
On estime qu’une augmentation de 50% des terres cultivées est possible. En revanche, les rendements devraient doubler. Ce doublement des rendements est conditionné par la maîtrise de l’eau. Les ressources existent. Le potentiel irrigable est de plus de 10 millions d’hectares. De plus, des zones largement dépressives, qui peuvent bénéficier de retenues d’eau locales, offrent un potentiel important de 11 à 16 millions d’hectares. Le problème que posent ces aménagements est celui des capacités d’investissement. Les moyens ne peuvent être dégagés par les budgets des gouvernements locaux. Cela devrait représenter une priorité et un véritable effort en faveur de l’agriculture africaine.
Le développement de l’irrigation est indispensable à la satisfaction des besoins en riz, alors que la région est dépendante des importations à hauteur de 55%. La demande estimée en 2025 pour 455 millions d’habitants s’élèverait à 22 millions de tonnes de riz, soit un peu moins de 7 millions d’hectares avec un rendement de 5 tonnes par hectare. La surface actuelle consacrée au riz est de 5 millions d’hectares avec un rendement de 1,67 tonne de paddy. Mais le rendement moyen dans la zone de l’Office du Niger, qui est déjà de 4 tonnes par hectare, montre que ces objectifs ne sont pas hors de portée.
L’Afrique de l’Ouest pourrait nourrir ses habitants d’ici 2025. Les paysans africains en sont capables et les ressources du milieu le permettent. Il faut investir dans l’agriculture. Les États africains ne peuvent le faire seul. La communauté internationale doit les aider.
Les déclarations de la communauté internationale non suivies d’actions
Où en est la mobilisation des dirigeants du monde du printemps 2008 ? Agitation institutionnelle des diplomates, faible montant des sommes réellement libérées, conformisme de la réflexion sur les politiques agricoles… essayons donc d’y voir clair.
Lors de son intervention le 6 juin 2008 au sommet convoqué par la FAO à Rome, le président Nicolas Sarkozy a lancé l’idée d’un partenariat mondial sur la sécurité alimentaire. L’objectif était d’améliorer la coordination du système international, de le doter d’un groupe d’experts sur le modèle des experts du climat et de moyens pour soutenir la relance des politiques agricoles. En fait, on est plutôt conduit à constater une multiplication des prétendants à la coordination.
Le secrétariat des Nations Unies et son programme-cadre
La première instance qui y prétend est une équipe des Nations unies mise en place par le secrétaire général Ban Ki-moon en avril 2008. Sa dénomination officielle la caractérise : Coordination Team of the UN System High Level Task Force on the Global Food Security Crisis (« Équipe de coordination du groupe spécial de haut niveau des Nations unies sur la crise de sécurité alimentaire globale »). Cette instance a défini un cadre incitatif (Comprehensive Framework for Action CFA) qui est censé orienter les initiatives des acteurs multilatéraux et nationaux. Le texte rédigé dans le style des Nations unies s’adresse aux spécialistes de ce genre de diplomatie. On voit mal comment il peut atteindre les acteurs. Elle dispose aujourd’hui d’un organigramme avec une vingtaine d’experts répartis entre New York, Genève et Rome. Le budget de 3,4 millions de dollars est financé par le Royaume-Uni (1 million), l’Islande, la France, la Suisse et la Banque mondiale.
Le Comité de sécurité alimentaire réformé
L’autre prétendant majeur à la coordination internationale est la FAO. Son directeur général Jacques Diouf s’est battu pour ne pas être dépossédé de ses responsabilités par Ban Ki-moon et a procédé au renforcement du Comité de sécurité alimentaire mondiale (CSA) créé après la Conférence mondiale de l’alimentation de 1974 pour assurer le suivi de la situation alimentaire mondiale. La réforme, soutenue par la France, a ouvert le CSA aux différents acteurs du système alimentaire mondial. La France a aussi encouragé la création, intervenue le 3 septembre 2010, d’un groupe d’experts de haut niveau pour la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE). Le CSA est présidé par Noel De Luna. Le Dr S. Swaminathan, père de la révolution verte indienne, a été élu président du groupe d’experts. Le CSA possède aujourd’hui la légitimité institutionnelle pour assurer la coordination, même s’il ne faut entretenir d’illusions sur la capacité des grands rassemblements pour prendre des décisions et infléchir les stratégies des gouvernements.
Depuis 2008, le G8 et le G20 ont inscrit la sécurité alimentaire à leur ordre du jour. En 2009, les pays industrialisés membres du G8 ont adopté une déclaration sur la sécurité alimentaire mondiale, l’Initiative de L’Aquila sur la sécurité alimentaire (IASA). Les signataires conviennent « d’agir avec l’envergure et l’urgence voulues », et s’engagent à mobiliser 20 milliards de dollars sur trois ans. Ce chiffre de 20 milliards avait déjà été cité à la suite de la conférence de Rome du 6 juin 2008. De toute façon, la mise en œuvre reste de la responsabilité de chacun des acteurs. On ne sait s’il s’agit de financements nouveaux et on ne connaît pas leur destination. Ce n’est qu’une annonce.
Par ailleurs, la déclaration de L’Aquila recommande le renforcement de la gouvernance mondiale et cite toutes les instances de coordination sans clarifier leurs responsabilités respectives. Et il est vrai que la G8 n’est pas une instance de coordination. Mais quelques semaines après, les 24 et 25 septembre 2009, le G20 réuni à Pittsburg se saisit du dossier à son tour et recommande, sur l’insistance des États-Unis, d’appeler « la Banque mondiale à œuvrer […] pour établir un fonds d’affecta- tion spéciale multilatéral » afin de soutenir les actions innovantes et des programmes tels que le Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP). Les engagements s’élèvent à 22 milliards de dollars. On ne sait rien sur ces 22 milliards de Pittsburg, pas plus que sur les 20 milliards de L’Aquila. Mais les États-Unis ont obtenu la recommandation de la création d’un fonds spécial gérée par la Banque mondiale, idée à laquelle les Européens s’opposaient.
Les États-Unis prennent le leadership et s’appuient sur la Banque mondiale
Dès le 22 avril 2010, le secrétaire au Trésor des États-Unis annonce la création du Global Agriculture and Food Security Program (« Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire »). Comme prévu, le fonds sera géré par la Banque mondiale. Il est immédiatement doté de 900 millions de dollars, dont 475 millions viennent des Américains. Les pays fondateurs sont les États-Unis, le Canada, l’Espagne, la Corée du Sud et la Fondation Bill & Melinda Gates (30 millions de dollars). Ni l’Union européenne ni la France ne font partie des fondateurs. Ainsi les États-Unis prennent le leadership de la lutte contre l’insécurité alimentaire. La capacité d’action se situe au cœur de Washington, dans ce triangle où se trouvent la Maison-Blanche, la Banque mondiale, le FMI et l’administration américaine. Le fonds spécial n’est pas une instance de coordination : il est beaucoup mieux que cela, puisqu’il possède à la fois une gouvernance restreinte et un pouvoir financier.
Parallèlement, les États-Unis lancent leur propre stratégie de lutte contre l’insécurité alimentaire, « Feed the Future », un programme très structuré avec des choix clairs. Cette stratégie de l’administration Obama donne la priorité au soutien à la production agricole des pays pauvres, tournant ainsi le dos à l’orientation traditionnelle américaine en faveur de l’aide alimentaire.
Le refus de l’Union européenne de participer à cette initiative est une erreur historique. Elle résulte, une fois de plus, de l’absence de vision stratégique et de manque de réactivité (c’était la période de nomination des nouvelles instances de la Commission européenne et des commissaires…). Cette absence est d’autant plus regrettable que l’Union européenne avait dégagé un crédit spécial de 1 milliard d’euros à la fin de l’année 2008. Il est vrai que la technocratie de la Commission finissante a réussi à dépenser ce milliard sans impact, ni politique, ni stratégique, ni opérationnel. Inversement, par leur clarté, les initiatives américaines donnent quelque espoir et font regretter par contraste le flou des positions européennes.
La régulation des marchés agricoles ne traiterait qu’une partie du problème
Le président Sarkozy a donc annoncé que la France inscrirait la question de la régulation des marchés des matières premières, notamment celle des prix des produits agricoles, à l’ordre du jour du G20 que la France préside à partir de novembre 2010. Les raisons d’encadrer la volatilité des marchés agricoles sont nombreuses. L’instabilité pénalise les consommateurs lorsque les prix grimpent, et les agriculteurs lorsqu’ils s’écroulent. L’absence de prévisibilité des prix fait perdre à l’agriculture une grande partie des investissements potentiels. La volatilité de leurs approvisionnements cause de graves difficultés aux industries agroalimentaires. L’instabilité génère l’instabilité. Les producteurs réagissent aux signaux du marché, l’agriculture se trouve entraînée dans un cercle vicieux. Or les marchés agricoles souffrent de spécificités : la dispersion de la production, la vulnérabilité aux aléas climatiques et, surtout, la dissymétrie des informations qui imposent des décisions aux agriculteurs en l’absence de données économiques fiables. De plus, la financiarisation des marchés agricoles a amplifié la spéculation depuis une dizaine d’années.
Dans ces conditions, on ne peut que souhaiter que la communauté internationale arrête des dispositions permettant de limiter la fluctuation des cours à ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des marchés.
L’instabilité des prix dans les pays en développement dépend de facteurs endogènes
Pour autant, la question est complexe et sa résolution ne garantirait pas la sécurité alimentaire de la planète. En effet, la régulation concerne les prix sur les marchés internationaux. Or ces prix ont peu d’impact sur les marchés intérieurs des pays pauvres. Les études de la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) ont montré que la transmission des prix internationaux aux agriculteurs africains était très réduite. La volatilité des marchés intérieurs, nationaux et régionaux, dépend de facteurs endogènes, que l’on peut classer en deux grandes familles. La première est celle de la production dépendant des aléas climatiques mais aussi de l’organisation de la production, de l’accès au crédit et aux intrants. La seconde famille est celle de déficiences de fonctionnement des marchés en raison de l’insuffisance des capitaux et des crédits, des obstacles institutionnels, de l’inorganisation des filières agricoles et de l’absence de capacités de stockage physique et financière. Certes, le niveau de prix des denrées importées n’est pas indifférent. L’importation de riz bon marché déstabilise la production locale dans certains pays comme le Sénégal. Mais, durant une vingtaine d’an- nées jusqu’en 2007, le prix du riz importé n’a pas été instable. Il a été constamment bas.
Peut-on satisfaire à la fois les producteurs et les consommateurs ?
Il faut aussi poser la question des conflits d’intérêts entre producteurs et consommateurs. Peut-on déterminer des références de prix qui satis- fassent les uns et les autres ? Les gouvernements des pays pauvres ont tendance à arbitrer en faveur des consommateurs, au détriment des agriculteurs. Cette contradiction entre pays développés et pays en développement, ou du moins les plus démunis d’entre eux, ne risque-t-elle pas de se retrouver dans l’enceinte du G20 ?
Si la régulation devait entraîner une augmentation des prix agricoles intérieurs dans les pays d’Afrique subsaharienne, elle devrait impérativement être assortie d’une politique de soutien à la production locale. Dans ces conditions, on voit mal ce qui distinguerait un accord au G20 des négociations des accords de partenariat économique (APE) en cours dans l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les négociations n’ont toujours pas abouti avec l’Afrique de l’Ouest. Or les organisations agricoles de cette région demandent des taxes aux importations des produits agricoles de base de 50 à 80%. Les gouvernements africains n’y sont guère favorables. Mais, surtout, les négociateurs européens ne font rien pour aider les États africains à protéger les marchés régionaux et à faciliter la mise en place de politiques agricoles dynamiques.
De même, les négociations du cycle de Doha conduites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ont achoppé en juillet 2008 sur le mécanisme de sauvegarde spécial (MSS) exigé par l’Inde. Ce pays souhaitait appliquer des restrictions temporaires pour limiter les importations en relevant les tarifs douaniers ou en imposant des quotas. Pour l’Inde, l’objectif était de protéger les agriculteurs vulnérables des importations lorsque les prix baissaient trop fortement.
Le défaut majeur des négociations commerciales, qu’elles soient européennes ou multilatérales, est de distinguer la fixation des règles du commerce des financements de l’agriculture. En effet, l’Organisation mondiale du commerce n’a pas de maîtrise de l’aide au développement, alors que le cycle de Doha s’intitule cycle de développement. Ce travers se retrouvera au G20 si celui-ci traite de la régulation des marchés sans traiter en même temps des politiques de développement de l’agriculture et de leur financement. Cela serait d’autant plus dommage que le G20 offre à la France une occasion historique de reprendre la main sur le dossier de la sécurité alimentaire.
La conception de nouvelles politiques agricoles est aussi cruciale que les financements pour les mettre en oeuvre
Financement de l’agriculture et politiques agricoles publiques constituent un couple indissociable. L’absence de moyens réduit à néant la relance des politiques agricoles. À l’inverse, l’immobilisme conceptuel freine les décisions des responsables financiers. Les bailleurs de fonds multilatéraux utilisent l’alibi que la bonne gouvernance serait plus importante que l’augmentation des budgets. C’est un idéal inaccessible, constitué d’un mélange de politiques publiques «intelligentes», d’État de droit, d’administration efficace et d’absence de corruption. En fait les agences d’aide se sont repliées sur les projets de développement. Elles ont renoncé à des stratégies d’ensemble et à des programmes sectoriels.
Les politiques agricoles et les politiques de développement sortent d’un cycle de trente ans qui a commencé au début des années 1980, motivé, à l’origine par la nécessité de désendetter les États. Ce cycle est symbolisé par les politiques d’ajustement structurel. Les bons élèves du Fonds monétaire international, notamment les États d’Afrique subsaharienne, ont été au bout de cette logique. Ils ont démantelé les services agricoles et les caisses de stabilisation, réduit les budgets agricoles et privatisé les sociétés de développement et les banques agricoles, et ouvert leurs marchés aux importations.
La remise en cause de cette politique se heurte à des obstacles considérables en raison de la perte des compétences dans les ministères et du tarissement des budgets. Elle se heurte surtout à une difficulté conceptuelle. Il est impossible de revenir sur la libéralisation et l’économie de marché et il est difficile de concevoir et de mettre en place les nouvelles fonctions que requièrent les politiques publiques dans des économies libérales. D’autant qu’aucun État ne peut aujourd’hui réussir seul.
Des politiques agricoles favorables à l’investissement et à l’esprit d’entreprise
L’élaboration de nouvelles politiques agricoles et de développement est une nécessité. Cette conception ne peut provenir d’une inflexion des politiques antérieures, mais c’est bien à une rupture qu’il faut procéder. Les responsables politiques doivent peser de toute leur volonté pour y parvenir.
Il faut que les productions vivrières deviennent des productions commerciales pour le commerce local. Nous proposons ici de contribuer à l’élaboration de politiques agricoles nouvelles. Il importe de rappeler quelques attendus pour conserver notre objectif.
- La question traitée est celle de la sécurité alimentaire. Les productions agricoles concernées sont donc les productions vivrières : les céréales, les tubercules, les produits d’origine animale, notamment le lait et les volailles.
- Les productions d’exportation, telles que le coton, le cacao, le caoutchouc naturel, ou les productions industrielles, comme les oléagineux ou les biocarburants, ne sont pas exclues. Elles ne doivent pas être opposées aux productions alimentaires, mais les politiques agricoles ne peuvent se limiter à la réussite de ces filières.
- L’objectif est de faire en sorte que les productions alimentaires, par exemple le riz ou le maïs en Afrique subsaharienne, à l’instar du lait en Inde, deviennent des productions commerciales pour les marchés régionaux.
- La priorité doit être donnée au potentiel de production et au fonctionnement des marchés locaux. Il faut produire plus et diminuer les coûts de production unitaire. En effet, les marchés étant déjà ouverts, toute protection des marchés entraîne une augmentation des prix alimentaires.
- L’augmentation des rendements et de la productivité est une condition indispensable de réussite. L’intensification de l’agriculture des pays agricoles pauvres doit être considérée comme une priorité. C’est un droit des sociétés agricoles qui doivent avoir accès aux technologies disponibles. Ils disposent des marges de manœuvre de productivité leur donnant un potentiel de progrès sans provoquer de dégradation du milieu.
- Le développement des fonctions économiques des organisations agricoles et la structuration de filières agricoles en acteurs économiques doivent constituer le cœur de l’action. Il ne s’agit pas d’opposer cette priorité à la montée en puissance d’entreprises et d’investisseurs privés qui peuvent jouer un rôle de moteur économique, mais ce secteur privé ne pourra qu’occuper une place restreinte dans les filières vivrières. Il ne pourra pas répondre à lui seul aux enjeux ni de la sécurité alimentaire ni de l’emploi agricole.
Proposition pour une approche économique « pro-business » ou « pro-entreprises »
Dani Rodrik « Nations et mondialisation, Les stratégies de développement dans un monde globalisé » Paris La découverte – 2008
La démarche pro-business définit une conception globale des politiques agricoles tournées vers le développement économique et la diffusion de l’esprit d’entreprise. Elle vise à orienter les politiques publiques et à mobiliser les acteurs professionnels et privés dans une attitude «pro- entreprises ».
L’expression pro-business est empruntée à Dani Rodrik, professeur d’économie politique internationale à l’université de Harvard, et à Arvind Subramanian, membre du centre de recherche du Fonds monétaire international. Dans un texte de mai 2004, intitulé « From “Hindu Growth” to Productivity Surge: the Mystery of the Indian Growth Transition4 », les auteurs font l’hypothèse que la croissance économique de l’Inde a été provoquée par un changement d’attitude du gouvernement vis-à-vis de l’entreprise privée, en 1980. Les auteurs distinguent l’orientation pro- marché et l’orientation pro-business (ou pro-entreprise). « La première vise à supprimer les obstacles aux marchés à travers la libéralisation de l’économie. La seconde vise à accroître la rentabilité des établissements industriels et commerciaux existants. Elle tend à favoriser les entreprises et les producteurs. » Il est à noter que le traducteur de Dani Rodrik en français a conservé l’expression pro-business (plutôt que pro-entreprises). Nous avons adopté la même position, qui nous semble bien caractériser et différencier cette démarche.
Cette stratégie conduit à la mise en œuvre d’un nouveau modèle économique pour l’agriculture. Basée sur la promotion d’organisations professionnelles exerçant des fonctions économiques, elle suppose l’accès aux financements extérieurs en combinant les emprunts bancaires et les subventions de développement. Elle vise à dégager des marges assurant l’autonomie des groupements agricoles.
La sphère publique représentée par les États, les organisations régionales et les institutions internationales accompagne l’approche pro-business. Les pouvoirs publics favorisent et sécurisent les investissements. On peut rappeler quelques axes majeurs : investissements dans les infrastructures (transports, communication), investissements dans les structures du marché, actions incitatives (législation, subventions) favorables au crédit agricole, actions en faveur des dispositifs de couverture de risques, politiques d’intégration régionale, politiques à long terme donnant la priorité aux productions locales (tarif douanier adapté), politiques favorables à la structuration des filières agricoles (législation, subventions, délégation de gestion), promotion de l’approche mutualiste et des coopératives.
Les acteurs privés, les organisations professionnelles agricoles et leurs partenaires économiques et financiers, notamment les institutions de crédit, doivent être associés à l’élaboration des politiques publiques et à leur mise en œuvre. Il s’agit de les associer à la décision et non les cantonner dans les forums de la société civile ou du secteur privé, qui les tiennent de fait à l’écart des arbitrages décisifs.
Pour un G20 alimentaire consacré à la sécurité alimentaire
La priorité doit être donnée aux investissements, notamment à la relance des financements publics grâce la solidarité internationale. La sécurité alimentaire de la planète est possible. Il y faut une forte mobilisation conceptuelle et financière du Nord comme du Sud, afin de valoriser ce qui est disponible de technologies, de savoir-faire, d’économie et de management. Le double enjeu consiste à relancer les investissements en faveur de l’agriculture et de concevoir de nouvelles politiques agricoles. La communauté internationale a besoin d’un véritable coup de poing pour changer de rythme. C’est à ce prix que la période qui s’ouvre accordera aux enjeux agricoles l’ambition dont ils ont besoin. Le G20 est une opportunité. La régulation des marchés est un objectif fédérateur. Il faut le dépasser en traitant la sécurité alimentaire avec un nouvel élan.
La Fondation pour l’innovation politique publie cette note en partenariat avec la Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde. FARM est une fondation reconnue d’utilité publique créée par cinq entreprises françaises : Crédit Agricole SA, GDF SUEZ, le groupe Casino, Limagrain Vilmorin, Air France et l’Agence Française de Développement avec le soutien de l’Etat.
La mission de FARM est de promouvoir dans le monde des agricultures et des filières agro-alimentaires performantes et respectueuses des producteurs. FARM promeut une approche économique des filières agricoles et la diffusion de l’esprit d’entreprise. FARM agit par les études, les propositions, les rencontres, les projets de développement pilotes et la formation des leaders agricoles
Les ressources de la fondation proviennent des fondateurs, d’entreprises mécènes, des particuliers et des pouvoirs publics.
Les informations et les publications sont disponibles sur le site
www.fondation-farm.org




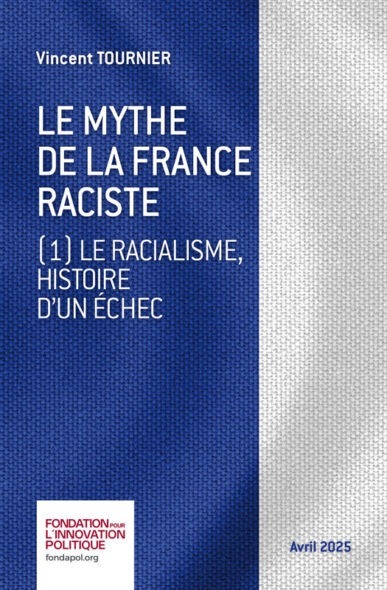









Aucun commentaire.