Le soufisme : spiritualité et citoyenneté
Quatrième note de la série « Valeurs d’islam »Note de l’auteur
Qu’est-ce que le soufisme ?
Le soufisme : une voie initiatique aussi exigeante que méconnue
La confrérie : une fraternelle islamique
Le renouveau contemporain de la culture soufie : un chemin de liberté
La femme égale de l’homme en dignité spirituelle
Le soufisme : un engagement séculier stimulé par la spiritualité
Fils et filles de leur temps : quelques grandes figures du soufisme
Mohammad Iqbal : une pensée soufie à la lumière de l’Occident
La république serait-elle à l’épreuve de l’islam ?
L’exemple algérien : de l’affaiblissement des zaouïas à l’émergence du radicalisme
L’islamophobie : ce nouveau racisme
Les discriminations : un dérivé de l’islamophobie
La centralité de l’école dans la fabrique d’un citoyen « éclairé ».
Une indispensable pédagogie de la laïcité
La faiblesse de l’enseignement religieux
Le phénomène qu’on appelle le « jihadisme français »
Désinstrumentaliser l’islam pour permettre l’exercice d’une citoyenneté active
L’organisation de l’islam de France de plus en plus contestée
Médias versus islam
Les musulmans face à une injonction contradictoire
Le poids de la variable cultuelle dans le comportement électoral
Le danger des listes communautaires
Les soufis : pour retrouver l’islam des lumières
De la suspicion à la reconnaissance : une nouvelle approche de l’identité
Le soufisme : une spiritualité en phase avec les valeurs de la laïcité
Faire de la France le « Harvard de l’islam »
Ce funeste « débat », lancé au printemps 2010 par Éric Besson, alors ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, s’est décliné sous forme de « réunions » organisées par les préfets.
Éric Geoffroy, Le Voie intérieure de l’islam, Seuil, coll. « Points », 2009, p. 9.
Cheik Khaled Bentounès, « L’État islamique mène une croisade contre l’humanité », interview, Jeune Afrique, 8 octobre 2014.
En novembre 2001, Catherine Poitevin, journaliste, écrivait dans un hors-série de Télérama intitulé « Comprendre l’islam » : « Nous sommes entrés dans l’ère du soupçon islamophobe […], un soupçon qui ne s’éteint pas par la condamnation unanime du terrorisme. »
Introduction
L’islam est devenu ces dernières années un sujet éminemment politique. Sa dimension religieuse et spirituelle s’est réduite à peau de chagrin, au profit de la polémique. Dans cette cacophonie, seuls ont voix au chapitre médiatique les obscurantistes, d’un côté, et les islamophobes, de l’autre, dans une mise en scène redoutablement efficace de surenchère et de légitimation mutuelle. C’est ainsi que le foulard est devenu niqab. Trop longtemps, les débats hexagonaux ont essentiellement porté sur la question de la visibilité dans l’espace public. Une image déformée de l’islam émerge de cette double instrumentalisation, tant au sein de la société dans son ensemble qu’auprès des musulmans eux-mêmes.
Toutes les enquêtes sur le sujet témoignent d’une défiance grandissante de la population française envers les musulmans, défiance démultipliée depuis les attentats du 11-Septembre. Dans son rapport annuel de 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) évoque « la montée de l’intolérance antimusulmane » et note que « la polarisation contre l’islam est la plus constante, la plus ancrée ». Autrefois latente, la suspicion s’exprime désormais clairement. Le débat sur l’identité nationale1, sous prétexte de libérer la parole, s’est transformé en un vaste exutoire islamophobe, ce qui n’a pas manqué d’émouvoir Gilles Bernheim, à l’époque grand rabbin de France, regrettant qu’il soit « de plus en plus difficile d’être musulman en France », qualifiant de « très malade une société qui cherche des boucs émissaires ». Aujourd’hui, pour certains, l’islam serait incompatible avec la République.
On peut certes relativiser ces analyses et souligner qu’elles expriment les angoisses d’une société en pleine crise économique, sociale et morale. On pourrait aussi expliquer comment ce désarroi collectif profite aux populistes qui bloquent toute réflexion et exploitent les peurs par calcul électoraliste. Une abondante littérature existe déjà sur l’inquiétude culturelle et les liens entre crise économique et repli identitaire. Mais ces analyses sociologiques – certaines passionnantes, d’autres de simples controverses – font l’impasse sur ce qu’elles n’observent pas.
La présente contribution vise à inciter les décideurs publics et les observateurs de la vie sociale et politique à élargir leur champ de vision et à aiguiser leur regard. Il est impératif, dans un pays où l’islam est la deuxième religion, de proposer un cadrage plus pertinent tant du point de vue de la réalité sociale que des perspectives politiques. Telle est la vocation de ma démarche : le débat n’est pas de savoir si on est pour ou contre l’islam ou les musulmans, mais l’urgence est de rétablir les conditions d’existence d’une République apaisée. C’est au regard du danger qui menace notre système politique que j’ai jugé, en qualité de représentante de la souveraineté nationale et forte de la tradition qui m’a portée, nécessaire d’intervenir, en mon nom, dans le débat en parlant de l’islam.
Au-delà de la distinction entre chiisme et sunnisme, il y a essentiellement deux manières principales de vivre l’islam :
- la voie légalitaire, où la foi est étroitement normée par le dogme, est suivie par la majorité des musulmans de France ;
- l’islam soufi, qui se caractérise par la pratique du dogme mais aussi par son dépassement au profit de la spiritualité, est pratiqué par une minorité de musulmans de France.
| Les traductions des versets du Coran proposées dans cette note sont l’oeuvre de l’auteur et ont été effectuées à partir de l’édition du Caire. |
L’islam soufi, tant en France que dans le monde, est un islam spirituel organisé en confréries multiséculaires. Éric Geoffroy souligne que « le soufi ne rejette nullement ni la loi, ni les rites de l’islam. Bien au contraire, il les éclaire de l’intérieur, renouvelant sans cesse leur sens pour le fidèle2 ». La voie soufie est largement méconnue à l’extérieur de l’islam et, depuis longtemps, marginalisée par l’orthodoxie islamique. Le soufisme est l’angle mort du discours sur l’islam. Aux côtés de l’islam légalitaire et de l’islam spirituel, le monde musulman, aidé en cela par les stratégies hasardeuses des puissances occidentales, a également enfanté un islam radical, qui s’est métastasé en sectes fondamentalistes et en groupuscules terroristes dont la visée première est la division (fitna) et le chaos. C’est sur l’islam qu’ils prétendent appuyer leurs actes, c’est l’islam qu’ils brandissent pour justifier leurs crimes. Ces organisations tentent d’asseoir leur légitimité sur un Coran dénaturé dans son message. Le problème, selon le cheikh Khaled Bentounès, est que « les saints et les assassins se réfèrent au même livre. Certains l’étudient, d’autres l’instrumentalisent3 ». Mais, dans cette mise en accusation de l’islam, l’opinion occidentale oublie souvent que les premières victimes de ce terrorisme post-guerre froide sont principalement les musulmans.
Les légalitaires et les soufis ont beau les condamner, affirmer qu’ils ne se reconnaissent en rien dans ces actes odieux commis en leur nom, la bataille sémantique et médiatique a, pour le moment, été remportée par les obscurantistes4. Ce radicalisme est aux antipodes du message coranique. Il propage une idéologie fondée sur le recours à la violence, suivant un mécanisme qui fut aussi à l’œuvre dans la Chrétienté. Il est grand temps d’arracher à la barbarie le masque de la sacralité qui veut faire croire qu’elle est l’expression de la transcendance.
De fait, l’islam est devenu l’otage de plusieurs factions complices. Les terroristes utilisent cette référence comme un butin de guerre à faire fructifier et les populistes comme un bouc émissaire bien commode. Comment, dans ces conditions, les musulmans peuvent-ils et doivent-ils agir pour récupérer leur identité et l’estime de soi quand on les somme en permanence de se dédire, de se justifier, voire de se renier ?
Dans un monde musulman en souffrance, la voie et le message soufis peuvent-ils constituer une alternative réelle ? Il est vrai que l’essence et les principes soufis, notamment au regard de l’action de quelques grands savants et maîtres de la voie, illustrent en quoi le soufisme pourrait s’imposer comme un élément d’apaisement dans le débat français et comme un vecteur d’une citoyenneté active. Pour que ce discours fasse sens, il faudrait au préalable que la République n’oublie pas elle-même les principes qui la fondent.
La première partie de cette contribution tentera une approche générale du soufisme. Seront ensuite abordées les crispations liées à l’islam dans le contexte historique français, puis la question de la désintrumentalisation de l’islam s’impose comme une nécessité afin de permettre l’exercice d’une citoyenneté active. Enfin, nous verrons comment des intellectuels musulmans, d’inspiration soufie et ayant pleinement conscience des enjeux, se sont discrètement improvisés « médiateurs » dans le débat français.
| Le conseil scientifique de la série Valeurs d’islam a été assuré par Éric Geoffroy, islamologue à l’Université de Strasbourg. |
Bariza Khiari,
Sénatrice de Paris (ex-première vice-présidente du Sénat).

Islam et contrat social
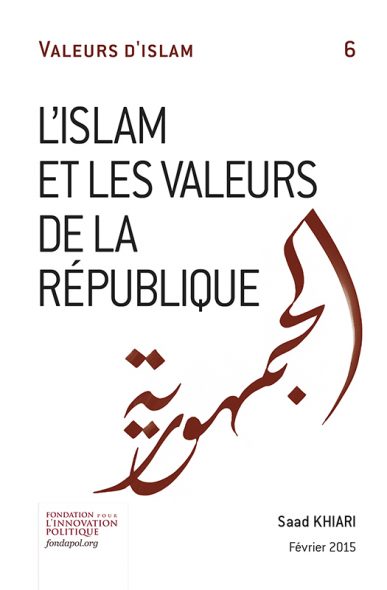
L'islam et les valeurs de la République

Éducation et islam

Le pluralisme religieux en islam, ou la conscience de l'altérité

Les femmes et l'islam : une vision réformiste

Islam et démocratie : les fondements

Islam et démocratie : face à la modernité

Chiites et sunnites : paix impossible ?

Le pluralisme religieux en islam, ou la conscience de l'altérité

Coran, clés de lecture

L'humanisme et l'humanité en islam
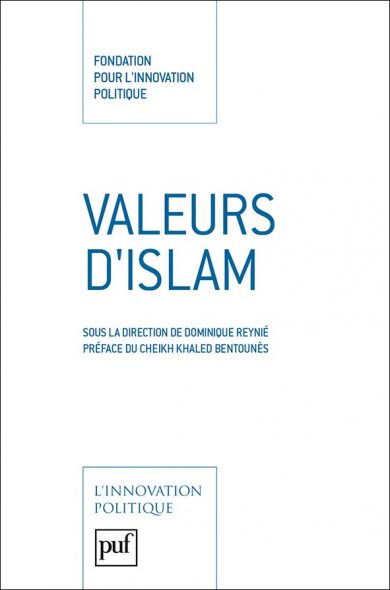
Valeurs d'islam
Note de l’auteur
| Cette contribution ayant été rédigée avant le drame qui a décimé Charlie Hebdo, il m’a semblé nécessaire de rajouter un commentaire pour évoquer cet événement d’une barbarie sans nom.
L’exécution de toute l’équipe de Charlie Hebdo, notamment des principales plumes, suivie par l’assassinat de deux policiers, la prise d’otages et le meurtre de quatre Français, parce que juifs, dans un hypermarché casher de Vincennes, par trois jeunes Français les 7, 8 et 9 janvier 2015, porte la signature d’un terrorisme jihadiste :
Cette attaque s’inscrit dans une grammaire presque trop parfaite : enfance désespérante, petite et grande délinquance, radicalisation religieuse accentuée par un milieu carcéral criminogène, lien avec les organisations djihadistes à l’étranger. Mais cette généalogie du mal est par trop réductrice au regard de la diversité des profils des aspirants jihadistes dont on parlera plus loin. L’analyse de ce terrorisme occidental qui se revendique de l’islam reste à faire. Seule une certitude émerge pour l’heure : l’explication par le seul contexte national français est insuffisant. En revanche, la spectaculaire mobilisation du peuple français dans les jours qui ont suivi ces heures noires s’inscrit quant à elle pleinement dans l’histoire nationale, l’indéfectible attachement aux libertés, notamment la liberté d’expression. Subitement, le 7 janvier, peu avant midi, le sens, la valeur, la portée de nos principes républicains ont repris toute leur centralité dans notre existence. L’hommage historique de toute la nation du 11 janvier est autant porteur de promesses que d’inquiétudes. Pour que perdure le sursaut, il faudra que chacun, d’où qu’il parle, fasse l’effort d’un examen de conscience avant de parler à nouveau. Puisse ce texte contribuer à une meilleure connaissance d’un aspect des merveilles de l’islam, tant auprès des Français de confession musulmane que de tous mes compatriotes. Puisse aussi ce texte contribuer également à une meilleure connaissance de la laïcité qui fonde la primauté de la citoyenneté sur l’identité et qui est la pierre angulaire de notre société. |
Qu’est-ce que le soufisme ?
Coran 18 : 28.
Le salafisme est un mouvement sunnite revendiquant un retour à l’islam des De nos jours, il s’agit d’un mouvement fondamentaliste composite, constitué notamment de mouvances politiques et jihadistes. Toutes ces mouvances partagent le fait de se poser en continuation de l’islam des premiers siècles. À ce titre, il importe de voir qu’étymologiquement le mot salaf signifie « prédécesseur » ou « ancêtre » et désigne les compagnons du prophète Mahomet et les deux générations qui leur succèdent.
Grande figure du Maghreb du XIVe siècle, Ibn Khaldûn est considéré comme un des pionniers de l’histoire. On lui doit notamment la Muqaddima, introduction à l’histoire universelle et à la sociologie moderne, et Le Livre des Exemples (ou Livre des considérations) sur l’histoire des Arabes, des Persans et des Berbères.
Eva de Vitray-Meyerovitch, Anthologie du soufisme, spiritualités vivantes, Albin Michel, « Spitualités vivantes », 1995, p.22.
Beaucoup d’écrits contemporains, parfois mal intentionnés, abordent l’islam mais peu mentionnent le soufisme, si bien que cette voie n’est connue que des spécialistes ou du grand public à travers des manifestations célèbres, à l’instar de celles des derviches tourneurs. Le détour étymologique présente ici de l’intérêt : selon une première hypothèse, le terme soufisme viendrait de l’arabe safâ qui signifie la pureté cristalline. Le soufisme serait ainsi une vision épurée, pleine de clarté, de l’islam. Selon une deuxième hypothèse, le terme viendrait de l’expression ahl al-saff, « les gens du banc », ceux des premiers rangs, les plus bénis de la communauté. Ce terme renvoie aux premiers temps de l’islam, en référence aux Sûfiyya qui vivaient dans la mosquée du Prophète, à Médine, et que le Coran présente comme « la compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir5 ». Si l’on s’en tient à cette hypothèse, cela reviendrait à affirmer que les soufis sont les plus proches de l’islam véridique. En ces temps où certains se revendiquent du Salaf6 d’un islam prétendument des origines, cette étymologie aurait le mérite de susciter le débat et d’inciter certains fidèles à s’interroger.
D’autres étymologies ont cours. L’une des plus célèbres est sans doute celle qui associe le terme soufisme au terme al-sûf, la laine. C’est d’ailleurs l’hypothèse que retient Ibn Khaldûn7, le grand historien des sociétés musulmanes. Les soufis portaient un habit de laine, réservé aux plus pauvres, en signe de modestie, de refus de l’orgueil et du contentement de soi. Enfin, une dernière hypothèse ferait remonter le terme soufi à une origine étrangère aux langues sémites : la sophia grecque, la sagesse. Le soufi serait ainsi un sage, un être capable de percevoir la réalité du message de Dieu et d’en tirer l’essence.
Retenons de ces multiples définitions l’image d’un soufi inscrit pleinement dans une double intelligence : celle de l’abstraction par la méditation et celle de la pleine compréhension du réel. Comme le souligne Eva de Vitray-Meyerovitch (m. 1999) : « Les définitions proposées par les grands maîtres du soufisme ne constitueront donc que des approches, puisqu’il y a autant de “voies” que de pèlerins et l’âme ne perçoit que ce qu’elle est capable de saisir8. »
Le soufisme : une voie initiatique aussi exigeante que méconnue
Cheikh Khaled Bentounès, Le Soufisme cœur de l’islam, Pocket, 1999, p. 48.
Haute figure de la spiritualité musulmane au Xe siècle, Abû l’Qasim al-Junayd al Baghdadi (m. 911) est considéré comme un grand maître soufi.
Éric Geoffroy, cit., p. 281.
Kebir Ammi, Abd el-Kader, Presses de la Renaissance, 2004, p. 67.
Mansur al-Hallâj est un mystique soufi d’origine Auteur d’une œuvre poétique abondante, il cherche à renouer l’islam avec l’origine pure du Coran. Peu satisfait par l’enseignement traditionnel de l’islam et attiré par une vie ascétique, il se rapproche du soufisme. Rentré à Bagdad, il est suspecté aussi bien par les sunnites que par les chiites pour ses idées mystiques et son influence sur les foules. Sa poésie a été traduite en français par Louis Massignon.
Louis Massignon est un universitaire et islamologue français, auteur d’une thèse sur la vie de al-Hallâj.
Le Cheikh Bentounès, guide de la confrérie ‘Alâwiyya, très présente en Europe et fondateur des Scouts musulmans de France, regrette l’ambiguïté actuelle : « La tradition soufie est très peu connue et suscite de nombreuses interrogations comme celle, par exemple, du lien entre soufisme et islam. On pense souvent que ce sont deux choses différentes, alors que le soufisme est la voie ésotérique de l’islam. On peut dire que si l’islam est un corps, le soufisme en est le cœur9. »
Le soufisme s’est construit au fur et à mesure de son histoire. Suivant un schéma chronologique imparfait, on pourrait dire qu’aux premiers temps de l’islam le soufisme était, dans sa pratique, synonyme d’ascétisme ; puis son expression devint de plus en plus mystique (Xe siècle). Contraint pour des raisons politiques à contenir en public sa dimension « mystique », il se développe autour de confréries, et s’organise autour d’un maître, tandis que la doctrine, peu à peu, se consolide autour de grands textes poétiques, ésotériques, et d’exercices spirituels. Les confréries poursuivent leur expansion, tantôt en mouvement de masse, comme en Asie centrale ou dans les Balkans, tantôt marginalisées dans d’autres espaces géographiques.
Au-delà des différentes étymologies et des singularités locales, le soufisme renvoie à la volonté de parvenir à un état de haute spiritualité. Junayd10, grand maître soufi de Bagdad, rappelait dans une formule elliptique que « l’eau a la couleur de son récipient » : autrement dit, il n’y a pas de voie impérieuse et il appartient au cheminant de découvrir par lui-même la vérité. D’après Éric Geoffroy, cette image « signifie qu’il n’y a qu’une seule religion primordiale [l’eau] qui a pris des colorations multiples en fonction des contextes11 ».
En l’absence de définition univoque, le soufisme n’est pas une doctrine normée, et encore moins normative, mais bien une voie initiatique exigeante. La recherche spirituelle n’a de sens que si elle s’exprime dans le tumulte de la vie quotidienne. L’émir Abd el-Kader (m. 1883) disait : « Mon désert, c’est la foule12. » En cela, le soufisme est une praxis : la spiritualité doit trouver une expression dans la vie séculière. C’est à cette aune que le soufisme n’a pas manqué d’inquiéter l’ordre établi.
En effet, l’orthodoxie, dans une querelle de légitimité, et soucieuse de contenir l’aspiration à la liberté, a réprouvé la pratique soufie. Le poète soufi Hallâj13 (m. 922) fut condamné à mort pour hérésie, après avoir affirmé, dans un moment extatique : « Je suis la vérité. » Cet épisode, fondamental dans l’histoire des relations entre les soufis et les tenants du pouvoir, a fait de Hallâj le « martyr du soufisme ». L’un de nos plus grands orientalistes, Louis Massignon14 (m. 1962) en avait fait le sujet et le titre de sa thèse de doctorat. Suite au martyr de Hallâj, le soufisme s’est engagé dans une mystique « raisonnée ». On pourrait dire que le soufisme « s’académise » alors autour de grandes références intellectuelles, de la constitution d’une méthode et d’une doctrine. Junayd, en proposant une voie du juste milieu, une voie du soufisme sobre où la lucidité l’emporte sur « l’ivresse », fut le principal artisan de cette inflexion. Cette voie dite junaïdi est admise par l’orthodoxie des quatre grandes écoles juridiques du sunnisme que sont le malékisme, le hanbalisme, le shafiïsme et le hanafisme. Elle est aujourd’hui suivie par la majorité des grandes confréries.
La confrérie : une fraternelle islamique
À l’origine, la zaouïa désigne l’angle ou le recoin de la mosquée où le maître délivrait son enseignement ; à présent, ce terme désigne le centre organisationnel et spirituel des confréries.
Jalâl ad-Dîn Rûmî ou Roumi – son prénom, ô combien évocateur, signifie « Majesté de la religion » – est un mystique persan qui a profondément influencé le soufisme.
Coran 96 : Premier verset révélé au prophète de l’islam.
Dans le soufisme on considère qu’un « cheikh vivant » est un « héritier muhammadien » dans la mesure où il a pu hériter du « secret spirituel » du Prophète (appelé ainsi car il se situe au niveau de l’ineffable, de ce qu’aucun terme du langage usuel ne peut décrire) et qu’il a été lui-même « autorisé » à la fois par une source transcendante, divine, et par son propre maître qui confirme ainsi la véracité et l’authenticité d’une telle désignation.
Extrait d’un entretien personnel avec le cheikh Sidi Hamza, janvier 2013.
Historiquement, l’islam orthodoxe s’est toujours méfié du soufisme. S’il avait été un ordre retiré et dédié uniquement à la vie spirituelle et au dialogue avec le divin, à l’image des ordres monastiques chrétiens, la menace aurait été différente. Mais le soufi ne cherche pas à se retirer du monde ; au contraire, l’ancrage, la participation active aux affaires de la cité, à la vie séculière en font un acteur appelé à mettre sa quête spirituelle au service d’autrui.
Par ailleurs, le soufisme est une « école » qui repose sur une organisation extrêmement codifiée : la confrérie est dirigée par un maître et dispose de plusieurs zaouïas15, lieux de rencontre des membres ou compagnons de la confrérie. La zaouïa est administrée par un responsable, le mokadem, déjà initié. Au sein de chaque zaouïa, des compagnons sont chargés des disciples. L’enseignement dispensé s’appuie sur le Coran et les textes scripturaires. Il s’inscrit dans l’héritage revivifié d’un grand maître insufflé par un maître éducateur, le cheikh. Cette éducation spirituelle se décline selon trois grandes modalités : l’expression, l’allusion et le symbole. Selon le soufi marocain Ibn ‘Ajîba (m. 1809), « l’expression éclaire, l’allusion indique, le symbole réjouit ». Ses membres – les cheminants dans la voie ou disciples – sont astreints à des règles de vie et de conduite. Notons toutefois que le véritable soufi est l’être parvenu à un état de réalisation spirituelle totale et non celui qui aspire à cet état, simple disciple qui, à ce titre, devrait porter le nom de moutassawuf, le « cheminant sur la Voie ».
Le cheikh, maître d’éveil et médecin des âmes, initie le musulman aux principes soufis tout au long de son parcours sur la Voie. Jalâl ad-Dîn Rûmî16 (m. 1273), grand maître soufi, comparaît l’homme à « un isthme entre lumière et obscurité ». Cette image décrit une condition humaine tiraillée entre un désir narcissique et un désir d’élévation. En tant que principe d’élévation spirituelle, l’enseignement soufi repose sur l’idée que le cheminant ne peut être laissé seul ni face aux textes scripturaires, ni face à lui-même. Son initiation aux textes et au questionnement spirituel s’inscrit dans un enseignement en grande partie oral, autour d’un dialogue collectif, au sein de la confrérie. Les soufis nourrissent le dogme par une conception et une pratique intérieure de la foi, éclairée par les arts et le savoir.
À cet égard, rappelons que le premier enseignement du Coran est : « Lis [Iqra’] au nom de ton Seigneur17 », qui est une ode au savoir. Le cheikh Hamza Qadiri, grand maître soufi vivant18, a pu dire : « La civilisation islamique a connu son âge d’or illustrée par des innovations dans beaucoup de domaines, notamment scientifiques. Personne ne conteste cet apport à la civilisation universelle. Aujourd’hui, c’est l’Occident qui innove. Dieu a fait des Occidentaux, qui sont nos frères en Dieu, une clémence et une miséricorde (rahma) pour les musulmans en ce qu’ils sont à la pointe du progrès pour nous apporter des bienfaits dans le domaine de la santé, des transports, des nouvelles technologies. Saluons ces avancées et pour honorer notre passé, empressons-nous d’apporter notre contribution aux découvertes scientifiques à venir19. »
En Occident, le soufisme est souvent considéré comme un supplément d’âme, une coquetterie de l’élite, l’option contemplative, cérébrale douce et acceptable de l’islam, quand il n’est pas classé à l’extérieur de l’islam, comme un syncrétisme. On le présente aussi comme une société savante d’un caractère quasi exotique ou mystérieux. Cette image « New Age » est véhiculée par les contempteurs du soufisme. Il s’agit pour eux de discréditer et décrédibiliser la voie soufie et ses disciples.
En réalité, le parcours initiatique mène le disciple à l’élévation spirituelle par l’exigence morale et la bienveillance envers autrui, dans la volonté de construire une fraternité universelle. Abd el-Kader, soufi éminent, citait souvent cette maxime : « Il faut porter sur soi le destin d’autrui. » Tout l’enseignement soufi est centré sur la construction d’un fidèle ouvert sur les autres et sur le monde. Ce principe fonde et renforce ses rapports avec ses frères en Dieu, que ce soit à partir du compagnonnage durant l’initiation, de l’éthique consubstantielle au soufisme et, enfin, de l’adab. Ce dernier terme, intraduisible, considéré comme qualité supérieure, englobe tant la courtoisie, l’esprit chevaleresque, la bienveillance que la bonne éducation et la culture.
Le renouveau contemporain de la culture soufie : un chemin de liberté
Farîd al-Dîn Attâr est un poète mystique persan connu pour plusieurs œuvres majeures, dont La Conférence des oiseaux.
Ibn Arabî est un musulman d’origine arabe, né en Il est appelé le « Grand Maître de la spiritualité et de l’ésotérisme islamiques.
Hujwirî, Kashf al-mahjûb, Beyrouth, 1980, p. 239.
Abou Hamid al-Ghazâlî est un soufi sunnite d’origine iranienne, marqué par un mysticisme profond et possédant une formation philosophique très poussée.
Éric Geoffroy, « Al-Ghazâlî : la Voie et la Loi », Le Point Hors-Série, Paris, Novembre – Décembre 2005, 78. Du même auteur, on pourra lire sur des sujets similaires : L’islam sera spirituel ou ne sera plus, Seuil, 2009.
Les soufis célèbrent l’étude, l’art, la poésie, la musique. La poésie pour tenter d’approcher l’indicible et le chant poétique ou samâ‘, audition spirituelle pour parvenir à un état « primordial ». Ce n’est pas un hasard si les soufis ont été parmi les plus grands savants et poètes de l’islam, auteurs de monuments littéraires qui mériteraient d’être davantage connus. À titre d’exemple, on citera La Conférence des oiseaux de Attâr20 (m. 1220), le Matnawi de Jalâl ad-Dîn Rûmî ou Les Illuminations de La Mecque d’Ibn Arabî21 (m. 1240), célèbre soufi andalou, appelé aussi « le plus grand des maîtres ». L’art est ainsi mis au service de cet objectif qu’est la transformation de l’Homme.
Tous les ans, depuis vingt ans, le Festival des musiques sacrées de Fès, au Maroc, réunit les plus grands artistes du monde et accueille un public de plus en plus nombreux22. La confrérie est, osons cette comparaison, un think tank qui se reconnaît dans une lignée qui trouve son origine aux premiers temps de l’islam. « Think tank », parce que le soufisme produit de l’intelligence, de la science et de la culture. Le soufisme se veut énergie de transformation, levain de l’humanité. Le soufisme est un humanisme. Cette notion de « think tank » s’illustre chaque année autour de rencontres porteuses de sens. En effet, une fois par an, les grandes confréries soufies du monde se retrouvent, à Fès, au Festival de la culture soufie, sous la houlette du soufi marocain Faouzi Skali23. En parallèle de cet événement, des personnalités venues du monde entier, ainsi qu’un public averti, sont invités à l’agora « Une âme pour la mondialisation ». Par ailleurs, à Mostaganem, en Algérie, centre d’origine de la confrérie ‘Alâwiyya, se tiennent régulièrement des congrès. Cette année, en octobre, le Congrès international féminin pour une culture de paix avait pour thème « Parole aux femmes24 ».
Ces rencontres, qui se veulent un contrepoint aux grandes rencontres économiques, s’intéressent aux enjeux du monde contemporain. Parce que l’humanité ne peut se contenter d’être « une force qui va », les questions liées à la démocratie, à l’économie, au pouvoir, aux inégalités, à la diversité ou à l’écologie sont discutées non pas dans un discours technocratique, mais en lien avec les grandes interrogations de l’Homme. Au-delà du « comment », ces rencontres posent la question du « pourquoi » afin que le souci de la destinée humaine devienne la chose de tous. Tous s’emploient, principalement en français et en arabe, à tenter de « domestiquer » la mondialisation et à « civiliser » le temps présent.
Les soufis n’instrumentalisent pas l’islam, ne cherchent pas à pervertir son message à des fins politiques, pas plus qu’ils ne cherchent à imposer une voie plutôt qu’une autre pour dialoguer avec Dieu. « Le soufisme, c’est la liberté25. » Liberté dans le dialogue avec le divin et, surtout, liberté dans le rapport à l’autre. Si le dogme demeure toujours important, il devient un élément pouvant être dépassé au profit de la spiritualité. L’islam légalitaire, attaché au dogme, a toujours reproché au soufisme cette prétention, assimilée à une forme d’impiété. L’autre grande critique de l’orthodoxie islamique porte sur le culte des saints, particularité de l’islam soufi, et sur la dimension pour partie contemplative prônée par la voie soufie. Cette quête spirituelle est dénoncée comme un travers narcissique, voire la recherche égoïste du salut personnel, tandis que, de leur point de vue, les soufis dénoncent, notamment dans leur poésie, les dangers d’une foi réduite au dogme, asséché par une pratique austère et pointilliste. Ces critiques ne sont pas nouvelles. La tentation de certaines doctrines de l’islam à préférer le juridisme à la spiritualité est ancienne, tout comme la volonté de combattre le soufisme qui refusait ces dérives. Comme le rappelle Éric Geoffroy, « à un moment où le juridisme était en train d’envahir le champ de l’islam, Ghazâlî26 (m. 1111) a rappelé la hiérarchie des valeurs au sein de l’islam ; des siècles avant l’apparition des fondamentalismes modernes, il a souligné que cette religion avait avant tout une vocation spirituelle27 ».
La femme égale de l’homme en dignité spirituelle
Malek Jân est issue d’une famille de l’ordre mystique des Ahl-e Haqq (« Amis de la vérité »). Elle fut une poétesse de langue kurde et persane, connue sous le nom de cheikh Jâni ou Malek Jân Ne’mati.
Râbi‘a al-‘Adawiyya fut une mystique soufie, auteur de nombreux poèmes.
Considérée comme une sainte, Sayyida Nafîsa fut une grande théologienne, spécialiste du droit canon aussi bien ésotérique qu’exotérique.
Nur Artiran est présidente de la fondation Mevlevie.
Prix Nobel de littérature en 2007, Doris Lessing est une écrivaine britannique dont l’œuvre très riche aborde notamment les questions du conflit culturel, des antagonismes entre l’individualisme croissant et le bien commun.
Think tank musulman, école de « l’honnête homme », et éventuelle force de mobilisation, le soufisme est le premier adversaire de l’islam radical. Il en est un adversaire redoutable, idéologiquement, parce qu’il a su, dans son histoire, inscrire la femme comme l’égale de l’homme, les deux étant des « fils et filles de l’instant ». Ibn Arabî affirme que la « virilité » spirituelle n’est pas liée à la condition humaine biologique. Les femmes ont accès à la perfection spirituelle et donc à tous les degrés de sainteté, y compris celui de qutb (« pôle »), qui désigne le plus haut niveau de la spiritualité islamique. C’est dans ce monde, ici-bas, que le soufi est appelé à accomplir le bien. « La vie n’est pas courte mais le temps nous est compté » rappelle ainsi Malek Jân Ne’mati28 (m. 1993), sainte soufie du Kurdistan iranien (dont le mausolée se situe… dans le Perche !). Selon elle, il convient d’agir pour que l’urgence de vivre ne se transforme pas en action précipitée et irréfléchie ; le temps de la contemplation et de la méditation est le temps nécessaire à l’action juste et bienveillante.
La place des femmes et leur enseignement dans l’héritage et l’initiation soufis témoignent d’une modernité trop souvent passée sous silence. À titre d’exemple, on peut citer, Râbi‘a al-‘Adawiyya29 (m.801), appelée « la mère du Bien », sainte de l’islam et figure par excellence de l’amour divin ; citons aussi Sayyida Nafîsa30 (m. 823), toujours vénérée, considérée comme experte en droit canon. Aujourd’hui aussi, les femmes jouent un rôle important au sein du soufisme : ainsi, Nur Artiran31, d’origine turque, a reçu l’autorisation d’enseigner le Metnavi, héritage spirituel de la confrérie du grand maître Rûmi. Elle est actuellement maître de la confrérie Mevlevi. Je manquerais à tous mes devoirs si je ne rendais pas un hommage appuyé à Eva de Vitray-Meyerovitch qui, élevée dans la tradition catholique, a épousé un juif, et qui par la suite a embrassé l’islam à partir du soufisme. Grâce à ses traductions de grands textes de la littérature arabe et persane, elle a permis l’accès à leur propre culture d’un certain nombre de musulmans de France dont je suis. Doris Lessing32 (m. 2013), prix Nobel de littérature, et pour laquelle « il n’y a jamais nulle part où aller qu’en dedans », mérite également d’être signalée pour son long compagnonnage avec les soufis. Évoquer ces quelques femmes parmi tant d’autres, c’est rappeler que le soufisme ne se conçoit pas comme l’acceptation de l’infériorité de la femme. Ainsi les femmes ont pu proposer des voies de sagesse et être suivies et admirées.
Le soufisme : un engagement séculier stimulé par la spiritualité
Yathrib est le nom historique de Médine. Ce pacte de paix définit les droits et les devoirs des musulmans, des juifs et des autres communautés arabes tribales de Médine au cours de la guerre qui les opposa aux Koraïchites.
La confrérie Quâdiriyya Boutchichiyya a été créée par Abd al Qadir al-Jilani au XIIe siècle. La branche Boutchich est apparue au milieu du XVIIIe siècle, dans le nord-est du Maroc.
Le cheikh Yassine, fondateur et chef du mouvement islamiste marocain Al Adl Wal Ihsane, avait ainsi prôné, durant la campagne, la destitution du roi alors « Commandeur des croyants » et l’instauration d’un califat.
Le prophète Mohammed est considéré par les musulmans comme le messager de la parole divine, il fut aussi l’organisateur et l’administrateur de la cité de Médine. Le Prophète a dirigé Médine dans le consensus (ijmâ‘) pour en faire une cité harmonieuse et stable. Il élabora la Constitution de Médine, dite aussi charte de Yathrib, qui, en soixante-trois articles, visait à organiser la vie commune entre les différentes communautés. Il s’agissait à l’époque des communautés religieuses33.
Les soufis s’inscrivent dans l’héritage de l’exemple mohammadien. Contrairement à une vision radicale, le soufisme n’enferme pas le cheminant, il le libère des images erronées pour lui proposer une foi plus élevée. Le soufisme est une école de vie, une formation à une existence faite de pensées mais aussi d’actions. Le soufi est homme de la Cité par-dessus tout, son enseignement lui assurant la transmission des valeurs morales essentielles et l’exemplarité dans le comportement.
Dès lors, pour approcher la définition du soufisme, il ne suffit pas de dire que c’est une mystique initiatique ; ni que c’est un humanisme ; et, au-delà de la praxis, il faut ajouter que c’est aussi un engagement civique.
Cette affirmation peut être étayée par un épisode assez récent dans le monde musulman. Au Maroc, le guide de la confrérie Qâdiriyya Boutchitchya34, cheikh Hamza, rompant avec la tradition de discrétion propre aux confréries, a appelé les disciples de la Voie à manifester et à voter en faveur de la nouvelle Constitution. Le référendum constitutionnel de juillet 2011 visait à inscrire l’égalité civique entre les hommes et les femmes, et à reconnaître, entre autres, la judéité du Maroc. L’enjeu de cette consultation n’était pas tant l’issue du scrutin, mais le taux de participation à la manifestation et à l’élection. En effet, les mouvements liés à l’islam radical avaient appelé au boycott des élections. La confrérie a pu alors démontrer, y compris dans la rue, l’étendue de son influence et sa capacité de mobilisation, notamment face aux tenants du radicalisme35.
Fils et filles de leur temps : quelques grandes figures du soufisme
Cheikh Bentounes, cit., p. 52.
Cité par Bruno Étienne, in Abdelkader, Hachette, « Pluriel », 2012.
Extrait d’une lettre du maréchal Bugeaud au comte Molé datée de 1837, citée par François Maspero, in L’Honneur de Saint-Arnaud, Seuil, 1995, p. 92.
Abd-el-Kader, Lettre aux Français, Phoebus, « Libretto », Paris, 2007.
La confrérie Rahmaniya est une confrérie soufie fondée en 1774 par Sidi M’hamed Bou Qobrine en Algérie. À l’origine, cette confrérie, qui se nommait Khalwatiya, connut une forte audience jusqu’au XIXe siècle, réussissant à s’implanter solidement en Afrique du Nord.
Olivier Weber, La Confession de Massoud, Flammarion, Paris, 2013.
Le cheikh Bentounès rappelle à juste titre que « lorsque le monde musulman traverse une crise grave, il finit toujours par faire appel aux soufis. Leur présence assure un retour aux sources, une stabilité et une ouverture. Quelle que soit l’époque, chaque maître est un revivificateur de l’essentiel du message prophétique36 ».
L’enseignement soufi vise à permettre à l’Homme d’agir en homme de pensée, et de penser en homme d’action. Plusieurs grandes personnalités du monde islamique illustrent cette assertion : à titre d’exemple, l’émir Abd el-Kader ; une femme, Lalla Fadhma N’Soumer ; Mohammad Iqbal ; et, plus près de nous, le commandant Massoud. Toutes ces personnalités incarnent l’éthique soufie.
L’émir Abd el-Kader organisa la résistance des tribus arabes et berbères contre la colonisation française en Algérie. À ce titre, il est considéré comme la première icône nationale algérienne. Grande figure soufie, il s’est fortement impliqué dans les affaires de la cité sans jamais oublier l’enseignement de la confrérie. Poète et philosophe, auteur de nombreux ouvrages, il sut prendre les armes contre les Français quand il estima nécessaire de se battre aux côtés des siens. Au nom de sa foi musulmane, il a protégé et sauvé plusieurs milliers de chrétiens de Damas menacés de mort ; des hommes avec qui l’émir n’avait pas grand-chose en commun sauf l’essentiel : leur humanité. S’il y a un droit musulman, pour l’émir Abd el-Kader « il y a un droit de l’humanité au-dessus du droit musulman37 ». C’est dans ce même esprit que de nombreuses personnalités musulmanes ont lancé, dès janvier 2011, un appel pour sensibiliser l’opinion au sort des chrétiens d’Orient38, bien avant que les grands médias s’en saisissent.
Les principes soufis ont guidé l’action de l’émir Abd el Kader, lui qui imposa une charte de traitement humain aux Français qu’il avait fait prisonniers. C’est d’ailleurs cette charte qui préfigurera la Convention de Genève sur les prisonniers. Il respecta toujours la parole donnée, autre exigence des soufis, lui valant l’estime des généraux français. Citons ainsi le maréchal Bugeaud : « Cet homme de génie que l’histoire doit placer à côté de Jugurtha est pâle et ressemble assez au portrait qu’on a souvent donné de Jésus-Christ39. » À la suite de sa détention au château d’Amboise, l’émir Abd el-Kader écrira un texte magistral, intitulé Lettre aux Français40. Pas un mot de reproche sur le mauvais comportement de nombre de ses interlocuteurs, notamment ceux qui n’avaient pas respecté le pacte signé. Bien au contraire, il y prendra de la hauteur pour porter un autre regard sur l’incompréhension entre l’Orient et l’Occident, et mettre en garde ses contemporains contre les risques de rupture du dialogue et de l’enfermement dans des certitudes. N’est-ce pas ce à quoi on a abouti aujourd’hui ?
Lalla Fadhma N’Soumer (m. 1863) est encore aujourd’hui une femme célébrée comme une figure de la résistance algérienne. D’une longue lignée soufie, membre de la confrérie Rahmaniya41, elle se consacre à la méditation. Elle prend également part à la vie de la cité et organise, dans les années 1850, l’insurrection en Kabylie pour lutter contre les troupes françaises. Elle fit subir de lourdes pertes au maréchal Randon, qui la surnomma « la Jeanne d’Arc du Djurjura ». Son autorité morale et sa conscience politique précoce lui ont assuré le soutien de nombreux habitants et la constitution d’une troupe de fidèles. Elle est finalement capturée par les Français et meurt en détention à l’âge de 33 ans. Son statut de femme n’a nullement entravé la capacité d’action de Lalla Fahdma N’Soumeur qui prit la tête d’un mouvement de lutte. Elle a été respectée tant par ses compagnons pour son haut niveau de spiritualité que par ses adversaires pour son art de la guerre. En signe d’hommage, sa dépouille a été transférée, tout comme celle de l’émir Abd el-Kader, au carré des martyrs du cimetière d’El Alia, à Alger. Le commandant Massoud (m. 2001), le moine soldat, est un soufi de la confrérie Naqshbandiyya. Il organisa la résistance afghane contre les Soviétiques, puis contre les talibans. Sa combativité exceptionnelle lui valut le surnom de « lion du Panshir » après sa résistance à plusieurs attaques successives des Soviétiques. Opposé aux talibans, il incarnait la continuité de la présence de l’islam spirituel en Afghanistan42.
Mohammad Iqbal : une pensée soufie à la lumière de l’Occident
Mohammad Iqbal, Reconstruire la pensée religieuse de l’islam, Éditions du Rocher, 1996.
K.G. Saiyidan, Un grand poète indien : Iqbal, conférence donnée à l’Institut des langues orientales, Unesco, 1971, p. 10.
Mohammed Iqbal, Le Livre de l’éternité, cité par Abdennour Bidar, in L’Islam face à la mort de Actualité de Mohammed Iqbal, François Bourin, 2010, p. 36.
Ibid.
« Le Coran est un livre ouvert à bien des lectures », interview de Souleymane Bachir Diagne, 8 juillet 2010, site Oumma.com.
Abdelwahab Meddeb, « Le soufisme, un recours face au désastre », Le Monde, 8 octobre 2014.
Mohammad Iqbal (m. 1938), grand poète, philosophe auteur de Reconstruire la pensée religieuse de l’islam43, est considéré comme le père du Pakistan moderne. Il a aussi étudié en Europe et a été nourri par son enseignement soufi mais aussi par de grands philosophes occidentaux, dont Henri Bergson. Ces quelques vers illustrent son attachement aux principes de la Voie :
« Vous avez créé la nuit, moi, j’ai fait la lampe pour l’éclairer Vous avez créé la terre, moi, j’en ai façonné de belles coupes. Vous avez créé les déserts, les montagnes et les plaines arides Moi, j’ai créé de riches vergers, des bosquets, des jardins, C’est moi qui ai tiré le verre de la pierre,
C’est moi qui ai extrait du poison l’élixir précieux »44.
Dans ces vers, Mohammad Iqbal reconnaît la primauté et la prééminence de Dieu dans la création. Néanmoins, il insiste sur la capacité de l’homme à s’adapter à tout contexte, à ne pas être prisonnier d’une « fatalité divine ». À chaque création de Dieu répond une adaptation de l’homme. L’homme se pose donc en être doué de raison capable d’agir sur le monde. Il s’agit d’un hymne de l’homme à la liberté, mais aussi un refus de l’orgueil d’une société qui a cru avoir oublié la transcendance. Nous sommes appelés, écrit-il, à prendre conscience que loge au fond de nous « un ego infini ». Comme le rapporte Abdennour Bidar, selon Iqbal, la finalité ultime de la religion dans l’histoire de l’humanité est de révéler l’homme à lui-même45.
Deux autres célèbres énoncés d’Iqbal permettent de mieux cerner sa pensée : « Attache ton cœur de façon nouvelle aux versets évidents si tu veux saisir au lasso l’époque nouvelle » et « Si tu possèdes un cœur de musulman, examine ta propre conscience et le Coran, ses versets contiennent cent mondes nouveaux, ses âges sont enroulés dans chacun de ses instants ! L’un de ces mondes est l’époque actuelle : comprends-le, si ton cœur est capable de saisir cette signification46. » L’inscription du fidèle dans son époque est un enseignement majeur du soufisme, rappelle ainsi Mohammad Iqbal.
La tradition ne doit pas enfermer, le texte sacré ne doit pas être perçu comme un frein à la modernité au nom d’une prétendue lecture des origines. Le Coran contient les éléments de sa propre modernité pour inscrire la foi dans les évolutions du monde. Le soufi n’a pas une lecture littéraliste des textes ; au contraire, la lecture ésotérique, celle qui s’affranchit du premier degré, permet de vivre et d’appréhender le présent et d’accompagner le changement dans le respect des principes de la religion.
Dès lors, la critique du soufisme comme contemplation narcissique est singulièrement fausse. Et, à cet égard, ces quelques exemples témoignent de l’implication des soufis dans la gestion des affaires de la cité, notamment durant les périodes de guerre et de doute. Et, on pourrait en citer beaucoup d’autres qui ont marqué leur époque par une vision émancipatrice des peuples. La particularité commune à ces personnalités reste principalement la lutte contre l’occupation coloniale, ainsi que l’affirmation de leur islamité et, au-delà, de leur spiritualité. Ils nous apprennent surtout « à penser un fatalisme actif, d’homme et de femme d’action, qui n’a rien à voir avec l’attitude de soumission à ce qui est prédéterminé47». [Le maktoub que l’on prête généralement aux musulmans.] Les récentes rencontres soufies témoignent d’une intense réflexion chez les cheminants, qui va de la spiritualité soufie aux grands enjeux contemporains. Il est intéressant de noter que certains dirigeants des pays arabes n’hésitent plus à reconnaître l’apport des confréries soufies au monde musulman, tant dans le passé que dans les tourments du présent.
Les cheminants soufis ont appris à articuler la citoyenneté – et ses exigences en termes de droits et de devoirs – à leur foi, leur tradition à la modernité. Alors que les tenants de l’islam radical s’évertuent à dénoncer la citoyenneté comme une « perversion occidentale », les soufis, à l’instar de la grande majorité des musulmans de France, sont dans l’expression d’une foi sécularisée. C’est par l’exercice de leur citoyenneté qu’ils peuvent combattre l’opprobre qui s’est abattu sur l’ensemble des musulmans et faire reculer le radicalisme.
Abdelwahab Meddeb (m. 2014) fait des soufis un recours face au désastre, mais rappelle qu’« on ne les trouve que si on les cherche ». Leur discrétion, propre à leur éthique, doit-elle perdurer en temps de chaos ? Pour Meddeb, comme pour d’autres, « ils nous doivent d’être plus voyants. Ils ont, plus que d’autres, droit de cité en ces temps de malheur48 ».
Le soufisme est bien l’angle mort du discours sur l’islam. Cette ignorance est préjudiciable tant aux musulmans qu’à la société dans son ensemble. Il est vrai que le contexte historique français forme un « terrain géologique » particulièrement « sismique ». Sans remonter à Charles Martel, notre histoire contemporaine s’est nouée autour de la loi de séparation des Églises et de l’État, de Vichy et de la collaboration, et plus récemment d’une histoire coloniale encore vivace. Dans l’Hexagone, plus que dans tout autre pays européen, l’islam est un sujet incandescent provoquant une nouvelle « fièvre obsidionale ».
La république serait-elle à l’épreuve de l’islam ?
L’islam, en tant que religion, n’avait jamais été un sujet de préoccupation en France, même au plus fort de la guerre d’Algérie, alors qu’il aurait pu servir de dénominateur commun aux Algériens vivant en France et, au-delà, à la communauté musulmane au titre de la solidarité avec la Umma (communauté des croyants). L’islam vécu et pratiqué en France depuis la fin du XIXe siècle jusque dans les années 1970 n’avait jamais posé de problèmes particuliers, les musulmans pratiquant leur foi sans ostentation, ni revendication particulière.
Mais, avec la chute du mur de Berlin, l’Occident ayant perdu son adversaire traditionnel, il fallait bien lui trouver un ennemi de substitution. C’est ainsi que le « péril vert », incarné par la révolution islamique de 1979 en Iran, a remplacé le péril rouge. C’est le début d’un autre regard sur l’islam, différent et ouvertement hostile.
L’exemple algérien : de l’affaiblissement des zaouïas à l’émergence du radicalisme
À ce stade, cette hypothèse reste à valider par la recherche en sciences sociales.
Interview de Mohamed Aïssa, El Watan, 17 septembre 2014.
Abdelwahab Meddeb, « Sortir l’islam de l’islamisme », Le Monde, 16 décembre 2012.
Amin Maalouf, Les Identités meurtrières, Grasset, 1998, p. 86.
Depuis quelques années déjà, un monstre couvait dans le monde arabo- musulman. L’Algérie est, de ce point de vue, un bon exemple. À cet égard, je me risquerai à formuler une hypothèse : la disparition des zaouïas d’élévation spirituelle, en Algérie, au moment de l’indépendance, au profit d’un système politique dit du « socialisme spécifique », a déstructuré la vie sociale et favorisé l’émergence d’un islam radical49. La « volonté » de démocratisation du pouvoir s’est finalement heurtée aux développements dans la société du Front islamique du salut (FIS) qui prônait l’instauration d’un État islamique. En 1990, la campagne électorale du FIS, fondée sur un discours social, lui a permis de mettre en œuvre différents programmes de bienfaisance et ensuite de remporter l’essentiel des municipalités. Aux législatives suivantes, à l’issue du premier tour, le FIS aurait obtenu en projection 82 % des sièges si l’armée n’avait exigé l’interruption du processus électoral. Cette décision déclencha la « décennie noire » qui fit plusieurs milliers de victimes. Il aura fallu l’attentat du RER en gare Saint-Michel à Paris en 1995 et l’assassinat l’année suivante des moines de Tibhirine pour que la France et le reste du monde réalisent que les événements algériens n’étaient pas qu’une « affaire interne ».
Aujourd’hui, il y a en Algérie une prise de conscience. Mohamed Aïssa, actuel ministre des Affaires religieuses, a dernièrement rappelé que le soufisme fait partie de l’héritage religieux de l’Algérie. Regrettant que le pays, « qui appartient à une civilisation jaillie de Cordoue », se soit « retrouvé dans une pratique bédouine de la religion », il souhaite « réconcilier les Algériens avec l’islam authentique50 ». C’est corroborer l’idée que l’affaiblissement des zaouias d’élévation spirituelle a laissé la place à un islam importé, rigoriste, qui n’a rien à voir avec la pratique habituelle de l’islam en Algérie et au Maghreb. Les Maghrébins représentant la plus grande partie de l’immigration en France.
La référence du ministre algérien des Affaires religieuses à la « pratique bédouine » de la religion est un euphémisme pour désigner le wahhabisme, forme rigoriste et austère de l’islam sunnite basée sur des commandements négatifs. Tout ce qui peut distraire l’homme de son rapport à Dieu est impie. À l’opposé des soufis, ils honnissent le culte des saints. Ces vingt dernières années, ils ont détruit un nombre incalculable de lieux tant sacrés que patrimoniaux. De la destruction des bouddhas de Bâmiyân par les talibans en 2001 à celle des mausolées des saints au Mali en 2013 au nom du péché d’idolâtrie, la même inspiration est à l’œuvre. Pour Abdelwahab Meddeb,
« si la maladie de l’islam est antérieure au wahhabisme, cette doctrine l’a fortement accentuée en tissant sa toile grâce aux pétrodollars dans le monde musulman » ajoutant qu’« il est nécessaire de défendre nos pays contre la déferlante wahhabite salafiste. Celle-ci est en train de transformer l’islam et de conduire ses peuples vers le pire, vers la régression, l’obscurantisme, la fermeture et le fanatisme51 ».
Le développement de l’islam radical est corrélé à la « qualité » de la gouvernance des pays arabo-musulmans. Dans bien des cas, les dirigeants ont laissé en jachère leur nation, tant du point de vue social, économique que culturel. En Algérie, comme dans bon nombre de pays musulmans, « ce sont les nationalistes et non les islamistes qui ont mené leurs pays à l’indépendance ; le radicalisme religieux a été la dernière réponse quand toutes les autres voies ont été bouchées, il n’a pas été un choix spontané, naturel, immédiat des Arabes ou des Musulmans52 ». Ce qui veut bien dire que l’instrumentalisation de la religion n’a jamais été une première option et que l’origine du désastre actuel est à mettre aussi au passif des dirigeants des pays arabes. Il ne faut toutefois pas oublier que ces pays ont accédé à l’indépendance il y a quelques décennies, et que la mise en œuvre d’un débat tant philosophique que sociétal n’a pas fait partie de leur priorité. Les « printemps arabes », encore à l’œuvre, ont mis en mouvement les sociétés arabo-musulmanes. Les dernières évolutions tunisiennes prêchent pour un peu d’optimisme, mais il est bien trop tôt pour se prononcer et établir un bilan.
Pour l’heure, les opinions occidentales, traumatisées par les attentats du 11-Septembre, les suivants et les monstruosités de Daesh, sont habitées par l’idée que l’islam est une idéologie à combattre. Les terroristes sont parvenus à dévoyer l’islam et à occulter sa dimension spirituelle. Ces bouleversements, ainsi que la centralité du conflit israélo-palestinien, auraient-ils pu être sans conséquences en France, où vivent plusieurs millions de musulmans ?
Atteints par le chômage – notamment celui des jeunes –, par la précarité, la ghettoïsation et, plus généralement, les discriminations, les enfants des travailleurs venus « balayer la France » et occuper les emplois que les Français refusaient pendant la période coloniale et postcoloniale sont le nouveau « lumpenprolétariat » et incarneraient pour certains non plus les classes populaires mais les « classes dangereuses ».
L’islamophobie : ce nouveau racisme
« Musulmans » : l’usage de ce terme, a fortiori décliné en millions, dérange dans un pays qui refuse, au nom de la laïcité, de mettre l’accent sur l’origine ou la confession. Mais comment appeler ces enfants ? Petits-enfants d’immigrés, nés en France, pour beaucoup de parents français, et tour à tour désignés, au gré des circonstances et des opportunités comme des « beurs », des « issus de », puis des « jeunes des quartiers », de « sauvageons » et enfin de « racailles » quand ils vivent en banlieue, ou des représentants de la diversité ou de la « beurgoisie » pour les diplômés vivant dans les beaux quartiers. Ils n’ont, en dépit de leur revendication d’égalité, jamais obtenu le droit d’être considérés comme des Français à part entière. L’islam est devenu pour une partie d’entre eux une identité de repli, une cuirasse et une armure. Dans un phénomène classique de « retournement du stigmate », nombreux sont ceux qui brandissent l’islam comme un bras d’honneur.
Pendant ce temps, les essayistes dialoguent par voie de presse pour savoir si, oui ou non, le terme d’« islamophobie » est pertinent pour décrire la violence symbolique, et parfois physique, dont sont victimes ceux qui « réellement » ou « supposément » seraient musulmans. Sur ce point sémantique précis, il est utile de rappeler que l’usage du terme « islamophobie » a été discrédité, pour vice de forme, par certains intellectuels français, parce qu’il aurait été « inventé » par l’ayatollah Khomeyni. En réalité, c’est l’administration coloniale française qui, au début du XXe siècle, l’avait forgé. Dans son rapport de 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme revient longuement sur l’usage de cette notion, pour finalement lui reconnaître sa validité : « Le racisme a subi un profond changement de paradigme dans les années postcoloniales, avec un glissement d’un racisme biologique vers un racisme culturel53. »
Le détournement des valeurs de l’islam et la falsification de son message par des nébuleuses extrémistes et fondamentalistes ont cristallisé les peurs et donné lieu à une réaction de rejet de nature islamophobe. Devant l’ampleur du phénomène, qu’au lieu de circonscrire on a laissé se développer par négligence ou par malveillance, les musulmans sont en droit d’attendre de l’empathie de la part de la classe politique et de l’ensemble des intellectuels, et une dénonciation très nette du danger. Au lieu de quoi on assiste à une véritable surenchère dans les propos et les postures islamophobes, particulièrement dans les médias. Comment faire, dès lors, pour rappeler que l’islamophobie n’est ni un avis, ni une opinion, mais bel et bien un délit au même titre que d’autres propos racistes ou antisémites, lesquels sont heureusement punis par la loi. On en arrive à se demander pour quelle raison la France, pays des droits de l’homme, donnerait l’impression de moduler son indignation selon les racismes et les opportunités géopolitiques de l’heure.
Ce doute est d’autant plus légitime qu’on assiste sans réagir à la banalisation d’actes et de discours notoirement islamophobes, sans procéder à une clarification ou à un recadrage afin de ne pas laisser s’installer durablement dans l’opinion de la très grande majorité de nos concitoyens musulmans un sentiment de marginalisation qui ne pourrait que profiter à tous les extrêmes. Méfions-nous d’une banalisation de faits notoirement islamophobes et de l’absence de réaction, car certains faits sont encore dans les mémoires et forment une chaîne qui devrait nous inquiéter :
- le livre Aristote au Mont Saint-Michel de Sylvain Gouguenheim qui, en niant l’apport du monde arabo-musulman à la science, développe une forme d’islamophobie savante ;
- le discours de Ratisbonne de Benoît XVI sur l’islam où le Saint-Père, en reprenant une citation d’un empereur byzantin, a ouvert la voie à ce qui aurait pu s’apparenter à une islamophobie religieuse, controverse fort heureusement rattrapée par la suite par la visite à la mosquée Bleue d’Istanbul et ses propos sur le dialogue interreligieux ;
- une islamophobie politique : les propos récurrents de Jean-Marie le Pen qui visent en permanence l’immigration, notamment ses récents propos sur « la déportation » rapportée comme une possibilité à ne pas exclure ;
- une islamophobie intellectuelle : le concept de « grand remplacement » élaboré par Renaud Camus, cette idée raciste qui se propage, ainsi que la fixation pathologique d’Alain Finkielkraut, philosophe en mal d’identité, sur l’islam des cités ;
- une islamophobie médiatique : les propos distillés à longueur d’antenne par le télépolémiste Éric Zemmour, construisant ainsi un « marketing de la haine », avec notamment ses récents propos sur « la déportation » rapportée comme une possibilité à ne pas exclure ;
- une islamophobie littéraire : Soumission, le livre de Michel Houellebecq, qui reste une fiction, certes, mais qui surfe sur les peurs de l’islam et des musulmans.
Prenons garde à cette apathie généralisée car, comme le disait saint Augustin : « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. »
C’est à ce titre qu’il faut saluer l’ouvrage courageux d’Edwy Plenel intitulé Pour les musulmans54. Pour la première fois, une grande signature de l’intelligentsia, non suspecte de communautarisme, alerte la communauté nationale en apportant son concours au combat contre l’islamophobie. Cette évolution majeure est en elle-même un événement sinon déjà une victoire.
Les discriminations : un dérivé de l’islamophobie
François Dubet, Olivier Cousin, Éric Macé et Sandrine Rui, Pourquoi moi ? L’expérience des discriminations, Seuil, 2013, p. 79.
Bariza Khiari, « Quel modèle républicain ? », Quelle France dans 10 ans ?, rapport d’information n°246 (2013-2014) fait au nom du groupe de travail du Sénat, déposé le 18 décembre 2013, p. 157-167.
Malek Chebel, Manifeste pour un islam des Lumières, Hachette Littératures, 2004, p. 60.
Si la promesse républicaine est l’égalité, force est de constater que cette dernière est aujourd’hui mise à mal par les nombreuses discriminations dont sont victimes certaines personnes en raison de leur origine ou de leur religion. En l’espace de quelques décennies, « les immigrés » sont devenus « les musulmans ». Mais, bercées à la promesse républicaine, « méritocratique et indifférente aux races et aux religions », ces populations ont fait valoir leurs attentes d’égalité à l’occasion de la Marche pour l’égalité de 1983. Ce fut leur « Marche des dupes » : cet événement, rebaptisé par les médias et les partis politiques en « Marche des beurs », a été détourné de son objectif politique. En renvoyant les marcheurs à une identité héritée et stigmatisée, les grands acteurs politiques ont démonétisé le message qu’ils portaient : l’égalité. C’est ainsi que des revendications républicaines d’égalité, à chaque fois insatisfaites, ont cédé la place à des revendications particularistes, nourries de la frustration d’être considérés comme des citoyens de seconde zone.
Les discriminations identifiées comme « des morts sociales » sont en effet des atteintes à l’idéal républicain, en même temps qu’elles renvoient les personnes visées à une identité stigmatisée. Le combat contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité passe par une lutte sans merci contre l’islamophobie et tous les racismes. Ce travail, parce qu’il participe de la lutte contre les préjugés et les stéréotypes, agit par voie de conséquence sur les discriminations.
L’expérience massive et continue de la discrimination vécue par les citoyens français issus de l’immigration et en grande partie musulmans demeure largement sous-estimée et parfois même disqualifiée. Cette minimisation tient à la singularité de cette expérience, balisée par « la certitude d’être discriminable et l’incertitude d’être discriminé55 ».
Il est difficile, en effet, dans l’expérience de la stigmatisation, de distinguer ce qui relève du racisme, de la discrimination, de l’inégalité de traitement ou de l’injustice. C’est cette confusion, aussi bien phénoménologique que conceptuelle, qui paralyse l’arsenal législatif et réglementaire destiné à combattre les discriminations. Et c’est cette même confusion qui autorise certains à ne pas reconnaître la discrimination, à lui nier toute dimension politique en la réduisant à de la simple subjectivité, voire à une pathologie paranoïaque. Cette maltraitance provient non seulement des discriminations, mais aussi de la disqualification symbolique de cette expérience désignée comme une vulgaire opération de victimisation.
Les élites politiques et administratives, dans un déni de réalité, ont toutes les difficultés à percevoir l’écart entre deux siècles d’idée républicaine et les faits objectifs : il suffit encore pour certains de réciter l’article premier de notre Constitution comme « solde de tout compte ». Convient-il de rappeler que l’idée républicaine était une réaction à la « cascade des mépris » qui organisait la société de l’Ancien Régime ? Le mépris contemporain n’est plus seulement vertical ; il est cynique, diffus, sournois, anonyme et parfois même institutionnalisé56.
Ce qui fait dire à l’anthropologue Malek Chebel : « Le sentiment d’appartenance à l’islam progresse à mesure que la justice sociale régresse, ce qui conduit à une substitution de la foi à la loi57. » Si effectivement ce combat n’est pas mené avec détermination, c’est dans le repli sur soi et sur des références mythifiées que certains trouveront refuge, avec l’inévitable risque de dérive vers le radicalisme.
La lutte contre le radicalisme religieux appelle des réponses multiples. La première d’entre elles, la plus urgente et la plus indispensable, est bien évidemment l’école. L’Éducation nationale, pourtant en première ligne pour mesurer les fractures françaises, n’a pas encore mesuré les conséquences de la concurrence que lui livrent les nouvelles technologies de l’information. Elle n’a plus le monopole de la transmission des savoirs. Il est nécessaire qu’elle réinvente sa légitimité pour combattre le « dumping cérébral ».
La centralité de l’école dans la fabrique d’un citoyen « éclairé ».
L’école a largement contribué à la légitimation de l’idée républicaine et à la création d’un sentiment d’allégeance nationale, via notamment l’imposition du français comme langue unique d’enseignement sur tout le territoire. Cette homogénéisation de la langue de l’enseignement est constitutive de la construction républicaine et moderne de la France.
Ce processus historique et politique est achevé : le français est la langue commune, le pouvoir politique s’est émancipé du religieux, la laïcité est revendiquée comme un patrimoine commun. Pourtant, les crispations se multiplient. Il est temps de réassigner à l’école une ambition d’éducation élargie, en fidélité avec l’esprit de la célèbre Lettre aux instituteurs de Jules Ferry. Il faut que l’école réinvestisse une mission éducative, prenant appui sur ses missions d’enseignement.
Si l’on veut bien accepter le fait que la France du XXIe siècle est une France métissée, aux identités multiples, cela implique, pour l’école, non plus de les ignorer, ni même de les reconnaître, mais de les inscrire pleinement et objectivement dans l’histoire nationale et pas seulement en note infrapaginale. Seule l’école possède la force, l’organisation et la légitimité pour mener à bien cette fabrique du citoyen, de conquérir, jour après jour, par une succession de petites victoires sur l’ignorance et les préjugés, non pas les cœurs, mais les esprits.
Cette mission éducative pourrait notamment se déployer suivant trois nouveaux axes, qu’il faudra articuler pour redonner à la laïcité un contenu qui fasse sens :
- évaluer et revoir l’enseignement du fait religieux afin d’outiller des esprits capables de reconnaître autrui, quels que soient son sexe, sa couleur ou sa religion, comme un semblable en dignité ;
- aborder la colonisation et la décolonisation du point de vue d’une « histoire partagée » afin de permettre à chacun de comprendre dans sa complexité la construction nationale et d’apaiser les tensions que cette histoire encore récente est susceptible de créer ;
- intégrer au plus tôt la question de l’usage des technologies de l’information dans l’enseignement, afin notamment d’inculquer aux élèves la distance critique nécessaire face aux contenus accessibles en ligne, mais aussi de les sensibiliser dès le plus jeune âge au bon usage de la parole sur Internet.
Bien que principe organisateur de notre société, la laïcité est pourtant source de confusion ; certains l’assimilent à l’athéisme, d’autres à de la simple neutralité. Aussi la pédagogie de la laïcité doit-elle également s’adresser à l’ensemble de nos concitoyens.
Une indispensable pédagogie de la laïcité
La grande faute politique des républicains est d’avoir laissé, sans combattre, le Front national opérer un rapt sur la laïcité et transformer cette valeur en instrument d’hostilité contre une partie de la population. Si la République ne reconnaît aucun culte, elle se doit de protéger l’exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi. Telle est une des dimensions de la laïcité.
À force de « tordre » la notion de laïcité, certains en sont venus à considérer la foi comme étant le contraire de l’émancipation. Or la laïcité a été conceptuellement définie comme un espace politique de concorde permettant de vivre ensemble au-delà des différences, dans la liberté de croire ou de ne pas croire : la laïcité ne vise pas à éradiquer la foi du cœur des hommes, mais à rendre à « César ce qui lui appartient ».
L’inscription dans une tradition, une culture, parce qu’elle participe de l’estime de soi, de la construction personnelle peut aussi avoir une portée émancipatrice majeure. À cet égard, la fierté, le sentiment de dignité ont aussi une dimension collective. La désinstrumentalisation de l’islam, et de la religion en général, implique par ailleurs de reconnaître le rôle de la foi et sa participation à la construction personnelle. L’appartenance à l’islam serait-elle contraire à l’allégeance citoyenne ? Non, il suffit d’observer la forte implication des musulmans de France dans les corps intermédiaires – associations, syndicats, partis politiques… – et d’avoir à l’esprit la mort de soldats musulmans, que ce soit au Mali, en Afghanistan ou sur tous les théâtres d’opérations de nos forces armées, pour reconnaître leur volonté de s’impliquer dans la vie citoyenne à tous les niveaux.
La faiblesse de l’enseignement religieux
La majorité des musulmans de France ont une connaissance lacunaire des enseignements de la religion dont elle se réclame. Et pour cause ! Hors terre d’islam, la connaissance des textes est faible, car il n’existe aucun organisme d’éducation religieuse. Les catholiques et les protestants disposent d’écoles confessionnelles. Pour ceux qui fréquentent l’école publique, les familles peuvent choisir, non loin de chez eux, l’enseignement de la catéchèse ; les jeunes bénéficient d’un accompagnement spirituel pour les différents sacrements, notamment pour la communion et la confirmation. Les familles juives, peuvent, si elles le souhaitent, inscrire leurs enfants dans des écoles privées confessionnelles. Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de leur bar/bat-mitsva, ils bénéficient là aussi d’une formation au dogme et d’un accompagnement. De fait, il n’existe aucun rite de passage permettant d’initier les jeunes musulmans à leur religion.
Pour les familles musulmanes qui souhaitent assurer un enseignement religieux à leurs enfants, il n’existe en France qu’une seule école confessionnelle sous contrat58. Dès lors, les seules références religieuses sont cantonnées à la sphère familiale, références et pratiques parfois dévitalisées ; l’autre source d’identification revient aux médias, qui renvoient une image démonétisée de l’islam. L’aumônerie musulmane n’a malheureusement pas encore dépassé l’enceinte des prisons, de l’armée, et peine à se professionnaliser dans les hôpitaux. Les charlatans de la foi ont su facilement creuser leur sillon dans ce désert culturel et cultuel. Aujourd’hui, en France, le seul organisme d’éducation de la jeunesse réellement structurant, les Scouts musulmans de France, d’initiative soufie, est de création relativement récente59.
Le phénomène qu’on appelle le « jihadisme français »
Christian Jambet, « Entre islam spirituel et islam légalitaire : le conflit est déclaré », Le Monde, 26 juin Christian Jambet, philosophe, spécialisé notamment sur l’islam, est aujourd’hui titulaire de la chaire des études islamiques à l’École pratique des hautes études (EPHE).
Interview de Zaïm Khenchelaoui, « L’Algérie se fanatise de partout », El Watan, 18 septembre 2014.Dés
En 2001, Christian Jambet traçait une ligne de rupture, affirmant : « Le conflit est déclaré : la guerre est bel et bien ouverte entre l’islam spirituel et l’islam légalitaire60. » Plus d’une décennie plus tard, les différends entre ces deux pratiques de l’islam paraissent dépassés. La ligne de démarcation s’est déplacée : le danger vient de dérives sectaires instrumentalisant l’islam.
Les crimes odieux commis au nom de l’islam par un pseudo-calife de Daesh sorti de nulle part et également la destruction des manuscrits de Tombouctou ainsi que des tombeaux des saints musulmans au Mali ont réellement inauguré ce nouveau conflit au sein du monde arabo-musulman. Aucun croyant ne tolère que l’on assassine et que l’on saccage des monuments sacrés d’une religion. Ces ignominies sont l’œuvre des obscurantistes et intégristes qui ont pris en otage l’islam dans une dérive que l’Algérien Zaïm Khenchelaoui, anthropologue des religions, qualifie de « modèle bédouin crypto-païen61 ». Le phénomène du « jihadisme français », constitué de jeunes gens en plein désarroi, en perte de repères, recrutés sur Internet, est inquiétant. Quantitativement, il s’agit d’un phénomène qui concerne peu de personnes mais dont la radicalité effraie. Certains oublient que ce phénomène fait écho à la paralysie internationale en Syrie : en trois ans, près de 200.000 Syriens, dont des milliers d’enfants, ont été les victimes de la guerre civile. Mais la décision de partir vers une mort certaine, présentée comme l’accès au paradis, résulte d’un endoctrinement sectaire, d’une manipulation mentale, qui engage la responsabilité de l’État. Comment protéger ces jeunes gens et enrayer le naufrage dans la spirale sectaire ? Comment empêcher leur départ ? Dans quelles conditions organiser leur retour ? Tout comme les pouvoirs publics, les responsables musulmans, qu’ils relèvent des secteurs associatifs culturels ou cultuels, doivent s’engager activement pour détecter les processus de radicalisation et tarir ce phénomène.
À cet égard, la loi antiterroriste – qui n’est en rien liberticide – votée au Parlement en octobre 2014 et qui inclut le retrait du passeport et une surveillance accrue des réseaux sociaux, et la formation aux processus de radicalisation des personnes qui encadrent les jeunes vont permettre de tenter d’enrayer cette spirale.
Échaudés par les grands médias qui les stigmatisent en permanence, les musulmans, et notamment les jeunes, sont de plus en plus nombreux à chercher des réponses à leurs interrogations sur les forums et sites spécialisés. Internet, formidable relais d’informations, est aussi le refuge des pires charlatans, un vecteur de choix pour la diffusion de propos simplistes et anxiogènes. Il revient à l’État de veiller à ce que des réseaux occultes n’exploitent pas la crédulité et l’ignorance d’un public souvent jeune et en pleine interrogation, en suscitant l’émergence d’autres interlocuteurs et d’autres canaux d’information. Ce combat est d’autant plus du ressort des pouvoirs publics que les dérives sectaires prospèrent sur fond de crise.
L’enseignement soufi est, cela a été dit, confrérique, collectif, et spirituel. Il vise à permettre au fidèle de s’interroger, entre autres, sur ce qu’il peut apporter aux autres. Dès lors, l’asymétrie est terrifiante : d’un côté, les plus fragiles, les moins éduqués, les plus isolés s’engagent dans une relation inégale de face-à-face avec des sites qui, à coups d’images sensationnalistes, de certitudes péremptoires, de sophismes et de mensonges délivrent un message et prescrivent une conduite destinée à vendre une « estime de soi » qui n’est rien d’autre qu’une aliénation mentale ; de l’autre, la pratique soufie convoque la raison et invoque la bienveillance et le dépassement de soi. Cette asymétrie n’est pas propre à l’islam, tant s’en faut. À cet égard, peut-on indéfiniment accepter que la Toile soit un espace de « liberté » sans limites ? S’il fallait s’y résoudre, alors l’émergence d’autres espaces de débats différenciés s’imposerait plus que jamais comme une nécessité politique.
Le contexte qui vient d’être décrit tisse une trame explosive : indigence de la formation et de l’accompagnement spirituel en France, faiblesse de la légitimité de la représentation du culte, persistances de miasmes coloniaux, perversion de la laïcité, discriminations à l’œuvre et réseaux jihadistes. Il serait temps de proposer des alternatives et des solutions, et ce d’autant plus que, fidèles à l’héritage des Lumières, la France et l’Occident ont su former de nombreux esprits, clercs ou laïcs, en mesure de riposter et d’élever le niveau du débat.
Désinstrumentaliser l’islam pour permettre l’exercice d’une citoyenneté active
De nombreux penseurs de l’islam réfléchissent depuis longtemps aux grands enjeux contemporains et aux défis que doivent relever les musulmans occidentaux.
Pour Abdelwahab Meddeb, « les musulmans du Vieux Continent sont en mesure de pratiquer un culte spiritualisé, nourri entre autres, par le riche fonds du soufisme. Ce n’est pas par le déni de soi mais par son affirmation libre que le sujet d’islam sera un acteur efficace dans l’horizon d’une cosmopolitique post-occidentale62 ».
Le soufisme pourrait être un passeur culturel et spirituel entre l’Orient et l’Occident. C’est précisément cet islam qu’il faut retrouver en France pour permettre le retour à des relations normales et naturelles dans un climat serein, condition d’une démocratie apaisée où chaque citoyen se détermine librement.
Pour Abdennour Bidar, « nous, musulmans occidentaux, installés au cœur et à la pointe de la modernité […], nous pourrons être demain l’avenir de l’islam, c’est-à-dire ceux qui réalisent en eux-mêmes, dans leur vie, dans leur cœur, une conciliation, pacifique et harmonieuse, entre l’Orient et l’Occident. Montrons […] que nous inventons un monde nouveau qui n’est plus ni l’Orient ni l’Occident, mais le produit de leur synthèse et de leur dépassement63. »
L’organisation de l’islam de France de plus en plus contestée
Faute d’avoir anticipé l’intrusion du danger islamiste et d’avoir répondu à l’appel de représentants d’un islam apaisé concernant l’absence de lieux de culte et une meilleure prise en considération de la communauté musulmane, les différents gouvernements ont procédé par tâtonnements. La création au forceps de différents organismes destinés à représenter l’islam de France est l’illustration de cette difficulté à penser l’islam en France, l’islam de France. La création d’un conseil représentatif de l’islam de France, le Conseil français du culte musulman (CFCM), se heurte à une difficulté majeure : l’islam sunnite, à la différence du catholicisme, n’est pas organisé en clergé. La pratique du fidèle est individuelle. De plus, la pratique de l’islam n’est pas homogène, la majorité des musulmans de France s’inscrivent dans l’islam malékite, une des quatre écoles de l’islam, présente notamment au Maghreb. Ils s’en remettent au dogme et rien qu’au dogme : la profession de foi, le jeûne, la prière, l’aumône légale, le pèlerinage. D’autres, invoquant le dogme, et sous l’influence des tenants d’une lecture obscurantiste de l’islam, inventent des pratiques qui ont pour objectif d’afficher, dans l’espace public, une foi ostentatoire : barbe, niqab, kamis. La pratique de ces derniers s’apparente de plus en plus à une religiosité aliénante. En limitant l’islam à la différenciation entre ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est licite et ce qui est illicite, le Coran se retrouve alors confiné dans un rôle de « code pénal » censé distinguer les bons comportements des mauvais. Il n’est rien de plus dangereux que de réduire l’islam à cette dimension de tri autoritaire sans aucune profondeur et sans aucun recours à la raison.
Le mode d’élection au sein du CFCM, calibré sur le nombre de mètres carrés dédiés au culte, a été largement contesté. Pour cette raison, une grande partie des musulmans ne se reconnaît pas dans la représentation institutionnelle de l’islam de France. De fait, le CFCM est contesté davantage non pour ce qu’il fait, mais surtout pour ce qu’il ne fait pas. Par ailleurs, son mode de fonctionnement est encore marqué par une trop grande allégeance aux différents pays d’origine. Il existait pourtant une tradition orientaliste française qui a traversé le XXe siècle et qui perdure autour d’islamologues, de savants spécialistes de l’exégèse islamique, et de docteurs de la foi. Les aurait-on consultés au préalable que la décision publique aurait gagné en clairvoyance ! Eux connaissent l’islam au-delà des caricatures. Alors que le CFCM n’a pas su investir son rôle, les médias propagent une image et un discours décérébrant.
Médias versus islam
Le silence supposé des Français de confession musulmane est, en fait, une construction médiatique. Trop longtemps, dans les grands médias, les invités prétendument représentatifs de l’islam relevaient de la catégorie des « analphabètes bilingues » : ils n’étaient représentatifs de personne, si ce n’est de l’image que les médias voulaient « vendre ». De surcroît, en mettant systématiquement en avant quelques « télé-polémistes », tel Éric Zemmour, les médias ont accrédité l’idée que l’islam n’existe que dans sa radicalité ou dans sa médiocrité. C’est comme si Civitas, association catholique intégriste, dont la visée politique est la restauration de la monarchie, devenait la voix officielle des catholiques français.
Parce qu’ils formatent les représentations plus que de raison, les médias portent une lourde responsabilité. Il leur appartient de faire le bilan de vingt ans de traitement médiatique de l’islam, notamment au regard du développement de l’islamophobie et, surtout, au regard de l’extraordinaire ignorance de la majorité de nos concitoyens sur cette culture et cette religion en dépit de nombreuses heures d’exposition médiatique. Ibn Arabî disait des hommes qu’« ils sont les ennemis de ce qu’ils ignorent ». Le « choc des civilisations » prophétisé par certains esprits chagrins – en réalité un « choc des ignorances » – est adoubé par le sacre médiatique. À ce titre, les soufis, grands connaisseurs de l’islam dans sa complexité et ses spécificités, auraient pu jouer un rôle pour l’élaboration d’un autre discours.
Les musulmans face à une injonction contradictoire
www.figaro.fr, 25 septembre 2014.
Campagne « Not in my Name » lancée par des musulmans britanniques face aux massacres perpétrés par Daesh.
Le Figaro, 25 septembre 2014.
L’immense majorité des musulmans de France ne se reconnaît ni dans les jihadistes partis en Syrie, ni dans les femmes arborant un voile intégral. Il leur revient de le faire savoir et de rejeter ces pratiques comme contraires à leur éthique. Le silence face à des dérives sectaires est souvent assimilé à une complicité tacite. Récemment, un sondage publié sur le site d’un grand quotidien a suscité une vive émotion, avec cette question : « Les musulmans en font-ils assez dans leur condamnation de l’assassinat de l’otage français ?64 » La formulation laissait supposer que les musulmans portaient une part de responsabilité à travers un silence coupable. Face au tollé qu’a provoqué ce sondage, il fut retiré du site.
Par ailleurs, un débat curieux s’est instauré à la suite de la pétition « Pas en notre nom65 » et, surtout, de la tribune « Nous sommes tous des sales Français66 ». Cette tribune, signée par des musulmans de la société civile, condamnait avec force l’assassinat d’Hervé Gourdel. Le débat a mis face à face ceux qui condamnent ces crimes et ceux qui pensent qu’il n’appartient pas aux musulmans de France de se justifier des agissements commis par de soi-disant musulmans dans le monde. En fait, ils sont tous d’accord sur la condamnation mais ne supportent plus les injonctions qui leur sont faites en permanence et qui reviennent à cautionner le procès fait à l’islam. Quand les Français de confession musulmane se taisent, ils sont forcément dans la complicité ; quand ils s’expriment, ils signeraient leur duplicité ! En mettant systématiquement les musulmans face à ce dilemme, on favorise l’émergence et l’installation de solidarités absurdes.
Le poids de la variable cultuelle dans le comportement électoral
Abdelmalek Sayad, L’Immigration ou les paradoxes de l’altérité, De Boeck Université, 1992.
Ifop, « Le Vote des musulmans à l’élection présidentielle », Ifop Focus, no 88, juillet 2013, p. 2.
Alors que certaines populations décrochent, une classe moyenne issue de la diversité émerge. Les élites et la classe moyenne ont une forte conscience du rôle qu’elles peuvent jouer à travers l’exercice démocratique. Elles sont plus que jamais, dans l’affirmation de leur citoyenneté, car « exister, c’est exister politiquement67 ». Elles étaient au rendez-vous lors des dernières élections. Une note du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) de 2011 puis une étude Ifop de 2013 ont tenté d’isoler le poids de la variable cultuelle dans le comportement électoral des musulmans ; ce segment, qui compte selon l’Ifop 5 % des inscrits, et qui se caractérise par un survote à gauche très important, « représente 1,5 point du corps électoral… soit l’avance qui a permis à François Hollande de l’emporter68 » en 2012.
Plus récemment, la Fondation Jean-Jaurès a consacré une note à ce segment électoral stratégique en Île-de-France69. Selon cette étude, les « musulmans de gauche » se singularisent par des valeurs conservatrices sur les questions de société et, électoralement, par une plus forte propension à l’abstention. L’auteur, comme surpris de sa propre audace, prend soin de souligner le caractère « explosif » de cette révélation politique. Pourtant, l’étude du poids de la religion n’est pas une discipline nouvelle. Ce n’est donc pas tant sa dimension confessionnelle qui effraie, mais bien sa dimension spécifiquement musulmane.
Le danger des listes communautaires
Bariza Khiari, « De quoi le vote musulman est il le nom ? », Mediapart, 17 avril 2014.
Aux dernières élections municipales de mars 2014, ces mêmes électeurs, qui avaient pourtant voté pour la gauche aux élections présidentielles, ont par leur abstention massive ou leur report sur des listes dites « citoyennes » fait trébucher le Parti socialiste jusque dans ses bastions traditionnels, notamment en Île-de-France. Les messages envoyés à l’exécutif ont exprimé une double sanction : une déception sur l’absence de résultats en lien avec les questions socio-économiques et le rejet d’un agenda politique trop centré sur les questions dites de société. En clair, ils attendaient le « vote pour tous », ils ont eu le « mariage pour tous », assorti des ABCD de l’égalité, concept mal expliqué puis détourné.
C’est en redonnant du crédit à la parole politique et sa force au pacte républicain que l’on parviendra à affaiblir les revendications les plus problématiques. La manière la plus efficace de lutter contre les extrémistes religieux, les populistes et les communautaristes serait de lutter contre leurs fondements, ce qui les anime et ce qui les nourrit. La montée d’un islam revendicatif est bien la traduction d’un pacte républicain fragilisé sur lequel surfent les populistes. Il ne s’agit pas de combattre les religions, mais de rétablir le pacte républicain. La crédibilité des institutions républicaines et de la laïcité s’incarnera dans l’acceptation d’un pluralisme intégrant les musulmans de France.
Cette feuille de route, simple en théorie, se heurte à la configuration idéologique du système partisan en France. Pour le dire plus simplement : la droite, dans une tradition nationaliste, n’aime pas les immigrés ; la gauche, façonnée dans son combat contre l’Église, n’aime pas les musulmans. Les Français de confession musulmane doivent se battre sur deux fronts : l’un, à droite, afin de faire valoir leur légitimité en tant que Français et leur capacité à agir comme tels en dépit de leurs origines ; l’autre, à gauche, afin de faire valoir leur citoyenneté et leur capacité de penser en dépit de leur foi.
La création du ministère de l’Identité nationale et le débat du même nom voulus par l’ancien président Nicolas Sarkozy, la difficulté du président François Hollande à mettre en débat le droit de vote des étrangers pourtant inscrit dans les promesses du candidat, l’absence de nominations à des postes de la haute fonction publique alors que les compétences existent et que la gauche dispose du pouvoir de nomination et, enfin, l’atonie d’une politique publique d’ampleur visant à lutter contre les discriminations démontrent, s’il en était besoin, l’incapacité de la classe politique à aborder ces sujets avec clairvoyance. La droite n’est pas en reste, elle qui a contribué à aggraver la situation en ethnicisant les fonctions régaliennes (que l’on se souvienne en effet de l’épisode du « préfet musulman »).
Depuis trop longtemps le citoyen de confession musulmane a l’impression d’être l’objet d’une farce où alternent tour à tour gauche et droite. Tantôt variable d’ajustement d’une gauche en mal d’électeurs et cherchant à catalyser les mécontentements, tantôt repoussoir pour une droite soucieuse de donner des gages à son électorat le plus radical et de séduire les soutiens de l’extrême droite. Si cela perdure, il ne faudra plus s’étonner de voir fleurir pour les prochaines élections davantage de listes communautaires.
Aujourd’hui, le danger est double : les aspirants au jihad, petite minorité mais fortement radicalisée, représentent un danger pour la sécurité nationale, tandis que l’émergence d’un « vote spécifiquement musulman » est porteuse d’antagonismes au sein de la République.
Entre radicalisme, abstention et listes dites citoyennes, il y a pour les musulmans de France un chemin : celui de la République sociale et laïque.
Mais cela implique pour les grands partis politiques de reconnaître les citoyens de confession musulmane comme membres à part entière de la cité et de tenir les promesses qui leur sont faites, comme aux autres électeurs. Le non-respect de la parole politique est mortifère pour la démocratie70. Et cela implique également, du côté des musulmans, une très grande clairvoyance et exigence à l’endroit de ceux qui les représentent ; il leur incombe surtout, quelle que soit leur position dans la société française, de contribuer à une « bataille culturelle ».
En effet – et les musulmans de France le savent désormais parfaitement –, le combat contre l’islamophobie ne se fera pas à coups de manifestations, de concerts et de pin’s. Ils n’ont pas oublié que vingt ans d’antiracisme officiel ont mené Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles. Le combat contre l’islamophobie doit être une offensive constructive, et non une posture défensive s’exprimant à coups d’anathèmes et de jugements moraux. Le combat contre l’islamophobie ne peut être gagné que si d’abord les musulmans de France s’en mêlent.
Ils doivent, avec d’autres, s’emparer du débat, avec les armes dévolues au combat d’idées : le combat contre l’islamophobie doit être porté par l’ensemble de la société. À présent, ce volet doit être accompagné d’un discours permettant de redonner du sens à la présence de l’islam en France. Les soufis, forts de leur tradition intellectuelle, ne devraient-ils pas s’engager dans cette bataille culturelle, destinée à promouvoir un islam spirituel libre et responsable ?
Les soufis : pour retrouver l’islam des lumières
La crise identitaire européenne est-elle la conséquence de la crise économique et sociale, ou bien a-t-elle sa propre dynamique ? De quoi souffre notre République ? Le diagnostic a son importance, car il détermine en principe le sens et la légitimité de l’action publique. La cohésion sociale est-elle menacée par le communautarisme, ou bien davantage par les discriminations liées à l’islamophobie ? Faut-il, pour être un « bon Français », se départir de ses identités « héritées » ? La religion est-elle l’adversaire de la République ? Les soufis, dans le dialogue intérieur qu’ils entretiennent entre foi et raison, tradition et modernité, ont peut-être quelques éléments de réponses à cette grande crise identitaire qui affecte la France.
De la suspicion à la reconnaissance : une nouvelle approche de l’identité
Amartya Sen, Identité et violence, Odile Jacob, Amartya Sen, économiste et philosophe indien, a notamment dirigé le Trinity College de l’université de Cambridge. Il a reçu en 1998 le prix Nobel d’économie.
Élise Vincent, « “Assimilation” ou “intégration”, le sens politique des mots », Le Monde, 20 décembre 2010.
La restauration de la confiance dans le modèle républicain implique de repenser l’image du citoyen, conçu initialement pour porter le projet politique d’une nation moderne et unifiée. Le citoyen français du XXIe siècle est riche d’une histoire politique traversée de débats, d’inflexions et de mutations, dont le combat anticolonial et ses conséquences qui ont marqué plusieurs générations. Le suffrage, autrefois censitaire et masculin, est devenu « universel ». De national, il s’est « en partie » affranchi des frontières avec le droit de vote aux élections locales des résidents européens. À l’opposé du pessimisme ambiant, on pourrait faire l’hypothèse que l’élargissement du périmètre de la citoyenneté est consubstantiel à la démocratie.
Force est de constater que cette dynamique se heurte à l’atrophie conceptuelle de la notion d’identité. Certains esprits chagrins se sont convaincus que l’appartenance à l’islam était incompatible avec l’expression d’un vote citoyen. C’est ce préjugé tenace qui enchaîne depuis trente ans le projet du droit de vote des étrangers aux élections locales dans les limbes législatifs. Le projet politique de la citoyenneté n’a pas changé : permettre les conditions d’existence d’une démocratie fondée sur l’égalité juridique des personnes. À l’heure du « village planétaire », l’efficience de l’idéal citoyen doit se mesurer à sa capacité à créer du lien social, dans une société qui n’est plus homogène culturellement. Or la citoyenneté contemporaine doit se redéfinir autour d’un projet qui vise non pas à déraciner l’homme ou la femme, à « effacer son disque dur », mais à lui apporter et à lui garantir son émancipation, tant intellectuelle que sociale. Il est donc nécessaire de réconcilier la citoyenneté avec l’histoire récente de la France, notamment celle de la décolonisation, et de l’immigration.
Les odes à l’assimilation – entendue comme une abjuration de soi – tout comme les hommages à la diversité – qui sonnent trop souvent comme à un appel condescendant à la tolérance – sont d’une certaine façon des discours périmés. Le discours politique doit réconcilier la notion de citoyenneté avec celle de personne humaine. Cette dernière n’est pas un produit de laboratoire, née d’une génération spontanée et vierge de toute histoire, mais le dépositaire d’une histoire familiale et collective, riche de drames et de gloires.
Dans son ouvrage Identité et violence, Amartya Sen rappelait à juste titre que l’identité est plurale, fruit de recompositions, de reconstructions, de choix personnels et parfois collectifs71. Dans un entretien, Patrick Weil disait avec justesse : « Le débat est absurde car il n’y a pas d’opposition entre “assimilation” et “diversité”. Il y a des moments où chacun d’entre nous aspire à être traité comme ses semblables devant les institutions et d’autres où il demande à être reconnu dans sa particularité culturelle72. » De fait, vouloir l’autre comme soi-même ou le déclarer radicalement différent sont les deux versants d’une même médaille : le racisme.
La question de la foi en France est prise en tenailles entre l’obésité médiatique d’un islam caricaturé et/ou dévoyé, et l’atrophie conceptuelle de la notion d’identité. Le « curseur » des musulmans comme celui des autres citoyens, n’en déplaise aux Cassandre, n’est pas bloqué sur la seule variable cultuelle. Les musulmans se définissent eux-mêmes par d’autres critères. Ils sont pauvres, riches, chômeurs, salariés, fonctionnaires, entrepreneurs, sportifs, artistes. Ils sont actifs dans la cité. Ils ont des problèmes similaires à ceux de leurs concitoyens. Il convient donc de veiller à ce que la construction de l’identité politique ne prenne pas racine sur un fondement religieux – ce qui serait mortifère –, mais sur des valeurs dans le cadre d’une citoyenneté active faite de droits et de devoirs autour du pacte républicain, assurant une expression religieuse apaisée et plus intérieure, en phase avec la laïcité, à la condition toutefois que les musulmans se prémunissent d’un double écueil : un passé sans avenir et un avenir sans racines.
Les musulmans soufis de France ont pleinement conscience que la spiritualité qu’ils vivent et qu’ils portent peut être un élément de réponse à la crise identitaire, notamment auprès des musulmans de France. Dans un double souci de discrétion et de bienveillance, forts d’une foi sereine et paisible, ils puisent dans l’enseignement qu’ils reçoivent le sens d’un engagement citoyen. Ils peuvent, avec d’autres, contribuer à redonner de la dignité et de la fierté collectives à une communauté qui en est privée depuis trop longtemps.
Le soufisme : une spiritualité en phase avec les valeurs de la laïcité
Le soufisme est aujourd’hui le principal rempart face à l’islam radical et à ses dérives sectaires. La lecture que privilégie l’islam soufi est ouverte sur l’autre. Elle n’exclut pas mais intègre. Elle ne rejette pas mais accueille. Elle ne refuse pas mais ouvre. Le soufisme rend plus difficile le détournement de la foi au profit d’une vision pervertie en ce que le collectif sert de garde-fou à de possibles dérives. Les soufis en sont d’autant plus convaincus qu’ils estiment que le désordre et le chaos entravent l’émergence d’une dimension spirituelle. Puisque le soufi considère avant tout l’islam et sa pratique comme relevant du domaine de la foi intérieure, il ne souscrit pas à une politisation de la religion. Leur éthique de l’islam garantit ainsi une pratique apaisée s’inscrivant dans le respect de nos institutions.
Les mouvements radicaux craignent le soufisme en ce que celui-ci s’inscrit dans la négation de ce qu’ils sont, car les soufis n’ont jamais cessé, tout au long de l’histoire, de se référer au véritable islam et de transmettre en le contextualisant. Aujourd’hui, ils peuvent être une alternative face à ceux qui sont « sortis » de la religion et qui commettent des ignominies en son nom. La prise en compte par les pouvoirs publics d’une parole soufie – si elle peut s’exprimer – n’obère nullement la question des revendications pour les questions d’égalité et de lutte contre les discriminations, mais cela permet de nier toute dimension religieuse à ces questions et de séparer revendications politiques et religieuses, principe nécessaire à un débat serein.
Faire de la France le « Harvard de l’islam »
L’ expression est d’Abdennour Bidar.
Al-Fârâbî est un philosophe persan à qui l’on doit notamment un commentaire de La République de Platon, ainsi qu’un sommaire des Lois de Platon.
Entretien avec Ghaleb Bencheikh, « Un État moderne et démocratique est le garant du libre exercice du culte », Liberté, 12 juillet 2014.
Abû al-Walid Ibn Ruchd (m. 1198), connu en Occident sous le nom d’Averroès, est un grand philosophe et théologien musulman.
L’ijtihâd renvoie à l’effort de réflexion que les juristes musulmans entreprennent pour interpréter les textes fondateurs de l’islam et en déduire le droit musulman ou pour informer le musulman de la nature d’une Ce terme désignait naguère l’effort des plus illustres savants pour atteindre les avis juridiques les plus justes et en conformité avec l’esprit des textes.
L’Immigration à l’école de la République, rapport d’un groupe de réflexion animé par le professeur Jacques Berque au ministre de l’Éducation nationale, CNDP/La Documentation française, 1985.
Mettre en évidence le débat, les interrogations, les cassures et les risques de rupture, c’est permettre l’information et le choix en connaissance de cause. En cela, les pouvoirs publics ont un rôle éminent à jouer car la France a l’avantage d’un très long voisinage avec le monde arabe et le monde musulman, à travers les échanges multiséculaires autour de la Méditerranée, l’époque coloniale, les migrations… Au regard de cette histoire riche et tumultueuse, la France aurait pu être le « Harvard de l’islam »73, un lieu de rayonnement majeur en Occident de la recherche sur cette religion et sur sa civilisation. Or la recherche française en la matière s’exprime dans une « niche » pour des initiés et par des spécialistes alors qu’elle fut à la pointe de la connaissance de l’islam au XIXe siècle et au début du XXe siècle, portée par un orientalisme savant largement vulgarisé (Louis Massignon, Jacques Berque, Vincent Monteil, Louis Gardet, Régis Blachère, André Miquel, Dominique Chevallier…) ou par des érudits inclassables comme René Guénon.
Ce déficit patent a pour conséquence un double préjudice intellectuel et social. Intellectuel, parce que la recherche française en matière d’études de l’islam n’occupe pas la place qui devrait être la sienne dans le monde. Social, parce que la population d’origine musulmane vivant dans notre pays compte aujourd’hui un très grand nombre de femmes et d’hommes cultivés, diplômés, en attente d’un tout autre discours sur l’islam que celui qui a cours actuellement. Cette élite ne demande qu’à tirer l’islam par le haut dans une démarche de distanciation critique. Si l’on veut bien croire que l’ignorance est l’ennemie de la démocratie, alors la création d’une chaire au Collège de France, projet académique déjà bien avancé, devrait être concrétisée urgemment.
Les travaux de recherche portant sur la refondation de la pensée islamique sont absolument nécessaires, sous peine d’assister, à une plus grande échelle, à un endoctrinement religieux aussi médiocre qu’aliénant. L’absence de confrontation intellectuelle est d’autant plus dommageable qu’il y a eu, dans le contexte islamique, plusieurs querelles entre les Anciens et les Modernes. À titre d’exemple, « lorsqu’al-Fârâbî74 (m. 950), par exemple, dans sa Cité vertueuse, présentait la conquête du bonheur et la quête du salut comme une entreprise humaine réalisable sur terre sans attendre le secours du Ciel, il était éminemment moderne. Lorsqu’il préconisait qu’en cas de désaccord entre la foi et la raison c’est à la seconde de prendre le pas sur la première, il faisait preuve d’un certain courage75 ». Ou d’un Ibn Ruchd76, pour qui la vérité, celle de la foi, ne saurait contredire une autre, celle de la raison. La confrontation et le débat d’idées ne peuvent qu’être propices à une exégèse réformatrice (ijtihâd77) pour se hisser à la hauteur des exigences des temps modernes.
Dans la même perspective, mais plus en amont, d’autres propositions visant à lutter contre l’ignorance ont fait long feu. En 2002, dans un rapport remis au ministre de l’Éducation nationale, Régis Debray avait préconisé l’enseignement du fait religieux à l’école. Cela aurait notamment permis d’apprendre que l’islam n’est en rupture ni avec le judaïsme, ni avec le christianisme, mais qu’il s’inscrit dans un continuum avec le message biblique. Au lieu d’un débat constructif, cette mesure a donné lieu à une polémique stérile. L’enseignement des langues d’origine, proposé par Jacques Berque, éminent islamologue, a aussi connu le même sort78. La récente polémique autour d’une fausse circulaire relative à l’enseignement de la langue arabe à l’école illustre le fossé qu’il reste à combler pour combattre l’obscurantisme, d’où qu’il vienne.
* * *
Ceux qui clament que l’islam n’est pas soluble dans la République ont doublement tort : d’une part, parce qu’ils se réfèrent à l’islam des médias, sectaires et sensationnalistes ; d’autre part, parce que la recherche de sens est nécessaire au projet politique.
Pour répondre au désenchantement du monde, les chrétiens sociaux travaillent à cette recherche de sens. Sous l’impulsion de Jean-Baptiste de Foucauld, ils ont produit un « Pacte civique79 » qui devrait être davantage pris en compte par nos dirigeants afin de construire le vrai socle du changement, non pour « le meilleur des mondes », mais juste pour un monde meilleur. Ce pacte pourrait être résumé en ces termes : l’homme doit l’emporter sur le système, le partage doit l’emporter sur la seule possession, la durée doit l’emporter sur l’urgence, le citoyen doit l’emporter sur le consommateur, la qualité ne doit pas être négligée au profit de la quantité. Les citoyens de confession musulmane, parce qu’ils sont portés par une tradition éminemment humaniste, adhèrent à ces principes dans leur grande majorité car ils sont attachés à une vision plus solidaire de la société. La recherche de sens – entendu également comme progrès – est nécessaire au projet politique. En fidélité à l’esprit de l’héritage mohammadien, tant dans l’aspect spirituel que dans la gouvernance de la cité, pour le musulman soufi la véritable citoyenneté prend ses racines dans les profondeurs de l’être et la véritable spiritualité s’incarne dans les actes citoyens de chaque jour. La normalisation de l’islam est le test de crédibilité de la République.
Cette normalisation doit avant tout procéder des pouvoirs publics. Il est de leur ressort de faire respecter l’égalité réelle, en luttant contre les discriminations et l’islamophobie, et en donnant la primauté à la citoyenneté sur l’identité. Mais elle doit aussi procéder des musulmans eux-mêmes. Il faut au préalable qu’ils se réapproprient, pour mieux les transmettre, les merveilles, les beautés de leur culture. Le soufisme d’hier et d’aujourd’hui est porteur de trois espérances majeures : la première est que la foi se nourrit tant du dogme que d’une spiritualité vivante ; la deuxième est que foi et raison ne s’opposent pas, mais s’éclairent l’une l’autre ; la troisième est que cette spiritualité, pour être vivante, doit être vecteur de sens en fondant l’action bienveillante.
À ce titre, la pensée soufie diffuse un islam libre, spirituel et responsable, qui permet l’expression d’une citoyenneté véritable, garante du vivre ensemble. Parce que « les hommes sont les ennemis de ce qu’ils ignorent », il est indispensable que les soufis promeuvent, au-delà des cercles confrériques, la voie dont ils sont autant les dépositaires que les acteurs. Comme le regretté Abdelwahab Meddeb, je suis persuadée que l’engagement des musulmans soufis dans le débat public pourrait contribuer à apaiser les crispations identitaires, tant de certains musulmans que d’une partie de l’opinion, et contribuer, ainsi à éteindre l’incendie qui se propage dans le corps social.


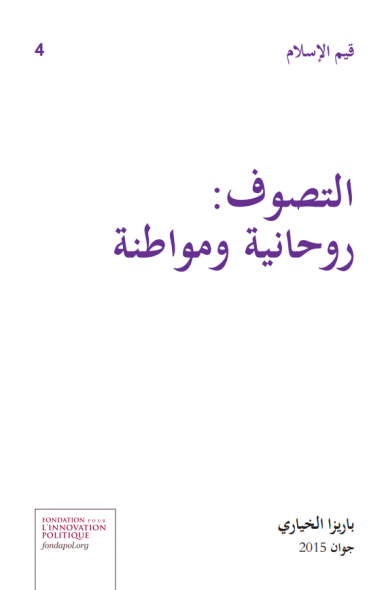











Aucun commentaire.