Changements de paradigme
2020, une rupture
Paradigmes et régulation de l’activité économique et sociale : de quoi parlons-nous ?
La gouvernance économique au XXe siècle : pourquoi est-elle puissante ?
Survivre à un changement de paradigme
Josef Konvitz,
Josef Konvitz a pris sa retraite de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2011, où il était directeur de la division « Politique réglementaire ». Il avait rejoint la division des « Affaires urbaines » en 1992, qu’il a dirigée de 1995 à 2003.
Historien de formation, il a fait partie de la faculté d’histoire de la Michigan State University de 1973 à 1992.
Il est professeur honoraire de l’université de Glasgow et titulaire de la chaire à l’Observatoire international Pascal.
2020, une rupture
- Voir Josef Konvitz, Ne gaspillons pas une crise, Fondation pour l’innovation politique, avril 2020.
« A better version of the pre-2008 world will just not do. People do not want a better past; they want a better future » (Martin Wolf, « Why so little has changed since the financial crash », ft.com, 4 septembre 2018).
Voir OCDE, « Infrastructure to Telecom, Land Transport, Water and Electricity », juin 2006.
Voir Friedrich Hayek, La Constitution de la liberté [1960], trad. Raoul Audouin, Institut Coppet, 2019.
« […] the consequences of great industrial and social processes which they can not alter, control, or singly cope » (Woodrow Wilson, « First Inaugural Address », 4 mars 1913).
Les crises mettent en lumière des forces qui étaient auparavant considérées comme acquises et des faiblesses longtemps ignorées. Dans une précédente note pour la Fondation pour l’innovation politique 1, j’avais déjà souligné la dimension urbaine de la pandémie du Covid-19 comme étant l’exemple le plus récent et le plus spectaculaire d’un risque transfrontalier qui tue et évolue rapidement. C’est avec gravité que nous reconnaissons que les choses ne seront plus jamais les mêmes : nous espérons le meilleur, mais craignons le pire. Lorsque de grandes souffrances prennent les pays au dépourvu, les gens sont divisés entre le désir de revenir à la normale et celui de compenser les vies et les richesses perdues en tentant de changer les choses. Le résultat est minutieusement équilibré. Déjà, en 2018, le journaliste économique britannique Martin Wolf avertissait à propos des échecs des politiques après la crise financière de 2008 : « Une meilleure version du monde d’avant 2008 ne fera tout simplement pas l’affaire. Les gens ne veulent pas d’un meilleur passé, ils veulent un meilleur avenir 2. » Mais, après 2008, la complaisance, le poids des idées reçues, la réticence à faire confiance aux nouvelles idées et le pouvoir des intérêts particuliers ont empêché le changement de politiques publiques. La même dynamique pourrait bien être à l’œuvre dans les années 2020. Y aura-t-il un élan plus profond vers un changement de paradigme maintenant que nous comptons des morts en plus de la dette ?
Avec cette crise du Covid-19, nous sommes confrontés à un moment unique, à une rupture historique entre une période et une autre. Lors d’une telle crise, nous réalisons à quel point les infrastructures sont précieuses et quels sont les risques d’un sous-approvisionnement. Cela va bien au-delà de la production de masques, de ventilateurs et de produits pharmaceutiques, ou du nombre de lits dans les unités de soins intensifs. De nombreux systèmes de télécommunication, de transport, d’approvisionnement en eau, de production et de transmission d’énergie, ainsi que des hôpitaux – certains construits pour durer cent ou cent cinquante ans, d’autres pour vingt-cinq ou cinquante ans – arrivent à la fin de leur cycle de vie utile. En 2006, le coût estimé du renouvellement et de la modernisation sur vingt-cinq ans était de 70.000 milliards de dollars, soit 3,5% du PIB mondial 3. Rien de ce montant n’a été investi avant 2020. Il s’agit d’un exemple classique de conjoncture, où une crise survient au croisement de tendances à court et à long terme et d’innovations technologiques majeures.
En 2008, les commentateurs affirmaient que l’État était de retour. Ils l’ont à nouveau proclamé en 2020. Une meilleure réglementation vient généralement après et non pas avant la catastrophe, mais, pour sortir de la récession, les entreprises vont plaider pour une suppression des réglementations. Pour certains, surtout à droite, le retour de l’État devrait être temporaire ; pour d’autres, essentiellement à gauche, ce rôle plus important de l’État devrait être permanent. Tous deux semblent oublier ce qu’affirmait Friedrich Hayek dans les années 1960 : ce n’est pas le quantum de la réglementation qui importe, mais ce qui est réglementé 4. Il vaut mieux avoir un haut niveau de réglementation sur les objets adéquats qu’une réglementation légère sur tous les objets. On peut dire la même chose des déficits : ce qui compte, c’est l’utilisation de l’argent. Les pressions exercées après 2008 pour réduire les déficits en diminuant les dépenses et les investissements ressortiront à maintes reprises dans les enquêtes post-pandémie sur la dotation en personnel des hôpitaux, sur la production et le stockage de fournitures médicales, ainsi que sur la formation et l’embauche de personnel médical. Vouloir changer l’avenir à court terme après 2008 a été l’erreur la plus coûteuse de toutes.
Ce qui peut sembler technique est en fait très politique car des sommes énormes sont en jeu. Les décisions prises maintenant et dans les années à venir auront des effets considérables, modifiant puis verrouillant des facteurs de développement et des structures territoriales qu’il sera très difficile de changer une fois mis en place. Après 2008, il y a eu à la fois des échecs politiques et des défaillances du marché. Il n’y a pas de marge d’erreur cette fois-ci.
Nous avons besoin d’un meilleur modèle de gouvernance économique qui préserve les avantages d’un ordre économique libéral ; il est nécessaire de protéger les personnes là où elles vivent, celles-là même qui, selon les mots du 28e président américain Woodrow Wilson, « ne peuvent pas modifier, contrôler ou faire face aux conséquences des grands processus industriels et sociaux 5 ». Wilson a d’ailleurs joint l’acte à la parole, en faisant ce qui était alors considéré comme impossible : fonder la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), créer les bases de l’État régulateur moderne, réduire les tarifs douaniers, organiser l’aide alimentaire aux États neutres pendant la Première Guerre mondiale et fonder la Société des nations. La lutte entre régimes autoritaires et régimes libéraux, et entre économies de marché et économies contrôlées qui, en son temps, a encadré ce que l’on peut appeler la « deuxième guerre de trente ans » (1914- 1945), a façonné le paradigme qui est devenu dominant à la suite de cette grande crise. Wilson était plus attentif aux tendances à long terme qu’aux événements majeurs. Aujourd’hui, il serait probablement à l’origine de la création d’un programme multinational différent : idéaliste mais pas utopique. Un changement de paradigme visant à modifier les priorités doit avoir une vision inspirante. Elle commence par les faits et les valeurs qui permettent de les interpréter.
Paradigmes et régulation de l’activité économique et sociale : de quoi parlons-nous ?
« Non dari spem sine metu neque metum sine spe » (Baruch Spinoza, Éthique, III, Définition des affections, XIII, « Explications », Ch. Appuhn, Garnier-Flammarion, 1965, p. 202).
Josef Konvitz, Cities and Crisis, Manchester University Press, 2016, p.227.
Voir Stanley Hoffmann, « Thoughts on Fear in Global Society », Social Research, 2004, 71, n° 4, p. 1023-1036.
Les paradigmes nous sont nécessaires. Personne ne peut individuellement penser une philosophie complète ni créer un cadre de règles et de codes. Ceux-ci sont appris, généralement sans que l’on porte sur eux un regard critique. La valeur d’une civilisation est précisément de transmettre un cadre à peu près adapté à l’époque et d’assimiler les leçons de l’expérience à propos des systèmes économiques, sociaux, politiques et environnementaux qui, parce qu’ils sont intrinsèquement dynamiques, sont susceptibles d’échouer. Les paradigmes paraissent généralement abstraits lorsqu’ils sont écrits, voire idéalistes, mais ils sont en fait éminemment pratiques, composés d’outils dont l’efficacité a été prouvée, ou dont les gens pensent qu’ils fonctionneront. L’objectif essentiel de chaque paradigme est que les gens aient confiance dans le fait que ce qu’ils font est juste et va dans la bonne direction.
Les paradigmes sont des systèmes de résolution de problèmes très puissants. Ils sont composés de principes de base qui définissent les priorités des individus et des sociétés, et de techniques et de méthodes spécifiques qui peuvent ensuite être appliquées aux problèmes au fur et à mesure qu’ils se posent. Quand ils veulent accomplir quelque chose, la plupart des gens se soucient davantage de l’application des principes clés que de ces principes eux-mêmes. Les paradigmes nous permettent de gérer la complexité, en rendant la résolution des problèmes plus facile, plus simple. Ils permettent de concentrer les énergies, de réduire l’incertitude, de libérer la créativité, de fixer des priorités mais dans un cadre d’objectifs convenus. Les paradigmes sont intériorisés dans les normes et les valeurs, exprimés dans les politiques, les lois et les règles, et mis en œuvre dans les institutions et les organisations. Les paradigmes fonctionnent beaucoup plus efficacement par le biais d’une conformité volontaire que par la contrainte, la sanction ou la répression.
Chaque paradigme dominant qui concerne la régulation économique et sociale est fondé non seulement sur l’espoir de réaliser quelque chose de formidable, mais aussi sur la crainte de quelque chose de terrible à éviter. Cette association d’espoir et de peur est le mécanisme qui donne de la cohérence à un paradigme sur ce qui devrait ou ne devrait pas être réglementé par le gouvernement pour que l’économie, la société et le système politique continuent à progresser vers un objectif commun. « Il n’y a pas d’espoir sans crainte ni de crainte sans espoir 6 », a écrit le philosophe Baruch Spinoza, qui soulignait également notre tendance à vouloir croire en ce que nous espérons, et notre résistance à croire que ce que nous craignons pourrait être vrai 7. Il existe un équilibre délicat entre la crainte et l’espoir ; il se peut toutefois que ce soit la crainte plus que l’espoir qui encourage les gens à faire ce qu’ils doivent faire.
Un paradigme définit toujours la sécurité que recherche une société. Il ne suffit pas de définir ce à quoi elle aspire en termes positifs : la clé pour connaître l’objectif vers lequel une société tend est de savoir ce qu’elle craint le plus, sa némésis. Au XIXe siècle, la poursuite du progrès séculaire guidait l’initiative publique et privée. Avant, au XVIIe siècle, les sociétés s’évaluaient en fonction de critères religieux et moraux. Dans les sociétés occidentales actuelles, la priorité est la sécurité économique, basée sur plus de croissance et moins de chômage, par crainte que moins de croissance et plus de chômage rendent la société moins stable et les États plus vulnérables. Ainsi, les objectifs économiques sont devenus une sorte de méta-réglementation, et cela ne concerne pas seulement l’économie mais aussi la structure sociale et le système politique. De nouveaux classements de pays, basés sur un mix d’indicateurs de qualité de vie, existent parallèlement au PIB et aux mesures économiques mais ils ne les ont pas encore remplacés.
Un changement de paradigme se produit lorsqu’une société redéfinit ses espoirs et ses craintes, généralement dans le creuset des crises. C’est pourquoi la tension entre la santé et le travail dans la pandémie est si forte : deux définitions rivales de la sécurité, l’une plus ancienne, l’autre plus récente, sont en jeu. J’utilise volontairement le terme « rivales », car pour se protéger contre certains risques, on s’expose à d’autres. C’est cela qui est au cœur du dilemme que l’on vit dans de nombreux pays entre le retour au travail et le maintien en confinement, et c’est pourquoi certains hommes et femmes politiques proclament que le remède – le confinement – est pire que la maladie parce qu’il donne lieu à une crise économique. Non seulement le paradigme dominant, orienté vers un faible taux de chômage, est mis à rude épreuve par la pandémie, mais les séquelles risquent aussi d’engendrer davantage de problèmes sociaux, ce qui fragilisera encore davantage le paradigme dans une sorte de spirale descendante. D’un point de vue économique, il s’agit de faire des compromis, de trouver le moment où l’on peut assouplir ou mettre fin au confinement et aux restrictions sans générer de charges ingérables sur le système de santé.
Nous savons mieux envisager la santé d’un point de vue économique qu’envisager l’économie si la sécurité est redéfinie de manière à placer la santé et l’environnement comme les principaux risques pour la stabilité sociale et la sécurité politique. Je n’affirme pas que la protection contre les risques pour la santé ou contre les risques liés au changement climatique est plus importante que la protection contre l’effondrement économique et le chômage, mais je dis que la tolérance de la société à l’égard des catastrophes environnementales et sanitaires est devenue plus étroite – les risques que nous avons vécus dans le passé sont désormais inacceptables – et que le paradigme du XXe siècle, qui s’articule autour de la sécurité économique, ne peut générer à lui seul de solutions crédibles.
La pandémie combine de nombreuses questions : santé préventive et traitement, inégalité sociale et inégalité économique, mobilité, communication, énergie, qualité de l’air et de l’eau… La liste est longue, et pour chaque question il existe des programmes concurrents, favorisant des réformes dans l’allocation des ressources et la réglementation. Des appels sont lancés en faveur d’une meilleure intégration des politiques intersectorielles. La théorie est logique, mais la coordination doit commencer avant que les politiques soient en place, et non après. L’absence de coordination est aussi un élément qui caractérise le comportement des États : nous avons eu des exemples spectaculaires de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, d’échecs de leadership lorsque des gouvernements ont persisté dans la mauvaise voie alors que cela menait manifestement à la catastrophe. La souveraineté nationale ne changera pas la nature des problèmes auxquels nous sommes confrontés et ne les rendra pas plus gérables.
En 2004, l’historien Stanley Hoffmann écrivait que, des décennies après la Seconde Guerre mondiale, nous nous trouvions « dans un troisième univers de peurs : universelles, omniprésentes, mondialisées », citant non seulement les armes de destruction massive que « même les petits États peuvent produire et exporter dans le monde entier, mais aussi les fléaux mondiaux tels que les épidémies, le trafic de drogue et d’armes et, bien sûr, les terroristes ». Ce qui est commun aux États nations, quelle que soit leur taille, est leur capacité limitée à contenir ces risques 8. Nous ne savons que trop bien ce que nous craignons. Comment pouvons-nous contrôler la peur en créant un cadre pratique qui assure notre sécurité ?
Nous avons connu des situations similaires, mais pas récemment. À la fin du XIXe siècle, à la suite d’épidémies de choléra (Hambourg) et de typhoïde, ou à la suite d’incendies de masse (Boston, Chicago, Baltimore), les responsables municipaux et les ingénieurs ont compris que si une ville entière ne pouvait pas être reconstruite sur des lignes plus sûres, même les plus riches seraient en danger. Des fondations philanthropiques, des organisations civiques, des scientifiques, des ingénieurs soucieux du bien public et une fonction publique professionnelle ont conçu et mis en œuvre ensemble des réglementations en matière de santé et de sécurité qui s’appliquaient à tous. La définition de l’intérêt public transcendait les droits de propriété individuels qui, jusqu’alors, avaient limité le pouvoir réglementaire de l’État ; les lois ont dû être modifiées, des procès ont été gagnés ; certains partis politiques au pouvoir ont perdu des élections. Les maladies infectieuses, les pénuries alimentaires, le chômage élevé et la criminalité concentrée dans les villes ont reculé. Au milieu du XXe siècle, la théorie économique appliquée a soutenu un paradigme basé sur la croissance économique urbaine et sur des taux élevés de migration et de mobilité de la main-d’œuvre. Aujourd’hui, plus de 75% de la population des pays à revenu moyen et élevé vivent dans des zones urbaines.
Nous ne devons pas avoir peur d’un changement de paradigme. Même si cela peut être difficile et stressant, les dirigeants politiques vont être appelés à prendre des décisions qui ne seront peut-être pas populaires et rompront avec ce qui a précédé. Aujourd’hui, il ne reste pas de survivant parmi ceux qui ont une part active au dernier changement de paradigme, celui qui a suivi la Grande Dépression, mais les mémoires et les traités de ceux qui en étaient les acteurs sont d’une lecture intéressante. L’histoire peut nous guider. Le monde occidental a connu plusieurs changements de paradigmes spectaculaires depuis le XVIIe siècle. Une fois achevés – entre vingt-cinq et trente ans environ –, les changements de paradigme inaugurent une période plus longue de développement plus stable jusqu’à ce qu’ils perdent à leur tour leur puissance. Un changement de paradigme réussi a aidé l’Europe à surmonter les obstacles dans le passé. Cette histoire devrait nous inspirer aujourd’hui.
La gouvernance économique au XXe siècle : pourquoi est-elle puissante ?
« … not only the goals of policy and the kind of instruments that can be used to attain them, but also the very nature of the problems they are meant to be addressing » (Peter Hall, « Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain », Comparative Politics, vol. 25, n° 3, avril 1993, p. 279).
Voir Aida Caldera-Sánchez, Alain de Serres et Naomitsu Yashiro, « Reforming in a difficult macroeconomic contest: A review of the issues and recent literature », OECD Economics Department Working Papers, n° 1297, 21 avril 2016, et Aida Caldera Sánchez, Alain de Serres, Filippo Gori, Mikkel Hermansen et Oliver Röhn, « Strengthening Economic Resilience: Insights from the Post-1970 Record of Severe Recessions and Financial Crises », OECD Economic Policy Paper, n° 20, décembre 2016.
Voir OCDE, OECD Regions and Cities at a Glance 2018, OCDE, 2018. Des versions antérieures de cet ouvrage sont parues en 2011, 2013 et 2016.
Comme l’écrivait l’urbaniste britannique Peter Hall, un paradigme définit « non seulement les objectifs de la politique économique et le type d’instruments qui peuvent être utilisés pour les atteindre, mais aussi la nature même des problèmes qu’ils sont censés résoudre 9 ». Le paradigme dominant dans une grande partie du monde mesure le changement par rapport au taux de croissance, au PIB et à l’emploi. Il a connu une longue et bonne période depuis la Grande Dépression, permettant de sortir des millions de personnes de la pauvreté, de supprimer l’impact des récessions et d’améliorer le niveau de vie. Ces dernières années, cependant, ce paradigme a également creusé l’écart entre les régions, entre celles en tête de file de la productivité et celles à la traîne, qui ne rattraperont peut-être jamais leur retard.
Nous décrivons les villes comme des moteurs économiques. Mais les comparer à des boîtes noires serait peut-être une meilleure métaphore car les économistes mesurent leur production mais n’observent pas ce qui se passe à l’intérieur. Les modèles économiques basés sur des unités nationales ne peuvent pas aider les décideurs à analyser les nombreuses variables qui rendent une ville différente d’une autre. Par conséquent, la politique économique nationale, qui opère par le biais de secteurs top-down, est indifférente aux besoins de villes et de régions particulières. Au mieux, dans notre paradigme actuel, le changement spatial est une variable dépendante, quelque chose qui se produit à la suite d’autres politiques sur les taux d’intérêt, le bien-être social, le transport, l’énergie, la fiscalité, les marchés du travail, l’immigration ou même l’innovation.
La raison pour laquelle la politique macroéconomique est peu sensible à la dimension spatiale est simple : les politiques macroéconomiques et structurelles classiques partent du principe que le changement spatial est lent, du moins par rapport aux tendances économiques et aux cycles politiques, et qu’il est donc largement hors de propos dans l’élaboration des politiques macroéconomiques. L’action gouvernementale est plus souvent corrective, s’attaquant à des conditions que les politiques antérieures ou les forces du marché ont aggravées, plutôt que proactive.
Les politiques n’ont pas intégré le fait que le changement spatial, principalement dû à la croissance urbaine rapide, s’est accéléré avant même que le public prenne conscience du changement climatique. Rien qu’en France, les gens en perçoivent de nombreux aspects : croissance périurbaine, déclin des petits centres urbains, érosion côtière, déforestation, parcs logistiques et complexes commerciaux sur des sites vierges, insuffisance de l’offre de nouveaux logements dans les zones de demande et abandon dans les zones de déclin, pavage d’espaces verts, construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et d’autoroutes, tout cela au cours des quarante dernières années. Pour ne citer qu’un chiffre : entre 1990 et 2000, l’augmentation des surfaces artificielles pour les logements, les parcs urbains, l’industrie et les transports dans les vingt-sept États membres de l’Union européenne a été d’environ mille kilomètres carrés par an, dépassant la taille de Berlin et augmentant à un rythme quatre fois supérieur à la croissance démographique. Hormis les nouvelles infrastructures, une grande partie de cette augmentation s’est faite de manière progressive et sans aucun effort pour évaluer l’effet cumulatif, notamment sur l’énergie et l’eau.
L’hypothèse selon laquelle le changement spatial est lent, peut-être recevable autrefois, ne l’est plus aujourd’hui. Le changement spatial – que l’on peut également appeler changement environnemental – s’est accéléré au cours des dernières décennies et il est devenu lui-même un moteur d’autres développements politiques. Cela explique une partie du décalage entre les objectifs de la politique économique et les problèmes auxquels sont confrontés les décideurs politiques.
Nous devons faire face au coût de la lutte contre la pandémie de Covid-19 avant d’avoir réparé les dégâts économiques et sociaux de la crise financière de 2008. En 2008 ou en 2020, de nombreux pays avaient des économies performantes au début de la crise, d’autres étaient plus fragiles, mais presque tous ont subi un choc. Lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté, le taux de croissance économique, bien que toujours positif, était environ la moitié de ce qu’il était avant 2008. Dans la plupart des pays occidentaux, dont les États-Unis, la richesse des ménages en termes réels n’a pas augmenté depuis près de vingt ans. Le PIB a chuté de 2,7% aux États-Unis et de 4,2% dans l’Union européenne en 2009 ; la baisse sera plus importante en 2020. Non seulement le PIB par habitant était plus bas en 2011 qu’en 2007 dans tous les pays du G7 (excluant l’Allemagne), mais, dans de nombreux États, le revenu moyen des ménages n’était pas plus élevé en 2018 qu’en 2000. Pour la première fois depuis un siècle, le revenu moyen des jeunes Américains a cessé d’augmenter plus rapidement que celui de leurs parents 10. Les disparités régionales au sein des pays sont plus importantes, et ne se corrigent pas d’elles-mêmes par des mesures économiques classiques 11. Dans le même temps, de nombreuses villes et régions sont exposées à des catastrophes auxquelles elles ne sont pas préparées et qui, depuis 1990, sont plus fréquentes et plus coûteuses.
Nous sommes donc pris dans un dilemme. La croyance en la prospérité, clé de voûte du paradigme du XXe siècle, n’est plus convaincante pour beaucoup. La croissance peut exacerber les problèmes régionaux, urbains et environnementaux, mais sans croissance, le coût de la lutte contre le réchauffement climatique, sans parler du vieillissement de la population, des nouveaux problèmes de santé ou de la révolution de l’intelligence artificielle, sera plus difficile à supporter. La lutte pour concilier les objectifs économiques et environnementaux est un effort intellectuellement sophistiqué, marqué davantage par des « compromis » que par des résultats « gagnant gagnant ». Ceux-ci ne sont pas très satisfaisants pour beaucoup de personnes qui n’ont jamais joui de l’abondance et qui peuvent trouver un attrait au populisme et à un leader fort, conduisant à la centralisation de la prise de décision dans des régimes non démocratiques et autoritaires.
Chaque dimension majeure de la pandémie a attiré l’attention sur des problèmes qui nécessitent des cartes ainsi que des graphiques, tant la dimension territoriale est importante : télétravail, transport par mer, air, rail, voiture, vélo, disparités raciales et socio-économiques qui expliquent la vulnérabilité des différents groupes, la distribution et la capacité des soins de santé, les chaînes d’approvisionnement, les travailleurs migrants… Et la liste s’allonge si l’on y ajoute toutes les problématiques liées au changement climatique.
Une meilleure gestion de l’espace est devenue impérative. Les politiques macroéconomiques et fiscales, les mesures réglementaires et techniques ainsi que le bon fonctionnement des institutions sont des conditions préalables, nécessaires mais non suffisantes pour aller au-delà de mesures fragmentaires. L’État a toujours été essentiel à chaque paradigme depuis la Renaissance et il a survécu à chaque changement de paradigme. Le paradigme actuellement en place est cependant plus profondément ancré dans le fonctionnement de l’État, qui absorbe aujourd’hui entre 30 et 60% de l’économie.
L’État a besoin que l’économie soit la plus performante possible, afin de collecter l’impôt et d’éviter de soutenir l’économie par l’endettement. Dans le même temps, l’État est confronté à la nécessité d’investir pour aller vers un nouveau paradigme. Nous avons dépassé l’époque Reagan-Thatcher, où une réduction massive de la taille et du rôle de l’État était alors une option. Des groupes de travail, des conseils et des comités spéciaux peuvent compenser au cas par cas mais ne serviront à rien pour réformer l’organisation du gouvernement afin de faire face à la crise – à court et à long terme – et à la nouvelle norme. Dans tout ce que j’ai lu sur les raisons pour lesquelles un changement de paradigme est à la fois souhaitable et nécessaire, je n’ai lu aucune analyse sur la manière dont un nouveau type d’État est susceptible d’émerger une fois la transition terminée.
Survivre à un changement de paradigme
« The global economic outlook is the murkiest in modern history » (Robin Wigglesworth, « Coronavirus creates biggest economic uncertainty in decades », Financial Times, 20 avril 2020).
« Almost all of the important decisions in modern democracies require this “silo-busting” analysis » (Gillian Tett, « How much should it cost to contain a pandemic? », Financial Times, 22 avril 2020).
Voir Andy Haldane, « Reweaving the social fabric after the crisis », Financial Times, 24 avril 2020.
L’évolution à un an de l’état de l’économie et de l’équilibre géopolitique entre les grandes régions du monde est inconnue. Nos sociétés peuvent se retrouver épuisées, au moment même où un effort important est justement nécessaire si nous voulons adopter des modes de vie et de travail différents et, espérons-le, meilleurs. Même si la pandémie prend fin dans un an ou deux, les effets de la crise nous accompagneront pendant une plus longue période, ce qui aura des conséquences non seulement sur la santé de centaines de milliers de personnes, sur le développement des entreprises et de l’emploi, mais aussi sur les priorités et la réaffectation des ressources. Il faudra des années pour démêler les pièces imbriquées qui soutiennent le paradigme actuel et mettre en place le cadre pour le nouveau. Et, pendant tout ce temps, il n’y aura pas de séparation chronologique nette et visible entre crise et période d’après-crise : seules les années à venir permettront de regarder en arrière et de voir où s’est produit le tournant.
Nous sommes là où nous sommes. L’incertitude macroéconomique, élevée en 2008 et pendant la longue et lente reprise, est maintenant « la plus élevée de l’histoire moderne 12 ». L’incertitude à un niveau intolérable peut être paralysante. Nous sommes confrontés à la perspective que les risques mondiaux, qu’ils concernent les systèmes financiers, le réchauffement climatique et la montée du niveau des mers, la santé ou les réseaux technologiques, ne peuvent être maîtrisés que dans une certaine mesure, leurs effets étant atténués. Cette pandémie a suscité des appels à un rôle plus important de l’État nation tout en mettant en évidence son caractère artificiel dans une crise mondiale. Les unités infranationales – villes et régions – ne sont pas aussi vulnérables mais dépendent de politiques nationales uniformes. L’idée selon laquelle l’Union européenne n’en a pas fait assez coexiste avec les sondages qui parallèlement montrent un plus grand soutien à l’Europe. Il faut faire quelque chose. Mesuré en termes de responsabilités futures, si des mesures préventives et proactives ne sont pas prises, le coût sera colossal. C’est ce qui m’est apparu clairement il y a un an, lorsque j’ai préparé une ébauche de cet essai. La pandémie de coronavirus a rendu la question d’autant plus urgente.
La logique des silos sectoriels et des mesures fiscales de redistribution est dépassée. Les économistes et les épidémiologistes, comme l’a fait remarquer la journaliste britannique Gillian Tett, appartiennent à des communautés distinctes, alors que « presque toutes les décisions importantes des démocraties modernes nécessitent cette analyse qui brise le cloisonnement 13 ». La convergence des disciplines devrait générer des synthèses innovantes et non des choix binaires. Aucun paradigme ne peut fonctionner sans des experts auxquels les gens s’en remettent, qu’il s’agisse des théologiens au XVIIe siècle, des philosophes au XVIIIe ou des économistes au XXe. Mais la pandémie a remis en question l’autorité des experts. Le port d’un masque pour empêcher la propagation du Covid-19 est ainsi devenu une forme d’expression politique dans certaines régions des États-Unis. Alors, quelles sont les expertises qui feront autorité au XXIe siècle ? En attendant la réponse, nous devons améliorer la conception de politiques et de services dans le cadre du paradigme qui existe, non pas parce qu’il fonctionne bien mais parce que nous n’en avons pas encore mis en place de meilleur.
L’histoire des changements de paradigme ne laisse pas de place au doute : ces changements se font par le biais de crises. Il n’existe pas de raccourcis faciles, indolores et peu coûteux. Un changement de paradigme – qui nous oblige à désapprendre des pratiques, des routines, des lignes directrices et des normes que nous pensions supérieures – est tout sauf linéaire et simple ; il peut très bien diviser des générations et des groupes sociaux, mettant ainsi à rude épreuve la cohésion sociale. Le prochain paradigme sera forgé dans ce creuset de pression et de stress. Nous devons être mieux préparés à l’endurer.
Cependant, malgré tout ce qu’elle a coûté en vies humaines et en déficits budgétaires, la pandémie de coronavirus n’a toutefois pas détruit le stock de capital physique ou humain dont dépend notre bien-être futur. Comme l’a fait remarquer Andy Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, dans un appel au soutien du secteur social, la crise a peut-être en fait renouvelé notre stock de capital social, qui est si essentiel à la réalisation de nos objectifs 14. Nous en aurons besoin.
Beaucoup dépendra de ce qui ressortira comme consensus sur nos plus grands espoirs et nos pires craintes, sur la fixation des priorités. Le prochain grand paradigme doit :
- réduire le niveau d’incertitude ;
- limiter les risques à un niveau tolérable ;
- générer la confiance dans les personnes et les institutions qui gouvernent légitimement et démocratiquement ;
- créer des repères largement partagés pour les comparaisons entre lieux et dans le temps, pour une vision cosmopolite de l’humanité.
Depuis la Renaissance, à plusieurs moments importants, l’Occident s’est réinventé en adoptant un nouveau paradigme qui a amorcé une période majeure de croissance et de développement, en partie en résolvant des problèmes que les gens considéraient comme insolubles et dangereux, en partie en créant des institutions et des cadres moraux qui permettent aux gens de travailler en coopération pour atteindre des objectifs majeurs et communs. Nous en sommes encore là, mais avec une différence importante : notre époque est multipolaire, nos problèmes sont globaux. Dans le passé, l’Occident pouvait agir seul et pour lui-même, et exporter son paradigme vers une grande partie du reste du monde. À présent, son génie stratégique pourrait bien être de développer un paradigme que suffisamment de pays et de personnes dans le monde accueilleront pour les bénéfices qu’il leur apportera.



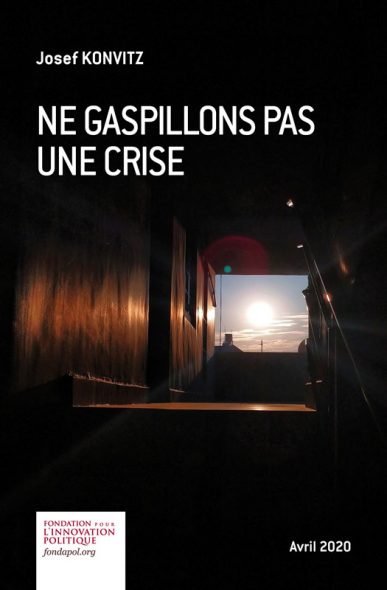

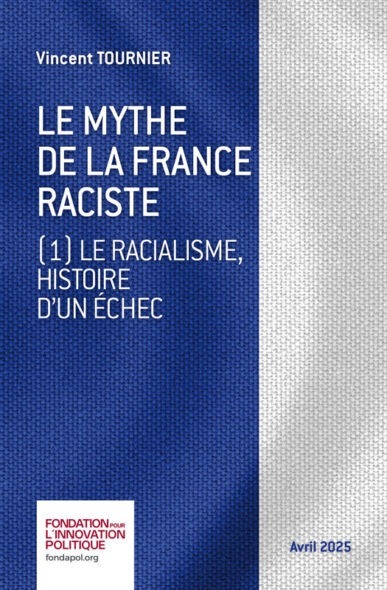









Aucun commentaire.