Projet d'entreprise : renouveler le capitalisme
Les entreprises peuvent jouer un rôle majeur dans la réponse aux défis auxquels est confrontée la société
L’entreprise doit changer pour survivre
L’entreprise prospère de demain procède d’un mode opératoire nouveau
Quelques fausses croyances auxquelles il faut renoncer
« Le profit est le seul but de l’entreprise »
« L’entreprise appartient aux actionnaires »
« Pour être vertueuse, une entreprise doit uniquement être prospère »
« La solution, c’est la transparence »
Des signes encourageants en faveur d’une réforme
Un nouveau modèle de création de valeur fondé sur les besoins sociétaux
Propositions pour une gouvernance efficace en lien avec les besoins sociétaux
Une gouvernance efficace nécessite d’abord une définition juste de l’entreprise
Placer la réalisation du projet d’entreprise au cœur de la gouvernance
l’ étape suivante est de dérouler ce projet d’entreprise
L’exercice des droits de vote par les actionnaires doit se conformer au pacte d’entreprise
L’information fournie à l’actionnaire doit changer
Une gouvernance vertueuse se préoccupera aussi de l’interaction entre le projet d’entreprise et son environnement
Deux bonnes raisons d’agir
Résumé
Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à la fois à un besoin impérieux et à une opportunité sans précédent de se renouveler. Il est largement admis qu’elles peuvent jouer un rôle prépondérant dans la recherche d’une croissance raisonnée génératrice de bien-être et de progrès. Si les entreprises ne relèvent pas ce challenge, il sera difficile de trouver quelqu’un d’autre pour le faire. Les États n’ont pas les ressources financières ni la flexibilité suffisantes ; la philanthropie et plus généralement l’économie sociale progressent mais n’ont en aucun cas le pouvoir des sociétés capitalistes. Par l’accélération du rythme de la révolution numérique et des avancées technologiques, l’entreprise est à même d’offrir des solutions nouvelles face aux défis climatiques, de santé, économiques et environnementaux.
La poursuite excessive d’une finalité simpliste – faire des profits pour les actionnaires – a isolé les entreprises et nourri la suspicion à leur égard.
Si, désormais, nombre d’entreprises s’en plaignent, pour autant elles ne se réforment pas. Le modèle hérité du passé, la finalité de l’entreprise et la gouvernance qu’ils véhiculent doivent être profondément repensés. Dans un environnement de plus en plus complexe, les entreprises prospères de demain seront celles qui adopteront une gouvernance souple qui favorise l’innovation, tout en analysant la contribution au bien-être, au travail et à la préservation des biens communs.
Sont exposées ici les conditions d’une telle gouvernance – redéfinition de la finalité, prépondérance du projet d’entreprise, responsabilité devant l’ensemble des parties prenantes –, tout en sauvegardant l’essence même de l’entreprise – délégation d’autorité au dirigeant et poursuite d’un profit mesuré comme condition de pérennité. Les propositions sont certes radicales mais elles remettront l’entreprise au service de la Société
Daniel Hurstel,
Avocat au Barreau de Paris, membre associé de l’Académie royale des sciences, des lettres & des beaux-arts de Belgique.
Cette déclaration a été tempérée lors du voyage du pape à New York au moment de son discours devant la session conjointe du congrès des États-unis, à Washington, le jeudi 24 septembre 2015, au cours de laquelle il a expliqué que l’activité d’entreprise est une vocation noble visant à produire de la richesse et à améliorer le il a aussi insisté sur l’importance d’encourager l’esprit d’entreprise.
Toujours du pape François, voir l’exhortation apostolique evangelii gaudium («la joie de l’Évangile»), du 24 novembre 2013, et la lettre encyclique laudato si’ («loué sois-tu»), de juin 2015
Voir Naomi Klein, tout peut capitalisme et changement climatique, actes sud, 2015.
Voir notamment Claire Régnier et al., «Mass extinction in poorly known taxa», Proceedings of the national academy of sciences, vol. 112, no 25, 23 juin 2015. Dans cet article, les auteurs estiment qu’au moins 7% de l’ensemble de la faune terrestre se serait éteinte sous l’action de l’homme depuis le début de la révolution industrielle
Voir Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, seuil, 2013
Sur ce point, voir l’intervention d’anand Giridharadas, « The thriving World, the Wilting World, & You », à l’aspen institute’s action Forum, le 29 juillet 2015
«Quand le capital est érigé en idole et commande toutes les options des êtres humains, quand l’avidité pour l’argent oriente tout le système socio-économique, cela ruine la société, condamne l’homme, le réduit en esclave, détruit la fraternité entre les hommes, oppose les peuples les uns aux autres et, comme nous le voyons, met même en danger notre maison commune.» Cette attaque est forte (excessive ?1), mais en fustigeant une nouvelle fois l’«inhumanité» du système capitaliste lors de sa tournée sud-américaine de l’été 2015, le pape François a exprimé, avec les mots de ses convictions et de sa foi, une critique du capitalisme qui gagne du terrain2. De manière générale, la critique a tendance à prendre de la vigueur en période de crise. Celle des marchés financiers de 2008-2009 a ouvert la voie à une critique d’autant plus véhémente qu’elle intervient dans un monde prenant conscience de problèmes graves, que ce soit à propos du climat3, de la biodiversité4 ou des inégalités5, voire même de la philanthropie6 quand elle est accusée de servir d’alibi à la poursuite de la pratique actuelle du capitalisme. La conviction que le système capitaliste, tel qu’il fonctionne aujourd’hui, n’assure pas une allocation des capitaux adaptée aux besoins de la Société (avec une majuscule, ce terme sera employé ici au sens de la cité, alors que «société», avec une minuscule, désignera le véhicule juridique de l’entreprise constituée sous forme de SA, SAS, SARL, etc.) et ne propose pas la gouvernance appropriée, est de plus en plus largement partagée alors que le scepticisme quant à la réelle création de valeur ajoutée par le capitalisme augmente. Si aucune attention sérieuse n’est donnée au besoin d’adapter le système capitaliste à son nouvel environnement, il existe un risque important de voir le système rejeté en totalité ou à tout le moins de voir les clivages actuels (ex. : Occupy Wall Street) se renforcer, et un risque encore plus important que les difficultés menaçant notre futur ne soient pas abordées de manière appropriée. Les lacunes actuelles du capitalisme sont à notre avis largement dues à une gouvernance inopportune, qui devrait refléter une attention approfondie quant à l’impact de l’activité de l’entreprise. L’idée développée ici est que la gouvernance doit être structurée à partir de la réalisation du projet d’entreprise, lequel doit en retour prévaloir sur les intérêts à court terme des actionnaires.
Un large consensus s’est formé sur l’idée que le court-termisme doit être abandonné. Ce consensus gagne même du terrain dans le secteur de la finance. Des acteurs importants attirent l’attention des conseils d’administration des sociétés dans lesquelles ils investissent sur la nécessité d’accorder une attention plus forte aux perspectives à long terme. Pendant plus de trente ans, le bon fonctionnement des marchés et l’intérêt de l’actionnaire ont primé à tort sur le développement du projet d’entreprise. Les actionnaires bénéficient légitimement de sa réalisation, mais ils ne devraient pas utiliser leur droit de contrôle (exprimé à travers les droits de vote) pour servir leur propre intérêt. Il ne s’agit pas de défavoriser l’actionnaire ou de compromettre la recherche du profit, car l’entreprise n’est pérenne que si elle génère du profit et une rémunération des actionnaires pour les risques encourus, mais une entreprise regroupe des intérêts particuliers divers : plutôt que d’établir une hiérarchie entre ces intérêts particuliers, l’entreprise doit tous les prendre en compte pour maximiser sa performance. Une entreprise doit être libérée de l’emprise d’une seule partie prenante.
Cela est d’autant plus important que nous sommes en période d’accélération du changement et d’accroissement de la complexité. La revue The Economist se demandait récemment si, comme l’Empire romain d’Auguste, l’«Empire capitaliste» allait bientôt disparaître. Empire ou non, il est en crise et souffre d’une perte de confiance sans précédent. Et l’affaire Volkswagen n’a rien arrangé ! Mais cet environnement difficile est tout aussi riche d’opportunités. Songeons seulement aux espaces nouveaux ouverts par la révolution du numérique et par celles qui leur font suite : nanotechnologies, nouvelles énergies, la robolution, intelligence artificielle, pour ne citer que ces exemples, renferment les promesses d’un potentiel inédit d’innovation, de progrès et de profit. Ce bouleversement du monde, dans tous les domaines, représente une occasion unique de faciliter et d’amplifier la capacité extraordinaire d’action positive des entreprises sur le bien-être de la Société. Si nous sommes de plus en plus conscients que les ressources traditionnelles sont limitées, nous réalisons également que notre connaissance du monde est, comme l’univers, toujours en expansion ! L’infiniment petit et l’infiniment grand nous offrent de larges territoires inexplorés que nous devrions être capables de conquérir (grâce notamment à la contribution de l’intelligence artificielle) pour le bien de tous.
Le début du xixe siècle s’est distingué par l’adoption de lois sur les sociétés dans plusieurs pays, lois qui répondaient à un besoin de développement économique ; la fin du xixe siècle, elle, s’est attachée à la protection des salariés, notamment par l’émergence de l’«économie sociale» et de nouvelles formes de sociétés comme la coopérative. C’est à présent un nouveau défi qu’il faut relever, mais rien de plus que ce qu’ont fait nos aïeux : adapter nos organisations entrepreneuriales aux besoins de la Société et à un monde aux ressources traditionnelles limitées. Ne soyons pas bloqués par ce que nous connaissons mais soyons capables d’imaginer et de mettre en place de nouvelles solutions ; nous devons concevoir ce qui est à portée de main !
Confrontées aux mêmes bouleversements, entreprises et Société sont plus que jamais liées. Pour que le lien devienne fructueux, il nous faut mettre au pilori les fausses croyances («les entreprises appartiennent à leurs actionnaires», etc.) qui ne correspondent plus à la réalité du monde d’aujourd’hui, imaginer les grandes lignes d’une gouvernance vertueuse, redéfinir l’exercice du rôle des actionnaires et, enfin, réaffirmer la contribution de l’entrepreneur puis celle des salariés de l’entreprise. Les propositions très concrètes avancées ici s’appuient sur la conviction que le capitalisme est un outil flexible, capable de s’adapter bien au-delà de ce que conçoivent les imaginations figées de ceux qui prétendent le défendre. Voyons d’abord quelles sont les principales attentes de la Société vis-à-vis des entreprises.
Les entreprises peuvent jouer un rôle majeur dans la réponse aux défis auxquels est confrontée la société
Voir Frédéric Baule, Xavier Becquey et cécile renouard, l’entreprise au défi du climat, les Éditions de l’atelier, 2015
Avec 3.600 milliards de dollars en 2014, le chiffre d’affaires des dix premières entreprises mondiales pèse autant que le PiB de la France et la Belgique réunies, et celui de Walmart (485 milliards de dollars en 2014) peut être comparé au PiB de la norvège (500 milliards de dollars en 2014) ou du venezuela (509 milliards de dollars en 2014), ou celui de toyota (248 milliards de dollars en 2014) au PiB grec (237 milliards de dollars en 2014).
Yuval Noah Harari, une brève histoire de l’humanité, albin michel, 2015.
Google mène actuellement des recherches dans plusieurs domaines scientifiques, notamment sur un système informatique qui fonctionne comme un cerveau humain, des lentilles de contact intelligentes pour les patients diabétiques, des maladies liées au vieillissement et à l’âge, des comprimés capables de détecter le cancer et les attaques cardiaques, le stockage du génome humain dans le cloud, la chirurgie robotique…
L’actualité nous rappelle en permanence l’ampleur des défis auxquels nos Sociétés sont confrontées : explosion démographique, bouleversement climatique7, épuisement progressif des ressources naturelles et de la biodiversité, montée des inégalités, domination des marchés financiers ou encore malaise de beaucoup trop d’individus au sein de l’entreprise… Comment ces défis interagissent-ils avec l’activité des entreprises ? Les entreprises sont-elles de quelque façon concernées ? La réponse est oui pour plusieurs raisons :
- parce que la puissance publique ne peut seule faire face à ces défis. Les États sont de plus en plus impécunieux. De plus, d’une part, les États ont perdu le pouvoir d’agir au niveau approprié face à des entreprises globales dont la puissance ne cesse de croître8, et, d’autre part, les États n’ont plus ni la souplesse, ni l’efficacité nécessaires pour élaborer des solutions adaptées à celles des problématiques qui doivent être réglées au niveau local ;
- parce que même ceux qui ne croient pas en la responsabilité positive d’une entreprise, les États étant seuls en charge de l’intérêt public, acceptent que les conséquences négatives de certaines activités (la pollution, par exemple) soient limitées dans la mesure du possible (ou, au minimum, que le profit généré soit évalué en fonction des conséquences négatives de leurs activités). L’intérêt des entreprises est d’agir par elles-mêmes plutôt que sous la contrainte des régulateurs ;
- parce que les entreprises ont un pouvoir sans précédent, comme le souligne par exemple l’historien israélien Yuval Noah Harari : «Nous sommes probablement à la veille de la plus grande révolution biologique de l’histoire de l’espèce humaine, une révolution dont les effets s’annoncent d’une ampleur si considérable sur l’homme qu’ils ne peuvent être laissés entre les mains des seules forces du marché9.» Selon lui, ce qui a toujours fait la spécificité de l’espèce humaine réside dans la capacité à fédérer des groupes autour de certaines «fictions», «mythes» ou «croyances», des religions aux droits de l’homme en passant par la nation et la société à responsabilité limitée. Les sociétés à responsabilité limitée sont parmi les inventions les plus ingénieuses de l’humanité mais elles existent seulement comme le fruit de notre imagination collective même si, habitués à leur présence, nous avons oublié ce trait. Alors qu’une entreprise humaine à ses débuts vivait ou disparaissait en fonction de son fondateur-propriétaire, la société moderne a une vie en soi grâce à notre foi collective dans la fiction des codes juridiques. Dès lors, l’historien nous invite à mobiliser cette «fiction» qu’est l’entreprise pour aligner ses intérêts sur ceux de la Société et pour contribuer à faire évoluer les rapports de force dans un sens favorable pour la préservation et si possible l’accroissement de notre bien commun ;
- parce que les progrès récents en matière scientifique et technologique et le fait que la recherche conduite par les entreprises ou en collaboration avec les laboratoires de recherche indépendants leur confère un accès voire un contrôle sur des produits influençant (et même modelant) des aspects fondamentaux de notre vie quotidienne et, parfois même, de notre vie intime. Les entreprises sont par conséquent placées face à des responsabilités éthiques tout à fait inédites. Les limites humaines auxquelles nous sommes habitués et qui caractérisent notre finitude sont remises en question et l’alliance de l’entreprise et de la science (les récents nouveaux domaines d’activité de Google en sont un exemple frappant10) fait qu’il serait dangereux pour l’humanité de laisser prospérer le modèle capitaliste dans son cadre actuel, c’est-à-dire sans une analyse précise de l’impact de son activité. Tout cela peut-il être soumis à la primauté des actionnaires ou même à la direction d’entreprises et échapper ainsi à une analyse approfondie de leur impact ? Si la Société a besoin de l’entreprise, celle-ci doit aussi évoluer pour des raisons qui lui sont propres afin d’assurer sa pérennité et de reconquérir sa légitimité.
L’entreprise doit changer pour survivre
Selon un rapport de s&P capital
Dans le sillage de toyota et mitsubishi, les firmes japonaises se sont lancées à leur tour dans des opérations de rachats en France, le mouvement n’a rien de comparable par son ampleur (les rachats devraient porter sur quelque 20 milliards d’euros en 2015 pour les sociétés du cac 40), mais il monte aussi en puissance : airbus, schneider, sanofi, Publicis ou vinci, entre autres, ont inscrit des opérations de rachat à leur programme annuel.
Il s’agit de l’obligation qui serait faite à l’entreprise de faire ses choix en fonction d’une maximisation de la valeur
Les sociétés d’investissement étaient en 2014 l’un des plus grands groupes d’investisseurs au sein de sociétés américaines, détenant 30% de leurs actions (investment company institute, 2015 investment company Fact Book) les hedge funds détiennent un niveau record de capital : 3,197 milliards de dollars au 30 novembre 2015
The Financial times, 8 mai 2014
Nous vivons la fin d’un cycle. Les business model traditionnels sont à bout de souffle. Ce constat peut être effectué grâce à une caractéristique nouvelle intéressante : les trésoreries pléthoriques de nombreuses grandes entreprises et leurs corollaires, les plans de rachat d’actions sont les symptômes de la coexistence de profits conséquents et de la réticence à lancer de nouveaux projets. Les versements totaux pour les dividendes et rachats d’actions des sociétés du S&P 500 ont augmenté d’environ 100% les dix dernières années, de 507 milliards de dollars en 2005 à 934 milliards en 201411. La tendance est générale12. Entre les rachats d’actions et les augmentations de dividendes, plus de 1.000 milliards13 devraient être versés aux actionnaires en 2015. Ces montants considérables proviennent de profits antérieurs ou de recettes de ventes et n’ont pas été réinvestis. Pourquoi ? Parce que beaucoup d’entreprises conçoivent moins de projets générant le niveau de profit attendu par les actionnaires. Face à un monde complexe qu’ils ne parviennent pas à déchiffrer, beaucoup de dirigeants hésitent sur la direction à prendre pour leur entreprise. Ils constituent des réserves de trésorerie afin d’être en mesure de saisir les opportunités d’acquisition. Tout cela démontre un vrai désarroi et une difficulté à bâtir des stratégies cohérentes qui répondent en même temps aux attentes à court terme des actionnaires, au désir de mener à bien le projet d’entreprise, à l’aléa lié à l’évolution du comportement du client ainsi qu’aux bouleversements technologiques à venir. Les critiques des rachats d’actions y voient – et ils ont parfois raison – la preuve de la mainmise des marchés et de la cupidité des actionnaires davantage préoccupés par leur enrichissement immédiat que par le développement de l’entreprise (particulièrement quand les budgets en matière de recherche et développement diminuent et que les rachats d’actions augmentent). Ils ajoutent que les dirigeants cautionnent, voire encouragent, ces rachats parce que leur mode de rémunération les y incite. Cela est peut-être vrai mais redonner de l’argent aux investisseurs pour qu’ils l’utilisent pour d’autres projets (notamment pour des projets qui seront identifiés ultérieurement par l’entreprise et pour lesquels il sera possible de recourir à des augmentations de capital) constitue-t-il une mauvaise décision ? Encore plus important que de porter un regard critique sur les rachats d’actions et de mettre les investisseurs «activistes» en accusation, il faut voir dans ce phénomène le signe d’une certaine perplexité des chefs d’entreprise qui ne peut que croître face aux récentes baisses rapides de la valorisation d’entreprises de hautes technologies et du Net. Les entreprises doivent se réinventer pour assurer leur avenir et leur pérennité, et trouver un emploi efficace de leur trésorerie. Dans cet environnement incertain où les modèles économiques sont réinventés, il est plus important que jamais pour les entreprises de se protéger contre les pressions court-termistes des marchés financiers. L’ampleur des dérives observées au cours des dernières années dans les entreprises soumises à la dictature de la shareholder value14 a amené à privilégier les intérêts financiers à court terme, au détriment de la mise en œuvre du projet d’entreprise. La réponse à ces dérives doit être élaborée avec précaution. Il est important de ne pas se concentrer sur un coupable, par exemple le secteur financier. Éloigner les épargnants du marché ou diminuer les liquidités offertes par les marchés, les banques ou les fonds de private equity ne constituerait pas un progrès. Certes, les marchés ont développé leur propre logique, largement déconnectée de la réalité des entreprises. Un exemple frappant est celui de la valorisation boursière de certaines entreprises innovantes. L’absence de corrélation avec l’actif sous-jacent est le ferment des bulles financières. Plus important, il est contestable que la logique du «marché» conduise les investisseurs à capter les pouvoirs qui leur sont conférés par la gouvernance actuelle de l’entreprise et les utilisent pour maximiser les valorisations, indépendamment de l’intérêt propre de l’entreprise. Les entreprises évoluent de sujets actifs à des objets passifs lorsqu’elles sont utilisées pour valoriser le patrimoine des investisseurs.
Ce n’était pas l’idée lorsque les lois et statuts ont accordé un contrôle aux actionnaires sur les sociétés. Une société possède l’entreprise et est créée (et la personnalité morale lui est conférée) afin de permettre la réalisation du projet d’entreprise, non pour améliorer l’efficacité des marchés. Attelons- nous donc à cette réforme du système plutôt qu’à la critique de celle de tel ou tel comportement individuel. Enron seul n’a pas davantage condamné le modèle anglo-saxon du capitalisme que Volkswagen n’a condamné le modèle rhénan. Plus grave que la cupidité de tel ou tel dirigeant, c’est l’isolement provoqué par la poursuite aveugle de tel objectif primaire qui suscite les déviations. La suprématie des actionnaires est exacerbée par le fait que les investisseurs institutionnels détiennent un montant sans précédent d’actions au sein d’entreprises majeures15 et sont généralement moins intéressés par le projet d’entreprise que par la performance des actions. Pour leur propre bien, ils devraient évoluer. L’actionnaire aurait tort de croire que le droit de vote lui est acquis pour toujours. L’écart est croissant entre la contribution des actionnaires à l’entreprise et les droits qu’ils détiennent sur elle. Les actionnaires feraient bien de s’intéresser davantage à l’entreprise et exercer leurs droits de vote plutôt que de se fier aux recommandations formelles des «proxy». À cette fin, les entreprises devront aussi fournir aux actionnaires des informations qui ne soient pas financières et portant sur les questions stratégiques. Personne n’est particulièrement responsable de la déviation actuelle, mais il est de notre devoir d’y trouver un remède.
Les fondateurs de grands acteurs de la Silicon Valley ont parfaitement compris le risque de l’interférence de l’actionnaire avec les projets entrepreneuriaux à long terme. Ils conservent le contrôle sur les projets d’entreprises et limitent fortement le pouvoir d’actionnaires tiers en se réservant des droits de vote multiples. Dans certains pays européens, la manière d’aboutir au même résultat est d’utiliser la forme de «société en commandite» qui déconnecte la détention du capital et les droits de vote. Certaines sociétés en commandite ont fait la preuve qu’elles étaient capables de protéger les objectifs de long terme de l’entreprise du court-termisme d’intérêts purement financiers. La nécessité d’une réforme gagne le cœur même du système. Ainsi, lors de la tentative de rachat par l’américain Pfizer du groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, au printemps 2014, Martin Wolf, l’un des éditorialistes les plus suivis de la City et des milieux d’affaires, s’était interrogé avec véhémence sur la validité d’un vote des actionnaires pris dans leur seul intérêt et sans considération pour ses conséquences pour les autres parties prenantes de l’entreprise16. Trouver un équilibre nouveau qui assure à la fois le développement du projet d’entreprise et la flexibilité des marchés de capitaux est possible mais pas dans le contexte actuel.
L’entreprise prospère de demain procède d’un mode opératoire nouveau
Le mouvement du care est intéressant à connaître, même s’il s’agit là d’un modèle non reproductible pour tout projet, sa raison d’être étant le souci de l’autre.
À cet égard, les entreprises peuvent même s’inspirer d’expériences conduites dans des domaines non lucratifs – par exemple, la fondation marocaine lalla salma qui s’approvisionne en médicaments contre le cancer de générations passées. leurs prix sont vite dégradés lors de la mise sur marchés de versions nouvelles, parfois sans caractéristiques essentielles, et peuvent ainsi soigner bien plus de ces expériences se rattachent à la notion de «sobriété», très en vogue dans certains cercles économistes.
Voir notamment les travaux de l’action tank entreprise et Pauvreté présidé par le Pr Muhammad Yunus, martin Hirsch et Emmanuel Faber
Michael Porter et mark r. Kramer, « creating shared value », Harvard Business review, vol. 89, no 1-2, janvier-février 2011, p. 62-77.
À l’ère du numérique, l’entreprise a besoin d’une gouvernance qui soit à l’écoute des besoins des consommateurs pour les transformer en autant d’opportunités de création de valeur et qui favorise l’innovation. La révolution numérique et son corollaire, la possibilité offerte au consommateur d’organiser lui-même son produit ou service en fonction de ses propres besoins, représentent un changement majeur qui bouleverse le fonctionnement des entreprises. Dans le même temps, la concurrence change de nature et évolue d’un accroissement de sa part de marché à la volonté de capter des ressources stratégiques, la multitude de consommateurs potentiels. Tout cela est possible en déployant autour des individus ce que Henri Verdier, directeur d’Etalab, la mission Open Data de Matignon, appelle une «boucle de valeur», où tout prend place dans un ensemble cohérent, entièrement pensé autour de la qualité de l’expérience utilisateur et où la valeur d’ensemble est difficile à segmenter.
Dans ce contexte, les opportunités offertes par le marché BoP (bottom of the pyramide), autrement dit le marché qui regroupe les consommateurs à faibles revenus (moins de 3.000 dollars par an), et son corollaire, la reverse innovation (innovation mise au point dans les pays en développement avant d’être diffusée dans les pays riches), représentent une piste prometteuse : vecteur de croissance pour les entreprises et contribution significative à la diminution de la pauvreté dans le monde qui est un des grands objectifs du millénaire pour le développement lancé par l’ONU. Ces marchés exigent des entreprises qu’elles évoluent d’un modèle de vente de produits ou de solutions à la création de véritables écosystèmes prenant en compte l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la distribution, ainsi que les capacités d’investissement des clients locaux, et visant à répondre à des besoins objectifs en matière de développement. Là encore, la gouvernance ne doit entraver ni la réalisation d’un projet guidé comme jamais auparavant par le besoin du consommateur17 et son environnement, ni la création de ce besoin par un marketing affiné et des nouveautés sans efficacité réelle18. Des entreprises ont, de la même manière et avec des projets variés – Crédit agricole ou Danone en particulier, avec Grameen Bank, Engie, Orange ou Essilor, Total (programme Awango de lampes solaires en Afrique), L’Oréal (programme de microdistribution de certains produits par des femmes des favelas de Rio, au Brésil) ou Lafarge (chaîne de livraison de béton prêt à l’emploi en Inde et de nouveaux liants pour les briques en terre en Afrique)…19 – ont développé des modèles d’entreprise spécifiques où le projet social, et non lucratif, guide leurs choix. Ces projets restent accessoires par rapport aux principales activités de ces entreprises et sont donc limités dans leur portée (ils sont également financés par des activités lucratives traditionnelles), mais ils démontrent que la reverse innovation et la fierté des employés de travailler sur un projet qui a du sens sont des réalités.
Ces expériences s’inscrivent dans une réflexion plus générale sur la manière pour l’entreprise d’appréhender les questions sociales. Cette notion est le thème des travaux de Michael Porter et Mark Kramer autour du concept de «valeur partagée». Dans un document publié dès 2011 dans la Harvard Business Review, les deux chercheurs défendent l’idée que, plutôt que de se laisser imposer une prise en compte de sa responsabilité sociale par l’extérieur
La gouvernance de l’entreprise doit tenir compte de ce changement qui souligne l’importance d’organisations horizontales et non verticales, et l’aptitude à s’adapter au changement croissant. Beaucoup d’employés jouent un rôle majeur et leur travail principal évolue de l’accomplissement d’une tâche déterminée vers l’imagination et la conception de produits innovants, et une coopération plus poussée avec des tiers (centres de recherches, start-up, sous-traitants, associations, ONG…). Ce nouveau modèle de gouvernance doit intégrer la nécessité d’associer au processus de décision les intérêts des différentes parties prenantes, dont l’importance est croissante.
La nouvelle organisation de la chaîne de valeur produit une autre conséquence : les entreprises ne sont plus responsables d’une activité économique verticale et intégrée. Beaucoup d’entre elles agissent comme des sous-contractants anonymes au sein de processus verticaux conçus par d’autres. La question du projet de cette entreprise est dès lors soulevée de manière complexe et nouvelle.
L’innovation permanente est stimulée par l’approche collaborative, comme les efforts de collaboration déployés entre les grandes entreprises et les start-up : veille technologique, participation à des incubateurs, organisation de hackathons, encouragement des entrepreneurs… C’est le temps de la collaboration, synonyme d’un brassage culturel et fécond permanent, générateur d’un nouvel écosystème pour chacune des parties prenantes. Une gouvernance orientée autour de la préservation de l’intérêt de l’actionnaire rend cette évolution très difficile, si elle ne l’empêche pas. La création de valeur économique ne peut être isolée de la création de valeur sociétale. (à commencer par les gouvernements), les entreprises doivent s’en emparer et voir dans les questions sociales des opportunités de profit, et ce dans une démarche de coopération active avec tous les acteurs20. Parallèlement, Bruno Roche, chef économiste d’un groupe alimentaire majeur, Joy F. Jakub, directeur de la recherche externe, et Colin Mayer, travaillent avec l’université d’Oxford sur l’«économie de mutualité» (economics of mutuality), une approche de l’entreprise où le partage de la valeur créée est en elle-même le critère des choix de gestion, avec l’évaluation se faisant non par le profit, comme chez Porter et Kramer, mais par les valeurs sociales et humaines générées par l’activité.
Tout salarié éprouve le besoin de donner du sens à son activité professionnelle. Les salariés découragés regagnent de la motivation quand ils travaillent au sein d’une organisation qui défend et applique des valeurs compatibles avec les leurs ; c’est une source d’efficacité et de compétitivité pour l’entreprise et, plus important encore, de satisfaction des salariés. Il ne s’agit pas ici de naïveté : la polémique récente autour des conditions de travail au sein d’Amazon montre que l’arbitrage entre les différents intérêts présents dans l’entreprise ne signifie pas qu’il faille tous les satisfaire.
Quelques fausses croyances auxquelles il faut renoncer
« Le profit est le seul but de l’entreprise »
Lettre encyclique laudato si’, op. cit.
Le but d’une société est le partage des bénéfices par l’actionnaire. C’est la première croyance – mais aussi réalité juridique – qu’il convient de clouer au pilori. Formulée il y a près de deux siècles, cette conception de l’entreprise était alors exacte et constituait même un progrès : démultiplier l’activité économique grâce au capital. Cela se faisait dans un monde aux ressources que l’on croyait alors illimitées. L’activité économique était considérée – et l’était vraiment, dans une certaine mesure – a priori bonne, les terres étant encore largement vierges. Cette approche ne correspond plus à notre réalité, et ce pour deux raisons principales : tout d’abord, dans un monde de ressources limitées, il est urgent de réévaluer en permanence le seuil d’acceptabilité de tout dommage susceptible de dégrader l’environnement ou d’accroître les inégalités (à ce titre, le lien que fait le pape François entre climat et pauvreté est nouveau21) ; ensuite, la création d’entreprise s’est largement affranchie de la détention de capitaux. Le terme de «capital social» n’a plus beaucoup de sens. Les rôles se sont inversés : à présent, les détenteurs de capitaux courtisent les entreprises. En forçant quelque peu le trait, on pourrait dire que les investisseurs sont devenus des fournisseurs. Ce ne sont plus eux qui apportent à l’entreprise les éléments les plus «précieux» (en plus de sa raison d’être : son projet) que sont son organisation, ses capacités d’innovation, ses actifs incorporels et, surtout, la confiance dont elle jouit (c’est-à-dire l’adhésion remportée parmi les employés, mais aussi, plus largement, parmi les parties prenantes et l’écosystème au sein duquel ses produits ou services sont utilisés). Ils sont développés d’abord par les fondateurs puis, selon un ordre qui diffère d’une entreprise à l’autre, par les salariés, les fournisseurs ou les sous-traitants.
À partir de là, le but de la société ne peut plus être le seul partage des bénéfices par les actionnaires, qui constitue seulement l’un des intérêts légitimes en jeu, il est plutôt de développer de manière profitable le projet d’entreprise, et ce en ligne avec les besoins sociétaux.
« L’entreprise appartient aux actionnaires »
Olivier Favereau et Baudoin roger, Penser l’entreprise. nouvel horizon du politique, Parole et silence, 2015
Une théorie résumée dans un article de Milton Friedman publié le 13 septembre 1970 dans le new York times magazine et intitulé « the social responsibility of business is to increase its profits » (« la responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits »).
Ils sont les mandataires de la société et non des actionnaires, ce qui signifie d’ailleurs qu’ils n’ont pas en réalité de mandants mais sont sous le risque de leur révocation par les actionnaires.
Lynn Stout, « the problem of corporate purpose », issues in Governance studies, no48, juin 2012
Quelque 36.000 milliards de dollars d’encours sous gestion en 2014 pour les seuls fonds de pension.
Dans les pays de l’ocde, les fonds de pension, fonds d’investissement et compagnies d’assurance ont augmenté le montant total de leurs actifs sous gestion de plus de 50% entre 2000 et 2011. les fonds d’investissement connaissent l’augmentation la plus importante puisque leurs fonds sous gestion ont augmenté de 121%. voir serdar Çelik et Mats isaksson, institutional investors and ownership engagement, oecd journal: Financial markets trends, vol. 2013/2, 2014
Alors que quelques fonds activistes géraient moins de 12 milliards de dollars en 2003, cette catégorie a augmenté ses fonds sous encours à plus de 112 milliards de dollars pour les hedge funds activistes (j.P. morgan, the activist tevolution, understanding and navigating a new World of Heightened investor scrutiny, janvier 2015
« Capitalism’s unlikely heroes », the economist, titre de la une du numéro du 7 février 2015
Voir à ce sujet William lazonick, « Profits without prosperity », Harvard Business review, vol. 92, no9, septembre 2014, 46-55.
Il est temps de remettre en cause l’idée encore largement répandue selon laquelle une entreprise «appartient» à ses actionnaires. Les actionnaires sont propriétaires des actions et, en contrepartie des fonds qu’ils ont mis à disposition de l’entreprise, ils obtiennent une rémunération via la distribution de dividendes et l’augmentation éventuelle de la valeur de leurs actions. Olivier Favereau, professeur de sciences économiques à l’université Paris- Ouest-Nanterre-La Défense, et une équipe de recherche multidisciplinaire du Collège des Bernardins, entre autres, ont entrepris de démonter cette contre- vérité et d’en expliciter toutes les conséquences négatives, voire destructrices, sur le mode de fonctionnement des entreprises22.
Cette conception a prospéré, rappelons-le, sur la base des idées de Milton Friedman puis de l’école de droit de Chicago et de la théorie du Law and Economics, initialement pour contrer les excès d’un capitalisme managérial (un risque qui ne doit jamais être sous-estimé) antérieur à une époque de relative rareté du capital. Pour l’économiste américain, il était indispensable de s’en tenir à une stricte répartition des tâches : la responsabilité de l’entreprise est de satisfaire l’intérêt de l’actionnaire23 et celle de l’État de veiller à l’intérêt général, et la théorie du ruissellement des richesses ferait le reste. Un peu plus sophistiquée, la théorie de l’agence, selon laquelle les dirigeants seraient au service des actionnaires dont ils sont les mandataires, est tout aussi erronée24. Autant de théories (fausses, bien sûr, en droit !) destinées en réalité à légitimer la prééminence totale des marchés et qui continuent encore aujourd’hui à nourrir les cursus des meilleures business schools, comme le souligne Lynn Stout, professeur de droit des affaires à la Cornell Law School25. La gouvernance d’entreprise et un certain nombre de produits juridico-financiers ont été conçus afin d’aligner les intérêts des actionnaires et ceux des dirigeants procèdent de la logique de la théorie de Law and Economics.
L’idée que l’entreprise « appartient » à ses actionnaires demeure en effet vivace et se trouve même renforcée par l’évolution des marchés de capitaux, qui consolide encore la place de l’actionnaire. Les grands organismes de gestion collective concentrent une part de plus en plus importante du capital des sociétés cotées26. Elles se doivent d’afficher les meilleures performances financières, surtout à court terme, car c’est d’elles que dépendent les choix de leurs clients27! Leur comportement d’actionnaire est en outre influencé par celui des «activistes», ces actionnaires qui acquièrent une participation dans une société cotée pour mettre la pression sur les dirigeants afin d’obtenir une inflexion de leur stratégie. En raison de la qualité de leurs performances, la catégorie plus large des hedge fund (qui inclut celle des investisseurs activistes) draine des ressources croissantes28 au détriment des investisseurs institutionnels traditionnels. Les comportements de ces «héros improbables du capitalisme29», et leurs succès fréquents renforcent encore l’idée que l’entreprise appartient aux actionnaires30 (ce qui est malheureusement souvent la base des combats activistes, même si parfois il ne s’agit que de l’exercice légitime de droits d’actionnaires). En droit, l’entreprise appartient à la société, et celle-ci étant une personne morale, n’appartient à personne.
Le seul qui pourrait tenter de parler de propriété est le fondateur, dans la mesure où il détient aussi le capital de l’entité formée pour mettre en œuvre son «projet». Son «héritier» est le dirigeant et non l’actionnaire.
« Pour être vertueuse, une entreprise doit uniquement être prospère »
Cela n’a pas toujours été le cas : dans les pays de common law où la personnalité morale a été octroyée par des chartes royales ou dans les pays de droit civil jusqu’à la seconde moitié du xixe siècle
Une autre idée reçue voudrait que si une entreprise est profitable, elle paie des factures, verse des salaires et paie l’impôt et, par conséquent, contribue au progrès social. C’est exact. Mais détruit-elle de la richesse en même temps ? Détruit-elle en même temps des biens communs ? En particulier les biens qu’une entreprise utilise pour produire ? Toute entreprise, quel que soit son but (sauf ceux illicites), a droit à la personnalité morale, c’est-à-dire le droit de détenir des biens, de passer des contrats, dès lors que ses créateurs se conforment à quelques obligations formelles (nombre d’actionnaires, capital social minimal, etc.). La personnalité morale est accordée sans considération pour l’incidence future de l’activité31. L’octroi de la personnalité morale et la responsabilité limitée des associés, qui sont des avantages majeurs, ne requièrent aucune contrepartie. Cette notion de contrepartie existait au xixe siècle quand s’est posée la question de la personnalité morale, mais elle s’est perdue au fil du temps. Nous avons créé une fiction mais en avons abandonné le contrôle. Ce nouveau contexte justifie pleinement une nouvelle approche du sujet.
« La solution, c’est la transparence »
Alain Supiot, la Gouvernance par les nombres, cours au collège de France (2012-2014), Fayard, 2015
Enfin, il faut faire un sort à l’obsession de la transparence. Aujourd’hui, faute de convictions, on pare la transparence et la précaution de toutes les vertus. Pour autant, l’initiative entrepreneuriale et son premier attribut, la délégation de pouvoir, nécessitent la confiance et l’acceptation du risque. Les dirigeants ont besoin de l’espace de liberté créé par la confiance pour gérer dans les meilleures conditions. La transparence est fille de la suspicion ! Et c’est aussi la mère de l’incertitude quand une information exhaustive est communiquée plutôt que traitée de manière appropriée (par exemple les documents financiers qui révèlent avec neutralité les possibles conflits d’intérêts). Pratiquée comme c’est le cas aujourd’hui, la transparence s’érige en une valeur alors qu’en réalité, elle permet le règne de la gouvernance par les nombres32, autrement dit la soumission du droit aux objectifs économiques ultralibéraux.
La transparence n’est qu’un moyen ; elle est en elle-même imparfaite car elle ne peut jamais être totale mais, plus important encore, elle est devenue une valeur par défaut. L’accumulation de moyens sans un but responsable ne permettra jamais de construire une Société juste.
Des signes encourageants en faveur d’une réforme
Lynn Stout, the shareholder value myth, Berrett-Koehler Publishers, 2012
Le moment est propice au changement ! Un peu partout dans le monde émergent des réflexions et des expérimentations destinées à dépasser les théories fondées sur la prééminence des actionnaires et de la shareholder value, une « idéologie » assez récente, pour reprendre la terminologie utilisée par Lynn Stout33.
Un nouveau modèle de création de valeur fondé sur les besoins sociétaux
On reste ébahi à lire le «volkswagen mission statement». mais la question de l’obligation réelle qu’est l’adoption d’une mission s’applique à toute entreprise qui en affiche une
En France, un créateur d’entreprise sur quatre n’est pas encore trentenaire, et leur nombre a triplé en dix ans, selon l’agence pour la création d’entreprises (aPce). chaque année, quelque 125.000 jeunes Français se lancent ainsi dans l’aventure. au royaume-uni et aux États-unis, une nouvelle entreprise est créée toutes les un nombre record de créations de petites entreprises a aussi été observé au royaume-uni : en 2015, il y avait environ 5,2 millions de petites entreprises, une augmentation de 760 000 sociétés depuis 2010. voir aussi l’enquête scenario 2012, menée par la Fondation pour l’innovation politique et le cabinet nomadéis, qui démontre qu’une majorité de 16-29 ans dans trente pays considère qu’il est possible de concilier progrès matériel et protection de l’environnement.
Outre les travaux de Michael Porter et Mark Kramer, de Bruno Roche et de son principe d’«économie de mutualité» (economics of mutuality) ou les projets BoP ou d’entreprises sociales, on a vu apparaître dans la communication des entreprises la notion de «mission». Ces missions, qui n’ont aucun fondement contractuel, sont ambitieuses et difficilement réfutables, et montrent la volonté de l’entreprise de donner une nouvelle image d’elle-même. Leur fragilité réside néanmoins dans le fait qu’elles ne créent aucune obligation spécifique pour leurs émetteurs et ne posent pas la question de leur interaction avec l’objectif de maximisation de la shareholder value qui leur est juridiquement assigné34. De même, la création de nouvelles structures juridiques, telles que les benefit corporations (« B Corp ») ou les multi purpose companies aux États-Unis, répond à ce besoin nouveau. Pour être B Corp (connues notamment grâce à Patagonia ou Ben & Jerry), les sociétés concernées doivent préciser dans leurs statuts, outre la poursuite du profit, une ou plusieurs finalités additionnelles qui procurent un avantage à une collectivité déterminée (et elles s’engagent à mesurer l’impact de leurs décisions).
Toutes ces expériences innovantes ne sont pas indifférentes aux nouvelles générations, de plus en plus séduites par l’idée de se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise. L’entreprenariat gagne partout du terrain (même dans des pays comme la France qui y était davantage réticente dans le passé)35.
Ce nouvel esprit souffle aussi, même s’il reste encore très ténu, à peine une brise, du côté des marchés financiers. Le niveau de l’action est-il bien le seul critère de comportement «rationnel» de l’actionnaire ? Outre les travaux de Lynn Stout déjà cités, on peut noter le développement de l’épargne solidaire, le débat autour du financement d’activités jugées néfastes ou encore l’approbation par des actionnaires «financiers» de projets financés par les réserves de l’entreprise, qui leur seraient à défaut destinés, tels que les fonds Danone Communities. On peut aussi parmi d’autres citer le cas de Yngve Slyngstad, en charge du fonds souverain de Norvège, le premier au monde, qui a demandé récemment que les conseils d’administration des sociétés dans lesquels il investit rendent compte de l’attention qu’ils portent aux questions de changement climatiques, de travail des enfants et de gestion de l’eau.
Propositions pour une gouvernance efficace en lien avec les besoins sociétaux
Une gouvernance efficace nécessite d’abord une définition juste de l’entreprise
Celle-ci est un lieu de rencontre de différents intérêts particuliers et collectifs en vue de conduire un projet d’entreprise (certains parlent d’un «nœud de contrats»). Elle n’est pas un simple moyen d’accroître le patrimoine des investisseurs (cela devrait être une conséquence seulement de leur activité). En d’autres termes, le dirigeant d’une entreprise n’est pas un gestionnaire de portefeuille pour investisseurs. Les parties prenantes délèguent à un dirigeant la responsabilité de conduire le projet d’entreprise et par conséquent d’arbitrer entre des intérêts divers. Un tel arbitrage est accessoire à sa mission principale qui est la promotion d’un projet qui dépasse l’addition de leurs intérêts individuels.
Placer la réalisation du projet d’entreprise au cœur de la gouvernance
Francis Mer, nouvelle entreprise et valeur humaine, Fondation pour l’innovation politique, avril 2015, 5.
Dans l’état actuel du droit, l’entreprise est oubliée au profit de la société. Cette dernière est le seul véhicule juridique qui régit l’organisation des pouvoirs au sein d’une entreprise (ou groupement d’entreprises).
L’entreprise ne devient une réalité économique que dès lors qu’elle produit. La société n’est au contraire qu’une construction, formidable certes, car elle permet à l’entreprise de se développer et d’agir, mais ce n’est qu’une construction. Je n’ai jamais rencontré d’entrepreneurs souhaitant constituer une société, j’ai rencontré des entrepreneurs qui voulaient monter un projet et qui avaient donc besoin de la forme juridique de société pour le faire !
Pour assurer la prééminence et la pérennité du projet d’entreprise, il convient de modifier la loi sur les sociétés dans un certain nombre de pays. Aucune nouvelle forme spécifique de société ne nécessite d’être créée. Dans les pays de droit civil, il est nécessaire de reformuler le projet d’entreprise. C’est aussi ce que recommande Francis Mer dans une contribution récente : «Cette refonte de l’entreprise sera facilitée par la modification du droit des sociétés afin de supprimer les excès actuels de la logique actionnariale36.»
Voici par exemple comment on pourrait formuler les articles 1832 et 1833 du Code civil. La rédaction actuelle de l’article 1832 («La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter») pourrait être amendée comme suit : «La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d’affecter des actifs, sous la forme d’apports en numéraire, en nature ou en industrie, à une entreprise économique en vue de développer un projet d’entreprise et de répartir le profit susceptible d’en résulter.» De même, l’article 1833 («Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés») pourrait être modifié comme suit : «Toute société doit avoir un projet d’entreprise licite et être gérée dans l’intérêt commun des associés et des tiers prenant part, en qualité de salariés, de collaborateurs, de donneurs de crédit, de fournisseurs, de clients ou autrement, au développement de l’entreprise qui doit être réalisé dans des conditions compatibles avec l’accroissement ou la préservation des biens communs.» Ainsi les lois doivent indiquer clairement que l’intérêt de l’actionnaire ne peut pas être le but de l’entreprise !
l’ étape suivante est de dérouler ce projet d’entreprise
Des liens rendus publics, par exemple, entre la « mission » affichée par l’entreprise et ses priorités réelles ou encore son fonctionnement et sa publicité – ou encore sur son attention aux écosystèmes touchés – seront les bienvenus.
Sur tous ces points, voir Daniel Hurstel, Homme, entreprises, société. restaurer la confiance, eyrolles, 2013
Voir par exemple Karl Polanyi, dans la Grande transformation (1944), qui identifie trois biens qui doivent être protégés des marchés : la terre, le travail et la Karl Polanyi insiste également sur la nécessité de «réencastrer» l’économie de marché dans la société.
Étant la pierre de touche de la société et sa raison d’être, il doit être formalisé et les statuts doivent s’y référer. Certains vont jusqu’à parler de le «constitutionnaliser». Il faudra préciser la manière dont le projet sera mené à bien (comment les produits sont conçus et la productivité justifiée, quel est l’impact sur les communautés affectées par l’activité…), et dont les divers intérêts des actionnaires seront exprimés et pris en compte. Le projet d’entreprise doit être doté d’une autorité qui protège l’entreprise de la pression mortifère du court terme, mais aussi les actionnaires contre un dirigeant qui utiliserait son pouvoir pour que l’entreprise serve son propre intérêt ou encore les parties prenantes contre une entreprise qui agirait abusivement contre eux. Il est proposé ici d’appeler ce document «pacte».
D’une finalité simple et unique (enrichir l’actionnaire), et donc facile à mesurer, mais non adapté à un monde complexe, nous évoluerons vers une finalité plus complexe à mesurer : réaliser un projet qui assure la préservation, voire l’amélioration des biens communs et s’efforce de bénéficier à toutes les parties prenantes. La complexité n’est pas un avantage en soi mais elle ne doit pas être niée ; il est en effet inévitable de prendre en compte les différents aspects des répercussions de l’entreprise dans le processus de prise de décision. Le pacte doit être rédigé avec précision, tout en laissant au dirigeant la marge de manœuvre suffisante pour arbitrer.
L’adoption du pacte doit satisfaire la nécessité d’une gouvernance d’entreprise qui ne nie pas la quête du profit mais la soumet à une finalité qui la dépasse : l’intérêt propre de l’entreprise confronté à celui de son environnement. Le pacte est la déclaration des acteurs quant à la finalité qu’ils poursuivent et aux moyens qu’ils se proposent de réunir pour la réaliser ou de ceux auxquels ils se refusent37 ! C’est l’image concrète de la manière dont l’entreprise va mettre en œuvre l’objet social. Tandis que l’organisation des pouvoirs des organes sociaux restera de la compétence des statuts, le pacte sera le réceptacle du projet et le guide des choix de l’entreprise. Il aura force juridique par la référence contenue dans les statuts. Rédigé initialement par les fondateurs, il sera adopté par l’assemblée générale mais aussi par le conseil d’administration, qui pour ce faire pourrait aussi regrouper des représentants d’autres parties prenantes. Une fois adopté, il guidera la prise de décision, notamment les arbitrages à faire par les dirigeants entre les différents intérêts en jeu38.
Le dialogue qui s’instaurera autour des mises à jour du pacte créera des temps réguliers de retrait par rapport au quotidien (exactement ce qui a manqué dans l’affaire Volkswagen malgré la codétermination ou chez Enron, pourtant appelé le champion de la corporate governance). Ces appréciations régulières seront salutaires pour éviter les pertes de sens commun si souvent dénoncées par de nombreux dirigeants… une fois partis à la retraite ! Le travail sur le pacte est un moyen de répondre à la question difficile et nouvelle mais essentielle de concilier la rapidité et l’efficacité possibles grâce aux technologies nouvelles et le diktat de l’instant imposé par les tendances du marché avec une réflexion continue sur le sens de ce que chacun fait.
Le pacte en lui-même n’est pas une garantie de moralité mais ouvre un espace pour que la morale s’épanouisse. Il agira également pour limiter l’efficacité primaire de la gouvernance d’entreprise en confrontant les activités mesurables en termes de profit à la conservation de ceux des biens qui ne devraient pas être sujets à l’économie de marché39.
L’exercice des droits de vote par les actionnaires doit se conformer au pacte d’entreprise
La propriété des actions, comme nous l’avons déjà précisé, peut être exercée par l’actionnaire en fonction de son intérêt propre. L’exercice du droit de vote, au contraire, doit être exercé pour promouvoir le projet d’entreprise. La responsabilité conférée par le droit de vote a été confiée aux actionnaires par les parties prenantes et d’autres choix d’allocataires de ce droit auraient pu être faits, et le seront d’ailleurs peut-être. En tant que responsabilité, le droit de vote doit s’exercer en conformité avec l’intérêt des constituants de cette responsabilité : l’entreprise et l’ensemble des parties prenantes.
Par ailleurs, et en sens inverse, la caractéristique fondamentale de l’entreprise étant la délégation de l’autorité au dirigeant, il est nécessaire de s’assurer que celui-ci ne détourne pas l’exercice du pouvoir à son profit. Si l’alignement d’intérêt dirigeants-actionnaires prôné par l’école de Chicago est infructueux, la monopolisation du pouvoir à l’avantage du dirigeant n’est pas préférable. Le contrôle sur sa décision est exercé par les actionnaires ; il ne s’agit donc pas d’un contrôle sur les conditions de l’administration des biens des actionnaires, mais d’un contrôle destiné à vérifier que les décisions prises par les dirigeants ont bien pris en compte les intérêts de l’ensemble des parties prenantes et le projet d’entreprise.
L’information fournie à l’actionnaire doit changer
L’information fournie par la société à ses actionnaires et au marché doit être adaptée pour permettre aux actionnaires de se prononcer sur les conditions de réalisation du projet d’entreprise. Les actionnaires exercent actuellement leurs droits de vote sur la base des résultats financiers et rapports annuels présentés à l’assemblée générale. Pendant les road shows, seule l’information financière est discutée. Les actionnaires votent sur des résultats passés et ne sont pas en position d’évaluer la réalisation du projet d’entreprise à long terme. Pour remédier à cette situation, le contenu de l’information doit être revu et l’accent doit être mis sur les conséquences que les décisions à court terme auront sur le projet à long terme de l’entreprise. Le respect du «pacte» doit aussi être décrit aux actionnaires.
Une gouvernance vertueuse se préoccupera aussi de l’interaction entre le projet d’entreprise et son environnement
Voir à ce sujet les travaux de lynn s. Paine, professeure à la Harvard Business school, notamment l’article « sustainability in the Boardroom », Harvard Business review, vol. 92, no 7-8, juillet-août 2014, p. 87-94, ou son ouvrage, corédigé avec joseph l. Bower et Herman B. leonard, capitalism at risk. rethinking the role of Business, Harvard Business review Press, 2011.
Quelle que soit la qualité du produit ou du service proposé, l’entreprise ne doit pas exercer une pression active ou passive abusive sur tout organisme concerné par ses activités. L’entreprise doit veiller à ce que son activité ne vienne pas dégrader les conditions de travail et de vie et contribue à la préservation de son environnement. La représentation des parties prenantes dans l’adoption du pacte mais aussi dans le contrôle de son respect est donc souhaitable. Parmi ces parties prenantes, il faut aussi inclure celles qui sont affectées par l’activité de l’entreprise sans forcément avoir de liens avec elle. La présence de représentants d’ONG pour certaines prises de décisions peut être appropriée. On peut concevoir un conseil d’administration étendu à partir d’une notion extensive des parties prenantes (à déterminer en fonction de l’activité de l’entreprise) pour certaines décisions40.
Deux bonnes raisons d’agir
Pour conclure, nous retiendrons deux bonnes raisons d’agir. Et d’agir rapidement. D’abord, tout simplement, par souci d’efficacité économique. La croissance s’essouffle, mais cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de place pour le progrès. Au contraire. Le plus pressant est de réduire l’impact négatif de l’activité des entreprises. Pour ce faire, il faut «désisoler» le profit des actionnaires des coûts imposés à la Société. Sommes-nous en train de créer de la valeur si nous détruisons en même temps les ressources matérielles, dégradons notre santé, l’environnement ou augmentons les inégalités ? Il est essentiel pour la compétitivité de nos économies de permettre l’invention de nouveaux modes de création de richesse afin de préserver notre bien-être et celui des générations futures. Toute entreprise qui agira dans cette direction, la seule possible, garantira sa profitabilité sur le long terme.
La seconde raison d’agir fait écho à une vision éthique qui nous ramène à la condition humaine. En usant de mots très forts (idole, avidité, esclave…), le pape François nous rappelle à quel point notre Société ressemble peu à ce que nous sommes en droit d’espérer. Mais a-t-il pour autant raison de placer les espoirs de renouveau entre les seules mains des pauvres et les instruments de l’économie sociale, et de renoncer à l’instrument formidable qu’est l’entreprise dans le système capitaliste ? Le débat est entre ceux qui estiment le capitalisme sans avenir car reposant sur l’intérêt égoïste et ceux qui continuent à croire dans la capacité d’innovation et de création de richesse d’un système qui repose sur le goût d’entreprendre et l’efficacité de la délégation au chef d’entreprise. Que les seconds se dépêchent d’agir. Ils ont les moyens de le faire et peuvent réintégrer un sens de la responsabilité dans le processus de décision de l’entreprise, en reconnaissant les limites de l’activité économique. Ces limites naissent par exemple lorsque l’activité de l’entreprise a une incidence sur les biens communs. Cette interconnexion entre les biens communs et l’intérêt privé est aussi le point où la solidarité peut compléter les activités centrées sur un profit mesurable.
Le capitalisme a les moyens de se réformer de l’intérieur et de devenir ce système économique compétitif et structurant qui prend soin de la «maison commune».



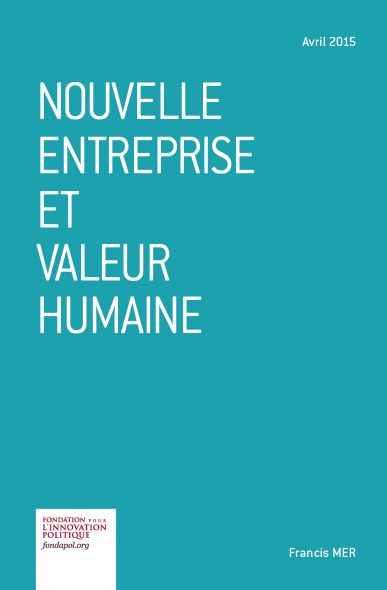











Aucun commentaire.