De la transition écologique à l'écologie administrée, une dérive politique
Introduction
L’organisation bureaucratique
La bureaucratie et les normes
Le coût de la bureaucratie
Bureaucratique et judiciarisation
La bureaucratie et le numérique
La bureaucratie et les libertés
La bureaucratie et les citoyens
Conclusion
Résumé
Devenue un objectif prioritaire en raison du dérèglement climatique, la transition écologique est conduite par une puissante bureaucratie. Si une très large majorité de citoyens adhère à un nouveau modèle de développement pour permettre cette transition, les moyens mobilisés, prenant l’habit de normes et d’interdictions, sont souvent éloignés des réalités locales.
Confiée à des « bureaucrates de l’écologie », eux-mêmes poussés par la radicalité d’un certain nombre de collapsologues, la transition écologique crée de fréquentes tensions chez ceux qui sont directement affectés par des régimes d’autorisation, de contrôle ou de surveillance de plus en plus stricts. La question de la légitimité de cette bureaucratisation de l’écologie, entre une régulation des consommations et la préservation des libertés individuelles, constitue le point de départ de cette réflexion.
David Lisnard,
Maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie.
Frédéric Masquelier,
Maire de Saint-Raphaël, avocat.
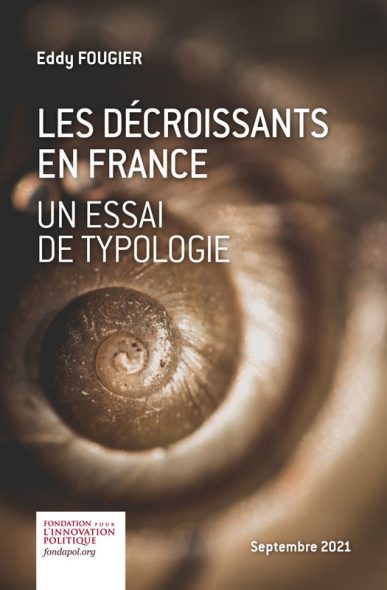
Les décroissants en France. Un essai de typologie

Les coûts de la transition écologique

Devrions-nous manger bio ?

Quel avenir pour l'agriculture et l'alimentation bio ?
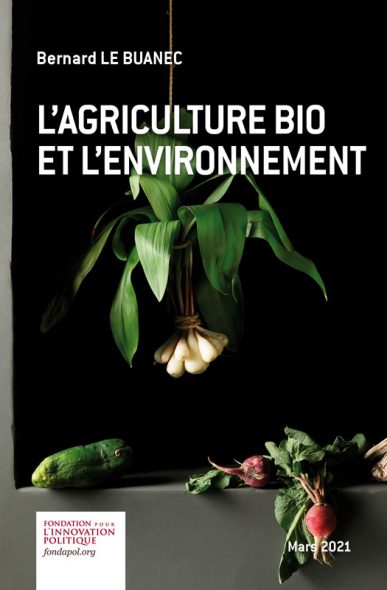
L'agriculture bio et l'environnement

Reconquérir la biodiversité, mais laquelle ?

Tsunami dans un verre d'eau

Les assureurs face au défi climatique

Glyphosate, le bon grain et l'ivraie

L'Affaire Séralini l'impasse d'une science militante
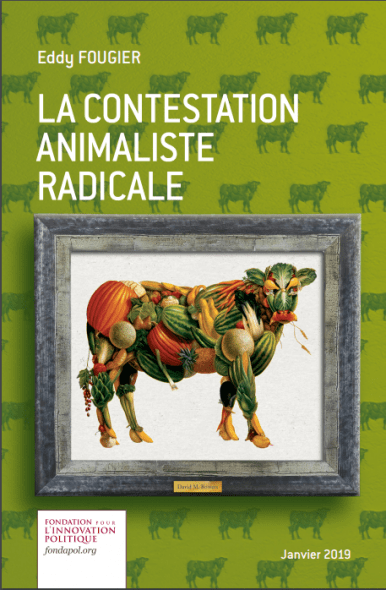
La contestation animaliste radicale

Villes et voitures : pour une réconciliation
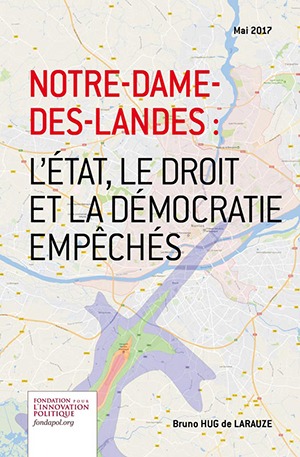
Notre-Dame-Des-Landes : L'État, Le Droit, La Démocratie empêchés

Good COP21, Bad COP21 (1) : le Kant européen et le Machiavel chinois
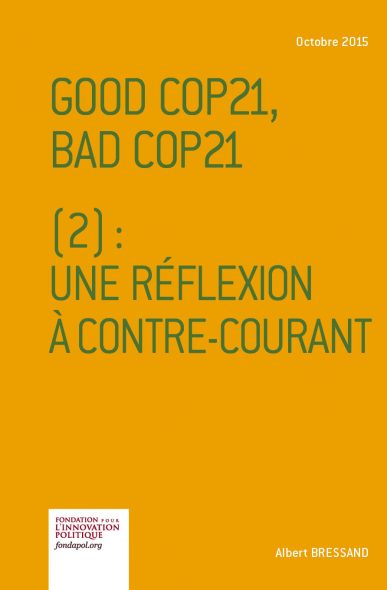
Good COP21, Bad COP21 (2) : une réflexion à contre-courant
Introduction
Voir le Sixième rapport d’évaluation du GIEC. « Le Résumé à l’intention des décideurs du rapport du Groupe de travail III du GIEC, Changement climatique 2022 : atténuation du changement climatique, a été approuvé le 4 avril 2022 par les 195 gouvernements Membres du GIEC ».
François-Guillaume Lorrain, «Robert Poujade, le ministre « de l’Impossible », est mort», Le Point, 8 septembre 2018.
Chantal Delsol, La Fin de la chrétienté, Paris, Cerf, 2021. L’avènement d’une religion de l’écologie est un thème qu’aborde également, mais différemment, en prenant le point de vue libéral et rationaliste, Ferghane Azihari dans Les Écologistes contre la modernité. Le procès de Prométhée (Paris, La Cité, 2021).
Discours de Greta Thunberg à la COP24 en Pologne, décembre 2018 : «Ce que nous espérons atteindre par cette conférence est de comprendre que nous sommes en face d’une menace existentielle. Ceci est la crise la plus grave que l’humanité ait jamais subie. Nous devons en prendre conscience tout d’abord et faire aussi vite que possible quelque chose pour arrêter les émissions et essayer de sauver ce que nous pouvons. »
Le xxe siècle a ouvert une ère de lutte contre les grandes idéologies totalitaires communistes et fascistes qui demeure au xxie siècle, tandis qu’il est devenu nécessaire d’engager aussi une lutte contre le réchauffement climatique. Après la dynamique des révolutions industrielles, le défi de notre époque est d’inventer de nouvelles façons de produire des biens, de se loger, de se nourrir, de consommer, de se déplacer et de se chauffer, sans émettre davantage de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère et sans, pour autant, renoncer aux bénéfices de la croissance. Les études montrent que 8 Français sur 10, sans doute marqués par la multiplication de catastrophes climatiques d’une rare intensité dans le monde, disent adhérer à la nécessité d’une transition écologique. Certains pays sont dramatiquement touchés comme le Bangladesh, le Pakistan ou les Maldives ; les pays de l’Afrique subsaharienne sont traversés par des épisodes de famines, l’accès à la ressource eau est annoncé comme le terreau de futurs conflits majeurs au Proche-Orient ; les catastrophes naturelles (incendies en Australie, ouragan Dorian en Amérique du Nord, typhons en Chine et au Japon, crues historiques dans le Midwest, feux de forêts en Californie…) sont la cause de plusieurs centaines de milliers de morts et de dégâts aux coûts colossaux. Tous les spécialistes le confirment : les conséquences du réchauffement climatique provoqueront prochainement de grands mouvements de populations qui engendreront des tensions extrêmes.
Pour tenter de répondre à ce défi, de nombreuses conférences internationales sont organisées et médiatisées pour affirmer une volonté commune de lutter contre les effets visibles du réchauffement climatique. En France, ces effets sont perceptibles lors de périodes de sécheresse soutenues et de violentes catastrophes naturelles, incendies ou inondations, qui émaillent l’actualité de plus en plus régulièrement. Depuis le Grenelle de l’environnement en 2007, les problématiques liées aux déplacements et aux transports, aggravées par les récentes tensions sur l’approvisionnement énergétique, font de la transition vers une société décarbonée une priorité des gouvernements et de la lutte contre le réchauffement de la planète un élément structurant de toute politique publique.
Lors de la Conférence de Paris sur les changements climatiques en 2015, dite COP21, la communauté internationale s’est fixé, pour la première fois, avec le renfort d’engagements juridiquement contraignants, l’objectif de limiter à 2°C la hausse des températures à l’échelle planétaire à l’horizon 2050. Cet objectif passe essentiellement par une diminution de la production de carbone résultant de l’activité humaine avec l’élimination des combustions fossiles, en premier lieu du charbon, montrées du doigt comme une des principales causes du réchauffement climatique. En d’autres termes, l’époque contemporaine vise à une approche rationalisée de la consommation en rompant avec une économie de l’abondance parce qu’elle favorise la production de biens à outrance partout sur la planète pour obtenir les meilleurs prix. Dans ce millénaire qui débute sur la crainte d’une raréfaction des ressources, le progrès est assimilé à « la sobriété », pour reprendre les termes du GIEC, lesquels ont été aussi repris récemment par le président de la République1. La question est donc moins celle de l’orientation des politiques publiques – presque tous les États y adhèrent – que celle des mesures à prendre, de leur ampleur, des calendriers et des moyens pour y parvenir. C’est dans ces circonstances que l’État et sa bureaucratie prennent place comme des acteurs majeurs de cette transformation.
Depuis le xixe siècle, la bureaucratie est en effet le support fidèle du camp de ceux qui se disent progressistes. Cette prise en main par l’État de la question écologique est en passe de se transformer en une prérogative régalienne qui a infiltré tous les corps de l’administration. Il semble loin le temps où Georges Pompidou disait au premier ministre de l’Environnement, Robert Poujade : « Vous n’aurez pas beaucoup de moyens. Vous aurez peu d’action directe sur les choses. Vous ne connaîtrez que très tard les résultats de votre action. »2 La politique écologique est désormais conduite par une administration puissante autour des deux ministères de la Transition écologique et de la Transition énergétique, eux-mêmes placés sous l’autorité d’une Première ministre chargée de la planification écologique. Comme dans de nombreux autres domaines, mais plus particulièrement ici, l’administration est devenue une bureaucratie, c’est-à-dire un système où l’appareil est prépondérant avec pour mission d’orienter les politiques publiques environnementales vers une logique unique de préservation, de protection et de conservatisme. Cette prise de pouvoir par les « bureaux » est un phénomène qui se situe dans la lignée des travaux du sociologue Max Weber, dont l’ouvrage Le Savant et le Politique fait toujours référence. Pour synthétiser sa pensée, face aux errances du pouvoir politique, jugé corrompu, instable et incompétent, le transfert du pouvoir aux bureaux est, selon ses partisans, la garantie de bénéficier des compétences de fonctionnaires choisis après un concours, dotés d’un statut de protection, dévoués à la mise en œuvre de mesures dites d’intérêt général. Pour accomplir cette mission, la bureaucratie se donne comme moyen le quadrillage réglementaire de toute la société avec un cadre dit rationnel aspirant à dégager l’intérêt général, ici l’intérêt écologique. Cette assimilation de l’action administrative à un objectif transcendant au nom d’un progrès linéaire explique en grande partie le refus de la bureaucratie de se remettre en cause et de faire évoluer sa doctrine. Ce serait le prix à payer pour un État sûr, à l’abri de l’arbitraire, tourné vers le bien commun.
Sans tomber dans la caricature, l’organisation bureaucratique se caractérise par un cloisonnement, une hiérarchie pressante, un devoir d’obéissance, des oukases, un langage spécifique, une tendance à l’immobilisme et une absence de responsabilité presque totale. La bureaucratie, lorsqu’un problème est posé, tend à mettre en place des règles élaborées sur les bases qu’elle connaît le mieux, c’est-à-dire des interdictions, des limitations et des sanctions, reproduisant ce modèle en de nombreuses circonstances. C’est ce que les Français vivent lorsqu’ils sont confrontés au millefeuille des redoutables administrations environnementales dont notre pays s’est doté.
Cette administration bureaucratisée n’intervient pas sans heurts. Alors que la lutte contre le réchauffement climatique devrait être consensuelle, sa traduction concrète crée des fractures entre l’État et les élus locaux, entre les administrations et les citoyens, entre le monde administratif et les entreprises. L’hyper-bureaucratisation des politiques écologiques conduit en effet à décourager l’initiative, voire l’innovation, en rendant toutes les actions complexes, longues, onéreuses. Son poids redoutable conduit de nombreux projets à la mort pure et simple. Ses injonctions sont vécues par une grande partie des citoyens, sans compter leurs représentants locaux, comme des diktats. C’est ainsi que, on le sait maintenant, le mouvement des Gilets jaunes est né de l’augmentation du coût du diesel, de la limitation de la vitesse sur les routes départementales et de l’application d’une taxe carbone. Les plus modestes se sentent particulièrement pénalisés par l’inflation des normes environnementales, d’autant qu’elle concerne directement la satisfaction de besoins primaires qui ont une part prépondérante dans leur budget. Alors qu’ils connaissent déjà des difficultés, on leur impose de nouvelles contraintes pour eux-mêmes et pour les générations futures. Ces clivages sont regrettables car les incidences du réchauffement climatique et des périodes de canicule sur l’agriculture, sur la gestion de l’eau potable, ou encore sur la santé devraient entraîner la participation de chaque citoyen.
L’objet de cette note est double : décrire une dérive bureaucratique qui étouffe de nombreuses initiatives, tant privées que publiques, et proposer d’agir de façon concrète et acceptable pour tous, avec mesure et bon sens. La tâche est ardue car vouloir toucher à la bureaucratie est un projet périlleux compte tenu de ce qui peut être considéré, selon la philosophe Chantal Delsol, comme une nouvelle religion3, voire comme la nouvelle religion d’État. Toute nuance de désaccord avec cette administration conduit, en effet, à être rangé immédiatement dans la catégorie des climatosceptiques, voire des complotistes ou des peu instruits. La polémique suscitée durant l’été 2022 par l’affaire du beluga échoué dans la Seine, dont le déplacement a mobilisé près de trente personnes, est une illustration du silence que l’on s’impose afin d’éviter des critiques pénibles. Bien entendu, il n’y a pas de contradictions entre sauver un « sympathique » mammifère et aider des enfants malades, pour reprendre le terme exact de la polémique, mais l’excès de moyens déployés pour cette cause traduit objectivement un conformisme de pensée où l’émotion prend le pas sur la raison. Un aperçu de cette théâtralisation nous a été donné avec l’émergence médiatique de Greta Thunberg, égérie des écologistes qui, hormis le caractère sans doute sincère de son engagement, n’était cependant qu’une adolescente diffusant de banales généralités sur la cause climatique4. Le débat est solidement cadenassé et la noble idée qui était au départ de protéger l’environnement s’est muée en idéologie.
Suivant un mouvement historique bien connu, la bureaucratie est devenue le bras armé de cette idéologie et des intérêts qui la soutiennent. La cause n’est pas désintéressée. La réalité montre qu’elle est soutenue, voire poussée discrètement, par de puissantes organisations associatives, financières, militantes et politiques. Comment remédier à cette situation qui a institué une « écolocratie » en France ? La seule solution efficace serait que le politique se réapproprie son pouvoir perdu. Le peut-il ? Le veut-il ?
L’organisation bureaucratique
Voir le site du ministère de la Transition écologique, « La méthode du Gouvernement sur la planification écologique», 21 octobre 2022.
L’omniprésence bureaucratique est la conséquence d’un modèle de structure centralisatrice, cloisonnée et sans responsabilité. Pour bien comprendre la logique, rappelons que l’autorité vient d’en haut selon un modèle de tuyaux d’orgues pour diffuser la bonne parole dans chaque échelon de l’État. Ce ne sont pas moins de trois ministères qui sont chargés de la politique écologique. Comme cela a été évoqué, sous l’autorité du Premier ministre, nous avons le ministère de la Transition écologique et celui de la Transition énergétique, avec leurs myriades de directions et de sous-directions qui couvrent la plupart des pans de l’activité humaine. En haut de la pyramide, les ministères sont solidement dirigés par des hauts fonctionnaires qui occupent une place déterminante avec des missions élargies, formant une tenaille bureaucratique qui se referme sur les ministres dont les membres de cabinets leur ont souvent été choisis et imposés. Ainsi, le politique n’est plus qu’une tête d’épingle, certes en haut de cette pyramide, mais avec des pouvoirs limités par des règles qu’il a lui-même acceptées. Il n’est que le chef théorique d’une machine qui lui échappe. Tout le fonctionnement de l’État est passé sous les fourches caudines de cette administration centrale qui inspire les projets de loi, rédige les ordonnances, les règlements, les circulaires, les arrêtés préfectoraux, nomme les directeurs régionaux ou départementaux… Même lorsque les textes sont issus d’un vote du Parlement, les hauts fonctionnaires y ont joué un rôle déterminant. Les textes issus des lois environnementales comportent, en effet, de nombreuses dispositions complexes inspirées par des experts qui déterminent ainsi les grandes orientations du pays en la matière. Ressuscitant un terme quasiment disparu depuis l’effondrement de l’Union soviétique, la France s’est lancée depuis 2022 dans la « planification » comme mode de gouvernance écologique5.
Mais que signifie planifier ? Et qu’est-ce que cela implique ? Dans le langage commun, cela conduit à l’organisation par les pouvoirs publics de la transition écologique qui sera élaborée, découpée, orientée dans le temps, budgétée en fonction d’impératifs planifiés. Au nom de la transition écologique, l’objectif de cette planification est d’uniformiser la société selon un modèle unique. Le but est clairement de contrôler les activités humaines selon une taxonomie fixant des cadres homogènes, sans intérêt pour l’esprit d’initiative et d’innovation, la géographie et le climat de chaque région. Un exemple prégnant est celui du renforcement des normes de constructions devenues identiques partout en France, avec une hyperdensification dans les villes, un refus de l’étalement urbain et le même type de mixité sociale. Or, chacun peut comprendre qu’une ville située en bord de mer et entourée par un massif naturel classé, ne répond pas aux mêmes critères qu’une ville située en Ile-de-France ou qu’une commune rurale du centre de la France. De surcroît, il ne faut pas oublier le critère humain. Il est à prendre en considération autrement que par une approche quasi marxiste de notre société de libre marché qui introduit dans l’inspiration de chaque norme le concept d’égalité, en dehors même de l’objectif initial de lutter contre le réchauffement climatique. Cette dérive de l’écologie vers les questions sociales, champ dans lequel se concentrent les zélateurs de l’égalité, conduit à une logique uniformisante voire déshumanisante de l’action administrative.
Un autre exemple de cette vision bureaucratique nous est donné à l’occasion des récentes prescriptions en matière de lutte contre les vagues de submersion marine, à l’appui d’études théoriques menées par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique. Ces prescriptions s’uniformisent et s’appliquent de manière similaire à tous les espaces littoraux, y compris ceux qui ne risquent rien d’autre qu’un bon nettoyage en cas de forte houle. Nul n’ignore la force de ce tropisme bureaucratique qui a pris progressivement la main sur les politiques locales, notamment, à travers les politiques de délivrance de subventions qui accompagnent les projets d’aménagement ou de constructions. Tous les appels à projets sont à présent subordonnés à des critères « écologiques » définis dans des bureaux sans véritable arbitrage politique. Sans un volet complet portant sur la transition, il n’y a pas d’aide, de sorte que les impératifs écologiques priment même parfois sur le projet.
Conséquence directe de ces contraintes : sur le plan local, seules les plus grandes collectivités sont capables de répondre à ce type d’appel à projets tandis que les plus petites en sont réduites à promouvoir une politique de communication et de gadget. Comme dans tous les phénomènes de bureaucratisation, le pouvoir des fonctionnaires du bas n’est pas à négliger dans les bureaux dédiés à la politique écologique. Ils disposent d’une très grande liberté dans l’interprétation des normes et dans la délivrance du sésame des autorisations. La tyrannie des minorités y est multiforme et vivace. Les réglementations sont si pointilleuses qu’il vaut mieux parfois connaître le fonctionnaire du bas de l’échelle que le ministre. L’adage selon lequel le diable se niche dans les détails s’applique ainsi plus que jamais aux sujets environnementaux. Une ambiance particulière règne dans ces bureaux entre les fonctionnaires ayant un parcours d’ingénieur, qui sont des interlocuteurs avec qui il est possible d’échanger, et les environnementalistes, fortement endoctrinés, qui s’imaginent en gardiens du temple.
Il n’est pas étonnant que le concept d’autorité soit plus diffus que dans d’autres ministères et que sous le ton de la confidence, ces derniers soient vus comme des électrons libres. Cela rappelle que la bureaucratie est arbitraire et que l’approche peut varier en fonction de l’interlocuteur. Personne ne semble s’insurger contre cet arbitraire. La hiérarchie se contente de constater son impuissance en se résignant à la passivité face au pouvoir des seconds couteaux. Personne n’ose contrarier une administration censée œuvrer pour sauver la planète. Ces aspects révèlent un monde à part dirigé par une administration lointaine, agissant en cercle fermé, usant d’un langage spécifique, abusant d’acronymes, se contentant de considérations générales, un monde souvent coupé des réalités et des citoyens qui ne comprennent pas les mesures qui leur sont imposées. En ce sens, le besoin d’une débureaucratisation des politiques environnementales s’impose manifestement. Il s’agit de remédier à cette situation problématique avec une plus grande proximité de terrain, à travers une véritable déconcentration et une décentralisation sur laquelle nous reviendrons.
La bureaucratie et les normes
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1).
Confier la conduite d’une politique à une administration bureaucratisée, c’est accepter que cette politique soit avant tout normative, c’est-à-dire globale et généralisante. La genèse des normes est souvent le monopole d’organisations internationales réputées pour leur fonctionnement exclusivement bureaucratique autour d’une pléthore de spécialistes et de conseillers en tous genres. Le politique n’y est au mieux qu’un modérateur au sein des discussions entre experts internationaux, créant encore davantage de distance entre deux mondes parallèles, l’un composé de décideurs, l’autre de récepteurs. L’administration française bureaucratisée ne fait pas mieux en incrémentant des lois complexes qui n’ont pas d’origine démocratique dans la mesure où elles n’ont pas été délibérées et décidées par le législateur élu. C’est ainsi que le code de l’environnement est devenu progressivement un des codes les plus lourds, comprenant plusieurs milliers de pages, réparties sur des centaines de chapitres et sous-chapitres. Ce code est passé de cent mille à un million de mots en l’espace de vingt ans, sans compter les mesures d’application que sa mise en œuvre implique. Mais en deçà des lois, l’empire des bureaux se crée aussi son activité en produisant des milliers de règlements et de circulaires techniques, ajoutant des alinéas, des conditions, des critères, des interstices, et en orientant l’application des textes en fonction d’une pensée administrée. Rien n’arrête cette boulimie de normes dès lors que les seuils de résilience écologique (niveau de pression que la nature est capable d’absorber) n’ont jamais été clairement définis et que tout est finalement objet de normalisation. Ainsi, chaque catastrophe climatique crée un contexte d’émotions et offre des opportunités à l’administration pour activer ou renforcer un arsenal de textes avec de nouvelles réglementations visant à établir des préventions renforcées selon un combat prométhéen où l’homme vaincrait la nature par la loi.
La technicité accrue des normes environnementales impose un recours systématique à des bureaux d’études comme préalable à l’action. La nécessité de commander des études ne peut en soi être contestée. En revanche, leur multiplication et leur degré de précision, ainsi que leur réitération créent un transfert de pouvoir aux techniciens et in fine à leur destinataire, c’est-à-dire la bureaucratie qui a le pouvoir de donner des suites à leurs conclusions. Presque tous les élus locaux se plaignent de l’abondance de ces études qui s’apparentent à un parcours du combattant.
Celui-ci comporte en premier lieu, l’incertitude qui pèse à chaque fois sur l’issue de ces procédures. Pour des travaux entraînant des conséquences sur l’environnement, la première démarche est d’en mesurer l’impact pour ensuite réduire les effets néfastes sur la biodiversité, voire les compenser par diverses prescriptions, y compris financières. Cet impact fait, en principe, l’objet d’une évaluation sur un cycle complet, voire sur plusieurs saisons, ce qui signifie que l’étude d’impact conduit à des années d’attente. En fonction des résultats, des mois supplémentaires seront nécessaires pour obtenir l’avis des administrations concernées sur la réalisation du projet. La nécessité de ces rapports interpelle parfois car la plupart des domaines étudiés sont connus. Le territoire français, sa faune, et sa biodiversité, sont déjà largement répertoriés, et certaines études sont de ce fait inutilement redondantes. Il est incompréhensible d’avoir à chaque fois l’impression de repartir à zéro comme s’il s’agissait d’appréhender un territoire vierge, et comme s’il fallait protéger le dernier spécimen d’une espèce en voie de disparition. En fonction des résultats, l’administration a un pouvoir, quasi discrétionnaire, de se prononcer sur la proportionnalité de l’atteinte à l’environnement. Certaines directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) n’hésitent pas, comme argument imparable, à entrer dans des considérations surprenantes comme la psychologie de l’animal ou dans des interrogations sur son stress éventuel pour imposer des prescriptions insurmontables. Cela pose la question de la pertinence de certaines pratiques dont la finalité est devenue imperceptible, voire franchement déconnectée de tout bon sens, pour ne pas dire abusive.
En second lieu, ce qui est à relier à la problématique précédente, les porteurs de projets consacrent des sommes considérables pour pouvoir passer sous les fourches caudines de l’administration sans aucune garantie de succès. Une fois le dossier validé vient l’étape ultime des mesures destinées à compenser la disparition de la biodiversité. Concrètement, en cas de réalisation, par exemple, d’une digue et d’un barrage, la compensation sera au moins proportionnée à l’étendue de la zone qui sera recouverte par l’eau retenue. Le coût et la durée de ces mesures conduisent la plupart du temps à l’abandon du projet. Il arrive que le coût de la compensation dépasse celui du projet, sur des durées pouvant aller jusqu’à cinquante ans.
Cette réalité est encore aggravée par le fait des injonctions contradictoires qui permettent aux bureaux de prendre, en toute légalité, des positions opposées sur un même dossier. En effet, en l’absence de hiérarchisation des positionnements entre des bureaux demeurant cloisonnés (DREAL, DDTM, ABF, etc.), le refus d’un bureau peut à lui seul bloquer un projet, ce qui confère une surpuissance à chacun d’eux.
Ainsi, un objectif prioritaire de production de logements peut être enterré au motif d’une atteinte à la biodiversité sans que l’on connaisse réellement les véritables points de tensions. Enlever quelques roseaux ou déplacer un lézard ne devrait pas être un obstacle à la construction de logements. Aucun texte ne fixe un tel degré d’exigence. Tout l’enjeu est de convaincre l’administrateur en charge du dossier.
Cette volonté d’hypercontrôle de la bureaucratie est telle que, bien souvent, elle ne parvient pas elle-même à suivre ses propres projets. En matière de plan de prévention des risques inondation ou incendie, il est impossible d’engager dans de nombreux départements des procédures de révision faute de personnel disponible dans les services de l’État. Une fois qu’un plan est arrêté, il n’y a donc pas de procédure de révision possible avant plusieurs décennies alors qu’en matière de sécurité incendie des progrès significatifs existent. Concrètement, cela signifie que des propriétaires sont lourdement pénalisés par des contraintes inutiles parce que les services de l’État manquent de temps. En matière de justice, on appellerait cela un déni de jugement.
En réalité, le conservatisme est un trait marquant de cette évolution bureaucratique comme l’illustre l’interdiction récente de construire sur les sols non aménagés, objectif pompeusement dénommé ZAN (zéro artificialisation nette), alors que cette interdiction pourrait susciter l’adhésion dans les zones urbaines à forte densification, quand y subsistent encore des espaces naturels désormais très précieux et sur lesquels plane la menace d’opérations immobilières qui ne feraient qu’accroître encore la bétonnisation et la densification6. La bureaucratie a reçu avec cette loi, et selon des critères opaques, le nouveau pouvoir exorbitant de déterminer les zones frappées d’inconstructibilité. La conséquence est que se décrète de manière dogmatique l’interdiction de créer de nouvelles zones d’activités économiques, de loisirs etc. sur des espaces non construits. Une autre conséquence est le surcoût du renchérissement d’un foncier plus rare. Ceci n’est pas pris en compte. Chacun sait que près de 80 % du territoire français n’est pas bâti et que la démographie est stable. Il serait ainsi préférable de détruire certains quartiers insalubres, bétonnés ou inadaptés à la vie sociale et créer des espaces verts ou de nouveaux lotissements correspondant à un mode de vie moins agressif et plus agréable. Tout ceci est la marque d’un système normatif coûteux laissant peu de place à l’humain.
Le coût de la bureaucratie
Léon Gueguen, Devrions-nous manger bio ?, Fondation pour l’innovation politique, mars 2021.
Philippe Bertrand, «Les distributeurs s’alarment du coût des contraintes environnementales», Les Échos, 14 février 2022.
Ibid.
Voir Bruno Hug de Larauze, Notre-Dame-des-Landes. L’État, le droit et la démocratie empêchés, Fondation pour l’innovation politique, mai 2017.
La transition écologique a évidemment un coût difficile à évaluer car derrière chaque norme se cache son propre coût. Ce qui est certain c’est que les coûts de la transition écologique se retrouvent à plusieurs niveaux : d’une part des coûts indirects avec le rallongement des procédures, l’incertitude sur les projets majeurs et d’autre part des coûts directs dans la phase de réalisation. Ainsi, l’accroissement des coûts de la construction ces dernières années s’explique largement par les normes supplémentaires imposées aux constructeurs. Plus les normes sont exigeantes, plus la facture augmente. L’évaluation du montant de la dette écologique dépend étroitement des objectifs écologiques retenus. Elle peut même donner lieu à réévaluation si les normes ou les objectifs sont modifiés. Ainsi, les normes européennes en vigueur jusqu’à la fin 2013 pour lutter contre la pollution atmosphérique impliquaient une dette écologique de très faible ampleur alors qu’il en va tout autrement pour celles qui sont proposées aujourd’hui.
Les normes écologiques couvrent non seulement les domaines de l’énergie, des transports ou de la construction, mais aussi la quasi-totalité de l’activité humaine : désamiantage, dépollution des sols, démantèlement de navires, dépollution de l’air… Même les menus des cantines scolaires sont scrutés à la loupe et établis selon des règles diététiques dont la validité n’a pas été prouvée7 de sorte qu’établir un cahier des charges respectant les dernières prescriptions implique de recourir à des bureaux spécialisés. Pour légitimer ces normes, on les présente comme une assurance pour nos sociétés contre les coûts de la répétition des catastrophes climatiques, des dégradations irréversibles des écosystèmes et des déplacements massifs de population. Précisons que de nombreux assureurs commencent à émettre de véritables réserves sur la prise en charge des sinistres liés aux catastrophes naturelles, multipliant les précautions pour contester le lien de causalité entre la sinistralité et la cause naturelle.
Outre son intervention dans ces domaines, l’écologie se targue de pouvoir créer des millions de nouveaux emplois. C’est ainsi que de nombreuses entreprises surgissent pour répondre aux exigences des normes les plus récentes, voire pour en proposer de nouvelles au motif d’une plus grande protection. Transfigurée en sujet économique, la norme devient alors légitime à tel point que les États s’y engouffrent pour créer de nouvelles formes de protectionnisme. Le coût pour les entreprises de toutes ces exigences formées dans le creuset de l’écologie administrée se passe d’une évaluation précise faute d’un consensus sur les critères à prendre en compte. Ce qui est certain c’est que tous les coûts se répercutent sur leurs bilans, et in fine, sur le pouvoir d’achat du consommateur. En effet, on sait maintenant que la construction de bornes de recharge pour véhicules électriques, d’ombrage pour les parkings, de fontaines à eau, de systèmes de récupération des emballages et d’économies d’énergie, répond à des règles en faveur du climat et nécessite de nombreux investissements pour les commerçants. Perifem, l’association technique qui les regroupe, les chiffre à près de 4 milliards d’euros. Cela représente 30% des 11 milliards d’investissements courants du secteur8. Au cours des Assises du commerce, tenues en décembre 2021, les distributeurs ont demandé l’aide de l’État, soulignant la nécessité pour eux de doubler leurs investissements afin d’affronter la transition climatique mais aussi la transition numérique. Selon Thierry Cotillard, président de Perifem, « D’une façon ou d’une autre, la hausse des investissements sera répercutée sur les prix aux consommateurs. Plus de 3 milliards, cela correspond à une inflation de 0,6 point »9.
Le débat s’enrichirait si l’on adoptait une approche rigoureuse qui permettrait de confronter les coûts des exigences écologiques avec leur impact réel sachant qu’il est difficile d’évaluer les dommages évités par une lutte efficace contre le réchauffement climatique au niveau d’une région, d’un département ou d’une commune. Du point de vue de l’évaluation macroéconomique, il est certain que confier à une administration bureaucratisée le soin de mener ces politiques n’est pas forcément un gage de bonne gestion. Il est communément constaté que l’administration peine à gérer sainement les deniers publics, d’autant plus que les gaspillages – pour ne pas dire la gabegie – sont principalement dus à des revirements de politiques publiques. Les exemples célèbres ne manquent pas, de Notre-Dame-des Landes10 aux portiques écotaxes sur les autoroutes…
Ajoutons que des politiques fiscales mal évaluées, dans des secteurs comme celui des énergies renouvelables, puissamment incitatives ont engendré des excès comme la prolifération de panneaux photovoltaïques sur les toitures de hangars dans certaines zones agricoles ou d’éoliennes au détriment de paysages que l’on voit profondément détériorés. On peut même parler d’une aversion administrative à l’égard des économies budgétaires qui sont souvent abordées avec une indifférence coupable. Le détachement est tel que de nombreux projets peuvent se retrouver, au nom du dogme environnemental, subordonnés à une condition d’absence de rentabilité économique ce qui conduit dès le départ à sa condamnation à mort. Tout cela ne peut s’expliquer que par une profonde défiance de la part de la bureaucratie à l’égard de la logique de marché dont elle est totalement coupée quand elle ne lui est pas hostile. A travers ces exemples, se joue un débat fondamental sur le clivage entre des normes de plus en plus restrictives et le bon sens inhérent à la vie quotidienne des Français, de surcroît dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat.
Bureaucratique et judiciarisation
Voir le site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique, « Loi climat et résilience : l’écologie dans nos vies », 20 juillet 2021.
Selon la Convention citoyenne pour le climat, « constitue un crime d’écocide, toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ».
Voir « Une loi climat invalidée par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe », rédigé par la Direction générale du Trésor, ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 5 mai 2021.
« L’affaire du siècle » est une opération menée par quatre associations et soutenue par des citoyens, des personnalités du milieu du spectacle, visant à attaquer l’État français en justice pour son insuffisance dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Autre avatar de la bureaucratisation, la judiciarisation de l’écologie. Elle mériterait une étude à elle seule. Le pouvoir judiciaire est le bras armé de la bureaucratie avec le pouvoir de contraindre et de punir. Plus une administration est bureaucratisée, plus ses relations avec la justice sont étroites. L’application de ses décisions par les tribunaux accroît le rôle des procédures et du droit dans la définition et la mise en œuvre des politiques écologiques, à tel point que des projets d’ampleur sont annulés pour des questions de pure procédure sans aucune incidence sur le fond des dossiers, ni aucun grief, et privilégiant même la mauvaise foi de certains requérants en jetant l’intérêt général aux oubliettes.
Nous affirmons que l’excès de bureaucratie a pour cause directe et pour conséquence immédiate une judiciarisation de la société. Les juridictions pénales rendent des décisions tous azimuts dans le domaine de l’écologie, lequel est défini par une circulaire du ministère de la Justice comme prioritaire. S’il est justifié de rendre compte à la justice d’atteintes volontaires à l’environnement, nous devons être plus circonspects s’agissant des poursuites pour violation des dispositions particulières d’un arrêté préfectoral ou pour l’absence de mise en œuvre des moyens nécessaires à la prévention d’une catastrophe naturelle dans des zones connues de tous comme étant à risques. Le spectre des fautes est relativement large. S’il est vrai que celles-ci restent la plupart du temps limitées à des hypothèses où la connaissance du risque est clairement avérée, il n’en reste pas moins que leurs auteurs sont soumis, quant aux poursuites, à la volonté du procureur de la République. La crainte suscitée par le risque d’une responsabilité pénale conduit, bis repetita, à prendre des mesures de protection excessives et fait alors entrer la prévention dans le régime de l’interdiction. Ainsi, si un maire ne veut pas être ennuyé, mieux vaut qu’il refuse un permis de construire ou d’aménager que de l’autoriser au risque d’être coupable d’une négligence ou d’une mise en danger de la vie d’autrui. Notons tout de même avec soulagement que la loi Climat et résilience11, si elle a créé un délit d’écocide, n’est pas allée jusqu’à la criminalisation de ce concept, ce qui permet de conserver une cohérence à notre système pénal. Personne n’aurait compris que les atteintes à la nature, aussi graves soient-elles, aient une équivalence avec les crimes commis sur les personnes. S’il avait été adopté, ce crime d’écocide12 aurait conduit à un changement épistémologique de la justice en mettant l’humain et la nature sur un pied d’égalité et en les dressant l’un contre l’autre.
Ce sont tous les pans de l’activité du pays qui sont soumis au contrôle de la justice au nom de l’« État de droit environnemental ». Tout d’abord, la justice administrative, principalement le Conseil d’État, crée des principes nouveaux qui posent un spectre contraignant sur les politiques menées. Il est à craindre que les injonctions, assorties de lourdes astreintes, se multiplient au cours des prochaines années pour privilégier les impératifs écologiques et conduisent de fait à imposer une hiérarchie dans le choix des politiques publiques. Le politique se retrouve ainsi sous une tutelle administrative qui lui enjoint de prioriser les politiques environnementales sur d’autres considérations telles que la sécurité, le logement ou l’éducation.
Dans le même ordre d’idée, le principe constitutionnel de précaution est un allié de poids pour la bureaucratie. Elle y trouve un puissant levier dogmatique pour s’opposer à chaque risque prévisible. En pratique, cela conduit à envisager tous les risques possibles et imaginables en anticipant, en posture de défense, celle du refus dès le stade de l’étude du moindre projet. A défaut de courage, ou si le projet est mineur, il y a de grandes chances que les projets audacieux soient rapidement abandonnés au regard de leur complexité, de leur longueur ou de leur coût. Ensuite, au sommet de l’ordre des juridictions, le Conseil constitutionnel s’est transformé avec le temps en Cour suprême. Au nom du respect de l’État de droit, ce n’est que timidement que les gouvernants ont, enfin, compris les dangers de cette évolution qui se concrétise par un véritable transfert de souveraineté au Conseil constitutionnel. Nombreuses sont les raisons de s’interroger sur le pouvoir pris par le Conseil constitutionnel d’émettre des réserves sur le caractère suffisamment ambitieux d’une loi. Et le domaine environnemental est au cœur de cette interpellation avec la portée de la Charte de l’environnement qui a pris une ampleur non soupçonnée lors de son adoption par le Parlement réuni en congrès.
Que dira-t-on quand demain, à l’instar de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui invalidait le texte de la loi climat allemande en avril 2021, il jugera nos lois par rapport à leur efficience pour lutter contre le réchauffement climatique ?13 Cette dérive au profit des bureaucrates et des juges est amplifiée par l’intervention de nouveaux acteurs privés s’érigeant en porte-parole de citoyens. C’est le cas de nombreuses associations écologistes spécialisées dans la protection de la faune ou de la biodiversité, redoutables plaideurs financés par l’argent du contribuable. Surveillant tous les projets publics d’ampleur, ces associations bénéficient d’une qualité pour agir sur tout le territoire national et deviennent les sentinelles de la judiciarisation permanente de l’action publique. Leur proximité avec les administrations en charge de l’écologie dans les ministères conduit à une alliance définitive aliénant l’expression de tout autre pouvoir concurrent, dont le pouvoir politique. Ces groupes de particuliers et d’associations, entraînés dans le mouvement de judiciarisation de la société sont encouragés à lancer des procédures. En témoigne « L’affaire du siècle », une action engagée par des associations contre l’État, remis en cause parce qu’il ne respecte pas les objectifs qu’il s’est fixés14. En somme, ces dérives de l’écologie administrée incitent à saisir toute occasion pour créer de l’adversité.
La bureaucratie et le numérique
Mathilde Golla, « 2023, année de la mise en place d’un quota carbone individuel ? », Les Échos, 6 janvier 2023.
Le numérique et l’intelligence artificielle offrent des outils performants pour piloter efficacement les politiques écologiques. Aidée par la miniaturisation des composants, le stockage des données, la vitesse des échanges, le perfectionnement des algorithmes, l’accélération du débit des réseaux, l’intelligence artificielle chamboule le monde bureaucratique et par conséquent sa déclinaison écologique. Il est certain que dans un premier temps, le numérique apporte des solutions pour améliorer la performance de services quotidiens. On songe immédiatement aux villes connectées, dites intelligentes – les fameuses Smart cities –, aux domaines de l’électricité ou de la gestion de l’eau potable avec un meilleur pilotage de la consommation des flux. On pense également aux politiques de sécurité publique qui connaissent de réelles avancées, comme la reconnaissance faciale qui s’imposera à l’entrée des stades lors des Jeux olympiques de 2024. Le bénéfice de cette gestion automatisée de la ressource procure des avantages indéniables en optimisant la gestion par des données chiffrées objectivement véritables.
Mais la bureaucratie a compris que le numérique, s’il augmente les performances et permet d’accélérer les processus, est aussi une aubaine pour promouvoir ses missions et ses prérogatives. Elle profite de la technologie numérique pour être omniprésente, exerçant ainsi au bout du compte un pouvoir encore plus grand qui porte en lui les germes d’une potentielle dictature techno-bureaucratique. La crise énergétique a montré que le numérique pouvait avoir son revers de médaille : un contrôle accru des consommations individuelles, et par voie de conséquence de la liberté du citoyen de choisir ses modes de consommation. On peut constater déjà que l’extinction des enseignes lumineuses dès la fermeture des magasins, la réduction de l’éclairage, voire une baisse de la température dans les magasins à 17° C sont des scénarios envisagés et pour lesquels le numérique constitue un outil privilégié de l’administration. Dans la sphère privée, il est facile, en effet, de savoir si un individu utilise sa climatisation, s’il a pris plusieurs douches ou s’il débranche ses appareils électroniques. Certains annoncent que la sanction pourrait aller jusqu’à de sévères amendes. D’autres évoquent la mise en place d’un permis à points, sous forme de QR code, qui pénaliserait le consommateur dont les achats dépasseraient 2,5 tonnes de carbone par an15. L’idée serait de sanctionner financièrement les consommateurs jugés peu respectueux de l’environnement. La frugalité devenant de ce fait une niche fiscale inédite. À l’instar d’autres secteurs comme l’éducation, la médecine, les impôts ou la sécurité, les nouvelles technologies donnent manifestement aux administrations une puissance inégalée susceptible de porter atteinte à des libertés essentielles.
Grâce au numérique, la bureaucratie peut ainsi être en mesure d’imposer des restrictions efficaces dans la vie quotidienne des habitants en fonction d’impératifs qu’elle aura définis, qu’ils soient écologiques ou d’une tout autre nature. Une telle technologie, si elle n’est pas parfaitement encadrée, peut faire craindre une collecte de grande ampleur de données personnelles grâce à la multifonctionnalité des téléphones ou aux modes de paiement bancaires et à l’examen des relevés de comptes avec un classement thématique des dépenses. Notre rapport à la liberté et à la sécurité de nos données sera donc un défi majeur dans les années à venir. Pour aborder cette dialectique entre écologie et liberté, le politique paraît mal à l’aise. D’un côté, l’écologie redonne du souffle à un discours politique épuisé, à la recherche de nouveaux combats pour se donner une posture progressiste courageuse. D’un autre côté, le politique doit se battre pour redonner de la vigueur aux partisans de la liberté qui sont inquiets face à la montée d’un totalitarisme écologique. Il est, en effet, insupportable de voir des pans entiers de la vie se retrouver cadenassés par des prescriptions réglementaires, certaines liberticides, sans réagir. C’est un combat à mener, inconfortable, et son issue est incertaine. La plupart des sondages ne révèlent-ils pas que l’exigence d’une politique environnementale ambitieuse est une des priorités des Français, notamment des plus jeunes ? Et bien entendu, c’est du pain béni pour une minorité active qui s’empare de cette question pour s’imposer comme porte-parole de la société.
Il devient impératif de faire entendre une voix discordante dans le concert unanime des restrictions et de mener le combat pour la liberté. Il impose de s’opposer fermement à cette approche dogmatique visant à ce que rien ne change, alors que d’autres considérations sur l’importance d’investir dans la qualité de vie devraient être prises en compte. Ainsi, les individus devraient avoir localement leur mot à dire car tous sont attachés à leur cadre de vie. Ils ont, pour préserver leur environnement, des représentants élus qui sont des interlocuteurs fiables.
La bureaucratie et les libertés
Voir le Sixième rapport d’évaluation du GIEC, ibid.
La lutte contre le réchauffement climatique doit-elle conduire à un régime strict d’interdiction, de punition et de sanction ? De manière générale, l’administration n’est pas faite pour encourager l’innovation, l’investissement ou promouvoir la science. Elle a principalement pour fonction de produire des règles, des procédures, des protocoles permettant d’appliquer des politiques publiques et de garantir l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Ces règles limitent bien évidemment les libertés individuelles. Mais pour garantir l’égalité de tous, faut-il nécessairement être ennemi des libertés ? Pour garantir l’État de droit, faut-il nécessairement punir et oublier l’humain ? Tout ceci interroge le rôle de l’État et de la bureaucratie pour qui la liberté – et l’humain – ne sont que des objectifs secondaires. L’égalité est un concept plus facile à manier que la liberté pour imposer une politique bureaucratique qui prenne en compte les intérêts de chacun.
Les bureaucrates s’arrogent ainsi le pouvoir d’orienter les comportements individuels, y compris dans la sphère privée, pour garantir une certaine idée de la nature. Le citoyen est, quant à lui, mis de côté, caricaturé en consommateur effréné responsable de l’épuisement des ressources naturelles et de la disparition de la biodiversité. L’introduction de l’écologie dans la sphère privée entre parfaitement dans les dernières préconisations du rapport du GIEC. Selon le groupe d’experts, les transformations ne doivent pas reposer sur des choix individuels, mais plutôt sur des choix politiques et structurels qui doivent tendre vers la sobriété, définie par le GIEC comme « un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d’éviter la demande d’énergie, de matériaux, de terres et d’eau tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète.16 » Dans ce rapport, il est question d’éviter les vols long-courrier, de changer les modes d’alimentation pour un régime à base de végétaux ou d’améliorer l’efficacité énergétique de son logement. On le voit, l’écologie a tendance à se confondre avec une lutte idéologique marquée par une forte radicalité, alimentée par un discours anxiogène, avec des arrière-pensées consistant à incriminer les propriétaires, grands ou petits, qu’ils aient un bateau privé ou une piscine. Il faut dire que les habitants des grandes villes plébiscitent les mesures visant à pénaliser les déplacements en voiture, à promouvoir les transports en commun, à favoriser une politique de vélos et de trottinettes, comme autant de signes qui suggèrent une campagne dans la ville et symbolisent le bien-être. Ces normes de comportements fracturent la société en distinguant des sous-ensembles de citoyens et de villes.
| Sécheresse : quand l’État choisit l’égalitarisme réglementaire au détriment des communes qui investissent
Durant l’été 2022, la France a connu un épisode de sécheresse sévère. Mais les arguments avancés pour justifier certaines interdictions ont été démagogiques et redoutables. Ainsi, quelques écologistes ont demandé la fermeture des douches publiques, notamment à Saint-Raphaël, ce qui représentait pour cette ville 2.100 m3 de consommation d’eau sur un mois par rapport à sa consommation mensuelle totale de 610.000 m3. Cette mesure était largement en deçà des enjeux de protection de la ressource sachant, de surcroît, que l’approvisionnement en eau était garanti par plusieurs sources. En fait, cette interdiction a été décidée au nom de l’égalité, des villages subissant des coupures d’eau pour cause de dépassement de débit autorisé. Les raisons de ces dépassements étaient dues à un sous-investissement chronique dans la consolidation des réseaux d’eau causant un taux de fuite de plus de 50% alors que la moyenne nationale est de 20%. Pour ne pas rompre l’égalité entre les villes du littoral et les villages, les restrictions se sont intensifiées comme pour démontrer que l’État assurait « la solidarité ». Pourtant la privation des uns n’a rien apporté aux autres, ce qui laisse penser que ces mesures n’avaient aucun sens dans la réalité et étaient uniquement démagogiques. La solution pour l’État a été à nouveau de type réglementaire alors que la bonne démarche aurait été de proposer un programme d’investissement, seule solution pour éviter que ces problèmes perdurent. |
Voir « Le parcours citoyen de l’élève », circulaire n° 2016-092 du 20-6-2016, Éducation nationale, 2016.
Rémi Barroux, « Transition écologique : le gouvernement lance la formation de ses hauts fonctionnaires », Le Monde, 12 octobre 2022.
Article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1).
Dans le domaine des déplacements, il y a à l’origine d’autres tensions, des interdictions orientant vers tel type de transport, et surtout sanctionnant les personnes qui achèteraient des véhicules polluants avec un système très pénalisant de bonus-malus. Ici encore un débat existe entre les métropoles, aménagées en fonction de déplacements urbains de masse, et les communes rurales ou de taille moyenne où l’usage de la voiture demeure indispensable. Pour arriver à faire accepter une telle évolution menant à une vision subsidiaire de la liberté, l’État est tenté d’orienter les objectifs de l’Éducation nationale et inscrit dans ses programmes l’implication des élèves « sur les enjeux liés à l’environnement (écodélégués, responsabilité des élevages, cultures…) » afin de les amener à un « comportement écocitoyen »17. De la même façon, la Première ministre, Élisabeth Borne, a mis en place une formation aux impératifs de la transition écologique pour les fonctionnaires et pour les ministres. Ainsi, quarante et un mille cadres issus des trois fonctions publiques devraient être formés d’ici à 2025 aux enjeux de la lutte contre le changement climatique18. Cette formation accélérée durerait vingt minutes. Il serait nécessaire de voir quel type d’intervenants sera proposé, afin de connaître l’orientation, et surtout le contenu de cette formation express.
L’écologie est un des rares domaines où une telle massification de l’éducation est proposée. Il n’y a pas de formation budgétaire, ni de formation en finances publiques ou en sécurité. Cela montre bien qu’au-delà de former, l’objectif est de « formater ». Il est d’ailleurs étonnant que ce projet ne suscite pas de vives réactions car les élus n’ont pas à recevoir une formation de l’État. Ils doivent l’organiser eux-mêmes et il existe des centres de formation dédiés à cela. Voilà donc le signe inquiétant d’une nouvelle étape de la bureaucratisation de la démocratie. Dans ce contexte, il n’y a rien d’étonnant à ce que la cause écologique cadenasse progressivement la liberté d’expression dans les médias. A chaque événement climatique, le même discours convenu inonde les réseaux médiatiques en montrant du doigt les coupables, en fustigeant les politiques menées, en appelant à une prise de conscience forcément générale, en créant de nouveaux cercles de réflexion sur les interdictions à mettre en place pour prévenir et limiter les risques au nom d’un hypothétique « bonheur pour tous ». Les médias et la bureaucratie écologique s’alimentent ainsi en vase clos, l’un renforçant le pouvoir de l’autre et vice versa. Peu de responsables politiques osent réellement s’opposer à ces interdictions dans la mesure où elles se sont imposées comme relevant du camp du bien. En ne les soutenant pas, l’homme politique se place, au choix, du côté de l’ignorant, de l’égoïste ou de l’immoral. L’expression d’une pensée simplement modérée n’est plus possible au royaume de la vérité bureaucratique, le contrevenant étant rapidement ostracisé dans le camp des « écolosceptiques ». Cette bureaucratie écologique produit in fine une autocensure conduisant à n’entendre qu’une pensée extrême. Pour plaire à cette bureaucratie, les entreprises adoptent elles-mêmes des chartes, des codes de déontologie et autres prescriptions pour faire figure de bons élèves. Il suffit d’examiner la communication des multinationales, et même le vocabulaire utilisé par leurs dirigeants autour des concepts de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou de développement durable, pour presque croire qu’il s’agit d’associations philanthropiques.
Avec la floraison, ces dernières années, de normes environnementales ISO 9001, 26000, 50001 ou encore 14001, les entreprises ont même le choix de leurs contraintes. Plus aucune d’elles ne peut se désintéresser de la question écologique. L’environnement est devenu, sans que cela ne suscite beaucoup de débats, l’un des objectifs des entreprises avec la réforme du code civil qui a mis les considérations environnementales sur un pied d’égalité avec le social ou la réalisation de bénéfices. Et les investisseurs institutionnels ont même l’obligation depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte de rendre compte à leurs souscripteurs de l’exposition aux risques climat de leur portefeuille et de la contribution à l’objectif climat19.
La bureaucratie et les citoyens
Bruno Hug de Larauze, Notre-Dame-des-Landes. L’État, le droit et la démocratie empêchés, Fondation pour l’innovation politique, mai 2017.
L’écologie doit se construire au plus près des citoyens qui sont, à l’évidence, les premiers concernés par la qualité de l’air, la protection des eaux et des sols, la qualité de l’habitat, la préservation des espèces animales et végétales. Ils sont les principaux bénéficiaires ou les premières victimes de la qualité de l’environnement. Il est normal qu’ils aspirent à vivre dans des villes remplies de beauté, de charme, d’humanité. Le lien entre protection de la nature et citoyenneté est évident. Penser la nature est le privilège de tous, ce droit n’a pas à être confisqué par une minorité de bureaucrates éloignés des réalités. L’incongruité est que les écologistes se proclament les meilleurs promoteurs de la démocratie participative à travers la consultation des citoyens. De grandes conférences sont mises en œuvre pour donner la parole à ces derniers. Des procédures de concertation et d’enquête publiques sont censées récolter leur avis. Des référendums sont même organisés pour connaître leur position face à de grands projets comme celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Or, in fine, rien n’est pris en considération. L’impression générale demeure que l’avis des citoyens n’est pas suivi. Ils ont le sentiment que leur opinion ne compte pas alors qu’ils subissent de plein fouet les mesures prises dans le huis clos des bureaux. Contrairement à une pensée convenue, ils sont assez peu associés aux décisions publiques ce qui a pour effet logique de les éloigner davantage encore de la politique qui en est rendue responsable. Pour reprendre l’exemple de Notre-Dame-des-Landes, malgré un référendum se prononçant pour la réalisation du projet, le gouvernement y a renoncé afin de ne pas contrarier des zadistes qui avaient investi le site, et qui demeurent, aujourd’hui encore, occupants sans droit ni titre de terrains expropriés20.
Comme les élus, les citoyens souhaitent que leurs procédures administratives soient accélérées d’où le besoin d’un renfort de décentralisation et de déconcentration pour revenir au terrain. La véritable participation citoyenne, gage d’une politique efficace, consiste à demander l’avis à la personne qui est directement impactée par la mesure, en fixant un ordre de priorité. Les citoyens ont la désagréable impression que la bureaucratie agit contre eux, et non pour eux, et plus encore que les procédures sont des moyens commodes, voire détournés, pour s’opposer à un projet. Cela s’explique largement par l’absence de transparence du débat public, limité au partage d’un constat, mais insignifiant sur le terrain des objectifs et des moyens d’y parvenir. Or, l’avenir va nécessiter des arbitrages majeurs sur des questions fondamentales. Qu’il s’agisse de la construction des villes, du choix des déplacements ou encore de l’agriculture et de l’alimentation, les modes de consommation vont évoluer et de nouvelles habitudes vont s’imposer. Ce sont les échanges, facteurs de croissance et à l’origine du développement des villes et des pays, qui seront à repenser. Il est de ce fait regrettable que ces choix soient laissés aux mains d’une administration craintive, autocentrée sur ses prérogatives et ses intérêts, incapable de faire naître un sentiment de puissance et de confiance, ciment indispensable à la cohésion nationale.
La décentralisation n’est pas une vaine action. Elle signifie la garantie d’une politique de proximité menée par des personnes responsables car révocables lors des élections. Les initiatives locales, certaines menées avec les services déconcentrés de l’État comme l’agence de l’eau, sont des exemples de réussite. On obtient de très bons résultats dans le domaine des dispositifs d’alerte avec des mécanismes de prévention efficaces ou dans celui des restrictions à la construction dans les zones inondables, dans l’entretien des cours d’eau et des vallons ou encore avec la désimperméabilisation des sols. Ces initiatives constituent autant de mesures de lutte contre le réchauffement climatique. D’autres actions de sensibilisation sont mises en œuvre avec le tissu associatif comme le nettoyage des espaces sensibles, le tri des déchets, la protection de la biodiversité et bien d’autres. C’est pourquoi pour mener une politique publique de réelle portée écologique, il est impératif de faire confiance aux acteurs de terrain, les seuls à même de mobiliser les énergies utiles pour opérer une transition acceptée par tous.
Conclusion
Force est de constater que la bureaucratie s’est emparée de la cause écologique. L’appareil d’État y trouve même un second souffle à l’heure où son omniprésence est critiquée pour sa lourdeur, ses contraintes et son coût. Pour ceux qui se sont donné pour mission de sauver la planète, l’écologie est devenue une nouvelle idéologie dans laquelle se retrouvent un certain nombre d’opposants traditionnels à la liberté, largement issus de l’extrême gauche, pour combattre leurs ennemis habituels, à savoir les entreprises, les propriétaires, ceux qu’ils estiment être des privilégiés ainsi que les représentants démocratiquement élus. Ces représentants de l’écologie ont infiltré l’administration et veillent à ce que leurs directives soient bien appliquées selon leurs objectifs propres, sans nuance ni remise en question.
Personne ne semble se demander ce qui est aujourd’hui supportable en termes d’effort pour un pays vieillissant, lourdement endetté, dont la dépense publique et les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde, et la croissance économique en moyenne inférieure à 1,5% depuis plus de dix ans. Or, la solution passe par des investissements puissants et multiples, une décentralisation plus forte, la mise en œuvre du principe de subsidiarité, une réelle déconcentration et l’implication permanente des citoyens dans les décisions qui les concernent. La capacité à faire confiance à l’échelon local sera la clef de la réussite ou de l’échec de la grande transformation écologique de notre société.













Aucun commentaire.