Défendre l'autonomie du savoir
Introduction
Définir l’autonomie de la science
Nécessité de l’autonomie de la science
Les moyens de l’autonomie
Garanties institutionnelles
Garanties organisationnelles
Garanties intellectuelles
Garanties juridiques
Menaces externes
Pressions religieuses et politiques
Pressions économiques
Interférences des réseaux sociaux
Menaces internes
Atteintes institutionnelles
Atteintes organisationnelles
La confusion des arènes
Les méfaits des convictions idéologiques
Les méfaits du postmodernisme
Les méfaits du wokisme
Parades
Clarifier la notion de la « liberté académique »
Quelques mesures
Conclusion
Résumé
La science ne peut se développer sans respect de son autonomie, c’est-à-dire sans indépendance par rapport à des pouvoirs extérieurs et sans conscience de la spécificité de ses enjeux et de son fonctionnement. Or cette autonomie tend à être de plus en plus menacée, non seulement par des pressions provenant du monde social (notamment économique) mais aussi, de l’intérieur, par la pénétration d’idéologies cultivant la porosité des frontières entre le savoir et l’opinion, entre la vérité scientifique et la croyance, ainsi qu’entre la conviction politique et la mission de production et de transmission des connaissances.
La présente note propose un rappel des principes et des garanties qui fondent l’autonomie de la science, un état des lieux du mouvement régressif qui l’affecte et, pour finir, quelques propositions pour y remédier, de façon à préserver ce bien commun qu’est le savoir.
Nathalie Heinich,
Directeur de recherche en sociologie (classe exceptionnelle) au CNRS, membre du Centre de recherches sur les arts et le langage (Cral) de l’École des hautes études en sciences sociales.
Introduction
Il est des valeurs qui, telle la démocratie, paraissent installées une fois pour toutes dans le paysage politique, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’elles sont en train de se déliter, voire qu’elles appartiennent déjà au passé. Il en va de même de l’autonomie de la science, menacée aujourd’hui non seulement en tant que pratique effective mais aussi en tant que valeur. Or c’est elle qui garantit la validité de ce que produit l’activité scientifique, c’est-à-dire le savoir. Et le savoir est un bien commun, qu’il faut préserver et favoriser. C’est pourquoi il importe de prendre conscience de ces nouvelles menaces et de se donner les moyens de les contrer.
Après une définition succincte de la notion d’autonomie de la science, nous en argumenterons la nécessité, puis nous en préciserons les moyens, avant de décrire les principales menaces qui pèsent actuellement sur elle, et de proposer pour finir quelques pistes pour y remédier.
Définir l’autonomie de la science
C’est ce qu’on nomme l’« autotélisme » des valeurs. Sur ce thème, voir Nathalie Heinich, Des valeurs. Une approche sociologique, Gallimard, 2017.
Pierre Bourdieu en a fait un élément fondamental de description de l’évolution du « champ » artistique (voir Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, 2e éd., 1998, ainsi que Esteban Buch, « L’autonomie », in Nathalie Heinich, Jean-Marie Schaeffer et Carole Talon-Hugon (dir.), Par-delà le beau et le laid. Les valeurs de l’art, PUR, 2014, p. 23-32).
L’autonomie de la science consiste avant tout en l’indépendance des recherches menées en son nom à l’égard d’injonctions venant d’autres domaines ou champs d’activité : pouvoirs religieux, politiques, économiques… Mais elle signifie également l’indépendance non plus par rapport à des instances extérieures mais aussi envers des idéologies professées au sein même du monde scientifique et qui influencent la production et la transmission des connaissances en les éloignant de la visée d’objectivité et de vérité qui est au fondement de l’activité scientifique.
Cette dernière caractéristique – la visée de l’activité – relève d’un impératif non plus d’indépendance mais de spécificité : c’est le fait de se donner la connaissance comme fin en soi qui définit le cadre de l’activité scientifique, à la différence par exemple d’une visée de progrès technique – qui peut découler des découvertes de la science, mais ne les justifie ni ne les motive nécessairement – ou d’une visée d’amélioration morale ou politique de la société.
La prise en compte de la visée de l’activité scientifique, et non plus seulement de ses conditions effectives, permet de mettre en évidence la nature duelle de l’autonomie de la science. Elle apparaît en effet non seulement comme une réalité factuelle, observable, mais aussi comme une valeur à faire advenir : être à soi-même sa propre fin est ce qui définit une valeur1. C’est dire que l’autonomie peut souffrir tant d’obstacles à sa réalisation effective, sur le plan de la réalité (comme en ont témoigné récemment des révélations sur la manipulation des données scientifiques au profit d’industries cherchant à éviter l’interdiction de leurs produits), que de contestations de sa nécessité, sur le plan des valeurs (par exemple lorsque des convictions idéologiques ou des objectifs militants sont présentés comme des visées légitimes pour des chercheurs).
Enfin, cette autonomie ne relève pas d’une dichotomie, de type ou bien/ou bien, entre une science qui serait autonome et une science qui ne le serait pas, mais plutôt d’une gradation sur l’axe du plus au moins d’autonomie : celle-ci est donc toujours relative. C’est pourquoi le concept d’autonomie tel qu’il a été introduit en sociologie doit s’entendre plutôt comme un moment dans un processus d’autonomisation2 : l’autonomie de la science, toujours plus ou moins accomplie, est à penser comme un fait non pas absolu mais relatif, en même temps que comme une valeur plus ou moins partagée.
Indépendance et spécificité de l’activité scientifique, considérées à la fois comme un fait et comme une valeur, et dans une perspective non pas statique mais dynamique : voilà comment on peut définir utilement l’autonomie de la science.
Nécessité de l’autonomie de la science
Lyssenko promettait de pouvoir sauver l’agriculture en imposant des caractères héréditaires aux plantes, et en réalisant ainsi leur « rééducation socialiste ». Cette théorie qui devait balayer la « génétique bourgeoise » et dont l’absurdité finit par être reconnue, eut une influence dans la communauté scientifique au-delà des frontières soviétiques, notamment en France.
Malgré cette vulnérabilité des sciences de l’homme et de la société, notamment de la sociologie, il n’en existe pas moins des critères de rigueur largement reconnus « permettant de distinguer clairement ce qui relève d’une démarche scientifique de ce qui relève de l’engagement militant » (Olivier Galland, « Où va la sociologie ? », telos-eu.com, 15 juin 2021).
Voir Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tustsi, La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994). Rapport remis au Président de la République le 26 mars 2021, Armand Colin, 2021.
La science occidentale s’est construite peu à peu grâce au processus d’autonomisation. N’en donnons ici que quelques exemples emblématiques.
Tout d’abord, c’est l’emprise de la religion dont les savants ont dû se dégager : on sait que Giordano Bruno fut brûlé publiquement pour avoir développé la théorie héliocentrique selon laquelle c’est la Terre qui tourne autour du Soleil. Aujourd’hui encore, la théorie créationniste, dans des pays pourtant scientifiquement aussi avancés que les États-Unis, tente de disqualifier cette avancée majeure dans l’histoire des sciences que fut l’explication darwinienne de l’origine des espèces par la sélection naturelle.
Il a fallu également, pour que la science progresse, échapper à l’emprise du politique. Celle-ci s’est particulièrement illustrée au XXe siècle avec le stalinisme, qui entendait soumettre la « science bourgeoise » à la « science prolétarienne », jusqu’à produire avec Lyssenko3 une pseudo-théorie génétique censée correspondre au programme politique marxiste – théorie au nom de laquelle ses opposants ont pu être envoyés au Goulag. Autant dire que la génétique a dû, pour poursuivre son développement, s’émanciper de ce type d’injonctions.
Quant aux enjeux économiques dont les travaux des chercheurs ont tout intérêt à se déprendre, ne citons ici que les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), créé en 1988 : s’il s’avérait que leurs conclusions soient soumises à des préoccupations d’ordre économique, tendant par exemple à maintenir les bénéfices des industries émettrices de gaz à effet de serre, il est clair que ces travaux, pourtant issus des meilleurs spécialistes mondiaux, n’auraient non seulement aucune validité scientifique mais aussi aucune utilité politique. On perçoit bien dans ce type de cas à quel point le respect de l’autonomie scientifique, s’agissant non seulement des thèmes de recherche mais même, dans les pires des cas, des méthodes et des résultats, est une question d’intérêt général.
Enfin, nous y reviendrons, la question de l’autonomie est particulièrement sensible dans les sciences de l’homme et de la société car elles sont beaucoup plus vulnérables que les sciences de la nature à la pénétration de convictions religieuses, morales ou politiques au sein de l’activité scientifique4. Et la quête exclusive de la vérité historique, sociologique, anthropologique, à l’exclusion de toute tentative pour étayer un préjugé, y est d’autant plus nécessaire lorsque les résultats du travail de recherche peuvent avoir des effets politiques ou juridiques. On l’a vu récemment avec le rapport sur le génocide des Tutsi au Rwanda remis au président de la République, en mai 2021 par l’historien Vincent Duclert5 : si l’enquête des historiens avait été biaisée par la volonté de disculper ou d’accuser la France, un tel travail n’aurait eu, là encore, ni intérêt scientifique, ni impact politique. Seul le respect d’objectifs proprement scientifiques donne de la valeur à ce type de productions.
Les moyens de l’autonomie
Il existe toute une batterie de moyens pour faire exister, garantir et attester l’autonomie de la science. Nous allons passer en revue les principaux, d’ordre institutionnel, organisationnel, intellectuel et juridique.
Garanties institutionnelles
À la différence de la France, où il à pris de nos jours une connotation quelque peu négative, le terme « académique » renvoie dans le monde anglophone à tout ce qui concerne à la fois l’université et la recherche, ce pourquoi nous l’utiliserons de préférence à « universitaire », trop restrictif car centré sur l’enseignement.
Il existe une charte de l’intégrité scientifique à laquelle tout un chacun peut se référer : Pierre Corvol, « Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique », rapport remis à Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 29 juin 2016.
Tout d’abord, les garanties institutionnelles sont fournies par les institutions académiques6 elles-mêmes, en tant qu’elles sont dotées de procédures de recrutement et de promotion basées exclusivement sur la compétence expertisée par les pairs, ainsi que de procédures de contrôle et de sanction de l’activité de leurs membres. C’est le cas des universités et des grands organismes de recherche (CNRS, Insee, Ined, Inserm, IRD, Inrap…). En cas de manquement à l’intégrité scientifique, il est possible de saisir la direction de l’établissement concerné, ainsi que les instances de régulation constituées de membres de la communauté académique, telles que le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) ou le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser)7. En outre – et c’est le cas, notamment, de la France, à la différence des États-Unis –, le fait que les enseignants-chercheurs soient rémunérés par l’État ou ses établissements publics, sur des postes pérennes, permet à ceux-ci de ne pas dépendre des attentes ou des avis de leurs financeurs – sponsors, mécènes et/ou étudiants.
Garanties organisationnelles
Ces garanties institutionnelles s’accompagnent de garanties d’ordre organisationnel, qui cadrent les obligations incombant aux chercheurs en matière non pas de résultats mais de moyens. Ce sont les règles de validation des travaux scientifiques des chercheurs, sous forme de publications dans des revues à comité de lecture ou d’ouvrages dans des collections spécialisées. Ces règles reposent sur une condition fondamentale garantissant l’autonomie : l’expertise par les pairs, dont nous venons de voir qu’elle est pratiquée également pour les recrutements et promotions par les institutions. Concrètement, tout article soumis à une revue scientifique doit faire l’objet d’une évaluation anonymisée par au moins deux spécialistes du sujet, qui le valideront (souvent en demandant des modifications) ou non. La procédure n’est certes pas sans défauts dans ses applications, mais dans son principe c’est la meilleure solution qui ait été inventée pour s’assurer que les publications scientifiques – et parfois même les communications aux colloques – soient conformes à des normes minimales de qualité, définies par le milieu académique lui-même et en fonction d’enjeux proprement épistémiques, c’est-à-dire relevant de la connaissance.
Garanties intellectuelles
Voir la Charte française de déontologie des métiers de la recherche, rédigée en janvier 2015.
Ne citons ici que quelques contributions centrées sur l’épistémologie des sciences de l’homme et de la société : Jean-Claude Passeron, Le Raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement naturel, Nathan, 1991 (rééd. Albin Michel, 2006) ; Norbert Elias, La Dynamique sociale de la conscience. Sociologie de la connaissance et des sciences, La Découverte, 2016 ; Pascal Engel, Les Vices du savoir. Essai d’éthique intellectuelle, Agone, 2019.
Voir Max Weber, Le Savant et le politique [1919], Plon, 1959 (rééd. 10/18, 2002).
Sur la neutralité et son corollaire, la distinction entre jugements de fait et jugements de valeur, voir Nathalie Heinich, op. cit.
Quels sont donc ces critères de qualité sur lesquels s’appuient ces procédures de validation ? Nous abordons ici la troisième catégorie de garanties, d’ordre non plus institutionnel ou organisationnel mais intellectuel. Même si elles ne sont pas – hélas ! – systématiquement enseignées aux futurs chercheurs, elles font partie du bagage professionnel qui s’acquiert sur le tas et sans lequel aucune carrière scientifique ne devrait être possible.
Citons notamment la fiabilité des sources, la traçabilité des données (notamment par les références indiquées en note, qui constituent une preuve incontournable de probité du travail), la bonne connaissance et la mention des travaux existant sur le sujet (dont témoigne la bibliographie), la cohérence du raisonnement, ainsi que l’absence de conflit d’intérêts et, condition majeure, l’abstention de tout plagiat8.
À ces exigences générales s’ajoutent des critères spécifiques aux différentes disciplines. Ainsi, la reproductibilité des résultats ne s’applique qu’aux sciences expérimentales, tandis que les sciences de l’homme et de la société admettent la combinaison de méthodes mixtes : au raisonnement hypothético-déductif (qui cherche à valider ou invalider une hypothèse en la confrontant aux données) s’ajoute le raisonnement inductif (qui part des données pour en dégager progressivement la logique interne) ; à la démarche explicative s’ajoute la démarche compréhensive (qui cherche à restituer le sens que les acteurs donnent à leur expérience, car contrairement aux objets étudiés par les sciences de la nature, les humains sont dotés de réflexivité) ; et à l’analyse statistique (qui comptabilise des occurrences) s’ajoute l’analyse typologique (qui met en évidence des « types » indépendamment de leur poids statistique). Si donc les critères de validité des travaux sont plus complexes dans les sciences de l’homme et de la société que dans les sciences de la nature, ils n’en existent pas moins, et ont d’ailleurs été largement étudiés et commentés par les épistémologues9. Or c’est le respect de ces critères de qualité qui garantit que les travaux produits répondent bien à des nécessités définies de l’intérieur du monde scientifique.
Parmi ces garanties intellectuelles, il faut faire une place particulière à une notion très présente en sociologie, mais qui concerne l’ensemble des sciences de l’homme et de la société et même les sciences de la nature : la « neutralité axiologique » telle que l’a définie le sociologue allemand Max Weber, c’est-à-dire l’obligation pour l’enseignant-chercheur de s’abstenir d’exprimer des jugements de valeur d’ordre éthique, politique ou religieux dans le contexte de son enseignement ou de sa recherche10. Le terme de « neutralité axiologique » utilisé par son traducteur Julien Freund a été discuté, de même d’ailleurs que la notion elle-même – nous y reviendrons à propos des menaces pesant sur l’autonomie. Cette distinction entre jugements de fait et jugements de valeur sur laquelle repose cette restriction de la liberté d’opinion des enseignants-chercheurs fait également l’objet de controverses, chez les philosophes et les analystes du discours11. Reste que, même s’il peut exister un certain flou sur ses limites, cette règle de base permet d’éviter que les opinions personnelles, les croyances religieuses, les convictions militantes ne viennent interférer dans la mission impartie à ceux auxquels la collectivité confie la production et la transmission des connaissances.
Garanties juridiques
Loi n° 68-978 d’orientation sur l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968 (loi Faure), art. 34 (devenu art. 57 de la loi Savary n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur). Reprise dans l’article L952-2 du Code de l’éducation, elle a reçu une validation constitutionnelle dans une décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984. Elle se retrouve enfin dans l’article L141-6 du Code de l’éducation, rédigé en 2000 : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique». Pour un tour d’horizon très complet de la notion de liberté académique, voir Olivier Beaud, Les Libertés universitaires à l’abandon ?, Dalloz, 2010.
Il existe enfin une dernière catégorie de moyens permettant de garantir l’autonomie de la science : ce sont les moyens juridiques, au premier rang desquels figure la liberté académique, encadrée par différentes lois et réglementations. Née aux États-Unis au début du XXe siècle, sous le nom d’academic freedom, afin de protéger les universitaires des pressions religieuses et politiques, elle instaure « la libre communication des résultats, des hypothèses et des opinions » comme étant « au cœur même du processus scientifique », selon une recommandation de l’Unesco datant de 1974. En France, la loi dispose que « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de cette loi, les principes d’objectivité et de tolérance12 ».
Nous reviendrons plus loin sur les modifications qu’il conviendrait d’apporter à ces textes pour rendre pleinement efficace l’encadrement juridique de la liberté académique. Mais celle-ci n’en demeure pas moins une garantie fondamentale, sans laquelle l’autonomie de la science ne serait qu’une valeur plus ou moins partagée et non pas un impératif s’imposant à tous. Or sa défense est particulièrement nécessaire lorsque, comme c’est le cas actuellement, elle est exposée à de multiples menaces, venant à la fois de l’extérieur et de l’intérieur du monde académique.
Menaces externes
Les menaces pesant sur l’autonomie de la science sont d’autant plus pernicieuses qu’elles sont à la fois nombreuses et hétérogènes, rendant parfois difficile leur identification – ce à quoi cherche à remédier la présente note. Commençons par celles qui proviennent de l’extérieur du monde scientifique.
Pressions religieuses et politiques
Pour une explicitation des voies par lesquelles la laïcité protège la rationalité scientifique, voir Renée Fregosi, Nathalie Heinich, Tournay et Jean-Pierre Sakoun, Le Bêtisier du laïco-sceptique, Minerve, 2021.
Voir notamment Judith Lyon-Caen, « Les historiens face au révisionnisme polonais », laviedesidées.fr, 5 avril 2019. En février 2019, un colloque international tenu à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) consacré à « la nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah » a été violemment perturbé par des militants nationalistes polonais proférant invectives et insultes antisémites, entraînant une protestation de la présidence de l’EHESS auprès de l’ambassade de Pologne.
En France, ces pressions « hétéronomes » ne sont plus d’ordre religieux, comme elles ont pu l’être (ou le sont encore ailleurs, notamment aux États-Unis où fleurissent les contestations créationnistes de la théorie de l’évolution), car la laïcité protège encore la France des tentatives de mainmise confessionnelles sur la recherche et l’enseignement supérieur13.
Les pressions provenant directement du pouvoir politique sont plus subtiles et plus complexes à analyser. Elles prennent en effet la forme moins de diktats imposés aux enseignants-chercheurs pour des raisons idéologiques (bien que ce soit le cas actuellement en Pologne, où le pouvoir entrave les travaux des chercheurs sur la Shoah montrant l’implication de la population polonaise dans la persécution des Juifs14) que d’incitations financières et administratives à privilégier des thèmes de recherche jugés prioritaires. Or, si un fléchage partiel des budgets de recherche par le pouvoir politique peut se justifier eu égard à l’origine publique des fonds alloués à l’activité scientifique, il reste que celle-ci doit pouvoir s’effectuer aussi en fonction d’objectifs proprement épistémiques, si l’on veut éviter la stérilisation et la démotivation des chercheurs. D’où les nombreuses protestations, ces dernières années, contre les orientations jugées beaucoup trop contraignantes du financement de la recherche.
Pressions économiques
Voir Stéphane Foucart, La Fabrique du mensonge. Comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger, Denoël, 2013. Pour un autre point de vue sur le sujet, voir Marcel Kuntz, Glyphosate, le bon grain et l’ivraie, Fondation pour l’innovation politique, novembre 2020 ; Marcel Kuntz, L’Affaire Séralini. L’impasse d’une science militante, Fondation pour l’innovation politique, juin 2019.
«Procès Roundup: les “Monsanto papers” dévastateurs pour la défense», sciencesetavenir.fr, 23 mars 2019.
Daniel Andler, « Le doute stratégique, ou comment retourner la rationalité contre elle-même », in Jean Baechler et Gérald Bronner (dir.), L’Irrationnel aujourd’hui, Hermann, 2021, p. 105-106.
Les pressions les plus inquiétantes aujourd’hui sont d’ordre essentiellement économique, avec l’action des lobbys industriels qui, en cherchant à orienter les décisions politiques, tentent de dévoyer l’activité des chercheurs dont les résultats alimentent les procédures d’homologation des diverses agences concernées. De nombreuses révélations ont mis en évidence les conflits d’intérêts (chercheurs payés par les industries), ainsi que les manipulations dans la production ou la présentation des données, voire la fabrication de fausses études.
Un exemple récent a été fourni en 2017 par le travail collectif des journalistes réunis autour des Monsanto Papers, dévoilant les techniques de falsification de l’activité scientifique utilisées par les industriels du glyphosate15. L’une d’elles est le ghost writing, consistant à « rédiger des articles scientifiques tout en les faisant signer, moyennant finance, par des scientifiques reconnus et présentés comme indépendants 16 ». Une autre technique de falsification est le « doute stratégique », utilisé notamment par l’industrie du tabac pour instiller dans l’opinion et chez les décideurs l’idée qu’il y aurait un doute légitime sur la fiabilité des données scientifiques démontrant les dangers du tabagisme : « Feignant l’ignorance, affirmant que rien n’est prouvé, commanditant auprès de chercheurs patentés d’innombrables études tendant à noyer le poisson, inondant le public de rapports sur le thème “Personne ne connaît la réponse”, l’industrie du tabac s’en est tenue à un principe cardinal : prétexter l’incertitude pour instiller le doute, [de façon à] ralentir et détourner l’enquête scientifique sur les effets sanitaires du tabac menée à partir du début des années 195017. » Ici, l’atteinte à l’autonomie vient à la fois du monde extérieur à la science (les industries) et de certains de ses membres, qui contreviennent à la déontologie par intérêt financier, voire par déraison. La chose est d’autant plus grave que l’enjeu n’est plus seulement la qualité de la science mais la santé publique.
Interférences des réseaux sociaux
Voir Nathalie Heinich, « Le processus de civilisation est en train de se retourner en son contraire sous le coup des réseaux sociaux », lemonde.fr, 26 octobre 2020 (en accès réservé).
Voir le site de l’Observatoire du conspirationnisme.
Enfin, parmi les menaces provenant de l’extérieur du monde académique, il faut souligner une nouveauté due aux progrès technologiques ayant révolutionné l’échange des opinions en rendant possible leur communication immédiate, à grande échelle et non filtrée par des éditeurs : il s’agit de l’essor des réseaux sociaux, des blogs ou encore des commentaires en ligne sur les sites d’information professionnels. Ils favorisent en effet l’écrasement des différences entre, d’une part, l’opinion personnelle du citoyen non spécialiste et, d’autre part, l’expertise professionnelle en matière de production d’un discours véridique, factuel, vérifiable – qu’il s’agisse de la compétence certifiée des journalistes ou de celle des scientifiques. On observe aujourd’hui en permanence les effets pervers de cette démocratisation spectaculaire de la production d’opinions, en matière aussi bien de « décivilisation des mœurs18 » que d’indistinction entre données scientifiques et rumeurs, sur fond de défiance envers les « sachants » et les « élites », aboutissant avec la pandémie sanitaire mondiale à une véritable épidémie de complotisme19.
Toutefois, les menaces pesant sur l’autonomie de la science ne viennent pas seulement du monde extérieur mais – et c’est peut-être là le plus grave – des scientifiques eux-mêmes.
Menaces internes
Cette rubrique très fournie comporte les mêmes catégories de menaces que celles qui organisent, comme nous venons de le voir, les moyens de défense de l’autonomie de la science : menaces relevant des institutions, de l’organisation du travail, ainsi que de conceptions intellectuelles de la mission de l’enseignant-chercheur qui, quoique attentatoires à l’autonomie, sont en plein essor.
Atteintes institutionnelles
C’est ce que suggère le rapport Corvol (op. cit.).
Voir Valérie Igounet, Robert Faurisson. Portrait d’un négationniste, Denoël, 2012, p. 295-297.
Le texte de cette charte ne figure pas toutefois sur la version actuelle du site de l’AFS, qui ne propose en guise de plateforme déontologique qu’une « Charte pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles ».
Voir Nathalie Heinich et Pierre Verdrager, « Les valeurs scientifiques au travail », Sociologie et sociétés, vol. XXXVIII, n° 2, automne 2006, p. 209-241.
Les atteintes d’ordre institutionnel se produisent lorsque les institutions académiques se dérobent à leur devoir de contrôle et de sanction des infractions à la déontologie, notamment en cas de falsification due à des fraudes scientifiques. Qu’elles soient motivées par l’obsession du résultat ou par des biais idéologiques, elles entraînent la transgression des règles d’établissement de la vérité. Le faible nombre de sanctions au titre d’atteintes à l’intégrité scientifique est probablement dû moins à l’absence de fautes qu’à la frilosité des institutions à mettre en œuvre les procédures disciplinaires prévues par la loi, et au corporatisme des commissions chargées des sanctions lorsque la protection des intérêts personnels du fraudeur au nom de la solidarité corporatiste prévaut sur la déontologie20.
Un cas emblématique a été, il y a deux générations, l’affaire Faurisson, du nom de ce spécialiste de littérature devenu un chantre du négationnisme mais dont l’université de rattachement (Lyon-II) tarda considérablement à supprimer l’enseignement où il défendait sa thèse sur l’inexistence des chambres à gaz alors que des historiens professionnels en avaient démontré l’inanité, et qui y conserva son poste pendant une dizaine d’années, bénéficiant en outre de son salaire de fonctionnaire jusqu’à la retraite21.
Quant à ces quasi-institutions que sont les associations professionnelles, elles ne sont pas toujours le garant du respect de l’autonomie de la science. Ainsi, la charte de l’Association française de sociologie (AFS) stipulait en 2009 que « la recherche sociologique a pour objet de produire des connaissances pouvant être utiles à la société22 » : affirmation pour le moins peu soucieuse de la valeur en soi du savoir, et qui a en outre l’inconvénient d’exclure des œuvres majeures dont on voit mal en quoi elles peuvent être « utiles à la société », depuis L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme de Weber jusqu’aux Formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim en passant par La Civilisation des mœurs d’Elias ou Les Rites d’interaction de Goffman, pour ne citer que quelques piliers de la tradition sociologique.
Atteintes organisationnelles
L’association Qualité de la science française (QSF) ne cesse d’alerter les autorités sur ce problème, en préconisant l’interdiction au niveau national du recrutement local. Voir, notamment, « Propositions pour l’amélioration des procédures de recrutement des enseignants-chercheurs », qfs.fr, 4 mars 2021.
Le titre de docteur en sociologie fut décerné à l’impétrante avec la mention très honorable (voir Daniel Filâtre, « Affaire Tessier : historique », 30 décembre 2001).
Voir Agnès De Féo, « Le voile intégral en perspective : France, 2008-2019 », thèse de doctorat en sociologie sous la direction de Michel Wieviorka, EHESS, 2019.
Pour un exemple de ce type de dérives, voir Nathalie Heinich, Ce que le militantisme fait à la recherche, Gallimard, coll. « Tracts » n° 29, p. 16-17.
Voir Jean-François Mignot, « Prénoms des descendants d’immigrés en France : essai de reproduction d’un article scientifique », août 2021.
Une autre catégorie d’atteintes à l’autonomie provenant du milieu académique concerne le non-respect des règles de validation du travail de recherche, qu’il s’agisse de recrutement, de promotion ou de publication. Il s’agit, plus précisément, du dévoiement de l’expertise par les pairs, alors que celle-ci est, nous l’avons vu, à la base de tout fonctionnement du monde scientifique.
Concernant le recrutement, les conditions ne sont pas toujours réunies pour que les critères mis en œuvre relèvent exclusivement des qualités attendues d’un enseignant-chercheur : pour la partie enseignement, l’étendue des connaissances et les compétences pédagogiques ; et, pour la partie recherche, l’alliance contradictoire de maîtrise de la tradition intellectuelle et de capacité d’innovation, d’observance attentive des protocoles et de curiosité, de sens du travail collectif et d’audace individuelle23. L’on sait notamment combien le souci des réseaux, le clientélisme, les manœuvres diverses pour conquérir ou conserver des positions de pouvoir entravent les conditions d’un recrutement vertueux, reposant sur des critères proprement scientifiques. Et chacun sait que le recrutement local, par la cooptation au sein d’une même université, en est l’un des principaux obstacles – mais cela n’empêche nullement, hélas, que cette pratique, proscrite dans la plupart des pays occidentaux, continue d’être légale en France24.
Par ailleurs, s’agissant des recrutements au CNRS (qui transforme un chercheur précaire en fonctionnaire à vie), ceux-ci sont effectués par des commissions composées pour un tiers de chercheurs nommés par la direction et pour deux tiers de chercheurs élus – le problème étant que ceux-ci sont présentés par des syndicats. Quel rapport y a-t-il entre le fait d’être syndiqué et la compétence permettant d’expertiser un dossier de candidature ? Aucun. Quelle incidence cela peut-il avoir sur les décisions ? De tels modes de recrutement ne peuvent que favoriser des alliances et des jeux de réseaux ayant fort peu à voir avec la qualité scientifique des candidats. Autant les représentants syndicaux ont un rôle essentiel s’agissant des conditions de travail ou de rémunération, autant leur présence dans des commissions d’experts chargés d’évaluer la qualité respective des candidats à un poste constitue un évident déni de la notion même d’expertise scientifique.
Les soutenances de thèse, qui transforment un doctorant en docteur d’université et donc en potentiel enseignant-chercheur, peuvent aussi donner lieu à des manipulations peu conformes à l’intégrité scientifique pour peu que le jury soit composé de façon à cautionner l’orientation de la thèse, surtout lorsque celle-ci est chargée en implications politiques. Le simple jeu des alliances et des réseaux peut suffire à produire des situations de complaisance qui nuisent forcément à l’application de critères scientifiques rigoureux. En témoignent maints bruits de couloir dans les universités, mais qui vont rarement jusqu’au scandale, comme dans le cas emblématique de l’« affaire Teissier », lorsqu’une thèse en sociologie défendant l’astrologie fut soutenue par l’astrologue Élisabeth Teissier à l’université Paris-V sous la direction de Michel Maffesoli, entraînant les protestations de nombreux sociologues25. On constate aussi parfois le risque d’une surdétermination des critères de qualité proprement scientifiques par des partis pris idéologiques : ce fut le cas notamment avec une thèse soutenue en 2019 à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) sur la pratique du voilement intégral du visage des musulmanes, et dont le jury n’était composé que d’universitaires ayant publiquement pris position contre son interdiction26. L’entre-soi idéologique ne favorise pas l’équanimité du jugement sur la qualité proprement scientifique d’un travail de recherche lorsque celui-ci défend des orientations politiques.
En matière de publications, la qualité de l’expertise tend à être considérablement altérée par la technologie numérique qui rend possible l’open edition, c’est-à-dire la mise en ligne d’articles en libre accès. Si elle permet à la communauté scientifique de s’affranchir des coûts prohibitifs imposés par les éditeurs de revues spécialisées, elle possède aussi ses effets pervers en rendant parfois facultatif le filtre de l’expertise préalable (à l’instar du site HAL-Archives ouvertes), et en faisant payer aux chercheurs eux-mêmes l’accès à la publication de leurs articles, ce qui revient à opérer une sélection par les moyens financiers et non plus par la seule qualité scientifique. En outre, l’open edition a permis la floraison d’une multitude de petites revues autoéditées par des groupes de chercheurs voire par un laboratoire, abaissant d’autant les possibilités de confrontation avec d’autres approches, et donc d’une expertise efficiente27.
Enfin, les procédures de validation de la qualité scientifique peuvent être également biaisées par les revues elles-mêmes lorsqu’elles se dérobent aux règles de communication de la méthodologie et, si, besoin, de rétractation d’articles litigieux voire frauduleux. Ainsi, un chercheur du CNRS qui voulait vérifier les résultats d’un article paru en 2019 dans Populations et Société, la revue de l’Institut national d’études démographiques (Ined), en a été longtemps empêché non seulement par les auteurs de l’article mais aussi par la direction de la revue ainsi que par la direction de l’Ined28. Il est également arrivé que la démonstration de la non-validité d’un article publié par une revue n’ait pas été suivie de sa rétractation dans les formes, à savoir non pas la simple suppression de l’article mais la publication d’une notice de rétractation et le barrage en rouge de l’article en ligne avec le mot « rétracté » sur chacune des pages.
La confusion des arènes
Max Weber, op. cit.
Les atteintes internes à l’autonomie de la science par la transgression des règles spécifiques de validité des productions ne sont pas forcément commises pour des motifs de gain – comme avec les conflits d’intérêts évoqués plus haut à propos des pressions économiques – mais, bien souvent, par conviction idéologique. Elles s’expliquent souvent par ce que l’on peut nommer la « confusion des arènes » entre le domaine du « savant » et celui du « politique », pour reprendre le titre d’un livre canonique de Max Weber29. C’est cette confusion des arènes qui caractérise l’indistinction entre opinion personnelle et avis d’expert évoquée plus haut à propos des effets pervers des réseaux sociaux.
Les méfaits des convictions idéologiques
Voir Stéphane Foucart, Le Populisme climatique. Claude Allègre et Cie, enquête sur les ennemis de la
science, Denoël, 2010.
Cette question est développée dans dans Ce que le militantisme fait à la recherche, op. cit.
Ibid.
Ibid., ainsi que Xavier-Laurent Salvador (dir.), «Rapport sur les manifestations idéologiques à l’Université et dans la Recherche», Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, 10 mai 2021.
« Les propos de Weber sur la neutralité axiologique ne seraient pas aussi grotesquement déniés s’il ne s’agissait de balayer l’objection pour lui opposer une conception radicalement opposée de la science : une science politisée» (Alain Garrigou, «Retour sur la neutralité axiologique», blog.mondediplo.net, 14 juillet 2021). Voir aussi Nathalie Heinich, « Pour une neutralité engagée », Questions de communication, n° 2, 2002, p. 117-127.
Voir Norbert Elias, Engagement et distanciation [1983], Fayard, 1993 (rééd. Pocket-Agora, 1996).
L’un des plus célèbres exemples d’atteinte à la rigueur scientifique par conviction idéologique – elle-même conséquence de l’incapacité à distinguer entre les arènes du scientifique et du politique – est le climato-scepticisme professé dans les années 1990, à l’encontre des conclusions du Giec, par Claude Allègre, géochimiste et membre de l’Académie des sciences (qui, d’ailleurs, le suivra un temps dans cette dérive)30.
La confusion des arènes est particulièrement marquée en sciences humaines en raison de leur porosité à des positions idéologiques directement importées de la sphère politique. Particulièrement vulnérables à cette porosité sont les disciplines ayant une relation directe avec des « sujets de société », telles que les sciences politiques, l’anthropologie et la sociologie (qualifiée de « sport de combat » par Pierre Bourdieu et ses adeptes)31. Elles sont le foyer privilégié d’une « militantisation » de la recherche qui, certes, n’est pas un phénomène nouveau (à l’instar de l’influence du marxisme à l’université dans les années 1960 et des gauchismes dans les années 1970), mais qui a été relancée dans la dernière génération à la fois par le succès du « paradigme de la domination » et de la sociologie critique propres à la pensée de Bourdieu, et par l’importation du postmodernisme américain puis du développement des studies32.
Issues du courant anglais des cultural studies, ces studies sont devenues en une génération un mode de structuration très répandu dans les universités occidentales, dont les enseignements sont fréquemment organisés non plus par disciplines (histoire, économie, sociologie, anthropologie, etc.) mais par objets, et presque toujours par objets considérés comme victimes de discriminations (nous y reviendrons avec le mouvement woke) : femmes, personnes de couleur, homosexuels, etc. Voilà qui favorise l’indistinction entre recherche (ou enseignement) et militantisme, tout en entraînant une dilution des repères théoriques et méthodologiques propres aux disciplines académiques, ainsi qu’une dégradation des modes de validation de la recherche par la culture de l’entre-soi idéologique33.
On ne s’étonnera pas que ces enseignants et chercheurs prompts à transgresser voire à délégitimer l’injonction à respecter la spécificité des enjeux épistémiques propres au monde académique, soient aussi les premiers à récuser l’impératif wébérien de « neutralité axiologique », dont nous avons vu plus haut qu’elle est une importante garantie de l’autonomie de la science. Certes, cette neutralité est plus difficile à observer dans les sciences de l’homme et de la société que dans les sciences de la nature, en raison de leur proximité avec des systèmes de valeurs que le chercheur peut être tenté de défendre ou d’attaquer au lieu de les décrire et de les analyser34, mais elle n’en reste pas moins un idéal à faire advenir, grâce à des techniques de contrôle de la posture intellectuelle et d’expression de la pensée : Norbert Elias a bien montré comment les sciences ont pu se développer en s’autonomisant par rapport aux motivations émotionnelles et axiologiques grâce à leur déplacement du pôle de l’« engagement » vers celui du « détachement », ce en quoi les sciences de l’homme et de la société ont tout intérêt à prendre exemple sur les sciences de la nature 35.
Les méfaits du postmodernisme
Voir François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, La Découverte, 2003. Pour une analyse du phénomène d’import-export de la pensée que constitue la French Theory, voir Nathalie Heinich, « French Theory : petits malentendus transatlantiques », telos-eu.com, 9 février 2021.
Sur les sophismes sur lesquels repose ce constructivisme exacerbé, voir Nathalie Heinich, Le Bêtisier du sociologue, Klincksieck, 2009.
Sur les arrière-plans religieux de cette suspicion portée sur la vérité scientifique, voir Nathalie Heinich, « Une sociologie très catholique ? À propos de Bruno Latour », Esprit, n° 334, mai 2007. Sur les effets actuels du postmodernisme dans les sciences, voir Marcel Kuntz, « L’idéologie postmoderne contre la science », contrepoints.org, 29 août 2015, et François Rastier, « Après le postmodernisme : pour une reconstruction », Texto ! Textes et cultures [revue en ligne], vol. XXVI, n° 1, 2021.
Éric Muraille, Alban de Kerchove d’Exaerde et Bernard Feltz, « Didier Raoult, le postmodernisme en étendard», theconversation.com, 24 août 2021.
« Il y a chez Didier Raoult un positionnement postmoderne assumé, avec de fréquentes références aux théoriciens de cette approche, un rejet des normes scientifiques, des découvertes communiquées au public sans attendre l’examen par les pairs, ou encore une présentation des critiques qui lui sont adressées comme étant des attaques personnelles. […] En réduisant la science à un outil d’oppression et une source de vérité locale, le postmodernisme fait perdre à la science toute légitimité particulière à éclairer les décisions politiques » (ibid).
Voir Manuel Manguelti et François D’Astier, « Une démonstration d’un sociologue sur la mortalité des vaccins ? Attention à l’interprétation des chiffres », factuel.afp.com, 4 août 2021. Le même sociologue a également fait l’objet d’une analyse de l’Observatoire du conspirationnisme sur ses positions complotistes : « Laurent Mucchielli, de Mediapart à France Soir », conspiracywatch.info, 6 août 2021. L’affaire a entraîné une mise au point du CNRS dans un communiqué de son comité d’éthique (« Le CNRS exige le respect des règles de déontologie des métiers de la recherche », 24 août 2021), jugé toutefois trop elliptique par le journaliste scientifique Sylvestre Huet (« Covid : mensonges et sociologie », où figure le texte du communiqué du CNRS, lemonde.fr, 25 août 2021).
Avant même le développement des studies, la porosité de la frontière entre science et idéologie s’était introduite dès les années 1980 dans le monde académique à la faveur d’un courant de pensée né à la fin des années 1970, et qui s’est considérablement développé ensuite, notamment dans le monde anglo-américain, même s’il s’est inspiré d’auteurs français réunis sous le vocable importé de « French Theory36 » : il s’agit du courant « postmoderne », professant le « constructivisme », c’est-à-dire le caractère relatif car « socialement construit » des vérités scientifiques, et donnant lieu au concept de « post-vérité37 ». Transposé dans le domaine non plus philosophique mais scientifique grâce aux science studies (notamment sous l’influence du Français Bruno Latour), ce courant a le défaut d’appliquer à la science en général, pour en récuser l’objectivité, des descriptions qui ne sont valables que pour des moments qui ne sont pas ceux de son état stabilisé : en amont, le moment de la recherche, forcément riche en tâtonnements et controverses ; en aval, le moment de la technique, forcément dépendante d’enjeux extrascientifiques. Ce faisant, il ignore le moment consensuel et institutionnalisé de la science, postérieur aux processus de validation et antérieur aux utilisations sociotechniques. C’est le point faible de l’analyse des réseaux sur laquelle repose l’approche latourienne : leur mise à plat ne permet pas de prendre en compte la spécificité du moment institutionnel, celui de la cristallisation du savoir à l’état stabilisé, donc peu vulnérable à la déconstruction38.
Plus récemment, on a vu Didier Raoult se réclamer de ce courant : auteur en 2015 d’un essai intitulé De l’ignorance et de l’aveuglement : pour une science postmoderne, il présente le postmodernisme comme « la solution à une science qu’il décrit comme improductive et sclérosée par les théories et les normes méthodologiques39 ». La promotion de l’hydroxychloroquine qu’il présente comme traitement contre la Covid-19 se comprend mieux dans cette perspective40. La pandémie a révélé l’existence de telles dérives également dans les sciences de l’homme et de la société, notamment lorsque le sociologue au CNRS Laurent Mucchielli a cosigné un article (publié sur son blog sur Mediapart, puis retiré à l’initiative du site) interprétant à tort des statistiques de santé publique comme une preuve de la létalité élevée de la vaccination contre le virus41.
Les méfaits du wokisme
Voir Nathalie Heinich, « Cancel culture (l’importation d’une politique) », Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics, mai 2021. Pour des exemples de cette cancel culture à l’université, voir Nathalie Heinich, Oser l’universalisme. Contre le communautarisme, Le Bord de l’eau, 2021.
Voir Xavier-Laurent Salvador (dir.), op. cit.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence, art. 2.
Antoine Petit, « Journée internationale des droits des femmes », cnrs.fr, 7 mars 2019.
Voir UK Research and Innovation, « UKRI Gender Equality Statement Guidance », mai 2021, p. 2 [traduction de l’auteur] : « They will show that the applicants have proportionately and meaningfully considered how their project is likely to reduce inequalities between persons of different gender throughout the design of the project, implementation of the project and impact. »
Voir Pierre Valentin, L’idéologie woke (1). Anatomie du wokisme et L’idéologie woke (2). Face au wokisme, Fondation pour l’innovation politique, juillet 2021.
Voir Andreas Bikfalvi, « La science et la médecine sous l’emprise des idéologies identitaires », latribune.fr, 27 mai 2021 et Id., «Les sciences dites “exactes”», decolonialisme.fr, 31 juillet 2021.
Voir notamment Chris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon (dir.), Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des populations en France, Ined, 2016.
Voir Philippe d’Iribarne, « Les employeurs sont-ils islamophobes ? », Le Débat, n° 197, novembre-décembre 2017, p. 87-98.
Voir « La savante et le politique. Défense et illustration des libertés académiques – 7-10 juin 2021 », legs.cnrs.fr. Voir aussi le blog de Mediapart consacré à ce colloque. On notera avec intérêt l’usage de l’écriture inclusive et de la féminisation systématique des noms de fonction, qui aboutit à d’amusantes contorsions lorsque « la savante », en guise du « savant », ne parvient pas à trouver son équivalent avec un « la politique » qui renverrait à tout autre chose qu’une personne de sexe féminin…
Terminons ce rapide tour d’horizon des effets délétères de la confusion des arènes en nous penchant sur la pénétration récente, dans le monde académique, des effets du mouvement woke, ou wokisme. On entend par là, outre-Atlantique, l’« état d’éveil » permanent face aux discriminations, qu’elles soient de sexe, de race, d’orientation sexuelle, de religion, d’apparence physique, etc. La légitimité de ces causes dans le domaine politique, pour peu que l’on soit sensible à l’égalité des droits, leur confère une puissance de conviction dans le domaine académique rendant difficile leur contestation alors même qu’elles entretiennent ou même réactivent la confusion entre recherche et militantisme. On ne développera pas ici les conséquences en termes de cancel culture (ou culture de la censure, consistant à empêcher de s’exprimer tous ceux dont les propos seraient considérés comme non adéquats à la cause woke), mais celle-ci est bel et bien une conséquence de cette conscience égalitariste érigée en principal, voire en seul critère d’acceptabilité des productions académiques42.
Or il ne s’agit pas là de simples lubies professées par quelques étudiants ou enseignants radicalisés : ces problématiques ont pénétré non seulement dans les sujets de thèses et les appels à articles ou communications, mais aussi, au sein de l’administration académique, dans les appels à projets et les profils de postes à pourvoir43. La création dans les universités de « missions égalité », confiées à des « référents égalité », est aussi de nature à imposer aux enseignants-chercheurs des contraintes qui peuvent avoir leur justification dans le domaine civique et sociétal, mais ne sauraient dicter enseignements ou sujets de colloques. Ces problématiques devraient-elles encore moins être imposées sous forme réglementaire, comme c’est le cas dans le Code de l’éducation tel que modifié le 24 décembre 2020, qui précise en effet que « le service public de l’enseignement supérieur contribue […] à la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes », ainsi qu’à « la construction d’une société inclusive44 ». Un autre article du même Code énonce que ce service public « mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communautééducative45 ».Si,encoreunefois,onnepeutqu’êtreenaccord avec de tels objectifs sur le plan sociétal, on doit relever l’extraordinaire inconscience des enjeux de l’autonomie scientifique que révèle ce vocabulaire militant, en termes de « luttes » et d’« actions à mener » dans un texte censé régir la bonne mise en œuvre de la visée de production et de transmission des connaissances, qui constituent pourtant aux termes de la loi la seule justification du statut des enseignants-chercheurs : « Les enseignants- chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche46. »
On voit là les effets immédiats de la montée en puissance, ces dernières années, de cette idéologie woke importée dans le monde académique français, puisqu’elle a réussi à faire modifier les textes de loi sans que, apparemment, personne ne se soit inquiété des dérives qu’elle pouvait entraîner. Or celles-ci sont considérables, comme on le voit dans le domaine de la lutte contre le sexisme, qui produit déjà des aberrations : il arrive que l’administration universitaire impose aux jurys de soutenance ou de recrutement une stricte « parité », au mépris de la loi qui ne parle que de représentation « équilibrée » des hommes et des femmes (permettant donc de tenir compte de l’inégale proportion d’enseignants-chercheurs de rang A dans les différentes disciplines), et au mépris surtout du critère fondamental qui devrait guider le choix des experts, à savoir leur compétence. Cet abandon ou, du moins, cette minimisation du critère du mérite scientifique, seul à même de respecter l’autonomie de la science, est une conséquence gravissime de la pénétration de l’impératif de lutte contre les discriminations au sein du monde académique : on l’a vu en 2019 lorsque le président du CNRS Antoine Petit, à l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, a envoyé à tous les membres de l’organisme une lettre indiquant que désormais serait respectée « la parité dans les attributions des médailles du CNRS », et que serait mise en œuvre « la promotion de chercheuses au prorata, aumoins, du pourcentage de femmes promouvables47 ». Là encore, les meilleures intentions peuvent aboutir, faute de conscience de la spécificité des critères d’excellence scientifique, à une démolition en règle du socle sur lequel repose l’évaluation de l’activité des enseignants-chercheurs – et ce à l’initiative des institutions académiques elles-mêmes, au plus haut niveau.
Voilà qui ne fait qu’imiter l’exemple fâcheux des universités anglo-américaines : ainsi, il est obligatoire de fournir un gender equality statement pour toutes les candidatures au UK Research and Innovation GCRF et au Newton Fund annoncées et publiées depuis le 1er avril 2019. Un document officiel explique que cette déclaration doit « montrer que les candidats ont pris en compte de manière proportionnée et significative les inégalités entre les personnes de genre différent tout au long de la conception de leur projet, de leur mise en œuvre et de leur portée et comment [leur] projet contribuera à les réduire48 ». La recherche se voit donc ici soumise à des impératifs moraux49. Le problème ne se pose pas que dans les sciences de l’homme et de la société : même les sciences de la nature sont touchées, qu’il s’agisse de biologie ou de physique, où les appels à projets internationaux exigent désormais une déclaration relative aux effets positifs du projet sur la lutte contre les discriminations dues au genre50. Or la question essentielle de la représentation des femmes dans les organismes de recherche, en particulier en sciences « dures », se pose dès la formation initiale au lycée et dans les classes préparatoires, et c’est là que doivent être corrigées les disparités numériques entre hommes et femmes. En revanche, dans les concours de recrutement, seul le mérite doit prévaloir : l’avantage donné à des femmes au nom de la parité (à l’instar de ce qui se pratique dans les conseils d’administration des entreprises cotées), contre des chercheurs masculins présentant pourtant de meilleurs dossiers, constitue une atteinte à l’autonomie de la recherche, qui ne peut que nuire à sa qualité.
Enfin, la focalisation sur les discriminations dues à l’appartenance ethnique comporte elle aussi ses risques, notamment en termes d’appauvrissement des analyses, voire de déformation plus ou moins volontaire des résultats : il a été ainsi démontré que des enquêtes sur les discriminations menées au sein de l’Ined tendent à interpréter unilatéralement les résultats en termes de préjugés racistes51, alors même qu’une analyse prenant en compte l’ensemble des paramètres montre que c’est plutôt l’engagement religieux qui fait l’objet de la méfiance des recruteurs52. Comment mieux illustrer le danger que représente l’imposition de critères extrascientifiques (et, en l’occurrence, idéologiques) pour la qualité du travail de recherche ?
Enfin, la confusion des arènes est à son comble lorsqu’elle est non seulement pratiquée sans scrupule mais revendiquée comme une valeur, ce qu’illustre bien la conclusion de cet appel à communication lancé en juin 2021 pour un colloque intitulé « La savante et le politique », organisé par les universités Paris-VIII et Paris-Nanterre avec le soutien du CNRS : « Loin d’opposer le savant et le politique, il s’agit de l’affirmer avec force : la savante est politique53. »
Parades
Nous nous trouvons dans la situation paradoxale où une norme communément admise par les intéressés – l’autonomie de la science – fait à la fois l’objet de transgressions dans les faits (tout le monde ne la respecte pas) et, de plus en plus, de contestations en tant que valeur partagée (tout le monde n’en fait pas le critère fondamental de la qualité du travail). D’où la nécessité d’y apporter des parades en forme de contrôle accru exercé de l’intérieur même du monde académique, de façon à en respecter l’autonomie.
Le problème est que ces nécessaires contrôles – nous allons en énumérer quelques-uns – sont parfois interprétés par les intéressés comme des atteintes à leur « liberté académique ». Or il s’agit là d’une incompréhension voire d’un détournement de cette notion. Voilà qui nécessite une mise au point, assortie de quelques retouches apportées aux textes.
Clarifier la notion de la « liberté académique »
Voir Olivier Beaud, «La liberté académique: un silence instructif», Commentaire, n° 175, automne 2021, p. 631-640.
Une conférence de la philosophe Sylviane Agacinski sur les enjeux de la PMA fut déprogrammée par l’université de Bordeaux à l’automne 2019 sous la pression de militants LGBT l’accusant d’être « homophobe » (voir Nathalie Heinich, « Nouvelles censures et vieux réflexes totalitaires », Cités, n° 82, juin 2020).
Pour un développement de cette proposition, voir Nathalie Heinich, « Les ennemis de la liberté académique et leurs confusions », intervention faite au colloque organisé par QSF sur les nouvelles formes de censures à l’Université, Sorbonne, 1er février 2020. Pour une position analogue, voir Hubert Heckmann, « Ne renonçons pas à exercer les libertés au sein des universités », lexpress.fr, 24 juin 2021.
En juin 2021, lorsque le Parlement danois a voté une motion contre « les excès du militantisme dans certaines recherches environnementales », une pétition a immédiatement circulé dans les milieux universitaires dénonçant « une attaque inadmissible contre la liberté académique ». Cette contre-attaque révèle une incompréhension fondamentale, chez certains enseignants-chercheurs (notamment les « académo-militants »), de ce que signifie la liberté académique54, en particulier de sa différence fondamentale avec la liberté d’expression. Car la première n’est garantie aux membres de la communauté académique qu’à la condition que leurs enseignements et leurs travaux correspondent bien aux critères de qualité scientifique et à leurs procédures de validation, à l’exclusion donc de productions qui relèveraient de l’engagement militant. Prétendre protéger celui-ci au titre de la liberté académique, c’est donc vouloir, si l’on peut dire, le beurre de la liberté d’expression accordée au citoyen avec l’argent du beurre de la protection académique accordée à l’universitaire. Autant dire que c’est réclamer un privilège inacceptable en démocratie.
Il faut dire que cette confusion est entretenue par les termes des articles réglementaires, inadaptés car contradictoires entre eux. En effet, dans la loi de 1984, la réserve invoquée en matière de liberté académique (« sous les réserves que leur imposent les principes d’objectivité et de tolérance ») est propre à rendre la protection inopérante ; car si l’on applique le principe de « tolérance » à n’importe quelle opinion émise dans une salle de cours par un étudiant ou un enseignant notoirement incompétent, comment assurer une quelconque « objectivité » aux productions scientifiques ? De même, concernant la validation constitutionnelle, on est en droit de se demander ce que vient faire le « pluralisme des opinions » dans les amphithéâtres, les séminaires, les revues spécialisées : faudrait-il donc, pour le respecter, organiser des échanges d’opinion comme sur la place publique ou au café, ou encore soumettre au débat l’opinion selon laquelle « 2 + 2 = 5 » ? Enfin, dans le Code de l’éducation, le « respect de la diversité des opinions », confondant le savoir avec l’opinion, autorise, au titre de la liberté académique, la protection d’opinions scientifiquement aberrantes, telles que celle selon laquelle la Terre serait plate ou celle selon laquelle les camps d’extermination n’auraient jamais existé. De telles « opinions » n’ont pas leur place dans l’enceinte académique, et non seulement peuvent mais doivent en être exclues au nom, précisément, de l’« objectivité du savoir » invoquée dans le même texte. En d’autres termes, l’article du Code de l’éducation énonce deux affirmations contradictoires, l’une – le respect de la diversité des opinions – ayant pour conséquence possible de ruiner immédiatement les fondements de l’autre – le respect de l’objectivité du savoir.
C’est dire que la protection juridique de la liberté académique nécessite une réécriture de la loi, assortie d’un renforcement constitutionnel. Cette protection doit être étendue non seulement aux entraves qui proviendraient du monde extérieur à l’université mais aussi à celles qui proviennent de l’intérieur, c’est-à-dire des universitaires eux-mêmes : ce n’est plus le statut de l’objecteur ou du censeur qui doit délimiter le domaine de la liberté académique, mais le statut des normes invoquées. Nul – pas même un collègue ou une administration universitaire – ne devrait pouvoir imposer à un chercheur ou à un étudiant l’usage de l’écriture inclusive. Et aucun enseignant-chercheur – et, moins encore, aucun collectif d’étudiants – ne devrait pouvoir interdire ou imposer l’étude d’un thème ou d’un auteur, quelques légitimes que soient les causes dont il se prévaut : l’affaire Agacinski, ainsi que quelques autres cas de censures universitaires en phase avec la cancel culture55, devraient alerter sur ce type de dérives56.
Quelques mesures
Voir Nathalie Heinich, « Mon idée pour la France : il faut enseigner les règles présidant à la production de l’information journalistique et du savoir scientifique », lemonde.fr, 22 février 2019 (en accès réservé).
Terminons par quelques propositions – non exhaustives – de mesures qu’il serait souhaitable de prendre pour protéger l’autonomie de la science.
– laisser aux chercheurs une plus grande marge d’autonomie dans le choix de leurs objets, en limitant le financement sur projets ;
– contrôler et sanctionner plus systématiquement la corruption active et passive des scientifiques par les lobbys industriels ;
– introduire dans l’Éducation nationale, contre l’emprise des réseaux sociaux, des cours d’éducation aux règles déontologiques d’établissement de la vérité, que celle-ci soit d’ordre journalistique ou scientifique57 ;
– inscrire dans la loi l’interdiction du recrutement local à l’université ;
– interdire la mention des appartenances syndicales dans l’élection des membres du Comité national du CNRS ;
– exiger des institutions académiques qu’elles soient plus exigeantes sur les atteintes à l’intégrité scientifique commises par les chercheurs et qu’elles mettent systématiquement en œuvre les sanctions prévues par les règlements ;
– créer une instance d’évaluation contradictoire permettant la contestation, voire l’annulation des résultats d’une soutenance au terme d’un débat entre spécialistes sur la qualité scientifique de la thèse ;
– renforcer le contrôle du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) sur les enseignements, ainsi que sur les revues en open edition, en refusant leur homologation en cas de revues insuffisamment ouvertes en matière de thématiques ou d’options épistémiques, refuser la prise en compte dans les dossiers de candidatures des publications non homologuées ;
– soutenir institutionnellement l’organisation des savoirs par disciplines et limiter l’organisation par objets (studies) aux équipes et projets temporaires initiés par des enseignants-chercheurs ;
– réaffirmer le critère primordial de la compétence du chercheur dans la cooptation des jurys de soutenance et de recrutement ou promotion, proscrire le critère de stricte parité au profit d’une attention à une présence équilibrée (notamment par rapport à la population de référence) des membres des deux sexes ;
– abroger les articles L123-2 et L123-6 du Code de l’éducation, qui peuvent à la rigueur s’appliquer à l’éducation des élèves mais n’ont pas à être imposés aux enseignants-chercheurs, lesquels sont libres de décider des contenus de leurs enseignements et de leurs recherches ;
– mobiliser les diverses académies (sciences, médecine, sciences morales et politiques) pour qu’elles réaffirment la nécessité de l’autonomie de la science, sa distinction d’avec l’opinion et le militantisme, ainsi que l’importance de la visée d’objectivité et le rôle fondamental de la neutralité comme conditions d’exercice de la liberté académique.
Conclusion
Nous venons de constater qu’il faut élargir la question de l’autonomie de la science au-delà des contraintes et menaces externes pour pouvoir mesurer l’ampleur du problème posé par les atteintes internes au monde académique lui-même. Celles-ci n’ont cessé d’augmenter dans la dernière génération en raison de la légitimation d’objectifs militants assignés à la recherche et à l’enseignement, corrélative d’une surestimation de l’opinion personnelle au détriment de la production de connaissances.
L’autonomie de la science est une conquête des Lumières, qui a subi dans l’histoire de nombreuses entorses, lesquelles ont permis d’en réaffirmer la légitimité et d’en consolider les garanties. La régression à laquelle nous assistons actuellement n’est pas inéluctable : nous pouvons, en en prenant conscience et en apportant les contre-feux nécessaires, faire en sorte que se poursuive le progrès vers l’autonomisation de la production et de la transmission des connaissances, pour le bien de tous.

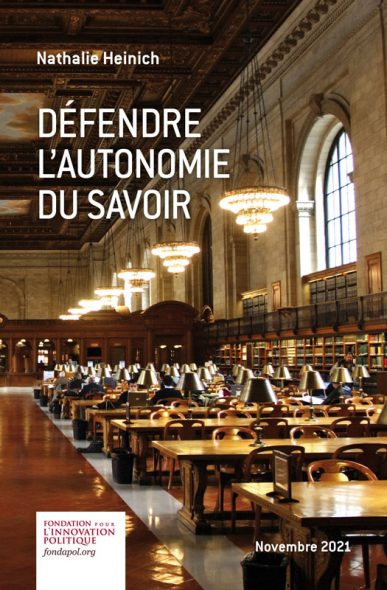
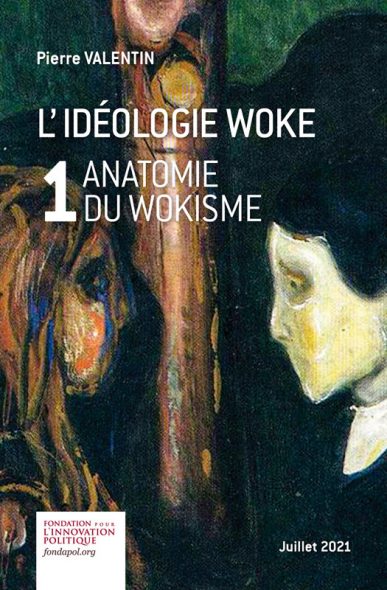
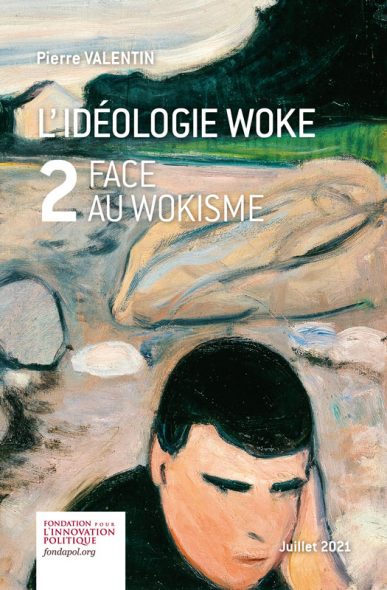
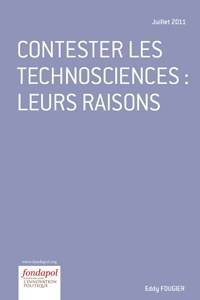








Aucun commentaire.