Où va la politique de l’Église catholique ? D’une querelle du libéralisme à l’autre
I – D’un totalitarisme à l’autre
L’autonomie individuelle en débat : vers un nouveau laïcisme ?
Vatican II en perspective
Retour du religieux et laïcité positive
On trouvera facilement des statistiques sur les croyances et les pratiques religieuses des Français en consultant les sites internet des principaux instituts de sondage : iFop, BVA, IPSOS, TNS, SOFRES…
D. Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, Paris, Bayard, 2003. On le sait, il est difficile d’évoquer l’Église catholique en général, car « l’Église, c’est un monde ». il n’est pas toujours aisé de faire la part de sa dimension nationale et de sa dimension internationale, de la curie romaine et du reste, des laïques et des clercs, de sa dimension populaire et de sa dimension intellectuelle, ni même, à supposer que ces noms lui conviennent, de sa « droite » et de sa « gauche ». E. Poulat, L’Église, c’est un monde. L’ecclésiosphère, Paris, Éditions du Cerf, coll. « sciences humaines et religions », 1986 ; J.-M. Donegani, La Liberté de choisir. Pluralisme religieux et pluralisme politique dans le catholicisme français contemporain, Paris, Presses de Sciences Po, 1993 ; J. Baudouin et P. Portier (dir.), Le Mouvement catholique français à l’épreuve de la pluralité. Enquête autour d’une militance éclatée, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Des sociétés », 2002.
O. Landron, Les Communautés nouvelles. Nouveaux visages du catholicisme français, Paris, éditions du cerf, coll. « histoire », 2004. Sur le tournant de 1975 : G. Cholvy et Y.-M. Hilaire, Le Fait religieux aujourd’hui en France. Les trente dernières années (1974-2004), Paris, Éditions du Cerf, 2004.
Avec le concile Vatican II (1962-1965), l’Église semblait se rallier à l’opinion publique «avancée». Depuis, elle a donné l’impression d’en appeler moins à la liberté qu’au cadre moral contraignant qui, pour elle, donne un sens à la liberté. La figure de Jean-Paul II demeurait associée à la lutte contre le communisme et à l’alliance avec le centre gauche laïque (Solidarnosc). La figure de Benoît XVI, celle d’un théologien distingué, apparaît liée à une rébarbative «orthodoxie». Ces questions d’image soulèvent des enjeux fondamentaux. La défense catholique de positions impopulaires sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), la morale sexuelle ou la bioéthique constituent un test pour l’avenir de la liberté religieuse, pour le sens de l’autonomie individuelle, et donc pour le type de démocratie libérale auquel nous aspirons.
Le catholicisme demeure la religion de la majorité des Français, et il serait imprudent de croire que la tendance des cinquante dernières années constitue nécessairement la meilleure indication sur celle des cinq décennies à venir. La grande ignorance de la Bible et du catéchisme, l’audience limitée d’évêques dont l’autorité est peu reconnue, la diminution des ordinations sacerdotales, la baisse du nombre des baptêmes et la faible pratique religieuse accréditent la thèse d’un catholicisme politiquement insignifiant, dont il serait raisonnable d’ignorer l’existence1. Mais l’histoire religieuse de la France est faite de hauts et de bas. Si l’on s’avise que, même aux époques dites de «chrétienté», la pratique et la croyance variaient sans doute nettement plus qu’on ne se l’imagine en général, la situation présente ne permet pas de prédire l’avenir.
On peut noter que, sous l’influence du libéralisme et de la démocratie, le catholicisme est devenu bien souvent une option strictement personnelle plus qu’une instance structurante pour la société – que le catholicisme d’aujourd’hui ressemble moins à celui du XIXe siècle qu’au protestantisme libéral 2. Mais on peut aussi noter que l’impulsion donnée par Jean-Paul II et par Benoît XVI va dans un sens très différent. Dans l’ensemble, les jeunes évêques sont plus conservateurs que leurs aînés, et les jeunes prêtres sont plus conservateurs que les jeunes évêques. Les « communautés nouvelles » qui ont émergé depuis 1970 (Renouveau charismatique, communautés de Saint-Jean, de l’Emmanuel, des Béatitudes notamment) offrent l’une des faces les plus dynamiques et imaginatives de l’Église de France ; mais elles joignent à leur capacité de renouvellement un réel classicisme en matière de mœurs et de doctrine ainsi qu’un certain conservatisme politique; elles sont plus «attestataires» que contestataires3. En janvier 2009, la levée de l’excommunication des évêques ordonnés par Mgr Lefebvre a pu faire penser que Benoît XVI cherchait à se rapprocher des opposants les plus farouches au concile. L’interrogation se répand : les plus hautes autorités de l’Église seraient-elles désireuses de tirer un trait sur Vatican II ?
Cette question offre, parmi d’autres fils conducteurs possibles, un angle d’attaque fécond pour une analyse de la direction dans laquelle l’Église catholique semble se diriger. Une Église « de droite » reviendrait-elle sur un concile « de gauche » ? On ne saurait répondre à cette question sans se pencher au préalable sur l’évolution des démocraties libérales – sur lesquelles je centrerai mon propos, avec un accent tout particulier sur la France. L’apparente distance avec ce qu’on appelle « l’esprit » de Vatican II n’est intelligible que par référence à l’évolution de ces démocraties.
I – D’un totalitarisme à l’autre
A. Michnik, L’Église et la Gauche. Le dialogue polonais [1977], trad. A. Sonimski et K. Jeleski, Paris, le seuil, coll. « Essais », 1979, p. 141.
Id., ibid., p. 27.
Id., ibid., p. 170.
Id., ibid., p. 129.
Jean-paul II, Evangelium vitae, § 18, 1995.
Id., ibid., § 20. sur la signification des années 1960 pour les églises, voir H. McLeod, The Religious Crisis of the 1960s, Oxford, Oxford University Press, 2007.
L. Kolakowski, « the revenge of the sacred in secular culture », in Modernity on Endless Trial, chicago, the university of chicago press, 1990, p. 63-85. sur l’existence d’un totalitarisme démocratique, voir par exemple : A. Kolnai, Privilege and Liberty and Other Essays in Political Philosophy, Lanham, Lexington Books, 1999.
Jusqu’à la chute du mur de Berlin, en 1989, l’Église était résolument du côté de la liberté contre la tyrannie communiste. Pape polonais, Jean- Paul II symbolisait l’association de l’Église et du centre gauche laïque contre le totalitarisme. Voici ce qu’écrivait en 1977 l’un des intellectuels de Solidarnosc, Adam Michnik, un agnostique d’origine juive : « Tous les hommes de bonne volonté s’opposent au processus de soviétisation qui progresse […]. Mais c’est l’Église qui oppose la résistance la plus systématique4. » Ces lignes sont tirées d’un livre que Michnik destinait à ses camarades laïques, pour qu’ils ne se trompent pas d’adversaire. L’Église n’est pas un adversaire irréductible de la liberté individuelle. Même sous des apparences réactionnaires, l’Église protège sa propre liberté et donc la liberté elle-même. « Ne devrions-nous pas – nous, la gauche laïque – comprendre enfin que, face à une dictature totalitaire, les notions de “progrès” et d’“obscurantisme”, les divisions telles que “la droite” et “la gauche”, deviennent moins fondamentales que la ligne de division principale qui sépare les adeptes du totalitarisme de ses adversaires ? Et ne devrions-nous pas – en partant de cette constatation – revoir notre opinion traditionnelle sur la position et le rôle de l’Église catholique dans la Pologne d’après-guerre5 ?» La gauche découvre qu’elle doit abandonner son anticléricalisme militant si elle veut être du côté de la liberté vraie. Pour Michnik, les nefs sont bizarrement les seuls endroits que n’atteint pas le mensonge bureaucratique; le latin d’église permet de garder confiance dans la valeur de la parole humaine qui, hors de là, est systématiquement manipulée; le catéchisme à l’école impose des limites à l’endoctrinement scolaire par le régime communiste. « La liberté religieuse est le signe le plus visible du fonctionnement réel des droits civiques. L’attentat du pouvoir contre cette liberté est toujours un symptôme de la totalitarisation de la vie intellectuelle. Il n’y a pas d’exception à cette règle, parce que le pouvoir totalitaire est le seul à ne pouvoir accepter l’exhortation de saint Pierre et des apôtres : “Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes”6. »
L’évolution politique du centre gauche laïque, dont Michnik se fait le porte-parole, a son symétrique dans l’Église catholique. Cette dernière a longtemps été méfiante à l’égard des droits de l’homme, dans lesquels elle voyait une affirmation unilatérale de la liberté individuelle, au détriment de la vérité. Elle a longtemps eu tendance à préférer aux régimes libéraux sortis de la Révolution française des régimes plus conservateurs et plus autoritaires – en Pologne et ailleurs. Au XXe siècle, il lui a fallu se résoudre à l’évidence : l’alternative à la démocratie libérale n’est désormais plus la monarchie tournée vers l’Ancien Régime, mais la révolution totalitaire. D’où le message de Noël 1944, à l’occasion duquel Pie XII a affirmé la valeur éminente de la démocratie. D’où, à Vatican II, au cœur de la guerre froide, la reconnaissance de la liberté religieuse, dont l’Église a fait la pierre d’angle de sa philosophie politique. D’où, encore, la réconciliation que décrit Michnik entre l’Église catholique et l’intelligentsia libérale.
Michnik avait imaginé un avenir pacifié. « Le concept d’un État laïque est aujourd’hui antitotalitaire et non anticlérical. Le conflit ouvert entre l’intelligentsia libérale laïque et l’Église est un chapitre fermé – espérons pour toujours ! – de l’histoire européenne7. » Michnik écrivait ces lignes en 1976. Il ne s’apercevait pas que, depuis près d’une décennie, le conflit s’était déjà rouvert sur un autre plan. La révolution culturelle des années 1960 sépare les parties en présence : d’un côté, ceux qui interprètent cette révolution culturelle avant tout comme une libération (libération des femmes, libération sexuelle, approfondissement de l’individualisme et sécularisation…) ; de l’autre, ceux qui s’inquiètent d’innovations en matière morale et du mépris, selon eux, des droits des plus faibles (les embryons). Par la voie de ses plus hautes autorités, l’Église tend à se situer dans le parti des anxieux. Elle tend à s’opposer à l’évolution des mœurs, dans laquelle elle ne voit pas une libération, mais une aliénation. L’objet du désaccord n’est donc plus la démocratie libérale, qui a les faveurs de l’Église catholique. L’objet du désaccord porte non plus sur la pertinence du libéralisme politique, mais sur son interprétation. La liberté de l’individu implique-t-elle la légalisation de l’IVG, de l’euthanasie ?… Jean-Paul II s’inquiète de voir « les crimes contre la vie » interprétés comme « des expressions légitimes de la liberté individuelle ». Pour le pape, la difficulté est non pas l’idéologie des droits de l’homme, mais, au contraire, l’existence de mesures qui « représentent une menace directe envers toute la culture des droits de l’homme8 ». Le droit à l’IVG est dénoncé comme une violation radicale de la justice la plus élémentaire : « Le “droit” cesse d’en être un parce qu’il n’est plus fermement fondé sur la dignité inviolable de la personne mais qu’on le fait dépendre de la volonté du plus fort. Ainsi, la démocratie, en dépit de ses principes, s’achemine vers un totalitarisme caractérisé9. » Pour l’Église, quand l’affirmation de l’autonomie de la volonté aboutit à une remise en cause de la séparation du profane et du sacré et à l’idée que tous les problèmes humains sont susceptibles d’une solution technique, le libéralisme s’apparente au totalitarisme10.
Dans les démocraties bourgeoises, le débat se se situe plus aujourd’hui entre régimes politiques libéraux et régimes politiques antilibéraux, il s’agit plutôt de savoir quel régime libéral est vraiment libéral. Sur le plan politique, qu’on peut comprendre par rapport à l’alternative libéralisme- totalitarisme, l’Église est bien du côté du libéralisme. Sur le plan des mœurs, elle apparaît frileuse, hostile aux plaisirs et au Progrès – en rupture avec l’opinion publique libérale… L’animosité de l’Église catholique ne va plus aux droits de l’homme, au libéralisme politique : elle va à l’interprétation des conséquences du libéralisme, au sens de l’autonomie individuelle.
Pour une partie de l’Église catholique, il s’agit de continuer le combat contre la menace totalitaire, à ceci près qu’au totalitarisme brutal des communistes s’est substituée la menace d’un totalitarisme rampant qui revêt de manière sournoise les atours du libéralisme politique. Pour une partie de l’intelligentsia laïque, en sens contraire, le droit à l’IVG, le droit de mettre un terme à la souffrance par l’euthanasie, les transformations récentes de la morale sexuelle relèvent désormais des droits les plus élémentaires. Ceux qui s’y opposent sont décrits comme fondamentalistes. On en vient à juger rétrospectivement que, en dépit de sa réputation libérale, l’univers bourgeois (et souvent chrétien) qui a été rejeté dans les années 1960 avait quelque chose d’essentiellement illibéral et même sans doute totalitaire. De ce point de vue, il importe de lutter contre l’Église catholique au nom de la liberté, il s’agit de persévérer dans le combat contre le totalitarisme en limitant de manière drastique l’in- fluence sociale et politique de l’Église. L’Église paraît se situer non du côté des partisans de la liberté, mais du côté de ses adversaires chagrins. Elle semble plus désireuse de limiter les excès de la liberté que de l’encourager. Elle passe moins pour une puissance émancipatrice que pour une puissance conservatrice soucieuse de ralentir les évolutions en cours plutôt que de les accélérer. Théologien distingué, Benoît XVI apparaît avant tout comme l’intransigeant défenseur de l’«orthodoxie», qui a souvent mauvaise presse à l’ère démocratique, éprise de nouveautés. Son absence relative de charisme, surtout par comparaison avec Jean- Paul II, semble confirmer dans les esprits l’orientation moins populaire de l’Église.
L’autonomie individuelle en débat : vers un nouveau laïcisme ?
I. Berlin, Éloge de la liberté [1969], trad. J. Carnaud et J. lahana, Calmann-Lévy, 1988 ; H. L. A. Hart, Law, liberty, and morality, Oxford, Oxford University Press, 1963 ; A. Macintyre, Après la vertu [1981], trad. L. Bury, Presses Universitaires de France, coll. « Léviathan », 1997.
Les réactions à l’encyclique ont été réunies dans cet ouvrage : F. V. Joannes (dir.), L’humanae vitae, Milan, Mondadori, 1969. Voir également P. Airiau, « Essai d’une histoire profane d’Humanae vitae », in Airiau et al., Corps, raison et foi : l’actualité d’Humanae vitae, Paris, Collège des Bernardins, coll. « colloques », 2009, p. 9-45.
Les évêques britanniques étant divisés sur la réponse politique qui convenait, une confrontation majeure a été évitée.
Congrégation pour la doctrine de la foi, Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, § 4, 2003 et Catéchisme de l’Église catholique, § 2358. dans le grand débat des années 1950 et 1960 sur le statut juridique de l’homosexualité au Royaume-Uni, par exemple, l’église catholique était en faveur de la dépénalisation.
C. E. Curran, Loyal Dissent. Memoir of a Catholic theologian, Washington, D.C., Georgetown University Press, 2006. à mesure que la hiérarchie devient plus conservatrice, on peut s’attendre à davantage de tensions avec les laïques.
Congrégation pour la doctrine de la foi, Note doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, § 2, 2002. Dans d’assez larges milieux catholiques, l’affaire Buttiglione a été considérée comme une illustration de cette crainte. pressenti pour occuper le poste de commissaire européen chargé de la Justice, des libertés et de la sécurité, Rocco Buttiglione, un intellectuel et un homme politique proche du vatican, a suscité une vive polémique par ses prises de position sur l’homosexualité active (qu’il considérait, du point de vue moral, comme un péché), en dépit du fait qu’il affirmait distinguer nettement le droit et la morale. Buttiglione a dû retirer sa candidature. il faut ajouter que : a) Buttiglione était berlusconien ; b) Buttiglione avait proposé un amendement pour retirer l’orientation sexuelle des motifs de discrimination quand il était membre de la convention européenne chargée de préparer la charte sur les droits fondamentaux.
Par exemple : R. Audi, « The separation of church and state and the obligations of citizenship », Philosophy & Public Affairs, vol. 18, n° 3, 1989, p. 259-296 ; et vol. 20, n° 1, 1991, p. 52-65.
Deux philosophies s’opposent, qui ont été élaborées dans le monde anglo-saxon. Les uns considèrent que la liberté individuelle doit être comprise comme la possibilité de choisir soi-même son idée du bonheur et sa morale, et ils tendent à penser que l’affirmation d’une idée objective du bien fait le lit de tous les antilibéralismes (c’est la thèse d’Isaiah Berlin sur la liberté négative, de Herbert Hart sur le droit). Pour eux, la morale est l’affaire de l’individu, et non de l’État ou d’autres organisations collectives (comme l’Église). Les autres considèrent que l’autonomie de l’individu doit être comprise par référence à un cadre moral qui lui donne son sens et sa portée. Ils estiment que la liberté individuelle n’est intelligible que par rapport à un ordre moral objectif (c’est la thèse d’Alasdair MacIntyre)11. Pour ceux-ci, il n’y a pas de sens à demander que l’État – ou d’autres organisations collectives – s’abstienne d’inter- venir en matière morale, parce qu’il le fait nécessairement. À leurs yeux, l’idée que seul l’individu choisisse sa morale ou que la morale relève exclusivement de la sphère individuelle est une illusion ou une utopie. L’Église catholique se range dans ce second camp; une partie active de l’intelligentsia laïque appartient au premier. La morale sexuelle offre une bonne illustration de ce désaccord.
Aujourd’hui, le critère de ce qui est légitime est lié non plus à l’institution du mariage et à la reproduction, mais au seul consentement (le mariage passe également par le consentement, mais associe ce consentement à une promesse de fidélité contraignante et, du point de vue catholique, à une ouverture à la fécondité). Ce qui est condamné est donc non plus la sexualité hors mariage dans son ensemble (homosexuelle, prémaritale ou adultère), mais, de manière plus limitée, le viol (qui exclut par définition le consentement) et la pédophilie (dont les victimes ne sont pas en âge de consentir). Le droit de la famille, tel qu’il était encore compris il y a à peine quelques décennies dans un contexte encore chrétien, semble avoir subitement disparu. L’idée du consentement qui est à l’œuvre dans le mariage est systématiquement subordonnée à une autre idée du consentement, plus subjective, qui ne passe pas par des institutions qui font autorité. Cette mutation de la morale sexuelle place l’Église en porte-à-faux. Elle apparaît rétrospectivement comme ayant été en pratique gravement complaisante à l’égard de certains comportements (comme la pédophilie). Elle apparaît comme décalée par rapport à la transformation de la perception de l’homosexualité et par rapport à l’usage des contraceptifs. L’encyclique Humanae vitae (1968), qui a désapprouvé toute méthode artificielle de régulation des naissances, a fait l’objet d’une réception particulièrement critique12.
Au Royaume-Uni, l’Église catholique a été contrainte de fermer ses agences d’adoption, parce qu’elle se refusait à traiter les couples homo- sexuels de la même manière que les couples hétérosexuels. En dépit du fait que les couples homosexuels pouvaient avoir accès à de nombreuses agences d’adoption non catholiques, les agences catholiques ont été condamnées comme discriminatoires 13. Par ailleurs, la question du droit de l’Église catholique (et d’autres confessions religieuses) à enseigner dans leurs propres écoles que les actes homosexuels sont un péché pourrait, à terme, être remise en cause. Cette dernière question est particulièrement sensible. D’un côté, il apparaît comme évident que, au nom de la non-discrimination, il devrait être impossible d’encourager, même indirectement, des attitudes de profonde désapprobation à l’égard de l’homosexualité active. D’un autre côté, il apparaît difficile de nier à l’Église la liberté de demeurer fidèle à une éthique qu’elle ne se croit pas en droit de remettre en cause. La démocratie libérale peut-elle contraindre l’Église catholique à taire ou à changer ses conceptions morales? On n’a pas assez remarqué combien l’idée de non-discrimination (originelle- ment liée au racisme) transformait les conditions de la démocratie libérale, en impliquant une transformation profonde de la société par la loi.
Dans les trente dernières années, l’Église catholique a fait un effort croissant pour distinguer de manière de plus en plus nette l’orientation homosexuelle (qu’elle n’a ni à approuver ni à désapprouver, mais qu’elle doit constater) de l’activité sexuelle qui lui est associée (et qu’elle désapprouve). Pour les catholiques, cette distinction permet de fonder en raison une politique de non-discrimination à l’égard des homosexuels : les hommes et les femmes ayant des tendances homosexuelles « doivent être accueillis avec respect, compassion, délicatesse ; à leur égard, on évitera toute marque de discrimination injuste14 ».Cependant, il est évident que ces inflexions du discours de l’Église ne suffisent pas aux yeux de tous ceux qui sont en faveur d’une révision radicale de son enseignement sexuel.
Cependant, la question de l’homosexualité n’est pas l’essentiel; au sein même de l’Église catholique, elle fait l’objet de débats virulents15. La question de l’homosexualité est surtout un révélateur d’enjeux plus généraux. En 2002, la Congrégation pour la doctrine de la foi s’est inquiétée de voir « la tolérance invoquée de manière malhonnête lorsqu’on demande à un grand nombre de citoyens (et parmi eux, des catholiques) de ne pas fonder leur contribution à la vie sociale et poli- tique sur leur compréhension particulière de la personne humaine et du bien commun16 ». Un nouveau débat se développe sur la justification de l’utilisation de références ou de catégories de pensée religieuses dans la sphère publique. Cette question se répand dans une grande partie du monde libéral17. La question est de savoir si l’expression publique de convictions religieuses est, en soi, une menace pour le débat démocratique. Pour certains, il faut que la société soit laïque, et non pas seulement l’État ; la religion doit alors demeurer dans le for intérieur, être une affaire purement privée. Naguère tenue pour parfaitement défendable et compatible avec les meilleures traditions démocratiques, l’idée de partis confessionnels démocrates-chrétiens dans lesquels la hiérarchie de l’Église pourrait avoir une certaine influence en vient à paraître incongrue et antilibérale. Au nom d’une certaine idée de l’autonomie individuelle, la séparation de l’État (laïque) et de la société (non laïque), qui fait le cœur du libéralisme classique, est importée dans la société même. Pour les Églises (catholique ou non), cette idée est évidemment difficilement acceptable, car elle revient à limiter drastiquement la liberté de mouvement, la liberté d’initiative, la liberté d’expression, pour des motifs qui ne sont pas d’ordre public (les seuls motifs qui soient en principe acceptables en régime libéral). La crainte d’un totalitarisme rampant trouve ici l’une de ses sources : l’autonomie de l’Église serait mise en cause, son existence comme corps distinct, comme ordre juridique spécifique, comme forme sociale serait menacée.
Bien évidemment, l’Église catholique cherche à éviter que la « bonne nouvelle » dont elle se veut porteuse ne soit réduite à un discours de type répressif sur la sexualité (ou sur l’euthanasie, ou sur l’IVG). Elle entend proposer un discours positif, et non pas des condamnations systématiques – un discours qui embrasse les questions les plus vastes. Après tout, le cœur de son message est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Ainsi, de manière significative, la première encyclique de Benoît XVI portait le titre Deus caritas est (« Dieu est amour »). L’Église entend ne pas se laisser enfermer dans des débats qui risquent d’affaiblir la portée de son enseignement moral et spirituel. S’agissant des questions de société, elle est désireuse de mettre au premier plan sa doctrine sociale, ses critiques du libertarisme économique, son insistance sur la nécessaire régulation de l’économie, sa défense des plus pauvres et du rôle des syndicats. Qu’on songe par exemple à l’encyclique de Benoît XVI, Caritate in veritate, de juin 2009. Mais il est frappant que les problèmes qu’elle cherche à éviter reviennent régulière- ment dans les débats publics. Dans les démocraties libérales, la doctrine sociale de l’Église ne mord pas sur l’opinion publique, parce qu’elle ne heurte pas les sensibilités de l’époque et parce que la question sociale a partiellement quitté le devant de la scène, à la différence des problèmes qui touchent le sens de l’autonomie individuelle.
Vatican II en perspective
Déclaration dignitatis humanae sur la liberté religieuse, II, 2, 1965. comparer avec R. Aubert, « l’enseignement du magistère ecclésiastique au XIXe siècle sur le libéralisme », in R. Aubert et al., Tolérance et communauté humaine (Cahiers de l’actualité religieuse), Tournai, Casterman, 1952, p. 75-103.
Congrégation pour la doctrine de la foi, Note doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, § 8, 2002.
P. Ladrière, « Le catholicisme entre deux interprétations du concile vatican II. Le synode extraordinaire de 1985 », Archives de sciences sociales des religions, vol. 62, n° 1, 1986, p. 9-51 ; R. Luneau (dir.), Le Rêve de Compostelle. Vers la restauration d’une Europe chrétienne ?, Paris, Centurion, 1989.
D. Pelletier, La Crise catholique. Religion, société, politique en France (1965-1978), Paris, Payot, 2002. Dans une veine plus polémique : M.-D. Chenu, La « Doctrine sociale » de l’Église comme idéologie, Paris, Éditions du Cerf, 1979 ; L. Bouyer, La Décomposition du catholicisme, Paris, Aubier-Montaigne, 1968 ; A. Besançon, La Confusion des langues. La crise idéologique de l’Église, Paris, Calmann-Lévy, 1978, repris dans A. Besançon, Trois tentations dans l’Église, Paris, Perrin, 2002.
J. Ratzinger, Libertatis nuntius, 1984 ; et, du même auteur, « Eschatologie et utopie », in Église, œcuménisme et politique, trad. E. Gagnon, P. Jordan, P.-E. Gudenus et B. Müller, Paris, Fayard, 1987, p. 311-334.
J. Ratzinger, Ma vie. Souvenirs (1927-1977), trad. M. Huguet, Paris, Fayard, 1998, p. 127-135.
H. U. Von Balthasar, Le Complexe anti-romain [1974], trad. Willibrorda, montréal, éditions Paulines, 1976 ; F.-G. Dreyfus, Des évêques contre le pape, Paris, Grasset, 1985 ; R. Luneau et P. Michel (dir.), Tous les chemins ne mènent plus à Rome. Les mutations actuelles du catholicisme, Paris, Albin Michel, 1995 ; H. Küng, Infaillible ? Une interpellation [1970], trad. H. Rochais, Paris, Desclée de Brouwer, 1971.
J. Ratzinger, Entretien sur la foi [1985], trad. E. Gagnon, Paris, Fayard, 1985, p. 27-59. La grande histoire du concile, rédigée sous la direction de Giuseppe Alberigo (Histoire du concile Vatican II, trad. E. Fouilloux et al., Paris, Éditions du Cerf, 1997-2004), a été contestée pour la place jugée excessive qu’elle faisait à l’« esprit » de ce concile. Voir A. Marchetto, Il Concilio ecumenico Vaticano II : Contrappunto per la sua storia, Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 2005.
G. M. Marsden, Fundamentalism and American Culture. The shaping of Twentieth Century Evangelicalism (1870-1925), Oxford, Oxford University Press, 1980.
L’Église catholique a longtemps condamné la liberté religieuse et donc le libéralisme, au nom des droits de la vérité : l’erreur n’avait pas de droits. Avec Vatican II, l’Église a reconnu le droit à la liberté religieuse. Mais elle n’a pas délaissé l’idée de vérité. Pour autant qu’il y ait une liberté de conscience et un devoir de suivre sa conscience, même erronée, cette liberté est ordonnée à la recherche de la vérité18. Le libéralisme que l’Église recommande est le libéralisme qui permet de trouver la vérité à la lumière de l’enseignement du Christ. Dans les décennies qui ont suivi le concile, les instances les plus hautes du Vatican ont semblé déçues par la formule à laquelle elles s’étaient finalement ralliées. Un certain nombre de textes officiels, dont le plus important est l’encyclique Veritatis splendor (1993), ont surtout mis l’accent sur l’importance de la vérité, comme si l’équilibre recherché en 1965 entre liberté et vérité ne s’était pas traduit dans les faits de manière satisfaisante. Voilà ce qu’on lit par exemple sous la plume du cardinal Ratzinger, en 2002 : « Il est bon de rappeler une vérité qui n’est pas toujours perçue aujourd’hui ou qui n’est pas formulée de manière exacte dans l’opinion publique courante : le droit à la liberté de conscience, et spécialement à la liberté religieuse, proclamé par la déclaration Dignitatis humanae du concile Vatican II, se fonde sur la dignité ontologique de la personne humaine, et en aucun cas sur une égalité qui n’existe pas entre les religions et entre les systèmes culturels humains19. »
Renouant avec la vieille critique catholique de l’indifférentisme (l’idée que la liberté religieuse rend indifférent à la vérité), Ratzinger dénonce le culturalisme et le subjectivisme généralisé, auxquels il oppose une idée objective de la vérité. Sans revenir sur les grands principes consacrés par Vatican II, Jean-Paul II puis Benoît XVI ont eu le sentiment que, dans le sillage du concile et des mutations culturelles associées à 1968, la recherche de la vérité était de plus en plus séparée de la transmission du révélé, l’Église et la société perdant leurs repères. Sans remettre en cause la reconnaissance de la liberté religieuse, ils se sont inquiétés des interprétations qui étaient faites de son sens et de sa portée. À leurs yeux, la liberté individuelle n’a pas été comprise de manière adéquate, comme en témoignent les débats évoqués plus haut, de la morale sexuelle à l’euthanasie.
On évoque aujourd’hui une remise en cause de Vatican II de la part du Saint-Siège. Alors que l’Église avait semblé désireuse de se fondre dans le monde démocratique et libéral au moment du concile, le Saint-Siège paraît aujourd’hui vouloir prendre ses distances. À la suite de Vatican II, les prêtres ont cherché à se mêler aux laïques, abandonnant la soutane pour le veston. Sous Jean-Paul II puis Benoît XVI, la soutane a fait un retour en force, accompagnée du col romain, qui marque une certaine distance avec la société. On peut distinguer trois différentes interprétations de cette évolution depuis le concile.
Dans le premier schéma d’interprétation, l’évolution actuelle de l’Église catholique s’explique par des mutations postérieures à Vatican II. Quant à l’essentiel, c’est après le concile que les questions de morale sexuelle et de bioéthique ont ramené l’Église catholique à une posture plus critique vis-à-vis de l’opinion avancée des démocraties libérales. Le changement de style et de ton de l’Église catholique ne renvoie donc pas tant à une remise en cause du concile lui-même qu’au caractère éphémère de la situation dont Vatican II est le produit ou l’expression : un moment où les démocraties libérales apparaissaient comme nettement préférables au communisme qu’elles combattaient; un moment fragile où l’exaltation de la liberté individuelle s’harmonisait avec la tradition chrétienne. On a souvent remarqué que Vatican II était le premier concile qui ait été convoqué non sous la pression d’une crise, mais à un moment de sérénité. De ce point de vue, Vatican II pourrait n’avoir été qu’une épiphanie, importante par les promesses de réconciliation qu’elle suppose, mais toujours provisoire.
Dans le deuxième schéma d’interprétation, les églises locales et les laïques auraient dû prendre le pouvoir dans l’Église, mais ils en ont été empêchés pas le conservatisme romain. Le concile ayant mis en avant le rôle d’institutions collégiales, les partisans les plus convaincus de ces institutions se sont, dès l’origine, méfiés du pouvoir centralisateur de la curie. À un titre ou à un autre, tous les papes ont été accusés de vouloir revenir sur Vatican II. La version faible de cette deuxième interprétation renvoie à la sociologie des organisations : par nature, les administrations s’efforcent d’accumuler le plus de pouvoir possible. La version forte renvoie à une conception révolutionnaire de Vatican II, que la hiérarchie ecclésiastique aurait trahie. Il y aurait eu sinon une contre-révolution au sommet de l’Église, du moins un Thermidor20. Dans des milieux restreints mais très actifs, on est venu à considérer que le monde démocratique réalisait le christianisme, comme si le christianisme se résumait en «valeurs» (la liberté, l’égalité, la fraternité) que la modernité incarnait, comme si le christianisme cessait d’être une religion d’interdits, d’ex- communications, une affaire de morale ou d’ascétisme, et devenait une question d’«idéaux». « L’esprit du concile » a suscité un enthousiasme parfois débordant, au prisme du marxisme ou d’autres doctrines apparentées21. Par contraste, le catholicisme contemporain, tel qu’il s’est redéfini sous Jean-Paul II puis Benoît XVI, a rompu avec ce progressisme. La théologie de la libération a été dénoncée avec vigueur22. À la fin des années 1960 et dans la première moitié des années 1970, Ratzinger s’est préoccupé de l’émergence d’une théologie qu’il considérait comme coupée de ses racines, contaminée par des visées politiques qu’il jugeait incompatibles avec la nature intrinsèque du discours théologique23. Une sensibilité moins démocratique et moins politique s’est imposée, au grand regret de ceux qui avaient vu dans le concile une mutation quasi messianique. Contre les papes des dernières décennies, on a vu ressurgir un certain gallicanisme, un certain nationalisme religieux. On a vu une sorte de complexe anti-romain, des évêques contre le pape, et d’assez nombreux catholiques ont soutenu que Tous les chemins ne mènent plus à Rome24.
Une troisième interprétation replace Vatican II dans la longue durée. Elle consiste à montrer que le concile prolonge l’œuvre de Vatican I (1869-1870). Connu surtout pour la déclaration sur l’infaillibilité pontificale, ce concile consacre l’importance renouvelée du rôle que joue le Saint-Siège à l’ère démocratique. Sous l’Ancien Régime, les catholiques étaient le plus souvent nationalistes, gallicans, peu désireux d’accorder le moindre poids à la papauté. La déconfessionnalisation des États, à la suite de la Révolution française, a impliqué un transfert des allégeances. Les catholiques ont été chercher à Rome l’autorité religieuse qu’ils ne trouvaient plus dans leurs États respectifs. Le premier concile du Vatican, qui ne manque pas d’aspects réactionnaires, adapte pourtant l’Église à la déconfessionnalisation de l’État. Il y a un élément libéral dans l’attachement au pape (l’ultramontanisme) qui triomphe : les catholiques n’auraient pas accordé tant d’importance à Rome s’ils n’avaient pas tenue pour acquise l’existence d’un élément essentiellement laïque dans l’État démocratique et libéral. De ce point de vue, le concile Vatican II complète l’œuvre de Vatican I. L’adaptation de l’Église au monde démocratique s’est faite en deux temps, avec ces deux conciles. Les continuités l’emportent largement sur les discontinuités. Ce sont deux étapes dans la prise de conscience que l’Église acquiert d’elle-même comme société distincte, à la lumière de l’évolution politique de l’Europe. Vatican II doit être compris non par référence à son « esprit », notion trop vague, mais par rapport à la substance des textes, nettement plus prudente et modérée que ne l’imaginent les catholiques les plus progressistes25.
De Paul VI à Benoît XVI, les papes ont souligné à l’envi leur fidélité à Vatican II en même temps qu’ils insistaient sur la continuité entre Vatican I et Vatican II. Plus on met en avant l’unité de ces conciles et la longue durée, moins le soupçon d’une trahison de Vatican II n’a de sens. La crainte d’un « retour en arrière », d’une réaction ou d’une contre- révolution n’est justifiée que si le concile marque une césure de grande ampleur. Si les deux conciles du Vatican constituent, de concert, une « réforme vaticane » cohérente, le tempérament plus romain de la nouvelle génération de prêtres n’implique pas nécessairement une incompréhension du monde moderne. A contrario, l’affirmation de la continuité entre Vatican I et Vatican II est apparue comme une trahison à beaucoup de catholiques de gauche.
Il convient de souligner que plus on accorde d’importance à la première de ces interprétations (le changement après Vatican II), moins on est susceptible d’accorder de crédit à la version forte de la deuxième (Thermidor ou la contre-révolution). Plus l’Église est hantée par le sentiment de la corruption intellectuelle de la société, plus elle ressent le besoin de se recentrer sur la papauté pour conserver l’intégrité de la révélation et de sa tradition. C’est ainsi qu’elle évite la réduction du dogme à la morale. Plus les croyants sont aliénés par la société, plus ils éprouvent le besoin de trouver une source d’autorité qui protège le dépôt de la foi, évitant qu’il ne soit édulcoré ou transformé. Placés dans la même situation, les évangélistes américains sont devenus fondamentalistes, trouvant dans l’Écriture, interprétée de manière littérale, une source d’infaillibilité, une manière de réaffirmer les dogmes26. La déclaration sur l’infaillibilité pontificale, en 1870, est une manière d’éviter le fondamentalisme. Pour contourner le libéralisme en théologie, l’Église catholique n’a pas besoin de faire du sens littéral du texte l’autorité finale, car elle peut s’en remettre à l’autorité du Saint-Siège. On peut assurément déplorer l’insuffisante place qui est aujourd’hui faite aux conférences épiscopales nationales, on peut regretter le caractère autoritaire, peu démocratique, de l’ultramontanisme; mais, s’il s’agit d’une parade au fondamentalisme, il faut reconnaître que ses inconvénients sont moindres.
Retour du religieux et laïcité positive
A. Latreille, « L’église catholique et la laïcité », in A. Audibert et al., La Laïcité, Vendôme, Presses Universitaires de France, 1960, p. 59-97 ; P. Portier, « L’église catholique face au modèle français de laïcité », Archives de sciences sociales des religions, vol. 129, n° 1, 2005, p. 117-134.
C. Nicolet, L’Idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, 1982, p. 187-277.
M. Gauchet, La Religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, coll. « Le débat », 1998, p. 103. voir également P. Valadier, Détresse du politique, force du religieux, Paris, Le Seuil, coll. « la couleur des idées », 2007.
M. Ozouf, L’École, l’Église et la République. 1871-1914, Vanves, Cana, 1982, p. 8. Républicains laïques et catholiques péguystes peuvent aujourd’hui aisément s’accorder : P. Raynaud et P. Thibaud, La Fin de l’école républicaine, Paris, Calmann-Lévy, 1990.
J. Ferry, arrêté du 27 juillet 1882 réglant l’organisation pédagogique et le plan d’études des écoles primaires publiques, Journal officiel, 2 août 1882, repris notamment par F. Buisson, article « laïcité », in Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, t. II, Paris, Hachette, 1888, première partie, p. 1473. C’est moi qui souligne.
C. Péguy, Notre jeunesse [1910], in Œuvres en prose complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la pléiade », t. III, 1992, p. 42.
N. Elias, La Civilisation des mœurs [1939], trad. P. Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy, 1973 ; et La Dynamique de l’Occident [1939], Paris, Calmann-Lévy, 1976.
Montesquieu, De l’esprit des lois, XXIV, 14.
A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. II, première partie, chap. V, « Comment, aux états-unis, la religion sait se servir des instincts démocratiques ».
A. de Tocqueville, Œuvres complètes, t. III, Écrits et discours politiques, vol. II, Paris, Gallimard, 1985, p. 494.
A. Comte, « Considérations sur le pouvoir spirituel » [1826], in Appendice général du système de politique positive, Paris, 1854, p. 188.
Id., ibid., p. 189.
J. Habermas, « Pluralisme et morale », Esprit, juillet 2004, p. 18. Voir aussi J. Habermas, Entre naturalisme et religion. Les défis de la démocratie, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2008, p. 170-211.
J. Habermas, « Pluralisme et morale », Esprit, op. cit., p. 14. voir Jean-paul II, Fides et ratio, 1998.
J. Habermas, L’Avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ? [2001], trad. C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2002.
Un nouveau laïcisme n’est pas à exclure, car la transformation des mœurs suscite des tensions croissantes entre l’intelligentsia laïque et certaines orientations suivies par l’Église catholique. Mais il est frappant que, parallèlement à ces tensions, on évoque aujourd’hui une version de la laïcité nettement plus favorable aux religions en général, et à l’Église catholique en particulier : la laïcité «positive» réclamée par Nicolas Sarkozy. Cette idée positive de la laïcité peut se comprendre de trois manières : par référence aux inflexions de l’enseignement politique catholique, par référence à la crise postmoderne du rationalisme, par référence à la réconciliation du républicanisme classique et du catholicisme au nom de la vertu morale et civique.
En premier lieu, il convient de noter que la vieille laïcité de combat est le résultat de circonstances très particulières, qui ont disparu. Les fondateurs de la IIIe République aspiraient raisonnablement et passionnément à un régime démocratique et libéral qui mette en pratique les idéaux révolutionnaires. Ils avaient contre eux certaines hautes instances de l’Église catholique, qui se défiaient de la démocratie et prêtaient une oreille attentive aux théoriciens de la contre-révolution. Or, la plupart des Français étaient catholiques. La laïcité était un moyen de contourner ce problème. Mais cette laïcité-là est aujourd’hui moins nécessaire. D’une part, l’Église s’est réconciliée avec la loi de 1905 telle qu’elle a été interprétée par la jurisprudence, et elle est même disposée à la défendre, car elle y voit des garanties pour sa propre autonomie27. D’autre part, l’Église s’est ralliée à l’idée de liberté religieuse qu’elle a consacrée de la manière la plus solennelle à Vatican II. La laïcité de combat des républicains de la IIIe République a donc perdu son objet. En outre, les républicains peuvent s’apercevoir que l’Église catholique présente aujourd’hui de sérieux avantages. À la différence de l’évangélisme protestant, l’Église catholique protège contre le fondamentalisme, qui est étranger à sa tradition. À la différence de certains courants de l’islam politique, elle offre des garanties de modération et de stabilité.
En deuxième lieu, on doit noter que la laïcité de combat a longtemps été justifiée au nom d’un type de rationalisme qui est aujourd’hui en crise. Ses théoriciens ont souvent été des positivistes ou des néo-kantiens qui estimaient pouvoir remplacer la religion par la raison28. L’idée dominante était que, avec les Lumières, l’homme était sorti de sa minorité, qu’il avait enfin pris son propre destin entre ses mains, qu’il avait conquis son autonomie. Les traditions, les coutumes, les religions renvoyaient à une figure dépassée de l’autorité. Dans la mythologie de la IIIe République, l’instituteur s’opposait au curé comme la raison s’opposait à l’irrationalisme moyenâgeux d’une Église qui aspirait de manière anachronique à l’alliance du Trône et de l’Autel. Il ne reste aujourd’hui plus grand-chose de cette mythologie, parce que les idéaux des Lumières ont été renversés par les esprits « avancés ». Depuis Nietzsche, mais sur- tout depuis Foucault, Lyotard ou Derrida, l’intelligentsia est supposée vivre dans l’ère postmoderne. La statue d’Auguste Comte, le fondateur du positivisme, reste place de la Sorbonne ; elle n’a pas encore été rem- placée par la statue de Michel Foucault ; mais le comtisme ne règne plus sur les intelligences. La science attire moins les étudiants que naguère. La Révolution française n’est plus censée incarner la Raison, l’« universel » n’étant que le faux nez de la « particularité » (bourgeoise, sexiste, impérialiste et esclavagiste). La philosophie s’auto-dévore; les philosophes sont devenus autophages. Une de nos fables convenues les plus chères est sur le point de disparaître : la religion du Progrès, la mythologie incantatoire dont ont vécu les esprits «avancés». L’obscurantisme n’a pas laissé place au règne éclairant des Lumières, les préjugés n’ont pas disparu. C’est notamment ainsi qu’on peut comprendre la phrase apparemment maladroite de Nicolas Sarkozy, dans son discours du Latran, en décembre 2007 : « Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s’il est important qu’il s’en approche, parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance. » Dans la lutte séculaire entre l’instituteur et le curé, le premier pouvait espérer remplacer le second ; il est désormais clair qu’il ne le peut pas. L’intérêt politique pour la religion renaît à mesure qu’on prend conscience des limites du rationalisme qui entend se substituer à la religion. « C’est ce collapsus des Lumières militantes au milieu des Lumières triomphantes qui remodèle le visage de la démocratie. C’est lui qui appelle les religions dans l’espace public », écrit par exemple Marcel Gauchet29. La laïcité positive est rendue nécessaire par l’épuisement du rationalisme positiviste et anticlérical, qui prive le rationalisme militant de sa substance et de son énergie.
En troisième lieu, la laïcité positive peut être interprétée à la lumière de la découverte ou de la redécouverte d’une certaine proximité entre l’enseignement de l’Église catholique et le libéralisme classique, tel qu’il s’est notamment incarné en France après 1880. L’individualisme radical qui tend à s’imposer aujourd’hui est dirigé contre l’Église catholique, mais aussi contre certains traits du républicanisme du type IIIe République. La critique de l’autorité morale atteint assurément le magistère de l’Église catholique, mais elle transforme également l’école républicaine. Par un curieux paradoxe, les républicains de 1880 apparaissent désormais comme ayant été très proches des catholiques qu’ils combattaient. Comme le remarque une historienne de l’école républicaine, « les manuels des deux écoles respiraient la même bonne conscience franco-centriste, exaltaient les mêmes grands hommes, donnaient les mêmes conseils. Puisqu’elle partageait sans le savoir les valeurs de l’école rivale, l’école laïque peut aujourd’hui parfois être présentée comme l’aboutisse- ment et même le triomphe ironique de la vieille école des Frères mise en place dès l’âge classique30 ».
Les républicains voulaient souvent se défaire de l’Église catholique, mais ils entendaient conserver précieusement la culture chrétienne. Pour Jules Ferry, « l’enseignement moral laïque se distingue de l’enseignement religieux sans le contredire31 ». Les républicains rejetaient le dogme et la hiérarchie (ce par quoi leur enseignement se distinguait de celui de l’Église), mais ils étaient attachés à la morale chrétienne, à laquelle ils n’entendaient pas substituer une autre morale, parce qu’il n’y en avait pour eux qu’une seule. L’Église catholique s’est ralliée d’autant plus volontiers à la République qu’on continuait, dans les lycées, à enseigner Racine, Pascal et Chateaubriand. Or, la nouvelle laïcité de combat menace à la fois la culture et la morale chrétiennes, contre lesquelles le républicanisme n’avait pas d’objection. Du point de vue des républicains classiques, l’existentialisme militant, qui, depuis les années 1960, transforme l’école et la société, pourrait se révéler délétère. Corrélativement, la laïcité positive renverrait ici à l’intérêt croissant des républicains classiques pour le catholicisme. Péguy note que « le mouvement de dérépublicanisation de la France est profondément le même mouvement que le mouvement de sa déchristianisation32 ».
Norbert Elias a décrit la naissance de l’âge moderne comme un « processus de civilisation33 ». Elias analyse l’accroissement de l’autocontrainte dans les comportements individuels, aussi bien dans les manières de table que dans les formes de l’agressivité sportive et guerrière. Il retrouve un lieu commun de la science politique, qui, de Montesquieu à Tocqueville, s’est intéressée aux conditions de possibilité sociologiques de la liberté, et en particulier au rôle central que joue la religion dans ce contexte. « Moins la religion sera réprimante, plus les lois civiles devront réprimer », écrit Montesquieu34. Pareillement, Tocqueville explique que « la religion facilite l’usage de la liberté » ; il ajoute : « Je doute que l’homme puisse jamais supporter à la fois une complète indépendance religieuse et une entière liberté politique35. » Un peuple qui est maître de lui-même doit être soumis à Dieu. S’il n’est pas soumis à Dieu, il ne peut être maître de lui-même. Pour Tocqueville, la religion a le mérite de régler les mœurs : « La liberté est bien moins fille des institutions que des mœurs et les mœurs sont filles des croyances36. » Le paradoxe est ici que c’est souvent grâce à l’autorité de la révélation qu’on peut éviter l’autoritarisme politique : l’autorité morale ou spirituelle a cet avantage, précisément, qu’elle est morale ou spirituelle, et non matérielle.
Grands lecteurs d’Auguste Comte, les fondateurs de la IIIe République se rappelaient sans doute ce qu’on lisait sous sa plume : « Le seul moyen de n’être pas gouverné, c’est de se gouverner soi-même37. » Quand décline le sens de la vertu civique et de l’autocontrainte, les républiques cèdent le pas au césarisme. Comte encore : « Moins le gouvernement moral a d’énergie dans une société, plus il est indispensable que le gouvernement matériel acquière d’intensité, pour empêcher l’entière décomposition du corps social. […] Dans une population où le concours indispensable des individus à l’ordre public ne peut plus être déterminé par l’assentiment volontaire et moral accordé par chacun à une doctrine sociale commune, il ne reste d’autre expédient, pour maintenir une harmonie quelconque, que la triste alternative de la force ou de la corruption38. » Auguste Comte ressentait le besoin d’un ordre moral et d’un pouvoir spirituel pour éviter le despotisme administratif et la corruption. A contrario, la dénonciation systématique de l’autorité fait le lit de l’autoritarisme. Ces considérations ont longtemps semblé inopportunes et dépassées. On associe davantage l’idée du rôle social de la religion à Napoléon et à Marx qu’aux fondateurs de la IIIe République, Tocqueville ou Montesquieu. Mais il se pourrait que la remise en cause systématique de l’idée d’autorité morale ne redonne à l’idée du rôle social de la religion une actualité du point de vue libéral lui-même.
Pour conclure ces remarques sur la laïcité positive, on gagne à se pencher sur l’évolution d’un philosophe qui n’est pas croyant, mais dont les prises de position remarquées se sont insensiblement rapprochées de l’Église catholique : Jürgen Habermas. Depuis quelques années, Habermas s’oppose de plus en plus nettement à l’idée d’une restriction du débat public qui exclurait les Églises, et notamment l’Église catholique. « Quand les citoyens sécularisés assument leur rôle politique, écrit-il, ils n’ont le droit ni de dénier à des images religieuses du monde un potentiel de vérité, ni de contester à leurs concitoyens croyants le droit d’apporter, dans un langage religieux, leur contribution aux débats publics39. » Pour Habermas, le non-croyant ne saurait présupposer que la religion relève a priori de l’irrationnel. La religion peut se révéler porteuse d’une véritable rationalité, car « la raison réfléchissant sur son fondement le plus profond découvre son origine à partir d’un autre40 ». La crise du positivisme rend l’apport de l’Église utile non pour substituer la révélation à la raison, mais pour donner à la raison un fondement plus solide.
Il semblerait que l’évolution de Habermas s’explique en partie par la crainte d’un « eugénisme libéral41 ». Longtemps lié dans l’esprit public au nazisme, l’eugénisme a notamment été exclu à cause des connotations qui résultaient de cette association. Mais, sur un plan philosophique, il faut se demander quelles sont les véritables raisons de refuser l’eugénisme. La conjonction d’un approfondissement de l’individualisme et de progrès techniques, les recherches sur l’embryon et le diagnostic préimplantatoire confèrent à cette interrogation une réelle urgence. Or, Habermas note que la conception libérale de l’autonomie individuelle, telle qu’elle est défendue dans la philosophie politique contemporaine, ne nous aide guère. C’est, semble-t-il, la raison pour laquelle Habermas se tourne vers les chrétiens et notamment vers l’Église catholique. Le refus tranché de certaines évolutions par le Saint-Siège peut en faire un allié de choix pour les adversaires de l’eugénisme. Sans nécessairement se rallier à la position catholique, Habermas est devenu sensible à ses mérites; il semble y voir un rempart contre une tentation de type nihiliste qui perdrait de vue le sens de la dignité humaine, et donc une des fondations possibles du libéralisme politique.
Interprétée de manière radicale, la thèse selon laquelle l’individu peut faire tout ce qu’il veut tant qu’il ne fait pas de tort à autrui ne suscite pas seulement une transformation des mœurs en matière sexuelle. Elle permet également de justifier jusqu’à un certain point l’euthanasie (on supprime la souffrance à la demande de celui qui souffre), l’IVG (ce n’est pas encore « autrui », et c’est le droit de la femme), ainsi que l’eugénisme (on améliore le patrimoine génétique). La plupart des débats qui suscitent aujourd’hui une tension entre une certaine intelligentsia laïque et l’Église catholique se retrouvent ici. L’Église catholique considère que la liberté de choisir n’a de sens que par rapport à certaines contraintes qu’elle ne se croit pas le droit de remettre en question. On peut accuser de conservatisme une institution qui s’en remet à ce qu’elle appelle la «Tradition», mais on aurait tort de croire (comme on l’a souvent fait dans les dernières décennies) qu’elle allait délaisser ses principes traditionnels. On doit s’attendre, de sa part, à une opposition farouche aux évolutions morales qu’elle récuse. Pour l’Église, la confrontation avec les totalitarismes du XXe siècle est la matrice essentielle de son ralliement à la démocratie et des critiques qu’elle ne cesse d’adresser à certaines conséquences de l’esprit démocratique. Quand l’idée d’autonomie de la volonté va jusqu’à remettre en cause l’idée d’une distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane, quand elle va jusqu’à suggérer que tout est manipulable, que l’humanité est indéfiniment perfectible, on ne sait plus si on est encore dans la démocratie libérale ou déjà dans le totalitarisme.
L’Église catholique est favorable à la démocratie libérale, car elle voit dans la liberté religieuse le fondement même de ce régime. Elle y sera nettement moins favorable si, au nom du libéralisme, on impose de profondes limites à sa liberté et si on en vient à ignorer ce qu’elle décrit comme les lois les plus fondamentales. La situation présente étant caractérisée par son instabilité, on peut envisager soit le retour de fortes tensions entre l’Église et l’État (en particulier au sujet de ce que signifie l’autonomie individuelle), soit, au contraire, que des formes de complémentarité ne deviennent politiquement manifestes. Du reste, ces deux possibilités ne s’excluent pas, puisqu’elles se nourrissent réciproquement. L’un et l’autre de ces scénarios risquent de poser de graves problèmes pour l’Église catholique : les évêques ne désirent pas apparaître avant tout comme les gardiens de l’ordre moral contre les tendances actuelles de l’individualisme; ils ne désirent pas non plus redevenir, comme au temps de Napoléon, des « préfets en robe violette ». Il pourrait leur être difficile de parler le langage qu’ils voudraient adopter : celui de la liberté.


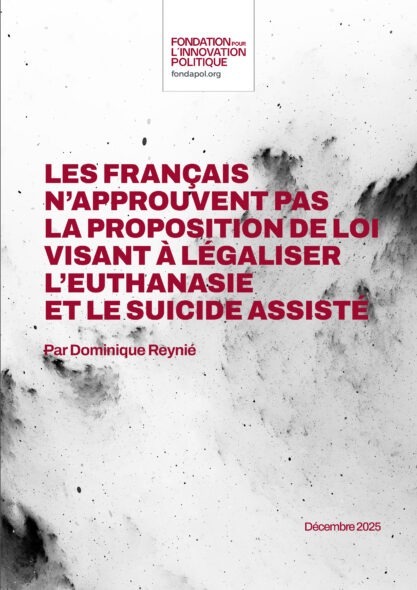



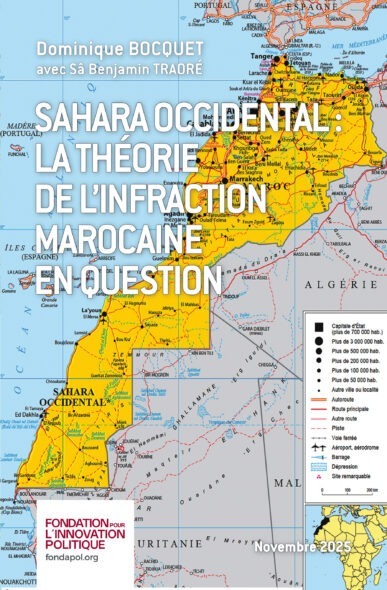


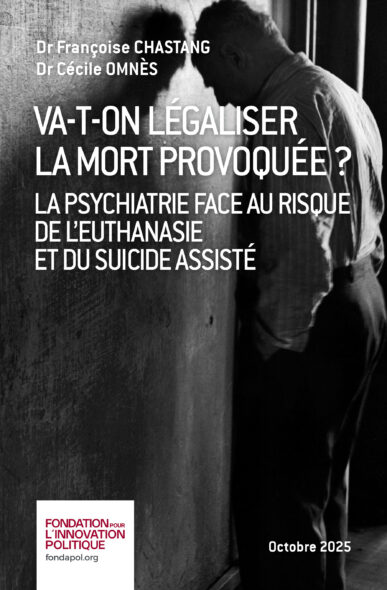

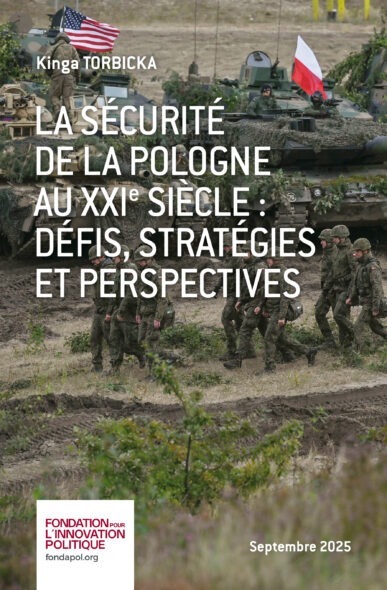

Aucun commentaire.