Éthiques de l'immigration
Introduction
Les positions cosmopolites et leurs contradictions
La position open borders de la gauche libérale.
L’éthique catholique : arguments et limites.
L’éthique libertarienne : apparence et réalité.
Éléments d’une éthique réaliste et politique de l’immigration
La position communautarienne : Michael Walzer.
La nation comme association politique (club) et la position closed borders.
Le capital social de confiance et la régulation de l’immigration.
Conclusion
Résumé
L’accueil des étrangers donne de plus en plus lieu à des prises de position éthiques allant dans le sens, pour les pays développés et notamment européens, d’un devoir d’accueil inconditionnel. Ce postulat, qui est celui de la gauche libérale mais aussi du pape François et d’associations spécialisées dans l’accueil des étrangers, passe pour la position éthique par excellence, la «seule attitude morale». Or l’examen attentif des travaux de philosophie morale consacrés à l’immigration va à l’encontre de ce qu’il faut bien appeler un préjugé. Le consensus des philosophies morales et éthiques existantes est qu’il est parfaitement légitime pour un État, sur le plan éthique, de réglementer sévèrement l’immigration et, au besoin, de l’exclure.
Cette note examine de façon critique le point de vue de sept philosophies morales sur la question de l’immigration : éthique libérale de gauche, éthique libérale classique, éthique chrétienne, éthique libertarienne, éthique communautarienne, éthique du club et éthique de la confiance. Les points de vue de John Rawls et de l’utilitarisme sont également très rapidement présentés.
L’examen commence par les éthiques qui prônent l’accueil inconditionnel : position open borders de la gauche libérale, éthique chrétienne et éthique libertarienne. Les faiblesses de construction de ces éthiques permettent de mettre en valeur la pertinence de la philosophie libérale classique sur la question de l’immigration. Puis ce sont les éthiques favorables à la position closed borders qui sont passées en revue : éthique communautarienne, éthique du club et éthique de la confiance ; elles ne sont pas exemptes de faiblesses mais certains de leurs arguments sont très pertinents.
Enfin, la présente note s’achève par un appel à croiser le regard de la philosophie morale sur l’immigration avec celui de la philosophie politique (souvent trop négligée) et de la science économique qui a atteint sur cette question un haut niveau de sophistication, tant il est vrai qu’il serait illusoire de prétendre définir une position éthique sur l’immigration dans l’ignorance du politique et de l’économique.
Jean-Philippe Vincent,
Ancien élève de l’ENA, maître de conférences à Sciences-Po, membre du comité de rédaction de la revue Commentaire.
Introduction
Mt , XXV, 34-36. Toutes les traductions des passages de la Bible cités dans notre note sont issues de La Bible de Jérusalem, Éditions du Cerf, nouvelle édition revue et corrigée, 1998.
Voir le discours du pape François, Rencontre avec les habitants et la communauté catholique : Mémoire des victimes de la migration, 16 avril 2016.
Ma réflexion est née de deux enseignements que je donne à l’Institut d’études politiques de Paris depuis Le premier s’intitule « Éthiques du capitalisme et des systèmes économiques ». Dans le cadre de ce séminaire, nous examinons quelques sujets importants du fonctionnement des économies de marché, notamment l’immigration. Le second enseignement s’intitule « Économie des grandes questions démocratiques ». Il s’agit d’analyser quelques grandes questions de société (addictions, criminalité, mariage et famille, corruption, terrorisme, religions, etc.) avec les outils de la science économique. Là encore l’immigration est au programme.
Voir, notamment, les travaux de George Borjas (Center for Immigration studies, cis.org/George-Borjas) et de Barry Chiswick (Institute of Labor Economics) L’analyse économique de l’immigration est pratiquement inconnue en France, où elle consiste le plus souvent à essayer de calculer si les immigrés sont débiteurs nets (ou non) aux organismes de sécurité sociale. Là encore, j’ai pu me rendre compte combien certains préjugés très répandus ne résistaient pas à une analyse économique un peu rigoureuse. Mais c’est un autre sujet…
Christopher Heath Wellman, « Immigration and Freedom of Association », Ethics, 119, n° 1, octobre 2008, p. 109-141.
«Alors le Roi dira à ceux de sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir moi1.”» Voici un verset de l’Évangile selon saint Matthieu qui semble parfaitement «légitimer» la position cosmopolite (open borders) qui prévaut, chez certains, en matière d’immigration et d’accueil des étrangers. C’est sur ce verset (mais aussi sur l’interprétation d’autres passages des Écritures) que s’appuie le pape François lorsqu’il prône l’accueil inconditionnel des étrangers et des migrants. Le 16 avril 2016, sur l’île de Lesbos, dans une «posture prophétique», le pape a appelé à l’accueil sans limites des étrangers. Le souverain pontife considère en effet que : «L’Europe est la patrie des droits humains, et quiconque pose le pied en terre européenne devrait pouvoir en faire l’expérience ; ainsi il se rendra plus conscient de devoir à son tour les respecter et les défendre.»2 Voilà qui est assez surprenant, car ce discours semblerait plus approprié dans la bouche d’un penseur libertarien comme Tibor Machan ou d’un «libéral de gauche» comme Joseph Carens que dans celle d’un pape, qui est en principe l’interprète d’une doctrine infiniment plus complexe, nuancée, et surtout beaucoup plus rigoureuse et respectueuse du droit des États. Mais cette conjonction est révélatrice de la confusion ambiante.
C’est justement cette confusion que cette note tente de clarifier. D’emblée, nous voudrions souligner que lorsqu’il s’agit de jeter un regard éthique sur la moralité de l’économie de marché3, sachant évidemment que les éthiques sont plurielles, nous sommes amenés à conclure qu’il n’y a pas «une» moralité mais une diversité très grande de points de vue éthiques sur l’immigration et que le «consensus» n’est pas celui de l’accueil inconditionnel. Par ailleurs, il y a aux États-Unis une véritable et très riche analyse économique de l’immigration4, malheureusement peu connue en France.
L’analyse des éthiques de l’immigration m’a conduit à trois «étonnements» :
- tout d’abord, j’ai constaté que l’approche «cosmopolite» (celle du pape François et de quelques libéraux de gauche) était très relayée par les médias mais pas du tout majoritaire chez les spécialistes de philosophie Le «consensus» reste celui du droit légitime d’un État à réguler l’immigration comme il l’entend, y compris en l’excluant à titre temporaire ou permanent ;
- ensuite je me suis aperçu que, depuis une trentaine d’années, plusieurs courants sont nés (théorie du club, théorie du capital social, notamment) qui permettent de jeter un regard neuf sur l’éthique de l’immigration. Il se trouve que ces courants « légitiment » une régulation très rigoureuse de l’immigration ;
- enfin, j’ai été très surpris, à l’étude de certaines de ces éthiques, de constater combien plusieurs d’entre elles étaient totalement déconnectées de la philosophie politique classique. On a parfois l’impression que le point de vue éthique (ou humanitaire) conduit à ignorer totalement la philosophie politique et la science politique. C’est à mon avis une dérive sérieuse, source de beaucoup de Une éthique a vocation à déboucher sur une politique. Or certaines éthiques de l’immigration débouchent sur une négation préoccupante du politique et de l’État.
Cette note ne passe pas en revue toutes les éthiques de l’immigration, loin de là. Le rawlsisme (opposé d’ailleurs à la position cosmopolite) et l’utilitarisme sont juste évoqués. Les éthiques envisagées sont classées en deux catégories : celles qui sont en principe favorables à la position «frontières ouvertes» et celles qui y sont opposées. Cela permet certes une présentation pédagogique, mais qui ne va pas sans simplifications. À chacun de se faire un point de vue éthique sur la question de l’immigration. Pour ma part, tout en étant séduit par certaines nouvelles approches comme la théorie du club de Christopher Heath Wellman5, je ne peux pas m’empêcher d’admirer ce que j’appelle la «position libérale classique», aujourd’hui décriée ou passée sous silence, mais qui garde une très grande robustesse. Résumons-la : l’égalité morale ne s’arrête pas aux frontières, mais les frontières créent une situation morale inédite qui légitime un traitement politique différencié entre nationaux et étrangers, dont les candidats à l’immigration. En conséquence, un État libéral est parfaitement autorisé à mener une politique d’immigration de son choix, y compris très restrictive.
Les positions cosmopolites et leurs contradictions
Trois éthiques sont en principe favorables à l’accueil inconditionnel : l’éthique «libérale de gauche», l’éthique chrétienne (catholique) et l’éthique libertarienne mainstream.
La position open borders de la gauche libérale.
John Rawls, Théorie de la justice, Seuil, 1987
Pierre Manent, La Raisons des Nations, Gallimard, 2006
Robert Nozick, Anarchie, État et utopie, PUF, 1974
Voir, par exemple, Rich Furman, Alissa R. Ackerman, Melody Loya, Susanna Jones et Nalinin Negi, « The Criminalization of Immigration: Value Conflicts for the Social Work Profession », The Journal of Sociology and Social Welfare, 39, n° 1, mars 2012, p. 169-185 ; Joseph H. Carens, « Aliens and Citizens: A Case for Open Borders », The Review of Politics, vol. 49, n° 2, printemps 1987, p. 251-273 ; Veit Bader, « Citizenship and Exclusion: Radical Democracy, Community and Justice. Or, What is Wrong with Communitarianism? », Political Theory, vol. 23, n° 2, mai 1995, p. 211-246 ; Christopher Heath Wellman et Phillip Cole, Debating the Ethics of Immigration. Is there a right to exclude?, Oxford University Press, 2011.
Joseph Carens, The Ethics of Immigration, Oxford University Press, 2013
Dans la philosophie morale classique (c’est-à-dire en excluant l’éthique chrétienne présentée ci-après), jusqu’au milieu des années 1970, il n’y avait aucun doute sur les droits de l’État à contrôler l’immigration, même très strictement.
Ce consensus tenait à deux éléments :
- la question de la régulation de l’immigration était pensée dans le cadre de la philosophie libérale. Celle-ci affirme l’égalité morale de tous les individus quelle que soit leur nationalité, mais cette égalité morale n’impliquait pas une égalité politique. Ces deux éléments étaient considérés comme distincts, et non sans raison. Il est symptomatique, à cet égard, que la théorie de la justice de John Rawls était pensée dans le cadre de l’État libéral et que le choix d’une théorie de la justice, sous voile d’ignorance, se faisait dans le cadre national6. Cela signifiait que, dans la pensée de Rawls, il était légitime de discriminer entre nationaux et étrangers sur le plan de l’égalité politique.
- d’autre part, la philosophie libérale s’est développée (de même que la démocratie) dans le cadre national. Sur ce point, on peut se reporter au livre de Pierre Manent, La Raison des nations7. Il était impensable, jusqu’à récemment, de concevoir une égalité morale qui ne serait pas garantie par des institutions politiques libérales et nationales. D’où la dissociation entre le principe de l’égalité morale et celui de l’égalité politique.
Probablement sous l’influence du livre de Nozick, Anarchie, État et Utopie8, ce consensus s’est effrité et il est aujourd’hui franchement remis en cause. L’idée de contrôles très rigoureux aux frontières est désormais tenue par plusieurs philosophes comme moralement illégitime9. C’est Joseph Carens10 qui a sans doute proposé la version la plus développée de ce nouveau paradigme moral.
a) La position open borders de Carens
Selon Carens, le libéralisme condamne l’utilisation d’éléments ou de faits contingents pour justifier des inégalités de traitement. Un aspect contingent de la personne – le caractère ethnique ou la race – ne peut légitimer une différence de traitement politique. Une communauté politique qui dénierait à des individus des droits en raison de leur race serait, chacun en conviendra, un cas exemplaire et typique d’une communauté illibérale et inique. La citoyenneté, selon Carens, semble être moralement aussi arbitraire que tout autre facteur comme la race ou le sexe. Aucun d’entre nous ne choisit son lieu de naissance et ses parents. Alors les restrictions apportées au droit d’immigrer, dans la mesure où elles différencient les droits en fonction de facteurs contingents et arbitraires, semblent par conséquent moralement répréhensibles et injustes. Si un gouvernement empêche un migrant de bénéficier des avantages du pays où il souhaite s’installer, il commet une injustice. Cette injustice, concède Carens, est moins intuitive que d’autres. Mais, selon lui, cela signifie que toutes les potentialités du libéralisme n’avaient pas été complètement appréhendées. Et après tout, note-t-il assez justement, il fut un temps, pas si lointain, où le libéralisme s’accommodait fort bien d’injustices raciales certaines.
Carens appuie sa démonstration en faisant une lecture cosmopolite de la théorie de la justice de Rawls. Pour ce dernier, le choix d’une forme de justice se fait dans la position originelle et sous un voile d’ignorance où chacun doit faire abstraction des facteurs contingents : race, sexe, situation sociale, etc. C’est le principe même du voile d’ignorance. Mais pour Rawls – et il l’a réaffirmé dans The Law of Peoples en 1999 –, cette procédure de choix se fait au niveau de l’État-nation (libéral). Pour Carens, la position originelle n’est pas celle de l’État-nation, mais celle du monde. Et il est évident que si la détermination d’une théorie de la justice se fait à l’échelle du monde, la liberté de mouvement (qui est un des principes premiers) vaut pour tout le monde. Chacun, selon cette lecture de Rawls, est par conséquent libre de s’installer où il veut.
Cette interprétation de Carens est habile, mais outre qu’elle est explicitement contraire à la pensée de Rawls, elle touche au sophisme. En effet, une théorie appliquée de la justice, quelle qu’elle soit, ne vaut que pour autant qu’elle puisse être mise en œuvre concrètement, au moins dans ses grandes lignes. Sans quoi elle est un pur exercice de style et Carens ne se situe pas dans ce cadre. Or il n’existe pas (encore) de gouvernance mondiale de la justice permettant d’appliquer une théorie de la justice, notamment celle de Carens. La théorie de Carens est donc affectée d’un défaut rédhibitoire. Cela a au moins le mérite de rappeler le caractère incontournable de l’État-nation et son lien intime avec le libéralisme démocratique.
b) Objections et critiques.
Comme la position catholique – qui postule un bien commun universel pour légitimer l’immigration libre, alors qu’il n’existe pas de gouvernance mondiale pour administrer ce bien commun et qu’il n’a donc guère de caractère opérationnel –, la position libérale de gauche achoppe sur un obstacle majeur : les préconisations qu’elle fait ne sont guère susceptibles d’être mises en œuvre (autrement que dans l’anarchie, ce qui n’est ni le souhait des catholiques, ni celui de Carens).
Néanmoins, les positions de Carens, par leur caractère systématique, amènent à se poser quelques questions utiles et importantes. Peut-on dissocier l’égalité morale et l’égalité politique ? Est-il légitime de discriminer entre les nationaux et les étrangers ? Cette dernière question est singulièrement importante, car s’il n’existe pas de justification éthique et politique pour « préférer » ses nationaux aux étrangers, alors l’État-nation n’est guère légitime pour réguler l’immigration et, le cas échéant, l’interdire. Carens a raison de dire que l’égalité morale propre au libéralisme ne s’arrête pas aux frontières. Mais peut-on en conclure que, moralement parlant, les frontières – même si leur élaboration doit beaucoup au hasard – n’ont aucune pertinence morale, qu’elles ne signifient rien sur le plan moral ? Assurément non. Une frontière marque les limites d’une allégeance partagée à un État politique. Or un État peut exiger beaucoup de ses citoyens : il peut les taxer, les contraindre, les punir et, à la limite, exiger d’eux qu’ils sacrifient leur vie. Les candidats à l’immigration, eux, ne sont soumis (du moins tant qu’ils sont candidats) à aucune de ces contraintes très fortes. La relation très spéciale entre un citoyen et son État crée en faveur du premier un droit spécifique, une différence qui mérite d’être reconnue sur le plan moral. La citoyenneté a une signification morale, une portée morale et, in fine, elle peut justifier, éthiquement, qu’un État traite préférentiellement ses nationaux. C’est ce que nous appellerons la « position libérale classique ». Elle n’a rien d’immoral. Et, dans ces conditions, un État est parfaitement en droit, sur le plan éthique, de réglementer (même sévèrement) l’immigration sur son territoire.
Certes, le statut de citoyen peut être déterminé par des éléments contingents ou arbitraires (naissance dans tel pays plutôt que dans tel autre), mais ce statut crée une situation morale spécifique qui doit être prise en compte. En particulier, les institutions politiques de la société doivent correspondre aux volontés des personnes qui sont soumises à son autorité car elles sont contraintes – si elles sont libérales – de gouverner avec l’accord politique explicite des citoyens qui sont soumis à son autorité exclusive. L’État libéral doit des garanties à ceux qui sont les sujets de son autorité. Et ces garanties ne s’appliquent pas à ceux qui ne sont pas (encore) les sujets de cette autorité. Cette différence de traitement ne constitue pas une brèche dans l’égalité morale qui est un des principes de l’État libéral. L’égalité morale est intégralement compatible avec des droits politiques différenciés. Ce point est essentiel et il légitime le droit d’exclure ou de restreindre l’immigration.
L’éthique catholique : arguments et limites.
Voir , X, 18, et Lv., XIX, 34.
Voir , XXV, 35.
Voir , III, 28, et Col., III, 11.
Voir Ps. XV
- Voir Ép., II, 19
Voir Lettre de St , V, 19.
Saint Augustin, La Cité de Dieu, XIV, 28, in Œuvres, II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2000, 194.
Catéchisme de l’Église catholique, Libreria Edititrice Vaticana, 1992, paragraphe Nous reproduisons la différence de typographie adoptée par le CEC et le second paragraphe est en petits caractères. Nous revenons plus loin sur la signification de cette typographie différenciée.
Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-IIae, question 66, tome 3, Éditions du Cerf, Paris, 1985, 438.
Léon XIII, Rerum Novarum, lettre encyclique, 15 mai 1891
Voir Eric Voegelin, La Nouvelle Science du politique, Seuil, 1985
Oscar Cullmann, Dieu et César, Delachaux et Niestlé, 1956.
MT, XXV, 35-39.
a)L’éthique chrétienne et l’acceuil inconditionnel : les arguments.
La position chrétienne d’accueil inconditionnel de l’étranger (réfugié ou réfugié économique) est fondée sur trois éléments : l’enseignement du Christ et des apôtres, le fait que tout chrétien est par nature un étranger à ce monde et, enfin, l’idée qu’un monde sans frontières préfigure la cité de Dieu. Ces fondements n’ont évidemment pas la même valeur ni la même portée.
L’enseignement du Christ et des apôtres
L’accueil ou, plus l’exactement, l’hospitalité due à certains étrangers sur la terre d’Israël est un élément de la foi juive. Notons à ce stade que cette hospitalité ne s’adresse pas à tous les étrangers, mais seulement à certains d’entre eux, les nokrim (étrangers de passage non idolâtres) et les ger (étrangers résidents dont le statut est voisin de celui des métèques). La loi juive prescrit de les aimer comme soi-même11.
Les paroles du Christ («J’étais étranger et vous m’avez recueilli12») ne font donc que confirmer un élément de la loi d’Israël. Mais les écrits pauliniens témoignent que l’Évangile concerne tout autant les païens que les juifs et que, dans l’Église, il n’y a pas d’étrangers, bien que dans l’Église primitive l’invitation à ne pas tenir compte des origines nationales de chacun pour constituer le corps du Christ, c’est-à-dire l’unique Église du Christ, ne fût pas entendue immédiatement ni facilement13.
Pour résumer la doctrine chrétienne à partir de ces éléments, on peut dire que l’accueil de l’étranger est une des figures de l’accueil du Christ, que dans l’Église il n’y a pas d’étrangers et que le peuple de Dieu est lui-même en pèlerinage sur cette terre (certains disent abusivement « en migration »).
L’Église, étrangère sur cette terre
Une transposition du statut du ger (étranger résident) survit dans la foi chrétienne. La terre de Canaan avait été promise à Abraham et à ses descendants, mais Dieu en reste le vrai propriétaire. Israël n’est que locataire. Cette idée contient en germe une attitude spirituelle qui se retrouve dans les psaumes. Le juif sait qu’il n’a aucun droit en face de Dieu, il désire seulement être son hôte14.
Dans le Nouveau Testament, cette intelligence de la condition humaine s’approfondit encore. Le chrétien ici-bas n’a pas de demeure permanente ; il est étranger sur la terre non seulement parce qu’elle appartient à Dieu seul, mais parce qu’il est un citoyen de la patrie céleste : là il n’est plus un hôte ni un étranger mais un concitoyen des saints15. Tant qu’il n’a pas atteint ce terme, sa vie est une vie voyagère, pérégrinante, à l’imitation de celle des patriarches. Jean accentue encore ce contraste entre le monde où il faut vivre et la vraie vie où déjà nous sommes introduits. Né d’en haut, le chrétien ne peut être qu’étranger sur cette terre parce qu’entre lui et le monde l’accord est impossible : le monde, en effet, gît au pouvoir de Satan16. Mais s’il n’est plus de ce monde, le chrétien sait, comme le Christ, d’où il vient et où il va, il suit le Christ qui a planté sa tente au milieu de nous et qui est retourné au Père afin de préparer une place pour les siens et sait que là où il est sont aussi ses serviteurs, à demeure chez le Père.
Un monde sans frontières, préfiguration de la cité de Dieu
On veut bien croire que la cité de Dieu n’ait pas de frontières, contrairement à la cité des hommes, mais la vérité est que l’on sait fort peu de choses, comme d’une manière générale en eschatologie, de ce que sera la vie des hommes dans ce qu’il est préférable d’appeler royaume de Dieu, lequel commence ici-bas par la présence du Christ dans l’eucharistie. Pour autant, il est surprenant que l’existence de frontières, qui est de fait l’une des caractéristiques de la cité des hommes, soit à ce point considérée aujourd’hui comme le mal absolu. Saint Augustin écrit ainsi dans La Cité de Dieu : « Deux amours ont donc bâti deux cités : celle de la terre par l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, celle du ciel par l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi17 », mais rien dans son ouvrage ne permet de conclure que les frontières entre nations sont un des maux principaux de la cité des hommes. Un chrétien, parce qu’il est étranger, du moins en partie, à ce monde, doit cultiver le détachement vis- à-vis de ses «ornements», mais cela ne signifie nullement qu’il doit mépriser l’enracinement, ni vouloir à toute force l’abolition des frontières.
b) L’éthique chrétienne de l’acceuil inconditionnel : critiques, objections et limites.
L’article 2241 du catéchisme de l’Église catholique
La position catholique est résumée dans le 2241 du catéchisme de l’Église catholique (CEC) :
« Les nations mieux pourvues sont tenues d’accueillir autant que faire se peut l’étranger en quête de sécurité et de ressources vitales qu’il ne peut trouver dans son pays d’origine. Les pouvoirs publics veilleront au respect du droit naturel qui place l’hôte sous la protection de ceux qui le reçoivent.
Les autorités politiques peuvent en vue du bien commun dont elles ont la charge subordonner l’exercice du droit d’immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l’égard du pays d’adoption. L’immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d’accueil, d’obéir à ses lois et de contribuer à ses charges 18.»
Cet article appelle quelques remarques et critiques liminaires. Il se compose de deux paragraphes. Le premier exprime la position nouvelle de l’Église, telle qu’elle s’est élaborée à partir des années 1950. La formulation en est ambiguë. D’une part, les réfugiés politiques et les immigrants économiques sont mis sur le même pied : «étranger en quête de sécurité et de ressources vitales». Cette confusion a créé un certain embarras chez les défenseurs du droit d’asile politique qui voient dans l’adjonction de «et de ressources vitales» un risque de fragilisation de la condition de strict réfugié politique.
D’autre part, l’article spécifie : «les nations mieux pourvues sont tenues d’accueillir autant que faire se peut». Ce membre de phrase est là encore plein d’ambiguïtés. En effet, la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 spécifie un droit à l’émigration, mais nullement à l’immigration. En fait, la déclaration de 1948 visait le droit (nullement acquis à l’époque) de sortir librement et temporairement du territoire national, puis à le regagner. L’article du CEC va considérablement au-delà puisqu’il crée un droit à l’immigration auquel les «nations mieux pourvues sont tenues autant que faire se peut». Ajoutons à cela que l’expression «sont tenues d’accueillir» a un caractère téléologique marqué : ce qui semble visé par l’expression «sont tenues», c’est bien la naissance d’un monde sans frontières dont on nous dit qu’il est comme la préfiguration de la cité de Dieu. Par ailleurs, si les lois de l’hospitalité ont toujours été une obligation des fois juive et chrétienne, il s’agissait d’une hospitalité temporaire et non d’une installation définitive. Or, sans l’affirmer clairement, il semble bien que l’article 2241 vise un droit d’installation. Il s’agit d’une vraie rupture, et pas des moindres. L’expression «autant que faire se peut» ajoute à la confusion en donnant à ce paragraphe un côté équivoque.
Il est vrai que, dans sa seconde partie, l’article du CEC spécifie quelques réserves correspondant à la doctrine catholique traditionnelle. Mais, d’une façon presque risible, cette seconde partie est imprimée dans des caractères sensiblement plus petits que la première partie, comme s’il s’agissait de faire comprendre que les réserves qu’elle contient sont optionnelles ou dépassées. La fin de l’article 2241, sous ces conditions, maintient le droit des États, au nom du bien commun, de restreindre les flux d’émigration en même temps qu’elle mentionne les «devoirs» matériels et spirituels des immigrés, confirmant en cette occasion que le droit d’immigration est bien un droit d’installation.
Voilà donc, pour la nouvelle doctrine officielle, celle défendue dans le cadre du magistère ordinaire : elle constitue une rupture. Pour cette raison, notamment, il est nécessaire de s’interroger sur la théologie sous-jacente du CEC et, surtout, du magistère ordinaire de l’Église sur la période récente.
Critique théologique de la nouvelle position catholique
Quel est le modèle économique et social sous-jacent ? Si l’on va au fond des choses, on s’aperçoit que la justification fondamentale de la position de l’accueil inconditionnel de l’étranger est en définitive la destination universelle de tous les biens. De celle-ci découlent le droit absolu à l’immigration et le devoir d’accueil des pays «mieux pourvus».
Il n’est pas question de nier la destination universelle des biens : elle est un droit naturel et fait partie de la foi chrétienne. Mais il est nécessaire de préciser dans quelles conditions et sous quelle forme elle s’exerce dans le cadre de la théologie catholique. C’est par analogie avec la propriété privée et son statut dans la doctrine catholique que l’on peut le mieux saisir l’articulation entre le développement économique dans le cadre des nations et la destination universelle des biens.
Dans la partie de la Somme théologique consacrée à la vertu cardinale de justice, saint Thomas d’Aquin s’interroge sur la légitimité de la propriété privée compte tenu du principe de destination universelle des biens. Voici sa réponse et elle mérite d’être citée complètement : «Deux choses conviennent à l’homme au sujet des biens extérieurs. D’abord le pouvoir de les gérer et d’en disposer ; et sous ce rapport il lui est permis de posséder des biens en propre. C’est même nécessaire à la vie humaine pour trois raisons :
1° Chacun donne à la gestion de ce qui lui appartient en propre des soins plus attentifs qu’il n’en donnerait à un bien commun à tous ou à plusieurs ; parce que chacun évite l’effort et laisse le soin aux autres de pourvoir à l’œuvre commune ; c’est ce qui arrive là où il y a de nombreux serviteurs.
2° Il y a plus d’ordre dans l’administration des biens quand le soin de chaque chose est confié à une personne, tandis que ce serait la confusion si tout le monde s’occupait indistinctement de tout.
3° La paix entre les hommes est mieux garantie si chacun est satisfait de ce qui lui appartient ; aussi voyons-nous de fréquents litiges entre ceux qui possèdent une chose en commun et dans l’indivis19.»
Mais si la propriété privée est pleinement légitime, efficace et favorable à la paix commune, que devient la destination universelle des biens ? Dans l’optique thomiste il est clair que si Dieu a donné la terre en commun aux hommes, cela ne signifie pas qu’ils doivent la posséder confusément mais qu’Il n’a assigné de part précise à personne en particulier : Il a laissé la délimitation des propriétés à la sagesse des hommes et aux institutions des peuples. Et, comme l’a fait remarquer le pape Léon XIII, « quoique divisée en propriétés privées, la terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous20. » Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre la propriété privée et la destination universelle des biens.
Le même raisonnement est applicable à la division du monde en nations. C’est un facteur d’efficacité, de responsabilité, de bonne gestion et de richesses, y compris spirituelles. Si toutes les décisions économiques et sociales devaient se prendre au niveau du monde, les risques de dérive bureaucratique, d’aléa moral généralisé et de sélection adverse prendraient des proportions gigantesques et entraîneraient un bien-être mondial sensiblement moindre que celui qui résulte de la division du travail entre nations. La bonne destination universelle des richesses de ce monde ne repose pas sur l’immigration généralisée mais sur une gestion appropriée des ressources au niveau des nations. Le droit inconditionnel à être accueilli dans « des pays mieux pourvus » crée un aléa de moralité de grande ampleur car il déresponsabilise la bonne gestion au niveau des nations : les autorités de certains pays pratiquent une gouvernance peu efficiente et parfois très risquée, assurés qu’ils sont que les effets de leur mauvaise gestion seront mutualisés grâce aux mouvements migratoires. En caricaturant, on pourrait dire que le pape François favorise un aléa de moralité en assurant aux gouvernements pratiquant des politiques irresponsables que leur «excès» de population pourra être pris en charge par des pays «mieux pourvus».
Par ailleurs, l’appel à un monde sans frontières comme anticipation de la cité de Dieu surprend par ses résonances gnostiques et millénaristes. La gnose est présente depuis le premier siècle de notre ère. Celui qui en a le mieux parlé à l’époque contemporaine est Eric Voegelin21, qui a identifié les différentes composantes de l’esprit gnostique, à savoir la détestation du monde tel qu’il est, la conviction que l’état « détestable » du monde est le résultat d’une organisation inappropriée – le monde est une anthropodicée –, qu’un salut est possible et qu’il il appartient aux hommes, que le salut existe et qu’il peut être réalisé dans l’histoire, et que ce salut peut être réalisé par des hommes ayant foi dans la vertu salvifique d’un groupe, prolétariat (marxisme), race (nazisme), pauvres (théologie de la libération) et, pourrait-on ajouter, immigrés, car on a nettement l’impression, chez certains, que l’immigration est vraiment une question de salut historique et, précisons-le, purement historique. Naturellement, il n’est pas question d’incriminer tous les clercs. Mais il est patent qu’au sein même de l’Église la tentation gnostique d’un salut historique par la foi dans les vertus rédemptrices de l’immigration existe. Elle n’est pas prédominante, mais elle est bien présente.
De la même façon, il existe, notamment dans certains milieux proches du catholicisme, une sorte de millénarisme lié à l’immigration. Considérer un monde d’immigration généralisée comme une anticipation de la cité de Dieu est symptomatique du millénarisme. Celui-ci est un phénomène très ancien et le penseur le plus important du millénarisme fut Joachim de Flore, moine cistercien et théologien du XIIe siècle. La conviction millénariste est la croyance en un règne de l’esprit dont il convient d’accélérer l’avènement par tous les
moyens. En l’occurrence, le règne de l’esprit serait celui d’un monde sans frontières auquel l’immigration sans freins ni limites permettrait d’accéder. Cette tendance millénariste est assurément ultraminoritaire dans l’Église, mais elle n’est pas sans influence dans certains milieux paracatholiques.
c) Questions et récapitulation.
En définitive, pour essayer d’y voir clair dans la position de l’Église sur l’immigration, il faut oser poser quelques questions simples.
À qui s’adresse le Christ quand il parle de l’accueil de l’étranger ?
Le Christ s’adresse à ses disciples et à ses fidèles potentiels. Ce sont toujours des individus. On ne trouve pas trace, dans l’enseignement du Christ, d’un discours s’adressant aux «pouvoirs publics» de l’époque, qu’ils soient juifs ou romains. Même le dialogue avec Pilate est réduit à sa plus simple expression, le Christ refusant souvent de répondre aux questions. Ceci pour dire que l’idée que le Christ ait pu tenir aux autorités de l’époque un langage, politique ou autre, est radicalement étrangère à l’esprit du Nouveau Testament. Ce point a été définitivement établi par Oscar Cullmann dans un ouvrage intitulé Dieu et César22. Le message évangélique, en l’espèce celui de l’accueil de l’étranger, s’adresse uniquement à la conscience des individus. On peut donc être surpris de voir les autorités romaines – le Vatican – s’adresser de plus en plus fréquemment directement aux dirigeants politiques. Et l’on peut également être surpris que le pape, à propos de la question des réfugiés, stigmatise aussi durement les peuples européens, comme s’il y avait une responsabilité collective, en négligeant au surplus le fait que ces nations sont démocratiques et que les catholiques, dans beaucoup d’entre elles, ne constituent désormais au mieux que des majorités relatives. Il y a dans ces interventions continuelles du pontife une résurgence de l’«esprit zélote».
À quel étranger fait référence le Christ dans l’Évangile selon saint Matthieu23 ? Le Christ s’inscrit dans le contexte juif de l’époque, même si son enseignement va évidemment au-delà. Dans le monde juif, il n’y avait pas un étranger, mais des étrangers. Nous avons déjà évoqué le cas des nokrim et des ger, qui étaient relativement proches du peuple juif et pouvaient être circoncis. Mais il y a également les Samaritains qui sont «étrangers», de même que les craignant- Dieu. Sans parler des païens idolâtres. L’«étranger», le ξενος du texte grec, se définit à la fois selon un critère religieux et selon un critère territorial, mais certainement pas en fonction d’un critère économique : le fait d’être démuni. L’étranger dont parle sans doute principalement le Christ, comme l’attestent les Évangiles, c’est principalement l’étranger proche, celui qui réside sur la terre d’Israël, mais qui est différent. Autrement dit, l’étranger est sans doute d’abord un voisin, un prochain, mais qui, pour certaines raisons, est aussi un exclu, les Samaritains par exemple. Assurément, le discours du Christ possède une portée générale et, à l’époque actuelle, il vise bien entendu les immigrés installés ou potentiels. Mais, pour l’individu chrétien auquel s’adresse le message du Christ, l’étranger, le ξενος, c’est peut-être le plus proche de lui. En tout cas, c’est une question que chaque chrétien doit se poser car il n’est pas possible d’assimiler brutalement l’«étranger» à tout candidat à l’immigration.
L’éthique libertarienne : apparence et réalité.
Robert Nozick, op, cit.
Lysander Spooner, Outrage à chefs d’État, Les Belles Lettres,
Voir David Friedman, The Machinery of Freedom, 1992 [traduction par l’auteur].
« A free society may well be modeled on such a gated Immigration would be predicated on the permission to either visit someone (an employer or friend) or to purchase a residence. The general precondition, then, of immigration into a free society is self-sufficiency and voluntary relationship with those who are already there » (Tibor R. Machan, « Immigration Into A Free Society », Journal of Libertarian Studies, vol. 13, n° 2, été 1998 p. 200, mises.org/library/immigration-free-society).
George Borjas, Immigration Economics, Harvard University Press, 2014
L’éthique libertarienne aboutit à une conclusion globalement similaire à celle des libéraux de gauche, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. Elle prône en effet une immigration libre. Toutefois, le raisonnement libertarien est très spécifique et mérite d’être explicité. Par ailleurs, précisément en raison de la logique libertarienne, la position «anarcho-capitaliste» est beaucoup plus ambiguë que ce que l’on pourrait croire a priori et, en définitive, plus restrictive comme l’attestent notamment les travaux de Tibor Machan.
a) La logique libertarienne appliquée à l’immigration.
Les libertariens historiques (Ayn Rand, Murray Rothbard, David Friedman), s’appuyant sur les écrits de «grands anciens» (Lysander Spooner, Benjamin Tucker, Gustave de Molinari), estiment que :
- les individus ont des droits souverains («Les individus ont des droits, et il est des choses qu’aucune personne, ni aucun groupe ne peut faire sans enfreindre leurs droits. Et ces droits sont d’une telle force et d’une telle portée qu’ils soulèvent la question de ce que peuvent faire l’État et ses commis – si tant est qu’ils puissent faire quelque chose24») ;
- la souveraineté des individus s’appuie sur la propriété qu’ils ont sur eux- mêmes : l’individu souverain est d’abord un propriétaire ;
- si l’individu est souverain, l’État, lui, n’a aucune légitimité («L’État n’est qu’une bande secrète de brigands et d’assassins25») ; à l’extrême limite, un État veilleur de nuit exerçant la fonction de défense nationale est le seul qui puisse être accepté («Le cas échéant, je n’essaierais pas d’abolir ce dernier vestige [la défense nationale] du gouvernement. Je n’aime pas payer des impôts, mais je préfère quand même les payer à Washington qu’à Moscou : les taux sont moins élevés26»).
La position vis-à-vis de l’immigration n’est donc pas une position nationale gérée par l’État, mais une position des individus qui, en tant que propriétaires, peuvent inviter des étrangers à rejoindre la «copropriété» des résidents en place. Concrètement, les libertariens raisonnent sur le modèle de la gated community, une communauté de copropriétaires : pour être accueilli dans la copropriété, il suffit d’avoir l’accord des autres copropriétaires et l’État n’a pas son mot à dire par rapport à cela. Tibor Machan est explicite sur ce sujet : «Une société libre est une société de copropriétaires. L’immigration serait fondée sur la base soit d’une visite qu’on rend à un ami ou à un employeur, soit conçue comme l’achat d’une propriété. La précondition générale à l’immigration dans une société libre composée de copropriétaires est l’autosuffisance financière et une relation volontaire de coopération avec les sociétaires déjà installés27.»
Le fondement de la position libertarienne sur l’immigration peut donc se résumer de la façon suivante : l’immigration consiste en ceci que des individus «invitent» d’autres individus à résider sur un territoire. L’État n’a aucune légitimité, il n’a pas de substance en face de la souveraineté de l’individu : il n’a donc pas à mener de politique d’immigration. Il n’est pas «invité» dans le processus.
Voilà la théorie : celle d’une immigration presque totalement libre. Mais la réalité de la position libertarienne est beaucoup moins «libérale», en tout cas sensiblement moins que la position libérale de gauche.
b) Appréciation critique de la position libertarienne.
Beaucoup de libertariens se réclament d’Aristote sur le plan éthique. C’est le cas notamment d’Ayn Rand et de Murray Rothbard, deux libertariens parmi les plus connus. En effet, l’éthique libertarienne n’est pas utilitariste, elle est perfectionniste, elle recherche une finalité : le Bien s’identifie à la liberté totale du sujet, conforme à la nature de l’homme en tant qu’homme. Mais, chez Aristote, l’éthique débouche sur une politique ; chez les libertariens, l’éthique débouche sur la négation du politique. C’est évidemment une «bizarrerie», une contradiction dont, curieusement, les libertariens n’ont pas conscience.
Les propositions libertariennes sur l’immigration reflètent cette contradiction. Et elles ne sont libérales qu’en apparence, sur le plan de la rhétorique. Quelles sont ces contradictions ?
Milton Friedman – qui n’était pas libertarien mais qui, sur certains sujets de société, avait des idées libertariennes – a toujours soutenu qu’il n’y avait pas de problème d’immigration excessive mais un problème d’État-providence. Autrement dit, c’est l’existence d’un État-providence trop généreux dans certains pays qui attirerait les immigrés. Si on démantèle l’État-providence, il n’y aura plus de problème de l’immigration. Ce raisonnement est des plus sommaires et même faux. Les travaux économiques de spécialistes de l’immigration (Georges Borjas28 ou Barry Chiswick, par exemple) ont bien montré que les flux d’immigration ne sont pas déterminés par les prestations sociales dans le pays d’accueil mais par le différentiel de salaire (anticipé) entre le pays d’accueil et le pays de départ. Ce différentiel de salaire, le candidat à l’immigration le compare aux coûts de sa décision d’émigrer (coûts d’opportunité explicite et implicite) et prend sa décision en conséquence. Les prestations sociales ne jouent qu’un rôle très accessoire. L’argument de Milton Friedman peut donc être assimilé à un refus de penser la question de l’immigration.
Par ailleurs, si le modèle de la gated community est intéressant – dans une certaine mesure, s’il se rapproche de la théorie du club qui sera présentée plus loin –, il faut toutefois savoir que les libertariens sont favorables au principe d’unanimité : l’accès à la gated community risque donc d’être très difficile. Cette difficulté sera d’autant plus forte qu’une des conditions de l’admission dans le «club» est l’autosuffisance financière, ce qui exclut de facto beaucoup de candidats. Les libertariens ont beau insister sur l’absence de discriminations dans le recrutement des gated communities, les conditions d’admission constituent une forme de «profilage». Derrière l’autosuffisance financière, il y a la recherche d’une identité culturelle. Ceci n’est pas une préoccupation déplacée, mais il serait préférable d’être explicite.
En outre, il existe des problèmes majeurs dans l’administration du modèle de la gated community. Les États-Unis ont certes une tradition de coexistence de communautés très disparates, mais cela n’est pas le cas dans nombre d’autres pays. Si la politique d’immigration se fait au niveau des communautés, il faut s’attendre à des difficultés de cohabitation. En somme, il faut être en mesure de gérer les questions de « voisinage » et ce ne sont pas là des questions simples.
Beaucoup d’autres problèmes pratiques pourraient être évoqués. Mais ce qui importe, c’est de comprendre que l’éthique libertarienne n’est favorable à la position open borders qu’en apparence. Ce qui est sérieux, c’est que la rhétorique libertarienne est utilisée par d’autres écoles, la gauche libérale, notamment, pour justifier l’ouverture des frontières et même leur caractère non pertinent.
Éléments d’une éthique réaliste et politique de l’immigration
Si l’on récapitule les enseignements tirés de l’examen critique des trois éthiques cosmopolites qui ont été passées en revue, on arrive aux conclusions préliminaires suivantes :
- ces éthiques négligent le fait politique lié à l’immigration. Pourtant, le point de vue de la philosophie morale et celui de la philosophie politique sont étroitement imbriqués. Un exemple manifeste de cette lacune concerne la position originelle qui sert de base pour apprécier le caractère éthique de l’immigration : pour les catholiques, avec l’idée de bien commun universel, la position originelle est un espace sans frontière, c’est-à-dire le monde entier ; pour les libéraux de gauche, utilisant une interprétation erronée de Rawls, c’est également le monde entier ; pour les libertariens, c’est la gated community. Mais, dans les trois cas, il n’existe pas aujourd’hui de gouvernance appropriée à ces niveaux, ce qui prive les théories en question de beaucoup de pertinence et de contenu opérationnel ;
- la seule «position originelle» opérationnelle pour apprécier l’éthique de l’immigration est l’État-nation (libéral). C’est ce qu’a fait Rawls. C’est ce que font la plupart des néo-utilitaristes pour lesquels le summum bonum à maximiser est national et non C’est aussi la position de la plupart des aristotéliciens (MacIntyre, par exemple) ;
- contrairement à ce que pensent les libéraux de gauche, les catholiques et les libertariens, si l’égalité morale ne s’arrête pas aux frontières, celles-ci créent néanmoins une situation morale qui justifie un traitement spécifique des citoyens : il est éthiquement justifié d’accorder des droits différents aux nationaux et aux étrangers. Il est donc légitime de réglementer l’immigration. C’est l’argument libéral classique ;
- c’est sur ces bases que l’on peut comprendre l’éthique de l’immigration proposée par les communautariens (Michael Walzer), les théoriciens de la nation-club (Christopher Heath Wellman) et les tenants de la théorie de la confiance comme capital social (Hilary Putnam).
La position communautarienne : Michael Walzer.
Michael Walzer, Spheres of Justice, Harvard University Press, 1983
Carl Schmitt, La Valeur de l’État et la signification de l’individu [1915], Librairie Droz, 2003
John Rawls, Libéralisme politique [1973], PUF, 1995
Roy Beck, The Case Against Immigration, W W Norton & Co , 1996.
Peter Brimelow, Alien Nation, Harper Perennial, 1996
a) L’argument culturel des communautariens.
Les communautariens comme Michael Walzer29 et Will Kymlicka défendent le droit à l’exclusion (c’est-à-dire la restriction ou l’interdiction de l’immigration) sur des bases culturelles. Pour eux, l’État-nation a le devoir de protéger ce qui est embedded (inséré, enchâssé, intégré). À quoi cela correspond-il ? À ce qui est local, traditionnel, notamment sur le plan de la culture. Une tradition philosophique, par exemple, peut être un élément culturel embedded. Pour Walzer, dans le cadre de la politique migratoire, l’État-nation a le devoir de veiller à ce que la culture et le patrimoine des communautés en place soient préservés. Il n’y a là rien de choquant a priori puisque l’on a vu que l’égalité morale était compatible avec un traitement politique différencié. Or, être citoyen ce n’est pas seulement voter, c’est aussi adhérer aux fondements du bene vivere. Les trois éléments du bien commun (paix, justice et amitié) ne viennent pas de nulle part : ils sont liés à un certain nombre de préconditions culturelles. Les communautariens insistent sur ces préconditions : une politique migratoire ne doit pas bouleverser les fondements du bene vivere et, in fine, du fonctionnement d’une démocratie libérale. À la limite, on peut trouver cet argument assez banal.
Évidemment, et les communautariens en sont conscients, il ne faut pas que cette défense des traditions culturelles et du local (il faudrait dire «des locaux») se transforme en une défense d’une ethnie ou d’une race. Le projet communautarien ne doit pas basculer dans la défense d’un ethnos au sens de Carl Schmitt30. On fait assez souvent ce procès aux communautariens, et d’assez mauvaise foi. En effet, pour les communautariens, les cultures et les «localismes» à défendre sont pluriels, ce qui est la réalité de pratiquement tous les États libéraux démocratiques. L’assimilation à la défense d’un ethnos est donc infondée. Par ailleurs, lorsque des dérives ont pu être constatées (cas de l’Australie entre les années 1860 et 1970 avec la White Australia Policy), les communautariens (Michael Walzer en particulier) les ont dénoncées. Au reste, les communautariens admettent que dans certains cas dramatiques l’État puisse avoir des devoirs à l’égard d’étrangers en situation de péril pour leur vie.
b) Critique de la position closed borders des communautariens
La position communautarienne est intéressante dans la mesure où elle justifie éthiquement une politique d’immigration (restrictive, en l’occurrence) et où, en plus, elle en définit l’orientation (principe de la local partiality).
Mais la local partiality peut engendrer bien des équivoques et l’on peut se demander si la position closed borders ne serait pas mieux défendue sur la base d’arguments plus simples:
- la position libérale classique (égalité morale qui ne s’arrête pas aux frontières, mais avec des frontières qui créent une situation morale qui peut justifier des différences de traitement politique) est très suffisante pour justifier une position «frontières fermées» et une politique restrictive. Est-ce que, finalement, l’argumentation communautarienne ne complique pas les choses ? ;
- d’autre part, on peut parfaitement soutenir, d’un point de vue libéral également, que la division du monde en nations et l’existence de frontières sont un bénéfice pour la population du monde C’est la position de Rawls dans son Political Liberalism31, par exemple. Autrement dit, un monde sans frontières ne serait certainement pas «le meilleur des mondes». On a vu aussi que cette position était celle de saint Thomas d’Aquin.
- enfin, on peut être plus radical et redéfinir le libéralisme comme la philosophie qui garantit l’égalité morale dans le cadre de la communauté nationale, mais pas au plan universel (voir, par exemple, Roy Beck32 et Peter Brimelow33). Il s’agit toujours d’un cadre libéral, mais réduit. Au fond, la position communautarienne, n’est-ce pas cela, tout simplement ? Le problème est que ce libéralisme «appauvri» est assez peu séduisant.
La nation comme association politique (club) et la position closed borders.
Voir, notamment, Christopher Heath Wellman et Phillip Cole, op cit.
Michael Oakeshott, L’Association civile selon Hobbes, suivi de Cinq essais sur Hobbes, Vrin, 2011
Voir Christopher Heath Wellman et Phillipp Cole: Debating the Ethics of Immigration: Is There A Right to Exclude, Oxford university press, 2011, p. 54 (traduction de l’auteur).
« On dit : où est la souveraineté ? Je dis : il n’y a pas de souveraineté. Dès qu’il y a une souveraineté, il y a despotisme ; dès qu’il y a despotisme, il y a, sinon mort sociale, et encore souvent il ne s’en faut guère que cela soit, du moins désordre organique profond » (Royer-Collard, cité par Émile Faguet, in « Royer-Collard », Revue des Deux Mondes, tome 98, 1890, p. 161).
Gary Becker, The Challenge of Immigration. A Radical Solution, Institute of Economic Affairs, 2011.
a) La théorie du club.
La théorie du club est due à une étoile montante de la philosophie morale (et politique) Christopher Heath Wellman. Il a défendu ses positions dans plusieurs livres d’éthique appliquée34. Sur le plan philosophique, Wellman doit beaucoup à Michael Oakeshott (en particulier son livre sur Hobbes et l’association civile35). Sa position peut se résumer ainsi : les États légitimes bénéficient d’une autonomie de décision, la liberté d’association est une composante déterminante de l’autonomie de décision et la liberté d’association autorise quelqu’un à ne pas s’associer avec d’autres. En conséquence, un État légitime peut choisir de ne pas s’associer avec des étrangers, y compris de potentiels immigrants.
Avant d’expliciter cette position, on peut reprendre l’exemple donné par Wellman lui-même. C’est une comparaison qui part des relations entre États : «Invoquer les droits de l’homme ne permet pas d’expliquer pourquoi il serait faux et inapproprié pour un corps extérieur comme la Suède ou l’Union européenne d’annexer de force un État légitime comme la Norvège qui préfère rester en dehors de l’Union Européenne. La seule bonne explication est que des entités politiques comme la Norvège bénéficient de la liberté d’association. Mais si des entités politiques légitimes bénéficient de l’autonomie de décision qui leur permet de refuser des relations avec d’autres pays et organisations internationales, il semble naturel de conclure qu’ils sont également autorisés à rejeter l’association avec des individus étrangers. Par conséquent, tout pays qui respecte et protège les droits de la personne humaine possède un droit unilatéral de concevoir et de mettre en œuvre sa politique d’immigration. En somme, de la même façon qu’un individu a le droit de déterminer avec qui il souhaiterait se marier, un groupe de citoyens a le droit de déterminer qui il voudrait inviter à rejoindre la communauté politique36.»
Voilà le cœur de l’argumentation de Wellman pour défendre sa théorie du club. Car c’est bien d’un club qu’il s’agit, les nombreuses références à l’Augusta National Golf Club, en Géorgie, l’attestent : on n’entre pas dans un club par effraction, mais seulement si on y est invité, et à certaines conditions très précises. Personne ne songerait à remettre en cause l’autonomie de décision des clubs dans leur politique d’admission des membres : pourquoi en serait-il autrement pour des États légitimes ?
La position de Wellman est très habile par sa prudence. D’une part, à aucun moment, il n’est fait référence à la notion de souveraineté. On sait, depuis Royer-Collard37 qu’il n’y a rien de plus antinomique que les concepts de liberté et de souveraineté : dès que la souveraineté est invoquée (Dieu, nation, peuple, État et même individu), la liberté est menacée et risque de disparaître. Wellman parle donc d’« État légitime » et de «sphère d’autonomie de la décision» (self- determination). Cela témoigne notamment du fait que Wellman n’est pas du tout un liberal nationalist comme David Miller (auquel il est souvent comparé), mais un «déontologique» (un État légitime est un État qui respecte les droits de la personne humaine et qui, à cette condition, bénéficie d’une sphère d’autonomie de la décision) qui parvient à des conclusions réalistes. C’est un tour de force. Ainsi, il annexe Rawls à sa cause puisqu’il fait remarquer que le principe de différence, appliqué au niveau de la nation, prescrit de maximiser la situation du national le plus défavorisé, et c’est ce dernier dont la position serait menacée par une immigration incontrôlée. Rawls vote Wellman !
b) Critiques et appréciation
Une appréciation critique complète de la théorie du club devrait comporter l’examen de chacun des quatre éléments qui la constituent :
- qu’est-ce qu’un État légitime ? ;
- qu’est-ce que l’autonomie de décision (self-determination) ? ;
- la liberté d’association est-elle vraiment une composante de l’autonomie de décision? ;
- la liberté d’association est-elle la bonne base pour soutenir une politique closed borders ?
Toutes ces questions sont pertinentes et aucun des prédicats de Wellman n’est évident. Remarquons tout d’abord que cette position est à la fois idéaliste (déontologique) et extrêmement réaliste dans ses conclusions. C’est le point nodal. La théorie du club pourrait ressembler à celle de la gated community des libertariens, ou à celle de la communauté culturelle des communautariens. Mais ce n’est pas le cas, car elle évite toute référence à la notion de souveraineté, que ce soit celle de l’État, de l’individu ou de la communauté politique fondée sur la culture. De ce fait, la théorie du club échappe aux critiques justifiées qui ont été faites aux philosophies morales présentées plus haut.
Mais il faut souligner que l’habileté de cette position repose principalement sur la notion d’État légitime et d’autonomie de décision. Pour Wellman, un État légitime est celui qui respecte les droits de la personne humaine. Mais qui va apprécier la nature des droits en question et, surtout, leur respect ? À partir de quel moment un État gagne-t-il sa légitimité et quand la perd-il ? Si l’on dit que l’État est souverain, la question est réglée, mais c’est précisément ce que Wellman évite de faire. Il y a donc une grosse interrogation et une forte incertitude, car la continuité de la légitimité de l’État – et c’est un élément essentiel de l’État et de la vie interétatique – est fragilisée. Peut-être que la solution, non donnée par Wellman, relève-t-elle en définitive de la théorie du club : un État légitime serait-il celui que ses pairs reconnaissent comme tel et membre du «club des États respectueux des droits de la personne humaine» ? Ainsi la boucle serait bouclée.
La théorie du club de Wellman a trouvé un point d’application concret avec les travaux de l’économiste et prix Nobel Gary Becker38, même si ce dernier part de prémisses philosophiques radicalement différentes puisqu’il est utilitariste. Becker part du constat que les politiques de régulation de l’immigration par les quantités – on fixe un niveau maximal d’entrées au titre de l’immigration sur le territoire – ont échoué en Occident. Il pose alors une question : ne serait-il pas plus efficace de contrôler l’immigration par les prix que par les quantités ? Ce contrôle par les prix voudrait dire que l’admission d’un immigrant sur le territoire (au sein du club, pourrait-on dire) serait rendue payante. L’État fixerait un prix du permis de séjour (Becker évoque un montant de l’ordre de 50.000 dollars) et tout candidat qui paierait ce droit d’entrée pourrait pleinement et légitimement résider sur le territoire. Voilà l’idée de base, sachant que l’État aurait la faculté de faire varier le prix du droit d’entrée en fonction des besoins de l’économie et des préférences des nationaux. Le système prévu par Becker est très raffiné : il prévoit notamment la possibilité de prêts bancaires (un peu comme les prêts étudiants) pour les candidats à l’immigration. L’immigration est d’ores et déjà payante mais le droit d’entrée est capté par les passeurs et les trafiquants, donc ce système aurait des avantages certains : les choses seraient transparentes et l’État serait libre de redistribuer les montants collectés comme il l’entend, d’une façon certainement plus efficace. Mais, surtout, tout immigré qui aurait payé son droit d’entrée serait totalement légitime pour résider sur le territoire national : il «ferait partie du club», car il aurait non seulement payé sa cotisation mais aurait respecté les règles d’admission fixées par les membres du club. Cette proposition présente évidemment de réelles difficultés de mise en œuvre et l’on peut douter qu’elle soit jamais adoptée et pratiquée. Elle montre en tout cas que la théorie du club est susceptible d’applications intéressantes.
Le capital social de confiance et la régulation de l’immigration.
Voir Niklas Luhmann, Trust and Power, John Wiley & Sons, Niklas Luhmann, La Confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale [1968], Economica, 2006, et Le Pouvoir [1975], Presses de l’Université Laval, 2010.
David Kreps, Corporate Culture and Economic Theory, Cambridge University Press, 1990.
Bengt Holstrom et Jean Tirole: The Theory of Firm, chapitre 2, in Handbook of Industrial organization, Richard Scmalensee et Robert Willig, eds, North-Holland, .3rd printing, 1992
Russell Hardin, Trust, Polity Press, 2006
Voir, notamment, Robert Putnam et Lewis Feldstein, Better Together, Simon & Schuster,
Jean-Philippe Vincent, Qu’est-ce que le conservatisme ? Histoire intellectuelle d’une idée politique, Les Belles Lettres, 2016
Voir, notamment, Robert Putnam, Bowling The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, 2000 ; Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford University Press, 2002 ; avec David E. Campbell, American Grace. How Religion Divides and Unites Us, Simon & Schuster, 2010.
George Borjas, Immigration Economics, Harvard University Press, 2014.
David Halpern, Social Capital, Polity, 2005
Depuis le début des années 1970 s’est développée une analyse totalement renouvelée du rôle de la confiance dans la vie en société. Ce renouveau doit beaucoup à Russel Hardin, professeur à l’Université de Chicago, décédé en 2017, à des penseurs allemands comme Niklas Luhmann39 ou encore à l’Américaine Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009.
Selon ces auteurs et d’autres encore, la confiance est envisagée comme un actif incorporel dont l’existence est essentielle au bon fonctionnement des sociétés. Elle peut être un actif privé, c’est-à-dire le produit d’une interaction entre au moins deux individus, le rendement de ce produit et de cet actif étant réservé à ceux qui l’ont produit. Dans une entreprise, comme l’ont montré les économistes David Kreps40 et Jean Tirole41, la confiance entre les différents acteurs (dirigeants, salariés, fournisseurs, clients) peut produire un bénéfice de confiance mais qui sera réservé à ceux qui auront coopéré à la production de confiance : celle-ci est un actif privé. Globalement, telle est la thèse de Russell Hardin42.
Mais la confiance peut également être un actif social au sens où ceux qui auront produit la confiance ne seront pas les seuls à en profiter et qu’une bonne partie de la société touchera les dividendes de la confiance. La confiance est alors un capital social dont la production se fait en réseau : telle est la thèse de Robert Putnam, professeur de science politique à Harvard43.
Il n’y a pas lieu de trancher entre ces deux conceptions, qui sont d’ailleurs plus complémentaires que véritablement opposées. Elles se rejoignent pour considérer que la confiance (privée et sociale) est probablement le capital social le plus précieux d’une société. Pour reprendre une image que j’ai déjà utilisée dans l’un de mes ouvrages, la main invisible libérale d’Adam Smith ne peut rien sans la seconde main invisible et conservatrice de la confiance44. Il n’y a pas de bonne économie sans confiance.
Robert Putnam, Elinor Ostrom et d’autres estiment que le capital social de confiance se construit principalement en réseau et dans le cadre de communautés (et non de communautarismes, évidemment) de tous ordres. Cette production en réseau donne toute sa force à la production de confiance mais est également une source de faiblesse, car un réseau est par essence fragile. En 1992, Russell Hardin a eu une intuition très forte : si une partie de la confiance se produit en réseau et par des communautés, est-ce que des chocs migratoires répétés et importants ne risquent pas de déstabiliser les communautés, la production en réseau et, en définitive, celle de la confiance ? Robert Putnam et d’autres se sont engouffrés dans cette brèche. Dans plusieurs de ses livres, il défend notamment l’idée qu’il faut maîtriser l’immigration de telle sorte qu’elle ne dégrade pas le capital social d’une nation45. Putnam a reçu le soutien objectif du grand économiste et spécialiste de l’immigration, George Borjas46. Ce dernier, en étudiant quelques vagues d’immigration massive aux États-Unis et ailleurs, a montré, chiffres à l’appui, que l’immigration incontrôlée pouvait détruire la confiance entre communautés, dégrader le capital social et engendrer toutes sortes d’effets pervers (baisse du taux d’assimilation, migrations internes, baisse du capital humain, etc.). D’où la recommandation d’avoir une politique d’immigration sans excessive faiblesse.
La thèse de Putnam peut donc se formuler de la façon suivante : la politique d’immigration doit être indexée sur le degré de confiance d’une société. Si ce degré est élevé, alors la politique peut être souple. Si le degré de confiance est faible, la politique d’immigration doit tendre vers des closed borders, le temps que la confiance du pays d’accueil soit «soignée». S’il s’agit là d’une approche très séduisante, car finalement assez flexible et subordonnée à des conditions – le bien commun, en fait, acceptable par presque toutes les écoles –, elle n’en pose pas moins des problèmes sérieux.
Notons tout d’abord que cette approche fournit des guidelines pour mener une politique d’immigration, mais qu’elle ne justifie pas la différence de traitement politique entre nationaux et étrangers. Celle-ci reste l’apanage de la «position libérale classique», décidément incontournable. Par ailleurs, l’approche en termes de capital social a des fondements philosophiques incertains et contradictoires : Putnam est probablement communautarien, mais Hardin était utilitariste, tandis que Elinor Ostrom était une libérale de stricte observance, avec des influences conservatrices, et que David Halpern, lui, est proche du libéralisme de gauche47.
Par ailleurs, si les indices de confiance sont désormais nombreux à tous les niveaux et de mieux en mieux calculés, les index pertinents – puisque la confiance est produite en réseau dans le cadre de communautés – seraient des indices de confiance par communauté. C’est possible, mais déjà plus difficile. Et surtout, que se passe-t-il si les index de confiance de certaines communautés sont au beau fixe tandis que ceux d’autres communautés sont très faibles ? Dans de tels cas, comment arbitrer ? On peut craindre, en définitive, que la politique d’immigration se cale sur l’indice communautaire le plus faible et qu’elle soit donc restrictive de façon permanente.
Conclusion
David Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt [1817], Garnier-Flammarion, 1999.
Les développements précédents ont pu donner l’impression d’une grande richesse (quantitative) de travaux d’éthique appliquée sur la question de l’immigration. En fait, il n’en est rien : jusqu’à une date très récente, la philosophie morale s’est peu intéressée à cette problématique. Il est vrai qu’il y a un rattrapage et que les travaux récents sont de grande qualité. Il y a là, sans doute, une explication quant au très grand nombre d’idées reçues sur l’éthique de l’immigration. Tout est fait pour donner l’impression que la seule alternative possible est entre la position «frontières ouvertes» du pape François ou la fermeture absolue dans une posture «défense de l’ethnos» inspirée de Carl Schmitt. Si le choix se résumait à cela, ce serait désespérant.
Mais il y a plus étonnant encore que la parcimonie des travaux de philosophie morale sur l’immigration, à savoir la quasi-inexistence de la philosophie politique dans le débat, alors qu’elle est bien sûr éminemment concernée. Quid de l’avenir de l’État-nation face à une immigration débordante ? Quid de l’État face à la position « frontières ouvertes » des libéraux de gauche et des libertariens ? Quid de la souveraineté ? Quid des relations interétatiques en face de l’«Internationale de l’immigration» qu’une partie des catholiques appellent de leurs vœux ? Voilà quelques questions qui devraient interpeller les philosophes du politique et les stimuler. Cette conclusion est donc, en partie, un appel à la philosophie politique : qu’elle nous aide à penser l’immigration !
Et puis il y a l’économie. On a vu qu’il existe aux États-Unis de nombreux travaux, d’une très grande qualité, qui aident à penser l’immigration. En France, malheureusement, les travaux de théorie appliquée sont quasiment inexistants. Ceci contribue encore à nourrir les préjugés. Pourtant, le point de vue économique est essentiel pour éclairer les enjeux. On sait que David Ricardo a inventé, au début du XIXe siècle, la théorie des avantages comparatifs48. Cette théorie, toujours valable dans ses grandes lignes, justifie le libre-échange des marchandises et des services puisque la spécialisation se fait non en fonction des avantages absolus (la compétitivité, en quelque sorte) mais des avantages (la productivité) comparatifs. De sorte que même le pays le plus désavantagé a toujours quelque chose à exporter et bénéficie du libre- échange. Mais ce que l’on omet généralement de dire, c’est que dans l’esprit de Ricardo l’avantage comparatif et le libre-échange des biens avaient cette vertu d’éviter les déplacements de populations, les migrations. Ricardo avait raison : les désordres de l’immigration résultent pour une bonne part des désordres du système de libre-échange des biens, des services et des capitaux. Ce sont les biens plutôt que les populations qui doivent bouger, s’échanger : les migrations sont presque l’aveu d’un échec.

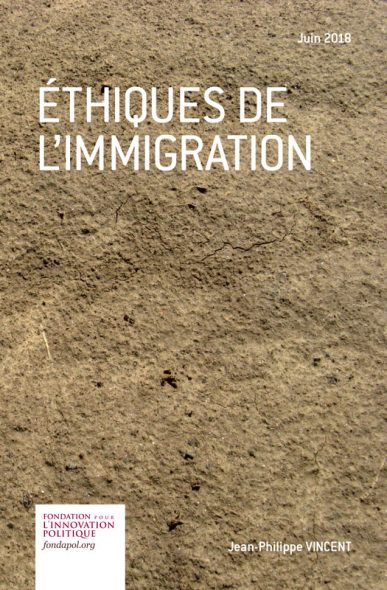












Aucun commentaire.