L’Ecole de la liberté : initiative, autonomie et responsabilité
Les établissements
Les collectivités territoriales
Les professeurs
Le ministre et les corps de contrôles
Conclusion
Résumé
En dépit des réformes engagées depuis plusieurs années, l’école française, du primaire au lycée, peine à atteindre des résultats à la hauteur de ceux obtenus par les systèmes comparables en Europe. Classement après classement le déclin du modèle éducatif français paraît inéluctable. La responsabilité ne peut en incomber à un quelconque défaut de réforme, car notre système éducatif à été à l’inverse soumis à une vraie frénésie de grands soirs et de matins qui déchantent sans que sa performance, c’est- à-dire les progrès mesurés chez lesélèves, ne s’améliore de manière signi- ficative. Les politiques publiques menées en matière scolaire ont parfois privilégié l’octroi de rares libertés nouvelles, mais plus fréquemment elles ont pratiqué une religion assidue de l’égalité, que l’on a voulue « réelle ». Celle-ci s’est réduite en dernier ressort à une distribution indistincte et sans discernement de moyens et de postes qui s’est avérée incapable de corriger certaines inégalités et de conjurer le déterminisme sociologique qui pèse sur les élèves les plus faibles. Partant de la croyance erronée que l’octroi de moyens considérables en personnels et en financement, garantiront mécaniquement le progrès pour tous, les pouvoirs publics n’ont eu de cesse que d’accorder le plus possible, le plus tôt possible, le tout sans considération des situations individuelles. En compensation de ses larges ses l’État a érigé le contrôle a priori et la centralisation en mode ordinaire et aveugle de direction du système éducatif. Ce système déjà inefficace et à bout de souffle en période d’abondance, est désormais condamné dans le contexte contemporain desimpasses budgétaires dans lesquelles se trouve un État exsangue.
Pour rompre avec un modèle dépassé, l’école doit à présent évoluer profondément dans trois directions. D’abord vers la liberté d’initiative et de prise de responsabilités enfin reconnue à ceux qui la font vivre chaque jour, et donc vers l’autonomie administrative et pédagogique conférée pleinement aux établissements. Aujourd’hui l’immobilisme vient d’en haut alors qu’en réalité tout se gagne au cœur des classes, des écoles, des collèges et deslycées. Loin des plans d’ensemble minutieusement élaborés par l’échelon central, mais jamais vraiment appliqués, l’autonomie consiste à rendre possible des formes d’organisation du travail et d’usage des ressources, plus pragmatiques, plus efficaces, plus diversifiées et plus respectueuses des personnes dont elle reconnaît les savoir-faire et encourage les initiatives. Les choix éducatifs doivent ensuite être réalisés au plus près des réalités très diverses qui caractérisent notre territoire national. La relation entre le centre et la (les) périphérie(s) doit être inversée. L’académie, et donc l’échelon régional, doit devenir l’échelon de principe de toute décision en matière éducative, réserve faite des compétences que l’État peut seul assumer, mais qui se réduisent, – et c’est essentiel – à la définition des contenus qui déterminent les programmes nationaux, à la collation des grades et des diplômes, au niveau d’exigence qu’il fixe pour tous et aux garanties qu’il accorde à la qualité du recrutement de ses fonctionnaires. Enfin le rôle des maîtres, des éducateurs, des professeurs et de toute la fonction enseignante doit être repensé. Cette réflexion doit se situer dans un cadre national, mais aussi en fonction des nécessités de proximité, et compte tenu des situations individuelles des élèves ; elle ne peut se limiter à la redéfinition du service des professeurs et doit porter d’abord sur la redéfinition de leurs missions.
Ainsi dans un cadre national simple, clair, intelligible, les établissements scolaires doivent désormais respirer à leur rythme, se sentir responsables et incités à l’initiative. C’est à eux de choisir leurs moyens, notamment pédagogiques, d’atteindre les objectifs fixés par la Nation.
Pour l’école est venu l’âge de l’autonomie, partout.
Charles Feuillerade,
Haut fonctionnaire.
Aucune campagne n’y échappe, et celle qui s’annonce doublement, présidentielle et législative, ne fait pas exception à la règle : la question éducative est de nouveau posée. Le débat public et politique sur la question éducative est récurrent, cyclique, quasiment un passage obligé à l’approche des échéances les plus importantes. Son traitement obéit à des règles, à des postures et, finalement, à des conclusions qui paraissent tout aussi convenues. Au risque de caricaturer, on peut affirmer que la question éducative, ou de l’école au sens large, est généralement abordée sous trois angles principaux :
- le « niveau » des élèves, la pédagogie, les programmes et leur adap- tation aux évolutions de la connaissance. Ce discours, qui prend lui- même appui sur celui relatif à la valeur des diplômes (baccalauréat), sur la problématique de l’orientation et sur l’analyse des grands indicateurs publics (taux de réussite ou d’accès au baccalauréat, pour ne citer qu’eux), alimente les thèses respectives des sectateurs du niveau « qui monte » et des contempteurs de celui « qui baisse » ;
- l’organisation complexe du système éducatif constitue un deuxième angle d’attaque possible du sujet : d’un côté, une administration centra- lisée et fortement hiérarchisée ; de l’autre, un monde enseignant pau- périsé mais disposant d’une large liberté pédagogique qui garantit une sorte d’exercice libéral d’une fonction publique ; trois niveaux différents de collectivités territoriales ; la survivance jusque dans les procédures pédagogiques et administratives des trois « ordres d’enseignement » (primaire, secondaire, supérieur) ;
- enfin, la question récurrente des moyens (nombre d’élèves par classe, nombre de classes, le nombre des options, nombre de postes d’en- seignants, scolarisation des tout-petits…) oblitère souvent les termes du débat public, même si la France dépense plus que tous les pays compa- rables pour son école. Le quinquennat actuel accentue cette perspective, tant il est vrai que la politique sans faille de réduction de l’emploi public dans le domaine scolaire et, plus largement, les mesures de contention de la dépense publique au sein de l’État troublent l’opinion publique.
Ces trois approches connaissent elles-mêmes chacune deux variantes méthodologiques, selon que l’on met l’accent sur un discours politique, centré sur les choix et sur les valeurs, ou sur un discours d’expert du monde éducatif, pédagogique ou technocratique.
On observera finalement que la question centrale des résultats objectifs obtenus par « le système » n’est pas la plus débattue, alors même qu’elle devient de plus en plus prégnante, car les comparaisons internationales ne cessent de démontrer, enquête après enquête, les échecs et les fragilités du système éducatif français en dépit d’une frénésie de grandes et de petites réformes.
La problématique des résultats objectifs est pourtant la première, car c’est elle qui peut répondre à l’aspiration forte et incontestable de nos concitoyens en matière éducative. La République doit garantir à tous une école qui assure l’accès de chacun aux diplômes, à l’instruction, à la qualification ou à la poursuite d’études, une école qui joue son rôle d’ascenseur social, une école qui prioritairement instruit, mais aussi ras- semble et transmet les valeurs de la République.
Est-il possible, pour s’interroger sur les voies d’amélioration des résultats obtenus, d’aborder la question de l’école de façon un peu différente, sans renoncer aux apports des analyses qui fondent les approches précitées ? Sans doute, si l’on examine l’école sous le prisme classique des grandes aspirations entre égalité et liberté qui tenaillent la société française.
Entre égalité et liberté, l’école contemporaine n’a jamais vraiment su choisir et, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, une société qui se méfie du risque, de l’innovation, et qui aspire légitimement à une sécurité toujours plus grande a inévitablement fait osciller le balancier d’un choix à l’autre, au gré des mouvements et des réactions plus ou moins vifs des acteurs du monde éducatif.
- La liberté : l’école contemporaine n’a jamais vraiment su s’en emparer. Tous les acteurs du système éducatif, et tous pour des raisons différentes, y ont vu un facteur de risque ; tous, à l’inverse, aspirent à une sécurité toujours plus grande, à des garanties plus fortes, à des moyens illimités. Les quatre années qui viennent de s’écouler se sont pourtant inscrites dans une perspective tendant à offrir plus de liberté : liberté pour les élèves et les parents de choisir leur établissement scolaire (c’est le sens de l’assouplissement de la carte scolaire, quelles que soient par ailleurs les imperfections persistantes de l’actuel système), liberté dans le cadre de l’école primaire pour les parents, les maires et les professeurs de choisir le rythme d’organisation de la semaine, liberté pour les lycéens de réaliser des choix d’orientation moins définitifs et moins contraints que par le passé, liberté plus grande pour les chefs d’établissements de s’organiser, etc.
- L’égalité : l’orientation générale des politiques publiques en matière d’éducation privilégie tendanciellement une religion assidue de l’égalité, qui se confond avec l’égalitarisme. Dans le chapitre visant à « bâtir l’égalité réelle », le projet du Parti socialiste se place sous l’angle des moyens et de l’égalité, les deux paraissant synonymes dans le « nouveau pacte éducatif ». Comme si l’action en faveur de l’application de l’égalité réelle se réduisait à un investissement massif et sans discernement, consistant (le plus possible, le plus tôt possible, le tout indistinctement, sans considération des situations individuelles) à consacrer des moyens illimités à l’action éducative de l’État et à compenser ces largesses par le contrôle et la centralisation. On part du postulat erroné que les moyens en personnels et en financement, les plus considérables possibles, garantiront mécaniquement le progrès pour tous. Hélas ! la distribution égale des moyens et des postes, même amendée par la « discrimination positive », s’est avérée incapable de corriger certaines inégalités et de conjurer le déterminisme sociologique qui pèse sur les élèves les plus faibles.
L’exercice de la liberté et des libertés au sein de notre système éducatif n’est cependant pas impossible. Il a simplement contre lui d’inspirer crainte et défiance. Crainte d’une balkanisation du système dans son ensemble, d’une rupture généralisée de l’égalité entre les élèves, entre les professeurs, entre les territoires, inquiétude face à l’avancée vers l’inconnu que représenterait le droit reconnu aux équipes éducatives (de direction, administrative et pédagogique) de prendre des initiatives propres, peur des implications systémiques de ce choix sur l’ensemble de l’organisation actuelle et sur la situation de ceux qui s’y insèrent. On pourrait répondre à ceux qui expriment ces craintes que la recherche de l’égalité n’a empêché aucune des dérives que l’on prétend conjurer, que la situation actuelle est en réalité plus défavorable pour les plus faibles qu’elle ne l’a jamais été, que les inégalités territoriales sont une réalité incontestable sur l’ensemble du territoire national, à Paris comme en régions, que les comparaisons internationales nous accablent, que l’im- mobilisme n’est plus supporté par les acteurs eux-mêmes. On pourrait ajouter aussi que l’uniformité et le nivellement, qui sont les vrais noms d’une supposée égalité réelle, sont les véritables ennemis de l’égalité, car on sait que les plus aisés échappent toujours à sesrigueurs.
Tout cela ne suffirait sans doute pas à lever les craintes. Il faut donc aller plus loin pour dresser le portrait de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Il faut d’abord se rappeler que la France se fonde sur une conception élective et non ethnique de la nation. Elle est moins une origine qu’un projet, un creuset où fusionnent les différences et les convictions privées. Ce souci d’intégration dans un espace républicain, dans une communauté civique, a conduit notre modèle politique à adopter ce principe simple : devenir français, c’est devenir citoyen français. Il faut donc susciter, entretenir, transmettre les ferments de l’unité : tel est l’enjeu premier de la nation. Et c’est l’école qui s’en charge, ou plutôt qui s’en chargeait.
Aujourd’hui, le lien entre école et nation s’oblitère. Chacun en connaît les causes. D’un côté, le vieux nationalisme, en France comme ailleurs, est en train de dériver vers une sorte de mouvement d’autodéfense de citoyens effrayés par l’interdépendance mondiale. À l’opposé, les identités communautaires se développent sans toujours se soucier de rester compatibles avec les valeurs communes de la République. Et même l’universalisme suscité par la mondialisation des techniques et de la communication n’est pas sans risque. Les citoyens, qui s’habituent à la culture du Net et de l’« hyperlien », en attendant la suite, se désintéressent de la proximité, au profit du mondial. Cette situation a touché l’école, tiraillée entre deux tendances. D’un côté, elle est soucieuse de l’éveil des consciences ; de l’autre, elle doit résister à la puissance de l’opinion, délivrer les jeunes des subordinations culturelles du moment, assurer une cohérence au savoir, garantir l’unité de ce qui se transmet. Face au pouvoir des émotions, des idéologies et des modes, l’enseignement est un contre-pouvoir.
Mais si l’on veut que l’école joue pleinement son rôle d’unificatrice de la communauté civique et nationale, encore faudrait-il qu’elle garantisse la justice sociale et l’égalité des chances. Or ce n’est plus toujours le cas aujourd’hui. Une enquête sociologique sur « la perception des inégalités et le sentiment de justice », a été menée par le Groupe d’études des méthodes de l’analyse sociologique à la Sorbonne (Gemass), avec le soutien de l’Académie des sciences morales et politiques. De cette enquête très riche, on ne retiendra ici qu’un fait et un chiffre. Le fait, positif : la qualité des établissements scolaires n’est citée qu’en fin de classement des causes d’injustice sociale liée à l’école. Et le chiffre, nettement plus inquiétant: 36% des Français interrogés jugent les inégalités scolaires « très fortes ».
Une chose est sûre : si l’école a réussi à scolariser tout le monde, elle a échoué dans sa mission d’intégration et de promotion. La massification n’est pas la démocratisation. Les chiffres publiés régulièrement par l’OCDE l’ont démontré. Parmi une trentaine de pays comparables, nous nous classons médiocrement : la France est dixième en culture mathématique et, pire encore, elle se retrouve au quatorzième rang pour la compréhension écrite. Une partie de l’enquête dite Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) porte sur le lien entre milieu socio-économique et performances des élèves dans la compréhension de l’écrit. Pour l’ensemble des pays de l’OCDE, un élève issu d’un milieu privilégié devance son camarade issu d’un milieu moins favorisé de 38 points, soit l’équivalent de près d’une année d’étude. Pour la France, l’écart est de 50 points, c’est-à-dire bien supérieur à la moyenne des pays concernés.
Il faut se rendre à l’évidence : le premier facteur de réussite scolaire pour un enfant reste son milieu familial, le niveau d’études de ses parents, de sa mère en particulier. Les hiérarchies sociales et culturelles se reproduisent très tôt selon les types d’établissements, de classes et de filières. Le nombre d’enfants issus de milieux défavorisés qui accèdent aux études supérieures ou aux grandes écoles ne cesse de diminuer dramatiquement. Si les initiés tirent seuls leur épingle du jeu, si l’école de la République ne permet pas le brassage social, si elle ne joue plus son rôle de promotion sociale et culturelle, qui s’en chargera ? Au risque de lasser, il faut rappeler ici que la première responsabilité de l’école, celle pour laquelle la nation a le devoir de demander des comptes, c’est d’assurer et de garantir, la maîtrise des fondamentaux à chaque élève. Aucun élève ne doit pouvoir quitter l’école primaire pour entrer en sixième sans savoir lire, écrire et compter, comme c’est encore le cas pour un quart des jeunes Français aujourd’hui. La priorité absolue porte sur l’apprentissage renforcé de la lecture, avec repérage et traitement précoce des élèves en difficulté, mission existentielle de l’école. Cette ambition est largement préparée par le travail législatif (loi du 28 avril 2005) et régle- mentaire des deux mandatures précédentes. Il s’agit donc à présent de lui donner un caractère véritablement effectif. L’unité de la société française dépend de l’aptitude de son école à garantir l’unité de son enseignement, principalement le socle commun de connaissances et de compétences. Telle est la voie du redressement.
Comment permettre à notre système éducatif de traduire ces buts et ces exigences dans lavie des élèves ? La seule issue aux impasses actuelles de notre système scolaire doit être recherchée dans la réalisation d’un bon équilibre entre deux aspirations, que l’on a souvent opposées artificiellement mais qui ne sont nullement contradictoires : d’une part, la liberté pleinement reconnue à ceux qui font vivre l’école dans les établissements ; d’autre part, la garantie de l’égalité de traitement dans un cadre dont les grandes orientations sont définies nationalement.
Pour les raisons indiquées plus haut, le choix d’une politique éducative qui renonce ainsi à l’uniformité et au centralisme pour reposer sur l’autonomie des établissements et l’exercice de libertés locales nouvelles doit être compatible avec quelques exigences simples : le progrès pour le plus grand nombre ; l’attention particulière due aux plus fragiles ; la mesure régulière et objective des résultats et des progrès ; la prise en considération des individus autrement que par leur appartenance à un sous-ensemble traité de manière uniforme et, finalement, corporatiste ; la mise en place de mécanismes de contrôle a posteriori.
Le principe d’une politique éducative fondée sur la liberté et la confiance pourrait alors s’articuler autour de trois idées, érigées en principes et en choix politiques. Il faut exposer ces trois idées, mais aussi en déterminer les principales implications.
En premier lieu, la liberté administrative et pédagogique en même temps que la confiance et la dévolution des moyens correspondants doivent être effectivement transférées aux établissements eux-mêmes, aux instances qui les dirigent, aux professeurs qui les animent, aux parents qui doivent davantage s’y impliquer, pour qu’ils puissent s’organiser selon des modalités qu’ils déterminent librement, recruter selon les besoins qu’ils expriment, à charge toutefois pour eux de rendre compte des résultats qu’ils obtiennent au regard des exigences qui demeurent fixées par la nation seule. Déconcentrer, et pourquoi pas décentraliser dans certains cas, mais à tout le moins donner sa pleine liberté au monde éducatif constituent, à l’image de ce que réalise aujourd’hui l’enseigne- ment supérieur, autant d’objectifs surlesquels il est possible de construire un paysage éducatif neuf en France.
En deuxième lieu, on doit pouvoir proposer, selon le principe du libre choix, des parcours de carrière différenciés aux futurs enseignants, nouveaux entrants. Un enseignant choisira entre une carrière classique et statutaire, vouée dans sa durée à l’enseignement, ou bien un parcours contractuel plus court, comportant des obligations de service plus sou- tenues, ne se réduisant pas au seul face-à-face pédagogique, offrant en contrepartie des rémunérations plus attractives et donnant finalement vocation à exercer une autre activité, soit dans le monde éducatif, soit en dehors ou autrement. Certains secteurs de l’État offrent ainsi aujourd’hui une pratique réussie de processus d’accompagnement à la reconversion. La liberté, c’est aussi de ne pas être enfermé dans un métier, sans même la perspective d’un avenir simplement différent. Un choix symétrique doit pouvoir être offert à ceux qui se destinent à l’exercice de fonctions administratives et d’encadrement.
Enfin, l’idée consiste à pousser plus avant, sous la conduite des recteurs garants du respect des exigences nationales, la politique de déconcentration des décisions et des responsabilités. L’académie, et donc l’échelon régional, doit devenir l’échelon de principe de toute décision en matière éducative, réserve faite des compétences que l’État peut seulassumer, mais qui se réduisent – et c’est essentiel – à la définition des contenus qui déterminent les programmes nationaux, à la collation des grades et des diplômes, au niveau d’exigence qu’il fixe pour tous et aux garanties qu’il accorde à la qualité du recrutement de ses fonctionnaires. Dans ce contexte, des questions aussi essentielles à la vie d’un établissement (c’est-à-dire d’une communauté qui est humaine avant d’être éducative) que celles du choix d’orientations pédagogiques propres, et donc des enseignants qui y concourent, de l’organisation de son temps, de ses rythmes, de la répartition des moyens dont il dispose librement, des partenariats et concours dont il souhaite s’entourer, des aides financières qu’il entend accorder aux élèves les plus fragiles, etc., doivent pouvoir se décider sans que le niveau central vienne limiter les libertés et les initiatives locales autrement que par un contrôle a posteriori.
Toutefois, si le choix de l’autonomie des établissements ne devait se traduire que par la réforme statutaire des écoles, des collèges, des lycées, et celle des personnels, les progrès ne seraient pas significatifs et les forces de rappel ne tarderaient pas à annihiler les prises d’initiative. La mise en place générale d’un système éducatif entièrement déconcentré, privilégiant le droit d’initiative d’établissements devenus autonomes, dont le pivot serait l’académie, capable de mesurer ses résultats régulièrement d’une manière autorisant les comparaisons dans le temps, ce système nouveau, donc, n’est susceptible de produire des effets bénéfiques sur la réalisation des objectifs nationaux qui si elle emporte simultanément une mutation profonde de l’ensemble du fonctionnement et des pratiques actuelles de l’Éducation nationale.
Il ne faut donc pas se tromper : la conduite de réformes fondées sur la liberté, la confiance et l’autonomie plutôt que sur l’uniformité, la surveillance et l’immobilisme emportera des changements majeurs pour toutes les parties prenantes du monde éducatif.
Pour les élèves, c’est l’apprentissage, sous la conduite des enseignants, des équipes de direction et de vie scolaire, comme sous celle des parents, d’une plus grande autonomie personnelle, de méthodes de travail qui privilégient l’atteinte d’objectifs précis, régulièrement mesurés, et non la soumission à des enseignements uniformes qui trouvent dans l’obligation d’« achever le programme » (sic) leur propre justification. C’est également pour eux la perspective d’une meilleure prise en compte indi- viduelle face à la difficulté ou, plus simplement, pour les guider et les accompagner dans les choix qui rythment la vie scolaire. C’est aussi reconnaître en particulier aux lycéens des responsabilités réelles, identifiées, dans la vie quotidienne et la conduite des affaires de leur établissement. Il ne s’agit ni de céder à une sorte de démocratie de façade trompeuse ni de mélanger les genres – les élèves ont horreur de cela –, mais bien de confier aux élèves des tâches opérationnelles.
La reconnaissance d’une liberté de décision au plus près des élèves permet enfin de valoriser le mérite scolaire : il n’est, par exemple, pas très coûteux de créer ou de transférer des bourses d’excellence, dont l’attribution se ferait directement par décision des équipes responsables de l’établissement, les élèves retenus bénéficiant alors non seulement d’un chèque annuel ou trimestriel très substantiel leur permettant d’envisager des études longues, mais tout autant d’un accompagnement et d’un encadrement adapté.
Les établissements
La liberté pédagogique et administrative en même temps que la dévolution des moyens correspondants et de la gestion des ressources humaines doivent être effectivement transférées aux établissements. À charge pour eux de rendre compte des résultats qu’ils obtiennent au regard d’exigences qui demeurent fixées par la nation seule. Dans les collèges et lycées, les principaux et proviseurs doivent d’abord pouvoir choisir librement leurs équipes de direction (sait-on seulement qu’aujourd’hui ce n’est pas le cas ?), pour concevoir ensuite avec elles et les enseignants le projet sur lequel ils entendent engager leur établissement. Il n’est pas anormal qu’en fonction de réalités locales, de caractéristiques particulières, d’atouts spécifiques, d’une localisation géographique singulière, de liens historiques propres ou de partenariats anciens avec l’extérieur qu’un établissement décide de privilégier des choix d’enseignement, des options ou des pratiques pédagogiques inédites. Qu’importe si ce qui se fait ici ne se fait pas partout de manière uniforme pourvu que cela soit bien fait, dans l’intérêt des élèves, dans le cadre d’un dialogue et sous le contrôle des autorités académiques de proximité, inspection académique et rectorat. Admettre le principe de liberté des choix stratégiques de l’établissement aurait, en outre, le mérite d’une plus grande transpa- rence pour les parents, les élèves – et le ministère ! – car, bien souvent, les initiatives locales sont tues, pour éviter qu’elles ne soient récusées. Citons ainsi le cas de ce lycée qui s’est attaché à lutter contre des taux très élevés de redoublement en seconde. Prenant le parti de ne pas entrer dans la mécanique, bureaucratique a priori, de « validation-des-pratiques-pédagogiques-innovantes », la direction et les professeurs ont choisi, sans en référer à quiconque, de faire passer dans la classe supé- rieure ceux des élèves « qui étaient justes » et qui étaient ordinairement voués à un redoublement dont la plus-value n’a jamais été démontrée. Les élèves ainsi concernés se sont contractuellement engagés vis-à-vis de leur professeur à suivre tout au long de l’année des heures quoti- diennes de soutien dans les disciplines où ils éprouvaient des difficultés. Le proviseur, ayant allégé ses classes de seconde des élèves qui désormais n’y redoublaient plus, a dégagé mécaniquement les moyens corrélatifs qui lui ont permis d’assurer en classe de première les heures de soutien auxquels tous les élèves concernés se sont soumis avec une parfaite assiduité. En moins d’une année, il a résulté de ce choix décidé et assumé au sein de l’établissement la situation suivante : des classes de seconde, qui n’étaient plus condamnées à accueillir des redoublants démotivés et passifs ; des élèves plus responsables, auxquels une nouvelle chance avait été offerte en contrepartie d’un effort supplémentaire réel ; des équipes de professeurs et de direction soudées autour d’un projet défini et conduit de manière partagée, pour un coût budgétaire nul. Contrairement à ce que l’on croit trop souvent, les exemples de cette sorte abondent et l’ingéniosité et le savoir-faire des personnels sont rarement démentis. Il faut leur offrir la liberté de se réaliser.
Si l’on veut donner aux équipes de direction des établissements la liberté de choisir, il faut d’abord doter ceux-ci des meilleurs chefs possibles. Ce n’est offenser personne que d’affirmer que la réalité actuelle n’est pas toujours telle. La détection et la formation des futurs chefs d’établissement, de leurs adjoints, de leurs équipes doivent être repensées en prenant appui sur les ressources qu’offre l’Éducation nationale – elle dispose d’une École supérieure –, mais aussi en s’ouvrant à d’autres lieux et creusets de formation, capables notamment de donner aux futurs proviseurs et principaux la formation humaine dont ils auront avant tout besoin. Un proviseur de lycée comptant plus de 1 000 élèves et des dizaines de professeurs et personnels administratifs exerce des responsabilités de haut niveau, comparables à celles d’un chef d’entreprise ou d’un chef de corps, et il doit être techniquement et humainement formé à ces exigences. Pour cette raison également, le vivier des chefs d’établissement ne peut davantage se réduire au seul monde éducatif, il doit largement s’ouvrir à d’autres talents, à d’autres expériences, à d’autres profils. Il n’en manque pas et la mission est passionnante.
Il faut simultanément réformer le statut des lycées et collèges, repenser leur gouvernance interne, pour permettre aux équipes de direction libre- ment constituées de définir leur projet, puis de le mettre en œuvre. Les équipes de direction doivent disposer des prérogatives indispensables à la conduite stratégique et quotidienne de leurs établissements. Dans un établissement scolaire, encore moins que dans n’importe quelle autre organisation, on ne peut admettre que la prise de décision soit entravée par l’absence de hiérarchie ou d’autorité.
Le progrès au sein des établissements passe par l’affermissement de l’autorité de leur direction. À ceux qui craignent la tyrannie des chefs, il faut rappeler, d’une part, que les chefs d’établissement sont eux-mêmes inscrits vis-à-vis des recteurs dans une relation hiérarchique forte et, d’autre part, que le défaut d’autorité a le plus souvent pour corollaire l’impuissance et, parfois avec des conséquences plus tragiques, la dilution de la responsabilité. Le fonctionnement démocratique d’un établissement suppose, à l’inverse, l’identification de proviseurs et principaux dont l’autorité se traduit par l’exercice de prérogatives réelles, y compris dans la relation avec les enseignants, devant rendre compte de leur action à un conseil d’administration dont la composition doit être repensée dans le sens d’une représentativité élargie au-delà du seul monde éducatif.
La relation des établissements avec les autorités de tutelle doit également fondamentalement changer. Elle est aujourd’hui presque exclusivement fondée sur une logique d’attribution unilatérale et uniforme de moyens. Il n’y a place ni pour le dialogue ni pour la prise en compte des aspects qualitatifs de la réussite des équipes éducatives et ni, ce qui d’une certaine façon est pire, pour la mesure et la prise en considération de l’échec. Dans le jargon du monde éducatif, on dira que la centrale délègue aux rectorats, ceux-ci, comptables de la pénurie, déléguant à leur tour aux établissements. Pour éclairer son pilotage, les directions centrales conduisent alors de multiples enquêtes. Il faut interroger les proviseurs et les principaux pour prendre l’exacte mesure de l’exaspération que suscite, pour eux, la multiplication de ces enquêtes demandées par « la centrale », lourdes, toujours urgentes, coûteuses en temps et en moyens, parfois redondantes, et dont le sens reste le plus souvent abscons. La réalité est qu’une organisation qui compte 1 million de personnels et 12 millions d’usagers ne peut pas être pilotée de façon centralisée. Il faut une forme d’arrogance ou, si l’on préfère, un sérieux défaut d’humilité et de sens des réalités pour le croire. Une telle organisation ne peut être orientée que dans un cadre fortement déconcentré. On peut du reste illustrer le propos par les deux grands moments de la vie scolaire que sont son début, la rentrée, et son achèvement, le baccalauréat, dont la réussite technique – à dire vrai une prouesse – est le fait d’une organi- sation totalement déconcentrée. Il est donc indispensable de rompre avec le modèle centralisé actuel, dont les limites sont atteintes et dépassées, qui uniformise et encourage l’immobilisme ou la simple conservation de ce qui a été obtenu l’année précédente. Il faut, à l’inverse, faire pré- valoir la contractualisation des relations entre, d’une part, les autorités académiques et, d’autre part, les lycées et, dans une moindre mesure, les collèges ainsi que, si elles le souhaitent, les collectivités locales de rat- tachement. La contractualisation et le pilotage par la mesure des résultats c’est-à-dire a posteriori, doivent ainsi se substituer au centralisme a priori, aveugle et inefficace.
Dans le premier degré, tout est à construire puisque, en réalité, faute de direction, les écoles primaires n’ont jamais été dirigées. Il est urgent de donner aux directeurs d’école l’autorité nécessaire afin de piloter les actuelles écoles primaires, ou plutôt, demain, de futurs établissements du premier degré dotés de la personnalité morale. Cette mesure, simple à mettre en œuvre, vise à affirmer l’autorité du directeur d’école et correspond à une attente des parents d’élèves et de la plupart des maires. Il appartient au législateur et à l’exécutif, chacun pour la part qui leur revient, de desserrer les contraintes de l’organisation scolaire actuelle dans le premier degré. Rien ne s’oppose vraiment à ce que coexiste, sans mettre en péril l’école communale et selon les besoins locaux, une assez grande variété d’organisations. De l’établissement public du premier degré de droit commun à l’école fondamentale du socle conduisant du cours préparatoire à la troisième, il faut autoriser et encourager la diversification des modes d’organisation scolaires. Des communes pourraient décider de créer un ou des établissements publics d’enseignement pri- maire, voire des « écoles fondamentales » en réseau autour du collège. Les grandes communes pourraient également décider, en lien avec la Région et le Département, de prendre à leur charge tout ou partie des établissements publics locaux d’enseignement, collèges et lycées. L’intérêt de telles mesures est de favoriser l’initiative locale et partenariale pour une meilleure organisation de l’école.
Les collectivités territoriales
Si l’on veut donner plus de liberté et d’initiative locale, il faut évidem- ment compter avec les collectivités territoriales. C’est déjà le cas s’agissant des équipements et des investissements immobiliers, et si de ce point de vue la qualité générale des infrastructures des collèges et des lycées force l’admiration des visiteurs étrangers, cela est dû à l’investissement massif que les Régions et les Départements leur ont consacré dans le cadre de la décentralisation. Il faut aller plus loin, sans rien céder au monopole que l’État peut seul exercer sur la définition des objectifs à atteindre, des cursus et la collation des diplômes. Mais il est certainement possible – en réalité, cela se fait déjà et il faut donc simplement mieux l’admettre – de nouer des partenariats plus étroits entre établissements et collectivités. Le domaine de l’enseignement professionnel et de la formation par alternance s’y prête plus particulièrement, afin de permettre de mieux articuler formation professionnelle initiale et zones d’emplois. Si l’on veut aller plus loin, il est possible de réfléchir à court terme à la décentralisation complète des lycées professionnels vers les Régions, personnels enseignants, administratifs et de direction compris. Il est concevable de donner à ces grandes collectivités, dont le périmètre coïncide le plus souvent avec le ressort de l’académie, la liberté de définir un projet éducatif pour mieux articuler la formation professionnelle initiale avec les zones d’emplois. L’État conserverait la maîtrise des cursus des programmes et la collation des diplômes, ainsi que le contrôle et l’évaluation, mais la redéfinition de l’articulation la plus performante entre lesformations et les besoins en emploi des Régions relèverait de ces dernières. Encore une fois, la diversité et la liberté d’organisation sont infiniment préférables aux pesanteurs et aux rigidités actuelles.
Les professeurs
Aucun des choix de demain ne fera l’impasse sur une refonte du métier d’enseignant. Chacun connaît les caractéristiques du corps enseignant français : 859.000 enseignants, statutairement structurés en de nombreux corps dont les obligations réglementaires de service sont différentes les unes des autres, faiblement rémunérés (40% de moins que leurs collègues allemands, par exemple), dispersés dans 62.000 unités éducatives (plus de deux fois plus qu’en Allemagne) et travaillant 36 semaines par an au sein des établissements. Désormais etpour longtemps très contraint sur le plan budgétaire, l’État, s’il veut porter demain un nouvel élan pour l’école et un projet de mandature crédible, ne pourra faire l’économie d’une remiseà plat de la fonction enseignante.
Si l’on désire donner plus de liberté et faire respirer la grande machine, il faut en premier lieu, et comme on l’a déjà dit, s’adjoindre les talents de ceux qui, à un moment donné, veulent enseigner, sans pour autant imaginer qu’ils y consacreront toute leur vie professionnelle. Le contrat offre pour les intéressés des garanties comparables au statut, en maintenant ouverte la perspective d’autres choix ultérieurs. La qualité du recrutement peut parfaitement être assurée sous le contrôle des corps d’inspection et de l’autorité académique. Ce mode de recrutement présente pour les établissements un élément de la liberté d’action au service d’unprojet. Un lycée qui, par exemple, voudrait se distinguer par un enseignement de langue original, mettre en place un programme d’échanges internationaux au profit de ses élèves, instituer des programmes d’enseignement mixtes associant pratique sportive et activités culturelles, devrait pouvoir accéder à des recrutements contractuels sans avoir à attendre qu’un jour la grande loterie annuelle du « mouvement » permettre enfin de donner corps à ses projets. Et pour qu’un établissement puisse, de la même façon, s’adjoindre les talents d’un enseignant statutaire pour réaliser ses projets, le recrutement selon la publication de postes à profil doit être systématiquement autorisé.
Simultanément, le rôle des maîtres, des éducateurs, des professeurs et de toute la fonction enseignante doit être repensé. Cette réflexion doit se situer dans un cadre national, mais aussi en fonction des nécessités de proximité et compte tenu des situations individuelles des élèves. Cette réflexion ne peut se limiter à la redéfinition du service desprofesseurs. Elle doit bien sûr être conduite, mais d’une façon renouvelée, en fonction du type d’établissement et du public scolaire et non plus seulement en fonction des seuls statuts particuliers. Cette réflexion doit emporter celle sur l’annualisation des services des professeurs du second degré sur la base de la moyenne OCDE, à quoi s’ajouteraient, sur la base du volontariat, des heures de tutorat, d’orientation, de conseil, de conduite de projets évalués. Mais même cela reste insuffisant : les obligations de service se déduisent des missions, elles n’en tiennent pas lieu. Il est plus important encore de dire aux enseignantsquelle est leur mission et comment – c’est- à-dire selon quelles modalités – ils peuvent l’exercer. Cette mission comporte des invariants : transmettre les savoirs fondamentaux, instruire, enseigner. Elle comporte surtout beaucoup de responsabilités inédites : à l’école primaire et au collège, accompagner de manière individualisée les élèves en difficulté, y compris en dehors de temps scolaire ordinaire ; au lycée, encadrer de jeunes adultes, contribuer à les ouvrir aux réalités du monde contemporain, les associer à des projets tout autant qu’à des programmes, les aider dans leur choix d’orientation. Si les maîtres doivent plus que jamais instruire, ils doivent aussi guider leurs élèves.
Ces impératifs nouveaux exigent essentiellement une disponibilité nouvelle. Les professeurs sont présents dans les classes, ils doivent également l’être dans les établissements en dehors de la classe, auprès des élèves, pour assurer d’autres tâches, qui peuvent varier d’un établissement à l’autre selon les besoins des élèves et les choix exprimés par l’établissement.
Il n’est ainsi ni illégitime ni impossible de demander aux professeurs de travailler plus longtemps dans les écoles et établissements, à la condition que leur service comprenne officiellement du face-à-face pédagogique, mais aussi du tutorat, du soutien, de la vie scolaire et du travail coopératif. Il est en particulier parfaitement possible de laisser à l’initiative de chaque établissement la mise en place d’un tutorat pour les élèves qui peinent à acquérir les fondamentaux. Ce tutorat peut être assuré, à l’école primaire et au collège, par des professeurs sur leur temps de service, à l’année et par groupe de quelques élèves. Cette mesure simple apporte de nombreuses conséquences positives pour les élèves qui commencent à décrocher, et pour lesquels le soutien individuel précoce et de proximité est la seule réponse immédiate efficace. Les difficultés individuelles n’appellent pas des plans d’ensemble, mais des solutions de proximité. Plus globalement, la définition du service d’un enseignant doit pouvoir comporter une part d’activité vouée à la transmission des connaissances et une autredestinée à la prise en compte de tâches nouvelles.
Le ministre et les corps de contrôles
La liberté n’est ni l’arbitraire, ni la mise en miette du territoire, ni enfin le désordre. La reconnaissance de l’autonomie et de la liberté locale ne signifie pas davantage l’abandon par l’État de ses responsabilités, pas plus que l’abdication par le ministre de son autorité. L’État doit jouer son rôle de garant national. Le ministre ne peut être responsable de tout, mais il a seul la responsabilité du tout. Le système central doit simplement cesser d’immobiliser ceux qui font vivre les écoles. C’est le rôle des recteurs et, sous leur autorité, des inspecteurs d’académie, des inspections régionales pédagogiques, enfin des inspecteurs de circonscription, de garantir l’autorité et la responsabilité de l’État sur l’ensemble du territoire, et de réunir les conditions concrètes de l’exercice des libertés locales nouvelles. Si l’échelon pertinent de décision déconcentrée devient, comme il faut le souhaiter, d’un côté, l’établissement et, de l’autre, la Région-académie, cette évolution reposera, pour une part plus grande encore qu’elle ne l’est actuellement, dans la relation étroite, largement fondée sur la confiance et l’intuitu personae, qu’entretient le ministre avec les recteurs. Un ministre responsable de tout ne peut être ni aveugle ni sourd. C’est le rôle de son administration déconcentrée de l’informer, de mettre en œuvre les réformes qu’il engage pour qu’elles entrent dans le patrimoine de chaque élève et de s’assurer que l’impulsion qu’il a donnée n’est pas entravée.
C’est également la mission des inspections générales. Dans le schéma évoqué ci-dessus, elles ont un rôle essentiel à jouer. L’organisation et la mission de ces inspections générales doivent cependant être profondément repensées. Le ministère de l’Éducation nationale détient en effet, avec le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le singulier privilège de disposer en son sein de deux corps d’inspection générale : l’Inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN), créée dès 1802, et l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la recherche (IGAENR), créée en 1965. Partout ailleurs, avant même la Révision générale des politiques publiques (RGPP), le sens commun avait conduit chaque département ministériel à ne disposer que d’une seule inspection générale. En vain tentera-t-on de justifier la pérennité de cette dualité par la spécialisation de l’une (IGEN) sur les questions pédagogiques (programmes, enseigne- ment,objectifs à atteindre) et de la seconde (IGAENR) sur les interrogations de nature institutionnelle (gouvernance, allocation et usage des moyens, organisation générale). En réalité, l’une comme l’autre est saisie, ou se saisit dans le cadre de son programme de travail, de questions qui relèvent aussi de la pédagogie que de l’organisation, rappelant ainsi que l’école est un tout qui ne se réduit pas aux catégories administratives.
D’un point de vue juridique, ces deux inspections, placées sous l’autorité directe des ministres chargés de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, exercent des fonctions de contrôle, d’étude et d’évaluation, et formule des avis et propositions concernant le fonctionnement et l’efficacité du système éducatif. Les ministres arrêtent annuellement le programme de travail des inspections dans une lettre de mission, qui comprend la réalisation de missions et d’études thématiques dans les domaines de l’enseignement scolaire (IGEN et/ou IGAENR) et supérieur et de la recherche (IGAENR). Ces études thématiques font l’objet de rapports destinés aux ministres qui peuvent être renduspublics. Parallèlement à la demande des ministres, les inspections peuvent être appelées à intervenir, à tout moment de l’année, sur des missions ponctuelles. Elles peuvent également être amenées à rédiger des notes synthétiques sur un thème d’actualité ou concernant un champ particulier.
Dans les faits, les deux inspections se distinguent essentiellement par leurs champs de compétences. L’IGEN voit sa compétence limitée à l’enseignement scolaire et, dans l’enseignement supérieur, aux classes préparatoires, alors que l’IGAENR, outre l’enseignement scolaire, est pleinement compétente pour l’enseignement supérieur et, depuis 1999, pour la recherche. Si l’IGEN et l’IGAENR participent au contrôle des établissements placés sous l’autorité ou le contrôle du ministre de l’Éducation nationale, l’IGEN est seule compétente pour évaluer les activités à caractère pédagogique des personnels d’inspection et de direction, d’enseignement, d’éducation et d’orientation, et prendre part à leur recrutement ainsi qu’à l’évaluation de leur activité ; c’est à ce titre qu’elle coordonne l’action de tous les corps d’inspection à compétence pédagogique en liaison avec les autorités académiques. L’IGAENR, quant à elle, est chargée du contrôle et de l’inspection des personnels d’inspection et de direction mais dans les domaines administratif, financier, comptable et économique. Par ailleurs, l’IGEN a pour mission d’évaluer les types de formation, les contenus d’enseignement, les programmes et les méthodes pédagogiques ; dans ce cadre, elle joue un rôle important dans l’élaboration des programmes scolaires et dans l’examen et la diffusion des pratiques pédagogiques.
Le simple énoncé de ces attributions inextricables témoigne de l’incohérence que représente aujourd’hui l’existence de deux inspections compétentes sur un même champ. Certes, l’existence de deux inspections s’explique, historiquement, par la volonté que les questions pédagogiques soient uniquement de la compétence d’une inspection, l’IGEN, dont le recrutement se fait quasi exclusivement parmi les enseignants représentant l’excellence dans leur discipline. Cette approche, toutefois, n’est plus pertinente, car il est devenu exceptionnel que les missions se limitent au seul acte pédagogique, ce dont témoigne au demeurant la multiplication des inspections conjointes ainsi que le développement, au sein de l’IGEN, du groupe « Établissements et vie scolaire », composé essentiellement d’anciens chefs d’établissement, d’inspecteurs pédagogiques régionaux ou d’inspecteurs d’académie directeurs des services de l’Éducation nationale, témoignage du besoin qu’éprouve l’inspection à se doter d’un groupe à compétence plus administrative que pédagogique. L’IGEN, de par son organisation en groupes disciplinaires, est de surcroît très mal armée pour appréhender l’approche pluri- et interdisciplinaire qu’implique la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences.
Enfin, l’IGEN, au contraire des autres inspections générales, a vu progressivement une partie de ses attributions relever non d’une mission d’expertise et d’audit mais, véritablement, du pilotage du système éducatif. Cette position, très ambiguë, source de tensions, résulte du rôle très particulier joué par l’IGEN dans le recrutement et la carrière des personnels qu’elle est censée contrôler. Ainsi les corps d’inspection déconcentrée se sentent-ils souvent plus placés sous l’autorité de l’IGEN que sous celle du recteur, et donc du ministre. De même, il n’est pas rare que, porteuse de l’excellence disciplinaire, l’IGEN aille au-delà d’un simple rôle d’expert en matière de conception et d’évaluation des programmes, se heurtant aux services centraux dont c’est la responsabilité. Cette situation n’a pas vocation à perdurer. Il est temps de mettre fin à cette organisation héritée du passé, qui a pu se justifier à une époque où la gestion du système éducatif se ramenait de manière quasiment exclusive à un face-à-face pédagogique entre le maître et l’élève, mais qui à présent n’a plus de sens.
Dans ces conditions, il semble évident que la constitution d’un corps unique d’inspection générale, comme dans tous les ministères qui en disposent, doit être réalisée. Cette fusion permettra de réduire le nombre actuel, inutilement pléthorique, des membres des inspections.
L’inspection générale exercera ses missions dans le cadre des instructions données par le ministre destinataire de ses rapports – rappelons qu’une inspection n’est pas le ministre –, à charge pour elle de s’organiser pour couvrir le champ des questions qu’elle aura à aborder dans les différents niveaux d’enseignement. Surtout, la recomposition de l’inspection générale doit être l’occasion de redéfinir son rôle au sein de système éducatif dans son ensemble. Ce rôle passe naturellement par le maintien des responsabilités ordinaires d’une inspection générale. Intervenir ponctuellement sur une difficulté donnée, notamment sur les questions mettant en cause des comportements, répondre à une demande d’expertise précise, anticiper sur la résolution d’un certain nombre de problèmes connus ou en devenir, mesurer par des rapports d’étape le degré de réussite d’une réforme ou encore prendre le temps et la perspective d’une réflexion approfondie sont autant de tâches auxquelles une inspection doit être en mesure de se consacrer avec pertinence, efficacité et loyauté.
Il est toutefois un domaine plus spécifique au rôle de l’inspection générale dans le domaine éducatif. Il concerne l’explication et l’accompagnement des réformes. Faute d’accompagnement approprié, la volumétrie du monde éducatif français condamne trop de réformes à une attrition qui les vide in fine de toute substance. Ainsi les projets de réforme s’empilent, provoquant la lassitude du corps enseignant, le sentiment de l’impuissance de la volonté politique, la critique du caractère tatillon et bureaucratique de l’échelon central, qui lui-même finit par n’évoluer que dans un monde clos et irréel de circulaires, avec pour conséquence ultime la croyance, par tous partagée, que toute réforme est vouée à l’échec. À l’inverse, la présence systématique de l’inspection générale sur le terrain, dans les établissements, auprès des équipes de direction et des professeurs offre des garanties réelles pour s’assurer de la bonne compréhension du sens d’une politique engagée et des moyens d’en atteindre les buts.
Conclusion
L’autonomie n’est ni une panacée ni une incantation. C’est une forme d’organisation du travail et d’usage des ressources, plus pragmatique, plus efficace et plus respectueuse des personnes dont elle reconnaît les savoir-faire et encourage les initiatives. Aujourd’hui, l’immobilisme vient d’en haut, alors qu’en réalité tout se gagne au cœur des classes, des écoles, des collèges et des lycées. Le système éducatif français est las de la succession des plans d’ensemble minutieusement élaborés par l’échelon central. Ceux qui en ont la responsabilité quotidienne aspirent à ce que soient reconnues les prises d’initiative au plus près des élèves, et donc à une liberté plus grande donnée dans un cadre national simple, clair, intelligible.
On dira qu’il est encore plus difficile de réformer l’école que d’en débattre. C’est vrai aussi. Mais n’est-ce pas parce que l’on a trop réformé ? Les réformes ont à peine le temps d’arriver jusqu’aux établissements qu’elles sont déjà remplacées par les suivantes. Entre les« trains de réformes » et les « trains de mesures », entre les « grands soirs » et les « petits matins », entre le tableau des arrivées et le tableau des départs, c’est la gare de Lyon à l’heure de pointe ! Il y a quelque chose de malhonnête à vouloir soumettre des enfants à toutes sortes d’expériences. Pour réformer, il faut avoir en tête que le temps de l’école ne se confond pas avec le passage d’un homme dans un ministère ; c’est un temps long, qui demande de la stabilité et qui demande que l’on sache discerner ce qui est juste, non ce qui est neuf.
On dira encore que les réformes ne peuvent aboutir parce que l’inertie des habitudes l’emporte toujours. Mais cela n’a rien d’une fatalité. Quel que soit leur horizon de pensée, tous les spécialistes de l’école le disent désormais : aucune réforme, si parfaite qu’en soit la conception, ne peut prétendre épouser l’extrême variété des situations. Car tout se gagne sur le terrain, au cœur des classes. Les établissements scolaires doivent respirer à leur rythme, se sentir responsables et incités à l’initiative. C’est à eux de choisir leurs moyens, notamment pédagogiques, pour atteindre les objectifs nationaux. Des établissements plus autonomes, où le pragmatisme l’emporterait sur l’idéologie, ne remettront pas en cause le caractère national de notre système éducatif, ils feront enfin confiance aux hommes et aux femmes du terrain, proches des élus, des associations et des entreprises qui les entourent. Ils savent mieux que quiconque comment agir en fonction du contexte local, de la diversité des élèves, des attentes des parents. Ils sont les mieux à même de sortir l’école de son isolement et, pour cela, de lui trouver des alliés. Pour l’école, l’âge est venu de l’autonomie, partout.

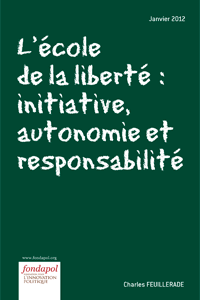











Aucun commentaire.