Nouvelle entreprise et valeur humaine
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Résumé
Croissance en berne, taux d’inflation et taux d’intérêt nuls, épargne en quête d’investissements et vieillissement de la population constituent les principaux défis d’une relance économique qui peine à voir le jour, au moins en Europe. La montée de la Chine a permis au système capitaliste de pousser aux extrêmes sa logique actionnariale : baisse du coût du travail et hausse du profit. À cette réalité se conjugue l’ambivalence des États face au système financier, qui s’interdisent d’intervenir dans l’économie mais n’hésitent pas à s’endetter pour le sauver. Cette situation caractérise la situation économique européenne et menace un modèle social qui constitue le fondement des valeurs de notre Europe.
Résorber cette crise passe par le nécessaire approfondissement politique, économique et financier de la zone euro afin de lui permettre d’exister sur la scène internationale. Cette relance de l’Union européenne implique une réorganisation de l’entreprise dont le tableau de bord est obsolète et qui doit mieux exploiter son capital humain pour innover et retrouver le cercle vertueux de la croissance au bénéfice de tous les actifs. Cette refonte de l’entreprise sera facilitée par la modification du droit des sociétés afin de supprimer les excès actuels de la logique actionnariale.
Francis Mer,
Ancien ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, président d’honneur du groupe Safran et membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique.
.
Croissance en berne depuis plus de cinq ans, taux d’inflation pratiquement nul, risque de baisse générale des anticipations de prix, taux d’intérêt atteignant des minimums historiques, taux d’emprunts publics devenant négatifs, effondrement du prix du pétrole, surcapacités mondiales dans de nombreux secteurs miniers et industries primaires (acier, ciment…), poursuite de l’endettement du système économique… tels sont les traits saillants de l’économie occidentale actuelle ! Et ce qui est étonnant, c’est l’absence de réflexions partagées sur les causes d’une évolution qui a notamment pour conséquence de mettre sur le côté de la route économique un nombre croissant de chômeurs et de dissoudre le sentiment d’appartenance à des communautés nationales vivantes et solidaires, avec des manifestations de perte de repères, de désespérance, rendant possibles les actes de violence individuels qui partout se multiplient.
Sans prétendre bien sûr apporter «la» solution ou couvrir l’intégralité des aspects caractéristiques de cette situation nouvelle et inquiétante, il est cependant possible de mettre en valeur quelques évolutions pouvant contribuer à une meilleure compréhension de la situation et à une vision plus constructive du futur.
.
Le monde économique est « un » depuis vingt-cinq ans et pour la première fois dans son histoire relativement récente, grâce à l’occurrence fortuite de deux «tsunamis» ayant bouleversé la donne : l’explosion soviétique et la renaissance chinoise. En dehors de ses conséquences géopolitiques durables quant aux soubresauts qu’elle a créés (Ukraine et autres…), la disparition de l’«utopie marxiste» dans l’espace européen a convaincu l’«autre utopie», celle du capitalisme libéral, qu’elle était la meilleure, puisque la seule, et a supprimé l’essentiel des freins collectifs qui entravaient plus ou moins efficacement les travers d’un capitalisme au seul service de ses «propriétaires». Simultanément, mais c’est un hasard historique, la disparition de Mao et la détermination du Petit Timonier ont créé rapidement les conditions politiques et économiques pour que la Chine rejoigne le monde occidental sur le plan matériel tout en gardant une organisation politique lui permettant de gérer sa nouvelle révolution en cohérence avec une culture ancestrale où les valeurs de base que sont le culte de la famille et le respect de l’État ne conduisent pas inéluctablement à tomber en adoration devant une organisation démocratique conçue il y a seulement trois siècles dans des pays européens qui s’imaginaient alors être le «Monde».
La découverte progressive du marché chinois par l’Occident et des ruptures générées pour le producteur occidental par l’offre du travailleur chinois a bouleversé l’ancienne distribution des rôles en raison de la taille mondiale du nouveau partenaire, à la fois fournisseur inépuisable de «masse laborieuse» et client insatiable de l’offre occidentale, et elle a permis au système capitaliste de pousser aux extrêmes sa logique intrinsèque : grâce au travailleur chinois, je baisse mes coûts et j’augmente mes profits en ne transférant au consommateur occidental que la part de cette «subvention» qui me permet de rester compétitif. Grâce à un marché chinois en expansion rapide, je trouve aussi une nouvelle opportunité de croissance de mon activité capitaliste, sans avoir besoin de vérifier que mon client occidental, qui est aussi mon producteur salarié, est toujours d’accord avec un système économique qui a comme finalité théorique son intérêt puisque, de toute façon, il n’a plus le choix depuis que l’autre système d’organisation économique et sociale a explosé ! D’où une croissance concentrant progressivement la création de valeur sur les acteurs et «propriétaires» du système, le monde de la finance et du capital, et ignorant l’intérêt du consommateur-producteur occidental, marginalisé dans une situation où son pouvoir d’achat ne croît plus et où il peine à trouver ou conserver un emploi.
.
Mais le fonctionnement du système suppose cependant que le consommateur reste toujours disposé à consommer. S’il prend progressivement conscience de sa fragilité de producteur, son instinct de survie l’incitera à prendre des précautions vis-à-vis d’un futur incertain, et donc à augmenter son épargne individuelle au cas où… Et, ce faisant, il contribuera à désamorcer la pompe en ralentissant son rythme d’achat. Comment réagit alors le système productif ? Il «manipule» le consommateur en le convainquant de s’endetter pour continuer à consommer et en lui offrant pour cela des conditions d’emprunt de plus en plus attractives. Et cela marche pendant quelques années supplémentaires, pour le plus grand profit d’un système financier dont tous les acteurs se sont installés dans une concurrence débridée pour grandir encore plus vite dans un système de valeurs où le niveau de l’action devient le seul critère de comportement «rationnel» de l’actionnaire et du «mécanicien» du système dont les intérêts personnels ont été «alignés» (stock-option = pile je gagne, face tu perds). Ces acteurs ont d’ailleurs découvert que les entreprises n’ont pas forcément besoin de tous les fonds propres qu’elles ont accumulés dans leur passé et que la meilleure manière d’augmenter un ratio (le résultat par action, donc la valeur de l’action) était de diminuer le dénominateur, c’est-à-dire le nombre d’actions, d’où la mode généralisée de la politique de rachat et de suppression d’actions depuis vingt ans, au nom de la théorie bien connue de la rationalité de l’acteur épargnant qui est censé savoir mieux que quiconque comment allouer son épargne et sans se préoccuper particulièrement des conséquences sur l’activité économique de l’affaiblissement des moyens financiers propres dont dispose l’entreprise pour grandir.
Mais, au bout d’un certain temps, certains découvrent que les arbres ne montent pas aux cieux et la mécanique infernale s’enraye, dévoilant brutalement sa fragilité et les risques croissants encourus par l’épargnant individuel qui continue à faire confiance au système financier pour, au moins, protéger la valeur de son épargne. Comment éviter la catastrophe et une crise remettant en question les bases du système économique ?
.
C’est là qu’intervient le monde politique, celui qui théoriquement est en charge de l’intérêt collectif mais qui, de manière incompréhensible, a laissé se développer la financiarisation du système économique, sans se rendre compte des dangers et sans donc y introduire certaines nouvelles règles de comportement. Pourquoi s’en préoccuper puisque cela marche et tant que cela marche ? En dehors d’une incapacité improbable de comprendre son fonctionnement, la réponse facile est l’idéologie de la libre concurrence entre les acteurs politiques nationaux pour faire fonctionner au mieux un système que chacun ne peut pas remettre en question par son action réglementaire sauf à handicaper ses «joueurs» dans un «jeu» mondial… mais sans «règles du jeu», à la différence du monde des échanges matériels, «l’ancien monde» qui a réussi progressivement à se doter de quelques règles d’organisation et de capacité de sanctions significatives en cas de non-respect de ces règles. Pour ne pas désavantager ses joueurs dans la compétition mondiale, chaque État s’interdit donc d’intervenir, jusqu’au moment où, en même temps et tous ensemble, les États occidentaux n’ont plus d’autre choix que de protéger l’épargne individuelle du citoyen électeur et de le rassurer (un peu) sur le fonctionnement du système en volant au secours du responsable de la catastrophe, à savoir le système capitaliste financier, et en prenant à sa charge, c’est-à-dire à celle du contribuable, une partie significative des dettes contractées dans cette folle course à la valorisation. D’où le saut d’endettement brutal des États et leur souci conséquent de maîtriser la croissance ultérieure de leurs dettes en s’efforçant de diminuer leurs déficits budgétaires.
.
Dans ce contexte de survie, les acteurs du système capitaliste financier qui ont pu jusque-là en bénéficier trop exclusivement n’ont qu’une seule obsession : préserver leurs intérêts individuels largement liés à la valorisation des entreprises qu’ils animent ou dont ils sont, directement ou non, «propriétaires». Comment faire ? En poussant au court terme, au raccourcissement des horizons stratégiques, à la réduction des investissements, à la minimisation des prises de risque…, en un mot en gérant et non plus en entreprenant.
Certes, et heureusement, nombre d’entreprises refusent cette stratégie et continuent à être fidèles à leur vocation d’entreprendre, notamment dans les entreprises patrimoniales et les start-up, sans parler des nouvelles « majeures » qui continuent à saisir à bras-le-corps les opportunités technologiques et qui modèleront profondément le nouvel environnement quotidien de la population mondiale. Mais, globalement, c’est incontestablement le changement de comportement managérial du capitalisme financier qui explique la situation économique actuelle : pourquoi des taux d’intérêt historiquement bas ? Parce que la demande d’argent est très inférieure à l’offre. Cette offre est celle des consommateurs qui ont peur pour leur avenir de producteurs et augmentent leur épargne de précaution tout en se désendettant sur le plan consommation et immobilier. Mais c’est de plus en plus celle générée par le système lui-même qui concentre sur un petit nombre d’acteurs l’essentiel des gains de productivité qu’il continue à créer à travers la concurrence, sans penser ni oser augmenter la rémunération de ses collaborateurs consommateurs au nom de la compétitivité de l’entreprise en concurrence mondiale avec des acteurs chinois ou autres qui, eux, bénéficient d’une main-d’œuvre pas chère. Or la capacité à dépenser, à consommer, de ces acteurs fortunés trouve rapidement ses limites physiques et elle les amène à disposer d’une épargne considérable qu’ils veulent eux aussi faire fructifier et au moins protéger.
Mais face à cette épargne abondante, qui souhaite emprunter pour investir, entreprendre, prendre des risques ? Les particuliers ayant choisi de privilégier leur désendettement, ce sont les États qui deviennent les premiers emprunteurs en raison de déficits budgétaires encore considérables qu’ils peinent à réduire sans mettre en danger leurs ressources fiscales. Même si ces déficits baissent en valeur absolue, ils n’en créent pas moins la nécessité d’emprunter pour les financer et pour rembourser les échéances d’anciens emprunts publics venant à échéance. Comme les entreprises cherchent à se désendetter elles aussi, tout en consacrant une part croissante de leurs résultats à des dividendes qui viennent augmenter les disponibilités des «propriétaires» du système capitaliste financier, les États deviennent le premier client de ce système financier et profitent de l’abondance d’épargne disponible pour emprunter à des taux qui sont historiquement faibles, voire négatifs. C’est une bonne nouvelle pour le contribuable puisque l’endettement supplémentaire de son État coûte moins cher que le service des annuités qu’il rembourse, mais c’est une mauvaise nouvelle pour le système économique qui continue à se désamorcer tandis que l’inflation occidentale disparaît, autre manifestation de l’excès de l’offre par rapport à la demande.
.
Que faire devant une telle situation qui caractérise un Occident désemparé ayant égaré la clé de fonctionnement d’un système économique où c’est l’offre qui crée la demande et où le renouvellement de l’offre est la raison d’être de l’acte d’entreprendre ? Cette situation n’est-elle pas largement le résultat d’une mondialisation non gérée où le «laissez faire, laissez passer» s’est retrouvé confronté à une rupture d’équilibre qu’il a été incapable de maîtriser et qui a été créée par une disponibilité soudaine et illimitée des «bras et têtes chinois» corvéables depuis trois décennies à des coûts qu’aucun pays occidental ne pouvait accepter pour ses citoyens. Le choc majeur introduit par ce changement historique dans la structure des chaînes de coûts ajoutés qui caractérisent l’activité économique contemporaine est probablement l’une des origines majeures de la situation actuelle. La renaissance chinoise a principalement concerné jusqu’à présent sa population urbaine et côtière, elle n’a pas encore touché une population agricole qui attend de bénéficier à son tour des bienfaits de cette croissance : il serait donc audacieux de considérer que la «compétitivité» de l’offre salariale chinoise va être dorénavant moins évidente, même si les cadres chinois commencent à pouvoir revendiquer un meilleur traitement.
Et, surtout, n’oublions pas que ce nouveau cadre global ne concerne pas que la Chine, même si les trois dernières décennies resteront dans l’histoire économique comme celles de l’empire du Milieu. Même s’ils ne bénéficient pas de l’exceptionnelle capacité gouvernementale chinoise, tous les autres pays «en retard» sont positivement concernés par une globalisation qui leur offre l’accès au consommateur occidental dans des conditions économiques commerciales et technologiques qui n’ont jamais été aussi favorables à leur décollage, de telle sorte que la compétitivité, donc l’attrait, de l’offre salariale du Sud continuera à être une puissante incitation pour optimiser la chaîne des échanges à travers le nouveau savoir organisationnel des grandes entreprises multinationales.
Si la globalisation continue donc à caractériser le modèle économique mondial, il n’y a pas de raisons évidentes pour que la situation actuelle, peu satisfaisante pour l’Occident et principalement l’Europe, ne se pérennise pas. Les États-Unis, plus réactifs, semblent mieux s’en accommoder grâce à des entreprises qui se remettent plus facilement en question au nom de la prééminence d’un système capitaliste financier à la base de leur prodigieux développement depuis cent cinquante ans et qu’ils n’hésitent donc pas à réactualiser quand il déraille. Sur ce plan, la reprise en main du secteur financier à la suite de la crise des subprimes a été efficace, même si elle n’a pas modifié profondément la philosophie d’un système généré par une culture américaine attachée à la liberté d’initiative accrue qu’entraîne la globalisation. La situation européenne, en revanche, est plus délicate en raison d’une culture élaborée historiquement dans ce que les Européens considéraient naturellement comme le creuset du monde.
.
Un récent sondage international concernant la génération Y le confirme d’ailleurs, avec des nuances suivant les pays, à travers les réponses à la question : «Mondialisation, opportunité ou menace ?» Alors que les jeunes répondent massivement oui à la mondialisation en Chine (97%), en Inde (90%), au Japon (79%), ils sont seulement 70% dans l’Union européenne, dont 85% en Finlande et au Danemark, mais seulement 56% en France. Tout en reflétant majoritairement l’opportunité que représente la mondialisation, le pourcentage d’adhésion occidental ne souffre pas la comparaison avec l’unanimité orientale et laisse prévoir la poursuite des difficultés que l’Europe continuera à connaître afin de s’adapter à de nouvelles règles du jeu pour en saisir économiquement les opportunités de développement, en acceptant de modifier certains comportements sur lesquels son économie s’est bâtie avec succès jusqu’à la grande rupture des années 1990. Et ce d’autant plus que le dynamisme démographique l’a quittée depuis une décennie et que son modèle économico-social va en être durablement affecté (vieillissement et dépendance). Avec une majorité des votants qui se rapproche des 60 ans et qui donne mathématiquement le pouvoir démocratique aux «vieux», alors que ce sont les «jeunes» qui paient leurs retraites et assurent leurs niveaux de vie, la situation politique française risque d’être de plus en plus ingérable, sans parler des solutions extrémistes qui seront toujours attirantes pour ceux qui cherchent à se rassurer et non pas à s’assumer.
Il est donc urgent de nous reprendre en main, nous Européens, nous Français, pour continuer à faire notre chemin dans un monde qui ne nous attend pas et pour qui notre population devient progressivement marginale – dans quarante ans, l’Afrique aura 2 milliards d’habitants ! – tout en continuant à être un débouché appréciable pour les économies émergentes en raison d’un niveau de vie substantiel qui ne peut que décliner s’il n’y a pas un sursaut collectif.
.
À qui incombe-t-il de réagir ? À chacun des acteurs politiques et économiques ! Sur le plan politique, il faut noter que seule la crise financière récente a contraint le monde politique européen à accepter certains abandons de souveraineté nationale au profit de nouvelles structures financières de l’Union européenne, permettant ainsi de mieux gérer les entités financières nationales qui ont fait la preuve de leurs difficultés individuelles à garder le cap de leurs responsabilités collectives sans avoir besoin d’une sauvegarde nationale octroyée dans la panique par des administrations craignant la révolte de citoyens menacés de perdre leur épargne à cause de comportements spéculatifs irresponsables des acteurs financiers. Ce progrès significatif devrait faire prendre conscience aux États européens de leur responsabilité collective dans la relance d’un approfondissement de l’Europe qui, il y a vingt-cinq ans, était l’horizon politique des bâtisseurs de l’euro avant que la chute du mur de Berlin vienne bouleverser leur agenda politique. Les crises grecque et ukrainienne que traverse actuellement l’Union européenne sont là pour lui rappeler l’urgence de reprendre sa construction politique, économique et financière si elle veut pouvoir continuer à exister durablement comme une entité incontournable dans la gestion du monde en devenir.
Ces enjeux ont une taille historique puisqu’ils consistent à sauver la crédibilité d’une entité européenne de 500 millions d’habitants et à lui permettre de continuer à vivre selon des valeurs partagées, qu’il n’est certes plus possible ou souhaitable d’imposer au reste du monde mais qu’il est primordial de sauvegarder pour un « vivre ensemble » européen.
Il est malheureusement possible que ce soit trop demander aux représentants de ces vieilles nations européennes que de raisonner à froid plutôt que d’attendre de manière fataliste la prochaine crise pour être forcés d’assumer des responsabilités qu’ils habillent trop facilement de la défense de leurs intérêts nationaux pour ne pas les prendre.
.
Sur le plan économique, il faut remettre les compteurs à zéro et, plutôt que de pratiquer, au moins inconsciemment, la politique du bouc émissaire, prendre conscience, au niveau des acteurs économiques que sont les entreprises et les administrations publiques, de la nécessité qui incombe à leurs dirigeants d’assumer leurs responsabilités au service de l’intérêt de la collectivité nationale et européenne dont elles font partie, et pas uniquement au service d’intérêts privés. Cette prise de conscience de leurs devoirs consiste pour eux à (re)découvrir que leurs responsabilités ne consistent pas seulement à gérer pour que l’entreprise soit profitable mais aussi et surtout à l’animer de manière qu’elle grandisse et participe à la construction d’un monde meilleur, plus développé, où partout il fait bon de vivre.
Faut-il rappeler qu’une entreprise «n’appartient pas» à ses actionnaires, qui sont seulement propriétaires d’un capital social qu’ils ont décidé de mettre à la disposition de l’entreprise en lui faisant confiance pour, si possible, faire prospérer cet argent par un retour de dividendes et une valorisation croissante ? Faut-il rappeler que, sans son capital humain, une entreprise n’est rien, même si elle est «équipée» avec des fournisseurs et des clients ? La responsabilité de la classe économique «dirigeante», c’est-à-dire des 20-25% de la population qu’elle regroupe, ne se résume pas à gérer au meilleur coût une situation donnée, mais au moins autant à animer tous ses collaborateurs – travailler avec ! – dans une organisation s’adaptant en permanence à un environnement changeant sur les plans technique, économique, concurrentiel, scientifique et, bien sûr, humain, de manière à conserver en permanence sa capacité à grandir, à construire, à créer, le tout dans une ambiance participative où chaque membre du personnel est reconnu comme une personne que l’on respecte, qui a sa capacité d’initiative et de responsabilité et qui participe au projet commun de l’entreprise en fonction de ses connaissances et de ses compétences opérationnelles.
Cette «nouvelle entreprise», dont le capital humain est le premier atout et non pas une masse salariale anonyme, est capable de performances économiques et financières insoupçonnées car chacun y travaille «pour son compte», et donc sans compter ni son temps, ni son plaisir puisque l’entreprise, c’est aussi la sienne, c’est d’abord la sienne ! Et tout le monde y trouve son compte, y compris les fameux actionnaires et, bien sûr, aussi les dirigeants qui sont reconnus comme initiateurs et gérants de ces performances, mais également tous leurs collaborateurs à qui revient l’essentiel de la réussite et qui en sont récompensés par des responsabilités renouvelées, des rémunérations en hausse et un intéressement croissant aux résultats.
Le cercle vertueux peut enfin être réinitialisé : les résultats de l’entreprise augmentent, ce qui plaît au monde financier mais aussi à ses dirigeants car ils disposent de moyens accrus pour investir, chercher, former leurs collaborateurs, c’est-à-dire de tous les moyens nécessaires pour relancer l’entreprise dans une croissance de son offre, de ses clients dans un espace géographique en extension car le «monde un» est un monde grand pour chaque acteur individuel. Cette croissance retrouvée permet aussi à l’entreprise de mieux rémunérer son personnel, qui a donc des moyens accrus pour consommer plus et, par conséquent, aider d’autres entreprises à grandir elles aussi dans un environnement où la confiance restaurée entre les multiples acteurs économiques leur permet de voir le futur comme une opportunité que chacun peut saisir en fonction de ses compétences et de ses penchants.
Dans une zone économique européenne ouverte sur elle-même et sur le reste du monde, et caractérisée par une démographie privilégiant désormais le vieillissement et la santé au détriment d’une augmentation de la population active, quels sont les ressorts d’une croissance nécessaire pour maintenir les conditions stables du financement d’un modèle social promu démocratiquement ? Une seule réponse : la productivité des facteurs de production permettant de produire autant en consommant moins et donc de dégager de l’exploitation courante des ressources nouvelles utilisées à la préparation (R&D), puis à la concrétisation d’une nouvelle offre générant de nouvelles utilisations pour les facteurs de production économisés par cette productivité.
D’où vient cette productivité des facteurs ? D’un environnement concurrentiel qui exige de chaque entreprise, pour sa survie, un effort continu de meilleure utilisation de ses facteurs de production et d’un environnement technologique en pleine mutation qui génère de nouvelles solutions en rupture par rapport aux approches traditionnelles : il y a autant de chercheurs en activité dans le monde aujourd’hui qu’il y en a eu au total depuis l’origine de notre monde économique (1800 ?) jusqu’à une période très récente (1980) ; le caractère exponentiel de cette croissance lui assure la capacité de continuer à révolutionner le monde grâce aux nouvelles connaissances scientifiques et techniques puisque, au moins statistiquement, plus on cherche, plus on trouve !
.
Encore faut-il savoir mobiliser dans l’entreprise ce potentiel de changement et le vouloir, c’est-à-dire en faire la principale raison de penser et d’agir de sa direction au sens large du terme, car le changement permanent que cela implique dans son organisation et dans ses performances va à l’encontre de la doxa managériale qui domine actuellement dans la plupart des entreprises occidentales cotées en Bourse, à savoir la priorité donnée à la valorisation de l’entreprise au profit d’un actionnariat «propriétaire», au service duquel s’est progressivement mise la classe managériale dirigeante en y trouvant son intérêt matériel.
La remobilisation des entreprises au service du futur des collectivités humaines dont elles font partie étant l’une des solutions pour retrouver la croissance, il faut donc créer les conditions interdisant la dérive actuelle. Pour cela, il faut, et il suffit presque, de modifier le droit des sociétés pour notamment empêcher cet alignement des intérêts des managers sur ceux des actionnaires et repenser les conditions d’une meilleure implication des collaborateurs dans le devenir des entreprises au-delà de leur statut de salariés.
Arrive immédiatement le chantage à la délocalisation dont pourraient être menacés les pays trop activistes individuellement de la part d’un monde capitaliste financier soucieux de préserver ses intérêts matériels, le danger d’un exode des compétences venant compléter cette menace. La seule manière de s’y opposer est d’adopter une politique partagée au nom des mêmes convictions et intérêts par plusieurs pays, c’est-à-dire au moins l’Union européenne et, si possible, les États-Unis. Dans la culture américaine, cette modification des règles au détriment de la capacité individuelle à s’enrichir ne devrait pas recevoir un soutien spontané et il est donc probable qu’elle se limiterait à l’espace européen. La dimension économique du marché européen restant durablement incontournable pour les entreprises, celles-ci n’auraient cependant pas d’autre choix que de s’y plier, quitte à ce que quelques dirigeants européens ne résistent pas à la tentation de franchir l’Atlantique.
La remobilisation entrepreneuriale implique aussi que les dirigeants prennent conscience du formidable potentiel d’engagement qui existe dans leur personnel, pour peu qu’il travaille dans des conditions propices à l’expression de ce potentiel. À peu de chose près, l’organisation actuelle de l’entreprise est la même qu’il y a cinquante ans avec une soi-disant «élite managériale» qui a fait des études débouchant sur des diplômes leur permettant d’accéder à une «noblesse du diplôme» et qui croit, à tort, disposer du monopole du savoir vis-à-vis du reste du personnel qui est là pour exécuter ses ordres et qui est considéré comme un coût – la masse salariale – parmi d’autres coûts. Or, depuis cinquante ans, le degré de connaissances acquis par les générations successives a incommensurablement progressé, facilité par les nouvelles technologies qui rendent rapidement obsolètes les connaissances acquises par cette «élite» dans ses études supérieures. Les entreprises d’aujourd’hui sont donc constituées par des communautés de personnes qui apprennent ensemble et en permanence alors que leurs organisations restent essentiellement hiérarchiques et figées autour d’organigrammes censés localiser et identifier les pouvoirs et centres de décision à une époque où l’innovation technologique passe du mode centralisé top-down à un mode inclusif en réseau, mobilisant tous les acteurs de l’entreprise et se traduisant par des ruptures ou des progrès incrémentaux, ou des sauts de performance changeant la norme en matière de coûts ou de qualité. Il incombe aux équipes dirigeantes des entreprises d’être à la hauteur de ces nouvelles opportunités dans le nouveau monde généré par le «tsunami numérique». Seules, elles ont peu de chances de réussir à faire survivre leurs entreprises et à les faire grandir. Si, au contraire, elles ont la clairvoyance et l’honnêteté intellectuelle de faire confiance à leurs collaborateurs et de créer les conditions sans cesse modifiées pour qu’ils puissent ensemble s’engager dans une nouvelle vision de leurs entreprises et y avoir un rôle renouvelé pour chacun de ses membres, alors elles auront la fierté d’avoir conduit leurs entreprises vers de nouvelles réalisations dans un effort d’innovation partagé par tous et ce faisant d’avoir retrouvé l’ambition et le chemin d’une croissance permettant de faire vivre le modèle social et communautaire qu’elles partagent.
.
Mais cette «reconversion» des classes dirigeantes ne peut être espérée de la part de «managers» honnêtes et voulant bien faire que si leur environnement professionnel est pacifié à travers une profonde modification du fonctionnement actuel des sociétés cotées leur permettant d’être plus assurées de leurs positions de dirigeants qu’elles ne le sont actuellement. Dans la logique implacable de la valorisation maximale des entreprises cotées au profit du «système», de nombreux dirigeants sont en effet soumis à la menace permanente de quelques actionnaires «activistes» réunissant les moyens financiers leur permettant, souvent à travers les conseils d’administration, d’imposer leurs stratégies aux dirigeants, en vue d’augmenter encore la performance au service du fameux «actionnaire» qui n’a en fait rien à faire de l’entreprise et qui ne s’intéresse qu’à son profit matériel, d’où les stratégies de distribution massive de dividendes, de rachat des actions de l’entreprise et de restructuration de ses activités dictées uniquement par la mobilisation de ressources financières au service de ces actionnaires.
La nature humaine étant ce qu’elle est, il est inévitable que de telles pressions soient « reçues » par des dirigeants, qui ne peuvent s’empêcher de penser aussi à leurs intérêts personnels et cherchent donc à sauvegarder des positions professionnelles acquises grâce à leurs compétences et expériences. Il faut donc supprimer cette possibilité de chantage en repensant le droit des sociétés cotées pour que le pouvoir actionnarial, exercé ou non à travers le conseil d’administration, ne soit pas totalement libre d’orienter l’équipe dirigeante de l’entreprise dans son seul intérêt de «propriétaire».
Ceci amène logiquement à repenser aussi, dans le monde du XXIe siècle et non dans celui du XIXe, le rôle que doit jouer la communauté humaine constituant son principal capital dans l’appréciation et le renouvellement de l’équipe dirigeante qui devrait dorénavant rendre des comptes à ses deux sources de capital, le capital social et… le capital humain.
Il faut donc aussi revoir la manière dont le capital humain de l’entreprise défend ses intérêts propres aux côtés des représentants du capital social. Historiquement, en Europe, notamment en France, le droit du travail et le droit syndical ont été pensés et élaborés pour « protéger » le salarié contre son «exploitation» par l’employeur. Sans aller jusqu’à supprimer tout ce qui concerne cette protection, il faut repenser les prérogatives de la communauté de travail dans un siècle où c’est elle, par son intelligence, ses compétences et sa collaboration qui crée les conditions du succès et du développement de «son» entreprise.
C’est donc dans une remise en question fondamentale du rôle, des pouvoirs et responsabilités de parties prenantes au succès de l’entreprise cotée du XXIe siècle à travers un nouveau «droit de l’entreprise» que l’on trouvera les conditions et les acteurs de notre renaissance économique.
Cette remise en question fait évidemment partie des responsabilités du monde politique qui, dans un système démocratique, est élu pour piloter les changements dans l’intérêt collectif, notamment à travers la gouvernance des entreprises qui en sont le moteur «matériel».
La mise en chantier d’une nouvelle gouvernance de l’entreprise pour mieux équilibrer les rôles que doivent y jouer les deux principales parties prenantes que sont la communauté de ses collaborateurs et les institutions financières lui faisant confiance pour accroître la valeur de leur mise paraît donc la voie raisonnable à suivre, en évitant les excès qui caractérisent actuellement un fonctionnement prédateur du système capitaliste et en créant les conditions permettant à ses outils que sont l’entreprise et le marché de fonctionner utilement au service de la communauté humaine.
Mais cette évolution souhaitable, voire nécessaire, implique une autre percée conceptuelle pour la mesure de la valeur. Qu’on le regrette ou non, il est clair actuellement que ce qui ne se mesure pas et n’est donc pas quantifiable n’a pas de valeur et n’est donc pas facilement pris en compte dans le management de l’entreprise – c’est le cas du capital humain, à la différence, notamment, du capital immatériel que représente la concrétisation en brevets des résultats d’une recherche ayant abouti. Cette énorme lacune du système comptable international explique, au moins partiellement, les raisons pour lesquelles les dirigeants des entreprises cotées y portent moins attention. À titre d’exemple, les dépenses de formation, qui ont la chance de pouvoir être facilement mesurées, moyennant quelques approximations simplistes du genre «la valeur de la formation d’une personne est mesurée par le salaire qu’elle continue à toucher pendant qu’elle se forme augmenté d’une certaine partie de la dépense de formation», continuent à être traitées comme un coût d’exploitation et non pas comme un investissement dont les effets bénéfiques se prolongent au-delà de l’année en cours et qui devrait donc être amortissable comme le sont les dépenses d’équipement ; ce changement comptable aurait certainement des conséquences significatives sur l’attrait d’une politique de formation impactant le bilan et non plus le compte d’exploitation annuelle, objet de toutes les attentions du management face au jugement du marché.
La seule occasion où apparaît la quantification de cet actif immatériel que constitue le capital humain est curieusement lors d’un changement de contrôle d’une entreprise au profit et à l’initiative d’une autre : le monde financier découvre alors que la valeur attribuée à une entreprise par une autre qui veut l’acquérir ou s’en séparer est différente de celle qui résulte de son bilan comptable. D’où la nécessité de faire apparaître soudainement un écart de valeur (goodwill ou depreciation) que le système capitaliste financier ne quantifiait pas jusque-là. À une époque où les progrès de la connaissance humaine donnent aux nouvelles générations les moyens croissants de maîtriser leur devenir, une telle situation devient inacceptable car elle consiste à accepter que tous les acteurs concernés conduisent le véhicule économique dont ils ont la responsabilité collective en faisant confiance aux indicateurs d’un tableau de bord obsolète et incomplet. Il est donc impératif de progresser rapidement dans une méthode à concevoir dans l’environnement technologique du XXIe siècle permettant de quantifier opérationnellement et périodiquement l’évolution du capital humain que représentent le savoir, l’expérience cumulée et l’organisation plus ou moins adaptée de la communauté de travail de l’entreprise.
Quand ce nouvel outil comptable aura été conçu et diffusé par le monde des experts-comptables, les dirigeants disposeront enfin de tous les outils nécessaires pour bâtir la performance et la croissance de leurs entreprises dans un système capitaliste financier rénové. De son côté, le monde politique aura accompli son devoir en modifiant volontairement les règles de gouvernance interne de l’entreprise pour une plus grande coopération entre le capital et le travail, et en redonnant aux équipes dirigeantes des conditions de travail pacifiées. Quant aux collectivités nationales, elles auront retrouvé les conditions leur permettant d’avoir toute confiance dans un avenir qui ne laissera personne au bord de la route.
Belle utopie ? Peut-être, mais pourquoi ne pas faire confiance au discernement humain ?

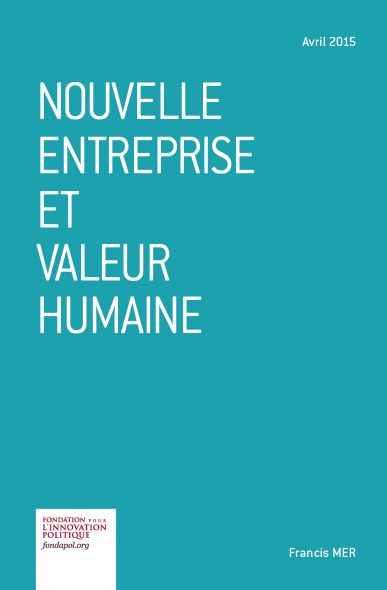
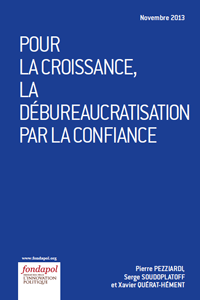











Aucun commentaire.