Les lois de la primaire. Celles d'hier, celles de demain.
Feu sur le quartier général
Le temps des innocents
Le temps des dynamiteurs
L’expérience in vivo
Arbitrages et compromis
Travaux pratiques
La lettre et la trace
Ce qui est acquis et ce qui ne l’est pas
Quelle rénovation ?
Résumé
En France, la primaire est née à gauche, et c’est celle du PS qui sert désormais de modèle parce que la plus achevée, celle de 2011, a permis de désigner sans heurt un futur président. Sur les modalités, l’UMP n’a pas cherché à innover. Au-delà des clivages politiques, faut-il en conclure que, face aux mêmes obstacles et aux mêmes enjeux, les grands partis de gouvernement sont contraints aux mêmes choix ? Mieux, faut-il croire que ces mêmes choix produisent les mêmes effets sur les acteurs de cette compétition ? L’exercice qui a permis à François Hollande d’être désigné comme candidat du PS a été un laboratoire. À travers lui, on observe pourtant un profond décalage entre ce qui avait été imaginé et ce qui s’est réellement passé, aussi bien dans la campagne interne que dans le mode de gouvernance qui en a résulté.
Primaire rêvée, primaire réelle ? Primaire initiale, primaire de toujours ? Ce mode de sélection repose sur des lois assez simples, dont la plus essentielle est celle du nombre. Il n’y a pas de primaire réussie hors de la mobilisation la plus large possible. Mais, en même temps, cet effet de masse bouscule le mode d’animation des partis, la mise en scène des ambitions rivales et, d’une certaine façon, les rapports de force qui en découlent au sein de l’exécutif. En ce sens, la primaire contribue à dessiner le nouveau visage de la Ve République. Elle célèbre l’ultime ingérence du libéralisme culturel dans un système fondé sur la promotion de l’autorité.
François Bazin,
Journaliste indépendant et responsable du blog lirelasuite-francoisbazin.fr.
Voir à ce sujet alain Bergounioux, anne-Lorraine Bujon, michel Balinski, rida Laraki et Thierry , « pri- maires : et si c’était à refaire ? », note Terra nova du 25 avril 2015.
Les institutions de la Ve République ont une histoire. Ses fondations ont été posées en 1958, puis renforcées en 1962 avec l’élection du président de la République au suffrage universel. Validé par référendum, ce bloc initial est l’œuvre, pour l’essentiel, du pouvoir gaulliste. Il dessine, à ce titre, une conception de l’autorité dont certains, à chaud, ont pu contester le caractère républicain. Pour le dire autrement, la Ve République, dès l’origine, penchait à droite.
Il a fallu attendre plusieurs décennies pour que cet édifice soit modifié, corrigé ou rééquilibré. En acceptant et, surtout, en codifiant les règles d’une cohabitation durable, entre 1986 et 1988, François Mitterrand a introduit une manière de droit coutumier dans un système institutionnel qu’il avait longtemps contesté. En 2002, c’est par référendum, sous l’impulsion décisive du Premier ministre de l’époque, Lionel Jospin, que le quinquennat, bientôt suivi par l’inversion du calendrier électoral, est venu renforcer le caractère présidentiel de la Ve République. À deux reprises, des codicilles ont donc été introduits par la gauche, comme si la correction d’un texte qui, à l’origine, échappait à sa tradition lui avait été réservée par les circonstances et l’histoire. On a longtemps estimé que ces retouches étaient des remords, au sens pictural du terme. Faute de pouvoir imposer une nouvelle République, la gauche – celle, du moins, qui aspire à gouverner – aurait été contrainte d’habiller son ralliement par des réformes qui, sans être marginales, n’auraient fait que renforcer la logique des textes existants. François Mitterrand, contempteur farouche du « coup d’État permanent », et Lionel Jospin, adversaire constant d’un mal français nommé bonapartisme, auraient ainsi poussé dans le même sens qui est précisément l’inverse de celui qu’ils prétendaient. C’est à la lumière de ces expérimentations paradoxales qu’il faut examiner aujourd’hui le mouvement en faveur des primaires qui, en France, est né à gauche, sous l’impulsion de responsables politiques souvent favorables, à l’instar d’Arnaud Montebourg, à une République, sixième du nom, rendue à une vérité démocratique trop longtemps malmenée à leur goût.
La primaire, plus encore que la cohabitation, relève du droit coutumier. Elle ne découle d’aucune interprétation constitutionnelle. Elle n’est encadrée par aucun texte législatif. Elle ne répond à aucun impératif légal. Elle est laissée, pour l’instant, à l’appréciation des seules forces partisanes et ne progresse que par capillarité. On pourrait même défendre l’idée que ce mode de sélection des candidats à la présidentielle est à ce point extérieur aux règles institutionnelles en vigueur qu’il n’influe en rien sur leur fonctionnement habituel. Telle n’est pas la thèse que l’on défendra ici. De même que l’élection du président de la République au suffrage universel a changé la Ve République, la primaire modifie le mode de sélection des futurs chefs de l’exécutif. Inévitablement, elle influera sur le profil de ceux qui, demain, exerceront les plus hautes responsabilités à la tête del’État, et donc sur leur lecture des institutions.
Déjà, avec François Hollande, premier président issu de cette procédure, on a vu combien la primaire pesait dans les rapports de forces au sein du gouvernement. Tout cela ne modifie en rien les textes qui encadrent le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, mais les habitudes qui s’instaurent, les réflexes qui s’installent, les rôles qui s’expérimentent dessinent progressivement des parcours politiques nouveaux et, avec eux, des rapports originaux entre celui qui préside et ceux qui prétendent l’avoir fait roi. Dans l’articulation entre gouvernants, partis politiques et citoyens, la primaire, au minimum, fait bouger les lignes.
Il est encore trop tôt pour savoir si ce mouvement, qui ne fait que commencer, renforcera, comme tous ceux initiés avant lui par la gauche, le caractère présidentiel du régime ou s’il débouchera, cette fois-ci, sur une démocratie renouvelée, hors des sentiers plébiscitaires voulus par le fondateur de la Ve République. Pour le moment, une seule chose est sûre et qui explique d’ailleurs qu’il faille considérer la primaire comme un phénomène particulier et global à la fois, échappant de ce fait à la seule loi des partis : cette procédure ne peut, demain, que se généraliser. La gauche, socialiste ou écologiste, l’a inscrite dans ses statuts. La droite républicaine n’a pu y échapper, en dépit des réticences qui continuent à s’exprimer dans sesrangs. Une fois qu’il a été actionné par tel ou tel, le ressort de la primaire – celui de l’appel au peuple des sympathisants – esttrop puissant pour que d’autres puissent lui résister. Et puis, surtout, il a tellement bien fonctionné la première fois qu’il a été expérimenté dans sa formule la plus pure qu’il passe désormais, à tort ou à raison, pour l’un des sésames de la victoire possible. Avec d’ailleurs un effet assez paradoxal sur les nouveaux acteurs de cette compétition : ceux qui, à droite, en contestaient le principe en reprennent aujourd’hui, au détail près, les règles et les rites, tandis qu’à gauche, ceux qui en ont été les inspirateurs célèbrent cette innovation à longueur de rapports, tout en expliquant qu’elle mériterait d’être perfectionnée ou adaptée à de nouvelles circonstances1. Un peu comme si la rude simplicité du mécanisme qu’ils ont mis en place leur donnait le vertige, soitque ses effets ne soient pas ceux qu’ils espéraient vraiment, soit qu’ils n’aient pas encore compris les vraies lois d’un scrutin ô combien étranger à l’esprit de sophistication.
Ce double mouvement a ceci d’assez farce qu’à y regarder de près, le lien n’est peut-être pas aussi fort qu’on le prétend parfois entre la primaire des 9 et 16 octobre 2011 et l’élection de François Hollande le 6 mai 2012. Le principal intéressé, en tout cas, n’était pas un chaud partisan de ce mode de sélection. Il aurait aimé qu’il soit moins tardif. Il s’y était préparé contre un adversaire, Dominique Strauss-Kahn, qui ne fut pas présent à ce rendez- vous. Pour François Hollande, la primaire fut d’abord une contrainte. Il l’a affrontée comme on franchit un obstacle et non comme un point d’appui pour la suite. Il en a utilisé les ressources a minima. Comme toujours, il s’est adapté. À travers cet épisode, on vérifie, une fois encore, que les innovations les plus fortes et surtout les plus riches, en politique, ne sont pas forcément celles qui avaient été le plus finement pensées par leurs bénéficiaires. Reste que la primaire de 2011 est une expérience qui vient de loin, qui a réussi au-delà de toute espérance et qui s’installe, de ce seul fait, comme un modèle à suivre. Sa force est d’avoir eu lieu. Ni plus ni moins. C’est ce qui justifie qu’onl’observe de près, comme le laboratoire d’un système politique sinon rénové, du moins modifié en profondeur.
Feu sur le quartier général
Ceux qui, à tâtons, ont été les premiers à expérimenter la primaire pour le choix du candidat à l’élection présidentielle ne sontpas ceux qui, ensuite, en ont théorisé les objectifs avant d’en codifier les règles. À gauche, la primaire a longtemps cheminé par des voies détournées.
Le temps des innocents
Le PS d’Épinay avait retenu l’idée de la primaire sans jamais l’appliquer. Non pas qu’il s’en soit méfié par principe, mais parce qu’il jugeait ne pas en avoir besoin. En 1974, l’ambition de François Mitterrand était d’être le « candidat commun » de la gauche. Son problème n’était donc pas dans ce PS dont il était alors le premier secrétaire, mais chez les alliés communistes et radicaux dont il entendait obtenir le soutien dès le premier tour. Ce qui fut fait. En 1981, l’affaire avait été réglée, deux ans plus tôt, dans le cadre du congrès de Metz, lorsque Michel Rocard, défait par François Mitterrand, avait pris l’engagement, que personne ne lui demandait, de ne pas briguer l’investiture de son parti à la présidentielle dès lors quele premier secrétaire en manifestait également l’intention. Ce qui fut le cas.
Les années Mitterrand ont été celles d’un long leadership, qui a été parfois contesté, y compris lorsque l’intéressé siégeait à l’Élysée. De ce point de vue, le congrès de Rennes (1990) fut une sorte de réplique de celui de Metz (1979). Mais jamais, jusqu’à la fin de son second septennat qui referme sa carrière au long cours, François Mitterrand ne s’est vu contesté par les siens la capacité politique de représenter, directement ou indirectement, le PS dans la compétition présidentielle. Durant toutes ces années, la primaire reste absente de l’imaginaire socialiste, aussi bien comme procédure d’arbitrage que comme objectif de mobilisation. Elle reste l’apanage, sous sa forme militante, de la famille écologiste, qui y voit une manière de construire son unité sans attenter à son goût de la diversité et de la démocratie directe. Autant dire que la primaire relève alors plutôt du folklore.
La retraite de François Mitterrand referme à gauche une parenthèse et rouvre, du même coup, la question de la sélection d’un nouveau leader digne de ce nom. Mais, là encore, le débat autour d’une éventuelle primaire pour la présidentielle prévue en 1995 n’est porté par aucun des prétendants socialistes. Ni Michel Rocard, sacré un temps, « candidat naturel » du PS, ni Jacques Delors, élevé par la suite au rang de « candidat surnaturel » du même parti, ne s’inscrivent dans cette logique. L’un et l’autre, à leur façon, recherchent l’évidence. Quand le premier chute et que le second se dérobe, c’est le vide face à une défaite désormais inéluctable qui conduit le PS à appliquer une règle de désignation qui figurait dans son arsenal statutaire, mais qu’une fois encore personne n’avait prévud’appliquer.
L’affrontement entre Henri Emmanuelli et Lionel Jospin, début 1995, est donc une innovation accidentelle. La primaire, réservée aux militants, entre le premier secrétaire en place et celui qui exerça cette fonction de 1981 à 1988, marque sans doute un tournant dans la vie du parti. Mais ce tournant a été improvisé et même d’ailleurs un peu bricolé : une offre a minima, une campagne ultracourte, pas de débats… D’emblée, on observe néanmoins que, dans une compétition de ce type, les logiques d’appareil s’effacent devant les logiques d’opinion. Le profil du vainqueur – homme de parti s’il en est – est tel que cette révélation qui le sert ne le conduit pas pour autant à la sacraliser. En 2002, la procédure des primaires est escamotée sans que personne s’en offusque. Si la question ressurgit, cinq ans plus tard, avec une nouvelle évidence, c’est que durant toute cette période l’ombre de Lionel Jospin a continué à planer sur le PS, malgré ses engagements du 21 avril au soir, et que le premier secrétaire, François Hollande, peine à s’imposer autrement qu’un primus inter pares. La primaire, une fois encore, n’est ni attendue, ni théorisée. C’est un pis-aller auquel on se rallie faute de solution alternative.
Même le choix, ô combien symbolique, d’ouvrir cette procédure à de nouveaux adhérents, détenteurs d’une carte à bas prix – 20 euros – n’a pas été dicté par un souci d’élargissement du corps électoral. Il résulte d’une initiative de Jack Lang, reprise par François Hollande, avant même l’envol de Ségolène Royal, dans le seul objectif de revivifier et d’élargir la base militante du PS sans qu’il soit question d’en faire une arme de combat lors de la désignation du candidat pour la présidentielle de 2007. Dans son principe et son format, la primaire socialiste, une fois encore, avance donc en fonction des circonstances, loin de tout calcul de ses organisateurs. Au profit d’ailleurs d’une personnalité qui, comme en 1995, n’était pas attendue sur la ligne de départ et qui ne bénéficiait pas de l’appui explicite de l’appareil du parti.
Le temps des dynamiteurs
En août 2008, sous la plume d’Olivier Ferrand et Olivier Duhamel, Terra Nova publie, une note intitulée « Pour une primaire à lafrançaise ». Ce think tank, qui se dit « progressiste », est animé par des hommes et des femmes qui pour la plupart sont membres du PS mais qui n’y occupent aucune position de pouvoir ou de responsabilité. Ce sont essentiellement des chercheurs, des intellectuels ou d’anciens des cabinets ministériels. Terra Nova a été fondé six mois auparavant. Ses financements le mettent à l’abri de toute influence directe du PS et son objectif affiché est de bousculer la réflexion d’un parti jugé sclérosé. En toile de fond, il y a le désastre du 21 avril 2002 et l’échec cinglant de Ségolène Royal à la présidentielle de 2007, après une campagne chaotique, dominée par la méfiance et l’improvisation.
La note d’Olivier Ferrand, fondateur de Terra Nova et ancien de la maison Jospin, et d’Olivier Duhamel, politologue reconnu, longtemps proche de Rocard et ancien député européen, a des allures de manifeste. Si la gauche vient de perdre coup sur coup deux élections présidentielles qu’elle pensait imperdables, c’est qu’elle est épuisée. Si elle est épuisée, c’est qu’elle ne sait plus réfléchir. Si elle ne sait plus réfléchir, c’est que ses procédures internes l’en empêchent. Derrière ce diagnostic implacable, il y en a un autre qui justifie l’angle d’attaque choisi par Terra Nova : dès lors que la présidentielle est la mère des batailles, il fautcesser de croire qu’on puisse la traiter comme le dernier épisode d’un processus tout entier concentré sur la vie du parti, au point d’en déconnecter les enjeux respectifs.
Pour Olivier Ferrand et Olivier Duhamel, tout se tient. La question du leadership est aussi celle du réarmement intellectuel. Lalégitimité va de pair avec la créativité. Pour changer la gauche, il faut rénover le PS ; pour le rénover, il faut l’ouvrir. CQFD. La primaire, parce qu’elle contrevient à une conception révolue du parti d’avant-garde et à un mode de fonctionnement fondé sur la proportionnelle des courants, est à leurs yeux le point de passage obligé pour faire entrer la gauche dans une nouvelle ère, celle d’un parti moderne et efficient, apte, à ce double titre, à conduire l’un des siens jusqu’à l’Élysée et d’y réussir de manière durable.
Pour la première fois dans l’histoire du PS, la primaire cesse ainsi d’être une procédure neutre ou une contrainte acceptée faute demieux. L’offensive est frontale. Sans être clé en main, elle est suffisamment charpentée pour ne guère laisser d’échappatoire. Les auteurs, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, ont ouvert des options qui, pour la plupart, sont des faux nez. Pour avancer, ils ont choisi de taper fort en faisant d’abord les extérieurs. La presse de gauche – Libération, Le Nouvel Observateur – est associée à une opération dirigée, pour l’essentiel, contre l’appareil honni du PS. Sondages, appels, tribunes, tout y passe. Pour cette fois, cependant, le discours n’est pas de pure dénonciation. Il repose sur une proposition simple : la primaire la plus large possible qui fasse du peuple de gauche le promoteur exclusif de son champion à la présidentielle.
Pour convaincre et populariser leur projet, Olivier Ferrand et Olivier Duhamel ont prévu d’avancer par notes et livres successifs, qui tiennent compte de l’accueil qui leur sera fait. Ils jouent à la fois sur l’opinion et ses relais médiatiques. Ils adoptent la posture de l’expertise, qui les place sur le terrain du pragmatisme sans qu’il soit possible de les accuser de rouler pour telle ou telle écurie. L’histoire qu’ils racontent est une success story qui est celle de Barack Obama aux États-Unis mais aussi celle du Parti démocrate en Italie et même du Pasok en Grèce. Ce sont là des exemples qui, sur la scène française, font encore rêver. On est en 2008…
Passé le temps des premières offensives qui ont popularisé leur projet, les dynamiteros de Terra Nova vont avoir besoin de trouver des alliés, au sein même du PS, pour avancer plus en avant. Le congrès de Reims, en novembre 2008, leur en offre l’occasion. Plusieurs responsables du parti, de Ségolène Royal à Pierre Moscovici en passant par Manuel Valls, se déclarentfavorables à la systématisation des primaires ouvertes au-delà des rangs militants. Martine Aubry s’affiche sur la même ligne. Mais l’essentiel n’est pas là. La nouvelle première secrétaire a été mal élue. Sa majorité est de bric et de broc. Pour s’installer à Solférino, elle a besoin d’alliés. Arnaud Montebourg est l’un d’eux, et non le moindre. Il est nommé secrétaire national chargé de la rénovation du parti. Sa force, comme toujours, va être de jouer de la faiblesse des autres.
Pour durer, Martine Aubry doit réaffirmer sans cesse une légitimité contestée. Après le désastre des élections européennes, la première secrétaire recherche tout ce qui peut rétablir des liens de confiance avec la base militante du PS. Elle penche pour la suppression du cumul des mandats. Lettre de démission en poche, Arnaud Montebourg lui impose, durant l’été 2009, le respect de toutes ses promesses, primaire comprise : en un an, le projet Ferrand- Duhamel s’est introduit jusqu’au cœur du parti.Soutenu, dans son principe, par la première secrétaire, il est placé illico entre les mains des militants qui le plébiscitent. Désormais, l’affaire est pliée, même si le scepticisme est de rigueur chez les caciques de l’appareil. Le débat qui se poursuit entre ses principaux dirigeants n’est pas anecdotique. Il porte essentiellement sur la date du scrutin et l’on remarque d’emblée que les favoris – Dominique Strauss-Kahn, notamment – le veulent le plus tardif possible, alors que les outsiders – François Hollande, au premier chef – aimeraient qu’il soit organisé au plus tôt.
La primaire, telle qu’elle s’impose au PS, est donc le fruit d’un Blitzkrieg. Elle tire sa force des circonstances et du manque de légitimité de la première secrétaire, dans une fuite en avant où les vainqueurs sont ceux qui ont des idées claires et un projet ficelé. Ceux-là, qu’ils soient dans la place, tel Arnaud Montebourg, ou à la marge du système, tels Olivier Ferrand et Olivier Duhamel, se veulent rénovateurs. Tous estiment que la primaire, pour la présidentielle, dès lors qu’elle est ouverte aux sympathisants, va changer la nature du parti. Ils n’ont pas pour autant la même conception de la suite : l’un estime que la primaire est un pas décisif sur le chemin de la VIe République, tandis que les deux autres pensent qu’elle signe, au contraire, le ralliement sans fard du PS aux institutions existantes. Leur alliance est à la fois tactique et circonstancielle. Elle vise le mouvement en interne et la gagne en externe. Elle repose sur l’idée, somme toute assez simple, que la victoire d’un socialiste en 2012, dès lors qu’il aura été choisi par le corps des sympathisants, ouvre la voie de tous les possibles. En ce sens et quoi qu’ils prétendent, les artificiers de la primaire sont bien des bonapartistes : « On avance et on voit. »
L’expérience in vivo
Dans le détail de son organisation concrète, la primaire a été mise au point dans le cadre d’une commission du PS réunissant les représentants de ses principaux leaders. Le rapport final, présenté par Arnaud Montebourg, devant le bureau national du parti, le 1er juin 2010, est validé, un mois plus tard, lors d’une Convention nationale après que les militants se sont prononcés en sa faveur à une large majorité (77% des votants). En dépit des doutes exprimés par Bertrand Delanoë et François Hollande, gardiens provisoires de la tradition militante, et les inquiétudes manifestées, ici ou là, par ceux qui, tel Jacques Attali, voient dans cette procédure complexe une nouvelle « machine à perdre » tout juste bonne à exacerber des ambitions rivales, la mécanique des primaires s’est installée dans des temps records. Un an avant qu’elle soit expérimentée, elle est déjà prête dans ses principaux rouages. La campagne proprement dite débute fin juin 2011, dans des conditions inattendues liées au forfait du favori des sondages, Dominique Strauss-Kahn. Elle s’achève le 16 octobre suivant, dans un face-à-face entre François Hollande et Martine Aubry, dont le premier sort doublement vainqueur en raison du nombre des votants (2,9 millions) et de l’ampleur de sa victoire (56,57% des voix). C’est dans ce processus en deux temps que se sont installés les règles, les rites et les rôles d’une procédure de sélection désormais codifiée pour longtemps.
Arbitrages et compromis
Le projet initial de Terra Nova, celui que défendra ensuite Arnaud Montebourg et le règlement finalement voté par les militants socialistes s’emboîtent tous les trois fort étroitement. La logique qui les sous-tend et les mécanismes qu’ils installent sont d’une nature comparable. Ils sont pourtant le fruit d’un processus de décantation au terme duquel la primaire, acceptée dans son principe, a surtout été jugée viable, réaliste et apte à produire les effets attendus par ceux qui l’avaient imaginée.
Le premier de ces arbitrages coulait en fait de source. Fallait-il organiser la primaire en début ou en fin de législature ? Le vainqueur de cette compétition devait-il être sacré leader du parti chargé de préparer, sur la durée, les conditions de sa propre candidature à la présidentielle ou devait-il être choisi, en fin de parcours, juste avant que s’ouvre la compétition dont il allait être le champion? La première option, évoquée dans le rapport de Terra Nova, donnait à cette opération un tour parlementaire, conforme aux pratiques des démocraties du même nom et qui répondait surtout à la lecture des institutions qu’en théorie le PS a toujours défendue. Elle présentait, enfin, l’avantage de ne pas compliquer à l’excès le partage des rôles entre le premier secrétaire et le candidat à la présidentielle, dont on sait combien il a suscité de tensions dans l’histoire récente du parti. Mais, vu la date à laquelle ce débat a été posé – deux ans avant la présidentielle de 2012 –, il était inévitable qu’il soit tranché autrement. L’urgence, en la matière, a fait loi. Les expériences de 1995 et 2007 ont servi de références. D’emblée, la primaire socialiste s’est calée sur le calendrier de la présidentielle. Ce choix qui s’imposait naturellement a déterminé toute la suite. La primaire allait être un décalque en réduction de la compétition principale. Un premier round interne, en quelque sorte, qui pourêtre compris des électeurs devait lui ressembler au plus près.
À partir de là tombait du même coup une autre option évoquée par Terra Nova et Arnaud Montebourg : copiée sur le modèleaméricain, elle proposait un processus de sélection au long cours, scandé par des scrutins régionaux, permettant aux divers candidats, quels que soient leur statut ou leur réputation, de tester progressivement l’écho de leur projet et l’impact de leurs ambitions. Mais cette procédure complexe, étrangère à la tradition française, éloignait la primaire de son vrai modèle, c’est-à-dire de la présidentielle proprement dite, est ampillée Ve République. Elle n’a pas vécu au-delà des rapports qui l’évoquaient, pour la forme. En l’écartant, les ingénieurs de la primaire réglaient du même coup la question cruciale du filtrage des candidatures. Car le modèle calqué sur la pratique américaine avait pour objectif affiché de permettre l’entrée en lice de candidats, sinon inconnus, du moins étrangers à l’appareil du PS, tels de grands élus locaux assimilés, en l’occurrence, à des gouverneurs à la française. Terra Nova imaginait même qu’il puisse favoriser la candidature de personnalités, comme Bernard Kouchner – « avant qu’il ne trahisse » (sic). Mais, une fois encore, c’est le modèle français qui s’est imposé comme référence unique. De même que les candidats à la présidentielle doivent être parrainés par 500 parlementaires ou élus locaux, les postulants à la primaire devront donc trouver leur lot de soutien dans un cheptel comparable : 5% des membres du conseil national du PS ou, alternativement, 5% des parlementaires socialistes, 5% des conseillers généraux ou régionaux issus d’au moins dix départements ou quatre régions, ou 5% des maires de villes de plus de 100.000 habitants issus d’au moins quatre régions.
Plus que la liste exacte des parrains potentiels, c’est le stock qui compte en la matière. En 2006, les candidats devaient êtresoutenus par au moins 15% des membres du conseil national, ce qui, mécaniquement, limitait à six leur nombre maximum, àcondition qu’aucun des postulants ne vienne assécher l’offre en multipliant les parrainages. Finalement, ils ne furent d’ailleurs que trois, Ségolène Royal, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, après le renoncement de François Hollande et de Lionel Jospin et l’échec de Jack Lang dans cette chasse inédite. Dès lors que, cinq ans plus tard, on prévoyait d’ouvrir la primaire au-delà des cercles militants, il était logique qu’on élargisse aussi celui des parrains dans un filtrage dont on retiendra qu’il a laissé sur le carreau deux prétendants peu connus du grand public, Christian Pierret, ancien ministre, et Daniel Le Scornet, issu dumouvement mutualiste, et qu’il n’a pas été loin d’écarter Manuel Valls, jeune pousse du parti, militant de longue date mais guèreimplanté chez les cadres et les élus en raison de son parcours atypique.
Dans ce processus de sélection calqué sur celui de la présidentielle, les organisateurs de la primaire ont toutefois introduit une exception qui répondait à une autre logique. La procédure qu’ils avaient imaginée prétendait changer le PS. Elle avait également pour objectif de changer la gauche en modifiant, à terme, ses frontières partisanes avec, en toile de fond, le souvenir du21 avril 2002 et de cette dispersion de l’offre qui avait produit le désastre que l’on sait. L’idée de la candidature commune, portée par François Mitterrand en 1965 puis en 1974, n’a jamais cessé de travailler la mémoire socialiste, avec cette difficulté,découverte après coup par les alliés communistes ou radicaux, qu’un parti digne de ce nom ne peut tenir son rang dès lors qu’il renonce à défendre ses couleurs dans la compétition reine de la Ve République. Or l’exemple italien n’avait-il pas montré que le processus des primaires, ouvert à d’autres partis que celui qui en était l’initiateur, pouvait résoudre cette contradiction en permettant à la fois la visibilité de chacun et le rassemblement de tous dès lors que la procédure choisie n’était plus celle d’une simple compétition interne ? C’est dans ces conditions que la primaire socialiste est devenue une primaire « citoyenne ». Le comparse, vu la stratégie isolationniste des écologistes et des communistes, ne pouvait être que radical. Les principaux dirigeants du PRG, par la voie de Jean-Michel Baylet et Roger-Gérard Schwartzenberg, avaient montré, en leur temps, leur disponibilité en déposant une proposition de loi donnant un tour légal à toute cette procédure. Pour qu’ils entrent dans la partie, initiée par le PS, il fallait toutefois qu’ils puissent y être admis intuitu personæ, sans être soumis au filtrage imposé aux prétendants est ampillés socialistes. Ce statut spécial a permis au président du PRG, désigné par ses pairs, de concourir, dès lors qu’il en a officiellement exprimé le désir, en juillet 2011.
Ce petit arrangement entre alliés n’avait pas d’autre motivation que de parfaire le rassemblement espéré par les dirigeants socialistes et, du même coup, de montrer les multiples fonctions prêtées au processus de primaires. Il a davantage changé l’image de la compétition que bouleversé en profondeur les conditions de la campagne. Il bloquait de facto toutes les ambitions qui, traditionnellement, émergent au centre gauche de l’échiquier politique à l’occasion de la présidentielle. Il justifiait surtout que le corps électoral ne soit pas réservé aux seuls militants du PS. Ce qui était l’intention première de tous les promoteurs de la primaire. Enfin, il conduisait tout droit à l’ouverture du scrutin à l’ensemble de ceux qui acceptaient, outre de verser 1 euro symbolique, de signer une charte aux contours particulièrement larges puisqu’elle renvoyait, sans plus de précisions, aux « valeurs de la gauche et de la République ».
Sans doute est-ce enfin dans les modalités pratiques de son organisation que la primaire est venue coller, au plus près, des règles en vigueur lors du scrutin présidentiel : vote secret par bulletins après passage dans l’isoloir et signature d’une feuille d’émargement, et non vote électronique. Cette dernière méthode, utilisée par les Verts lors de la primaire militante qui avait servi à désigner Eva Joly, juste avant l’été 2011, fut explorée un moment par les mécaniciens du PS avant d’être abandonnée pour des raisons de coût et de fiabilité. Par désir, aussi et surtout, ne rien faire qui, dans la symbolique du scrutin, vienne troubler les habitudes des électeurs. D’où, également, le choix de les faire voter, autant que faire se peut, dans les bureaux de votes traditionnels (mairies, écoles…), selon un mode de scrutin à deux tours où les finalistes, à l’arrivée, ne pouvaient être que deux. Cette sécurisation, via les rites, en appelait une autre, via l’utilisation des listes officielles, fournies en préfecture, sans lesquelles aurait été nécessaire un mécanisme complexe de préinscription.
La mise en place d’une autorité indépendante chargée de veiller au bon déroulement de la campagne et du scrutin participait de la même intention. Ce Conseil constitutionnel de la primaire, doté de pouvoirs élargis pour faire respecter l’égalité entre les candidats et la correction de leurs débats, a introduit une innovation majeure dans l’organisation des scrutins du PS. Là aussi, on retrouve cette volonté de faire coller la primaire aux règles de la présidentielle, connues et reconnues par les électeurs. Telle n’était sans doute pas l’intention initiale de tous ceux qui en furent les promoteurs mais, de même que l’on tombe toujours là où l’on penche, la logique de cette élection inédite poussait inévitablement en ce sens, cela d’autant plus que la clé de la réussite était tout entière dans le nombre de votants.
Le débat le plus rude, parce que le moins évident, fut en fait celui de la date du scrutin. Deux écoles se sont ainsi affrontées, sur des bases d’ailleurs assez paradoxales. Les partisans d’un vote tardif – fin 2011 – étaient aussi ceux qui souhaitaient unecampagne la plus courte possible. Ceux qui entendaient installer une campagne au long cours voulaient en revanche un vote avant l’été 2011. On a ainsi retrouvé à cette occasion des controverses qui avaient marqué la précédente primaire de 2006. Déjà, à cette époque, Ségolène Royal, favorite du scrutin, au moins dans les sondages, avait plaidé pour la première méthode, expliquant que sa victoire probable exigeait qu’on la ménage tandis que ses challengers lui opposaient la nécessité d’un débat approfondi, apte à faire tomber les faux-semblants. En 2011, on peut donc dire que Dominique Strauss-Kahn est devenuroyaliste, tandis que François Hollande enfilait des habits qui avaient été ceux du fabiusisme et du strauss- khanisme. Mais, danscette affaire, il n’a pas été nécessaire que le patron du Fonds monétaire international chute et soit remplacé au débotté par Martine Aubry pour qu’un compromis se dessine. Entamée fin juin, la campagne a été close mi-octobre, selon des modalités fixées dès l’année précédente, en vertu du bon vieux principe qui veut qu’une poire soit toujours coupée en deux. Pour s’installer, tel un premier round avant la présidentielle, la primaire ne devait-elle pas avoir lieu ni trop loin avant elle, pour ne pas épuiser le candidat, ni trop près, pour lui laisser le soin de retrouver son souffle ? Ce ni-ni très socialiste avait en tout cas l’avantage de n’humilier personne. Ce qui fut le but recherché, du début à la fin, par les dirigeants du PS dès lors qu’ils avaient tous compris,bon gré mal gré, que la procédure des primaires avait fait naître dans l’opinion un élan trop puissant pour qu’ils puissent donnerle sentiment sinon de le briser, du moins de le freiner par des réflexes ouvertement boutiquiers.
Travaux pratiques
Sur le vote des primaires socialistes et la sociologie des votants, on reprend ici les conclusions de Jérôme Jaffré exposées dans son article « La victoire étroite de François hollande », inpascal perrineau, Le Vote nor- Les élections présidentielle et législatives d’avril-mai-juin 2012, Les presses de sciences po, 2013.
On ne fera pas ici le récit détaillé d’une compétition qui a duré trois mois et demi, et qui s’est achevée le 16 octobre 2011, ausecond tour, par la nette victoire de François Hollande face à Martine Aubry. Notons simplement, tout d’abord, que cette primaire a été commentée par la presse et perçue par l’opinion comme un succès parfait, en dépit du scepticisme ambiant qui régnait au-delà même des rangs socialistes, et ce jusqu’à la rentrée de septembre.
Les organisateurs de ce scrutin, inédit sous cette forme, voulaient attirer l’attention des Français. Or les taux d’écoute des quatre débats organisés à la télévision – trois avant le premier tour, un pour la finale – ont démontré que tel a été le cas. Ils voulaient mobiliser les électeurs de gauche et la barre du succès avait été placée à 1 million de votants. Or ils furent trois fois plus nombreux, à chacun des deux tours. Ils voulaient démontrer que le PS, que l’on disait perclus de rhumatismes et miné par ses querelles d’ego, avait encore la force d’organiser une compétition de ce type. Or son encadrement militant lui a permis derelever ce défi. Enfin, ils voulaient faire la démonstration que le temps des magouilles et des contestations en tout genre était terminé. Or, aussi bien la campagne que le scrutin lui-même, ont été maîtrisés à l’extrême. Peu de polémiques, des flèches mais pas de coups bas, des résultats incontestés car incontestables, des mises en garde venant de la droite ou du gouvernement de l’époque qui tombent toutes à l’eau dès lors que les précautions demandées par la Commission nationale de l’informatique etdes libertés (Cnil) ont été entièrement respectées : revenant après coup sur son œuvre, Olivier Ferrand, patron de Terra Nova, a puécrire que « ce coup d’essai fut un coup de maître » sans que personne vienne le contredire.
Si on y regarde de plus près, cette campagne des primaires a surtout mis en valeur des rôles et installé, du même coup, des jeux de rôles. Le vainqueur, François Hollande, est le candidat qui s’était déclaré officiellement le premier, qui avait été désigné favori par l’ensemble des sondages lorsque la compétition était entrée dans sa phase décisive et qui est sorti en tête du premier tour avant de rassembler autour de lui, au second, l’ensemble des compétiteurs qui ne participaient pas à la finale. Le succès de François Hollande a donc eu davantage l’aspect d’une construction que d’une dynamique. Nul ne sait, par définition, si Dominique Strauss-Kahn, s’il avait pu participer au scrutin, aurait pu s’imposer dans les mêmes conditions. Durant l’automne 2011, on a quand même pu voir combien les attributs du succès annoncé s’emboîtaient les uns aux autres au profit d’un candidat qui n’était pas étranger à l’appareil socialiste – il l’avait dirigé onze ans durant ! – mais qui n’en avait plus la responsabilité directe.
Le positionnement du vainqueur de la primaire, de ce point de vue, est l’exact contraire de celui choisi par sa principale rivale, Martine Aubry. Partie tard, fin juin, juste avant la clôture des candidatures, comme à contrecœur après le forfait de Dominique Strauss-Kahn dont elle était l’alliée, lestée par un projet socialiste qu’elle avait parrainé alors qu’elle ne pensait pas entrer dans la compétition, privée de ce seul fait du pouvoir d’imaginer un programme original, la première secrétaire a ainsi accumulé les handicaps liés à sa fonction. En passant provisoirement la main, rue de Solférino, à Harlem Désir, dès le début de la campagne, elle s’est installée d’emblée dans un statut quelque peu « bâtard ». D’un côté, il lui a fallu assumer son bilan à la tête du PS ; de l’autre, elle s’est crue obligée d’abandonner les avantages de sa fonction. Rassembleuse lorsque cela n’était pas nécessaire, Martine Aubry s’est retrouvée isolée au moment décisif. Beaucoupont vu là un effet de son caractère ombrageux, alors qu’elle devait affronter le roi incontesté de la synthèse et de l’équilibre. On peut également penser que si tous les autres candidats se sont finalement ralliés, sous des formes variées, à François Hollande, c’est que dans cette compétition inédite il ne faisait pas bon d’être, de facto, l’incarnation de l’appareil, sans avoir de surcroît ce statut de favori, dispensateur de prébendes pour la suite.
Les six candidats ont ainsi géré la fin de la primaire selon des règles qui ressemblent fort à celles d’un congrès socialiste. Le vrai changement a concerné les outsiders de la compétition. Lors de la campagne du premier tour, tous ou presque ont adopté une logique de niche qui leur offrait un rôle pour la suite. Ségolène Royal, la seule ayant essayé de sortir de ce casting préétabli, a vérifié à ses dépens combien il était illusoire de vouloir rejouer 2011 comme 2006, alors que toutes les cartes avaient été rebattues, notamment dans les sondages. C’est elle qui, au soir du premier tour, est sortie la plus abîmée d’une compétition qu’elle croyait taillée à sa mesure. Alors même qu’avec 6,9% des voix elle devançait pourtant Manuel Valls et Jean-Michel Baylet, elle s’est retrouvée privée de tout rôle. Même son ralliement ô combien décisif à François Hollande ne l’a pas sortie d’une forme de marginalité, tandis qu’avec moins de voix dans leur besace, le député-maire d’Évry s’imposait comme un acteur décisif pour la suite et que le président du PRG trouvait le moyen de conforter la place qui avait été toujours la sienne dans le concert de la gauche.
Pour autant, la campagne des primaires de 2011 n’a pas uniquement servi à vérifier les niveaux. Comme en 1965 et 1969, lors des deux premières compétitions présidentielles, elle a permis de révéler des talents jusque-là méconnus ou jugés secondaires. Manuel Valls, comme Michel Rocard en son temps – et d’ailleurs avec un score identique (5%) – s’est imposé dans la cour des grands en occupant un créneau sans doute marginal mais extrêmement valorisant en termes d’image. De même, Arnaud Montebourg, comme François Mitterrand lors de son entrée initiale sur la scène présidentielle, a montré que cette compétition, dès lors qu’on en maîtrisait les règles, pouvait faire naître une dynamique prometteuse, quand bien même celle-ci resterait minoritaire. Pour comprendre le succès inattendu du député de Saône-et-Loire (17%), il faut tenir compte de son âge, de sa réputation de rénovateur casse-cou, de son implication décisive dans la procédure de la primaire et, surtout, de sa capacité à renouveler un rôle-titre installé de longue date dans le répertoire de la gauche, celui de la double contestation de l’Europe telle qu’elle est et de la mondialisation telle qu’elle se déploie sur le mode libéral. Dès lors qu’on admet que François Hollande a davantage enjambé la primaire, comme il enjambera d’ailleurs par la suite la campagne présidentielle proprement dite, en mettant sur la table le moins de cartes possibles, il faut bien reconnaître qu’Arnaud Montebourg est, de tous les candidats, celui qui a tiré le plus grand profit de cette compétition inédite. Avec, toutefois, une difficulté majeure dans ladernière ligne droite quand il lui a fallu choisir entre les deux finalistes. Pour se faire une place au soleil, il avait choisi, jusque-là, de les renvoyer dos à dos. Ce fut même la clé de son succès. Après avoir imaginé de s’abstenir de toute consigne pour le second tour puis de soumettre à la question l’un et l’autre des compétiteurs, il a été contraint à un atterrissage acrobatique en se prononçant « à titre personnel » pour le vainqueur probable avant de s’auto-octroyer un titre d’allié de référence que François Hollande, devenu candidat officiel du PS puis président de la République, s’est toujours bien gardé de confirmer ou d’infirmer publiquement.
Enfin, au-delà de la stratégie des différents acteurs de la primaire, le vote
des 9 et 16 octobre a montré que cette procédure de sélection obéissait à des lois originales, dont certaines annonçaientd’ailleurs celles de l’élection présidentielle proprement dite, le 22 avril et le 6 mai 2012. On en soulignera ici les trois principales.La première est la forte mobilisation des électeurs de gauche : 2,6 millions puis 2,8 millions d’entre eux se sont successivement déplacés pour choisir leur champion. Calculé par rapport au premier tour de la législative de 2012, cela veut dire concrètementqu’un électeur de gauche sur quatre s’est senti concerné par la primaire, avec des pointes allant jusqu’à 43% à Paris2. Ce qui signait d’emblée le succès de cette procédure.
Une deuxième caractéristique du scrutin est la fiabilité contrastée des sondages qui ont su saisir le rapport de force entre les deux favoris mais qui n’ont pas su estimer à sa juste mesure la dynamique qui portait Arnaud Montebourg et plombait Ségolène Royal. Dans le même ordre d’idée, on notera qu’à participation à peu près égale Martine Aubry a progressé de treize points en passant d’un tour à l’autre de 30,4% à 43,4% alors qu’elle ne bénéficiait du soutien d’aucun autre compétiteur.Ce qui souligne la forte autonomie des électeurs, au-delà des consignes et autres recommandations. Dans la primaire de 2011, lesvotants ont bien été, comme prévu, des citoyens engagés et non de pseudo-militants.
Enfin, et c’est sans doute le plus intéressant, la sociologie du vote à la primaire, version 2011, a montré que, dans ce type de scrutin aussi, l’électeur est d’abord un inclus, celui qui, au fond, se déplace toujours plus que les autres, quel que soit le scrutin et dont la mobilisation pèse davantage sur le résultat final que celle des votants les plus politisés. D’où son profil « en décalage complet avec la réalité du peuple de gauche », comme l’a remarqué Jérôme Jaffré en soulignant notamment, dans l’exercice de la primaire socialiste, la surreprésentation des hommes et des personnes âgées. 40% des votants avait en effet plus de 60 ans, contre 29% des électeurs de gauche, si l’on maintient la comparaison avec le scrutin législatif de 2012. Mieux – ou pis –, la sociologie du vote Hollande a été l’inverse de celle que magnifie son parti. La France de la jeunesse, de même que celle descatégories populaires et des grandes villes, ne s’est pas retrouvée prioritairement dans le candidat qui a remporté la mise. Celui-ci, en revanche, a dominé chez les plus de 50 ans, les retraités, les agriculteurs et les habitants des communes rurales. C’est même dans les zones dominées par la droite que son avance sur Martine Aubry a été la plus forte. Là est sans doute une des clés du score jugé décevant qui a été le sien au premier tour (39,2%), alors que certains de ses soutiens envisageaient qu’il passe d’emblée la barre de la majorité absolue. En même temps, François Hollande a fait dans cette primaire la démonstration de sa capacité à sortir du pré carré de son parti, accréditant ainsi la thèse qui lui a servi d’argument principal, selon laquelle il était lecandidat socialiste qui, au fond, l’était le moins et qui, à ce titre, était le mieux placé pour vaincre, le jour venu, Nicolas Sarkozy.
La lettre et la trace
La primaire socialiste est devenue un modèle. Elle a sélectionné le vainqueur de 2012 et son modèle s’impose désormais commeun rite dans le processus de sélection des candidats à la présidentielle. Cela vaut bien sûr pour le PS, qui a inscrit cette procédure dans ses statuts lors de son congrès de Toulouse, en octobre 2012, mais cela vaut également pour l’UMP, qui pouvait difficilement résister à son attraction dès lors que, dès 2006, son candidat évident, Nicolas Sarkozy, alors qu’il était déjà président du parti, avait esquissé – fût-ce du bout des lèvres – une primaire militante afin de montrer que sa concurrente socialiste, Ségolène Royal, n’était pas seule à pouvoir prétendre à pareil sacre. La guerre de leadership qui a fait rage au sein de l’UMP après la défaite de 2012, ne pouvait que renforcer l’attrait de la procédure de la primaire dans une formation politique pourtant peu rompue àl’exercice de la démocratie interne. Désormais, pour un grand parti de gouvernement, la difficulté n’est pas de comprendre comment on peut organiser une primaire mais de savoir comment on peut éventuellement l’éviter. La procédure est là. Elle a été expérimentée. Faut-il toutefois en conclure qu’elle ne peut être revisitée dans certaines de ses modalités pratiques et que les loisqui la régissent sont désormais immuables ?
Ce qui est acquis et ce qui ne l’est pas
La réalité de la primaire, c’est pour l’essentiel le nombre des votants. Depuis 2011, la barre a été mise à un niveau élevé. Tout ce qui favorise la participation devient dès lors incontournable. Vouloir maîtriser ou contrôler le nombre des votants est une tentation qui peut se concevoir. En pratique, elle est illusoire. Elle placerait celui qui la caresse dans la position intenable qui consiste à donner la parole au peuple des sympathisants tout en lui en mégotant ce droit. À l’extrême rigueur, telle pourrait être la posture d’un chef de parti ayant fait le choix de ne pas participer à la compétition. Avec quand même, au final, cette contradiction insoluble : pourquoi choisir une procédure qu’on prive, illico, de son ressort le plus précieux ?
La loi du nombre suppose donc que soit repris à l’identique tout ce qui a favorisé la participation, en 2011. Autrement dit, le vote à bulletin secret selon des règles copiées sur la présidentielle proprement dite, mais aussi les procédures de contrôle, à la fois de la campagne et du scrutin, via des organes jugés suffisamment représentatifs et donc extérieurs à l’appareil du parti. Tout cela constitue un bloc hors duquel il n’y a pas de primaire crédible, donc pas de primaire possible. Sans la force d’une participation qui, pour être massive, se doit aussi d’être sincère et ouverte, c’est toute la procédure qui tombe à l’eau sans que personne puisse tirer le moindre profit d’une telle déconfiture. Le nombre évite la contestation. Il noie la fraude éventuelle dès lors qu’elle reste marginale. Il empêche lesmanœuvres venant de forces hostiles ou simplement malveillantes.
À ce titre, on oublie trop souvent que les primaires qui, dans l’histoire, ont échoué ou ont tourné à la confusion ne sont pas par hasard celles qui ont été organisées par les Verts dans le cadre restreint de leurs cercles militants. Non pas que les écologistes soient roués par nature – des scrutins récents, tant au PS qu’à l’UMP, ont rappelé que nul n’avait le moindre monopole, en la matière… –, mais ce qui a bien fonctionné chez les Verts en 2011, au profit d’Eva Joly avec 21.500 votants, s’était avéré catastrophique en 2001 et en 2006 avec une participation moitié moindre. Dans un cas, il a fallu revoter, les deux finalistes, Dominique Voynet et Yves Cochet ayant obtenu le même nombre de voix ; dans l’autre, Alain Lipietz, candidat désigné sur desbases aussi minces, a pu être débarqué, après coup, dans une opération de déstabilisation de la plus belle eau, avant d’êtreremplacé au pied levé par Noël Mamère.
Dans le même ordre d’idée, certains ont pu craindre, lors de la primaire socialiste de l’automne 2011, que des coucous, extérieurs à la compétition, viennent influer sur son résultat en choisissant tel ou tel des concurrents officiels. Entre les deuxtours du scrutin, à l’évidence, l’état-major des Verts a donné des signes de sa préférence pour Martine Aubry. Reste que pour peser sur le résultat final, dès lors que près de 3 millions de personnes participaient au scrutin, il aurait fallu davantage qu’un clin d’œil pour renverser le cours des opérations. Imaginons, par hypothèse, que l’appareil écolo ait su mobiliser dans pareille aventure la moitié de ses troupes militantes et que – chose encore moins crédible ! – celles-ci aient toutes suivi la même consigne de vote, au total la maire de Lille aurait progressé de 5.000 voix environ alors, qu’à l’arrivée, son retard face à Hollande a été cent fois plus important.
Dans une compétition à environ 3 millions de votants, le point est à 30.000. Cela signifie clairement que la participation est l’antidote absolu de la manipulation. Pour dire les choses encore plus clairement, même dans un scrutin serré, dès lors que le vote est massif, il est statistiquement peu crédible que des électeurs venus de la gauche puissent demain troubler une primaire UMP. Ou, inversement, en d’autres occasions. Ce qui, au passage, souligne le caractère absurde de toute tentative de contrôle de la mobilisation électorale, au nom d’on ne sait quelle prérogative partisane. Car c’est là le seul cas de figure où la manipulation extérieure pourrait avoir des effets réels. Sur ce terrain-là, le risque, en fait, n’est pas celui du détournement du scrutin mais de son exploitation, a posteriori, par un candidat étranger à la compétition et qui déciderait, dans la présidentielle proprement dite, de défendre une ligne ou un programme défait lors de la primaire.
On mesure, du même coup, le caractère artificiel de ce débat qui passionne les états-majors politiques et qui porte sur le libellé de la charte d’adhésion soumis à la signature de ceux qui entendent participer à la primaire. En le durcissant ou en l’élargissant à l’extrême, on adresse bien sûr à l’opinion des signaux contrastés, mais la primaire de 2011 a rappelé que les électeurs n’avaient pas besoin de telles indications pour se sentir ou non concernés. Plus que la charte, c’est l’offre qui fixe le périmètre de la primaire. La présence, dans la première grande compétition de cette nature, des principales figures de la gauche réformistes, radicaux compris, suffisait pour en dire la vraie nature. De même, il suffirait que le représentant d’un parti centriste – ou d’un candidat ayant peu ou prou cette qualité – participe à la primaire voulue par l’UMP pour qu’elle cesse d’être celle de la seule droite républicaine, sans garantir toutefois qu’elle ait alors le caractère d’un rassemblement sans faille. De ce point de vue, il est donc faux de dire que la primaire est, par nature, le parfait antidote à la dissidence ou à l’irrédentisme.
Le choix de la date de la primaire soulève enfin un débat d’une nature comparable à celui suscité par la charte d’adhésion : chaque candidat en présence voudrait promouvoir des règles qui répondent à ses intérêts supposés, lesquels, d’ailleurs, ne sont pas toujours les plus avérées… Mais comme ces points de procédure sont toujours négociés, le plus probable est qu’à l’avenir, tout cela débouchera sur une manière de compromis, quel que soit le parti concerné. Avec un libellé pour la charte qui annonce plus des principes que des frontières. Avec un vote fixé à l’automne précédant la présidentielle pour satisfaire à la fois lesfavoris qui veulent prendre leur temps et les outsiders qui le savent compté.
Entre ce qui va de soi et ce qui se négocie sans peine, il apparaît donc, par réductions successives, que le seul point digne d’un vrai débat pour l’organisation d’une primaire est celui du filtrage des candidatures. Celui-ci peut être modifié à la marge, avec des effets sensibles sur le nombre et, surtout, le profil des compétiteurs. La question ainsi soulevée n’est pas tant celle de la qualification des poids lourds de tel ou tel parti que celle de la liberté d’accès à la compétition pour des personnalités jugées nouvelles ou mêmes marginales. La primaire du PS en 2006, filtrée par les membres du conseil national, a permis à trois candidats de concourir. Élargie à un panel d’élus, celle de 2011 en asélectionné deux fois plus dont l’un, ès qualités, en tant que président d’une formation alliée.
Là aussi, c’est une solution médiane qui, toujours, finit par satisfaire les différents compétiteurs affichés ou potentiels. Mais si les marges de négociation sont a priori aussi larges, c’est que les arguments en présence ont tous une vraie cohérence.Une primaire dans un effectif réduit peut être jugée plus dense, plus sérieuse, et donc plus attractive. Une primaire dans un effectifélargi peut être considérée, en revanche, comme plus représentative, plus variée, et donc… plus attractive aussi. Dans ce choix-là, pourtant, une variable vient modifier en profondeur les termes du débat : ceux qui fixent la règle sont ceux qui organisent la primaire et, sauf période de mise en place, un outsider comme Arnaud Montebourg n’a généralement pas voix au chapitre. Il y a donc fort à parier qu’au fil des expériences, lorsque cette procédure sera entrée dans les mœurs, la pression de ceux quientendent la réserver aux leaders patentés sera de plus en plus forte, de même que, pour l’élection présidentielle proprement dite,le nombre des parrainages exigé n’a cessé d’augmenter avec le temps.
Enfin, il y a une question que la primaire de 2011, par nature, ne pouvait pas régler : que faire au cas où le président de la République sortant entend se représenter ? Au nom du caractère intangible de la règle – introduite dans les statuts du PS, notamment –, faut-il que chacun s’y soumette, quel que soit son statut ? Ou faut-il l’annuler ou la mettre entre parenthèses au motif qu’elle est devenue absurde ou dangereuse sur le plan strictement politique ? Dans un rapport publié juste, après l’élection de François Hollande à la présidence de la République, les animateurs de Terra Nova avaient abordé ce point délicat, pour conclure que, dans ce genre de situation, la décision de surseoir au scrutin pouvait être prise par un vote des seuls militants socialistes. Sur le papier, cette solution ne pose pas de problème dirimant, à la seule condition qu’elle fasse l’objet d’un large consensus interne. Un président sortant qui s’impose naturellement peut estimer que le passage par la case primaire porte atteinte à son autorité, et donc à sa crédibilité. Cela dit, que se passe- t-il lorsqu’il est contesté jusque dans son propre parti ? La primaire peut être alors considérée comme le seul moyen, pour lui, de se relégitimer et, pour son parti, de faire régler par d’autres une difficulté interne. En même temps, on voit bien qu’imposer pareille épreuve à un président sortant, même affaibli,ne coule pas de source. À quelle date organiser le scrutin ? Comment faire pour préserver, jusqu’au bout du mandat, la fonction présidentielle ? Comment le soumettre à des débats publics sur un pied d’égalité avec des concurrents qui sont – ou ont pu l’être – ministres sous sa direction ?
Pour conclure sur ce point, la primaire apparaît donc dans sa réalité concrète dès lors qu’on va jusqu’au bout de ce qu’elle suppose et entraîne. Pour fonctionner correctement, elle doit faire nombre. En cela, elle convient en priorité aux grands partis de gouvernement ou aux courants politiques capables de mobiliser de larges secteurs de l’opinion. Pour trouver sa véritable justification, elle doit aussi servir à sélectionner un candidat en lui offrant, d’entrée de jeu, un statut conforme à celui qu’il ambitionne. En cela, la primaire est d’abord faite pour les partis d’opposition. Dans un système politique qui reste bipolaire, au moins par sa capacité à produire des présidents crédibles, cette procédure est en train de devenir le mode de sélection des partis qui en ont le plus besoin. Une fois le PS, une fois l’UMP, mais jamais ensemble, sauf quand le président sortant jette l’éponge.
Quelle rénovation ?
Les promoteurs de la primaire de 2011 n’avaient pas pour seule ambition la mise en orbite d’un candidat suffisamment crédible et légitime pour devenir président. Ils voulaient changer la politique. Ils prétendaient que la procédure dont ils se faisaient les hérauts était d’une telle nouveauté que l’art de faire campagne puis de présider en serait bousculé et que les partis, inévitablement, trouveraient là les ressources de leur indispensable rénovation. La seule expérience de la primaire socialiste ne suffit pas à conclure sur ce plan. Les cultures, les réflexes, les enjeux sont trop différents, de part et d’autre de l’échiquier politique,pour que des lois uniques puissent être tirées aussi rapidement et de manière aussi catégorique. Pour autant, il n’est pas sans intérêt d’observer ce qu’a ou non produit la primaire de 2011. C’est à travers elle qu’on peut essayer de deviner ne serait-ce quele champ du possible.
Sans la primaire, François Hollande aurait-il mené une campagne différente ? La réponse est non. Le candidat socialiste espérait un mode de désignation qui soit incontestable. Il craignait que celui qu’avait imaginé son parti ne le soit pas. Il a reconnu, aprèssa victoire, que ses craintes n’étaient pas fondées. Et puis il a refermé le dossier avec la conviction que toute autre procédure, pourvu qu’elle soit victorieuse, lui aurait apporté le même surcroît de popularité. La primaire a été la formule à laquelle il s’est adapté pour acquérir une forme de légitimité et donc d’autonomie. Il se serait satisfait de toute autre – un simple vote militant, par exemple – qui produise un effet comparable. Bref, la primaire a servi François Hollande mais sans le changer. Dans sa gestion des équilibres internes, à gauche et au sein du PS, il n’aurait pas agi autrement s’il avait été désigné selon des modalités plus ordinaires. Leslois de la présidentielle dont il s’est inspiré ne sont pas celles imaginées par Terra Nova mais celles que ses prédécesseurs avaient explorées avant lui, à gauche comme à droite, quelles que soient les conditions de leur promotion. Pour le dire autrement, Ségolène Royal, en 2006, aurait sans doute utilisé à plein l’effet de souffle d’une primaire élargie aux sympathisants pour dynamiter encore davantage les cadres de son parti. François Hollande, lui, s’est servi de la primaire pour retrouver des modes d’action qui lui étaient familiers. L’organisation de la campagne, de même que les formes de mobilisation utilisées par le candidat, estrestée d’un très grand classicisme. L’utilisation faite par ses équipes des nouveaux moyens de communication, via Internet, ne doit pas grand-chose à la procédure des primaires. Elle l’a sans doute accompagnée. Mais pas davantage. Même le fichier des votants ayant accepté de laisser leur adresse mail n’a fait l’objet que d’un usage limité. Ce qui tend à prouver que la primaire offre sans doute au candidat désigné des armes nouvelles, mais qu’elle ne le contraint pas à les utiliser. Au-delà de la question du leadership, telle était pourtant l’une des hypothèses centrales des promoteurs de cet exercice lorsqu’ils célébraient notamment ce moment fondateur que fut, à leurs yeux, la campagne victorieuse de Barack Obama. Autre interrogation : la manière que François Hollande a de gouverner depuis 2012 a-t-elle un quelconque rapport avec les modalités de sa désignation comme candidat ? Bref, existe-t-il un président de primaire ? Le prétendre, c’est établir un lien direct entre la nature du corps électoral etle profil de celui qui est élu. C’est même faire remonter sur le corps électoral des sympathisants l’essentiel d’un baptême signant d’entrée de jeu l’identité du futur président. Là encore, l’expérience est trop mince pour que l’on puisse établir des lois définitives. Pour comprendre un président tel que François Hollande, il semble toutefois audacieux de convoquer l’épisode d’une primaire dont il n’a pas fait grand usage, si ce n’est d’en enregistrer le verdict. Si la question se pose, malgré tout, c’estque certains participants de cette compétition, une fois devenus ministres, ont évoqué une manière de contrat avec celui qu’ils auraient fait roi. Dans ce registre, Arnaud Montebourg a été le plus explicite. Mais un homme comme Manuel Valls l’a aussi fait à sa façon lorsqu’il prétend que la primaire est une expérience spécifique permettant de sélectionner non seulement le futur monarque mais aussi les barons du quinquennat à venir. Ainsi la primaire serait-elle créatrice de plusieurs sortes de leaderships, l’un principal, les autres secondaires, avec au bout du compte un président renforcé dans sa légitimité personnelle et en même temps, entouré d’un cénacle, sorte de conseil restreint au sein duquel il ne serait plus qu’un primus inter pares.
Cette thèse n’a d’intérêt qu’en raison de la personnalité de celui qui l’a soutenue avec le plus de force. Arnaud Montebourg, parce qu’il est à l’origine de l’expérience des primaires, n’était-t-il pas lemieux placé pour en décliner ensuite les effets et les lois ? À ce détail près que dire une intention n’est pas tout à fait la même chose que constater un résultat. L’espoir montebourgien – espoir déçu, au demeurant – signale surtout un possible que lespremiers promoteurs de la primaire avaient en tête mais dont rien ne permet de dire aujourd’hui le caractère mécanique. Si on y regarde de près, on constate d’ailleurs que, sur les cinq concurrents de François Hollande en octobre 2011, seuls trois ont ensuite été ministres et, surtout, que seuls deux d’entre eux ont sans doute dû leur promotion à leur participation à cette compétition initiale.
Mais, là encore, les liens directs de causalité restent à démontrer. Sous le règne de François Mitterrand, par exemple, Jean-Pierre Chevènement fut, à sa façon, l’ancêtre d’Arnaud Montebourg parce qu’il avait été un acteur décisif du congrès d’Épinay en 1971. Ce qui prouve que le statut d’«allié de référence» peut être acquis par des voies qui ne sont pas celles d’une primaire, au sens strict du terme. On retrouve là des règles de fonctionnement, y compris au sommet de l’État, dont toutsemble démontrer qu’elles tiennent plus aux mœurs socialistes qu’aux effets naturels d’un mode de désignation. Sans doute y a-t-il une cohérence entre ces mœurs et la procédure des primaires. Rien, en tout cas, ne permet d’affirmer pour l’instant qu’elle s’imposerait, à coup sûr, à d’autres acteurs venus d’autres horizons politiques.
L’effet primaire sur la campagne présidentielle puis sur le mode de gouvernance du nouvel élu est donc, on le voit, sinon faible, du moins aléatoire. Il peut éventuellement créer des habitudes. En aucun cas, il ne dicte de lois. Les promoteurs de cette procédure de désignation ont surestimé l’impact de la révolution démocratique qu’ils entendaient promouvoir dans le cadre inchangé des institutions de la Ve République. Dans leur esprit, il y en avait toutefois un autre qui, lui, devait bousculer les règlesde fonctionnement des partis politiques traditionnels. Quand on observe aujourd’hui les effets de la primaire sur les grands partis qui s’en sont saisis ou qui se préparent à le faire, il paraît évident que le changement attendu est bien au rendez-vous.
De là à considérer qu’il a le caractère espéré d’une rénovation, il y a toutefois une sacrée distance…
La primaire ouverte, celle qui s’adresse aux sympathisants, est un transfert de pouvoir. Être candidat à la présidentielle fut d’abord un choix personnel devant lequel les partis politiques s’inclinaient, à moins qu’ils s’y rallient. Puis ce fut un choix d’état-major, éventuellement ratifié par les militants. Enfin, ce fut, à gauche notamment, et au PS, en particulier, un privilège réservé aux encartés. La primaire façon 2011 signe donc un dessaisissement. Ceux qui, demain, imiteront ce modèle actionneront inévitablement de semblables ressorts. Le parti d’avant-garde – à gauche – et le parti du genre bonapartiste – à droite – ne peuvent que subir les conséquences de cette procédure qui les frappe dans ce qu’ils avaient de plus essentiel : la maîtrise exclusive de la sélection de leur champion pour le scrutin autour duquel se dessine l’ensemble du système politique.
On peut certes imaginer qu’au terme de ce processus, le sympathisant «réseauteur» vienne un jour se substituer au militant à l’ancienne et que la primaire, déclinée pour toutes formes d’élection, y compris locales, devienne ainsi le moment privilégié de son engagement. Mais pour l’instant, la dite «primaire» vient moins signer l’acte de naissance du parti postmoderne que l’arrêt de mort d’un type d’organisation à l’ancienne. Ou plutôt son suicide accompagné, tant il est vrai qu’en se résignant à cette procédure les partis patentés ont pris acte que leurs anciens privilèges, en abandonnant toute efficacité réelle, avaient perdu du même coup toute forme de légitimité. Derrière ce grand basculement, il y a la marque d’une individualisation croissante des attentes démocratiques. Plus prosaïquement, il y a là un attentat avéré contre ces corps intermédiaires que la Ve République a toujours combattus. La primaire, en ce sens, est un paradoxe détonant : celui de l’ultime ingérence du libéralisme culturel dans un système fondé sur la promotion de l’autorité.
Au-delà du parti, c’est le chef du parti qui voit ainsi son statut altéré. Au PS, par exemple, le premier secrétaire a longtemps été le candidat naturel à la présidentielle, dès lors qu’il s’agissait de préparer l’alternance. Gagner le congrès, c’était gagner le ticket d’entrée dans cette compétition. François Mitterrand, en 1974 et 1981, fut l’incarnation parfaite de ce mode de sélection d’essence partisane. Mais depuis que la primaire s’est progressivement imposée, d’abord sous sa forme militante puis dans un format plus ouvert encore, jamais un premier secrétaire n’a été en mesure d’imposer sa candidature. En 1995, Henri Emmanuelli a été sèchement battu par Lionel Jospin. En 2006, François Hollande a dû renoncer faute d’avoir su contrôler sa compagne de l’époque, Ségolène Royal. Il n’a eu sa revanche, en 2011, qu’après avoir abandonné, deuxans plus tôt, son titre de premier secrétaire au profit de Martine Aubry, celle-là même qu’il ira défaire dans un duel décisif.
On pourrait, certes, soutenir que l’existence d’un véritable leader à la tête d’une formation politique, reconnu et accepté comme tel, rend l’exercice de la primaire sinon inutile, du moins formel. Mais à partir du moment où celle-ci devient la règle, il est inévitable que s’organisent, en son sein, les candidats qui entendent y participer. Au PS où l’on est passé depuis longtemps de la logique des courants à celles des écuries présidentielles, le changement n’a été que minime dans des stratégies individuelles de conquêtes du pouvoir qui placent le premier secrétaire dans une position encore plus inconfortable qu’auparavant. Dans les partis de droite dotés d’une tout autre culture, l’exercice, en revanche, ne peut conduire qu’à de plus grands changements et, à cetitre, à des perturbations accrues. Conçue pour rénover le PS, la primaire le conforte dans ses traditions qui ne sont pas forcément les meilleures et dont on voit bien comment elles pourraient devenir, demain, celles d’une UMP échappant définitivement à son monolithisme.
La primaire bouscule l’ensemble du système politique par le bas. C’est en cela que ce mouvement qu’elle suscite est profond. Dans l’exercice du pouvoir d’État, il n’a pas encore produit d’autres effets que la consolidation d’habitudes ou de modes de comportement anciens. Mais au fur et à mesure que cette procédure va s’imposer comme le mode de sélection naturel des candidats à la présidentielle, on assistera immanquablement à une uniformisation des postures et des rôles. Celle-ci va d’abord modifier les règles de la vie partisane, surtout à droite. À terme, elle va transformer les conditions dans lesquelles se fabrique un président, avec des conséquences aussi puissantes, sur le rythme et la nature du mandat, que le fut hier le passage du septennat au quinquennat.
Dans cette révolution à bas bruit, rien n’est encore gravé dans le marbre. La primaire socialiste de 2011, pourtant, a déjà installé des profils de candidature qui se diffusent alors même que celle de l’UMP n’est pas encore définitivement installée. C’est dire combien, dans ce genre d’exercice, la première fois est sinon la meilleure, du moins celle qui laisse les souvenirs les moins évanescents. Qui sera, demain, le nouveau Valls dès lors qu’on sait que, sur un créneau étroit – ad augusta, per augustam ! –, onpeut grimper au septième ciel ? Qui sera le nouveau Montebourg, dès lors qu’on sait aussi la dynamique perturbatrice d’uneprise de risque sur des thématiques à la fois classiques et revisitées ? Qui sera même le nouveau Baylet, dès lors qu’on a vu avec lui que participer, fut-ce pour ne rien récolter, c’est exister encore ? La liste n’est sans doute pas définitive de ces rôles-titres que la primaire permet d’expérimenter sur une scène politique en pleine transformation. À travers ceux que l’exercice de 2011 a déjà installés, on voit apparaître une nouvelle distribution dans laquelle le chef de parti peut être aussi bien souffleur que metteur en scène. Elle multiplie, par ailleurs, le nombre des jeunes premiers. Pour eux, la primaire, c’est la présidentielle du pauvre, celle qui permet d’entrer dans la troupe, puis de figurer à l’affiche sans pour autant prétendre au premier rôle. Cette logique de casting, loin de toute ambition généraliste, crée des outsiders dont la vocation est de poursuivre, dans la même veine, au sein du gouvernement. C’est peu, compte tenu des ambitions premières des promoteurs de la primaire. C’est faible, au regard de ce qu’exige un système politique qui crève précisément de trop de segmentations, sur fond de technocratie galopante. C’est pourtant ce vers quoi conduit tout droit cette révolution tranquille qui redistribue les cartes sans modifier la logique des institutions alors qu’elle changera, plus vite qu’on l’imagine, le profil, les réflexes et les hiérarchies des futurs présidents.

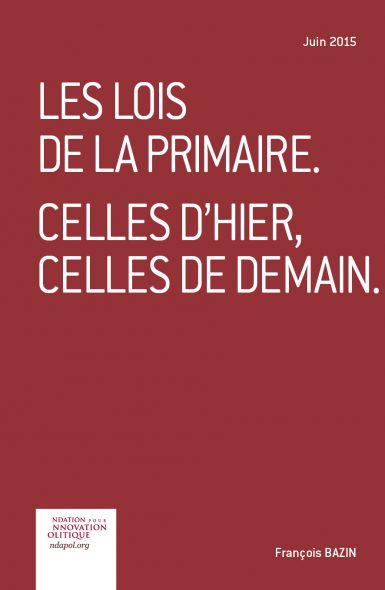


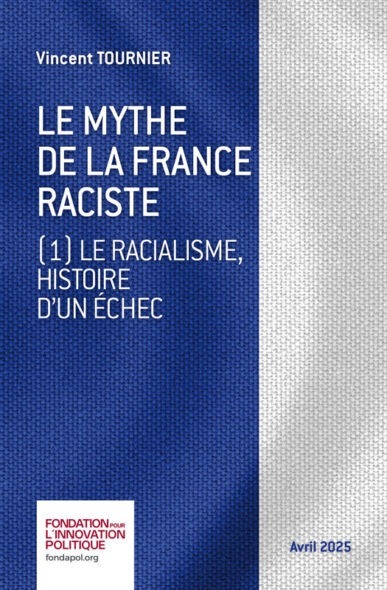









Aucun commentaire.