Introduction
Signification de la laïcité et de l’espace public sous la Vè République
première approche de la laïcité de l’État
Les trois sens de la notion de laïcité
La compétence de l’État neutre pour conduire une politique publique du fait religieux au nom de l’intérêt général
Position du problème et problématique
La signification du principe de neutralité en droit public français
Neutralité de l’État et renforcement du bien-être social de la population et de la cohésion nationale : l’État peut-il participer à la formation des imams ?
L’ajustement des instruments juridiques et institutionnels pour une gestion publique du fait religieux
Résumé
La présente note s’interroge sur la possibilité d’une politique publique de gestion du fait religieux en contexte laïc. Bien évidemment, une telle politique doit en premier lieu respecter le cadre juridique de la laïcité et tendre à la protection des libertés fondamentales. Toutefois, en tant que garant de l’intérêt général, l’État doit également tenir compte de ces forces sociales, à la fois mouvantes et puissantes que sont les religions, afin d’éviter que ces dernières ne constituent un instrument d’affaiblissement de l’État. Au contraire, les autorités étatiques doivent s’efforcer de mener une politique, sans remettre en cause la portée juridique du principe de laïcité, leur permettant de manière constante de tendre au renforcement du « bien-être social de la population ».
Au nom de cet objectif, ces autorités doivent nouer avec les collectivités religieuses un dialogue construit et institutionnalisé. S’il ne s’agit pas de renouer avec le gallicanisme napoléonien, il importe néanmoins de ne pas affaiblir l’État et de lui donner les moyens d’une réelle régulation institutionnelle et juridique des tensions internes qui peuvent se manifester au sein de la société dont il a la responsabilité. L’enjeu, en cette période de tensions récurrentes sur le plan international, comme interne, est donc d’importance.
Thierry Rambaud,
Professeur des Universités (Sorbonne Paris Cité-Paris Descartes). Ancien membre de la Commission de réflexion juridique sur les rapports entre les pouvoirs publics et les cultes auprès du ministère de l’Intérieur de 2005 à 2006.

La religion dans les affaires : la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise)

La religion dans les affaires : la finance islamique
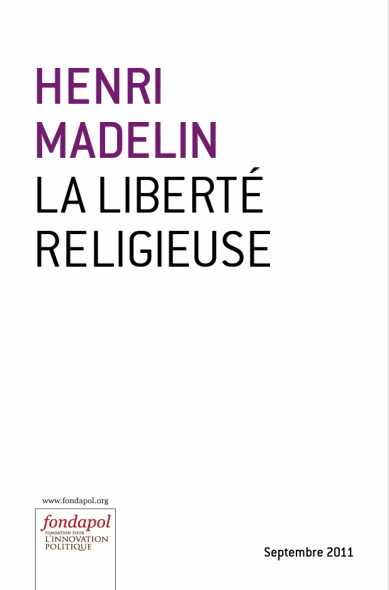
La liberté religieuse

Où va la politique de l’Église catholique ? D’une querelle du libéralisme à l’autre

L'humanisme et l'humanité en islam

Islam et démocratie : les fondements

Le soufisme : spiritualité et citoyenneté

Les femmes et l'islam : une vision réformiste

Islam et contrat social
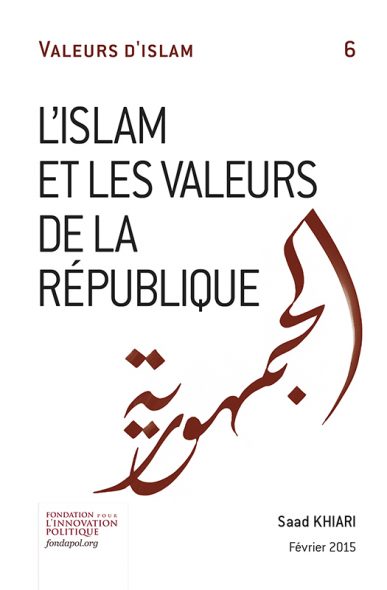
L'islam et les valeurs de la République

Éducation et islam
Introduction
Association du corps préfectoral, La République laïque : toujours et pour toujours ? acte du colloque Claude- Érignac, 15 septembre 2016, p. 86
Ibid., p. 87.
Franck Frégosi (dir.), Bruno Étienne. Le fait religieux comme fait politique, L’Aube, 2009.
La perspective ici retenue est celle de l’analyse des politiques publiques et du droit Nous avons conscience de l’importance de ce sujet en philosophie politique, notamment chez Hobbes ou chez Hegel, qui ont consacré des développements majeurs à ces thèmes. Nous les avons à l’esprit lorsque nous défendons l’idée que l’État est celui qui transcende les conflits religieux des citoyens et régule les tensions au sein de la société. Seulement, notre point de vue dominant n’est pas celui de la pensée politique mais davantage celui de la gouvernance institutionnelle.
Jean-Gustave Padioleau, L’État au concret, PUF, 1982, 25.
John Kingdom, Agendas, Alternatives, and Public Policies, Longman, 1984, p. 114 , cité dans l’article d’Elizabeth Sheppard, « Problème public (définition) », Dictionnaire des politiques publiques, sous la direction de Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet, Presses de Sciences Po, 2014.
Voir Manuel Valls, « Reconstruire l’islam de France », tribune parue dans Le Journal du dimanche, 31 juillet 2016.
Voir Gérald Darmanin, « Plaidoyer pour un Islam français. Contribution pour la laïcité », 7 juin 2016.
Bertrand Badie et Pierre Birnbaum, Sociologie de l’État, Grasset,
Voir Robert Putnam, avec Robert Leonardi et Rafaella Y. Nanetti, Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, 1993.
Pierre Manent, « Crise de l’État, crise de la politique », Liberté politique, n° 6, automne 1998, 99 et 101-103.
Sur la notion de « dialogue », voir notamment Bérengère Massignon, Des dieux et des Religions et laïcités face au défi de la construction européenne, PUR, 2007, p. 234-236.
Jean-Pierre Machelon (dir.), Les Relations des cultes avec les pouvoirs publics, rapport au ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, La Documentation française, septembre 2006. Le rapport comporte cinq chapitres : les lieux de culte (chap. I), le support institutionnel de l’exercice du culte (chap. II), la protection sociale des ministres du culte (chap. III), la législation funéraire (chap. IV) et les régimes particuliers à certains territoires (chap. V). Il rappelle également que la loi de 1905 a été modifiée à treize reprises depuis son adoption (p. 14, note 1).
La laïcité ne cesse jamais de revenir sur le devant de la scène. Peut-être même, est-ce l’essence du principe de laïcité que d’ouvrir un dialogue qui ne se refermerait jamais. Il serait le contraire d’un principe clos dans lequel les portes de l’interprétation se seraient fermées.
Dans un important colloque de l’Association du corps préfectoral, qui s’est tenu en 2016, Régis Debray, intervenant en qualité de grand témoin, notait au sujet de la laïcité de l’État : « Le terme de “cadre” me semble être le plus fondamental. Il permet de faire tenir debout une construction juridique complexe. Ce cadre est constitué par l’État, dont Mesdames et Messieurs les Préfets, vous êtes les représentants. L’État est le dernier bien de ceux qui n’en ont pas, l’ultime garant de la solidarité entre les pauvres et les riches, et de l’égalité entre hommes et femmes1 ». Régis Debray mettait ici l’accent sur une dimension fondamentale : concernant la gestion des religions en République laïque, l’État peut-il se contenter uniquement d’être un « cadre » ou doit-il être plus ? Il ajoutait : « La version française de la laïcité a deux adversaires intérieurs : un État qui se renonce et un État qui s’exagère2 ». Entre les deux extrémités, il existe l’État qui respecte, mais qui agit également, car il a conscience qu’il est essentiel de relier la manifestation publique et sociale des religions à la réalisation de l’intérêt général dont il exerce la responsabilité.
L’idée générale, qui sous-tend notre étude, est que les religions constituent autant des facteurs de cohésion et de progrès social que de déstabilisation et de violence dans nos sociétés contemporaines. Elles sont tout à la fois génératrices d’harmonie et de division sociales, ainsi que, par voie de conséquence, objet d’appréhension par le pouvoir politique. Le fait religieux constitue en effet un « fait politique », pour reprendre les termes du titre d’un volume paru en 2009 en l’honneur de Bruno Étienne3, ou encore un « problème public », au sens de la littérature sur l’analyse des politiques publiques4. Quoi qu’il en soit, le « fait religieux » ne peut se résumer, pour le publiciste, à une garantie des libertés publiques en matière religieuse.
la notion de « problème public »
La notion de « problème public », bien qu’intuitivement aisée à saisir, n’est en réalité pas simple à définir dans la mesure où elle renvoie davantage au produit d’un processus de problématisation qu’à un fait objectif. En effet, aucun « problème politique » n’existe a priori. Que nous enseigne la littérature politiste à ce sujet ? Selon Jean-Gustave Padioleau, le problème public renvoie à un sujet qui « appelle un débat public, voire l’intervention des autorités publiques légitimes5 ». John W. Kingdom avance, pour sa part, qu’un problème politique existe quand les citoyens commencent à penser que « quelque chose peut être fait pour changer la situation6 ». C’est ici tout le paradoxe : comment peut-on expliquer que le sujet de la gestion du fait religieux entre dans la sphère publique, alors que l’on pensait, depuis longtemps, qu’il s’agissait d’un acquis de la modernité politique que de considérer que la croyance religieuse relevait avant toute chose de la sphère privée ?
Pour être publicisé un problème doit en effet faire appel aux compétences des autorités publiques ainsi qu’à un débat public. Or il est devenu incontestable que le fait religieux s’impose dorénavant à ces autorités.
actualité du sujet
Cette irruption se fait malheureusement de manière inopportune. Le libre exercice du culte rencontre actuellement un certain nombre de difficultés dans notre pays : les personnes de confession juive ne se sentent plus en sécurité lorsqu’elles se rendent à la synagogue, tandis que la visibilité, même pacifique, de la religion musulmane dans l’espace public est source de nombreuses contestations – la société française peut s’enflammer à la simple vue d’un burkini sur une plage du sud de la France – et que l’extraordinaire patrimoine religieux de la France n’est pas suffisamment protégé – des églises, véritables joyaux historiques, subissent des dégradations déplorables.
Ce sujet a pris une acuité renouvelée lors des récents événements tragiques qui ont frappé la France en 2015. Plusieurs propositions ont alors été émises et ont, pour l’essentiel, concerné l’islam. On songe notamment à celle de l’ancien Premier ministre Manuel Valls, qui suggérait l’organisation de l’islam de France comme l’une des réponses à la guerre qui se joue sur le front des attentats7. Déjà, dans un travail remarqué, le député maire de Tourcoing Gérald Darmanin avançait l’idée que l’État devrait faire avec l’islam ce qu’il avait réalisé, dans le passé, avec les religions catholique et juive8. Ces propositions traduisent une volonté d’apporter des solutions à un sujet qui est en train, pour reprendre une expression familière, de « monter » très vite. On regrettera seulement le lien ainsi établi entre la réponse à des attentats dramatiques et le sujet de l’organisation juridique d’un culte : pourquoi s’en tenir à une conception strictement sécuritaire de la gestion des cultes dans notre espace public ?
politique publique religieuse et État fort
Cette confusion est singulièrement regrettable et pourrait être aisément évitée si l’on admettait qu’adopter une politique de gestion publique du culte constitue une nécessité pour un État. C’est ce que relevait déjà Louis Canet (1883-1958), conseiller du ministère des Affaires étrangères pour les affaires religieuses de 1920 à 1946, puis conseiller d’État, qui considérait qu’un État qui n’a pas de politique ecclésiastique constitue un État faible. En ce qui nous concerne, le point de départ de notre réflexion réside dans le maître ouvrage de Pierre Birnbaum et de Bertrand Badie, La Sociologie de l’État, paru en 19799. Les auteurs font état d’une distinction capitale entre « États forts » et « États faibles ». Nous privilégierons ici la grille de lecture qu’en a proposée Robert Putnam10, celle de l’analyse de l’État fort en termes de « performance institutionnelle », c’est-à-dire l’évaluation de la performance qui prend en considération la capacité de l’État à s’imposer au sein de la société.
En ce sens, on définira l’État fort comme celui qui se révèle apte, au nom de l’intérêt général, à s’imposer dans une société caractérisée par des tensions sociales et religieuses vives. Pour dire les choses simplement, ce type d’État doit constituer la référence partagée par tous car il est la « chose commune » à tous. En aucune manière, il ne saurait être en concurrence avec d’autres forces sociales ou religieuses pour la détermination d’une loi commune à l’ensemble des citoyens. Seul l’État définit cette dernière, c’est-à-dire celle qui assure, pour reprendre la terminologie de la Cour européenne des droits de l’homme, l’« être-ensemble » de tous les citoyens quelle que soit leur religion. Ceci implique que l’État se donne des objectifs clairs en la matière, identifie les acteurs de la mise en œuvre de sa politique et s’en donne les moyens institutionnels et politiques. Un tel schéma ne saurait naturellement rompre avec le principe constitutionnel de laïcité qui doit rester la charte juridique de la République dans les domaines religieux et institutionnel. On entend à ce stade de nos développements par « État laïc », l’État qui ne professe aucune confession déterminée, qui ne favorise ni ne discrimine aucune religion et qui assure l’égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur religion, devant la loi. Il s’agit de l’État neutre sur le plan confessionnel.
Quels sont alors les objectifs que doit se fixer un tel État ? La problématique en a été parfaitement résumée par Pierre Manent : « La question, c’est l’État en tant qu’instrument du politique. Nous avons aujourd’hui des États sans tête […], mais qui ont perdu leur articulation avec un projet politique. Nous sommes dans un interrègne entre l’État-nation qui a perdu le mandat du ciel, mais qui reste à certains égards un instrument indispensable, et une Europe qui ne me paraît pas destinée à proposer réellement un autre instrument politique, une autre communauté politique, susceptible de résoudre nos problèmes11 ».
les objectifs d’une politique publique du fait religieux
Fort de ce constat, il importe à présent d’identifier, du point de vue de l’État, les objectifs d’une politique publique du fait religieux, à savoir :
- assurer le libre exercice des cultes sur son territoire : la France est un pays de liberté et elle doit le rester ;
- vérifier que les activités cultuelles ne portent pas atteinte à l’ordre public au sens matériel de la protection, de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques ;
- veiller à ce que les cultes contribuent au renforcement du bien-être social de la population et à celui de la cohésion nationale au sein de l’espace
Réaliser ces objectifs implique, pour reprendre la terminologie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la réalisation d’un « dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Églises et organisations12 ». Les Églises apparaissent ainsi comme des institutions à part entière du processus de concertation européen13. Le droit de l’Union européenne institutionnalise ces relations entre les institutions européennes et les mouvements et organisations confessionnels. Le dialogue représente une première étape. Il se doit d’être institutionnalisé, c’est le seul moyen pour lui de réunir les caractéristiques que l’on a rappelées. En dialoguant, chacune des deux instances défend des points de vue qui peuvent être conciliables ou non mais qui, à tout le moins, doivent correspondre aux objectifs que se fixent ces acteurs. C’est ainsi que l’État « entre en dialogue » pour renforcer le caractère inclusif de la société dont il a la responsabilité. C’est lui qui est en charge du « tout social ». Ceci implique qu’il échange avec les religions en vue de renforcer le lien social et la cohésion nationale, tout en restant dans le cadre constitutionnel laïc. C’est à lui de veiller à ce que, au sein de l’espace public, les religions contribuent à la réalisation de l’intérêt général sans constituer des activités de service public. Telle est la thèse soutenue dans cette note.
Pour défendre cette idée, notre analyse s’articule en trois temps, liés les uns aux autres :
- définir le cadre, c’est-à-dire la signification de la laïcité de l’État et de l’espace public sous la Ve République ;
- fonder la légitimité de l’intervention de l’État, qui doit percevoir dans les religions des leviers de renforcement de la cohésion nationale, sans évidemment aller jusqu’à adopter le modèle napoléonien du droit concordataire et des cultes organiques ;
- déterminer les instruments et dispositifs institutionnels pertinents d’une nouvelle régulation du fait religieux qui permettraient de contribuer à la réalisation de l’intérêt général.
Ces thèmes renvoient tous à la nécessaire réalisation de la « performance institutionnelle » de l’État, qui doit réguler le fait religieux afin d’apaiser les tensions au sein de la société civile et permettre la coexistence pacifique des différentes religions, des croyants et des non-croyants. La présente étude se conclura par la formulation de propositions institutionnelles et juridiques. Précisons cependant que notre intention n’est pas de réfléchir à l’éventualité d’une nouvelle révision de la loi du 9 décembre 1905, tant ce sujet a été traité par les travaux de la commission sur les relations des cultes avec les pouvoirs, dite commission Machelon, qui a remis son rapport au ministre de l’Intérieur en 200614.
Signification de la laïcité et de l’espace public sous la Vè République
Nous reprenons une partie de ces développements de l’article « Laïcité » que nous avons donné au Dictionnaire encyclopédique de l’État, sous la direction des professeurs Pascal Mbongo, François Hervouët et Carlo Santulli, Berger-Levrault, 2015.
Les travaux ne manquent pas sur l’origine et la signification de la laïcité. Les points de vue se croisent bien souvent, voilant plus que de raison ce qu’elle signifie dans le champ juridique. L’on ne sait plus véritablement si elle est détermination d’un cadre juridique ou fondation d’un projet sociétal issu des combats politiques des XIXe et XXe siècles. Notre point de vue s’avère ici simple à énoncer : que signifie la laïcité et qu’autorise-t-elle aux pouvoirs publics en charge de l’intérêt général et du bien-être social de la population ?
Fruit d’une évolution longue et complexe, la laïcité de l’État, qui ne prend son sens qu’au regard de la longue durée historique, ne constitue pas une valeur universelle qui serait partagée, dans le temps et dans l’espace, par l’ensemble des systèmes politiques et constitutionnels dans le monde. Notion polysémique, elle invite à une mise en perspective et à une différenciation des divers sens auxquels elle est susceptible de donner lieu15.
première approche de la laïcité de l’État
Voir Jacques Robert, La Liberté religieuse et le régime des cultes, PUF, 1977.
Sur ce sujet, voir Sélim Jahel, La Place de la Chari‘a dans les systèmes juridiques des pays arabes, Éditions Panthéon Assas, 2012.
Ibid, p 24.
Voir Michel Troper, « French Secularism or Laïcité », Cardozo Law Review, 21, n° 4, février 2000, p. 1267- 1284.
Voir Jean Rivero, La Notion juridique de laïcité, Dalloz, 1949.
Parmi les standards de bonne gouvernance publique mondiale, au cœur de ce droit constitutionnel global en cours d’élaboration, qui tendent à s’imposer aux rédacteurs des nouvelles Constitutions, figurent le respect de l’État de droit, des droits de l’homme, du principe de prééminence du droit ou encore des exigences de transparence et de responsabilité. On n’y trouvera pas néanmoins le principe de laïcité. Et pour cause. Il ne s’agit en aucune manière d’un principe universel dans la mesure où la laïcité reste souvent présentée comme un attribut de la conception occidentale du pouvoir qu’il serait illusoire de vouloir exporter dans d’autres régions ou d’autres aires culturelles dans le monde. Le terme « laïcité » a des origines diverses. Pour certains historiens anglais, le mot laicization signifie la montée du pouvoir des laïcs, celui des rois et de leurs conseillers, qui prennent le contrôle de l’Église d’Angleterre. En France, aux XIXe et XXe siècles, des auteurs, comme Ferdinand Buisson (1841-1932) et Émile Durkheim (1858-1917), ont conçu la laïcité à partir d’un processus historique plus brutal. On distinguerait ainsi le processus de sécularisation de celui de laïcisation. Quoiqu’il en soit, au cours des siècles, une évolution générale vers la laïcisation, entendue au sens large, s’est opérée, pour aboutir à l’instauration de l’État laïc.
Sur le plan institutionnel, il importe de relever qu’il subsiste encore des États théocratiques ou quasiment théocratiques, ou encore des États qui accordent un statut particulier à une religion. Jacques Robert distinguait ainsi, en matière de relations entre les cultes et l’État, trois formules : les fusions, les unions et les séparations16.
Parmi les modèles de fusion se trouvent des États théocratiques, comme l’Arabie saoudite ou l’Iran. Dans ces deux pays existe une imbrication du religieux et du politique qui se traduit ainsi par la mise en œuvre d’un système théocratique. Produit direct du rôle qui échoit à la charia, la fusion du religieux et du politique couvre tous les domaines de la vie institutionnelle, sociale et économique17. Il en découle certains objectifs, qui ont été notamment énoncés par le roi d’Arabie saoudite dans son message à la nation accompagnant la promulgation du statut organique du royaume en 1992 : « La foi en un Dieu unique, l’application de la charia, la prédication, l’assainissement moral de la société, la renaissance et le développement des voies de l’islam, la consultation [choura], qui est le mode de gouvernement recommandé par Dieu, la protection des Lieux saints et, enfin, la défense de la religion, de la patrie et de l’État18 ».
À côté des États théocratiques, il existe nombre d’États qui confèrent un statut particulier à une religion déterminée, qu’il s’agisse de la religion catholique (Monaco), du protestantisme (Danemark) ou de l’islam (Égypte). Ce sont les formules d’unions qu’évoque Jacques Robert. La seule prise en compte d’un critère organisationnel est néanmoins contestée par Michel Troper, qui propose d’y ajouter un critère d’ordre fonctionnel, celui de la diffusion ou non de valeurs. Un État peut être séparé des cultes sans être totalement neutre sur le plan axiologique. C’est le cas de la République française qui, sous la IIIe République, entendait conférer une valeur positive à la morale laïque19. Dans ce schéma, la laïcité ne se réduit plus à constituer le cadre juridique d’exercice des activités cultuelles, mais tend à couvrir un projet plus global de nature morale. Dans ce cas, la voie est ouverte au laïcisme.
Dans de nombreux États, le statut particulier conféré à la religion produit un certain nombre de conséquences juridiques qui viennent heurter le principe de neutralité confessionnelle de l’État. Or c’est par ce dernier qu’il paraît opportun d’appréhender la notion juridique et politique de laïcité. L’exercice est délicat. Le mot « laïcité » présente en effet de singulières difficultés qui expliquent les nombreux usages auxquels il peut donner lieu. Une des raisons est liée à ce qu’il relève de champs disciplinaires et sémantiques très différents : philosophie, sociologie, science politique ou encore droit. Dans ce dernier domaine, si le mot a pu « sentir la poudre » (Jean Rivero), il constitue désormais, selon la littérature juridique dominante, un synonyme de « neutralité confessionnelle » de l’État. Encore à l’époque contemporaine, il est possible de souscrire à l’analyse claire de Jean Rivero20. Cette vision nécessite néanmoins de s’interroger sur la portée exacte du concept de « neutralité de l’État » dans le champ du droit public : s’agit-il d’une neutralité « active » ou, au contraire, d’une démarche plus passive qui traduirait un rapport d’abstention entre l’État et le fait religieux ? C’est une conception active de la neutralité qui sera ici privilégiée au nom de la responsabilité de l’État comme garant de l’intérêt général. C’est en effet au nom de la « cohésion nationale » et de la nécessité de transcender, et ainsi de dépasser les tensions internes qui se développent au sein de la société civile que l’État doit adopter une conception active de la neutralité.
Les trois sens de la notion de laïcité
Martin Heckel, « Zur Ordnungsproblematik des Staatskirchenrechts im säkularen Kultur- und Sozialstaat », Juristen Zeitung, n° 9, 6 mai 1994, p. 425-476.
Voir Santi Romano, L’Ordre juridique, Dalloz, 1975.
Axel von Campenhausen, de Wall, Staatskirchenrecht, Juristische Kurz-Lehrbücher, 2006, 4ème édition.
À ce sujet, voir Pierre-Henri Prélot, « La religion dans les Constitutions françaises. De la Constitution civile du clergé à la laïcité constitutionnelle (1789-1958) », in Samim Akgönül (dir.), Laïcité en débat. Principes et représentations en France et en Turquie, Presses universitaires de Strasbourg, 2009, 79-116.
Trois sens identifiables peuvent être subsumés dans cette catégorie juridico- politique qui est celle de la laïcité de l’État :
- la laïcité caractérise l’État qui ne professe ni ne favorise ou discrimine aucune religion particulière ;
- la laïcité caractérise l’État dont l’ordre juridique présente un haut degré d’autonomie par rapport aux règles juridiques religieuses ;
- la laïcité caractérise une formule particulière de relations des religions avec l’État que l’on appelle en général « séparation stricte ».
Si ces trois définitions ne sont pas synonymes, elles se superposent en général d’un point de vue pratique : un même État répondra simultanément aux trois critères. Ce n’est néanmoins pas une obligation juridique. Prenons un exemple simple : l’Alsace-Moselle, qui connaît encore un régime juridique des cultes reconnus, est néanmoins régi par le principe constitutionnel de laïcité, sur le fondement de l’article 1 de la Constitution française de 1958, et par le droit français, qui s’avère d’essence laïque, en ce sens que les règles qu’il énonce ne sont en rien guidées par des prescriptions religieuses.
a) l’absence de doctrine confessionnelle ou philosophique professée par l’État
En premier lieu, la laïcité-neutralité confessionnelle de l’État s’apparente à une absence de doctrine confessionnelle ou philosophique professée par l’État. Celui-ci ne se revendique d’aucune doctrine, confessionnelle ou philosophique. À cet égard, la laïcité de l’État se distingue du « laïcisme », qui s’analyse comme une philosophie radicalement antireligieuse, en ce qu’elle vise à combattre non seulement le rôle public et social des religions, mais également les religions en elles-mêmes, dès lors que l’on admet que celles-ci ne sauraient se réduire à la seule conscience de la personne humaine, c’est-à-dire ne relever que de son « intime conviction ». L’État laïc se définit comme « la communauté politique d’appartenance de tous les citoyens » quelles que soient leur religion ou leur conviction. Un tel projet rejoint celui développé en France par les auteurs et publicistes, que l’on appelait les Politiques et qui ont inspiré l’Édit de Nantes de 1598. Ces derniers, dans leur projet, développent un « concept formel de paix » (E-W Böckenförde dans l’article cité) destiné à pallier les nombreuses guerres civiles et confessionnelles qui se déroulaient en France au XVIe siècle.
Ce concept de paix et de pacification doit conduire l’État à privilégier en permanence la tranquillité publique, extérieure comme intérieure. Dans cette perspective, du point de vue de l’État, les questions de vérité religieuse passent au second plan au profit d’une affirmation de l’autorité de la décision politique. Le roi, sur le plan religieux et confessionnel, est cantonné dans le rôle d’une instance neutre et de modération. Il se doit de veiller au bon ordre et à la sécurité publique dans l’intérêt du royaume sans se préoccuper de la question d’une vérité religieuse. La conversion du roi Henri IV au catholicisme est de ce point de vue exemplaire, car elle obéit à des considérations de raison politique et de conduite des affaires de l’État. Ce sont ces mêmes considérations qui ont conduit à l’adoption de l’édit de Nantes en 1598, qui reconnaissait à un individu le droit d’être citoyen du royaume, de jouir de l’ensemble des droits civils sans appartenir à la « vraie religion ». De ce point de vue, la révocation de l’édit de Nantes en 1685 peut s’analyser comme une erreur politique majeure au regard de l’histoire longue de l’État et du processus d’autonomisation de la sphère politique par rapport à la religion.
C’est ainsi que l’on peut considérer qu’à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle se met en place la problématique d’un « État déthéologisé » et donc « rationnel ». Cependant, comme le rappelle le professeur Martin Heckel21, force est de reconnaître que cette déconfessionnalisation s’accompagnera pendant longtemps d’un maintien de la subordination de l’Église à la souveraineté de l’État (Staatskirchenhoheit), auquel seule la reconnaissance de la séparation des cultes et de l’État mettra un terme.
b) le degré d’autonomie de l’ordre juridique par rapport aux prescriptions religieuses
En deuxième lieu, la laïcité de l’État renvoie au degré d’autonomie de l’ordre juridique par rapport aux prescriptions religieuses. On distinguera ainsi un « droit laïc » d’un « droit religieux », le mot « droit » renvoyant ici à la notion de tradition juridique. C’est le degré d’autonomie d’un ordre juridique, notamment dans ses fondements, par rapport aux doctrines religieuses qui est en l’espèce pris en considération. Sur une telle base, il est concevable de distinguer la tradition juridique dite laïque, dont relèvent les traditions de common law et romanistes, et les traditions juridiques religieuses, parmi lesquelles se trouvent le droit musulman, le droit hébraïque, le droit hindou, mais également le droit canonique. À ce stade, une précision s’impose : la conception, retenue dans cette note, s’inspire des travaux de l’école institutionnaliste de Santi Romano22. Selon cette école, toute institution est susceptible de produire du droit. Il existe ainsi, à côté du droit étatique, d’autres ordres juridiques dont l’existence et l’effectivité ne sont pas conditionnées par une reconnaissance étatique. Ce constat ne doit néanmoins pas occulter le fait que, dans de nombreux ordres juridiques étatiques, il est accordé une pleine valeur de droit positif à des règles religieuses. Il suffit de songer aux règles du statut personnel en Égypte, en Israël ou au Liban. L’État apparaît comme le garant d’un pluralisme normatif qui articule tradition juridique laïque et traditions juridiques religieuses.
c) la laïcité et le principe de séparation des cultes et de l’État
Dans une dernière acception, la laïcité qualifie un régime juridique particulier de séparation des cultes et de l’État, caractérisé principalement par une volonté de cantonner les activités et les règles religieuses dans le champ du droit privé. Nous avons eu l’occasion de montrer que les principes de laïcité et de séparation des cultes et de l’État ne se recoupaient pas totalement, dans la mesure où la séparation n’était pas en tant que telle antinomique avec le recours à des concepts de droit public, comme l’illustrent les modèles allemand et autrichien de relations entre les cultes et l’État. Ces derniers constituent des modèles de « séparation-coopération » caractérisés par le recours à des techniques juridiques de droit public destinées à souligner le rôle social des collectivités sociales dans l’espace public. Tel est notamment le cas du recours au statut de corporation de droit public ou au droit conventionnel. Or si le droit allemand des relations entre les collectivités religieuses et l’État relève de la catégorie juridique de « séparation », il ne constitue pas en revanche un modèle laïc au sens que la doctrine majoritaire s’accorde généralement à donner à ce terme23.
Revenons à présent au modèle français de laïcité et à sa signification en droit constitutionnel. L’inscription du mot « laïcité » dans la Constitution française remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à l’élaboration de la nouvelle Constitution de 1946 qui proclame le caractère laïc de la République. En 1958, la formule adoptée en 1946 a été transposée en tant que telle dans le texte de la nouvelle Constitution, à l’article 2, devenu, à la suite d’une révision constitutionnelle en 1995, son article 1. À cette reconnaissance de la laïcité sont ajoutées les deux phrases suivantes : « Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Il conviendra donc, désormais, d’interpréter la laïcité à la lumière de ces deux principes de l’égalité et du respect des croyances religieuses, c’est-à-dire fondamentalement comme l’affirmation de la neutralité religieuse de l’État24.
De ces échanges ainsi brièvement résumés, et à la lumière de ce que montre un siècle et demi d’histoire constitutionnelle, il apparaît que le principe constitutionnel de laïcité revêt un double sens :
- d’une part, il définit ce qu’on peut appeler le statut confessionnel de l’État, caractérisé désormais par sa neutralité idéologique et organique à l’égard de toutes les L’État n’a pas de religion, n’en favorise aucune et n’en sollicite aucune à son soutien ;
- d’autre part, il énonce les principes fondamentaux du régime juridique des religions en droit français, tels qu’ils ont été aménagés par la loi de 1905.
C’est ainsi que dans sa décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantit le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte ». En résumé, en droit public français, le principe de laïcité garantit la neutralité de l’État, le respect de toutes les croyances devant la loi, le respect du libre exercice des cultes, ainsi que l’impossibilité de salarier l’exercice d’un culte, sous réserve du maintien en vigueur du droit local alsacien-mosellan des cultes garanti dans la même décision.
Autrement dit, ce simple mot de « laïcité » inscrit dans la Constitution revêt une importance fondamentale du point de vue de la définition même du statut constitutionnel de l’État républicain, au même titre que son « caractère unitaire », son caractère de « République sociale ». À cet égard, on saisit les différences pouvant exister entre le modèle français de « laïcité » et la séparation des Églises et de l’État aux États-Unis. Cette dernière repose sur la « clause de non-établissement » (establishment clause) du premier amendement à la Constitution américaine. Cependant, la séparation américaine ne se réduit pas à cette seule dimension mais inclut également le principe constitutionnel de libre exercice du culte (free exercice clause). Ce dernier est au fondement de cette vitalité religieuse américaine qu’évoquait déjà Alexis de Tocqueville. Le dynamisme des institutions religieuses est un des facteurs explicatifs du fonctionnement de la société américaine. On ajoutera également que cette clause constitutionnelle fait l’objet, en lien avec la clause de non-établissement, d’une jurisprudence riche de la Cour suprême des États-Unis.
Cette vision institutionnelle doit être complétée par une approche sociologique : en effet, sur un plan extrajuridique, le facteur religieux tient un rôle plus important dans l’espace public et social américain que dans l’espace français. Cette reconnaissance permet de comprendre cette « religion civique » à l’américaine qui semble imprégner le fonctionnement des institutions américaines et dont on trouve les fondements philosophiques dans la pensée des Pères fondateurs. La foi est omniprésente dans l’espace public : la plupart des discours à la nation prononcés par le président se terminent par « God bless America » (« Dieu bénisse l’Amérique ») et la cérémonie d’investiture du président et du vice-président peut comprendre un serment sur la Bible, bible qui provient de la famille de celui qui prête serment. De ce point de vue, il serait intéressant d’entreprendre une étude portant sur l’influence de certains courants évangéliques américains sur les décisions du Président Donald Trump. Nous songeons en particulier à la reconnaissance par le Président américain de Jérusalem comme seule capitale de l’Etat d’Israël. Une telle religiosité de l’espace public américain, qui influence le fonctionnement des institutions politiques, en réalisant une fusion de la politique et de la religion, rend inadéquat l’emploi de l’adjectif « laïc » pour qualifier le modèle public américain de régulation du fait religieux.
En résumé, le principe de laïcité se définit en référence à la neutralité confessionnelle de l’État qui implique l’égalité des religions devant la loi. Formule institutionnelle de relations entre les cultes et l’État, la laïcité de l’État renvoie également au degré d’autonomie d’un ordre juridique par rapport aux normes religieuses. Enfin, sans céder aux dérives laïcistes, l’État laïc se doit d’assurer néanmoins une neutralité de la sphère publique qui repose sur la reconnaissance de valeurs communes partagées par tous et dont l’État est le premier garant au nom de la cohésion nationale et du vivre ensemble. Nul État ne peut échapper à cet impératif indispensable à la survie de la communauté politique qu’il fonde.
La compétence de l’État neutre pour conduire une politique publique du fait religieux au nom de l’intérêt général
Position du problème et problématique
Ernst-Wolfgang Böckenförde, Le Droit, l’État et la constitution démocratique. Essais de théorie juridique, politique et constitutionnelle. Réunis, traduits et présentés par Olivier Jouanjan, Bruylant, LGDJ, 2000, p. 101.
.Ibid., p 101.
Olivier Jouanjan, « Ernst-Wolfgang Böckenförde et la légitimité de l’État sécularisé », Droits, n° 60, 2014, (2), pp 117-136.
Wissman, « Le dialogue entre le cardinal Ratzinger et Jürgen Habermas, Divinatio, 2006, pp 47-50. Le 20 décembre 2017. De manière générale, sur ce sujet voir Jürgen Habermas et Joseph Ratzinger, Raison et Religion. La dialectique de la sécularisation, Salvator, 2010.
Le Conseil a rendu deux arrêts le 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée (n°395223) et fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne (n°395122).
Voir Malo Tresca, « Crèches de Noël dans les mairies : “L’Église n’en a jamais fait un étendard” », fr, La Croix, 24 octobre 2016.
Décret n° 83-132 du 23 février 1983 portant création d’un Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Journal officiel, 25 février 1983, article 1er, 630.
Eric Weil, Philiosphie morale, Vrin, 1998, 224
Ernst-Wolfgang Böckenförde, cit., pp 101-118.
En ouverture de ces quelques développements, nous souhaiterions rappeler l’axiome de Ernst-Wolfgang Böckenförde, professeur de droit public allemand à l’université de Fribourg et membre de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, selon lequel, « l’État libéral, sécularisé vit sur la base de présupposés qu’il n’est pas lui-même capable de garantir25 ». Cet axiome permet de comprendre les ressorts, les faiblesses et, en même temps, les forces et les leviers d’un État de droit libéral et démocratique qui se conçoit comme neutre d’un point de vue confessionnel.
Le professeur Olivier Jouanjan évoque à ce propos le « théorème de Böckenförde », « Diktum », qui apparaît à la fin d’un article intitulé « La naissance de l’État, processus de sécularisation26 ». Ce théorème énonce qu’ « au moment de sa formation, l’État constitua une aventure, un pari, celui qu’il pouvait vivre en se sécularisant, c’est-à-dire sans s’affirmer fondé sur la religion ; mais une fois sécularisé, comme il ne peut toujours pas garantir ses présupposés, il est et reste un pari, une aventure. Son histoire n’est donc pas finie, puisque la sécularisation a lancé l’État dans une aventure risquée27 ». Indissociable d’une théorie démocratique et libérale de l’État moderne, la reconnaissance institutionnalisée de la mission publique et sociale des grandes religions, au premier rang desquelles l’Église catholique, paraît une nécessité refondatrice d’un lien social à repenser dans le cadre de la société française qui a tant de mal à déterminer la place du religieux dans la définition des « solidarités essentielles » selon l’expression de Régis Debray.
Les termes du sujet peuvent être utilement éclairés par les échanges entre le philosophe allemand Jürgen Habermas et le cardinal Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI. Dans ce dialogue, le célèbre philosophe allemand n’hésite pas à dire à Mgr Ratzinger, quelques mois avant son élection comme successeur de Pierre, combien la contribution des religions lui paraît précieuse pour la survie des sociétés sécularisées : « Quand des citoyens sécularisés assument leur rôle de citoyens, ils n’ont pas le droit de dénier à des représentations religieuses du monde un potentiel de vérité présent en elles, ni de contester à leurs concitoyens croyants le droit d’apporter, dans un langage religieux, leur contribution aux débats publics28 ». Jürgen Habermas souligne ainsi l’apport des grandes religions à la compréhension des fondements moraux prépolitiques d’une société libérale et à la consolidation des valeurs qui doivent constituer le soubassement d’une société politique. C’est dire ainsi que l’État, qui est en charge du bien commun au sein de la société, ne saurait exclure les religions de la participation aux grands débats publics. Les religions contribuent à renforcer le lien social au sein d’une société déterminée dans la mesure où elles apparaissent comme des éléments constitutifs de la communauté nationale. C’est cette approche qui a prévalu dans le rapport de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public au Conseil d’État29, dans une affaire relative à l’installation de crèches par la mairie de Melun et le conseil départemental de la Vendée. En ces temps de crispation sur les enjeux religieux où prévalent aisément des conceptions manichéennes, Aurélie Bretonneau propose une approche subtile, n’hésitant pas à utiliser une notion relevant du champ de la théologie morale, celle de « casuistique ». Elle propose en effet d’apprécier au cas par cas si une crèche relève d’une intention prosélyte, auquel cas elle ne saurait avoir sa place dans un bâtiment public, ou si, au contraire, elle s’inscrit dans un cadre festif et culturel et peut ainsi être acceptée dans ledit bâtiment30. Elle préconise d’apprécier au cas par cas le « caractère revendicatif ou non de son installation ». Comment le déterminer ? En vérifiant le caractère « temporaire » de l’installation, dans un « temps festif lié à la célébration de Noël », et en vérifiant aussi qu’elle n’est teintée d’aucune forme de « prosélytisme religieux ». La crèche doit présenter un caractère de « manifestation culturelle ou au moins festive » et donc s’insérer « dans l’histoire locale et l’espace public ».
C’est également une telle approche qui justifie la participation des grandes religions aux travaux du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). Créé par le décret du 23 février 1983, ce comité est actuellement composé d’un président et de trente-neuf membres, nommés pour quatre ans et répartis en trois catégories31 : cinq personnalités désignées par le président de la République « appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles », dix-neuf personnalités « choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes éthiques », et quinze personnalités « appartenant au secteur de la recherche (Inserm, CNRS, Institut Pasteur…) ». Le caractère ouvert de la composition du CCNE se justifie par la nature de la mission qui lui incombe : « Le comité a pour mission de donner son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concernent l’homme, les groupes sociaux ou la société tout entière32. » C’est la raison pour laquelle le renouvellement de la composition du CCNE en 2013 avait suscité beaucoup de critiques. En effet, pour la première fois depuis trente ans, les autorités religieuses ne disposent plus d’aucun siège. Ces dernières ont été consternées d’avoir ainsi été évincées du comité, sans préavis. Les quatre postes sur les trente-neuf membres au total qui étaient nommés en raison de leur appartenance à une famille religieuse sont occupés par quatre laïcs, spécialistes des questions judaïques, catholiques, protestantes et islamiques. En 2016, ont été nommés Dominique Quinio pour le courant catholique et Abdennour Bidar pour le courant musulman. Par un arrêté du 26 décembre 2017, le président de la République a nommé, en qualité de personnalités appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles, la théologienne Marion Muller Colard et la philosophe Cynthia Fleury, pour représenter le judaïsme. De telles nominations, de personnalités de qualité incontestable en l’espèce, ont été très surveillées après les controverses de 2013.
Cette évolution, qui tend à affaiblir la place des autorités religieuses au sein d’instances qui interviennent sur des sujets très sensibles, est très préoccupante, tant pour des raisons de méthode – les témoignages recueillis attestent d’une absence de véritable consultation envers les autorités religieuses sur cette inflexion et sur les nominations envisagées – que de fond – c’est une mécompréhension du rôle profond que doit jouer le CCNE dans notre démocratie, celui de dégager l’universel humain en écoutant les morales particulières. Cette posture morale a été parfaitement résumée par le philosophe Éric Weil : « La réflexion sur la morale surgit du conflit des morales33 ».
C’est à l’aune de ces enjeux que l’État doit reconnaître la contribution des grandes familles spirituelles et philosophiques de notre pays. Admettre un tel axiome ne signifie pas violer la neutralité confessionnelle de l’État ; bien au contraire, ces deux exigences doivent être articulées l’une à l’autre. Seulement, cette proposition doit être davantage argumentée en revenant sur la portée du principe de non-confessionnalité de l’État. Ce principe renvoie à l’État
« neutre », qui ne se fixe pas d’objectif religieux et donc n’en possède pas. Ceci signifie que l’État a ses objectifs propres qui sont d’ordre séculier. Son autocompréhension, qui est issue de la philosophie constitutive des « temps modernes » et qui lui permet d’assurer son rôle de médiateur et de garant de la paix intérieure dans la société, a été mise en évidence par une étude de Böckenförde, parue en 1967, relative à la « naissance de l’État, comme processus de sécularisation34 ». Comme le relève l’auteur, « après que le schisme fut devenu réalité, la chrétienté européenne se trouvait confrontée à la question de savoir comment les différentes confessions pourraient vivre ensemble au sein d’un ordre politique commun ».
C’est cette vision d’un État se situant au-dessus des confessions religieuses qui est au centre des théories des « Politiques ». Ils développèrent une argumentation originale en posant un concept formel de paix, obtenu par « opposition à la guerre civile ». Le seul moyen de garantir cette paix réside dans l’émergence d’une sphère politique aconfessionnelle qui s’élève au-dessus des confessions religieuses pour assurer entre elles l’harmonie et la coexistence pacifique. On sait la postérité de cette conception politique dans l’avènement de la modernité.
Ce rappel effectué, revenons à la portée du principe de neutralité et à ce que nous en dit la jurisprudence des cours suprêmes.
La signification du principe de neutralité en droit public français
Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 16 mars 2005. Sur cette question, voir Jean-Marie Woehrling, « L’interdiction pour l’État de financer ou de reconnaître un culte : quelle valeur juridique ? », Revue du droit public, n° 6, novembre 2006, p. 1633-1670.
Voir « Le Conseil d’État précise l’interprétation et les conditions d’application de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État », conseil-etat.fr, 19 juillet 2010.
En droit positif français, le principe de neutralité apparaît, notamment dans la jurisprudence du Conseil d’État, comme une déclinaison du principe constitutionnel de laïcité : « Considérant que le principe de laïcité de l’enseignement public, qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est un des éléments de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves35 ».
De la même manière, dans un arrêt du 16 mars 2005, le Conseil d’État juge que le « principe constitutionnel de laïcité […] implique neutralité de l’État […] et traitement égal des différents cultes36 ». La haute juridiction administrative retient, à cette occasion, une conception assez souple du principe de neutralité en considérant que la règle de non-subventionnement des activités cultuelles, telle que posée par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, ne disposait pas d’une valeur constitutionnelle. Dans l’affaire en cause, le Conseil d’État a indiqué que le principe constitutionnel de laïcité « n’interdit pas, par lui- même, l’octroi dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes ». Pour le Conseil d’État, la condition d’intérêt général était réalisée par le fait que le presbytère incriminé n’était pas seulement un édifice du culte, mais qu’il servait de lieu d’accueil à l’ensemble de la population lors des tempêtes. On en déduit que certaines activités prises en charge par des cultes peuvent correspondre à un intérêt général, justifiant un soutien public.
Par plusieurs décisions du 19 juillet 201137, le Conseil d’État a reconnu aux collectivités territoriales désireuses de financer des projets en rapport avec des édifices ou des pratiques cultuels une latitude d’action qui leur avait été récemment contestée. Des décisions de financement sont légales dès lors qu’elles répondent à un intérêt public local et qu’un certain nombre de conditions sont respectées. Elles doivent, au premier chef, respecter le principe de neutralité à l’égard de tous les cultes. A fortiori, cela signifie que ce dernier principe ne prohibe pas en tant que tel l’octroi de telles subventions. Des conditions supplémentaires sont prévues. Ainsi, ces subventions, dans le respect du principe d’égalité, ne doivent pas s’assimiler à une aide à un culte, ni constituer une libéralité. À la lecture des arrêts, étaient en cause, en l’espèce, l’installation d’un orgue dans une église du Maine-et-Loire, la réalisation d’un ascenseur pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à la basilique Notre-Dame-de-Fourvière, à Lyon, l’aménagement d’un abattoir temporaire par la communauté urbaine du Mans, la construction d’une salle polyvalente à Montpellier et l’édification d’une mosquée à Montreuil-sous-Bois.
C’est dans le cadre du rappel de ces exigences constitutionnelles que s’inscrit l’action de l’État, garant de la « cohésion nationale ». Confronté à une société sans cesse davantage pluriculturelle et pluriconfessionnelle, caractérisée par des revendications individualistes croissantes qui rendent absolument nécessaire l’exigence de sa neutralité, l’État doit laisser les citoyens libres de faire leurs choix religieux et rester en retrait. La première des garanties de la liberté de pensée, de conscience et de religion réside dans l’abstention de l’État. Cet impératif est également conforté par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la mise en œuvre de la liberté religieuse. Cette « obligation de neutralité », combinée au « devoir d’impartialité », n’oblige néanmoins pas l’État à se cantonner à une attitude strictement négative de non-intervention dans les affaires religieuses. Si l’État ne reconnaît pas nécessairement les cultes, comme dans le cadre du modèle français de séparation des cultes et de l’État, il est conduit à connaître le « fait religieux » sous sa dimension sociale et collective.
Ces exigences juridiques doivent être lues à l’aune d’un des objectifs fondamentaux d’un État démocratique et libéral qui consiste à favoriser l’intégration au sein de la collectivité publique de tous les individus, quelle que soit leur religion, et de tous les groupes confessionnels en donnant une possibilité équivalente à tous ces citoyens et à tous ces groupes de pouvoir s’identifier à cet État. Il ne s’agit néanmoins pas, par esprit de parallélisme, d’en déduire que les religions, elles aussi, devraient être « neutres » par rapport aux options politiques. Tel n’est pas le cas, comme le souligne justement Jean-Marie Woehrling, dans la mesure où la neutralité constitue un fondement de l’État libéral et démocratique occidental qui n’impose pas aux religions d’adhérer au même principe de neutralité38. Elles peuvent avoir des engagements politiques marqués39.
Par ailleurs, si l’État doit être neutre, sur un plan religieux, dans la fixation de ses objectifs, il peut ne pas l’être dans les effets que produit son action. Les juristes allemands écrivent ainsi « qu’il peut ne pas y avoir de Wirkungsneutralität40 » (il ne saurait y avoir de neutralité absolue quant aux effets produits). En effet, « l’État ne saurait être tenu de modifier l’action qu’il déploie dans une perspective d’intérêt général, uniquement parce que celle-ci convient mieux ou moins bien à telle ou telle conviction religieuse41 ». À titre d’exemple, selon Jean-Marie Woehrling, « si, dans un but d’intégration, l’État proscrit certaines tenues vestimentaires, cela peut être indifférent pour certaines opinions religieuses et présenter un aspect négatif pour d’autres opinions religieuses […]. Les exemples pourraient être ainsi poursuivis au regard de la règle du divorce, de celle du commerce dominical, etc.42 ». Dans ces exemples, l’objectif que se fixe l’État est un objectif d’intérêt général, qui n’exclut pas qu’il puisse produire des conséquences plus ou moins négatives pour les fidèles d’une confession déterminée.
Ces postulats admis, il s’agit à présent d’identifier la question centrale qui se pose à nos yeux et que l’on peut résumer de la manière suivante : si l’État doit être neutre en matière de religion, doit-il l’être également au regard des valeurs et des convictions en général et de leur contribution au bien-être général ? On serait alors aux prises avec une conception libérale de l’État, celle de l’État gendarme. Tel n’est pas néanmoins le présupposé préjuridique de cette étude, présupposé qui nous paraît cependant confirmé par les données du droit constitutionnel positif. En effet, la Constitution énonce un certain nombre de principes de valeurs essentielles à la continuité de l’État. Ils constituent les principes fondamentaux de l’ordre juridique étatique dans le cadre du « contexte de sens » (Carl Schmitt) posé par la Constitution.
Neutralité de l’État et renforcement du bien-être social de la population et de la cohésion nationale : l’État peut-il participer à la formation des imams ?
Sur cet aspect, voir Jean-Marie Woehrling, « Le principe de neutralité… », cit.
Voir Francis Messner, La Formation des cadres religieux musulmans, rapport pour le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2014, p. 24. L’auteur distingue trois parties : la formation des cadres religieux en Europe, la formation des cadres religieux en France, le développement des diplômes universitaires et des pôles d’excellence mobilisables sur l’islam.
Ibid., p. 26.
Jacques Berque, Une cause jamais Pour une Méditerranée plurielle. Écrits politiques 1956-1995, Albin Michel, 1998, p. 78.
L’État ne peut pas être indifférent aux valeurs. Son rôle est de favoriser les conceptions qui renforcent l’intégration sociale et de combattre les doctrines qui portent atteinte à la cohésion sociale. Une neutralité complète de l’État serait même la négation de celui-ci et aboutirait à accélérer un processus d’atomisation de la société vers l’individualisme et la déstructuration du lien social. De surcroît, une telle conception de la neutralité serait aux antipodes des traditions françaises héritées de la philosophie rousseauiste, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que des principes constitutifs du patrimoine juridique et politique républicain français qui tendent à conférer à la société française son caractère spécifique.
Quels sont ces principes républicains essentiels dans la société française actuelle et dont l’État doit assurer la protection, car ils sont au service de l’intérêt général ? Il ne s’agit en aucune manière de principes supraconstitutionnels qui relèveraient davantage de la morale publique ou de conceptions philosophiques particulières, mais plutôt de principes garantis au niveau constitutionnel et figurant dans ce que la doctrine publiciste qualifie régulièrement de « bloc de constitutionnalité ». Parmi ceux-ci, on peut mentionner43 : le respect de la dignité humaine et la primauté de la personne humaine, l’affirmation de la liberté de conscience et de la libre détermination par chaque personne de ses choix de vie, la restriction du recours à la violence, la reconnaissance du rôle de la raison dans la détermination et la conduite de la politique des sociétés humaines, la légitimité de la place de la science dans la société, le renforcement de la cohésion nationale et du bien-être social, etc. Ces options ne sont en tant que telles ni évidentes, ni universelles : dans d’autres traditions juridiques, le groupe peut également primer l’individu, les choix collectifs l’emporter sur les options individuelles, l’inégalité entre les personnes justifiée par leurs rôles sociaux respectifs ou l’importance de la tradition. Au modèle occidental peut ainsi être opposée la philosophie sociale et juridique chinoise ou coréenne traditionnelle qui tend à faire primer le groupe sur l’individu.
C’est ainsi que des obligations juridiques positives reposent sur l’État au nom de la garantie des principes constitutionnels. Celles-ci fondent l’« être- ensemble » et solidifient la cohésion nationale qui se situe au cœur de notre pacte constitutionnel. C’est à l’aune de cet axiome que l’État ne peut être indifférent à la construction d’un islam intégré dans les statuts des cultes nationaux, dont la formation des cadres est un des éléments. Une part importante des cadres permanents de l’islam sont soit formés à l’étranger, soit préparés à leurs fonctions de manière sommaire. C’est la raison pour laquelle ont été mis en place des diplômes d’université (DU) de « formation civile et civique », qui ont un triple objectif : transmettre des connaissances relatives au contexte socio-historique, au droit et aux institutions de la France ; fournir des instruments aux étudiants concernés en vue de faciliter la gestion des institutions cultuelles ; proposer une approche universitaire du fait religieux. Une telle offre de formation s’adresse en priorité aux cadres religieux au sens large : s’il s’agit principalement des cadres religieux musulmans, sont également concernés les ministres du culte d’autres religions arrivées récemment sur le territoire français (évangéliques, prêtres catholiques originaires d’autres continents, etc.). Comme le note Francis Messner dans son rapport, « cette offre peut le cas échéant être étendue à des agents publics qui ont par ce biais la capacité d’acquérir des clés pour une meilleure compréhension du fait religieux et des normes encadrant les institutions et les activités religieuses44 ». L’intéressante combinaison mise en place à Lyon illustre bien la nécessité de saisir ces deux types de public. Le premier bilan qui peut être établi s’agissant de ces expériences conduit à encourager les pouvoirs publics à poursuivre dans cette voie de la création de nouveaux DU et de la consolidation des anciens. Bien plus, on souscrira très volontiers à la proposition de Francis Messner selon laquelle « l’obtention d’un visa pour les ministres du culte étrangers souhaitant exercer leur activité en France pourrait être subordonnée à leur engagement de suivre les enseignements d’un DU et par voie de conséquence de faire preuve d’une bonne maîtrise du français conformément aux critères établis par le Centre international d’études pédagogiques45 ».
La préparation de tels diplômes constitue une étape nécessaire, mais il importe également de s’intéresser au sujet fondamental de la formation dite théologique des cadres religieux. L’importance du sujet avait été perçue par Jacques Berque. Celui-ci, en réponse à une question sur le défaut de formation des ulémas en France, soulignait « la nécessité d’en former, ce qui pourrait être la fonction d’une faculté de théologie » et ajoutait : « Il ne semble pas que la Mosquée de Paris ait répondu à ce besoin. J’imagine donc une faculté musulmane que la France fonderait, de même qu’elle a fondé une faculté catholique et protestante à Strasbourg, dans les départements qui ne sont pas régis par la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, mais par le régime concordataire napoléonien. Je préconise que cette faculté soit créée et gérée avec une vieille faculté musulmane. Je pense à Al-Azhar du Caire. Cette faculté formerait non seulement des imams, des cheikhs, mais aussi des islamologues dont on a le plus grand besoin 46. » Ce sujet de la formation des imams et des islamologues dans notre pays est un des sujets majeurs des années à venir. La France dispose d’une grande tradition d’islamologues avec laquelle elle doit impérativement renouer, sans hésiter et avec conviction.
On notera que le principe de neutralité confessionnelle de l’État n’interdit pas à ce dernier, dans le respect de certaines limites, d’opérer des choix volontaristes en termes de cohésion de l’ensemble national et de promotion de certaines valeurs d’intérêt collectif. Il est fondamentalement celui qui assure le bon fonctionnement du pluralisme religieux, marque évidente des sociétés occidentales sécularisées.
L’ajustement des instruments juridiques et institutionnels pour une gestion publique du fait religieux
Voir à ce sujet Conseil d’État, Réflexions sur l’intérêt général – Rapport public 1999, 30 novembre 1998. Ce rapport s’ouvre par les considérations suivantes : « L’intérêt général se situe, depuis plus de deux cents ans, au cœur de la pensée politique et juridique française, en tant que finalité ultime de l’action Il occupe une place centrale dans la construction du droit public par le Conseil d’État. Cette notion, qui donne aujourd’hui lieu à de multiples interrogations, est-elle toujours d’actualité ? En cette année [1999] du bicentenaire du Conseil d’État, il nous a paru tout naturel de consacrer nos réflexions à ce thème et à sa modernité ».
Marcel Gauchet, Un monde désenchanté ? Paris, Editions de l’Atelier/ Editions ouvrières, 2004, 253 pages, voir spécialement chapitre XV, p 235.
Voir Jürgen Habermas, Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique, Fayard, 2000.
Sur ce sujet, on se reportera avec profit aux analyses de Ghislain Benhassa, L’État de droit à l’épreuve du terrorisme : Faut-il suivre l’exemple américain ?, Éditions L’Archipel,2017.
À ce stade de l’analyse, nos postulats sont les suivants : l’État fort, celui qui intègre les tensions de la société civile, est légitime en contexte laïc à assurer une régulation du fait religieux qui garantisse à la fois la protection des libertés fondamentales et le renforcement de la cohésion nationale. Ce qui est en jeu est cette notion, si bien connue des publicistes, qui est celle d’intérêt général47, c’est-à-dire l’intérêt commun à tous. Certes, on le sait, il n’existe pas de définition juridique univoque de l’intérêt général, qui correspond en réalité davantage à un objectif de valeur constitutionnelle reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel dans une jurisprudence constante. Il est ainsi ce but vers lequel doit tendre l’action du législateur, y compris en matière cultuelle. La loi du 9 décembre 1905, et de manière générale l’ensemble du droit des relations entre les cultes et l’État, se lit à la lumière de l’objectif constitutionnel d’intérêt général. Or cet objectif conduit les pouvoirs publics à réguler le fait religieux en prenant en considération la contribution du bien-être des religions au bien-être social.
Cette régulation conduit l’État à édicter des actes juridiques et à adopter des pratiques permettant ce dialogue institutionnalisé avec l’ensemble des cultes présents sur le territoire national. Une occasion de relancer ce dialogue institutionnalisé pourrait exister dans le discours que le président de la République, Emmanuel Macron, dans un contexte difficile caractérisé par la montée des tensions religieuses, s’apprête à prononcer au début de l’année 2018, après avoir déjà reçu les représentants des autorités religieuses fin décembre. Le président de la République a mis l’accent sur l’idée d’une laïcité apaisée qui doit organiser les relations entre les cultes et l’État. Le rappel du caractère fondamental de la laïcité ne peut cependant pas tout. Les autorités étatiques ne sont plus en mesure de faire l’impasse sur une politique publique assumée de gestion du religieux.
Cette problématique a été parfaitement soulignée par Marcel Gauchet qui pose la question suivante : « Quel rôle pour les institutions religieuses dans une société sortie de la religion ? La question peut être évidemment envisagée de deux façons. Elle est, très normalement, la question des responsables des institutions religieuses… Mais la question peut également être abordée de l’extérieur par un observateur qui s’interroge, de manière neutre et impartiale, sur le rôle possible que les sociétés sorties de la religion laissent aux institutions religieuses48 ». Cette interrogation intéresse tant le croyant que l’agnostique, « dès l’instant où l’un et l’autre s’accordent sur l’ethos civique commun de la démocratie ». À ce titre, les religions agissent en qualité d’« acteurs publics » au sein de l’espace démocratique. La séparation des cultes et de l’État ne les a pas expulsées de la sphère publique, ni définitivement reléguées dans l’espace privé. Elles remplissent une mission publique et sociale que les juristes allemands soulignent en recourant à la notion d’Öffentlichkeit (l’espace public). C’est au nom de cette mission de contribution à la construction et à la vie d’un espace public que les principales religions peuvent bénéficier du statut constitutionnel de corporation de droit public dont résulte le recours à l’impôt ecclésiastique prévu par l’article 140 de la Loi fondamentale allemande qui incorpore une grande partie de l’ancien article 137 de la Constitution de Weimar. Elles remplissent également de très importantes missions dans le champ social (bienfaisance, activités de soin, d’éducation, d’aide aux déshérités). En droit public allemand, la technique juridique souligne de manière adéquate la prise en considération de cette mission publique et sociale des principales collectivités religieuses. Il n’est évidemment pas question de transposer le droit public des cultes allemands en France, mais de réfléchir à la condition d’émergence d’un espace public où les principaux courants religieux et spirituels apporteraient une contribution importante à la consolidation d’un « être-ensemble » national et républicain.
Dans ces conditions, quel serait le modèle recommandé de gouvernance institutionnelle des cultes en France ? Actuellement, le bureau central des cultes, qui relève du ministère de l’Intérieur et de la direction des libertés publiques, exerce une fonction administrative essentielle, celle de la mise en œuvre de la loi du 9 décembre 1905 et de la police des cultes. Cette fonction, néanmoins, ne saurait se substituer à la nécessité d’un pilotage politique des affaires religieuses. Nous précisons bien que cette proposition ne remet en rien en cause la grande qualité du travail effectué par les Chefs du bureau des cultes, souvent des jeunes sous-préfets, qui accomplissent un travail fondamental qui se situe au centre du dialogue entre les cultes et l’Etat.
L’idée défendue ici est celle de l’exercice d’une politique publique du fait religieux qui concilie la liberté du culte, la protection de l’ordre public et la mise en évidence du rôle public et social des religions en vue de renforcer le lien social au sein de la République et la cohésion nationale. L’objectif n’est pas tant de modifier une nouvelle fois la loi du 9 décembre 1905, qui constitue un cadre juridique tout à fait satisfaisant à l’exercice du culte, mais davantage d’ajuster nos instruments institutionnels et de pilotage de la gestion publique des cultes, à savoir :
- éviter de cantonner l’État dans un dialogue singulier avec l’islam qui aboutirait à faire de celui-ci de facto une « religion d’État ». Un tel choix ne pourrait avoir pour conséquence que d’attiser les tensions au sein de la société française. C’est la raison pour laquelle l’État doit, au contraire, se donner les moyens d’un « dialogue institutionnalisé » avec l’ensemble des cultes présents en Actuellement, le débat public ne porte que trop exclusivement sur la difficile insertion du culte musulman dans l’ordre juridique étatique. Une telle approche dissimule les enjeux autour de la mise en œuvre d’une réelle politique de gestion publique du fait religieux. Chaque culte rencontre ses propres difficultés : si l’entretien d’un patrimoine historique religieux de première importance constitue la préoccupation principale de l’Église catholique, en revanche, les mouvements évangéliques et pentecôtistes se soucient davantage de l’édification de nouveaux lieux de culte ou de l’acquisition de la qualité d’« association cultuelle » au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905. Les fidèles de confession juive exigent pour leur part de l’État des garanties afin de pratiquer leur culte de manière sûre. Nous ne pouvons à cet égard qu’être atterrés, qu’en France, en 2016, le culte juif ne puisse être célébré sans la présence de forces de l’ordre protégeant les synagogues. Sans parler des écoles confessionnelles juives qui sont sous la protection continue de l’armée. Les autorités publiques ont l’obligation d’assurer l’exercice effectif du culte en France. Une réponse adaptée ne peut se réduire à la surveillance des lieux de culte, mais doit davantage appeler une sévérité pénale maximale et un effort de pédagogie au sein des établissements scolaires de la République ;
- identifier les valeurs et principes qui sont au cœur de notre « patriotisme constitutionnel » (Jürgen Harbermas49) afin de construire une politique publique de gestion du religieux qui permette la mise en œuvre de ces axiomes fondamentaux que sont le respect de la dignité humaine et la primauté de la personne humaine, l’égalité entre les individus, la liberté de conscience et d’opinion, le renforcement de la cohésion nationale, l’affirmation de la liberté individuelle et de la libre détermination par chaque personne de ses choix de vie, la reconnaissance du rôle de la raison dans la détermination et la conduite de la politique des sociétés humaines, la légitimité de la place de la science dans la société, etc. Ces valeurs essentielles, déjà énoncées auparavant, doivent être respectées non seulement par les cultes, mais également par tous les croyants ;
- rappeler, dans le cadre précédemment évoqué, qu’au cœur de notre pacte constitutionnel et social figurent les libertés de conscience et de culte qui constituent des libertés de premier rang qu’on ne peut pas L’État doit assurer le respect des libertés publiques, mais en tenant compte du « bien- être social de la population », exigence à l’aune de laquelle il peut ajuster en continu le niveau de protection des libertés en prenant en compte d’autres impératifs, comme la protection de l’ordre public, selon un schéma utilitariste de prise en compte d’un optimum de « bien-être social » de la population. Dans le modèle proposé, l’objectif est de concevoir un système d’échange entre ces deux finalités essentielles du droit public dans un État de droit. Si le lien ainsi défini entre liberté et sécurité n’est certes pas nouveau, en revanche l’apport essentiel du tradeoff, du modèle de l’équilibre, est de mettre sur un pied de stricte égalité les impératifs de sécurité et de liberté50. Ces impératifs deviennent des biens comparables qu’il s’agit de répartir en fonction des besoins de la population, eux-mêmes déterminés en fonction des circonstances politiques. Le curseur n’est donc pas en permanence placé sur la liberté ou sur la sécurité ; au contraire, il se déplace en fonction des nécessités imposées par les circonstances. Dans le cadre de ce modèle, il va de soi que le contrôle de l’opinion publique joue un rôle de premier plan dans l’appréciation du déplacement du curseur par le pouvoir politique. Une forme de consentement, au moins tacite, s’avère requise pour le relèvement du niveau sécurité, au détriment de la liberté ;
- permettre à l’État de prendre en compte la situation institutionnelle et les besoins propres de chaque culte à travers le recours au droit conventionnel et la notion de « cultes représentatifs ». Une convention, signée entre le Premier ministre et les responsables de chaque culte doté d’une certaine représentativité sur le territoire national, doit permettre de corréler de manière adéquate législation étatique et situation réelle de chaque collectivité religieuse. À cet effet, nous proposons d’introduire en droit français la notion de « cultes représentatifs », comme le propose également le professeur Jean Morange, cultes qui seraient identifiés sur la base de critères objectifs : nombre d’adhérents, de lieux de culte, degré d’organisation institutionnelle, respect des valeurs républicaines, etc. Évidemment, il s’agirait que les cultes signataires respectent tant l’ordre public matériel que l’ordre public immatériel. L’idée est d’introduire, dans le respect des grands principes de la loi du 9 décembre 1905, un « droit négocié » dans notre droit des cultes. La laïcité n’exclut pas le recours au contrat qui, loin de conférer des privilèges à tel ou tel culte, s’efforcerait de mieux prendre en considération leur liberté d’organisation institutionnelle.En outre, il apparaît, et ce malgré les efforts des ministres de l’Intérieur successifs, qu’un tel pilotage serait plus adéquat au niveau du Premier ministre que du ministère de l’Intérieur. Le sujet cultuel est interministériel (régime juridique des cultes, abattage rituel, service d’aumônerie, enseignement scolaire ou universitaire, affaires extérieures, etc.) et nécessite en conséquence un pilotage et des arbitrages au niveau du Premier ministre. Celui-ci s’appuierait sur un Conseil des cultes et de la laïcité qui comporterait les représentants des principaux cultes de la République et des grands mouvements spirituels et humanistes.Adhérer fermement au principe de laïcité de la République n’est pas condamner la protection des libertés religieuses, ni renoncer à une politique publique de gestion du religieux. Le fait religieux constitue un « fait social » qui, à ce titre, est nécessairement objet du politique. Quels que soient leurs orientations et leurs partis pris, les décideurs politiques ne pourront se dispenser de porter une politique publique de gestion du fait religieux dans la France du XXIe siècle.

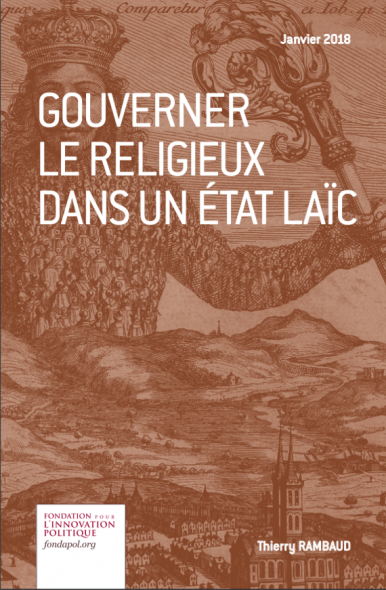











Aucun commentaire.