Introduction
L’esprit de 1789 et les tâches de l’Etat
L’Etat et la confiance
Quelques perspectives sur la transition en cours
Annexe : extrait d’histoire de La civilisation en Angleterre, Par H. T. Buckle
Introduction
L. Jaume, L’Individu effacé ou le Paradoxe du libéralisme français, Paris, fayard, 1997.
Les circonstances de l’actuelle crise financière, économique, mais aussi morale et intellectuelle ne peuvent que renforcer la tendance à rendre le libéralisme responsable de tous les maux. En France, le problème ne date pas d’aujourd’hui, il possède des racines qui s’enfoncent loin dans le passé, il concerne la naissance et le développement de l’État administratif à la française, qui a fait figure de colonne vertébrale dans l’histoire de notre nation. Remonter aux origines historiques de cette conception, c’est d’abord mieux comprendre combien la mondialisation brouille ou anéantit les repères immémoriaux des Français. En outre, les faits nouveaux survenus avec l’éclatement de la crise financière, depuis l’automne 2008, sont en train de réactiver cet héritage et de lui redonner des énergies d’une portée imprévisible, ce dont tout gouvernant devrait être averti ; nul ne sait quelles seront les conséquences d’une crise peut-être comparable à celle des années 1930, en tout cas, on ne peut pas se dispenser de mener l’enquête sur ce qui a été, à travers une quinzaine de constitutions et de régimes, le rôle original de l’État en France. Le propos est donc non pas de donner des recettes ni d’incriminer des responsables, mais de proposer aux lecteurs, aux décideurs, aux citoyens, quelques pistes de réflexion et, peut-être, d’action !
Il y a douze ans, je publiais un livre sur le libéralisme français, dont le titre soulignait, par l’idée d’« effacement » de l’individu1, que la France, pays des droits de l’homme et du citoyen, n’avait pas accompli sa révolution individualiste. Il fallait entendre par là que les tutelles, les précautions prises par l’État, la centralisation administrative, la recherche de corporatismes protecteurs signaient dans notre pays la méfiance envers le libéralisme et la société civile.
Bien plus près de nous, les 20, 21 et 22 mars 2009, le forum de Libération, sur «Comment sortir de la crise ? » (diffusé par France Inter), prenait pour leitmotiv la thèse que l’individualisme était devenu excessif, que l’égoïsme avait montré suffisamment ses ravages et que, donc, il fallait inventer (ou retrouver) de nouvelles formes du collectif. Ou, comme dit aussi Régis Debray, il faut rénover la fraternité. Ma position consistera à suggérer que le libéralisme qu’on croit pourfendre est un épouvantail, qu’il faut s’entendre sur ce qu’on appelle l’individualisme, qui, d’ailleurs, n’a pas constitué le modèle dominant de l’éducation, des entreprises et de la vie intellectuelle en France. Je demande aussi que l’on n’oublie pas, dans ce qui suit, un principe d’interprétation pour notre histoire : tout ce que nous avons construit depuis la Révolution et depuis Napoléon est une lutte contre l’Ancien Régime. Une clé capitale est la haine tenace portée à l’esprit de privilège et aux particularismes pouvant évoquer (réalité ou métaphore) l’ancienne société de corps, de hiérarchie et de morgue. On peut citer le Code civil, la conception de la justice, l’école laïque, la République et sa trilogie (Liberté, Égalité, Fraternité), la décentralisation si longtemps demandée (au moins durant tout le xixe siècle)et si longtemps refusée (jusqu’en 1982, lois Defferre). Nos institutions et nos passions protectrices de ces institutions portent l’empreinte en creux – si l’on regarde bien – de la monarchie absolue et de l’Église catholique. Gouverner aujourd’hui rend nécessaire de connaître cette histoire, pour éviter de graves discordances ; la crise politique nouée autour de l’université (l’autonomie, le statut des enseignants) en constitue un exemple.
Il nous faut, dans un premier temps, partir de l’esprit de 1789, de ce qu’il nous a légué et que nous reproduisons souvent sans le savoir ; notamment, en matière d’action de l’État, un certain type de pensée et d’intervention qui s’exerce sur le lien social. Quand on dit « l’État », ici, il est clair qu’on ne parle pas des gouvernements ou de tels ou tels courants politiques qui ont gouverné. La figure de l’État, le sens de sa mission vont bien au-delà. On verra, dans un deuxième temps, les conséquences qui en découlent, notamment en matière de confiance, puisque la confiance est le ressort essentiel des démocraties libérales. Enfin, on terminera sur un problème politique récurrent, d’intensité névralgique, celui de la formation des élites en France.
L’esprit de 1789 et les tâches de l’Etat
Repris dans la Constitution de 1791 : les députés « ne seront pas représentants d’un département particu- lier, mais de la nation entière » (titre iii, chapitre premier, section iii, article 7).
Le lecteur pourra consulter mon étude : « une liberté en souffrance : l’association au xixesiècle », dans Associations et champ politique. La loi de 1901 à l’épreuve du siècle, C. andrieu, G. le béguec et d. tartakowsky (dir.), Paris, Publications de la sorbonne, 2001.
Tel qu’il se fonde sur de nouvelles bases lors de la Révolution française, et selon le principe que la loi est « l’expression de la volonté générale », l’État considère qu’il a des missions à l’égard de la société, y compris dans les rapports que l’individu entretient avec lui-même et avec les autres. On le voit encore ces jours-ci, où l’image de Jacques Tati ou d’une comédienne incarnant Coco Chanel est soumise à censure parce qu’elle constituerait une incitation à fumer. De façon globale, cela concerne tout ce qui constitue le lien social, comme lieu d’intervention de l’État. Pour le dire brièvement, il s’agit, à partir de 1789, de dépolitiser le lien social, d’individualiser le lien social et, enfin, de l’administrer. Considérons tour à tour ces trois aspects.
Que faut-il entendre par « dépolitiser le lien social » ? On peut s’étonner d’une pareille affirmation, alors que la Révolution prend appui sur la mobilisation de la société, sur « le peuple visible », qui manifeste dans la rue et qui, parfois, n’en fait qu’à sa tête, par exemple en ramenant le roi et sa famille à Paris en octobre 1789, ou, auparavant, en prenant la Bastille. Mais c’est vers les juristes, ce groupe dirigeant de l’Assemblée constituante (notaires, avocats, robins divers) qu’il faut se tourner pour comprendre la nouvelle conception appelée à inspirer les rapports entre société et pouvoir. Quelqu’un comme Sieyès est issu du clergé et non de la basoche, mais il a son idée du droit : la volonté générale, explique-t-il dans le discours du 7 septembre 1789, ne se trouve pas dans le peuple ni dans le corps électoral, mais dans l’Assemblée élue. C’est d’ailleurs pourquoi la notion d’un « appel au peuple » contre des projets de loi de l’Assemblée (proposition de défenseurs de l’exécutif comme Mirabeau) est, à ses yeux, une idée absurde. Le peuple – ou la nation, comme on voudra – n’a pas de volonté propre à faire valoir contre ceux qui, par leur réunion dans la capitale, par la délibération, la confrontation de leurs opinions, font émerger la volonté générale. D’ailleurs, explique encore Sieyès dans ce discours, c’est l’unité de l’Assemblée élue qui crée l’unité du peuple, et non l’inverse. Le peuple français ne peut exister politiquement et ne peut vouloir quelque chose qu’à travers son incarnation visible : l’Assemblée de ses représentants, où chaque membre « représente la nation tout entière »2.
C’est évidemment une conception théologique qui n’est pas sans rap- peler le discours de Bossuet sur l’unité de l’Église : chaque évêque ne doit rien dire ni rien faire qui ne puisse être avoué par tous les autres, car il représente l’Église, qui est, par son unité mystique, tout entière en chacune de ses parties. La différence est-elle que les députés peuvent voter, se combattre, décider à la majorité ? Mais les synodes, les conciles et toutes les assemblées ecclésiastiques le font aussi, en inventant d’ailleurs les techniques électorales et délibératives de l’époque moderne.
En fait, dans la conception des constituants de 1789 – hormis quelques récalcitrants –, la politique est déplacée de la société vers l’État, des simples citoyens vers les « spécialistes » de la chose publique. On le vérifie dans deux autres circonstances parlementaires : au moment de la loi que Le Chapelier fait voter en juin 1791 sur les syndicats (ouvriers ou patronaux) et en septembre 1791 sur les clubs et les sociétés populaires. Dans le premier texte, il est dit que les salariés ne sauraient se regrouper pour « leurs prétendus intérêts communs » (article 2), pour « délibérer », c’est-à-dire pour s’entendre par décision propre sur le salaire et, éventuellement, sur la grève. De même, présentant le second texte l’avant-dernier jour de la Constituante, le 29 septembre, Le Chapelier affirme que les Jacobins (club de Paris fédérant des centaines de filiales en province) ne sont rien d’autre qu’une corporation; ils ont un réseau serré et hiérarchisé, ils sont disciplinés, obéissent à des mots d’ordre communs, votés en assemblée et diffusés par le centre. Or, selon une remarquable formule de l’orateur, à cette date, « l’opinion publique est connue » et « la Révolution est terminée ». Les corps politiques intermédiaires, entre les citoyens et les représentants, sont donc des centres d’agitation inutiles et dangereux, tout comme les syndicats seraient nuisibles à la liberté d’entreprendre.
C’est en ce sens que l’État a pour fonction de dépolitiser le lien social, dans la mesure où il détient le monopole de la connaissance de l’intérêt général, de sa défense, de son application. En réalité, cette dépolitisation est une politisation précise et qui ne s’avoue pas. Voyons l’exposé des motifs de la loi sur les syndicats : « Il n’y a plus de corporations dans l’État, il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. »
Les termes État, citoyen, chose publique signalent combien la question est politique en fait : pourquoi parler de citoyens dans la relation de travail contractuelle ? De même, à l’en croire, Le Chapelier vise à restreindre (sinon à étouffer) les clubs jacobins non parce qu’ils sont, sur sa gauche, une opposition à la ligne de la Constituante, qui est plus modérée, mais parce qu’ils ressuscitent les « corporations » ! Il prétend défendre l’ordre constitutionnel nouveau contre ceux qui veulent recourir à des mobilisations au sein de la société pour conquérir le pouvoir ou simplement l’influencer (opinion publique). Quarante ans après, Tocqueville est habité par cette vision lorsque, voyageant aux États-Unis, il observe la vitalité des communes, le self-government, l’importance du contact direct et de la discussion entre citoyens et avec les politiques, les échanges incessants du public et du privé. Dire que la volonté générale est dans l’État et non dans le peuple paraîtrait une formule incongrue aux interlocuteurs de Tocqueville ; elle trahit une provenance précise, c’est-à-dire qu’elle est issue de la culture monarchique et catholique, qui forme la matrice française.
Mais l’État doit aussi individualiser le lien social, car, depuis la Révolution et jusqu’à une date très récente, il montre une grande méfiance envers les corps de toutes sortes. L’origine de cette attitude n’est pas mystérieuse ; on vient de voir avec Le Chapelier que la liberté des échanges économiques suppose de briser les règlements intermédiaires et particularistes qui organisaient la vie des corporations, mais il y a aussi la hantise que l’Église reconstitue ses ordres traditionnels. La loi républicaine de 1901, qui fait suite à trente-deux tentatives avortées sous la IIIe République, réserve une place explicite et bien encadrée aux associations religieuses. En outre, la crainte de beaucoup de gouvernants au xixe siècle concernait les associations républicaines et/ou socialistes, qui menèrent notamment la vie dure à la monarchie de Juillet : le régime traverse une suite d’insurrections, et Guizot finit par interdire pratiquement, en 1834, la création d’associations 3.
Il faut rappeler que, selon la Déclaration de 1789 et la Constitution de 1791, la liberté d’association n’est pas un droit de l’homme et que le Conseil constitutionnel a pris son essor en 1971 à propos de la liberté associative, les gouvernants rêvant en général d’«autoriser » par voie administrative la naissance d’associations. En l’occurrence, le conflit opposait Raymond Marcellin et l’association Simone de Beauvoir-La Cause du peuple. Durant tout le xixe siècle, le Code pénal veille jalousement sur le droit des associations, que l’on a comprimé le plus possible, car, outre le souci d’ordre social et la hantise des jésuites, l’intuition essentielle de Le Chapelier reste agissante : entre l’individu et l’État, il ne doit pas y avoir de corps représentatifs et de forces intermédiaires. Ce qui est public ne doit pas se mélanger à la sociabilité du privé. En réalité, la hantise des contre-pouvoirs et l’hostilité envers les « corps » ont engendré divers effets pervers ; car, bien entendu, il y avait des corps, et la politique de Guizot, puis de l’orléanisme, a été d’essayer de reconstituer les corps (à l’université, dans l’Administration, la justice et l’armée, dans la société civile, dans le système électoral, etc.). La politique des notables est de favoriser des formes corporatives tandis que, officiellement, l’État ne reconnaît que des individus. Quand Napoléon parle des « masses de granit » qu’il est indispensable d’instituer (Conseil d’État, justice administrative, université, etc.), il se doute en même temps que la « schizophrénie » de la vie publique française va se perpétuer.
Enfin, le rôle de l’État issu de la Révolution française est d’administrer le lien social. On peut dire qu’en cela la visée est double. Tout d’abord, l’Administration a pour fonction primordiale de protéger l’État de la mainmise des « intérêts particuliers » (dont le nom seul est dépréciatif) ; d’où la création d’une justice administrative spécifique, bien séparée du juge judiciaire, et contre laquelle des libéraux comme Tocqueville vont regimber tout au long du xixe siècle. Car l’idée est que l’État doit avoir sa justice à lui, que le Conseil d’État de Bonaparte, c’est « l’Administration se jugeant elle-même », chose indispensable puisque l’Administration seule peut apprécier l’orientation de l’action en fonction de l’intérêt général. Un juriste très respecté, Henrion de Pansey, a dit sous la Restauration : « Juger l’Administration, c’est encore administrer. » La formule est devenue un axiome des écoles de droit. Notons que le libéralisme au pouvoir, celui de Guizot et de l’orléanisme, défendra cette conception : ils refuseront avec constance de déférer le contentieux administratif (conflits entre le citoyen et l’État) à la justice ordinaire.
Si la conception régnante a été de protéger l’État contre les intérêts particuliers, réciproquement, l’État administratif préserve les individus de l’injustice des monopoles, des corps qui sont de facto « privilégiés », il veille aussi à ce que le lien d’égalité entre les citoyens soit préservé. Le juriste Maurice Hauriou définit en 1923 la « fraternité administrative » : « Le régime administratif dans son ensemble correspond à la catégorie de fraternité. Il a été créé pour des raisons de police [c’est-à- dire d’administration urbaine, voirie, hygiène, ordre public, etc.], mais son résultat est une assistance fraternelle. […] Dans tout service public, il y a une part d’assistance par le seul fait que le service, qui n’est pas payé également par tous, est fourni gratuitement à tous. On ne dira pas que, dans l’école primaire gratuite, il n’y ait pas une forme d’assistance » (Précis de droit constitutionnel, réédité en 1929).
Le doyen Hauriou explique que, par la fraternité, il entend une forme de solidarité entre les citoyens, qui a permis de contrer « l’action dissolvante des assemblées parlementaires », et avec succès, ajoute-t-il, puisqu’on a pu « résister déjà à quatre-vingts ans de suffrage universel ». On voit comment l’esprit de Napoléon se continue, à travers cette synthèse entre la liberté et la tutelle : l’État est foncièrement protecteur, il s’autolimite devant les libertés (publiques et individuelles), il n’est pas despotique. Il représente, comme dit encore le juriste, « un correctif nécessaire de l’individualisme ». On trouve ici le libéralisme à la française, celui qui a gouverné, qui était un libéralisme par l’État, et non contre l’État. Si l’on considère des dirigeants marquants du xxe siècle, comme Valéry Giscard d’Estaing ou encore Édouard Balladur, on voit bien en quel sens le courant libéral qui a gouverné en France – c’est-à- dire qui n’est pas resté oppositionnel – a toujours été mâtiné d’étatisme. Il est savoureux de lire cet avertissement du doyen Hauriou : « Il faut prendre garde que la fraternité administrative, qui est une lourde charge pour la production, ne verse pas dans un socialisme d’État qui ruinerait la production. » Parole capitale ! On croirait entendre la controverse sur les nationalisations, une cinquantaine ou une soixantaine d’années plus tard. Mais Hauriou lui-même ne craignait pas de proposer « l’incorporation graduelle des syndicats professionnels dans l’administration publique ». Les raisons avancées sont caractéristiques : lorsque les syndicats, en 1923, prétendent rendre l’adhésion obligatoire et régler la profession concernée, c’est insupportable ; mais s’ils deviennent « un rouage administratif », comme dit l’auteur, alors « on pourra leur reconnaître un droit de réglementation sur la profession », puisque l’intérêt général sera garant de l’ensemble.
L’Etat et la confiance
A. Thiers, discours du 7 mai 1833, in Discours parlementaires de M. Thiers, éd. m. Calmon, Paris, Calmann- lévy, tome ii, 1879, p. 103.
Id., ibid., 28 février 1834, p. 223-224.
R. Capitant, « l’aménagement du pouvoir exécutif et la question du chef de l’état », L’État, encyclopédie française, tome X, 1964, jamais réédité de façon intégrale. C. Eisenmann, « les fonctions de l’état », ibid., p. 291-311.
Il faut passer maintenant aux conséquences de cet héritage révolutionnaire et napoléonien. Il faut parler de la question de la confiance, qui est essentielle pour la démocratie libérale.
En considérant les choses sous l’angle historique, on peut dire que l’État, traditionnellement, n’a pas confiance dans la société, car il faut, à ses yeux, qu’elle soit protégée. Nous savons déjà quelle est cette protection : elle s’exerce contre les intérêts particuliers, les intérêts de corps, les intérêts aristocratiques, les intérêts religieux. Ce que l’on appelle « le public » est conçu comme le lieu nécessaire de la pacification et de l’intérêt le plus général, une pacification qui, en France, doit toujours être reconstruite, car elle est menacée par ce que l’on croit être (à tort et parfois à raison) un retour du passé.
Au fond, qu’est-ce que la légitimité de l’État, forgé par la monarchie, reconfiguré par la Révolution (sous l’emblème de la loi « expression de la volonté générale » et garantissant la liberté et l’égalité), puis repris en charge par les républicains ? La légitimité de l’État consiste à étendre le public, qu’il protège, et qui est le témoignage manifeste de sa protection. Jusqu’à une date très récente, en accroissant le domaine du public (la santé, l’enseignement, la culture, la nationalisation des grands moyens de production, de financement et de transport), l’État cultivait sa légitimité, car il montrait sa sollicitude pour la société. De façon significative, pendant la dernière campagne présidentielle, l’actuel président confirmait aux Français qu’il les « protégerait » – mais cette fois contre les dégâts causés par l’Europe ou par la mondialisation.
Inversement, la société, elle, est tenue d’avoir confiance dans l’État administratif. On l’a déjà dit, ce dernier s’est donné sa justice particulière ; à l’origine, le jugement administratif au contentieux était rendu par des membres issus de l’Administration, avant qu’on institue les tribunaux administratifs à recrutement spécifique. L’Administration était donc assurée de trouver une oreille très attentive dans la haute juridiction toutes les fois que des intérêts venus de la société civile émettaient des plaintes.
L’État aura également son élite, attachée à le défendre ; la question d’une école administrative spécialisée est posée dès le xixe siècle, notamment durant la IIe République, où une première ébauche est créée. Mais nous reviendrons, en troisième lieu, sur les élites.
Surtout, pour la vie locale, l’État sera longtemps réputé mieux savoir (compétence) et mieux gérer (indépendance et honnêteté). Il doit définir les besoins locaux à la lumière du point de vue d’ensemble et de l’intérêt général, qu’il peut seul appréhender. Il faut entendre, au moment où Tocqueville achève son premier volume sur l’Amérique, la façon dont Thiers repousse les demandes d’autonomie budgétaire en faveur des communes, grandes ou petites. Dans ce débat parlementaire qui l’oppose à des libéraux décentralisateurs comme Odilon Barrot, Thiers affirme une position qui est d’abord de principe – la centralisation est maintenant associée au système parlementaire, porteur de toutes les libertés :
« Je comprends que, sous l’Ancien Régime, on parlât de libertés municipales. Dans l’Ancien Régime, il n’y avait pas de Chambres. Quel était le moyen de résister au gouvernement ? C’était de se renfermer chez soi. […] Aujourd’hui que vous avez des Chambres, il est absurde de parler de libertés municipales. […] Ce sont les prétentions des grandes communes4. »
Entendez : ces grandes communes sont jalouses de Paris et, de façon générale, du pouvoir central. En outre, Thiers met en cause l’intégrité des maires (choisis depuis peu dans le corps municipal élu), il cite des exemples où une « féodalité » a été recréée, puisque, par arrêté municipal, une unique corporation est habilitée, dans tel port, à décharger les navires ; ailleurs, « vingt-deux familles » accaparent le marché de la poissonnerie sur la place publique; « quelquefois, [ces gens] transportaient leurs privilèges en les vendant ». Corporations, féodalité, privilèges acquis et transmis : c’est le répertoire sémantique classique contre ceux qui sont accusés d’entraver la marche modernisatrice de l’État et la compétence de l’Administration. De plus, si les communes peuvent voter leur budget, on verra les maires s’endetter de façon extravagante, poursuit l’orateur. Seul le ministre de l’Intérieur, explique Thiers, peut avoir, grâce à ses bureaux, la connaissance suffisante du coût des marchés, abattoirs et autres constructions dispendieuses. Dans ce débat de 1833- 1834, Thiers n’accepte même pas que le préfet exerce l’approbation préalable sur les arrêtés municipaux : il faut que ce soit le ministre lui-même, c’est-à-dire son cabinet ! Thiers fait l’éloge des bureaux parisiens, ce texte n’est pas sans intérêt aujourd’hui : « Dans l’administration centrale, je ne dis pas dans le ministre qui passe, mais dans les hommes qui restent, ces connaissances [du terrain] existent ; ils connaissent l’esprit de toutes les localités de la France, ils connaissent ses besoins, puisque ses besoins ont passé sous leurs yeux ; il faut toutes les connaissances de ces hommes pour réformer les arrêtés5. »
En somme, il faut que les communes accordent leur confiance au ministère de l’Intérieur (c’est le poste de Thiers en 1834), faute de quoi il n’y aurait pas un seul État, mais « trente-sept mille petits États » : le spectre du fédéralisme, si efficace depuis la Révolution et l’élimination des Girondins, est de retour !
Cependant, ce qui perturbe la confiance exigée envers l’État est le statut du pouvoir exécutif, une question lancinante dans l’histoire française. La vie politique a commencé avec le drame du régicide, qui a suscité par contrecoup la tendance des assemblées révolutionnaires entre 1789 et 1799 à renforcer de façon outrancière le principe de représentation de la nation, par les députés ou autres élus, au détriment de l’exécutif et, surtout, des fonctions même de gouvernement. La question « Qu’est-ce que gouverner ? » a été, étrangement, laissée de côté. Un ancien conseiller de Napoléon, Roederer, s’y risque sous Louis-Philippe. Peut-être faut-il aller jusqu’à dire que, avant Charles Eisenmann et le remarquable article de René Capitant6 en 1964, la fonction de gouvernement, comme exercice du leadership, programmation d’une perspective politique, direction des services administratifs, reste peu éclaircie. Maurice Hauriou affirme qu’il faut cesser de « subalterner », selon son expression, le pouvoir exécutif. Car, dit-il, le pouvoir exécutif est « seul un pouvoir d’entreprise ». La notion d’entreprise chez Hauriou est très importante pour analyser la vie des institutions : l’entreprise est cette pratique qui jouit d’une visée continue, d’une autonomie réelle et d’une confiance forte de la part de ceux qui y collaborent.
On peut dire que notre histoire est également celle des efforts du pouvoir exécutif pour :
1) capter la confiance et incarner l’État administratif ;
2) recevoir les vrais moyens de gouverner, contre les tabous pesant sur la fonction de chef de l’État.
C’est pourquoi nombre de clichés un peu faciles sur le « bonapartisme » et son supposé retour (de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy) mériteraient d’être plus affinés, en tenant mieux compte de la façon dont nous avons « raté une marche » dans la controverse constitutionnelle de mai-octobre 1789 ; puis dans l’élimination violente du premier « chef de l’État » en janvier 1793. Du coup, le fantôme de la monarchie a obsédé les républicains, comme on le voit dans les débats constitutionnels de 1795, 1848, 1871, 1958, 1962… La IIIe République est obligée de confier le gouvernement à un président du Conseil absent en réalité de la Constitution, et qui doit mendier la confiance devant les deux assemblées. La responsabilité du gouvernement devant les Chambres, en tant que technique efficace, n’arrive pas à se faire jour au xixe siècle, alors que l’Angleterre l’a résolue, avec pragmatisme comme toujours, depuis longtemps. Si la Ve République a trouvé la stabilité grâce au fameux parlementarisme rationalisé (ainsi l’article 49-3 ou la distinction entre la loi, domaine du législatif, et le règlement, attribut de l’exécutif), on ne peut pas dire que le passé ait cessé de nous poursuivre. Depuis 1958, chaque président se voit accusé, plus ou moins vite, d’exercer le pouvoir de façon monarchique.
« l’éducation et la sélection », reproduit dans la Revue française d’histoire des idées politiques, n° 22, 2005, p.355-379. Paru d’abord dans la Revue des deux mondes, 1er juin 1890, tome XCiX, p. 561-588.
On recommandera la riche étude d’olivier ihl, Le Mérite et la République. Essai sur la société des émules, Paris, Gallimard, coll. « nrf essais », 2007.
La présente note a été rédigée pendant le mouvement de protestation des enseignants-chercheurs au début de l’année 2009.
Vincent Descombes a pris pour thème explicite le caractère de corps, et même de corporation, qui doit être attaché au statut des universitaires : « l’identité collective d’un corps enseignant », la vie des idées.fr, mars 2009.
Sur le projet éducatif nécessaire à l’Europe, l’inspiration à tirer de la renaissance, voir mon livre à paraître : Nous autres Européens. Le sens commun et la règle dans la tradition européenne.
Une autre conséquence de la position symbolique prise par l’État sera, comme on le devine, de n’accorder de véritable légitimité qu’à l’élite d’État ou l’élite qui existe par la volonté de l’État. Comparativement, les élites de la société civile, qu’elles soient littéraires, artistiques ou économiques, ont joui d’un moindre prestige. Certes, l’entrée en scène des grands moyens médiatiques, l’attachement des Français au cinéma et au sport, les modes portées par la mondialisation, tout cela a changé les choses. On peut cependant noter que « l’État culturel », critiqué par Marc Fumaroli dans un essai célèbre, et l’État promoteur du sport sont des moyens de légitimation et de décuplement du vedettariat, moyens auxquels la puissance publique n’est pas étrangère. Parallèlement, ce qu’on appelle « pipolisation » (en francisant le terme people) emporte dans la même vague le personnel politique, les grands dirigeants d’entreprise et les « vedettes » de toutes sortes. En fait, le projet affiché de la démocratisation des loisirs, du sport et de la culture est au service de la légitimité de l’État.
Pendant longtemps, les élites légitimes, c’étaient les grandes écoles créées par la Convention, les grands corps d’ingénieurs ou de l’Administration, les individualités du barreau entrant en politique après avoir fait leur droit. Là encore, Maurice Hauriou sert de révélateur. Il rappelle que l’État républicain doit satisfaire à la prescription énoncée par l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789 :
« Tous les citoyens […] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
À cette citation (donnée p. 724 du manuel), Hauriou ajoute aussitôt : « C’est l’administration qui appréciera la capacité, les vertus et les talents. » Il ne craint pas d’appeler « faveur administrative » cette promotion méritocratique, dont il ajoute qu’elle « ne peut guère être organisée méthodiquement dans une démocratie que grâce à un pouvoir administratif qui soit à la fois discrétionnaire et d’équité ». On est donc encore loin de la réglementation des concours de recrutement administratif, mais il est intéressant aujourd’hui de relire les termes employés par l’un des grands juristes de la IIIe République, à la fois administrativiste et constitutionnaliste, et source d’influence jusqu’aux débuts de la Ve République. Un pouvoir à la fois « discrétionnaire et d’équité » : jolie formule, qui dit beaucoup sur notre histoire et sur cet État « autolimité » dont on a parlé plus haut !
Bien entendu, un tel pouvoir attendra énormément de l’école, Hauriou s’empresse de le dire, car « cette élite, il faudra la susciter, […] elle ne se trouve pas dans une classe de la nation comme dans les aristocraties ». Toujours revient cette idée que l’État républicain doit combattre les préjugés et l’injustice de la société aristocratique, mais se donner une organisation élitiste et aristocratique. « Aristocratie naturelle », disait déjà Guizot, « aristocratie des concours », dira la France postérieure à Jules Ferry.
Certains auteurs iront loin dans les tentatives pour préciser l’idée d’un élitisme proprement républicain. On peut citer l’article quasi extravagant de Fouillée, qui expose en 1890 un véritable darwinisme méritocratique. Il faut « trier », dit-il, les facultés les plus utiles à la société.
« L’éducation doit cultiver les facultés les plus hautes et les plus récemment développées dans l’espèce par la sélection : elle n’a d’autre but que de leur donner une fixité et une solidité plus grandes. » Nous renvoyons le lecteur intéressé à ce texte, qui conclut en faveur de « l’aristocratie démocratique » par laquelle la France saura faire face au socialisme et au nationalisme qui, en Allemagne, nous menacent pour « le début du prochain siècle »7. On ne peut pas dire que Fouillée soit une figure secondaire de la République, pas plus que son épouse, auteur du célèbre Tour de la France par deux enfants, sous le pseudonyme de Giordano Bruno, martyr de la libre-pensée.
Le problème qui tourmente cet élitisme cher à la vision française, c’est qu’il s’agit de fabriquer une élite dans l’égalité. Vouloir les deux en même temps, dans un pays qui ne connaît ni la continuité britannique de source aristocratique ni la radicalité américaine fondée sur la confiance dans l’individu promoteur de soi, conduit à des tiraillements douloureux et parfois à des hypocrisies. Sur ce plan aussi, comme on l’a vu pour le discours anticorporatiste recouvrant des pratiques corporatistes, une certaine schizophrénie se laisse observer. Sans doute nos systèmes à deux vitesses devraient-ils être analysés sous cet angle historique et, disons-le, culturel et idéologique8. Par exemple, dans l’enseignement considéré globalement, du collège aux études doctorales. D’un côté, il existe les grandes écoles, les concours et le service public de l’État, longtemps prestigieux ; de l’autre, le souci de la démocratisation et ses dérives : un véritable « droit au baccalauréat » s’est installé dans l’esprit des familles ; la progression du taux de réussite satisfait ce désir par un miracle toujours renouvelé. Il semble que, maintenant, un « droit au master » est en train de gagner ses titres de légitimité, la question de la sélection à l’entrée de l’université paraissant désormais taboue, au prix de plus de 40% d’échec en première année de faculté.
Cette association entre :
1) « l’élite dans l’égalité » ;
2) l’affirmation bruyante de l’égalitarisme malgré la disparité des situations et des moyens financiers ;
3) la défense de la dignité du secteur public est pleinement illustrée par la question universitaire.9
Ne pas envisager cette dernière à la lumière de notre expérience historique, c’est, inévitablement, courir au mécontentement et au refus de la part des membres de l’enseignement supérieur. L’étiquette valorisante d’enseignant-chercheur – et qui en réalité pose problème – n’adoucit nullement les susceptibilités ni les intérêts froissés. Il est caractéristique que la défense du corps se soit organisée autour de la thèse selon laquelle les professeurs sont « fonctionnaires de l’État » et que, comme tels, ils ne peuvent accéder aux attentes nouvelles, directement liées à l’uniformisation des systèmes d’enseignement, en Europe et dans le monde. Ils ne peuvent accepter de subir les logiques de la société civile, puisque, historiquement, tout a reposé sur la hiérarchisation et la séparation entre la dignité de l’intérêt général et la réalité empirique des intérêts locaux, familiaux ou économiques. Les professeurs sont un corps autonome, par rapport à la société civile, et un corps indivisible, en ce sens qu’on ne saurait régionaliser les concours, les évaluations, les promotions. Le ministre n’est pas l’« employeur » au sens de la vie d’une entreprise, car il oublierait que c’est l’État tout entier qui l’habilite ; pas plus que le président d’une université n’est un manager, car la logique défendue par les protestataires est celle d’un système qui unit des « pairs », ainsi qu’un gouvernement par les pairs.
De même, les professeurs qui ont exprimé leur indignation à l’hiver 2008 et au printemps 2009 considèrent qu’ils ne peuvent être classés, évalués et, surtout, placés en relation explicite de concurrence entre eux – comme des salariés de la sphère privée. On peut dire sans exagération (en comparant peut-être avec les parlements d’Ancien Régime) que l’élite se voit ici comme un corps d’État – indigné d’être « lâché » par l’instance de tutelle –, et non comme composé d’individus, astreints à réaliser une performance, évalués (y compris par les étudiants) et discutés en public10. Car on considère que cette « publicité » (au sens originel du mot) n’est pas celle que la France a défendue traditionnellement ; celle-ci ne protège pas le fonctionnaire, elle est trop susceptible de contamination par des considérations privées.
Au fond, l’État est foncièrement émancipateur parce qu’il est protecteur – tel est le grand message que les Français ont gardé de 1789 –, mais, en l’occurrence, on voit bien qu’il émancipe un esprit de corporatisme et non une responsabilité individuelle, avec les risques qui y seraient inhérents. Le grand projet éducatif qui a porté la conquête républicaine en France, qui a longtemps matérialisé l’« ascenseur social », montre maintenant ses limites dans le monde actuel et ses dysfonctionnements11.
Quelques perspectives sur la transition en cours
Depuis le 1er mars 2010, la question prioritaire de constitutionnalité permet au justiciable de demander, via le Conseil d’etat ou la Cour de cassation, le contrôle de la constitionnalité d’une loi par le Conseil Constitutionnel.
T. Jefferson, Écrits politiques, préface de J.-P. feldman, Paris, les belles lettres, coll. « bibliothèque clas- sique de la liberté », 2006, p.131.
Faut-il le rappeler, la connaissance historique ne saurait conduire au fatalisme. Je ne veux point dire que, comme dans la tragédie antique, nous n’échapperons pas à notre passé, et que nous verrons Œdipe tuer son père et épouser sa mère, quelque précaution qu’il prenne pour éviter le destin qui lui a été dévoilé ! Au contraire, la connaissance est ce qui permet de ne pas répéter des situations enfouies dans la mémoire nationale et de répondre, aussi, à la tentation des replis et des mélancolies qui détournent de l’avenir. D’ailleurs, si l’on peut parler de modèle (durant la campagne présidentielle, le « modèle social français » était évoqué), tout le monde sait que celui-ci est contesté, et même en crise profonde. Sous les effets de la construction européenne, aussi hésitante soit-elle maintenant, et de la mondialisation, l’État administratif doit renoncer à nombre de ses prétentions. Pour simplifier les choses, disons qu’il tend à devenir un partenaire, dans la société civile, à côté des autres. Il va même jusqu’à déléguer ou partager des fonctions régaliennes, par exemple en matière de sécurité. Cela est bien montré dans une étude de la Fondation pour l’innovation politique, rédigée par Frédéric Rouvillois, sous le titre L’Externalisation ou comment recentrer l’État sur ses compétences essentielles (avril 2008).
Il faudrait étudier les effets de la révolution constitutionnaliste que la France a connue depuis une trentaine d’années grâce à un Conseil constitutionnel dont la mission première était assez limitée (veiller sur les prérogatives de l’exécutif), mais qui s’en est affranchi de façon spectaculaire. De ce fait, les droits de l’individu et les libertés publiques sont appelés à une protection croissante, quoique complexe et controversée, qui n’existait pas sous l’ancien mode de fonctionnement, et qui fait apparaître un rôle de contre-pouvoir, que le Conseil adopte de façon grandissante. Le recours ouvert à l’opposition est devenu une voie banalisée.
De son côté, le Conseil d’État a montré depuis longtemps son esprit d’indépendance et le souci des droits et des intérêts du citoyen face à la puissance publique, grâce à des procédures comme le recours pour excès de pouvoir.
Il faudrait donc traiter de la démocratie libérale, du pluralisme et de la culture constitutionnaliste qu’elle suscite partout, mais notre objet était en fait l’autre face de la question : la vision héritée de longue date, dont les effets ne sont pas pour autant minimes dans les pratiques actuelles, d’autant moins, d’ailleurs, si les dirigeants tiennent peu compte de notre histoire. On sera donc bref sur les perspectives de rénovation et sur la transition dans laquelle la France est actuellement engagée.
La réforme constitutionnelle voulue par le président Sarkozy peut produire des comportements nouveaux, notamment dans les recours ouverts à la société, la capacité des citoyens à saisir le Conseil constitutionnel : l’exception d’inconstitutionnalité, selon le terme technique, relève d’une autre culture, d’une autre pratique du droit dans le rapport entre l’État et le lien social – ce qui était notre point de départ.12 La démocratie libérale peut trouver un rajeunissement dans ces nouvelles façons de faire vivre le droit.
La confiance ou plutôt le chèque en blanc qui était exigé au profit de l’État depuis 1789 semble un fait du passé. Peut-on rétablir un nouveau pacte de confiance ? Il faudrait des enquêtes et d’autres concepts pour répondre à la question. Remarquons simplement que, désormais, la légitimité de l’État se trouve confrontée à d’autres légitimités concurrentes, qui non seulement exigent une adaptation croissante de la généralité de la loi à la particularité de leur cas, mais défendent des identités spécifiques au sein de la société civile.
On voit bien comment, au-delà de l’interdit que posait Le Chapelier (pas de représentations concurrentes, pas de délibérations autonomes, pas de centres d’opinion spontanés), la société développe de façon croissante des revendications de légitimité et d’identités diverses. C’est d’ailleurs là un effet du pluralisme qui caractérise les démocraties libérales : les mouvements féministes, homosexuels, de santé publique, régionalistes, religieux, etc., prennent la parole pour obtenir de l’État lois et réformes ; ce qui est classique, dira-t-on? Mais, en même temps, ces mouvements s’adressent à l’opinion, entité qui tend à devenir plus forte que l’État, c’est-à-dire l’État national, ainsi que le montre Ulrich Beck, en traitant de la dimension du « transnational » (Pouvoir et contre- pouvoir à l’heure de la mondialisation). Les groupes qui font émerger des revendications qu’ils considèrent comme négligées ou refusées ne disparaissent pas après la satisfaction que la loi leur apporte – ils mobilisent à leur profit, ils cherchent à créer des regroupements durables et de type identitaire, qui suivent d’autres logiques que la conduite classique et balisée des partis politiques. L’espace politique est ainsi profondément remodelé, parfois émietté, et n’autorise plus à considérer l’État comme l’acteur à la fois central et en surplomb qu’il était traditionnellement.
Si, disions-nous au début, le personnel révolutionnaire visait à déplacer la politique de la société vers l’État et situait au sommet la fameuse « volonté générale » qui fait la loi, dans la nouvelle représentation de l’espace public – ou des diverses arènes de la vie publique –, la politique émigre de l’État, son lieu traditionnel, vers les groupes revendiquant une identité séparée. Par ce décentrement, par le crédit d’opinion qu’ils s’attirent et par les actions de mobilisation qu’ils mènent, ces groupes recherchent, peut-on dire, une forme d’autorité. Peut-être rejoignons-nous ainsi cette « autorité de la société » que, au xixe siècle, Lamennais avait anticipée et que Tocqueville a cru observer en Amérique, comme je le montre dans mon livre Tocqueville : les sources aristocratiques de la liberté (Fayard, 2008). Il ne faut pas oublier que le sens premier de la notion d’autorité est : ce qui s’attire une considération et une crédibilité. Parlant de l’Église comme « autorité », saint Augustin disait que si la compréhension des choses vient de l’intelligence, la foi « procède de l’autorité ». Nous assistons aujourd’hui, dans la démocratie où l’opinion est reine, à une translation et à une démultiplication des foyers d’autorité.
Dès lors, la politisation du lien social devient frappante, elle constitue, si l’on veut, une forme d’américanisation ; en tout cas, elle inverse une tendance lourde installée en 1789. Comme on l’a vu précédemment, cette politisation doit être prise non pas au sens de l’adhésion aux partis politiques, mais comme une revitalisation du lien social, une demande de parole participative, le sentiment d’avoir son propre mot à dire et le besoin d’aider à l’expression de celui des autres, qui sont les non-experts de la politique, et, du fait de leur statut de « simples » citoyens, mieux enracinés dans la vie sociale.
Il est dangereux de prophétiser, contentons-nous d’un diagnostic provisoire. Il semble que la société française, qui, très longtemps, a pratiqué de façon contradictoire le culte de l’État et le ressentiment envers l’État (au besoin par l’émeute et par la rupture de l’ordre constitutionnel), découvre une logique différente. Peut-être allons-nous vers une reconnaissance de divers contre-pouvoirs qui gagneraient leur légitimité en faisant valoir la réalité, diverse, pluraliste et conflictuelle de la société française. La légitimité reconnue aux contre-pouvoirs supposerait qu’une culture de la défiance, à la façon américaine, se développe, supplantant la vieille culture de confiance à l’égard de l’État et (par identification) à l’égard du chef du pouvoir exécutif, qu’il fût roi, empereur, président du Conseil ou monarque républicain. Ce serait alors consacrer l’une des formes du libéralisme, celle qui cherche, au moyen du pluralisme conflictuel, à traiter les conflits par le moyen de la règle de droit et à extraire l’unité de la diversité.
Selon cette conception, tout pouvoir ne peut avancer que dans les limites que lui laisse l’action d’un contre-pouvoir. Le changement serait grand par rapport à la culture politique française, qui a privilégié l’unité. Il est caractéristique qu’aux États-Unis, dans un texte qui fait référence, Jefferson ait expliqué que « le gouvernement libre est fondé sur la vigilance et non sur la confiance13 ». Pour cette conception républicaine qui voit dans la politique un mal inévitable, qu’est-ce donc que le gouvernement, sinon, comme le dit encore Jefferson, « une tyrannie que les hommes que nous avons choisis ont conférée à notre président » ? Il faut donc des moyens de résistance, un jeu de checks and balances (freins et contrepoids).
Reconnaissons-le, nous sommes en transition; il nous revient donc aujourd’hui d’opérer des choix avec le plus de clarté possible et en faisant le partage conscient entre la fidélité à nos usages, d’un côté, et, de l’autre, l’indispensable effort pour rénover.
Annexe : extrait d’histoire de La civilisation en Angleterre, Par H. T. Buckle
H.T. Buckle, Histoire de la civilisation en Angleterre, trad. a. baillot, Paris, a. lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865, tome ii, p. 323-325.
Pour un dernier coup d’œil vers le passé, il est bon d’écouter ce que disait de nous un historien trop oublié, Henry Thomas Buckle, dans son Histoire de la civilisation en Angleterre, aussitôt traduite en français (1865). Buckle ne manque pas de comparer l’Angleterre à la France, qu’il gratifie de l’appellation « esprit protecteur » (the protective spirit), ce qui ne devrait pas nous surprendre au terme de cet essai.
« Le peuple français, quoique grand et magnifique, plein de cœur et de courage, chez qui les connaissances abondent et, peut-être, de tous les peuples de l’Europe, celui que la superstition opprime le moins, a toujours été incapable d’exercer le pouvoir politique et, quand il l’a possédé, il n’a jamais su combiner la liberté avec la stabilité. L’un de ces deux éléments du pouvoir lui a toujours manqué. Il a eu des gouvernements libres qui n’ont point été stables ; il a eu des gouvernements stables qui n’ont point été libres. Grâce à son tempérament généreux, il s’est révolté ; et il est probable qu’il continuera à se révolter contre une condition aussi mauvaise. Mais il ne faut pas être prophète pour prédire qu’il faudra encore plusieurs générations avant que ses efforts portent fruits ; car l’homme ne sait être libre qu’autant qu’il a été élevé par la liberté, et cette éducation, ce n’est ni l’école ni les livres qui la donnent, c’est le frein que l’on s’impose à soi-même, la confiance en soi, le gouvernement du pays par le pays. Ces idées sont traditionnelles en Angleterre, nous nous en pénétrons dans la jeunesse, nous les adaptons aux règles de la vie. Les vieilles associations en France prennent toutes une autre direction : à la moindre difficulté, elles appellent le secours du gouvernement. Ce qui pour nous est concurrence, pour elles est monopole; ce que nous faisons par nos sociétés privées, le Français le fait par les administrations publiques. Il ne peut creuser un canal, construire une voie ferrée, sans faire appel au gouvernement. Il lève sans cesse les yeux vers ses chefs ; nos gouvernants suivent le peuple du regard. Chez lui le pouvoir exécutif est le centre d’où rayonne la société. Chez nous la société est l’instigateur et le pouvoir n’est que son instrument. Les résultats dans les deux pays sont aussi différents que les moyens d’action. Nous nous sommes rendus capables d’exercer le pouvoir politique par la longue pratique de nos droits civils ; le Français se borne à croire que quoiqu’il en ait négligé la pratique, il peut prendre le pouvoir14. »



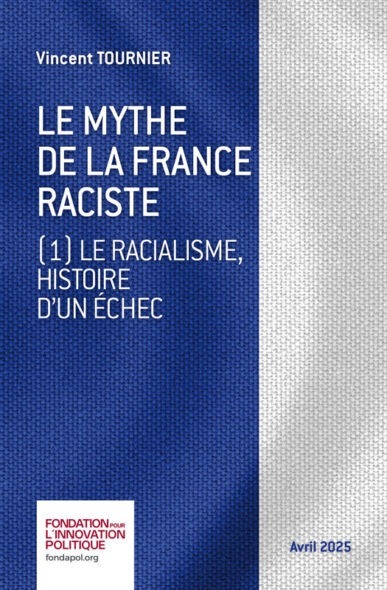









Aucun commentaire.