L'individu contre l'étatisme
Actualité de la pensée libérale française (XIXe siècle)Introduction
Le XiXe siècle ou l’âge d’or du libéralisme français de l’individu face à l’état
Comment, à la lumière de la révolution française, concilier démocratie et liberté ?
L’école libérale française d’économie à l’ère de l’industrialisation
Un libéralisme de l’individu, farouchement de gauche : le cas alain
Résumé
Même si nombre de ses citoyens et de ses élites intellectuelles semblent l’avoir oublié, la France n’est pas simplement le pays de Colbert et de la centralisation napoléonienne. Elle est aussi l’un des principaux berceaux de la philosophie libérale contemporaine et compte dans son riche patrimoine intellectuel un certain nombre d’auteurs majeurs qui se sont attachés à penser les rapports complexes entre l’individu, la société civile et l’État.
Ainsi, le XIXe siècle – période hantée dans l’Hexagone par le souvenir de la Révolution française – a vu l’apogée du libéralisme, même si celui-ci était composé de courants distincts. À côté du libéralisme conservateur, autoritaire et largement étatique, incarné par quelqu’un comme Guizot, cet âge d’or de la philosophie politique française a également vu l’éclosion d’un libéralisme de l’individu face à l’État. Non pas contre l’État, ni même contre un État fort, mais contre l’étatisme, c’est-à-dire contre un État obèse, instrumentalisé par les groupes de pression, et prétendant se mêler de tout sans même pouvoir assumer convenablement ses fonctions élémentaires.
Ce faisant, les libéraux français du long XIXe siècle qui, de Benjamin Constant à Alain, en passant par l’école libérale de Paris, ont cherché à défendre résolument les droits de l’individu face à un État jacobin et autoritaire hérité de plusieurs siècles de centralisation ont tracé la voie d’une réflexion politique qui reste éminemment précieuse aujourd’hui, alors que nous traversons une très grave crise de la représentation, doublée d’une quasi-faillite de notre modèle social.
Jérôme Perrier,
Normalien, agrégé d’histoire et docteur en histoire de l’ieP de Paris, enseigne l’histoire du libéralisme à sciences Po Paris et à l’université de Versailles-saint-Quentin-en-Yvelines.
Introduction
« the ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back. i am sure that the power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas. » John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, London, Palgrave Macmillan, 1936, pp. 383-384. On retrouve la même idée dans un célèbre texte de Friedrich A. von Hayek, « Les intellectuels et le socialisme » [1949], repris dans Essais de philosophie, de science politique et d’économie, Les Belles Lettres, 2007, p. 292.
en référence à l’ouvrage de Julien Benda, La Trahison des clercs, Grasset, 1957.
un terme qui est du reste ambigu et dont on déforme souvent le sens, comme nous le verrons.
Voir sébastien Caré, La Pensée libertarienne. Genèse, fondements et horizons d’une utopie libérale, PuF, 2009, Les Libertariens aux États-Unis. Sociologie d’un mouvement asocial, PuR, 2010.
Nous empruntons cette expression à Michael Freeden, « the family of liberalism: a morphological analysis », in James Meadowcroft, The Liberal Political Contemporary Reappraisials, edward elgar, 1996, p. 14-39.
Voir Lucien Jaume, L’Individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Fayard, Voir aussi, du même auteur, « Aux origines du libéralisme politique en France », Esprit, n° 243, juin 1998, p. 37-60.
La question de savoir quel est le poids des idées dans la vie politique d’un pays et dans l’élaboration des politiques publiques est un sujet de débat récurrent au sein des sciences humaines et sociales. Au XXe siècle, des penseurs aussi différents que Friedrich A. von Hayek et John M. Keynes n’ont cessé de répéter leur conviction selon laquelle « les idées comptent » (« ideas matter »), ce qu’expriment parfaitement ces célèbres lignes tirées de la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie : « Les idées, justes ou fausses, des philosophes de l’économie et de la politique ont plus d’importance qu’on ne le pense généralement. À vrai dire le monde est presque exclusivement mené par elles. Les hommes d’action qui se croient parfaitement affranchis des influences doctrinales sont d’ordinaire les esclaves de quelque économiste passé. Les visionnaires influents, qui entendent des voix dans le ciel, distillent des utopies nées quelques années plus tôt dans le cerveau de quelque écrivailleur de Faculté. Nous sommes convaincus qu’on exagère grandement la force des intérêts constitués, par rapport à l’empire qu’acquièrent progressivement les idées1. »
Rien n’illustre mieux la pertinence d’un tel propos que la situation présente de notre pays. En effet, beaucoup s’interrogent sur la résistance des Français devant la perspective de réformes engagées partout ailleurs depuis longtemps et sur leur étrange incapacité à appréhender la mondialisation autrement que sous la forme d’une menace vitale pour notre modèle social, voire notre identité nationale. D’aucuns attribuent cette singularité hexagonale au fait que des pans entiers de la société française jugeraient – non sans raison – que la libéralisation de l’économie remettrait profondément en cause certains avantages acquis et que, par conséquent, ils auraient plus à y perdre qu’à y gagner. En d’autres termes, le rejet par des secteurs entiers de la société française de la « mondialisation libérale » serait principalement le résultat d’un intérêt bien compris.
Un tel diagnostic soulève toutefois deux problèmes. D’abord, nul ne peut nier que le modèle social français, depuis déjà un certain temps, a atteint ses limites puisqu’il ne fonctionne guère plus pour une large partie de la population, tout en végétant au prix d’un surendettement qui en transfère la charge sur les générations futures, au point de nous conduire aujourd’hui au bord de la banqueroute. De plus, comme les marxistes jadis, nous avons trop souvent tendance à exagérer l’importance des intérêts dans l’explication des phénomènes sociaux (la surprise du Brexit en a apporté récemment une illustration éclatante), aux dépens des passions idéologiques, si vivaces dans un pays comme la France. Pour parler comme le philosophe Alain – que l’on a bien tort de ne pas relire davantage –, les intérêts transigent toujours, à l’inverse des passions, inflexibles par nature. Qui plus est, il n’y a pas d’intérêt en soi, mais uniquement l’idée que chacun se fait de ses intérêts. C’est pourquoi il paraît chaque jour plus évident que le blocage français est d’abord et avant tout un blocage de nature essentiellement idéologique. L’incapacité française à percevoir la mondialisation autrement que comme une menace relève d’abord et avant tout d’une idiosyncrasie idéologique qui est profondément enracinée dans notre culture politique. Un biais conceptuel qui confère aux élites intellectuelles françaises une immense responsabilité dans le profond désarroi que traverse notre pays (à ce propos, il ne faut pas hésiter à parler d’une nouvelle « trahison des clercs2»), et qui rend d’autant plus urgente la nécessité de s’interroger sur les racines de cette fièvre spéculative obsidionale, ainsi que sur les moyens d’y remédier au plus vite.
Car, bien entendu, il ne suffit pas de constater l’unicité de notre rapport à la mondialisation, encore faut-il l’expliquer. L’hypothèse qui, de notre point de vue, est la plus vraisemblable est que le biais intellectuel qui affecte notre appréhension de la réalité économique et sociale contemporaine est intimement lié à une autre singularité française, bien plus ancienne, à savoir notre rapport à l’État. Il est en effet assez manifeste que la mondialisation, telle qu’elle s’est développée depuis une trentaine d’années, a très profondément bouleversé la notion même de souveraineté étatique et la façon dont le pouvoir politique national prétend régir – ou tout au moins orienter – un phénomène aussi puissant et subversif. Or il est évident que dans un pays où l’État occupe une place aussi centrale et aussi ancienne que dans l’Hexagone, où la construction nationale est historiquement, plus que nulle part ailleurs, le produit de longs siècles de centralisation politique et administrative, la mondialisation actuelle ne peut qu’engendrer un désarroi intellectuel de très grande ampleur.
Et pourtant, la France jacobine, le pays de Colbert et de la centralisation napoléonienne, est aussi le berceau de l’une des plus riches traditions libérales – aux côtés du Royaume-Uni et des États-Unis. Mieux, bien que les Français (à commencer par le monde intellectuel et académique) semblent l’avoir complètement oublié, notre pays a vu naître et se développer, depuis plus de deux siècles, une école libérale d’une immense richesse et dont l’une des spécificités tient précisément à son rapport soupçonneux, et même franchement critique, à l’État.
Qui sait par exemple que pour désigner un libéralisme délibérément anti- interventionniste, les Anglo-Saxons utilisent communément un terme français, celui de « laissez-faire3» ? Qui sait également que l’ancien président des États- Unis, le républicain Ronald Reagan (qui ne passait pourtant pas pour un intellectuel féru de théorie), aimait à citer un libéral français mort en 1850, largement oublié chez nous mais immensément célèbre à l’étranger : Frédéric Bastiat ? Qui sait encore que, outre-Atlantique, les plus libéraux – ceux que l’on qualifie de « libertariens » et d’« anarcho-capitalistes4 » – se considèrent comme les héritiers du libéralisme français « optimiste » (une vertu bien oubliée aujourd’hui chez nous) du XIXe siècle, par opposition à un libéralisme britannique censé avoir abandonné la pureté doctrinale française du laissez- faire au profit d’un pragmatisme utilitariste, jugé par eux synonyme de dérive sociale et interventionniste ? Qui sait, enfin, que certains des courants libéraux récents dans le monde ont développé des thèses qui avaient été largement initiées par des auteurs français antérieurs ?
Voilà pourquoi cette note entend retracer succinctement les grandes lignes de cette école libérale française, en privilégiant quelques auteurs importants, et ceci dans le but de montrer combien cette tradition délaissée peut être – aujourd’hui plus que jamais – d’une immense utilité pour affronter intellectuellement les défis de notre époque, ce qui est un préalable indispensable à toute politique digne de ce nom. Bien sûr, le libéralisme qui sera évoqué ici n’est pas le seul courant de pensée qui, depuis deux siècles, peut prétendre relever de la « famille5 » libérale. Pour dire les choses de manière synthétique, il est possible de diviser le libéralisme français contemporain (c’est-à-dire postérieur à la Révolution française) en trois grands courants. D’abord, celui que Lucien Jaume a appelé le « libéralisme par l’État » (ou « libéralisme étatique6 »), et qui est certainement le mieux connu en France précisément parce qu’il donne le primat à l’État par rapport à l’individu – et aussi parce qu’il a été historiquement majoritaire au sein de la mouvance libérale. Il est du reste le seul à être vraiment étudié dans notre pays, d’autant qu’il a eu une traduction politique concrète, puisqu’il a compté en son sein quelques éminents hommes politiques, comme François Guizot et Adolphe Thiers au XIXe siècle, ou encore Valéry Giscard d’Estaing, qui se voulait dans les années 1970 le chantre du « libéralisme avancé ». Remarquons que ce libéralisme a souvent pris un visage conservateur, voire même parfois autoritaire. Dans tous les cas, il s’est parfaitement accommodé d’un interventionnisme politique très poussé, et c’est pourquoi il ne sera évoqué ici qu’accessoirement, dans la mesure où ce libéralisme étatique (voire étatiste) participe très largement du paradigme qu’il s’agit précisément, à nos yeux, de remettre en question si l’on veut pouvoir apporter des réponses nouvelles aux défis contemporains qui nous assaillent. Il existe dans notre pays un deuxième courant libéral, assez largement oublié de nos jours, à savoir le catholicisme libéral. Il s’agit là d’une mouvance très singulière dans l’histoire intellectuelle française, même si elle a compté au XIXe siècle quelques figures intellectuelles de grande envergure, comme Lamennais, Lacordaire ou encore le comte de Montalembert. Reste que nous ne nous attarderons pas sur ce courant très spécifique, dans la mesure où, tout au moins sur la question qui nous occupe ici, à savoir le rapport à l’État, il ne nous paraît pas avoir apporté de contribution véritablement originale par rapport aux deux autres.
Nous focaliserons donc notre analyse sur le troisième et dernier courant, qui ne fut peut-être jamais majoritaire au sein du libéralisme français mais qui a l’immense mérite d’apporter les idées les mieux à même de nous aider à relever l’immense défi qui est aujourd’hui le nôtre, à savoir la manière de penser un autre rapport entre l’État, la société civile et l’individu. C’est du reste certainement cette ambition qui explique que malgré sa richesse évidente, ce courant ait été largement oublié – pour ne pas dire refoulé – dans notre pays, alors même qu’il n’a jamais cessé d’être étudié à l’étranger. Ce courant, nous pouvons le qualifier de différentes manières, puisqu’il s’agit d’un libéralisme essentiellement attaché à défendre l’individu, si ce n’est contre l’État, en tout cas face à l’État, et indéniablement contre l’étatisme. Nous verrons d’ailleurs que cette philosophie a elle-même connu différents avatars, de la frange la plus laissez-fairiste et la plus anti-étatique (avec des accents que d’aucuns jugeront plus ou moins anarchiques) jusqu’aux auteurs plus modérés, uniquement soucieux de prévenir une emprise étatique trop forte, selon eux de nature à violer les droits fondamentaux de l’individu – et à freiner ses initiatives, source ultime de toute prospérité.
Nous nous attacherons donc à dessiner les contours de ce libéralisme de l’individu aux aguets face à un État virtuellement liberticide et objectivement proliférant. Pour ce faire, nous replacerons les diverses expressions de ce courant de pensée dans leur contexte précis et nous privilégierons les auteurs dont les œuvres nous paraissent les plus importantes et les plus utiles à relire aujourd’hui. De ce point de vue, nous nous concentrerons sur la période postérieure à la Révolution française, qui est l’événement fondateur de notre modernité politique, même si des auteurs antérieurs à ce jalon décisif – des penseurs du siècle des Lumières, en particulier – pourront être brièvement évoqués dans la mesure où certains d’entre eux sont des précurseurs du libéralisme contemporain (le mot lui-même apparaissant, comme chacun le sait, au début du XIXe siècle).
Le XiXe siècle ou l’âge d’or du libéralisme français de l’individu face à l’état
Nous partageons pleinement, de ce point de vue, l’avis exprimé par Pierre Manent dans Le Regard politique, Flammarion, 2010, 13-18.
Dans cette première partie de notre enquête, consacrée au XIXe siècle (qui constitue une sorte d’âge d’or pour la philosophie politique française contemporaine)7, nous examinerons comment les plus perspicaces représentants du libéralisme de l’individu ont cherché à (ré)concilier l’avènement de la souveraineté populaire et la sauvegarde des libertés, en insistant tout particulièrement sur la pensée politique de Benjamin Constant, qui reste sans conteste le meilleur théoricien de la démocratie libérale (A), avant d’étudier comment, sur le plan économique cette fois, cette même mouvance individualiste et anti-étatiste a pensé l’avènement concomitant de l’ère industrielle en développant une philosophie dont l’expression « laissez- faire » ne rend que très partiellement compte (B). Enfin, nous conclurons ce premier volet de notre étude en nous arrêtant sur la pensée politique d’un libéral de gauche, défenseur intransigeant de la liberté individuelle et censeur opiniâtre des pouvoirs, Alain (C).
Comment, à la lumière de la révolution française, concilier démocratie et liberté ?
Voir Aurelian Craiutu, Le Centre La pensée politique des doctrinaires sous la Restauration, Plon, 2006.
Ce qui n’a pas empêché l’anglophile Guizot de plaider, dès la Restauration, en faveur d’une intégration institutionnalisée de l’opposition au sein du régime Voir notamment François Guizot et la culture politique de son temps. Colloque de la Fondation Guizot-Val Richer, Gallimard/Le seuil, 1991.
Gérard Grunberg, Napoléon Le noir génie, CNRs éditions, 2015.
Voir Lucien Jaume (dir.), Coppet, creuset de l’esprit libéral. Les idées politiques et constitutionnelles du groupe de Madame de Staël, economica, 2000.
Voir notamment thierry Chopin, Benjamin Le libéralisme inquiet, Michalon, 2002, et stephen Holmes, Benjamin Constant et la genèse du libéralisme moderne, PuF, 1994.
Benjamin Constant, Principes de politique applicables à tous les gouvernements, II, chap. 4, in Étienne Hofmann, Les « Principes politiques » de Benjamin Constant, t. ii, Droz, 1980, p. 55.
Ibid., 1, p. 50.
Voir Lucien Jaume, «La fonction de juger dans le Groupe de Coppet et chez Alain», in Alain dans ses œuvres et son journalisme Actes du colloque organisé à Paris à l’occasion du cinquantenaire de la mort d’Alain les 30 novembre et 1er décembre 2001, institut Alain, p. 205-214.
Benjamin Constant, cit., liv. XiV, ch. 4, p. 366.
sur la manière dont le Conseil constitutionnel est devenu, de sa propre initiative, l’acteur décisif en matière de contrôle de la constitutionalité des lois dans notre pays, voir Francis Hamon et Céline Wiener, La Loi sous surveillance, Odile Jacob, 1999.
Benjamin Constant, cit., liv. iV, chap. 3, p. 85.
tout le monde aura reconnu Jacques Chirac qui, à l’occasion de la crise du Contrat première embauche (CPe), en 2005, a promulgué la loi tout en la suspendant instantanément.
Notons, toutefois, que Benjamin Constant a aussi écrit sur l’économie et défendu en la matière un libéralisme tout à fait cohérent avec sa vision des rapports que l’état, l’individu et la société civile devraient selon lui entretenir (voir son Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, Les Belles Lettres, 2004).
On peine aujourd’hui à imaginer combien notre XIXe siècle a été empreint du souvenir de la Révolution française et combien les Français de l’époque ont été littéralement obsédés par cet événement extraordinaire – dont certains se réjouissaient tandis que d’autres s’en désolaient, mais dont personne ne pouvait ignorer combien il avait stupéfié le monde entier et laissé dans notre pays des traces indélébiles. En particulier, toute personne qui, dans les décennies qui suivirent la Révolution et l’Empire, entendait méditer sur la politique se heurtait immanquablement à cette question lancinante : comment ce qui a commencé sous les auspices de la liberté a-t-il pu déboucher sur la Terreur, puis sur le régime autoritaire de Napoléon ? Ou, pour dire les choses autrement, comment la révolution libérale de 1789 a-t-elle pu déboucher sur le gouvernement liberticide du Comité de salut public de 1793 et sur le régime dictatorial consécutif au 18 brumaire ? La reconnaissance de la souveraineté nationale (c’est-à-dire l’affirmation du principe démocratique) serait-elle donc naturellement incompatible avec la préservation des libertés ?
Telle est incontestablement la question que se posèrent tous les libéraux français du XIXe siècle, même si leur réponse n’a pas toujours été la même, loin de là. Un courant, parfaitement incarné par Guizot et ceux que l’on appelle alors les « doctrinaires8 », estime que tant que les masses (majoritairement illettrées) n’auront pas acquis les moyens intellectuels et matériels nécessaires pour appréhender des questions relevant de l’intérêt général et resteront donc asservies à leurs passions irrationnelles ou leurs intérêts égoïstes, la liberté sera inévitablement en danger. D’où la volonté, magnifiée par Guizot, de substituer à la souveraineté du peuple une souveraineté de la raison, incarnée par la bourgeoisie, jugée par les doctrinaires comme la seule classe sociale apte à garantir la liberté politique contre les assauts conjugués de la caste aristocratique (nostalgique de l’Ancien Régime) et des masses populaires (analphabètes et anarchiques)9. Qu’un fils de guillotiné comme Guizot ait pu nourrir de farouches réticences à l’égard du principe démocratique – et donc du suffrage universel –, à une époque où aucun pays européen ne le reconnaissait, se comprend aisément. Pour autant, ce n’est nullement céder à l’anachronisme que de juger une telle philosophie plus conservatrice que véritablement libérale, d’autant que Guizot et ses amis restaient farouchement attachés à une centralisation administrative héritée de l’Ancien Régime et encore renforcée par le très illibéral régime napoléonien (comme l’a opportunément rappelé récemment Gérard Grunberg dans un stimulant essai)10.
Juger Guizot et la classe politique de la monarchie de Juillet finalement plus conservatrice et autoritaire que proprement libérale est d’autant plus légitime qu’il existait précisément à la même époque un vigoureux courant libéral qui, lui, faisait de la défense des droits individuels son absolue priorité, tout en veillant à rendre cette exigence compatible avec le principe même de la souveraineté populaire. De cet esprit authentiquement libéral et vigoureusement individualiste, nul n’est plus représentatif que Benjamin Constant et ce que l’on a appelé le « groupe de Coppet11 » (du nom du lieu de résidence de sa compagne Germaine de Staël). Cet intellectuel peut être à bon droit considéré comme l’un des plus grands théoriciens (et certainement le plus grand théoricien français) de la démocratie libérale, alors même que sa patrie d’élection ne lui a pendant longtemps pas accordé la place qu’il mérite.
Plus largement, force est de constater que dans les débats franco-français, si le mot « démocratie » est utilisé avec une frénésie à peine moins grande que pour le mot « république », la notion même de démocratie libérale est rarement comprise, alors même qu’elle s’avère plus que jamais indispensable pour formuler convenablement les problèmes qui sont les nôtres. Raison supplémentaire pour relire Benjamin Constant de toute urgence.
Benjamin constant, le grand théoricien français de la démocratie libérale
Pour bien comprendre combien le libéralisme de Benjamin Constant se distingue clairement, par la profonde méfiance qu’il exprime vis-à-vis du Léviathan étatique, de la vision autoritaire et centralisatrice de Guizot et des doctrinaires, il faut d’abord rappeler le contexte historique précis dans lequel s’est développée cette pensée entièrement dédiée à la sauvegarde des libertés individuelles.
Né à Lausanne en 1767 et mort à Paris en 1830, quelques mois après la fin de la Restauration et l’avènement de la monarchie de Juillet, Benjamin Constant écrit dans une France qui, en quelques années, est passée de la monarchie absolue d’Ancien Régime à la monarchie parlementaire, après avoir expérimenté successivement la dictature de Salut public de la Terreur, l’anarchie du Directoire et l’autocratie napoléonienne. Durant cette période ô combien agitée, la France n’a cessé d’alterner violemment entre anarchie et tyrannie. Or, aux yeux de Constant et de ses amis du groupe de Coppet, il s’agit là de deux formes d’arbitraire aussi condamnables l’une que l’autre. Et c’est précisément ce jugement qui va conduire ces authentiques libéraux à remettre fondamentalement en cause, non pas tant la souveraineté nationale que la notion de souveraineté elle-même, pourtant si prégnante dans la culture politique française.
Comme chacun le sait, le concept de souveraineté a été historiquement élaboré à l’époque moderne dans le but de mettre fin à l’anarchie qui régnait au temps des guerres de religion. En effet, les penseurs de la souveraineté comme Jean Bodin au XVIe siècle ou Thomas Hobbes au siècle suivant, ont jugé qu’une société ne pouvait exister durablement sans l’institution d’un pouvoir suprême qui aurait le monopole de la puissance publique et qui, par la force si nécessaire, serait à même de trancher les conflits, afin de garantir la paix civile. Tel est bien le sens du mot « souverain » : un pouvoir suprême, qui n’a rien au-dessus de lui. Source unique de l’autorité, le Léviathan (pour reprendre une image hobbesienne que nombre de libéraux reprendront pour mettre en garde contre sa toute-puissance) est donc pensé comme le remède imparable à l’anarchie. En ce sens, la notion de souveraineté a pu séduire un certain nombre d’auteurs pourtant réputés « libéraux », dans la mesure où elle semble devoir mettre les individus à l’abri de la violence anarchique et de la peur de la mort, deux maux caractéristiques de l’état de nature, où l’homme est supposé être un loup pour l’homme.
Néanmoins, il est facile de comprendre que dans une conception de ce genre, le pouvoir souverain peut aisément devenir tyrannique, comme l’ont montré la montée de l’absolutisme au XVIIe siècle puis, plus tard, l’épisode de la Terreur et de l’autocratie napoléonienne. C’est d’ailleurs bien cette dérive qui explique qu’aux yeux de Benjamin Constant le seul moyen d’éviter tout à la fois l’anarchie et le despotisme réside in fine dans la limitation de la notion même de souveraineté. En effet, pour cet éminent représentant du libéralisme de l’individu face à l’État, ce qui importe n’est pas tant la forme du gouvernement (monarchie parlementaire ou république, régime censitaire ou démocratique) que la stricte limitation dont le pouvoir (c’est-à-dire la souveraineté) doit faire l’objet, que ce pouvoir soit d’origine monarchique ou populaire. En effet – et c’est là une idée chère aux penseurs se rattachant au libéralisme de l’individu –, la source démocratique du pouvoir n’est pas une condition suffisante pour garantir le respect des droits et des libertés des personnes. Après tout, on peut très bien imaginer qu’un gouvernement élu par une majorité décide de priver de ses droits légitimes la minorité – y compris la plus petite des minorités qu’est l’individu. En effet, si on limite la démocratie à la stricte règle de la majorité – et si l’on applique de surcroît un positivisme juridique radical selon lequel la loi et le droit ne sont rien d’autres que les décisions du législateur –, qu’est-ce qui empêcherait 51 % des votants de spolier ou d’opprimer les 49 % restant ? En ce sens, un gouvernement de forme démocratique présente les mêmes risques et les mêmes dangers qu’un gouvernement monarchique. Voire même davantage, diront nombre de libéraux individualistes à la suite de Constant, dans la mesure où, imbu de son assise populaire, le gouvernement « issu du peuple » peut être davantage enclin à céder à une forme de hubris qu’un régime moins assuré de sa légitimité.
On peut noter en aparté que la difficulté que nous avons le plus souvent en France pour raisonner ainsi – en termes de démocratie libérale plutôt que de démocratie tout court – explique très largement l’embarras qui a naguère été celui de nombre d’observateurs hexagonaux lorsqu’il s’est agi d’analyser correctement ce qui s’est passé au moment des « printemps arabes ». D’aucuns ont alors oublié que le pouvoir de la rue ne pouvait déboucher sur un authentique État de droit que s’il était strictement canalisé par la sauvegarde inconditionnelle des libertés individuelles. D’où des circonvolutions assez hasardeuses pour expliquer, par exemple, que le « vrai » peuple égyptien n’avait pas voulu l’élection du président Morsi, mais qu’il se trouvait en revanche dans la rue pour renverser celui-ci (pourtant élu par les urnes). Faute d’utiliser le cadre conceptuel de la démocratie libérale (mais il est vrai que, chez nous, l’adjectif fait figure de gros mot…), certains en étaient donc réduits à postuler l’existence d’un bon (ou vrai) peuple et d’un mauvais (ou faux) peuple…
Mais pour revenir à Benjamin Constant et comme cela a été plusieurs fois souligné12, sa pensée politique peut être présentée comme une synthèse et un dépassement des deux réflexions politiques parmi les plus profondes du XVIIIe siècle français, à savoir celle, d’essence libérale, de Montesquieu, et celle, d’essence démocratique, de Jean-Jacques Rousseau. En effet, pour l’auteur de L’Esprit des lois, ce n’est pas la forme du pouvoir, c’est-à-dire le nombre de ses détenteurs, qui importe (monarchie, aristocratie ou démocratie), mais bien plutôt la manière dont celui-ci est exercé. En d’autres termes, le pouvoir est légitime lorsqu’il n’est pas illimité – autrement dit lorsqu’il est modéré. Et le meilleur moyen de le brider est encore la séparation et l’équilibre des pouvoirs (un message que les rédacteurs de la Constitution américaine retiendront en 1787). Rousseau, comme chacun le sait, réfléchit tout à fait différemment. L’essentiel pour l’auteur du Contrat social (qui raisonne dans le cadre d’une démocratie directe, il est vrai) est l’autonomie, c’est-à-dire le fait qu’un acte soit le résultat de la volonté de son sujet, ou, pour dire les choses autrement, que l’on vive sous une loi que l’on s’est soi-même donnée. Chez Jean-Jacques Rousseau, ce n’est pas la manière dont est exercé le pouvoir qui le rend bon, mais la manière dont il est institué. C’est pourquoi, à ses yeux, seule la république est légitime, puisqu’en permettant l’expression de la volonté générale elle autorise le peuple souverain à décider de la loi sous le règne de laquelle il vivra.
Si Benjamin Constant accepte le postulat démocratique rousseauiste selon lequel le pouvoir doit être l’expression de la volonté du peuple, il ne s’en contente pas et y ajoute la nécessité d’une stricte limitation de ce pouvoir, rejoignant ainsi la grande préoccupation libérale de Montesquieu. Pour Constant, en effet – et c’est là un thème qui sera au cœur de la réflexion de très nombreux libéraux français tout au long du XIXe siècle –, il ne suffit pas que le pouvoir soit légitime dans son origine, encore faut-il qu’il le reste dans son mode d’exercice. Autrement dit, un pouvoir ne saurait être légitime s’il n’est pas élu, mais il ne saurait l’être davantage s’il n’est pas strictement limité, cantonné dans ses attributions et maintenu à distance de l’espace privé individuel (la fameuse « liberté des Modernes » comparée à celle des « Anciens » à l’occasion d’une célèbre conférence prononcée en 1819 à l’Athénée royal). Ainsi, en cumulant les exigences démocratiques de Rousseau et les exigences libérales de Montesquieu, Benjamin Constant devient le premier grand théoricien français de la démocratie libérale – que l’on pourrait tout aussi bien définir comme une démocratie limitée par les droits inaliénables de l’individu. Ce qui conduit aussitôt Constant à développer trois autres idées qui, elles aussi, vont être au cœur du libéralisme de l’individu face à l’État au cours des deux siècles suivants : l’affirmation selon laquelle les droits sacrés de l’individu sont de nature à arrêter le pouvoir ; la remise en cause de l’idée de majorité toute-puissante ; et, enfin, la critique de la définition positiviste du droit. Reprenons rapidement chacun de ces trois points, qui heurtent de plein fouet la culture politique française, éminemment légicentrique jusqu’à la Ve République.
Si des théoriciens libéraux comme Montesquieu ou Madison fondent d’abord et avant tout la limitation du pouvoir sur sa division en plusieurs instances destinées à se contrôler et à se neutraliser mutuellement par le jeu des freins et des contrepoids (les fameux checks and balances au cœur des institutions américaines), Benjamin Constant, pour sa part, cherche d’abord et avant tout à limiter l’amplitude du champ d’intervention légitime du pouvoir et à circonscrire rigoureusement ce domaine à partir d’une règle intangible et absolue : les droits naturels de l’individu qui dessinent une sphère privée réputée inviolable par l’autorité sociale. « On peut, dira-t-on, par des combinaisons ingénieuses, limiter le pouvoir en le divisant, écrit ainsi Constant. On peut mettre en opposition et en équilibre ses différentes parties. Mais par quel moyen fera-t-on que la somme totale n’en soit pas illimitée ? Comment borner le pouvoir autrement que par le pouvoir ?13 » Pour celui que l’on peut à bon droit considérer comme le fondateur du libéralisme français de l’individu face à l’État, le point essentiel est « la limitation de la somme totale de l’autorité », autrement dit le strict endiguement du Léviathan étatique, qui constitue la sauvegarde ultime des droits et des libertés individuelles. Ce rigoureux cantonnement du pouvoir politique passe en effet par l’affirmation de la souveraineté (au sens de suprématie) de l’individu, dont les droits fondamentaux constituent une limite hors d’atteinte de la compétence légitime de la puissance publique.
L’affirmation de la suprématie des droits de l’individu s’articule chez Benjamin
Constant avec la critique récurrente de l’idée de majorité, corollaire de son refus de toute souveraineté absolue et illimitée (y compris populaire). À ses yeux, on l’a compris, le principe du consentement majoritaire est une condition nécessaire mais non suffisante de la validité d’un acte législatif : pour qu’un texte issu du pouvoir politique puisse recevoir le titre de loi, encore faut-il que ses dispositions n’empiètent pas sur les bornes définies par les droits individuels, fondamentaux et donc intangibles. « Le droit de la majorité est le droit du plus fort » écrit-il, avant d’ajouter : « Lorsqu’une autorité quelconque porte une main attentatoire sur la partie de l’existence individuelle qui n’est pas de son ressort, il importe peu de quelle source cette autorité se dit émanée, il importe peu qu’elle se nomme individu ou nation. Elle serait la nation tout entière, sauf le citoyen qu’elle vexe, qu’elle n’en serait pas plus légitime14. » Cette crainte de la tyrannie de la majorité – que partageront d’autres libéraux français comme Tocqueville – conduit Benjamin Constant à critiquer la conception de la loi qui est celle du positivisme juridique. La formulation la plus abrupte et la plus vulgaire de cette doctrine – assimilant strictement le droit à n’importe quel texte de circonstance dès lors qu’il est adopté par le législateur selon une procédure formellement démocratique – a été donnée dans les années 1980 par le député socialiste André Laignel, lorsqu’il a voulu faire taire les critiques de l’opposition en s’écriant en plein Palais- Bourbon : « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ! » Rien ne peut être plus éloigné de la conception du droit que se font les représentants du libéralisme de l’individu face à l’État législateur. Pour eux, en effet, le droit (celui qui touche aux libertés fondamentales) ne saurait dépendre du présent rapport de force politique, qui n’est que le résultat conjoncturel (et donc provisoire) des dernières échéances électorales. Un tel refus conduit nécessairement le théoricien de la démocratie libérale qu’est Benjamin Constant à désacraliser sciemment la loi positive – c’est-à-dire la loi de circonstance qui peut être adoptée par tel ou tel gouvernement, à tel ou tel moment, selon telle ou telle considération particulière. En effet, pour les libéraux appartenant à sa famille de pensée, l’obéissance à la loi ne saurait être aveugle et le citoyen ne saurait abdiquer son droit de la juger en conscience (une idée que l’on retrouvera, un siècle plus tard, chez cet autre libéral individualiste qu’est Alain)15. Pour reprendre les mots mêmes de Constant, la « conscience de chaque individu […] constitue un tribunal inflexible, qui juge les actes de l’autorité16 ».
Ainsi, le fondement de l’obligation d’obéissance à la loi repose sur l’appréciation de son contenu par le citoyen libre. Si c’est là une idée fort ancienne – comme le montre l’exemple bien connu d’Antigone –, il n’en demeure pas moins que les libéraux du groupe de Coppet, et Benjamin Constant au premier chef, opèrent ainsi un changement essentiel par rapport au « légicentrisme », caractéristique de la culture politique française. Par là même, ils jettent un doute décisif sur la sacralité dont jouit la loi, réputée être l’expression de la « volonté générale ». D’ailleurs, cette méfiance des libéraux à l’égard de la sacralité de la loi s’exprime très concrètement de deux manières. D’une part, beaucoup vont affirmer que les droits fondamentaux exposés dans une déclaration de principe doivent pouvoir être opposables à la loi positive : c’est ce que l’on appelle le « contrôle de constitutionnalité », qui aura toujours la faveur des libéraux, mais qui mettra presque deux siècles à s’imposer dans notre pays, tant il heurte notre culture politique légicentrique17. D’autre part, les libéraux vont s’attacher à défendre la société civile face à la toute-puissance de l’État et ne vont cesser de critiquer l’inflation législative (et réglementaire), qui s’est d’ailleurs considérablement accentuée au fil du temps. Déjà, à son époque, Benjamin Constant jugeait qu’en multipliant les lois, on multipliait « nécessairement les agents de l’autorité », donnant ainsi « à un plus grand nombre d’hommes du pouvoir sur leurs semblables » et doublant ainsi « les chances d’arbitraire18 ». On imagine sans peine ce qu’il penserait aujourd’hui. Mais il est vrai que la frénésie législative actuelle est en partie compensée par le fait que nombre de lois relèvent du pur affichage médiatique puisque leurs décrets d’application ne sont souvent jamais adoptés, sans même parler de l’inénarrable « susmulgation19 » inventée naguère par l’un de nos monarques républicains.
Si nombre d’aspects de la réflexion politique de Benjamin Constant se retrouvent chez d’autres penseurs (comme la crainte d’une tyrannie de la majorité qui hante l’œuvre d’Alexis de Tocqueville), l’auteur des Principes de politique reste indéniablement le penseur de la démocratie libérale le plus conséquent – et par conséquent le plus utile à relire pour appréhender les problèmes d’aujourd’hui. Il reste aussi le meilleur représentant français du libéralisme de l’individu au XIXe siècle, tout au moins pour ce qui concerne les questions strictement politiques20. Car si l’on veut avoir un aperçu complet de ce courant injustement oublié de nos jours, il convient d’aborder également les questions économiques, dans la mesure où, là encore, une très vivante école libérale française s’est alors illustrée par des contributions éminentes, dont la relecture s’avère aujourd’hui précieuse.
L’école libérale française d’économie à l’ère de l’industrialisation
sur ce sujet, voir l’excellente synthèse de Philippe steiner, La Science nouvelle de l’économie politique, PuF, 1998.
il serait exagéré de dire qu’il n’existe pas de travaux scientifiques français sur Jean-Baptiste say, mais force est de constater que les ouvrages de référence publiés en anglais n’ont toujours pas été traduits en français. Voir, par exemple, Richard Whatmore, Republicanism and the French An Intellectual History of Jean- Baptiste Say’s Political Economy, Oxford university Press, 2000.
C’est la raison pour laquelle, entre autres, l’empereur détestait Germaine de staël, qui présentait la circonstance aggravante d’être une femme.
il n’est pas anodin que ce soit à un universitaire canadien, Robert Leroux, que l’on doive la seule synthèse récente sur le sujet en français : Aux fondements de l’industrialisme. Comte, Dunoyer et la pensée libérale en France, Hermann, Voir aussi Leonard Liggio, Charles Dunoyer et le libéralisme classique français [1977], institut Coppet, 2014.
Notamment dans son ouvrage majeur, Human A treatise on economics (trad.fr. : L’Action humaine. traité d’économie, PuF, 1985).
Voir à ce propos la très intéressante contribution du regretté Michel Leter, « éléments pour une étude de l’école de Paris (1803-1852) », in Philippe Nemo et Jean Petitot (dir.), Histoire du libéralisme en Europe, PuF, coll « Quadrige Manuels », 2006, 429-509.
Pour une approche sociologique du mouvement, voir Lucette Le Van Lemesle, Le Juste ou le L’enseignement de l’économie politique, 1815-1950, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2004.
sur la question de l’utilitarisme britannique, l’ouvrage de référence reste le chef-d’œuvre du grand historien libéral élie Halévy, La Formation du radicalisme philosophique [1901-1904], PuF, 3 , 1995-1996.
Murray N. Rothbard, An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, ii, « Classical economics », edward elgar Publishing Ltd., 1995 (voir notamment le chapitre 1, « J.-B. say: the French tradition in smithian clothing », et le chapitre 14, « After Mill: Bastiat and the French laissez-faire tradition »).
Louis Reybaud, « Des largesses de l’état envers les industries privées », Journal des économistes, ii, 1842, p. 115 et 117.
Frédéric Bastiat, « L’état », Journal des débats, 25 septembre 1848 (reproduit in Frédéric Bastiat, Pamphlets, Les Belles Lettres, 2009).
Ambroise Clément, « De la spoliation légale », Journal des économistes, n° 83, 1er juillet 1848, 363-374.
La question consistant à savoir quand faire débuter le libéralisme économique français est malaisée, dans la mesure où certains auteurs des Lumières développent des idées qui, sur bien des points, annoncent leurs successeurs du siècle suivant. Turgot, d’Argenson (connu pour avoir notamment écrit qu’il convenait de « gouverner le moins possible »), Vincent de Gournay, les physiocrates (à commencer par leur chef de file François Quesnay), voilà autant d’auteurs que l’on pourrait à bon droit classer comme « libéraux », à ceci près que l’appellation n’existait pas encore21. De plus, pour ce qui est des physiocrates (dont on sait qu’ils eurent beaucoup d’influence sur quelqu’un comme Adam Smith), force est de constater que leur volonté de libérer l’économie d’Ancien Régime de ses multiples carcans en démantelant le vieux système mercantiliste s’accompagnait chez eux d’un éloge, bien peu libéral, du pouvoir fort – voire du despotisme éclairé – et de l’interventionnisme étatique, deux éléments peu compatibles avec la tradition que nous nous attachons à mettre en valeur dans ces pages. Surtout, les physiocrates écrivant avant la première industrialisation, ils développent une conception de l’économie qui repose sur l’idée selon laquelle seule l’agriculture est réellement productrice de richesses, ce qui limite bien évidemment la portée de leurs analyses. C’est pourquoi il nous semble que l’on peut, sans trop forcer la réalité, considérer que le véritable fondateur de l’école libérale française d’économie est Jean- Baptiste Say, qui sera d’ailleurs considéré tout au long du XIXe siècle comme l’équivalent hexagonal d’Adam Smith, ce qui ne fait que renforcer le sentiment d’étonnement et d’injustice face au quasi-oubli dans lequel il est tombé aujourd’hui dans son propre pays22.
Jean-baptiste say, le fondateur de l’école libérale française d’économie
Jean-Baptiste Say a été l’exact contemporain de Benjamin Constant, puisque les deux hommes sont nés la même année (1767) et morts à deux ans de distance (Say est mort en 1832). Ce n’est du reste pas leur seul point commun, car les deux hommes étaient protestants, viscéralement attachés à l’idée de liberté individuelle, acquis aux principes libéraux de 1789, et ils allaient tous deux se heurter à l’autoritarisme napoléonien (Say, comme Constant, a été révoqué du Tribunat en 1804, pour avoir refusé d’amender son Traité d’économie politique dans le sens voulu par Bonaparte, qui détestait l’indépendance d’esprit des
« idéologues »)23. Encore aujourd’hui moins lu dans son propre pays que Benjamin Constant, Jean-Baptiste Say n’en mérite pas moins d’occuper dans l’histoire de la pensée économique une place éminente, dans la mesure où l’homme est bien plus que le simple épigone d’Adam Smith, auquel on le réduit trop souvent. En effet, si pour Say la science économique commence véritablement avec La Richesse des nations, il est injuste de ne voir en lui que le simple « vulgarisateur » de l’économiste écossais. En réalité, sur un certain nombre de points importants, il a su prendre ses distances avec son maître et faire preuve d’une indéniable originalité. Il suffit pour s’en convaincre de prendre quelques exemples, qui aideront à mieux comprendre pourquoi Jean- Baptiste Say a été considéré par les économistes libéraux français du XIXe siècle comme leur incontestable inspirateur et pourquoi son Cours d’économie politique leur a pour ainsi dire servi de bible.
Contrairement à Adam Smith – et creusant ainsi un sillon dessiné avant lui par des économistes français du XVIIIe siècle, comme Cantillon –, Say estime que le principe de la valeur n’est pas le travail (notion objective), mais l’utilité (notion subjective). Loin d’être anodin, ce point est absolument décisif puisque, ce faisant, Say montre à la pensée économique le chemin de l’avenir. En effet, cette idée centrale sera reprise et approfondie dans les années 1870 (simultanément par l’Anglais Jevons, l’Autrichien Menger et le Français Walras) pour donner naissance à la « révolution marginaliste », à l’origine de toute l’économie contemporaine. Jean-Baptiste Say a là une bonne longueur d’avance sur l’économie politique anglaise de son époque, puisqu’il élargit et précise la notion de richesse. Pour lui, en effet, tout ce qui est utile mérite d’être appelé richesse : les services du médecin, de l’avocat, de l’artiste ou encore du fonctionnaire (les stars du football ou de la télévision, pourrait-on ajouter aujourd’hui) sont des « produits immatériels » qui, du point de vue économique, peuvent parfaitement être assimilés aux fruits de la terre ou aux fabrications industrielles, en ceci qu’ils répondent à un besoin et ont donc une utilité sociale. Dès lors, il ne saurait y avoir de « classe stérile » ou d’occupations stériles, et seule l’oisiveté mérite une telle épithète.
Mieux, alors qu’Adam Smith reste largement influencé par les physiocrates qui professent que l’industrie est moins productive que l’agriculture, Jean- Baptiste Say mesure quant à lui parfaitement ce qu’a changé la première industrialisation. Pour dire les choses autrement, Say est un homme de son temps, qui s’attache à penser la société industrielle de son époque, comme le feront certains de ses disciples libéraux, à l’image de Charles Comte (1782- 1837) ou Charles Dunoyer (1786-1862), eux aussi totalement oubliés de nos jours dans leur propre pays, alors même que leurs écrits annoncent, par bien des aspects, certains courants libéraux contemporains, y compris les plus radicaux24.
Pour illustrer la modernité du fondateur de l’école française libérale d’économie qu’est Jean-Baptiste Say, on pourrait aussi invoquer sa fameuse « loi sur les débouchés » (ou « loi de Say », selon laquelle « l’offre crée sa propre demande »), mais un autre aspect de son œuvre, moins connu, est encore plus révélateur de son importance dans l’histoire de la science économique. Il s’agit du rôle central que l’auteur du Cours d’économie politique donne, dans ses analyses, à la figure de l’entrepreneur. En effet, en distinguant le revenu de l’entrepreneur (qu’il appelle le profit) du revenu du capitaliste (qu’il appelle l’intérêt), Say fait de ce personnage le pivot de l’activité économique, là où, outre-Manche, les deux économistes libéraux qui dominent largement le XIXe siècle, David Ricardo (1772-1823) et John Stuart Mill (1806-1873), vont largement ignorer ce point de vue, pourtant si fructueux.
À dire vrai, le mot entrepreneur n’a pas été inventé par Say, puisqu’il est déjà utilisé au XVIIIe siècle par des économistes français comme Cantillon ou Turgot. L’originalité de Jean-Baptiste Say vient plutôt de ce que l’analyse qu’il en fait dépasse largement le sens banal que ce mot peut avoir dans le langage courant, à savoir celui d’un individu désireux d’investir et de fonder une entreprise, que ce soit dans le secteur industriel ou tertiaire. Chez lui, l’entrepreneur est un acteur central du développement économique, et c’est pourquoi ses écrits annoncent sur ce point ceux que développeront au siècle suivant les économistes libéraux autrichiens, en particulier Ludwig von Mises (1881-1973) et son élève Israel Kirzner (né en 1930). Le premier cité considère en effet que le passage de la théorie classique de la valeur (la valeur-travail) à la théorie subjective de la valeur (la valeur-utilité de Say approfondie plus tard par les notions de rareté et d’utilité marginale) a constitué une véritable révolution qui va bien au-delà de l’économie. Ainsi, explique Mises25, la production des richesses n’est pas le résultat de l’action d’un seul facteur de production (à savoir le travail), mais elle est le fruit de la combinaison de plusieurs facteurs (comme la terre, le travail et le capital). Or c’est précisément l’entrepreneur qui est chargé de combiner ces différents facteurs, afin de servir au mieux les consommateurs. Dès lors, pour Mises et Kizner, les profits de l’entrepreneur sont d’autant plus importants qu’il réussit mieux à procurer aux consommateurs ce qu’ils demandent le plus intensément. Ainsi la réussite entrepreneuriale consiste à anticiper l’évolution d’un marché en combinant et en recombinant de manière intelligente et efficace, voire prémonitoire, ces facteurs de production, en vue de satisfaire soit des besoins existants, soit des besoins nouveaux. In fine, l’entrepreneur peut espérer s’imposer face à ses concurrents et saisir de nouvelles occasions de profit ignorées jusque-là en offrant au consommateur le meilleur produit au meilleur prix. C’est dans la pertinence d’un tel pari (d’une telle spéculation, au sens propre du terme) que réside la qualité principale de l’entrepreneur qui, chez les économistes autrichiens, possède les mêmes attributs que lui attribuait déjà Jean-Baptiste Say plus d’un siècle auparavant : l’attention aux désirs souverains des consommateurs, l’esprit de combinaison agençant au mieux les facteurs de production et, enfin, l’intuition nécessaire pour deviner l’évolution du marché. Voilà donc un exemple concret – mais il serait possible d’en trouver d’autres – du caractère à la fois original et novateur de l’œuvre de Jean-Baptiste Say, qu’on ne saurait décidément réduire au statut de simple vulgarisateur d’Adam Smith. Et l’on comprend mieux dès lors que son œuvre ait pu, durant presque un siècle, faire office de référence et de pierre angulaire pour ce qu’il convient d’appeler l’« école libérale française d’économie ». Celle-ci – que l’on appelle aussi parfois « école de Paris » – a compté un grand nombre de figures, souvent très célèbres à leur époque (et encore étudiées aujourd’hui à l’étranger), mais largement méprisées en France, aussi bien dans les milieux académiques qu’éditoriaux.
L’école de paris 26, bastion continental d’un libéralisme optimiste et inébranlable
Cette école française est généralement affublée d’une double caractéristique, qu’il convient toutefois d’expliciter : elle est réputée être « optimiste » et « laisser-fairiste », par opposition à un libéralisme utilitariste dominant outre- Manche et beaucoup plus pragmatique concernant la question – centrale pour les libéraux – de l’intervention de l’État dans l’économie. Ce dernier point mérite que l’on fasse d’emblée une précision : l’expression « laissez faire » (ou « laisser faire ») est bel et bien d’origine française, et elle est devenue d’usage courant dans la littérature anglo-saxonne (dans sa langue d’origine), mais le mot n’a pas le sens qu’on lui donne le plus souvent. Il ne veut pas dire que ces libéraux entendent refuser tout rôle à l’État. En réalité, la maxime originelle est : « laissez faire, laissez passer ». Attribuée par Turgot à Vincent de Gournay (lors de l’éloge funèbre qu’il fit de celui-ci en 1759), cette expression remonte au XVIIe siècle, lorsque le marchand Legendre avait répondu à Colbert, qui lui demandait ce que l’État pouvait faire pour l’aider : « Laissez-nous faire » – sous-entendu : laissez-nous produire et échanger librement, sans interférer inutilement dans nos affaires. En d’autres termes, l’expression de libéralisme du « laissez-faire » peut à bon droit entendre résumer la philosophie du libéralisme de l’individu face à l’État que nous décrivons ici, mais si et seulement si nous l’entendons dans son sens originel : non pas le refus d’accorder à l’État le moindre rôle, mais bien plutôt la volonté de préserver l’initiative de la société civile face à un État aux prétentions dirigistes et interventionnistes croissantes. Ce point mérite que l’on s’y attarde, car la caricature du « laissez-fairisme » des libéraux français a toujours été un moyen pour leurs adversaires de les discréditer en préférant l’invective au débat.
Ces économistes libéraux français du XIXe siècle, disciples déclarés de Jean- Baptiste Say, vont dès les années 1840 se regrouper autour d’une revue, le Journal des économistes, qui, de 1841 à 1940, sera le point de ralliement de tous les libéraux défendant vigoureusement la liberté individuelle contre l’emprise croissante de l’État. Leur actif réseau va aussi se structurer autour d’un cercle de réflexion, la Société d’économie politique, et d’une très active maison d’édition, la librairie Guillaumin27. Ce faisant, ils vont parvenir à former, en marge de l’université, un puissant lobby libéral, que d’aucuns vont appeler « école de Paris » ou encore « école libérale de Paris ».
Au risque de déranger bien des idées reçues, force est d’admettre que cette école libérale française du XIXe siècle incarne une vision souvent plus inflexible dans son refus de l’interventionnisme étatique que son pendant britannique. C’est que la plupart des libéraux hexagonaux, en bons héritiers des Lumières, considèrent la liberté comme un droit « naturel », là où leurs homologues d’outre-Manche, influencés par l’utilitarisme benthamien et millien, rejettent cette notion de droit naturel, tout en acceptant un degré non négligeable d’interventionnisme étatique dès lors que celui-ci est destiné à favoriser « le plus grand bonheur du plus grand nombre » (objectif déclaré de la doctrine utilitariste)28. À tel point qu’un siècle plus tard des libertariens américains verront dans ces libéraux français de l’école de Paris des précurseurs, voire des modèles29. Le cas le plus extrême étant celui du Franco-Belge Gustave de Molinari (1819-1912), un temps directeur du Journal des économistes et qui, dans un article resté fameux mais qui rencontrera l’hostilité de tous ses amis libéraux, ira jusqu’à théoriser la privatisation de la police ! On comprend aisément qu’une prise de position aussi radicale puisse être invoquée aujourd’hui par des anarcho-capitalistes américains pour faire de Molinari leur précurseur, mais l’honnêteté oblige à ajouter que tous les écrits de l’intéressé sont loin d’être aussi extrémistes et qu’une telle spéculation est apparue comme parfaitement marginale, pour ne pas dire incongrue, à la plupart des libéraux français de l’époque, même les plus anti-étatistes. En réalité, Molinari – a fortiori dans ce texte très particulier – incarne la frange la plus radicale, voire la plus extrême, d’une mouvance très riche en individualités diverses et variées quant à leur tempérament et leurs prises de position, mais qui partagent tous un attachement viscéral à la liberté individuelle et une méfiance instinctive à l’égard d’un État qui se voudrait trop interventionniste et/ou paternaliste. Il ne saurait être question, ici, de mentionner tous les noms – plus ou moins célèbres en leur temps – qui peuvent être rattachés à cette mouvance individualiste et anti-étatiste, mais on peut néanmoins en citer quelques-uns, en distinguant globalement trois générations qui couvrent l’ensemble du XIXe siècle. La première est celle des précurseurs, comme Benjamin Constant, Germaine de Staël, Jean-Baptiste Say, Charles Comte ou encore Charles Dunoyer. La génération suivante va globalement de la fin de la monarchie de Juillet au début du second Empire, et comporte nombre de représentants, dont les plus illustres sont Frédéric Bastiat, Adolphe Blanqui, Michel Chevalier, Charles Coquelin, Gilbert Guillaumin, Jean-Gustave Courcelle-Seneuil, Joseph Garnier, Édouard Laboulaye, Hyppolite Passy ou encore Horace Say (fils de Jean-Baptiste). Enfin, une troisième génération correspond à la fin du second Empire et au début de la IIIe République, avec des gens comme Henri Baudrillart, Maurice Block, Émile Boutmy (le fondateur de l’École libre des sciences politiques), Clément Colson, Gustave de Molinari, Yves Guyot, Paul Leroy-Beaulieu, Frédéric Passy, Léon Say (fils d’Horace et petit-fils de Jean- Baptiste), Edmond Villey, etc.
Autant d’auteurs qui s’inscrivent parfaitement dans cette famille idéologique du libéralisme de l’individu face à l’État auquel nous consacrons cette note, malgré la nature très diverse de leurs écrits (tous ne sont pas des économistes de profession) et malgré leurs différences, voire leurs désaccords, sur des sujets non négligeables. Ainsi, la grande majorité d’entre eux sont farouchement anticolonialistes, même s’il y a des exceptions comme Paul Leroy-Beaulieu (pourtant toujours cité, comme si son apologie du colonialisme était représentative de l’ensemble du libéralisme français).
Il convient par ailleurs de remarquer que la pensée libérale des publicistes de l’école de Paris est une philosophie du droit, avant d’être une réflexion économique s’intéressant à la production, à la distribution et à la consommation de richesses. En effet, si nombre d’entre eux se considèrent comme des « économistes », à une époque où, rappelons-le, la professionnalisation du métier était bien moindre qu’aujourd’hui, cela ne veut en aucune façon dire qu’ils ont une conception technicienne de ce que l’on appelle alors l’« économie politique » (et qui recouvre un domaine largement plus extensif que la science économique actuelle). De fait, les libéraux français du XIXe siècle écrivent sur tous les sujets qui ont un rapport de près ou de loin avec les grandes questions de nature politique, économique et sociale, et force est de constater que les écrits qui nous parlent encore aujourd’hui sont ceux qui développent une véritable théorie de l’État et de la démocratie. En effet, ce sont ces textes-là qui méritent amplement qu’on les relise avec la plus grande attention, dans la mesure où ils conservent de surprenants échos jusque dans l’actualité la plus immédiate.
des libéraux hostiles à l’étatisme et à l’instrumentalisation du pouvoir politique, pas à l’état
À ce propos, une vision trop rapide des choses suggérerait que ce qui sépare les libéraux « laissez-fairistes » de l’école de Paris du libéralisme gouvernemental, autoritaire et étatiste des doctrinaires, c’est que le premier, dans une veine quasi anarchisante, militerait contre l’État, tandis que le second s’accommoderait volontiers d’un pouvoir fort, centralisé et interventionniste. Or les choses sont infiniment plus complexes, dans la mesure où, comme nous l’avons déjà dit, les libéraux de l’école de Paris sont bien davantage opposés à l’étatisme qu’à l’État lui-même. En effet, ils dénoncent moins un État fort qu’un État obèse et tatillon, qui prétendrait intervenir à tout bout de champ, et cela dans des domaines qui, selon l’orthodoxie libérale, devraient rester en dehors de ses compétences légitimes – essentiellement régaliennes. Pour dire les choses autrement, les libéraux français qui gravitent autour du Journal des économistes veulent en réalité remettre l’État à sa place, c’est-à-dire à strictement parler, le replacer dans l’espace public, alors même que l’action des gouvernants, trop perméables aux groupes de pression (en quête de subventions et/ou de protections tarifaires), aboutit à une véritable privatisation de l’État au profit de castes ou de catégories professionnelles privilégiées. Ainsi, loin de cultiver l’inaction de l’État, le « laissez-fairisme » de l’école de Paris repose moins sur une passivité revendiquée que sur le refus d’instrumentaliser les pouvoirs publics en couvrant de sordides intérêts privés et particuliers du manteau rutilant de l’intérêt général.
Qui sont, d’ailleurs, aux yeux des libéraux français, ceux qui profitent ainsi de l’État à des fins privées ? Là encore, à rebours de certaines idées reçues, il convient de noter une différence majeure avec le Royaume-Uni. En effet, outre-Manche, les libéraux affrontent surtout une aristocratie foncière déterminée à défendre ses privilèges et ses rentes par le biais d’une législation protectionniste rigoureuse (elle le peut d’autant mieux qu’elle occupe une place centrale au sein de la classe politique anglaise, notamment à la chambre des Lords). En France, les libéraux orientent davantage leur dénonciation de l’instrumentalisation de l’État vers une critique sans concession d’un patronat trop souvent en quête de subventions et de protections – alors même qu’aux yeux des libéraux conséquents les authentiques patrons devraient s’adonner aux activités de l’entrepreneur, tel que le décrivait Jean-Baptiste Say. C’est ce que résume fort bien l’homme de lettres et homme politique Louis Reybaud (qui se fit connaître grâce à un roman à succès, Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale) dans un article paru en 1842 : « Toute industrie se repose désormais sur l’État du soin de lui assurer des bénéfices tranquilles, uniformes, constants. Au moindre trouble apporté dans l’équilibre de son existence, c’est vers le Trésor public qu’elle se tourne en criant à l’aide et en invoquant les droits acquis. […] Habituer les industries privées aux largesses de l’État, c’est leur rendre un détestable service, c’est tourner leur activité vers l’intrigue, c’est déplacer le mobile qui les animait. […] Cela durera jusqu’à ce que ce système périsse par ses excès, et qu’il n’y ait plus en France que des industries mourantes auprès d’un Trésor tari30. »
Cette pratique consistant à soutenir ce que l’on appelle aujourd’hui des « canards boiteux » (c’est-à-dire des entreprises non compétitives) à coups de subventions et de protections (et donc aux frais du contribuable et du consommateur) aura un bel avenir dans notre pays, notamment au nom de la lutte contre le chômage et du patriotisme économique.
Les libéraux français de l’école de Paris, dont beaucoup sont des hommes de gauche, ne cessent quant à eux de rappeler que c’est au plus grand nombre – et donc aux plus modestes – que les hommes de l’État demandent de payer ce dont bénéficient quelques riches privilégiés, choisis selon des critères plus ou moins avouables, qui relèvent parfois du pur « copinage » politique. Et les gens modestes payent doublement : en tant que contribuables, d’abord (c’est en effet par l’impôt que l’on finance les subventions), et en tant que consommateurs, ensuite (la protection tarifaire dont jouissent quelques happy few se traduit par des produits plus chers sur le marché national). C’est là un point décisif que résumera parfaitement le plus célèbre des membres de l’école de Paris, Frédéric Bastiat, fondateur en 1846 de la Ligue du libre- échange, inspirée de l’Anti-Corn Law du Britannique Richard Cobden. Dans un texte justement célèbre, Bastiat rappellera à ses concitoyens qu’en toutes circonstances il convient de faire la part entre « ce que l’on voit » (en l’occurrence les quelques emplois sauvés à coups de taxes et de subventions) et « ce que l’on ne voit pas » (les emplois plus nombreux encore, qui sont détruits du fait de la perte de pouvoir d’achat que provoquent ces taxes et ces subventions chez des consommateurs qui ne peuvent dès lors consacrer cette partie de leur revenu aux consommations qu’ils avaient préalablement prévues).
Frédéric Bastiat est aussi célèbre (tout au moins à l’étranger) pour avoir donné cette mémorable définition : « L’État, c’est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde31. » Si la formule est bien connue, on en sous-estime généralement la portée en voulant la réduire à une sorte de boutade. Or lorsqu’on regarde attentivement comment fonctionne la société contemporaine et les réclamations tous azimuts qui assaillent quotidiennement les responsables politiques, on comprend aisément que l’on puisse créditer Bastiat – et plus largement l’école de Paris – d’une certaine forme de prophétisme. Qui plus est, ses mises en garde sont d’autant plus précieuses qu’à l’heure de l’information immédiate et continue il est plus que jamais facile de « vendre » à l’opinion « ce que l’on voit » sur les images (tels salariés heureux de pouvoir conserver provisoirement leur emploi…) que de lui faire comprendre « ce que l’on ne voit pas » (tous ceux qui ne trouveront pas d’emploi du fait de la dilapidation de l’argent public…).
Il convient par ailleurs de souligner que l’école libérale de Paris s’emploie à critiquer le système des primes et autres subventions, non pas au nom d’on ne sait quel anarcho-capitalisme avant la lettre, mais bien au nom de l’intérêt public ou, si l’on préfère, au nom d’un service public authentique, correspondant à la vision d’un État au service de tous (de l’intérêt général), et non pas au profit de minorités agissantes (puissantes parce qu’ayant de solides réseaux au sein de l’establishment politico-administratif ou parce qu’ayant une forte capacité de nuisance politique). Ainsi, lorsqu’ils dénoncent avec fougue la politique protectionniste qui vise à protéger un petit groupe de producteurs nationaux de la concurrence étrangère, les libéraux français réputés « laissez- fairistes » entendent d’abord et avant tout défendre le modeste consommateur, qui se voit condamné à acheter à un prix plus élevé ce qu’il aurait pu, sans interférence politique, se procurer à meilleur compte sur un marché libre. Il ne s’agit donc pas, pour nos libéraux, de défendre la libre concurrence au nom d’une obsession d’ordre idéologique, mais parce qu’ils constatent que les consommateurs sont infiniment plus nombreux que les producteurs. Dès lors, en bons démocrates, ils jugent que l’intérêt de ceux-là, réellement général, devrait prévaloir sur celui des petites mais puissantes minorités agissantes que constituent les riches producteurs et leurs relais politiques, incarnations d’un scandaleux capitalisme de connivence.
Pour dire les choses plus simplement, les libéraux de l’école de Paris prétendent défendre les masses contre les élites, les gens modestes contre les capitalistes, les petits contre les gros ! Ou, si l’on veut raisonner en termes purement partisans et au risque là encore de surprendre, les libéraux dits « laissez-fairistes » se situent indéniablement à gauche de l’échiquier politique. Croire d’ailleurs qu’il y a là quelque paradoxe, c’est faire preuve d’anachronisme, comme nous le verrons un peu plus loin avec l’exemple d’Alain, autre libéral de gauche. En attendant, remarquons qu’en affirmant que l’intérêt général n’est pas incarné par le producteur (voire même par le travailleur), mais par le consommateur, les libéraux français du XIXe siècle anticipent – une fois de plus – l’une des affirmations les plus récurrentes du libéralisme économique du siècle suivant, telle qu’on la retrouvera formulée chez des auteurs aussi différents que l’Autrichien Ludwig von Mises ou l’Américain Milton Friedman, sans oublier l’école du Public Choice qui, à la suite de James Buchanan et de Gordon Tullock, développera à partir des années 1960 une critique du « marché politique » qui ne fera qu’approfondir la problématique générale que nous venons d’exposer.
La critique de l’instrumentalisation de l’État à des fins privées s’accompagne aussi chez les libéraux français de l’école de Paris d’une défense intransigeante de la propriété (considérée par la plupart d’entre eux comme un droit naturel) et d’une condamnation virulente de ce que certains d’entre eux appellent alors la « spoliation légale ». En effet, si Jean-Baptiste Say (à la suite d’Adam Smith) s’est beaucoup interrogé sur le processus de création des richesses, ses disciples qui gravitent autour du Journal des économistes entendent prolonger les réflexions du maître en s’interrogeant sur les différents modes d’acquisition des subsistances dans la société moderne. C’est ainsi que, dès 1825, dans L’Industrie et la Morale, Charles Dunoyer estime que, dans la société postrévolutionnaire de son temps, le progrès s’identifie à la victoire de l’« industrie » (un mot qui a alors le sens général d’activité productive) sur la « passion des places », nouvel avatar des privilèges d’Ancien Régime.
Une vingtaine d’années plus tard, Frédéric Bastiat reprendra son combat, même si sa mort prématurée, en 1850, à l’âge de 49 ans, ne lui permettra que d’esquisser la philosophie de la « spoliation » qu’il entendait établir. Selon Bastiat, les nations modernes sont souvent présentées comme divisées en « trois classes » : l’aristocratie, la bourgeoisie et le peuple. Mais là où les socialistes concluent qu’il y a le même antagonisme entre les deux dernières classes qu’entre les deux premières (la bourgeoisie ayant simplement pris la place de l’aristocratie pour mieux dominer et exploiter le peuple des prolétaires), Bastiat pour sa part ne voit dans la société que deux classes : les gens qui gagnent leur vie par leur propre travail, et ceux qui subviennent à leurs besoins en captant des revenus prélevés par l’État sur l’ensemble de ses concitoyens, que ce soit par le couple impôts-subventions ou par une politique de protection douanière. C’est là du reste une idée que l’on retrouve chez pratiquement tous les auteurs représentant la mouvance individualiste et anti-étatiste de l’école de Paris. C’est le cas par exemple d’Ambroise Clément, qui est d’ailleurs à l’origine de l’expression « spoliation légale ». Dans un article portant ce titre et paru dans Journal des économistes en juillet 184832 (soit donc un mois après les journées révolutionnaires de juin), Clément explique ainsi que « le Vol est la violation de la propriété », et que si ses formes sont extrêmement variées (la violation de propriété pouvant être illégale lorsqu’elle est pratiquée par un particulier recourant à la violence physique, ou officielle lorsqu’elle est organisée par l’État recourant à la force légale), on « peut toujours le reconnaître à ce caractère, qu’il prive de tout ou partie de la propriété ceux qui l’ont créée par le travail, ou à qui elle a été librement transmise par ses fondateurs, pour la donner à d’autres qui n’y ont aucun de ces titres ». Outre qu’il y voit une chose immorale, Clément – comme tous ses amis libéraux – juge que cette iniquité est aussi un non-sens économique, puisqu’elle contribue à affaiblir (ou même à « supprimer entièrement ») les « motifs du travail et de l’épargne », décourageant dès lors irrémédiablement « les habitudes d’activité et de prévoyance en les privant de leur récompense naturelle ».
Ce faisant, Clément est assurément emblématique du courant le plus radical du libéralisme français du XIXe siècle, comme lorsqu’il énumère les différents types de spoliations légales pratiquées via l’instrumentalisation privée de l’État : les « vols aristocratiques et monarchiques » (à vrai dire plus prégnants outre-Manche qu’en France, où la Révolution a considérablement affaibli le pouvoir de nuisance de la noblesse) ; les « vols réglementaires » (le « pouvoir que s’est attribué le gouvernement de régir certaines professions, d’en soumettre l’exercice à son autorisation préalable et de limiter le nombre des personnes qui peuvent s’y livrer ») ; les « vols industriels » (ce que Frédéric Bastiat appelle pour sa part le « sisyphisme » et que l’on appellera plus tard la « politique de l’emploi », c’est-à-dire une politique consistant à subventionner les entreprises non compétitives ou à les protéger à coups de barrières douanières) ; les « vols philanthropiques » (la « charité légale, c’est- à-dire opérée par le gouvernement au moyen des contributions publiques ») ; et, enfin, les « vols administratifs » (que l’école du Public Choice s’attachera à décrire un siècle plus tard en montrant que l’Homo bureaucraticus, comme l’Homo politicus et l’Homo œconomicus, obéit à des mobiles qui relèvent plus souvent de l’intérêt personnel bien compris que de l’intérêt général).
Il serait erroné – comme on l’a fait trop souvent – de réduire ces critiques libérales à la simple expression des intérêts d’une classe bourgeoise peu encline à partager les richesses tirées de ses propriétés ou de son travail avec les nouvelles classes laborieuses et dangereuses. C’est ce que montre parfaitement le réquisitoire sans concession dressé par nombre de libéraux contre un pouvoir bureaucratique alors en plein essor. Il s’agit en effet là d’un trait commun à tous les courants du libéralisme, mais que l’on retrouve aussi par exemple chez le philosophe Alain. Un penseur qui, au tournant des XIXe et XXe siècles, incarne un individualisme farouchement démocratique et républicain, passionnément de gauche et résolument attaché à la défense des faibles contre les puissants.
Un libéralisme de l’individu, farouchement de gauche : le cas alain
Jérôme Perrier, Le Libéralisme démocratique d’Alain, Institut Coppet, 2015 (avec une préface d’Alain Madelin).
Voir notamment Alain, Propos d’économique, Gallimard, 1935.
Pour un aperçu plus développé de ces questions, voir Jérôme Perrier, « Le problème de l’intérêt général dans la pensée d’Alain : un utilitariste libéral au pays de Rousseau ? », Revue française d’histoire des idées politiques, n° 41, 2e semestre 2015, 231-260.
« Propos » du 12 décembre 1911.
Il peut paraître surprenant, au premier abord, de vouloir rapprocher Alain de l’école de Paris (ou, plus largement, de la tradition libérale), dans la mesure où l’inventeur des « Propos » n’a jamais revendiqué une telle filiation intellectuelle. Et pourtant, comme nous l’avons montré ailleurs33, celui qui aimait à se définir comme radical était tout autant un démocrate affirmé qu’un libéral caché.
De fait, durant toute sa vie, Émile Chartier est resté le petit boursier, fils d’un modeste vétérinaire et pur produit de la méritocratie républicaine, furieusement attaché à la défense du petit peuple contre les « Importants » (c’est-à-dire les puissants : ministres, généraux, académiciens, bureaucrates et autres riches propriétaires). C’est d’ailleurs cette volonté de résister aux pouvoirs, quels qu’ils soient, qui est à l’origine de son engagement politique, ce qui l’éloigne indiscutablement du libéralisme élitiste, conservateur et viscéralement méfiant à l’égard des « masses » (tel qu’on le trouve chez un Guizot ou un Tocqueville, par exemple). Mais cela le rapproche en revanche du libéralisme de l’individu face à l’État, tel que nous venons de le décrire. C’est du moins ce que nous allons essayer de démontrer.
défendre le citoyen-contribuable
Il existe différentes voies pour aborder le libéralisme d’Alain, dans la mesure où il s’agit d’un libéralisme qui, tout en ne disant pas son nom, s’avère complet, tout à la fois économique, politique et philosophique (au sens large du terme). Mais commençons par ce qui est peut-être chez lui le moins important (encore qu’il y ait consacré beaucoup de « Propos »)34 : son libéralisme économique. L’ardent républicain qu’est Alain rappelle d’abord très souvent que le citoyen est aussi un contribuable et que les initiatives des gouvernants ne peuvent exister que pour autant qu’ils ont le pouvoir de les financer en piochant à leur guise dans les poches de leurs mandants. D’où la nécessité, pour ces derniers, de tenir la bride serrée sur le cou des hommes de l’État (politiciens et bureaucrates), volontiers dilapidateurs de l’argent des autres. Alain dénonce ainsi de manière récurrente la frénésie de travaux publics en tous genres, comme dans ce « Propos » typique du 6 janvier 1907, où il déplore : « Le sous-sol de Paris est ravagé dans tous les sens par d’invisibles taupes. Quand je pense au prix du mètre courant, je me demande toujours si les voyageurs se multiplieront aussi vite que les voies de communication. […] Ainsi se font beaucoup d’entreprises, non par l’effet des besoins du consommateur, mais par l’effet des besoins du producteur. »
Comme on l’a vu, la défense intransigeante des consommateurs face aux puissants groupes de pression des producteurs est un thème récurrent de la littérature libérale, qui s’accommode à merveille du souci démocratique consistant à prendre systématiquement la défense du citoyen modeste contre tous les pouvoirs. C’est donc dans une veine tout à la fois libérale et de gauche, et dans un style à nul autre pareil, qu’Alain prend sans relâche la défense des pauvres consommateurs/contribuables pressurés par les riches producteurs alliés (au sens parfois familial du terme) aux puissants bureaucrates et aux prodigues politiciens. Ici, comment ne pas penser au célèbre pamphlet de Frédéric Bastiat, que nous avons déjà évoqué, consacré à « ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas » ? En effet, à ceux qui disent que les grands travaux créent des emplois, il est facile de rétorquer que ces grands travaux ont aussi tué des emplois : ceux qui auraient été créés grâce à un autre usage que les gens auraient pu faire (volontairement) de l’argent affecté (autoritairement) par les pouvoirs publics aux ouvrages de leur choix. En d’autres termes, pour faire vivre les entreprises de travaux publics, on sacrifie les marchands de chaussures ou les vendeurs de livres, dont les produits ne trouveront pas preneurs, puisque le pouvoir d’achat nécessaire à leur consommation a été redirigé autoritairement vers les constructions, dont l’utilité a été décrétée d’en haut. Là encore, comment ne pas penser à une foule d’exemples, depuis les lignes de TGV (de plus en plus nombreuses et de moins en moins rentables) jusqu’au Concorde (bijou supersonique sorti de brillants cerveaux d’ingénieurs, tout à leurs prouesses technologiques, mais assez peu soucieux de rentabilité), en passant par l’épidémie de ronds-points dont notre pays a le record en Europe, sous l’impulsion – la connivence ? – conjuguée des élus locaux et des entreprises de BTP. Mais on pourrait tout aussi bien citer nos centrales nucléaires, autre record français, ô combien plus problématique ! En effet, après avoir construit un parc de centrales totalement surdimensionné, les pouvoirs publics ont bien dû leur trouver un débouché. C’est pourquoi, les ministres successifs, conseillés par un hyperactif corps des Mines, ont décidé de développer le « tout électrique », au point que la France détient désormais un autre record européen : celui du pourcentage de personnes se chauffant à l’électricité.
Si cette frénésie a atteint son apogée aux riches heures de la technocratie gaulliste triomphante, elle a des racines bien plus anciennes et l’on comprend aisément pourquoi Alain revient fréquemment sur cette idée, qui lui vaudra la réputation tenace d’incarner la quintessence du grincheux contribuable « gaulois ». Ainsi, le 18 juin 1907, l’auteur des propos reprend son combat contre le lobby des ingénieurs d’État par ces mots : « Et il me paraît évident, quand je vois ces taupinières élever partout leurs petits tas de terre remuée, que toute cette production de tunnels a été abandonnée aux inspirations des ingénieurs, intéressés, comme les vignerons, à produire le plus possible sans voir au-delà. Et je m’imagine que le bureaucrate et le législateur n’ont pas songé un seul moment qu’il pût y avoir trop de tunnels sous Paris. “Abondance de métro ne nuit pas”, telle a été leur maxime ; absolument de la même manière qu’ils avaient dit, après le phylloxéra “abondance de vin ne nuit pas”. »
défendre le citoyen-consommateur
Mais le libéralisme économique d’Alain ne saurait se mesurer uniquement à sa dénonciation réitérée du gaspillage de l’argent public et aux multiples « éléphants blancs » financés avec l’argent du contribuable. Il s’accompagne chez lui d’une critique plus pointue des méfaits de l’interventionnisme, comme on le voit par exemple dans sa défense du libre-échange. Et là encore, ce combat place l’auteur des Propos du côté des libéraux les plus cohérents – a fortiori à une époque où le protectionnisme méliniste domine une large partie de la classe politique française, y compris chez ses amis radicaux. C’est ainsi que l’on peut lire sous sa plume, le 2 août 1906 : « Lorsque le législateur se met en tête de protéger l’industrie nationale, alors commence pour le consommateur l’ère des privations physiques et des satisfactions morales. D’abord, les douanes barrent la route aux produits étrangers, qui seraient moins chers et meilleurs que les produits nationaux. Le consommateur se console en dégustant, par les yeux, l’étiquette aux couleurs nationales ; ces choses-là nourrissent l’âme. Les producteurs nationaux se faisaient concurrence ; c’était à qui fabriquerait le mieux, et au meilleur marché ; mais bientôt ils comprennent les bienfaits de l’union ; ils s’entendent donc pour fabriquer moins bien et vendre plus cher. Ici le consommateur grogne, parce que les satisfactions morales lui manquent ; et c’est une période difficile pour le protectionnisme. Mais le prudent législateur, en même temps qu’il aperçoit le mal, aperçoit le remède : payer des primes à l’exportation, de façon que le producteur national trouve encore du bénéfice à vendre à vil prix à l’étranger ce qu’il vend très cher à ses compatriotes. Et voilà les produits nationaux vendus et achetés dans tout l’univers ; et voilà les statisticiens qui notent un excédent de l’exportation sur l’importation. Il n’en fallait pas plus au noble consommateur, pour le consoler de tous ses maux. Il se dit qu’il appartient à une grande nation […]. Pendant ce temps, il y a de l’autre côté de la frontière des consommateurs qui vivent à très bon compte, et se félicitent de l’invasion des produits étrangers. Mais ce sont des âmes molles, qui préfèrent le plaisir à la gloire. »
Un tel « Propos », tout empli d’une ironie mordante, aurait pu être écrit par Bastiat. C’est bien la verve du croisé du libre-échange que l’on croit retrouver dans cette dénonciation alerte des mensonges de toute politique protectionniste qui, derrière la rhétorique bien huilée de l’intérêt national et/ ou général, ne fait que déshabiller le consommateur Pierre pour habiller le producteur Paul, le tout enrobé de flonflons patriotiques qui laissent de marbre le pacifiste Alain. Comme elle laisse de marbre tous les libéraux individualistes (eux aussi d’ardents pacifistes, pour la plupart), qui savent qu’une nation est composée de personnes différentes et que ce qui sert les intérêts des uns ne sert pas forcément ceux des autres. Ici, le point commun entre Alain et les libéraux de l’école de Paris, c’est qu’ils visent tous un système de connivence entre les hommes de l’État et certains industriels qui ont l’heur de disposer des relais adéquats au sein de l’establishment politico-administratif, tout ceci aux dépens du consommateur-contribuable qui trinque comme toujours. De même qu’il donne du travail à certains producteurs chargés de l’édification des « éléphants blancs » voulus par le pouvoir (aux frais de tous les contribuables), le capitalisme de connivence, par sa politique protectionniste, nourrit certains producteurs politiquement privilégiés, aux dépens de l’ensemble des consommateurs.
Mais il serait toutefois erroné de penser qu’Alain, lorsqu’il parle d’économie, ne se fait que le porte-parole acrimonieux du consommateur-contribuable. Son authentique libéralisme s’enracine en effet beaucoup plus profondément dans une philosophie morale et sociale, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler Adam Smith et sa fameuse « main invisible ». Une philosophie – celle de l’harmonisation naturelle des intérêts – dont se réclament d’ailleurs volontiers les libéraux de l’école de Paris.
La main invisible alinienne
C’est sans doute dans le « Propos » paru le 11 août 1909 que la parenté entre la pensée d’Alain et celle d’Adam Smith est la plus évidente, au point que le philosophe français, à la prose toujours fleurie, semble y esquisser sa propre parabole de la célèbre « main invisible » (même s’il est vraisemblable que, contrairement à son grand ami Élie Halévy, il n’ait jamais eu la curiosité de se plonger dans la Richesse des nations, qui ne faisait pas partie du Panthéon des œuvres qu’il aimait à relire indéfiniment)35. La scène se déroule sur le quai d’une gare : « Cet employé n’aime pas mes malles, écrit Alain, mais il aime le pourboire. Tout à l’heure vous verrez tous ces gens très civilisés prendre les wagons d’assaut, occuper les meilleures places et boucher les portières. Voyez cet homme qui court du guichet à la consigne. C’est sans doute un homme doux et pacifique. Voyez pourtant comme ses talons frappent la terre, et comme il se précipite en buffle, le front en avant. Croyez-vous qu’il pense à l’ordre public, à la justice, aux règlements ? Pas le moins du monde ; il fait son trou dans la foule ; il cherche son bien, sa malle, sa place. Et ma foi, venez ; j’en vais faire autant. » Et Alain d’ajouter : « C’est pourtant vrai, me disais-je, que, sur toute la terre, chacun marche tête baissée vers son plaisir ; ce sont tous ces obstinés désirs qui tissent, hissent, traînent, poussent. Et il faut bien que cela s’arrange en une espèce d’ordre, comme lorsque l’on secoue le blé dans le van ; le grain va ici, la balle s’envole plus loin. Ainsi se tassent les foules, réalisant ainsi une espèce de bien général, auquel pourtant personne ne pense. »
Il est bien difficile, en lisant ces lignes, de ne pas penser à celles-ci, tirées de La Richesse des nations d’Adam Smith, et qui constituent sans doute le plus célèbre passage de la littérature économique mondiale : « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ; et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage. » Qu’Alain ait pensé ou non à Adam Smith en écrivant ces lignes importe finalement assez peu. Ce qui est sûr, c’est qu’il aime à opposer les apparents égoïstes aux altruistes de façade, dont les discours sirupeux, saturés de références à l’intérêt général, masquent en réalité des intentions autrement moins avouables. Pour Alain, en effet, il ne suffit pas d’invoquer à tout instant l’intérêt général ou d’afficher ostensiblement une abnégation bêlante pour servir réellement son prochain. Ce sont même là, la plupart du temps, des ruses trop faciles, uniquement destinées à légitimer l’égoïsme des puissants, si habiles à cacher leurs desseins véritables. Derrière l’invocation grandiloquente de l’intérêt général se devine en effet « neuf fois sur dix, quelque intérêt particulier36». Autrement dit, lorsque certains politiciens en manque de popularité disent vouloir, au nom de l’intérêt général, lutter contre les intérêts particuliers que seraient supposés incarner les milieux économiques, il convient d’être on ne peut plus prudent – ne serait-ce que parce que, aux yeux d’Alain, toutes les élites sont liées les unes aux autres, et que les politiques et les grands capitaines d’industries sont intimement mêlés, fréquentant les mêmes salons et se mariant même entre eux. Qui plus est, il n’y a aucune raison de penser que l’Homo politicus, tout comme l’Homo œconomicus, ne poursuit pas un intérêt qui lui est propre (être élu ou réélu, par exemple). Il n’y a aucune raison non plus de penser que les représentants de la haute administration (l’Homo bureaucraticus), si prompts eux aussi à s’orner du manteau chamarré de l’intérêt général, n’ont pas, à leur tour, des objectifs beaucoup moins altruistes et avouables (augmenter leur prestige ou leur budget, par exemple). Il s’agit là d’une analyse que développera aux États-Unis, à partir des années 1960, l’école du Public Choice, fondée par le futur prix Nobel James Buchanan et son collègue Gordon Tullock.
Pour autant, tout ce que nous venons de voir ne veut pas dire que pour l’auteur des Propos, tous les actes individuels sont uniquement motivés par l’intérêt. Malheureusement non, devrions-nous ajouter. En effet, ce serait paradoxalement une excellente nouvelle, dans la mesure où, à ses yeux, les intérêts transigent toujours, à l’inverse des passions. Or, pour le plus grand malheur des hommes, ce sont bien trop souvent ces dernières qui dictent le comportement des acteurs sociaux, comme en attestent la plupart des guerres (et contrairement à ce qu’avançait naguère la vulgate marxiste, qui voulait y voir le simple résultat des calculs amoraux des « marchands de canons »). C’est d’ailleurs là un constat qui nous conduira, dans le second volet de notre étude, à examiner un autre thème (qui, une fois encore, rattache clairement la pensée d’Alain à la famille libérale), à savoir que le véritable pouvoir est politique et non pas économique, et que par conséquent l’individu a moins à redouter le riche et la liberté économique que le militaire et l’homme politique, qui seuls disposent du monopole de la violence légitime et donc du vrai pouvoir de contrainte (ce que montreront avec éclat les totalitarismes).
Dès lors, reliant le XIXe et le XXe siècle, Alain nous conduira à examiner d’autres grands penseurs français de l’individu, qui nous montreront comment durant des décennies – des années 1930 aux années 1970 –, ce courant libéral, que nous avons jusque-là décrit comme particulièrement dynamique et prolifique, va être peu à peu marginalisé, essentiellement à cause de sa critique intransigeante de l’inflation étatique et de ses dimensions liberticides. Avant de retrouver une nouvelle vigueur à la fin du siècle à la faveur de la chute du communisme et de l’entrée dans la mondialisation, deux phénomènes qui vont profondément ébranler les certitudes des plus statophiles. Ce faisant, nous verrons que leur pensée reste plus utile que jamais pour penser le monde actuel et sortir enfin du marasme intellectuel qui est actuellement le nôtre.

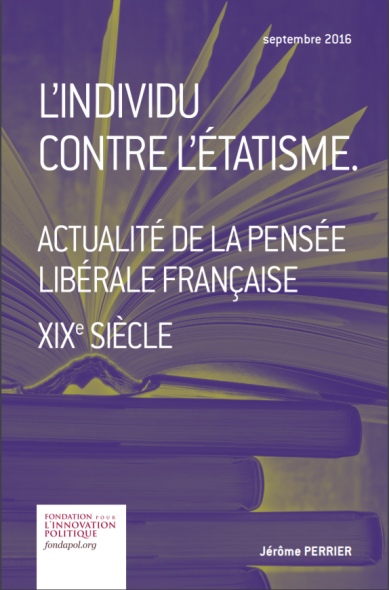


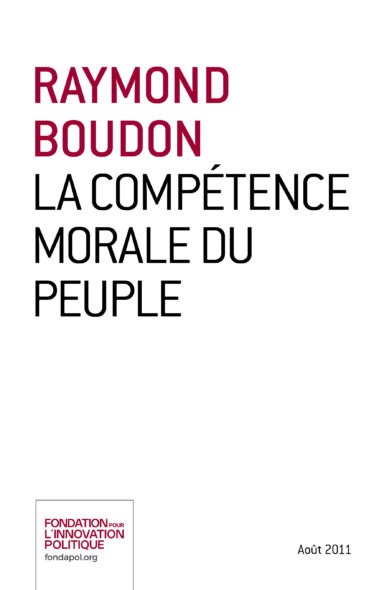













Aucun commentaire.