L'individu contre l'étatisme
Actualité de la pensée libérale française (XXe siècle)Introduction
Le libéralisme français au XXè siècle, de la marginalisation à la redécouverte
Le citoyen contre les pouvoirs et la crise de la représentation
Penser l’individu face à l’état des années 1930 aux années 1970
Le libéralisme de l’individu à la conquête d’un espace politique : la parenthèse libérale des années 1980
Résumé
Durant le « court XXe siècle », qui a vu l’État connaître un essor continu – que ce soit sous la forme sinistre des totalitarismes ou sous celle, pacifique, de l’État-providence –, les libéraux français les plus résolus à défendre l’individu face aux menaces du pouvoir ont dû relever des défis inédits, qui n’ont fait qu’aiguiser leurs réflexions et rendre ces dernières encore plus utiles à redécouvrir en ce début de XXIe siècle. Marginalisés des années 1930 aux années 1970, les plus anti-étatistes d’entre eux ont retrouvé un certain écho dans les années 1980, au point que leurs analyses ont paru alors pouvoir trouver un débouché politique concret.
Mais cet épisode s’est avéré fort éphémère et n’a touché qu’une fraction de l’échiquier politique français, au point que l’on peut tout au plus parler d’une parenthèse libérale, ambiguë de surcroît et liée à un contexte tout à fait singulier.
Durant le « court XXe siècle », qui a vu l’État connaître un essor continu – que ce soit sous la forme sinistre des totalitarismes ou sous celle, pacifique, de l’État-providence –, les libéraux français les plus résolus à défendre l’individu face aux menaces du pouvoir ont dû relever des défis inédits, qui n’ont fait qu’aiguiser leurs réflexions et rendre ces dernières encore plus utiles à redécouvrir en ce début de XXIe siècle. Marginalisés des années 1930 aux années 1970, les plus anti-étatistes d’entre eux ont retrouvé un certain écho dans les années 1980, au point que leurs analyses ont paru alors pouvoir trouver un débouché politique concret.
Mais cet épisode s’est avéré fort éphémère et n’a touché qu’une fraction de l’échiquier politique français, au point que l’on peut tout au plus parler d’une parenthèse libérale, ambiguë de surcroît et liée à un contexte tout à fait singulier.
Jérôme Perrier,
Normalien, agrégé d’histoire et docteur en histoire de l’ieP de Paris, enseigne l’histoire du libéralisme à sciences Po Paris et à l’université de Versailles-saint-Quentin-en-Yvelines.
Introduction
Si, au XIXe siècle, les libéraux français – sans jamais être hégémoniques dans le champ politique ou académique – ont à l’évidence constitué un courant très influent situé au cœur de tous les grands enjeux idéologiques de l’époque, les choses sont quelque peu différentes lorsque l’on prend pour objet d’étude le siècle suivant. En effet, au XXe siècle, l’histoire du libéralisme français paraît synonyme de déclin, a fortiori lorsqu’on s’intéresse, comme nous le faisons ici, à la mouvance la plus anti-étatiste du libéralisme français. Outre que la montée en puissance de l’État et de ses champs d’intervention semble condamner ce courant critique à n’être qu’une sorte de butte-témoin d’un passé apparemment révolu, une partie du monde intellectuel français, jusqu’à une date très tardive, a été influencée par la vision marxiste de la société qui identifiait les libéraux à de fieffés réactionnaires, nostalgiques d’un vieil ordre bourgeois honni.
De fait, durant le « court XXe siècle » (1914-1989) qui aura vu se propager le totalitarisme et l’État-roi, la pensée libérale, parce qu’elle entendait précisément mettre en garde contre les conséquences funestes d’une hypertrophie étatique non maîtrisée, a eu le plus grand mal à échapper à la caricature véhiculée par ses adversaires : celle d’une doctrine périmée, d’un paradigme daté, d’un langage suranné et d’une idéologie au service des puissants. La large marginalisation de penseurs aussi divers qu’Alain, Bertrand de Jouvenel, Raymond Aron ou encore Jacques Rueff en est une parfaite illustration. Il faudra en réalité attendre les années 1980 pour que les choses changent – partiellement. En effet, à partir de cette date, certains auteurs appartenant à l’école libérale française vont être redécouverts ou réhabilités, même si cette rédemption intellectuelle tardive a été finalement très partielle, négligeant de nombreuses œuvres, tout particulièrement au sein du courant le plus anti-étatiste de la grande famille libérale. Quant au champ politique, les années 1980 constituent une simple parenthèse durant laquelle les idées libérales les plus assumées ont pu brièvement être mises en avant par une fraction – non négligeable mais minoritaire – des forces politiques françaises, en se revendiquant à la fois d’un courant venu de l’étranger (libéralisme anglo-saxon et autrichien) et d’une tradition proprement française (celle que nous essayons de faire redécouvrir au fil de ces pages).
C’est ce double mouvement que nous allons mettre en valeur dans ce second et dernier volet de notre étude, en nous focalisant dans un premier temps sur la sphère proprement intellectuelle, avant d’aborder la traduction partisane qui a été – très brièvement – celle du libéralisme anti-étatiste, à contre-courant d’une culture politique aussi puissamment statocentrée que la nôtre. Nous conclurons alors en nous interrogeant sur la situation actuelle et en nous demandant si nous sommes à la veille d’un authentique renouveau du libéralisme dans un pays qui reste, quoi qu’en pensent ses contempteurs professionnels, l’un des grands foyers historiques de la pensée libérale.
Le libéralisme français au XXè siècle, de la marginalisation à la redécouverte
Plusieurs grands penseurs français du XXe siècle ont illustré avec éclat la philosophie libérale – sans du reste toujours s’en réclamer ouvertement. Or cet aspect de leur œuvre est longtemps resté négligé, comme le montre la manière dont les écrits d’Alain, de Bertrand de Jouvenel ou encore de Jacques Rueff (pour nous en tenir aux exemples les plus éminents) ont été traités dans leur propre pays, surtout après leur mort.
Le citoyen contre les pouvoirs et la crise de la représentation
À commencer par celui qui est sans doute le penseur libéral le plus conséquent du XXe siècle, l’Autrichien Friedrich A. Hayek.
Alain, Mars ou la Guerre jugée, in Les Passions et la Sagesse, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 655-656.
C’est là un constat amer que font la plupart des libéraux, même si ce sont sans doute les ordolibéraux allemands qui ont le plus mis en garde contre ce Voir notamment Patricia Commun, Les Ordolibéraux. Histoire d’un libéralisme à l’allemande, Les Belles Lettres, 2016.
Raymond Aron, Mémoires, Presses Pocket, 1, 1985, p. 58.
sur cette question, voir Jérôme Perrier, « Penser les rapports entre politique et haute administration à travers l’œuvre d’Alain et d’Henri Chardon », La Revue administrative, n° 398, mars-avril 2014, 147-158, et n° 399, mai-juin 2014, p. 248-269.
Voir notamment la préface de François Denord à l’ouvrage de Charles Wright Mills, L’Élite au pouvoir, Agone, 2012.
sur cette question très importante, l’ouvrage le plus clair et le plus synthétique est celui de Norberto Bobbio, Libéralisme et Démocratie, éditions du Cerf, 1996.
Propos du 3 août 1912, in Alain, Les Propos d’un Normand de 1912, institut Alain, 1998, 293-294.
Contrairement au lieu commun qui voudrait que la confiance soit la clé du bon fonctionnement démocratique. sur cette question, voir Pierre Rosanvallon, La Contre-Démocratie. La politique à l’âge de la défiance, seuil, 2006.
sur cette question, voir Jean-Marie Allaire, « Alain et les “puissances” d’après les Propos de 1906 », Bulletin de l’Association des amis d’Alain, n° 69, janvier 1990, p. 59-60.
Même si l’individualiste Alain ne partage pas toutes les vues du « solidarisme » théorisé par Léon sur le solidarisme, voir serge Audier, La Pensée solidariste. Aux sources du modèle social républicain, PuF, 2010, ainsi que, du même auteur, Léon Bourgeois. Fonder la solidarité, Michalon, 2007.
sur ce sujet, l’ouvrage de référence reste celui de Michael Freeden, The New An Ideology of Social Reform, Clarendon Press, 1978.
Dans le premier volet de notre étude, nous avons mis en avant un aspect trop méconnu de la pensée d’Alain, à savoir son attachement à la liberté économique et son inquiétude jamais démentie face à une emprise croissante de l’État, soit deux traits qui sont communs à tous les libéraux – fût-ce à des degrés divers. Il est toutefois clair que le volet économique n’est pas l’aspect le plus important de sa pensée (mais on pourrait en dire autant d’un bon nombre des plus grands penseurs libéraux)1, et nul ne peut contester que le cœur de sa réflexion est d’abord et avant tout moral et politique. Une réflexion qui nous semble aujourd’hui de la plus grande utilité, dans la mesure où elle offre une voie profonde et singulière pour sortir de la très grave crise de la représentation que traversent la plupart des démocraties contemporaines.
Pour originale qu’elle soit, l’œuvre politique d’Alain ne s’en inscrit pas moins pleinement dans la tradition libérale française que nous décrivons dans ces notes et qui cherche obstinément à défendre les droits de l’individu face aux menaces des différents pouvoirs présents dans la société.
Le vrai pouvoir est politique
De fait, l’une des idées fortes d’Alain consiste à distinguer au sein de la pluralité des pouvoirs sociaux ceux qui sont les plus menaçants pour les citoyens. Et force est de constater que sa réponse est à la fois claire et à l’unisson de la plupart des penseurs libéraux. En effet, à ses yeux, les pouvoirs politique et militaire sont clairement les plus dangereux pour les libertés, car tous deux sont fondés sur la coercition, contrairement au pouvoir purement économique, infiniment plus bénin. Il s’agit là d’un thème majeur chez lui, que résume parfaitement cet extrait de Mars ou la Guerre jugée qui mérite d’être longuement cité : « Qu’est donc le pouvoir du plus riche des riches à côté du pouvoir d’un capitaine ? Le genre d’esclavage qui résulte de la pauvreté laisse toujours la disposition de soi, le pouvoir de changer de maître, de discuter, de refuser le travail. Bref la tyrannie ploutocratique est un monstre abstrait, qui menace doctrinalement, non réellement. Le plus riche des hommes ne peut rien sur moi, si je sais travailler ; et même le plus maladroit des manœuvres garde le pouvoir royal d’aller, de venir, de dormir. C’est seulement sur la bourgeoisie que s’exerce le pouvoir du riche, autant que le bourgeois veut lui-même s’enrichir ou vivre en riche. Le pouvoir proprement dit me paraît bien distinct de la richesse ; et justement l’ordre de guerre a fait apparaître le pouvoir tout nu, qui n’admet ni discussion, ni refus, ni colère, qui place l’homme entre l’obéissance immédiate et la mort immédiate ; sous cette forme extrême, et purifiée de tout mélange, j’ai reconnu et j’essaie de faire voir aux autres le pouvoir tel qu’il est toujours, et qui est la fin de tout ambitieux. Quelque pouvoir qu’ait Harpagon par ses richesses, on peut se moquer d’Harpagon. Un milliardaire me ferait rire s’il voulait me gouverner ; je puis choisir le pain sec et la liberté. Disons donc que le pouvoir, dans le sens réel du mot, est essentiellement militaire, et qu’il ne se montre jamais qu’en des sociétés armées, dominées par la peur et par la haine, et fanatiquement groupées autour des chefs dont elles attendent le salut ou la victoire. Même dans l’état de paix, ce qui reste de pouvoir, j’entends absolu, majestueux, sacré, dépend toujours d’un tel état de terreur et de fureur. Résister à la guerre et résister aux pouvoirs, c’est le même effort. Voilà une raison de plus d’aimer la liberté d’abord2. »
Ce texte à lui seul permet de comprendre pourquoi la Politique d’Alain a été largement marginalisée en France (réduite à une sorte de pensée pour classe terminale), dans la mesure où elle heurte de plein fouet certains des topiques les plus ancrés de notre culture politique contemporaine – et qui ne sont pas sans lien avec le profond désarroi intellectuel qui est aujourd’hui le nôtre. De fait, plusieurs des affirmations présentes dans ces lignes peuvent être considérées comme typiquement libérales, en ce qu’elles aboutissent à conclure qu’un ordre purement capitaliste (un ordre imaginaire bien entendu, où l’« Économique » échapperait entièrement à l’emprise du « Politique » pour utiliser un langage alinien) ne saurait être liberticide puisque, sur un marché, le producteur n’exerce pas un pouvoir de contrainte mais offre au consommateur, souverain, un service dont dépendent sa réussite et son statut social même. Tant qu’elle ne peut prendre appui sur le pouvoir politico- militaire – comme c’est malheureusement trop souvent le cas dans la réalité3 –, la puissance économique est un soft power bien moins redoutable que le hard power des généraux et des hommes de l’État qui ont droit de vie et de mort sur leurs « semblables ».
Toutefois, ces idées – iconoclastes de nos jours – ne doivent pas induire le lecteur en erreur, dans la mesure où, chez Alain, l’analyse politique est inséparable d’une sociologie critique radicale. En effet, constatant qu’inévitablement, quelles que soient l’époque et la société, la puissance sociale est toujours très inégalement distribuée, l’auteur du Citoyen contre les pouvoirs développe une féroce critique des élites, notamment bureaucratiques. L’homme de gauche qu’il est viscéralement, pur produit de la méritocratie républicaine, ne cesse de prendre la défense des petits, des gens modestes, contre ceux qu’il appelle les « Importants » – terme qui désigne chez lui les Puissants, ou encore les Dominants, comme dirait aujourd’hui la sociologie critique en vogue dans les facultés de sciences sociales. C’est-à-dire, concrètement : les ministres, les généraux, les hauts fonctionnaires, les académiciens, les riches, les gens célèbres. Bref, tous ceux qui possèdent une parcelle de pouvoir et/ou d’influence.
À Raymond Aron, qui lui demandait quelle place il fallait accorder à la politique dans son œuvre, Alain répondit un jour par une boutade : « Il y a des hommes que je n’aime pas. J’ai passé mon temps à le leur faire savoir4. » Il y a là, en réalité, beaucoup plus qu’une boutade. En effet, toute l’œuvre politique d’Alain peut être lue comme une réflexion sur le meilleur moyen d’empêcher les dominants d’écraser les dominés. Ou, pour dire les choses autrement, sur les meilleures garanties susceptibles de sauvegarder la liberté des plus modestes, en les mettant à l’abri de l’emprise des Importants. Ce qui suppose de faire en sorte que les riches n’ajoutent pas le pouvoir politique à leur puissance économique, ce qui les rendrait redoutables. Mais Alain met aussi très régulièrement ses lecteurs en garde contre les hauts fonctionnaires (que l’on appelle alors plus communément les « bureaucrates »), qui exercent un pouvoir d’autant plus considérable qu’ils se trouvent sociologiquement à l’intersection de toutes les élites : politiques, économiques et culturelles5. En effet, leur pouvoir ne vient pas seulement du fait que, grâce à leur stabilité, ils parviennent le plus souvent à imposer leurs vues à des ministres éphémères. Il vient aussi de ce que bureaucrates, politiques et hommes d’affaires – les gouvernants, donc – appartiennent en fait au même (petit) monde. D’où, chez Alain, une analyse corrosive qui n’est pas sans rappeler celle, virulente, que fera Charles Wright Mills aux États-Unis dans les années 1950 (au point d’être devenu la coqueluche de la sociologie critique et néomarxiste)6. Mais une dénonciation aussi acerbe du pouvoir bureaucratique présente également de très nombreuses similitudes avec celle que l’on trouve au XXe siècle sous la plume d’auteurs libéraux, depuis le petit ouvrage publié par Ludwig von Mises en 1944 et intitulé Bureaucratie jusqu’à l’école américaine du Public Choice qui, à partir des années 1960, va chercher à appliquer les outils de l’économie à l’analyse du « marché politique », scrutant dès lors les comportements de l’Homo bureaucraticus et de l’Homo politicus, en les faisant descendre de leur piédestal et en les mettant sur le même plan que l’Homo œconomicus (c’est-à- dire en montrant que les individus, qu’ils travaillent dans les affaires ou pour l’État, sont motivés d’abord et avant tout par leur intérêt bien compris).
substituer la démocratie du contrôle au volontarisme politique pour prévenir toute crise de la représentation
Mais la Politique d’Alain ne saurait être réduite à une simple critique des élites ou du pouvoir bureaucratique, et encore moins à un simple éloge du marché. Elle s’incarne d’abord et avant tout dans une analyse profondément originale de la démocratie – une analyse qui nous semble du plus haut intérêt, à l’heure de la profonde crise de la représentation politique que nous traversons aujourd’hui. En effet, si Alain est un auteur que l’on peut sans hésitation qualifier de libéral (même si cet homme de gauche ne s’est personnellement jamais revendiqué d’un courant philosophique qui entretenait des rapports pour le moins complexes avec sa famille politique), son libéralisme a ceci de particulier qu’il va de pair avec une adhésion sans réserve à l’esprit démocratique et républicain, alors même qu’historiquement démocratie et libéralisme ont entretenu des relations souvent ambiguës, parfois même conflictuelles7.
Pour résumer, l’auteur du Citoyen contre les pouvoirs ne considère pas la démocratie comme l’expression du volontarisme politique, mais il la fonde bien plutôt sur le contrôle, la surveillance, l’admonestation des gouvernants par les gouvernés. Dans une telle logique, il ne s’agit plus tant de faire remonter des gouvernés vers les gouvernants une hypothétique volonté collective (à laquelle l’individualiste Alain ne croit guère en tant que telle), mais il s’agit bien plutôt de surveiller étroitement les gouvernants pour les empêcher d’abuser de leurs pouvoirs, en leur tenant la bride bien serrée afin qu’ils n’empiètent pas sur les droits fondamentaux des gouvernés. Ce sont d’ailleurs ces droits individuels que les élus doivent avoir pour mission première de garantir, plutôt que de chercher à changer la vie, c’est-à-dire à imposer aux citoyens leur vision grandiose de la Politique, avec un grand « P », en voulant régenter leur vie jusque dans les moindres détails. Bref, à une démocratie de la volonté, Alain oppose une démocratie de la vigilance. Là est pour lui la vertu cardinale de l’électeur républicain « pendu aux basques de l’élu » (comme il aime à dire), afin de mieux le surveiller et de l’interpeller au besoin pour l’empêcher de se prendre pour un pseudo-grand homme d’État « au regard d’aigle, qui voit loin tout autour et jusque dans l’avenir, administrant pour nos petits-neveux, pour toute la race, pour le pays tout entier8. »
On comprend dès lors mieux pourquoi l’enjeu du mode de scrutin occupe une telle place dans les écrits d’Alain. Le philosophe y a en effet consacré des centaines de propos tout au long de sa vie, aucun autre thème politique n’ayant eu droit à autant d’attention de sa part. En effet, grand lecteur de Rousseau, Alain sait que la démocratie indirecte moderne risque inévitablement de déboucher sur une crise de la représentation (celle que nous traversons aujourd’hui), et c’est précisément pour la prévenir qu’il défend bec et ongles la petite circonscription qu’est l’arrondissement (où chaque électeur connaît, pour ainsi dire personnellement, son représentant) et qu’il condamne la représentation proportionnelle (où la vie politique se déroule dans le cadre du département, trop vaste pour un face-à-face entre représentant et représenté, et où les états-majors parisiens dictent donc facilement leur loi). Si cette question passionne tant Alain, c’est qu’elle touche au fondement même de la démocratie telle qu’il l’entend. À ses yeux, en effet, la représentation proportionnelle est par essence le mode de scrutin propre à la démocratie volontariste, puisqu’elle fait voter l’électeur pour des partis, des programmes et des idéologies. Le citoyen ne s’y prononce pas pour un homme mais pour des idées incarnées de façon pour ainsi dire anonyme par les membres (interchangeables et souvent parachutés) de la liste qui est imposée depuis Paris au suffrage des électeurs. À l’inverse, le scrutin d’arrondissement – dont Alain se fait le défenseur passionné, intransigeant, et presque exalté – est au cœur même de toute sa réflexion politique, car il incarne on ne peut mieux cette démocratie du contrôle et de l’admonestation qu’il appelle de ses vœux. Une démocratie modeste (dans tous les sens du terme), où l’élu est sous la surveillance vigilante de ses électeurs/contribuables. Ceux-ci ne votent dès lors plus pour des programmes et des listes de noms dans le cadre d’immenses circonscriptions, mais pour un homme, connu de tous, pour son caractère et ses valeurs. En effet, les petites communautés que constituent les arrondissements (les fameuses « mares stagnantes » si souvent dénigrées) ont pour Alain cet avantage immense que le député doit constamment arpenter sa circonscription, être au contact de ses électeurs, à leur écoute. Des électeurs qu’il connaît presque personnellement ou, en tout cas, qu’il peut croiser régulièrement dans ses tournées et auxquels il doit donc à tout moment rendre des comptes. Là réside, pour Alain, le seul moyen efficace pour empêcher une crise de la représentation fondée sur une coupure manifeste entre le peuple et les élites parisiennes.
En réalité, pour originale que soit cette vision, elle rejoint une logique qui est présente chez d’autres auteurs libéraux, soucieux de limiter concrètement le pouvoir, en le tenant en laisse via une cascade de responsabilités. En effet, pour l’auteur du Citoyen contre les pouvoirs, les bureaucrates qui exercent au quotidien l’essentiel du pouvoir – ne serait-ce que du fait de leur longévité – doivent être en permanence sous la surveillance de leur éphémère ministre, qui ne doit pas hésiter à les secouer ou à les renvoyer au besoin. Mais, de la même manière, les ministres doivent à leur tour être sous la surveillance constante des députés qui ne doivent pas hésiter à menacer de renverser le gouvernement s’ils estiment que les intérêts de leur circonscription et de leurs électeurs sont trahis. Quant aux députés, ils doivent eux aussi être sous la surveillance étroite et pour ainsi dire quotidienne de leurs mandants qui doivent, si nécessaire, pouvoir interpeller leur représentant sur la place du marché dès lors qu’ils jugent qu’il défend mal leurs intérêts et leurs droits.
On le voit, pour Alain, la démocratie est fondamentalement une question de contrôle, de surveillance, voire de méfiance9. C’est un système destiné à empêcher les gouvernants/les puissants/les dominants/les Importants de faire trop de bêtises en abusant de leur pouvoir. Et rien ne résume mieux cette pensée que cette parabole tirée d’un « Propos » du 3 juillet 1911 : « Il y a toujours deux politiques : celle des politiques et celle des citoyens. […], il n’y a point de bons maîtres. On demandait aux poulets à quelle sauce ils voulaient être mangés : “Mais, nous ne voulons point être mangés.” On demande au peuple : “Par qui veux-tu être gouverné ?” Mais nous ne voulons point être gouvernés. Le peuple est roi ; pourquoi abdiquerait-il ? » Difficile de mieux résumer le libéralisme démocratique d’Alain.
Pour autant, Alain est aussi un authentique homme de gauche, et s’il n’a à l’évidence aucune sympathie pour le socialisme étatique (inévitablement bureaucratique et autoritaire à ses yeux), il en a encore moins pour toute politique qui ferait passer l’intérêt des puissants avant celui des petites gens. Répétons-le : si Alain a une fibre foncièrement libérale, il est clairement un libéral de gauche, pour qui la défense des plus modestes est une priorité. Nous avons vu qu’à ses yeux le pouvoir politique et militaire est plus dangereux que le pouvoir économique, à condition toutefois que celui-ci ne prenne pas appui sur celui-là pour s’imposer aux plus faibles. Dans une société libérale idéale, le pouvoir économique n’en serait pas vraiment un, car il ne pourrait s’imposer par la force. Mais, en réalité, comme le montre parfaitement sa sociologie critique des élites, Alain sait parfaitement que les riches et les hommes de l’État s’entendent comme larrons en foire sur le dos du pauvre citoyen. Appartenant au même milieu, se côtoyant au quotidien, ils constituent un seul et même monde, qui cumule les pouvoirs et qui s’avère donc dangereux, si de solides institutions démocratiques ne sont pas là pour remettre à leur place tous les puissants et les faire descendre de leur piédestal. C’est aussi la raison pour laquelle l’éloge de la liberté n’exclut absolument pas chez Alain des mesures législatives visant à réduire les inégalités (via l’impôt progressif sur le revenu, par exemple), à améliorer les conditions de travail des salariés les plus modestes (par la diminution du temps de travail, par exemple) ou encore à protéger les plus démunis10. On peut même trouver des « Propos » dans lesquels Alain se prononce en faveur de la nationalisation des chemins de fer, voire de celles de certaines assurances ou banques. C’est qu’en bon radical français du début du XXe siècle, Alain estime que la défense de la République exige que l’on n’ait pas d’ennemi à gauche. Pour autant, il critique toujours le socialisme étatique et autoritaire dans la mesure où celui-ci heurte de plein fouet ce qui reste pour lui l’essentiel (et le cœur de son libéralisme), à savoir la sauvegarde des libertés individuelles.
Républicain fervent, défenseur des petits contre les gros, Alain est bien un libéral de gauche, même s’il ne revendique que le second des deux termes – précisément pour ne pas se couper de sa famille politique. On peut du reste remarquer que par son souci de lutter contre certaines inégalités sociales, Alain rejoint une inflexion majeure du libéralisme de son époque. Cette inflexion conduit alors un certain nombre de penseurs à vouloir rompre avec ce qu’ils appellent le « laissez-faire » du libéralisme classique, pour forger un libéralisme plus social et compatible avec une certaine forme d’intervention étatique.
Ce « tournant social », qui se manifeste à partir des années 1880-1890, se retrouve aussi bien en France, dans le solidarisme cher aux amis radicaux d’Alain11, qu’en Angleterre, avec le New Liberalism de Thomas H. Green et Leonard T. Hobhouse12, sans oublier les États-Unis, avec le « progressisme » de John Dewey ou Woodrow Wilson.
Penser l’individu face à l’état des années 1930 aux années 1970
La précision est importante, Alain n’ayant cessé d’être réédité et cité concernant certains autres volets de son œuvre (ses écrits sur la pédagogie, par exemple).
Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir, Pluriel, 1994 ; De la souveraineté. À la recherche du bien politique, éditions Genin, 1955 ; De la politique pure, Calmann-Lévy, 1994.
Olivier Dard, Bertrand de Jouvenel, Perrin, 2008 ; Daniel Mahoney, Bertrand de Jouvenel. The Conservative Liberal and the Illusions of Modernity, isi Books, 2005.
Même si Halévy insiste davantage sur l’importance de la Grande Guerre dans l’émergence du totalitarisme, là où Jouvenel prolonge sa quête des origines bien en sur cette question du totalitarisme, voir stephen Launay, « un précurseur de la critique du totalitarisme : Bertrand de Jouvenel », Les Cahiers d’histoire sociale, n° 10, printemps 1998, p. 75-86.
Voir serge Audier, Le Colloque Aux origines du “néo-libéralisme”, Le Bord de l’eau, 2008.
Repris dans Bertrand de Jouvenel, L’Éthique de la redistribution, Les Belles Lettres, 2014.
Sur Röpke, l’ouvrage de référence en français est celui de Jean solchany, Wilhelm Röpke, l’autre Aux origines du néolibéralisme, Publications de la sorbonne, 2015.
Voir serge Audier, La Pensée solidariste…, cit., et Michael Freeden, op. cit.
Bertrand de Jouvenel, L’Éthique de la redistribution, cit., p. 115.
Voir Guy thuillier, Bureaucratie et bureaucrates en France au XIXe siècle, Droz, 1980, et La Bureaucratie en France aux XIXe et XXe siècles, economica, 1987.
Voir Philip Nord, Le New Deal français, Perrin, 2016.
Jacques Rueff, « Pourquoi, malgré tout, je reste libéral », Bulletin du Centre polytechnicien d’études économiques, n° 14-15, juin-juillet 1934, 30-34.
Cité par Frédéric teulon, Bruno Fischer, in « L’analyse libérale des crises financières : un hommage à Jacques Rueff », Vie & sciences de l’entreprise, 2011/3 (N° 189), 47.
Préface de Wolfgang schäuble, in Gérard Minart, Jacques Un libéral français, Odile Jacob, 2016, p. 7-8.
Frédéric teulon et Bruno Fischer, « L’analyse libérale des crises financières : un hommage à Jacques Rueff », Vie & Sciences de l’entreprise, 2011/3, n° 189, 46-60.
À diverses occasions, Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek ont eu l’occasion d’exprimer les espoirs que les libéraux les plus engagés avaient placés en étienne Mantoux et leur profonde tristesse à l’annonce de sa mort prématurée.
Voir Michel Zouboulakis, « éclectisme théorique et libéralisme pragmatique dans l’œuvre de Clément Colson », in Pierre Dockès (dir.), Les Traditions économiques françaises, 1848-1939, CNRs éditions, 2000, 583-593.
Voir à ce sujet la thèse soutenue par Gilles Richard, sous la direction de serge Berstein, Le Centre national des indépendants et paysans de 1948 à 1962 ou l’échec de l’union des droites françaises dans le parti des modérés, institut d’études politiques de Paris, 1998.
Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté. III. L’ordre politique d’un peuple libre, PuF, 1995, p. 38.
Michel-Pierre Chélini, « Le plan de stabilisation Pinay-Rueff, 1958 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2001/4 , n° 48-4, 102-123.
Reste que le sort réservé à l’œuvre politique et économique13 d’Alain – c’est- à-dire un très large oubli, teinté de mépris – est une bonne illustration du fait que durant la plus grande partie du « court XXe siècle » les libéraux français sont largement apparus sur la défensive, assaillis qu’ils étaient par des ennemis nombreux, venus de la gauche comme de la droite – et toujours prompts à s’unir pour dénoncer ce qui constitue leur cible commune favorite, à savoir la défense intransigeante de la liberté individuelle. Car si le libéralisme est, fondamentalement, une philosophie cherchant à limiter le(s) pouvoir(s), celle-ci a dû affronter au siècle dernier un double défi : le totalitarisme, né de la Grande Guerre, et la montée en puissance de l’État-(providence) et de la bureaucratie. Pour dire les choses autrement, au XXe siècle (et tout particulièrement entre les années 1930 et les années 1970), les libéraux ont dû combattre sur plusieurs fronts, subissant des offensives sur le plan intellectuel et politique, aussi bien du côté de la pensée économique dominante qu’était le keynésianisme que de la part de la gauche marxiste (qui, en France plus qu’ailleurs, s’est illusionnée jusqu’à une date très tardive sur la nature réelle de l’expérience soviétique). C’était en effet l’époque où il était de bon ton dans une grande partie de l’intelligentsia française de se targuer de « préférer avoir tort avec Sartre que raison avec Aron », alors même que ce dernier défendait un libéralisme, certes intransigeant vis-à-vis du totalitarisme communiste, mais par ailleurs extrêmement pragmatique sur le plan économique – puisqu’il était teinté d’un fort keynésianisme et s’accommodait d’une puissante intervention de l’État dans l’économie. Ceci explique pourquoi certains libéraux français, qui ont alors essayé de développer un libéralisme plus critique à l’égard de l’interventionnisme étatique et de l’idéologie technocratique et planificatrice dominante, ont eu le plus grand mal à se faire entendre. C’est ce que montre très bien le double exemple de Bertrand de Jouvenel et de Jacques Rueff, aussi reconnus à l’étranger qu’ils sont négligés en France, alors même qu’ils ont encore bien des choses à nous apprendre.
bertrand de Jouvenel, ou comment dompter le minotaure étatique
De tous les libéraux français du XXe siècle, Bertrand de Jouvenel est très certainement celui dont les écrits sont les plus largement ignorés dans leur propre pays, tout en étant considérés ailleurs dans le monde comme appartenant aux grandes œuvres de la littérature libérale contemporaine.
Il y a là, assurément, tout à la fois une injustice criante et une part de mystère. L’injustice est flagrante. En effet, à côté de nombreux écrits de circonstance, Jouvenel est l’auteur de trois chefs-d’œuvre, considérés dans beaucoup de pays (notamment aux États-Unis) comme de véritables classiques de la science politique : Du pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance (1945), De la souveraineté. À la recherche du bien politique (1955) et De la politique pure (1963). De fait, si le premier volet de cette trilogie est facilement accessible en français (il a constamment été réédité en poche), tel n’est pas le cas des deux suivants, épuisés depuis des décennies14. Or, si l’injustice d’un tel traitement saute aux yeux, son explication conserve une part de mystère. Certes, plusieurs choses jouent clairement en la défaveur de Bertrand de Jouvenel. La première, c’est que l’homme n’est ni agrégé de philosophie ni normalien, ce qui est loin d’être anodin dans un pays comme la France, qui pratique comme nul autre le culte du parchemin et a un sens suraigu des distinctions académiques. Qui plus est, Jouvenel (et c’est là un point commun avec Alain) s’exprime dans un langage tout à fait personnel, avec un vocabulaire – souvent métaphorique – qui lui est propre et qui s’avère fort éloigné du jargon académique. Ceci explique certainement qu’il ait eu, aux yeux des mandarins de la science politique française, une réputation de vulgaire essayiste qui ne répondait à aucun des canons de la discipline. Plus grave, Jouvenel traîne comme un boulet une réputation – aussi sulfureuse qu’indue – d’ancien fasciste. Accusation qui le conduira à intenter à l’historien israélien Zeev Sternhell un retentissant procès, dans lequel son ami Raymond Aron témoignera en sa faveur (avant de mourir d’une crise cardiaque, à la sortie même d’une audience, le 17 octobre 1983). Les biographes de Jouvenel, Olivier Dard et Daniel J. Mahoney15, ont montré ce qu’il pouvait y avoir d’outrancier dans cette accusation de (proto) fascisme, même si l’on est en droit d’estimer que le fait d’avoir adhéré au PPF de Jacques Doriot, ne fût-ce que pendant seulement deux années (de 1936 à 1938), n’est pas un titre de gloire ni un signe de grande lucidité politique, surtout pour quelqu’un qui, cinq ans plus tard, deviendra l’un des défenseurs les plus éloquents des valeurs libérales. Quant au livre L’Économie dirigée, que Jouvenel a publié en 1928, l’honnêteté oblige à reconnaître que son titre est pour le moins trompeur, dans la mesure où la planification qu’il défend – à une époque de défiance généralisée envers le « laissez-faire » – est bien plus proche de la planification indicative, telle qu’elle sera mise en œuvre en France après 1945, que du dirigisme soviétique de l’époque.
Reste que l’itinéraire intellectuel de Jouvenel n’est certainement pas des plus linéaires, puisqu’après avoir été, dans sa jeunesse, proche des Jeunes Turcs du parti radical, puis être devenu brièvement membre d’un parti fascisant (dirigé par un ancien communiste stalinien), l’homme va se convertir durant la Seconde guerre mondiale à un authentique libéralisme, avant de s’orienter vers de nouveaux horizons – aux confins de l’écologie et de la futurologie. Bien sûr, à la lumière de ce parcours pour le moins sinueux, on peut estimer que la lucidité de l’intéressé a été pour le moins intermittente, mais force est de reconnaître qu’il est loin d’être le seul clerc de l’Hexagone dans ce cas au XXe siècle. De plus, outre que ces moments d’égarement sont peu de chose au regard de l’aveuglement politique constant de certaines des figures les plus éminentes de l’intelligentsia française de son temps, ils ne sauraient en aucune manière justifier l’oubli d’œuvres aussi profondes que Du pouvoir, De la souveraineté ou De la politique pure. Des œuvres politiques majeures (et y en a-t-il tant que ça en France au XXe siècle ?) qui, par l’ampleur de leurs vues, transcendent très largement le contexte particulier dans lequel elles ont été conçues.
On en veut pour preuve que lorsque l’on demandait à Hayek quelles étaient les œuvres françaises contemporaines qui l’avaient influencé, il répondait aussitôt : Du pouvoir, de Bertrand de Jouvenel. Bien entendu, il est hors de question d’analyser ici en détail un livre aussi substantiel (tout comme d’ailleurs De la souveraineté et De la politique pure), ni même de prétendre résumer en quelques phrases ses riches aperçus, mais on peut néanmoins rappeler que s’y développe au fil des pages une imposante critique du caractère expansionniste de tout pouvoir, fût-il d’origine démocratique (sachant que, pour lui, tout pouvoir s’avère in fine d’essence oligarchique, comme le soutient également Alain). Ce faisant, la philosophie politique de Jouvenel s’inscrit dans la lignée des plus grands libéraux français, en renouant avec l’enseignement de penseurs majeurs aussi différents que Montesquieu (lorsque Jouvenel juge que le despotisme est le pire des maux et que tout ce qui le limite est salutaire).
Benjamin Constant (lorsqu’il s’interroge sur l’idée même de souveraineté en soulignant qu’un pouvoir élu, parce qu’il s’exerce « au nom du peuple », peut céder à une forme de hubris et, imbu de sa légitimité, imposer une loi de la majorité qui attente aux droits des minorités et de la plus petite d’entre elles : l’individu), mais aussi Tocqueville (lorsqu’il met en valeur les racines aristocratiques de la liberté et lorsqu’il met en garde contre l’essor d’un État tutélaire, envahissant et paternaliste, sans oublier de dénoncer les dangers d’une centralisation qui détruit les corps intermédiaires et réduit la société à un face- à-face inégal entre l’individu et l’État). Même s’il ne les cite pas, Jouvenel se rapproche aussi, par certains côtés, d’auteurs comme Alain (lorsqu’il met en garde contre le volontarisme politique et contre la réduction du droit à la simple loi positive, ou lorsqu’il établit un lien intrinsèque entre guerre et despotisme) ou bien encore Raymond Aron (lorsqu’il dénonce, tout comme l’auteur de L’Opium des intellectuels, la complaisance de trop nombreux intellectuels à l’égard de pouvoirs despotiques dès lors que ceux-ci prétendent œuvrer à l’édification d’une société réputée plus « juste »), sans oublier l’historien libéral Élie Halévy (lorsqu’il entreprend de faire la généalogie de ces « tyrannies » modernes que sont les régimes totalitaires)16. Autant d’exemples qui montrent que le « libéralisme conservateur » (pour reprendre les termes de son biographe Daniel J. Mahoney) de Jouvenel rejoint sur bien des points les plus grands auteurs libéraux français – venus aussi bien de la gauche que de la droite.
Le défi du planisme, de l’étatisme et du keynésianisme
Mais Bertrand de Jouvenel n’est pas seulement l’auteur d’ambitieux ouvrages de philosophie politique. Il est aussi un ancien journaliste à l’origine d’écrits certes plus circonstanciels mais qui n’en illustrent pas moins parfaitement la résilience, à l’apogée du keynésianisme, du technocratisme et du dirigisme triomphants, d’un certain libéralisme français anti-étatiste (même si l’intéressé n’aimait pas particulièrement l’adjectif « libéral »). Dès 1928, avec L’Économie dirigée (dont nous avons déjà souligné le caractère trompeur du titre), Jouvenel incarne assez bien ce que l’on appellera une décennie plus tard – lors du fameux « colloque Lippmann17 » – le premier « néolibéralisme », c’est-à- dire un libéralisme compatible avec une certaine intervention de l’État dans l’économie, à mi-chemin du « laissez-faire » du XIXe siècle et du planisme alors très à la mode.
Vingt ans plus tard, Jouvenel semble s’être rallié à une vision nettement moins statophile, puisqu’il développe – au moins à ce moment-là de son itinéraire intellectuel – une critique assez radicale de l’État-providence tel qu’il se met alors en place dans la plupart des pays occidentaux. En 1949, en effet, il publie (en anglais) le texte de deux conférences prononcées quelques semaines auparavant outre-Manche18. Écrites pour un public britannique au moment précis où le gouvernement travailliste de Clement Attlee jette les bases du Welfare state (selon un plan énoncé quelques années plus tôt dans le célèbre rapport Beveridge), ces deux courtes conférences entendent, selon les mots mêmes de leur auteur, « parler de la redistribution selon sa stricte définition, à savoir un prélèvement opéré sur le revenu des plus aisés afin d’apporter un supplément aux revenus les plus bas ». Dès lors, dans une veine qui n’est pas sans rappeler les libéraux de l’école de Paris un siècle plus tôt, Jouvenel s’attache à déconstruire, pour ainsi dire, les « jugements de valeur implicites » et les « présupposés » qui sont à la base de cet État-providence que la France met également en œuvre à la même époque et dont l’auteur juge qu’il n’est pas sans offrir de très graves sujets de préoccupation.
Renouant avec les accents tocquevilliens qui, un siècle plus tôt, mettaient déjà en garde contre le despotisme doux que constituerait un État excessivement protecteur et paternaliste, Jouvenel se livre à une critique implacable de ce qu’il considère comme le fondement étatiste et égalitariste des nouvelles politiques redistributrices qui se mettent en place après la guerre. Pour ce faire, il pointe les dangers d’une expansion indéfinie de la puissance publique et d’une omnipotence croissante de l’État, par le biais d’une fiscalité progressive qu’il juge spoliatrice, car destinée à établir une forme de « justice sociale ». Or, tout comme son ami Hayek (qu’il côtoie alors régulièrement au sein de la Société du Mont-Pèlerin), Jouvenel juge cette notion parfaitement discutable. À l’image de nombre de ses amis libéraux européens ou américains, il considère qu’avec les transferts de revenus opérés sous la houlette de l’État, on assiste insidieusement à un véritable dessaisissement du pouvoir des individus au profit d’un nouveau Léviathan, plus débonnaire que le Minotaure qu’il avait dénoncé durant la Seconde Guerre mondiale dans Du pouvoir mais qui n’en est pas moins dangereux et pernicieux.
Cette thèse, qui charpente les deux conférences, fait écho à des thèmes développés au même moment par l’Autrichien Friedrich A. Hayek dans sa célèbre Route de la servitude ou par l’Allemand Wilhelm Röpke dans Civitas Humana19, mais elle rappelle aussi des idées amorcées dès le XIXe siècle par les libéraux français dont nous avons longuement parlé dans le premier volet de cette étude. Ainsi en est-il, par exemple, de la virulente critique que Jouvenel fait de la pression fiscale, en particulier de la substitution progressive de l’imposition progressive à l’imposition proportionnelle. De fait, il s’agit là d’un sujet qui, déjà à la fin du XIXe siècle, constituait une pomme de discorde entre les libéraux les plus radicaux du Journal des économistes (qui y étaient farouchement hostiles) et les « nouveaux libéraux » de l’époque. Ces derniers se retrouvaient notamment dans le « solidarisme » du radical Léon Bourgeois – pendant français du New Liberalism britannique, théorisé outre- Manche par L.T. Hobhouse et T.H. Green20.
Mais dans l’immédiat après-guerre, à un moment où la classe politique française connaît un net infléchissement à gauche et fait de la charte du Conseil national de la Résistance (CNR) son agenda réformateur, Jouvenel renoue également avec d’autres thèmes qui avaient été omniprésents dans les colonnes de cette bible du libéralisme individualiste et anti-étatiste que fut le Journal des économistes durant les cent ans de son existence (de 1841 à 1940) : la croissance démesurée de la dépense publique, la dépossession du pouvoir des citoyens au profit de l’État, la montée en puissance d’une « nouvelle classe dirigeante » (la caste bureaucratique des hauts fonctionnaires qui, au dire de Jouvenel, « se croient meilleurs juges de l’intérêt commun que les individus, tout à leurs desseins égoïstes21 »), le socialisme redistributeur, égalisateur et centralisateur qui se mue en « succédané de despotisme éclairé », une redistribution qui ne consiste pas uniquement à prendre aux riches pour donner aux pauvres mais affecte d’abord les classes moyennes, etc. In fine, cette prétendue « justice sociale » débouche, selon lui, sur une politique de gribouille puisque, pour une partie des classes moyennes, il s’agit là d’un jeu à somme nulle, où – après que l’État se soit servi au passage – il leur est finalement reversé une part de leur contribution à la cagnotte commune, par le biais d’innombrables aides, allocations et autres dégrèvements. Autant d’opérations plus ou moins obscures qui constituent une ruineuse usine à gaz et aboutissent finalement à transférer des sommes de la poche gauche à la poche droite des citoyens. Ce qui revient, ni plus ni moins, à reprendre et à justifier la célèbre antienne de Bastiat, selon laquelle l’État s’avère être cette « grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde »…
Quant à la question de l’avènement d’une technocratie de plus en plus puissante et vorace, nous avons vu qu’elle était présente chez un auteur comme Alain, mais on pourrait en retrouver la trace dans bien d’autres écrits (pas seulement libéraux, d’ailleurs), et ceci dès le XIXe siècle22. Mais il est important de comprendre que cette problématique se pose de manière bien plus aiguë encore au sortir des deux guerres mondiales. En effet, dès 1914, la mise en place d’une économie de guerre a conduit les États européens à prendre en charge une part croissante de l’économie nationale pour la mettre au service de l’effort de guerre. Et si la fin du conflit, en 1918, a semblé déboucher sur un retour au statu quo ante, le tournant dirigiste inauguré par la Grande Guerre a eu un impact considérable sur les esprits, en enracinant profondément l’idée selon laquelle l’État était légitime lorsqu’il entendait rationaliser l’économie, en la pilotant lui-même et en se substituant largement à l’initiative privée, à rebours du vieil ordre libéral « laissez-fairiste » de plus en plus largement considéré comme révolu. De telles conceptions dirigistes vont en effet imprégner de manière croissante les esprits des élites économiques, politiques et intellectuelles au cours des années 1920 – et plus encore des années 1930, à la faveur de la Grande Dépression qui va convaincre des pans entiers de l’opinion publique de l’incapacité congénitale du marché à générer de lui- même un ordre stable et efficient. Même au sein de la très bourgeoise École libre des sciences politiques, longtemps considérée comme l’un des temples du libéralisme, l’enseignement de l’économie va devoir s’adapter aux temps nouveaux, inculquant ainsi aux futures élites politiques et économiques de la nation une version toujours plus interventionniste du libéralisme, en faisant une part croissante au keynésianisme à partir de la fin des années 1930, avant que l’idéologie planificatrice prenne le relais avec le régime de Vichy, puis la Libération23.
Le libéralisme atypique de Jacques rueff, entre position sociale dominante et marginalisation intellectuelle
Rares sont alors ceux qui continuent à assumer crânement leur libéralisme, au risque de paraître incarner une vision anachronique, pour ne pas dire réactionnaire, en décalage flagrant avec la nouvelle doxa interventionniste. Parmi ces libéraux irréductibles figure au premier plan Jacques Rueff, un penseur atypique à bien des égards.
De fait, ce haut fonctionnaire a connu tous les honneurs et exercé des responsabilités de premier plan, mais il est toujours apparu, en tant qu’économiste, à contre-courant des modes doctrinales de son temps. C’est ainsi qu’en mai 1934, à une époque où la quasi-totalité des intellectuels (français et étrangers) dénoncent le laissez-faire et prônent un ordre nouveau basé sur l’intervention croissante de l’État et sur la planification de pans entiers de l’économie, celui qui est alors l’un des plus brillants hauts fonctionnaires du ministère des Finances fait devant ses amis polytechniciens de X-Crise une conférence intitulée de façon provocatrice : « Pourquoi, malgré tout, je reste libéral24 ». Rueff y affirme sans ambages « venir avouer [s]on péché, qui est d’être resté libéral dans un monde qui cessait de l’être ». L’intéressé semble d’ailleurs avoir attaché une très grande importance à cette flamboyante prise de position publique puisque, dans son autobiographie parue en 1977, il exhumera ce texte prononcé quarante ans plus tôt. Dans cette même autobiographie, il écrira également : « Je me déclare simplement libéral, c’est- à-dire que je pense que c’est au mécanisme des prix qu’il faut confier le soin d’établir l’équilibre économique. Aux libéraux s’opposent les planistes de diverses obédiences qui pensent que l’organisation de l’économie doit reposer sur une construction consciente25. »
Ainsi, dès l’entre-deux-guerres, ce penseur non universitaire, héritier de la tradition des ingénieurs-économistes français, était l’un des très rares intellectuels hexagonaux à oser braver la doxa ultradominante en dénonçant à l’envi le « monstrueux mensonge » qui consistait à prétendre supprimer les crises du capitalisme en substituant à la régulation automatique par les prix une gestion administrée, c’est-à-dire fondée sur l’arbitraire politique et la négation des « lois » mêmes de l’économie.
En un temps où les milieux académiques et intellectuels sont largement influencés par les courants technocratiques, keynésiens ou marxistes, Rueff incarne ainsi une vision de l’économie beaucoup plus proche de l’ordolibéralisme allemand que de la doxa étatiste dominante dans l’Hexagone – notamment au moment de la reconstruction et de la technocratie gaulliste triomphante. Comme le reconnaît l’actuel ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble dans la préface d’une récente biographie consacrée à Jacques Rueff, « il est étonnant de constater à quel point les idées de [Jacques Rueff] en matière de politique économique concordent avec les principes d’une économie sociale de marché telle que Ludwig Erhard et ses partisans l’ont définie après-guerre26 ». De fait, comme les ordolibéraux allemands qui ont inspiré le « miracle économique » de la RFA des années 1950 et 1960, Rueff est resté, tout au long de sa vie, un défenseur intransigeant de l’équilibre budgétaire et de la stabilité monétaire, ainsi qu’un adversaire résolu de tout interventionnisme politique qui serait synonyme d’inflation et de planification autoritaire, ou encore de manipulation des prix et de la monnaie. Un constat qui explique l’oubli, pour ne pas dire le refoulement, presque complet dont a fait l’objet l’œuvre économique de Rueff chez les économistes français contemporains, largement acquis aux thèses interventionnistes et inflationnistes de Keynes. Mais ceci permet également de comprendre combien la redécouverte de ce libéral atypique peut être profitable pour qui veut comprendre la crise que nous traversons actuellement27.
Bien sûr, Jacques Rueff n’est ni le premier ni le seul économiste français à s’être attaqué aux thèses de Keynes, tout particulièrement à celles exposées en 1936 dans la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, appelée à devenir la bible des décideurs économiques occidentaux durant les trente années qui ont suivi la Seconde guerre mondiale. Pour ne s’en tenir qu’à un nom, on peut rappeler que le jeune Étienne Mantoux (disparu prématurément en avril 1945, à l’âge de 32 ans) avait ouvert la voie, au point d’incarner aux yeux de nombreux collègues étrangers l’espoir de voir renaître une vigoureuse école libérale française, à la hauteur de celles qui avaient existé dans l’Hexagone aux XVIIIe et XIXe siècles28. Reste que, des années 1930 aux années 1970 – et à la différence de quelqu’un comme Raymond Aron –, Rueff va se faire le procureur impitoyable des idées de l’économiste vedette de Cambridge et, plus encore, de ses épigones, prompts à faire de l’usage massif des dépenses publiques, des déficits budgétaires et de l’inflation la recette miracle de la croissance économique et de la lutte contre le chômage. Pour l’ancien disciple de Clément Colson (l’un des meilleurs représentants de l’école française des ingénieurs-économistes, mais aussi du libéralisme bon teint, tel qu’il était encore enseigné à l’École libre des sciences politiques avant la Seconde guerre mondiale)29, il s’agit là clairement d’une politique illusoire, fondée sur une base théorique fallacieuse et devant inéluctablement échouer à long terme, en engendrant stagnation économique et inflation (ce que, dans les années 1970, on appellera « stagflation »).
Pour Rueff, le keynésianisme est doublement condamnable, car il conduit ses adeptes à faire une apologie à peine déguisée des déficits budgétaires et de l’inflation, soit deux des manifestations les plus délétères de ce qu’il appelle les « faux droits ». En dépensant plus qu’il ne gagne et en manipulant la monnaie à coups de dévaluations « compétitives », l’État trompe sciemment ses citoyens en leur donnant le sentiment de bénéficier d’avantages qui ne sont en réalité qu’une pure apparence, un mirage. Ce n’est pas le lieu d’expliquer ici en détail la théorie des « faux droits » et des « vrais droits », telle que Rueff l’expose longuement dans son livre L’Ordre social, paru en 1945, mais il convient néanmoins d’en rappeler la centralité dans la pensée de Rueff, pour qui il ne saurait y avoir de liberté sans ordre, d’ordre sans propriété, de réelle propriété sans faculté d’en jouir et d’en disposer à sa guise (comme une forme de créance sur le reste de la société), et pas non plus d’authentique créance sans une monnaie saine et un système des prix à l’abri de toute intervention intempestive de l’État. Rueff n’est en effet pas hostile à l’intervention gouvernementale en soi, mais il considère que celle-ci n’est légitime pour autant qu’elle n’entrave pas le mécanisme des prix (qui représente, pour lui, comme pour Hayek, un vecteur d’informations crucial) et ne manipule pas la monnaie (dont la stabilité est un facteur essentiel pour assurer la confiance nécessaire à toute prospérité durable). Cette préservation de la liberté des prix et cette garantie d’une monnaie stable constituent les conditions sine qua non du bon fonctionnement de l’économie de marché et, plus largement, d’un ordre social stable, dynamique et efficace.
Tout au long de sa vie, ce conseiller du prince que fut Rueff, par ailleurs proche de certaines formations politiques de droite comme le Centre national des indépendants et paysans (CNIP)30, s’est intéressé de très près aux questions monétaires, estimant que la gestion d’un élément aussi vital pour l’ordre social ne saurait être livrée à l’arbitraire des gouvernants, naturellement tentés de l’instrumentaliser à des fins politiciennes. Comme l’a écrit son ami Hayek (que Rueff rencontre lors du colloque Lippmann de 1938, avant de le côtoyer durant plusieurs années au sein de la Société du Mont-Pèlerin), Rueff considère que laisser la monnaie aux mains de gouvernants élus, c’est « confier le pot de crème à la garde du chat31 ». D’où son attachement jamais démenti à l’étalon-or, qui avait le mérite à ses yeux d’empêcher toute manipulation monétaire par le biais du recours au couple diabolique inflation/dévaluation.
D’où également son attachement tout aussi viscéral à l’équilibre budgétaire, qu’il a d’ailleurs eu l’occasion de défendre auprès des plus hautes autorités de l’État, que ce soit Raymond Poincaré ou Paul Reynaud dans l’entre-deux- guerres, ou le général de Gaulle au début de la Ve République.
Car Jacques Rueff n’était pas simplement un théoricien libéral : il était avant tout un grand commis de l’État, associé au fil des décennies à quelques- unes des plus importantes décisions économiques de son temps, depuis la stabilisation du franc Poincaré en juin 1928 et les décrets-lois de Paul Reynaud pris à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en passant par le plan de redressement de 1958 et l’instauration du nouveau franc (plan Pinay-Rueff)32, sans oublier le rapport Armand Rueff de novembre 1959 chargé d’examiner
« les situations de fait ou de droit qui constituent d’une manière injustifiée un obstacle à l’expansion de l’économie33 ». Plus d’un demi-siècle après, ce dernier texte (qui ne sera que très partiellement mis en œuvre à l’époque de sa rédaction) n’a pas pris la moindre ride, au point que le rapport de la commission Attali de 2008 « pour la libération de la croissance française » ou les propositions les plus récentes d’Emmanuel Macron paraissent directement inspirés de ce texte étonnement d’actualité. De fait, on y trouve, pêle-mêle : le constat navré que certaines « législations ou réglementations ont pour effet de fermer abusivement l’accès à certains métiers ou certaines professions, de maintenir des privilèges injustifiés, de protéger, voire d’encourager des formes d’activité ou de production surannées, de cristalliser dans leur position les bénéficiaires de certains droits et de donner ainsi à certaines parties de l’économie française une structure en “offices”, si répandue sous l’Ancien Régime » ; la dénonciation de « certains groupes de pression, dont l’action méconnaît les exigences de l’intérêt général » et engendre des « îlots de résistance » largement responsables des « excès de réglementation » et des
« pratiques malthusiennes » qui favorisent le « sous-emploi » et les inégalités de statut ; la nécessité de réformer une fonction publique au statut trop rigide et aux rémunérations souvent insuffisantes ; la critique du coût et du non-sens économique que constituent de massives « subventions à l’improductivité », qui aboutissent au maintien en vie d’activités non rentables aux frais du contribuable et aux dépens d’autres activités rentables ; un réquisitoire contre l’inefficacité d’une politique du logement à la fois ruineuse et incapable d’atteindre ses objectifs, etc.
Autant de points qui ne sont pas sans rappeler une philosophie qui était déjà celle de l’école de Paris au XIXe siècle, comme nous l’avons montré plus haut, et que partagent aujourd’hui, plus ou moins, tous les partisans – qu’ils soient de gauche ou de droite – d’une politique de changement basée sur la nécessité de libérer des énergies depuis trop longtemps muselées par un carcan réglementaire tentaculaire et écrasées par un joug fiscal, devenu déraisonnable. Reste que ces adversaires du statu quo se sont avérés jusqu’ici parfaitement incapables de faire avaliser un tel agenda réformateur par une classe politique française tétanisée à l’idée qu’une telle audace précipite dans la rue une bonne partie du pays. Ce qui nous conduit à notre dernier point, crucial : pourquoi les libéraux, qui n’ont jamais totalement disparu de la scène intellectuelle française – même s’ils ont été incontestablement marginalisés entre les années 1930 et la fin des années 1970 – n’ont jamais réellement réussi à trouver un relais politique puissant, et par conséquent ne sont pas parvenus à traduire concrètement leurs idées dans les politiques publiques engagées par les gouvernements français des dernières décennies ?
Afin de mieux comprendre ce point, décisif pour qui s’interroge sur les moyens de sortir notre pays de l’ornière dans laquelle il se trouve incontestablement, il est intéressant de regarder d’un peu plus près la seule période où les libéraux ont semblé être en passe de pouvoir peser réellement sur l’agenda politique, à savoir le milieu des années 1980. En analysant de près le contexte dans lequel s’est déroulé ce moment atypique de notre histoire récente, nous réussirons certainement à mieux cerner les enjeux qui sont aujourd’hui ceux d’une pensée politique française qui se voudrait authentiquement libérale.
Le libéralisme de l’individu à la conquête d’un espace politique : la parenthèse libérale des années 1980
sans parler des catholiques libéraux, dont nous avons dit en introduction qu’ils représentaient un courant à part entière du libéralisme français du XiXe siècle.
sylvie Guillaume, « L’uDF et l’économie : le libéralisme revisité », in Gilles Richard, sylvie Guillaume et Jean- François sirinelli (dir.), Histoire de l’UDF. L’Union pour la démocratie française, 1978-2007, PuR, 2013, 53-61.
C’est par exemple la thèse que développe François Denord dans ses différents travaux sur le néolibéralisme, parmi lesquels Néo-libéralisme version française. Histoire d’une idéologie politique, Demopolis, 2007 ; « Les droites parlementaires et le libéralisme économique au début des années 1980 », in Olivier Dard et Gilles Richard (dir.), Les Droites et l’économie en France au XXe siècle, Riveneuve, 2011, 17-26.
Pour un aperçu plus détaillé de cette question, nous nous permettons de renvoyer à Jérôme Perrier, « La parenthèse libérale de la droite française des années Le phénomène politique de la “bande à Léo” ou l’échec de la promotion d’un libéralisme contre l’état », Histoire@Politique, revue électronique, n° 25, janvier- avril 2015, (on pourra notamment y trouver les références précises des nombreux textes cités ci-après). On peut aussi se reporter à Jérôme Perrier, « Alain Madelin et la brève tentation libérale de la droite française (1981-1986) », in Dominique Barjot, Olivier Dard, Frédéric Fogacci et Jérôme Grondeux (dir.), Histoire de l’europe libérale. Libéraux et libéralismes en europe, XViiie-XXie siècles, Nouveau Monde éditions, 2016.
Voir serge Audier, Néo-libéralisme(s). Une archéologie intellectuelle, Grasset, 2012.
sur ce sujet, voir les différents travaux de Kevin Brookes, notamment « Deux réseaux de promotion du néo- libéralisme entremêlés dans les années 1960 et 1970 : l’Aleps et le groupe des Nouveaux économistes », in Barjot, O. Dard, F. Fogacci et J. Grondeux (dir.), op. cit.
Henri Lepage, Demain le capitalisme, Le Livre de poche, « Pluriel », 1978, et Demain le libéralisme, Le Livre de poche, coll. « Pluriel », 1980.
entretien d’Alain Madelin avec l’auteur.
La Nouvelle Lettre, 27 novembre 1984.
Pour reprendre le titre d’un livre de Jacques Frémontier, Les Cadets de la droite, seuil, 1984.
Voir Bernard Lachaise, « Le RPR et l’économie, 1976-1981 », in Olivier Dard et Gilles Richard, cit., p. 213- 223.
Voir Gilles Richard, « “L’expérience Barre” ou l’entrée de la France dans l’ère néolibérale, 1976-1981 », in Olivier Dard et Gilles Richard (dir.), cit., p. 277-291.
Liberté économique et progrès social, n°53, mars 1985, « François Léotard à l’ALePs : Quel libéralisme? »
Ibid.
tous ces chiffres sont tirés d’une intéressante analyse de Jean-Claude Casanova publiée dans L’Express du 7-13 juin 1985, sous le titre « Libéraux ou socialistes ? ».
entretien d’Alain Madelin avec l’auteur.
Raymond Barre, Réflexions pour demain, Paris, Hachette, 1984, « Pluriel », p. 35.
entretien d’Alain Madelin avec l’auteur.
Un rapide survol des penseurs libéraux français, comme nous venons de le faire tout au long de ces pages, pourrait induire le lecteur en erreur en lui laissant penser que le libéralisme hexagonal était exclusivement une affaire d’intellectuels, retranchés dans leurs certitudes et dans leur tour d’ivoire. Certes, à la différence de la Grande-Bretagne, il n’a pas existé de ce côté-ci de la Manche de véritable parti politique structuré se revendiquant explicitement, jusque dans son nom, de la philosophie libérale, même si de grands hommes d’État du XIXe siècle ont été d’éminents représentants d’une forme de libéralisme, fût-il assez autoritaire, centralisé et protectionniste (Guizot étant, bien entendu, le plus important d’entre eux). Qui plus est, bon nombre de libéraux incarnant le courant individualiste et anti-étatiste du libéralisme français34 furent également soit des parlementaires (il suffit de penser à Benjamin Constant, à Frédéric Bastiat et à bien d’autres membres de l’école de Paris, comme Léon Say ou encore Yves Guyot, qui furent même ministres), soit des intellectuels très activement engagés dans les débats politiques de leur temps. Quant au XXe siècle, il faut commencer par rappeler que le libéralisme dans sa version étatique y a été successivement représenté par des personnalités de tout premier plan (Raymond Poincaré, Antoine Pinay, Valéry Giscard d’Estaing, Raymond Barre…), mais aussi par des partis politiques importants, comme le CNIP après la Libération (un parti dont était proche Jacques Rueff) ou encore l’Union pour la démocratie française (UDF), créée en 1978 à l’instigation de l’Élysée pour incarner le « libéralisme avancé » giscardien face au néogaullisme chiraquien 35. Pour ce qui est en revanche du libéralisme anti-étatiste et individualiste, il a semblé ne pouvoir déboucher sur une action politique concrète et de portée nationale que dans une étroite fraction du spectre politique, et qui plus est durant une très brève période.
Mais avant de revenir sur cet épisode, il convient de préciser d’emblée que nous ne partageons absolument pas la vision homogénéisante véhiculée par certains auteurs selon laquelle l’ensemble des forces politiques françaises (et notamment la droite) se seraient converties au « néolibéralisme » dans les années 1980, au point que ce dernier dicterait dès lors l’agenda de tous les partis de gouvernement 36. Il nous paraît bien plus justifié d’affirmer que le ralliement à une certaine forme de libéralisme a été extrêmement ambigu, qu’il n’a guère concerné qu’une étroite frange de l’échiquier politique et, enfin, que ce phénomène n’a par ailleurs été perceptible que durant une très courte période de temps, correspondant essentiellement au début des années 1980, c’est-à-dire au premier septennat de François Mitterrand, c’est-à-dire dans un contexte politique tout à fait singulier 37.
D’abord, pas plus qu’il n’existe un libéralisme, il n’existe un néolibéralisme 38. Il est en effet possible de distinguer clairement deux néolibéralismes correspondant à deux périodes bien différentes. Le premier correspond à la fin des années 1930 et a été incarné par le célèbre colloque Lippmann d’août 1938, qui entendait – dans le contexte de la Grande Dépression – dessiner les contours d’un libéralisme rénové, éloigné du « laissez-fairisme manchestérien » (comme on disait alors), autrement dit un libéralisme compatible avec une assez forte intervention de l’État, destinée à sauver l’économie de marché en la régulant davantage. Ce courant est ainsi fort éloigné du second néo- libéralisme qui, à la faveur de la crise du keynésianisme dans les années 1970 et sous l’impulsion notamment des monétaristes de l’école de Chicago (à commencer par Milton Friedman), a développé une critique intransigeante de l’État et cherché à renouer avec une forme de libéralisme plus radical dans sa promotion du laissez-faire.
Si les années 1980 constituent à l’évidence une période originale dans notre histoire récente, c’est précisément parce qu’il s’agit là du seul moment où ce second néolibéralisme, foncièrement anti-étatiste, a séduit une partie – mais une petite partie seulement – de la classe politique française, tandis que la première forme de néolibéralisme, beaucoup plus statophile, a quant à elle toujours su trouver des défenseurs au sein des élites politiques et intellectuelles de l’Hexagone.
L’aleps et les nouveaux économistes, ou la promotion d’un libéralisme anti- étatiste au sein de la droite française 39
Rien n’illustre mieux ce constat que l’histoire de l’Association pour la liberté économique et le progrès social (Aleps). Créé en décembre 1966, ce cercle de réflexion regroupe des intellectuels libéraux (comme Jacques Rueff ou Daniel Villey) et des journalistes, mais surtout des chefs d’entreprise issus de la frange conservatrice du patronat. Si la doctrine de l’Aleps est d’abord assez floue, l’association connaît dix ans plus tard un tournant majeur dans son histoire avec l’affirmation en son sein de ceux que l’on a appelé alors les
« Nouveaux Économistes ». Ce groupe d’universitaires libéraux comprend notamment Pascal Salin (fondateur et animateur du « séminaire de théorie économique Jean-Baptiste Say », à l’université Paris-Dauphine), Florin Aftalion, Jean-Jacques Rosa, André Fourçans, Georges Gallais-Hamonno, Jacques Garello ou encore Henri Lepage. Autant d’économistes qui se donnent pour mission d’acclimater en France un libéralisme nettement plus radical que le « libéralisme avancé » défendu alors par Giscard (et qui s’avère dans la droite ligne du « libéralisme par l’État » que nous avons si souvent mentionné au fil de ces pages). Les sources d’inspiration de ces intellectuels affichant un libéralisme décomplexé viennent principalement d’outre-Atlantique (leurs travaux sont très influencés par les économistes de l’école de Chicago, ainsi que par les Austro-Américains Friedrich von Hayek et Ludwig von Mises), mais ils plongent aussi leurs racines dans le libéralisme individualiste et anti- étatiste français du XIXe siècle, alors tombé dans un oubli presque complet au sein de l’Hexagone. La promotion de ce second néolibéralisme (nettement plus radical que le premier, au point que ses ennemis auront tôt fait de le qualifier d’« ultralibéralisme ») se fait à travers un certain nombre de revues et de manifestations assez confidentielles, mais le mouvement parvient néanmoins à atteindre le grand public au tournant des années 1980, grâce notamment aux best-sellers d’Henri Lepage, Demain le capitalisme et Demain le libéralisme 40. Les liens entre les Nouveaux Économistes et certains hommes politiques français de l’époque (sensiblement de la même génération qu’eux) sont étroits, voire même intimes. C’est tout particulièrement vrai d’Alain Madelin, un ancien militant du groupe Occident qui a rompu avec l’extrême droite en 1968 pour rallier le parti giscardien, avant d’être élu député UDF de Redon en 1978, à l’âge de 32 ans. Après avoir renoncé au radicalisme militant de ses années étudiantes (un radicalisme motivé par un anticommunisme virulent), le jeune Madelin est très vite devenu l’adepte passionné d’un libéralisme décomplexé et extrêmement structuré, qu’il va découvrir à la faveur de ses lectures (celle de Bertrand de Jouvenel, notamment) 41, mais également au sein de diverses structures. Ainsi, grâce à Guy Lemonnier (alias Claude Harmel), il côtoie au tournant des années 1970 l’Institut d’histoire sociale animé par Georges Albertini, ainsi que l’Institut supérieur du travail, un organisme créé deux ans plus tôt afin d’organiser des stages destinés à informer les cadres des grandes industries françaises des réalités du monde syndical. Claude Harmel confie aussi au jeune Madelin le soin d’organiser la Semaine de la pensée libérale, en lien avec l’Aleps. Lorsque celle-ci devient en 1977 le point de ralliement des Nouveaux Économistes, le Jeune Turc giscardien connaît personnellement ces derniers, puisqu’il assiste à bon nombre de leurs manifestations, à commencer par leurs universités d’été qui se tiennent chaque année à Aix-en-Provence. C’est ainsi que Jacques Garello, le directeur de La Nouvelle Lettre (l’organe de la « Nouvelle Économie ») peut écrire en novembre 1984 : « Si seulement tous les libéraux étaient de la trempe d’Alain Madelin, nous pourrions être rassurés. Ce jeune parlementaire n’est bien évidemment pas un “Nouvel Économiste”, mais il en est si proche, il a participé à tant de combats intellectuels communs qu’on pourrait le faire “Nouvel Économiste d’honneur”. C’est en tout cas, sans conteste, l’un des hommes politiques les plus connaisseurs en matière de libéralisme 42. »
De fait, Alain Madelin est très proche de Pascal Salin et, plus encore, d’Henri Lepage, qui devient alors un ami et restera pendant des années l’un de ses principaux conseillers, les deux hommes partageant les mêmes références intellectuelles. C’est ainsi que le député de Redon, à partir de la fin des années 1970, n’hésite pas à s’afficher ouvertement comme un fervent admirateur des courants les plus novateurs et les plus radicaux du libéralisme contemporain, que ce soit l’école autrichienne d’économie (avec ses deux plus éminents représentants que sont Friedrich von Hayek et Ludwig von Mises), l’école du Public Choice (qui, sous l’impulsion du prix Nobel d’économie 1986 James Buchanan, développe une critique radicale de l’État, conçu comme un marché politique) ou, dans une moindre mesure, l’école de Chicago (alors animée par le prix Nobel d’économie 1976 Milton Friedman). Mais si le libéralisme défendu par Alain Madelin et ses amis de l’Aleps se réclame volontiers de courants et d’auteurs surtout actifs dans le monde anglo-saxon, ces croisés du libéralisme entendent aussi redécouvrir certaines œuvres françaises, tombées dans l’oubli dans leur propre pays parce qu’identifiées à un « laisser-faire » jugé périmé au temps du keynésianisme et du technocratisme triomphants. De ce point de vue, la figure dominante qu’ils se plaisent à citer aussi souvent qu’ils le peuvent est celle de Frédéric Bastiat, génial homme de plume du milieu du XIXe siècle et contempteur devant l’Éternel du protectionnisme et du socialisme. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le président américain Ronald Reagan aimait, lui aussi, à citer cet auteur et s’il est encore aujourd’hui célébré outre-Atlantique par les courants les plus radicaux du libertarianisme américain.
Bien entendu, il serait exagéré d’affirmer que des figures comme Hayek, Mises ou Bastiat font au début des années 1980 l’unanimité au sein de la droite française ou même au sein du seul Parti républicain (PR), dont Alain Madelin devient le numéro 2 en 1985. Outre que rares sont les hommes politiques à avoir, comme le député de Redon, le temps et le goût de se plonger dans des ouvrages théoriques, il est évident qu’un libéralisme aussi radical a plus de chance de séduire des intellectuels que des gouvernants, nécessairement confrontés aux dures réalités du pouvoir. Reste qu’au début de la décennie 1980, le rejet croissant de l’expérience socialiste engagée après la victoire de François Mitterrand a levé certains tabous et conduit à une radicalisation des positions, poussant ainsi une frange de la droite à assumer sans complexe ses positions, qu’elles soient libérales ou conservatrices.
une conversion limitée et ambiguë de l’opinion française des années 1980 au libéralisme
Plusieurs éléments paraissent en effet témoigner d’un phénomène d’opinion de grande ampleur, sur lequel certains « cadets de la droite 43 » (à commencer par la « bande à Léo ») sont soupçonnés de chercher à surfer. Si l’on s’en tient d’abord aux livres parus à cette époque, on est en effet tenté de souscrire au jugement fait alors par le magazine L’Express selon lequel « depuis trois ans, n’importe quel penseur brandissant l’étendard libéral est assuré de figurer sur la liste des best-sellers ». De fait, entre 1983 et 1986, on dénombre la parution de plus d’une soixantaine d’essais de tonalité franchement libérale, auxquels il convient d’ajouter la traduction de grands classiques libéraux, notamment étrangers (à commencer par Hayek et Mises). La presse dans son ensemble témoigne également de cette impressionnante vague. Deux grands news magazine en particulier sont nettement en pointe : L’Express, d’abord, sous l’impulsion de Jimmy Goldsmith et de Jean-François Revel, et Le Figaro- Magazine de Louis Pauwels, ensuite. Dès 1981, et de manière croissante à l’approche des élections législatives de 1986, l’hebdomadaire de la droite décomplexée, qui appartient alors au groupe Hersant, ouvre ses colonnes à la frange la plus radicale des libéraux et, au début de 1985, Alain Madelin y publie même une série de vingt substantielles chroniques, sous le titre « Pour comprendre et aimer le libéralisme ». Pauwels, qui ne manque jamais une remise du prix de la Pensée libérale organisée par l’Aleps, profite ainsi de cette cérémonie pour saluer en juin 1985 son « ami » Alain Madelin, en qui il voit « le véhicule de la pensée libérale dans la classe politique ».
À dire vrai, tous les partis de droite paraissent gagnés par la fièvre libérale à l’approche des législatives du printemps 1986 et alors que l’expérience Thatcher en Grande-Bretagne et l’expérience Reagan aux États-Unis semblent devoir servir de modèles à certains. De ce point de vue, la métamorphose la plus spectaculaire est sans conteste celle du RPR et de son président, Jacques Chirac, naguère chantre du « travaillisme à la française ». En quête d’un nouvel Évangile après la débâcle de son parti aux élections européennes de 1979, le chef du parti néogaulliste entame à cette date-là un ralliement progressif à la cause libérale 44, qui atteint son apogée en 1984, lorsqu’il remet à Friedrich von Hayek la médaille de la Ville de Paris et l’accueille par un discours enthousiaste que n’auraient pas renié les Nouveaux Économistes les plus fervents (du reste présents à la cérémonie).
Le cas de Raymond Barre est différent 45. Certains se plaisent à rappeler qu’il est le premier traducteur de Hayek en France, et lorsqu’il est invité par l’Aleps le 27 avril 1983, l’intéressé lui-même procède à un semblant de mea culpa, admettant que son action dans le passé n’a pas été « assez libérale » parce que beaucoup de Français ne l’auraient pas alors suivi. Le contraste n’en est pas moins saisissant lorsque l’on compare la prestation somme toute fort modérée de l’ancien Premier ministre avec celle effectuée deux ans plus tard (dans le même cadre de l’Aleps) par François Léotard. En effet, celui qui dirige le Parti républicain depuis 1982 ne lésine pas sur les moyens pour convaincre son auditoire de l’authenticité de sa fibre libéralo-libertaire, tout en exhibant comme une caution d’authenticité sa proximité avec Alain Madelin, assis au premier rang. « J’ai vécu, déclare-t-il, quarante-deux ans de ma vie dans une société colbertiste, étatisée, mais en rien dans une société libérale telle que nous la rêvons. » Et le secrétaire général du PR d’enfoncer le clou : « Le parti que je représente est l’héritier de la plus vieille famille libérale française. Le courant des “indépendants” trouve ses racines chez Benjamin Constant, chez Tocqueville, chez Bastiat, chez Hayek, chez Popper. […] nous récusons l’étiquette de “libéralisme avancé”, “ouvert” ou “social”. Nous ne souhaitons pas ajouter un adjectif au terme de libéralisme. […] Entre Mme Thatcher et MM. Kohl et Reagan, si les moyens et les résultats sont différents, il y a en commun l’esprit d’une certaine vision libérale du monde. Il m’est donc bien égal que l’on me qualifie de libéral “ultra”46. » Et lorsque, à cette même tribune, Henri Lepage regrette que, deux ans plus tôt, Raymond Barre ait pu expliquer que l’État conservait un rôle fondamental à jouer, notamment pour guider un marché réputé myope, François Léotard n’hésite pas à prendre le contre-pied de l’ancien Premier ministre en utilisant des termes qui semblent directement inspirés par l’école libérale du Public Choice (chère aux Nouveaux Économistes et à Alain Madelin) : « Je ne partage pas son point de vue, car je ne vois pas qui peut définir l’intérêt général. On parle des erreurs du marché mais les erreurs de l’État sont infiniment plus graves et plus dangereuses 47. »
En d’autres termes, le PR se présente au milieu des années 1980 comme l’avant- garde libérale de l’opposition, et c’est bien cette ligne – celle d’un libéralisme foncièrement anti-étatiste et anti-dirigiste – que ses jeunes dirigeants, sous l’impulsion d’Alain Madelin, défendent lors de l’élaboration du programme de gouvernement de 1986, qu’ils conçoivent comme devant établir une rupture nette avec le socialisme mitterrandien, bien entendu, mais aussi avec les timidités du « libéralisme avancé » giscardien, version édulcorante à leurs yeux du vieux libéralisme étatique français, autoritaire et conservateur.
Pour autant, il convient de relativiser le basculement idéologique de la droite dans sa globalité (et plus encore de l’opinion publique en général) en faveur du libéralisme, a fortiori dans sa version la plus radicale. De fait, dans la presse française du milieu des années 1980, il est à la mode de publier des enquêtes d’opinion pour mesurer l’adhésion supposée de l’opinion française aux idées libérales – à tel point que le « libéromètre » devient une sorte de marronnier auquel n’échappe aucun média. Or, ce qui ressort de toutes ces enquêtes, c’est que l’observateur peut y voir aussi bien le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Certes, toutes attestent une progression indubitable des idées libérales depuis l’alternance de 1981, mais outre qu’il est extrêmement difficile de savoir quelle est, dans ce phénomène, la part de déception face au pouvoir en place et quelle est celle d’une adhésion sincère aux valeurs du libéralisme politique, économique et culturel, les chiffres eux-mêmes se prêtent à des exégèses sans fin. Ainsi, en juin 1985 48, pour 63 % des Français (contre 15 %), le mot « libéralisme » éveille un sentiment positif (alors qu’ils ne sont que 45 % contre 36 % à penser la même chose du mot « socialisme »), mais dans le même temps le mot « capitalisme » suggère un sentiment négatif pour 49 % d’entre eux (contre 29 %) ; 41 % considèrent que les politiques libérales réussissent mieux face à la crise (contre 18% seulement en faveur des politiques socialistes), mais 76 % des Français ne veulent pas que l’on supprime l’impôt sur la fortune ; 55 % ne veulent pas rendre les licenciements plus faciles ; et 58 % ne désirent pas supprimer tous les contrôles des prix. Enfin, si 44 % des sondés (contre 30 %) sont favorables à la dénationalisation des banques, 47 % (contre 30 %) n’exigent pas de l’État qu’il renonce à subventionner les entreprises en difficulté. Pour tous les observateurs, il y a là de quoi perdre son latin. Et, de fait, si l’on peut soupçonner la droite de chercher alors à vouloir surfer sur une « mode libérale 49 » perceptible dans l’opinion, rien n’indique vraiment quel type de libéralisme recouvre cette sympathie finalement fort ambiguë. C’est pourquoi, en affichant ostensiblement un libéralisme décomplexé, antidirigiste et statosceptique (pour ne pas dire statophobe), la « bande à Léo », qui entend bâtir la « maison des libéraux » autour du PR, loin de faire preuve d’un simple opportunisme électoral, prend un réel risque politique (sans du reste faire consensus au sein même du parti).
Pour ce qui est de la droite dans son ensemble, l’absence d’unanimité autour de la définition du libéralisme qu’il convient de promouvoir est encore plus criante. Outre que Jacques Chirac, dans la même semaine, peut dire une chose et son contraire (ou peu s’en faut), un certain nombre de responsables au sein du RPR rejettent catégoriquement ce qu’ils qualifient de « mode libérale » sans lendemain. Bernard Pons, par exemple, met en garde contre le « libéralisme sauvage », mais le plus virulent dans ce registre est sans conteste Philippe Séguin, qui apparaît comme « le moins libéral des cadets de la droite », brocardant à l’envi la « libéralomania » ambiante, dans laquelle il ne voit rien d’autre qu’une mode d’un « irréalisme total », véhiculant une vision de l’État et des marchés qui relève à ses yeux de « la plus haute fantaisie ». L’UDF n’est d’ailleurs pas en reste. Dans un livre paru en 1984, Raymond Barre lui-même dénonce ceux qui « s’opposaient naguère » ou « ignoraient superbement » le libéralisme, et qui « en sont devenus les “ultras” et le proclament avec la foi et le simplisme des néophytes 50 ». La charge vise ici clairement Jacques Chirac, mais celui que Giscard avait présenté un jour comme « l’un des meilleurs économistes de France » estime plus largement que « le danger du libéralisme à la mode est qu’il risque de provoquer, par certaines outrances, un phénomène de rejet des thèses libérales, alors que celles-ci s’avèrent fécondes pour l’avenir ». Raymond Barre et ses proches s’en prennent ainsi régulièrement au « reaganisme à la française », lorsque ce n’est pas directement aux « reaganillons » du PR. Simone Veil, elle, déclare se méfier d’un « effet de mode » et en appelle à un retour au « pragmatisme ». Quant au centriste Jacques Barrot, il estime pour sa part que « le libéralisme a ses limites », et affirme que la droite ne doit pas se laisser entraîner par les « ultras » et par « ces mauvais démons qui, sous prétexte de “libéralisme pur et dur”, prétendent jeter l’État à bas et se livrent à des surenchères suicidaires ». Si le député de la Haute-Loire ne donne pas de nom et se contente d’évoquer les « idéologues parisiens de l’ultralibéralisme », il ne fait guère de doute que la frange libérale du PR est directement dans son viseur.
À l’évidence, entendre fonder le renouveau idéologique de la droite sur une réhabilitation de l’initiative individuelle face à l’État (voire contre lui) est une chose extraordinairement difficile, même après cinq années d’expérience socialiste, eu égard à la très profonde statophilie dont est porteuse depuis plus de deux siècles la culture politique française.
une france statophile, définitivement rétive au libéralisme ?
De fait, après mars 1986, le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac va très vite abandonner ses ardeurs libérales des premières semaines, et son échec retentissant face à François Mitterrand, deux ans plus tard, lors de l’élection présidentielle, sera attribué par nombre de ses propres amis à sa supposée « dérive libérale ». Dans le même temps, la gauche elle-même, après s’être engluée dans le néant idéologique du « ni-ni », va bientôt reprendre l’offensive contre un libéralisme devenu son bouc émissaire favori. Si bien qu’après 1988 le seul homme politique d’envergure à avoir assumé un discours ostensiblement libéral (avec un programme d’ailleurs très en retrait par rapport aux audaces de 1986) est Alain Madelin, qui obtiendra à peine 3,91 % des voix aux élections présidentielles de 2002, signant ainsi l’acte de décès d’une tentative de longue haleine, initiée un quart de siècle plus tôt et visant à importer dans l’agenda politique français un libéralisme exaltant l’initiative individuelle contre une culture administrative, centralisée et étatiste, aussi dominante que sclérosante.
Est-ce à dire que l’échec de cette tentative particulière signifie l’impossibilité de toute volonté politique de convertir l’esprit public hexagonal aux idées libérales ? Rien n’est moins sûr. Mais toute nouvelle initiative en ce sens devra affronter un double défi. Le premier se présente sous les traits d’un paradoxe, à savoir que la gauche française est culturellement libérale mais économiquement incapable de penser en dehors d’un cadre strictement étatiste, tandis que la droite est (légèrement) plus pragmatique sur le plan économique, tout en ayant beaucoup de mal à assumer un libéralisme culturel par trop étranger à sa frange la plus conservatrice – ce que l’épisode du « mariage pour tous » a récemment démontré de manière éclatante. C’est du reste ce constat qui conduit un homme comme Alain Madelin à dénoncer ce qu’il appelle le libéralisme « hémiplégique 51 » imprégnant une partie de la classe politique française. Ce qui nous amène au second défi que devra affronter toute tentative sérieuse visant à offrir un débouché politique viable à des idées authentiquement libérales, à savoir que le clivage droite-gauche, qui structure encore largement la vie politique française, ne correspond en rien au clivage libéral-antilibéral, puisque les deux extrémités de l’échiquier partisan se retrouvent dans un antilibéralisme forcené, pour ne pas dire frénétique, tandis que les seules forces ouvertes – même timidement – aux idées libérales se trouvent précisément au centre de l’échiquier, soit à l’endroit précis où passe la ligne de partage des eaux entre les deux camps qui jusqu’à aujourd’hui ont ordonné la vie politique nationale.
Tant que les libéraux français n’auront pas une réponse forte et convaincante à ce double défi, toute volonté de diffuser leurs idées au-delà d’étroits cercles de sympathisants sera vouée à l’échec. Et c’est bien pourquoi il est plus urgent que jamais de se replonger dans l’histoire du libéralisme français des deux derniers siècles, car cet exercice salutaire apporte la démonstration imparable qu’un libéralisme de gauche est tout aussi crédible qu’un libéralisme sachant s’affranchir de notre culture étatiste dominante, autoritaire et centralisée. Une culture politique statocentrée qui est, à n’en pas douter, la cause majeure de la crise intellectuelle profonde que traverse le pays depuis plusieurs décennies maintenant.


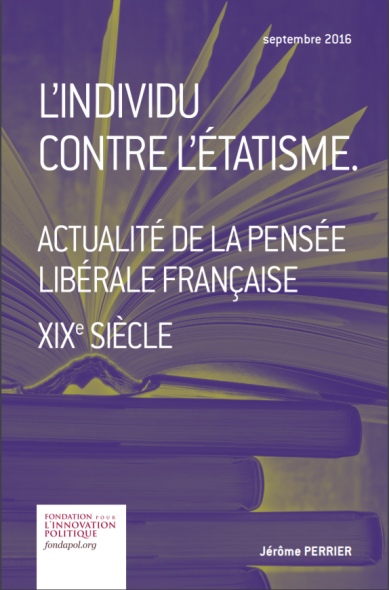

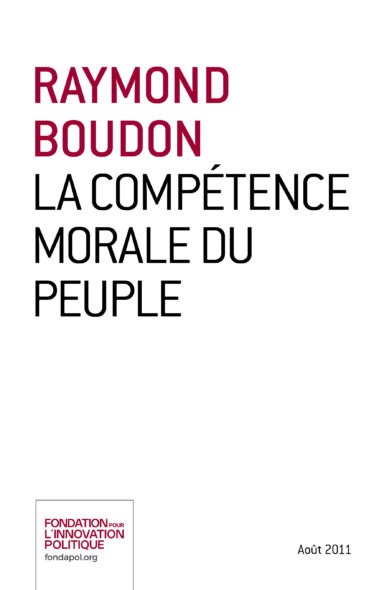













Aucun commentaire.