La crise orthodoxe (1) Les fondations, des origines au XIXème siècle
Le grand renversement
Primauté de l’origine
Ruptures et isolements
Captivités et résistances
Résumé
Qu’en est-il de la crise que traverse aujourd’hui l’orthodoxie ? On en devine l’importance géopolitique tout en peinant à la déchiffrer.Pour la comprendre, il faut appréhender comment l’Église orthodoxe se conçoit elle-même théologiquement, comment elle se représente l’écart entre ses principes constitutifs et ses vicissitudes historiques, comment elle répond au mode singulier de sécularisation religieuse et de polarisation politique qui est propre aux mondes orthodoxes.
De l’Antiquité aux Temps Modernes, en passant par le Moyen Âge, au cours d’une période alternant confrontations, ruptures, isolements et dominations, cette partie propédeutique montre en quoi s’est édifié en Orient un autre christianisme, en quoi le péril de sa disparition et la nécessité de sa résistance face à l’Occident et à l’islam ont accru la conscience de son irréductibilité et en quoi ses luttes pour la survie ne sont pas allées sans des risques de dénaturation auxquels font écho ses problèmes contemporains.
Publiée simultanément, la seconde partie de la présente note s’intitule La crise orthodoxe (2) Les convulsions, du XIXe siècle à nos jours et en explique les raisons immédiates.
Jean-François Colosimo,
Philosophe, théologien, président de l’Institut orthodoxe de Paris et directeur des éditions du Cerf.
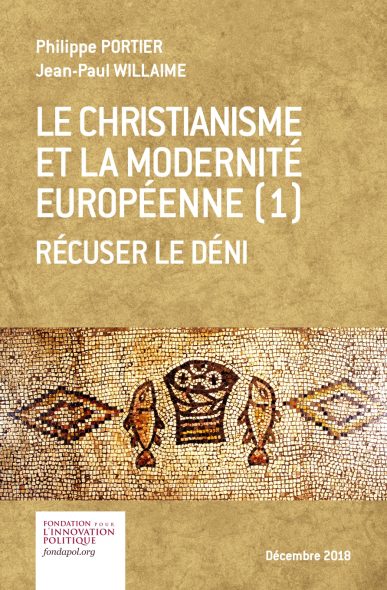
Le christianisme et la modernité européenne (1) récuser le déni
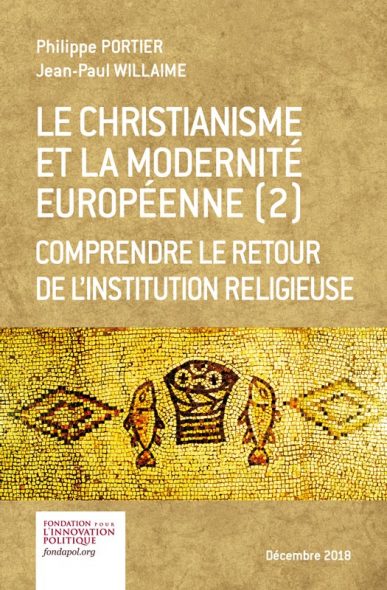
Le christianisme et la modernité européenne (2) comprendre le retour de l'institution religieuse
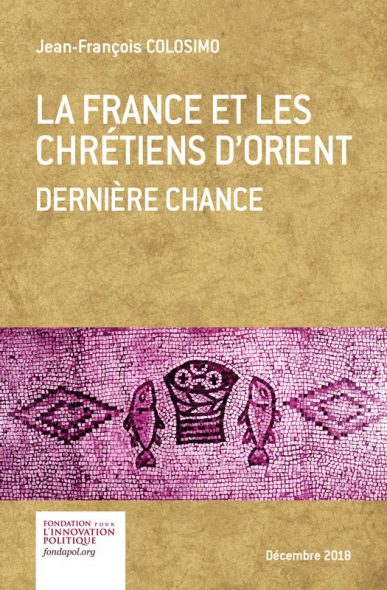
La France et les chrétiens d'Orient dernière chance
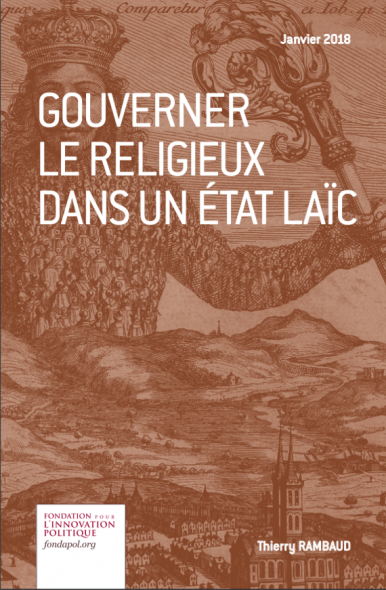
Gouverner le religieux dans un État laïc

La religion dans les affaires : la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise)
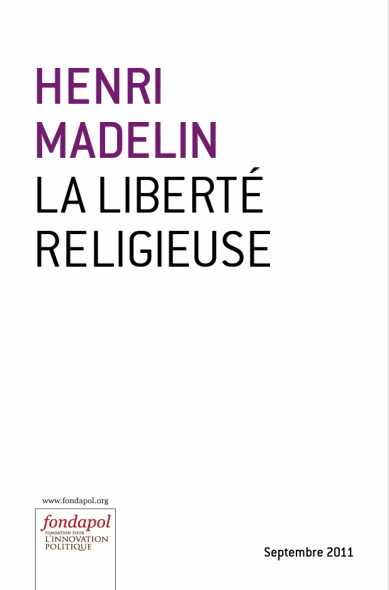
La liberté religieuse
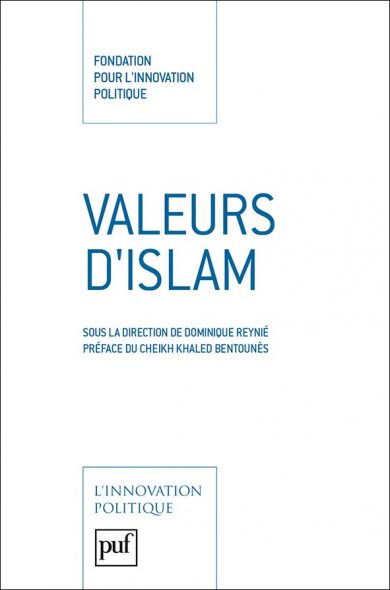
Valeurs d'islam
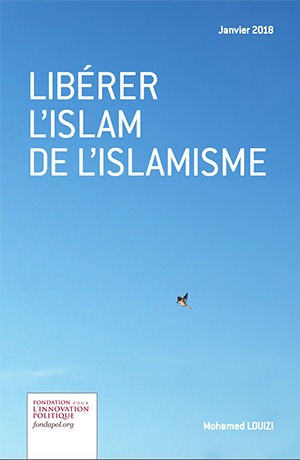
Libérer l'islam de l'islamisme

Portrait des musulmans d’Europe : unité dans la diversité

Portrait des musulmans de France : une communauté plurielle
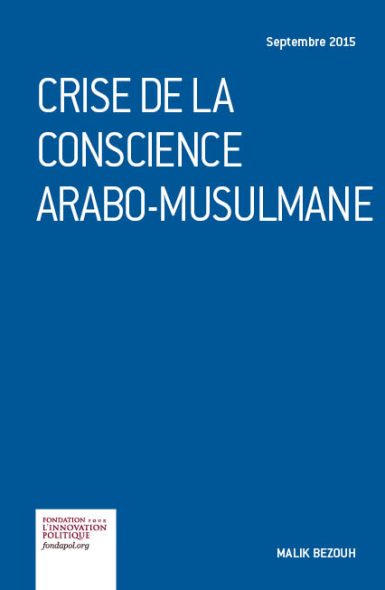
Crise de la conscience arabo-musulmane
Le grand renversement
Le temps n’est plus où, au sein d’un monde divisé entre l’Est communiste et l’Ouest capitaliste, l’orthodoxie apparaissait comme un univers martyre d’essence purement spirituelle. L’Orient chrétien, avec ses liturgies, ses icônes et ses anachorètes, semblait destiné à combler la décrue symbolique d’un Occident prêt à dévaler la pente de la déchristianisation. Son immutabilité présumée en faisait paradoxalement un signe avant-coureur de changements difficilement discernables mais sûrement désirables que résumait l’attente d’un « nouveau Moyen Âge », lequel, selon la prédiction du philosophe religieux russe Nicolas Berdiaev, verrait la fraternité renouer avec la verticalité, la beauté avec la frugalité. L’heure était à l’antan ou à l’ailleurs, et que l’orthodoxie pût incarner à la fois une si profonde nostalgie et un si proche exotisme ajoutait à la fascination qu’elle exerçait.
Dès l’après-1945, la redécouverte des sources communes de la foi chrétienne, menée par de savants orthodoxes en compagnie de leurs homologues catholiques et protestants, avait laissé espérer le renouveau d’une théologie existentielle qui, affranchie des impasses modernes, saurait répondre aux questions angoissées de l’humanité contemporaine. Le dialogue battait son plein à Genève, au Conseil œcuménique des Églises, ou à Jérusalem, où la rencontre du patriarche Athénagoras et du pape Paul VI, en 1964, fit croire proche la résolution d’un divorce millénaire, préalable à de plus grandes réconciliations à l’échelle planétaire. Dans les suites de 1968, la voix dissidente et fervente d’Alexandre Soljenitsyne perçait le rideau de fer, élevait le goulag au rang d’un Golgotha, dénonçait l’inhumanité à laquelle conduisait la négation de la transcendance, mortifère sous le socialisme, délétère sous le libéralisme, et renvoyait dos à dos les deux systèmes matérialistes. Les troubles récurrents du Levant, appelés à s’amplifier sous l’essor de l’islam politique visible dès les années 1970 et la guerre du Liban, soulignaient plus que jamais la vocation médiatrice de l’orthodoxie au regard de sa longue expérience de conflits pluriséculaires à fond de religion et de civilisation. Enfin, par la perpétuation active de son fort corpus ascétique et mystique, la tradition chrétienne orientale ne constituait-elle pas un contrepoids à la tentation de l’individualisme psychologisant qui puisait déjà volontiers, sur un mode consumériste et désordonné, dans les sagesses apophatiques de l’Asie ?
Mais il y avait plus, participant de l’évidence fulgurante ou s’y apparentant, à peine l’orthodoxie entrait-elle en acte et se dévoilait dramaturgie divine.
« Le Christ est ressuscité ! » : c’était dans la lumière glorieuse de la Pâque que l’Église d’Orient prêchait la Croix et sa propre crucifixion, sans cesser d’encore et encore confesser, tout au long d’immémoriales célébrations, une inébranlable espérance dans l’histoire. Ors, encens et fanaux, ballets hiératiques et chœurs sacrés, bénédictions, onctions et prosternations : l’univers s’annonçait transfiguré et la matière, la chair, le corps communiaient à cette transfiguration sans que jamais se dissolve le caractère incessible de chaque nom et de chaque visage. Ce que délivraient en une sorte de certitude les regards des saints jaillissant des fresques noircies, des moines irradiant la pénombre de chapelles désertées, des pèlerins surgissant au détour de chemins menant à des sanctuaires en ruine pour quiconque parcourait les mondes orthodoxes, alors tous ou presque abandonnés au désastre. Et s’il fallait la désigner, cette certitude était celle du Royaume, toujours perdu et toujours retrouvé.
En bref, par son ré enracinement obstiné dans la transcendance en dépit des plus grands malheurs, l’orthodoxie s’affichait en antidote au nihilisme ambiant. Elle se révélait être l’Orient de l’Occident, l’Occident de l’Orient, jetant un pont d’autant moins suspect entre des sphères longtemps étrangères et antagoniques qu’elle avait perdu toute puissance tout au long du XXe siècle et que le renoncement forcé à ses pesanteurs politiques et sociologiques la rendait libre d’attester de l’Évangile, pris en son essence et en son historicité, sans relativisme et sans intégrisme, comme salut. À l’instar du sacrifice eucharistique, son martyre avait fait d’elle un offertoire de communion, n’ayant plus d’existence que d’être un don « pour la vie du monde » : qui d’autre que le Christ descendu aux enfers pouvait abolir la mort de Dieu qui, de charnier en charnier, avait entraîné la mort de l’Homme ?
C’était hier. Rien de cela n’était ni vrai ni faux. Mais tout s’est déroulé autrement qu’attendu. La prophétie a moins été démentie qu’oblitérée et oubliée sous l’accélération de l’Histoire. Le devenir universel chaotique qui s’est avéré implacable sous l’enseigne de la mondialisation s’est vérifié dans le cas de l’orthodoxie sous le signe de la convulsion. Revenue brutalement sur la scène de l’Histoire à la suite de siècles d’oppression qui l’avaient rendue exsangue, elle a relevé de manière contradictoire le défi qui était le sien d’enfin pouvoir s’épanouir en liberté.
La représentation a basculé. Dès 1989, une légende noire est venue se substituer à l’enluminure dorée. Guère mieux fondée, aussi artificielle et non moins contestable, elle a naturalisé à son tour la semblance en flagrance, le réquisitoire succédant à l’apologie. Sur les écrans prévalent désormais les clichés de prélats baptisant des miliciens devant les murailles de Sarajevo, de hiérarques encensant des oligarques sous les dômes du Kremlin, d’éminences absolvant des tyrans sur les décombres d’Alep. L’Église confessante d’hier, persécutée par les pouvoirs totalitaires, a ainsi cédé la place, dans l’imaginaire, à l’Église militante d’aujourd’hui, rééditant l’alliance du trône et de l’autel. L’antique a ainsi laissé la place à l’arriéré, et le prémonitoire au rétrograde.
Qu’elle soit conçue négativement ou positivement selon les idéologies qui président à sa formation, cette inversion de perspective relève de l’effet optique. De manière circonstancielle, elle dépend pour beaucoup du nouveau partage politique qui occupe la conscience européenne et des batailles que s’y livrent les partisans du progrès et de la réaction. Sur le plus long terme, elle dénote que la question orthodoxe reste affaire de perception, non pas de réception. Autrement dit, une telle symétrie dans l’effet de balancier montre d’abord combien elle n’a pas varié en statut et qu’elle reste réduite, vue d’Occident, à un utile miroir déformant.
Attraction ou répulsion, il faut y voir le prix que l’orthodoxie acquitte pour avoir constitué sur un millénaire et demi un arc de résistance prouvant, à rebours de l’historiographie classique et de la mentalité dominante, qu’il est une autre Église, un autre Orient, une autre Europe ou encore un autre schisme que celui entre Rome et la Réforme. L’intégrer au tableau forcerait à une difficile révision de la généalogie et de la grille des cultures reçues, car son existence même renvoie la civilisation occidentale à un conflit originel en filiation et à une contestation permanente en droit et en légitimité sur la nature même du christianisme.
D’être l’objet d’une impensable altérité voue ainsi l’orthodoxie au rôle du tiers convoqué ou rejeté autant que de besoin, selon l’opportunité. Elle en ressort indifféremment en jumeau angélique qui serait à muséifier ou en double démoniaque qui serait à exorciser. Pour autant, aujourd’hui, c’est son état au-dedans qui alimente en premier lieu de telles instrumentalisations au-dehors. En dépit de la propension au complot qui agite aisément les peuples inscrits dans son orbe confessionnel, lesquels sont souvent pris au sentiment d’être assiégés, et quoique parfois non sans raison, ses faillites actuelles lui sont propres.
La contradiction qui domine et menace l’orthodoxie de l’intérieur et l’expose aux pressions contradictoires de l’extérieur tient à la difficulté qu’elle-même éprouve à distinguer entre monde orthodoxe et Église orthodoxe. Cette difficulté est révélatrice de la relation singulière qu’elle entretient avec la sécularisation depuis les Temps modernes, ses métamorphoses ayant été des pseudo morphoses. Irrésolue, cette altération explique son incapacité à endiguer les fragmentations qu’elle a subies et continue de subir sous le coup de captations impériales antagoniques dont l’affaire d’Ukraine, qui divise aujourd’hui les patriarcats de Constantinople et de Moscou, constitue le point d’orgue. L’état de morcellement prédominant ces deux derniers siècles a ainsi trouvé pour image ultime, à l’automne 2018, l’implosion en direct, sous l’œil des caméras, de l’Église orthodoxe en des Églises orthodoxes.
La crise présente que connaît l’orthodoxie vaut, certes, exemple de concentration sur le fait religieux qu’opère la mondialisation en déplaçant le pivot de l’humanité historique : l’unification axiale et centripète d’une identité abstraite provoque mécaniquement la rébellion périphérique et centrifuge des identités concrètes. Or la religion, noyau réel ou reconstruit, apporte une justification minimale et une mobilisation maximale à l’état d’hostilité, agi ou subi, par le sectionnement immédiat qu’elle produit entre homogénéité et différence. Le devenir mondialisé ne consiste pas dans l’une ou l’autre mutation, mais dans les deux simultanément, conjuguant ensemble dilution et contraction. En quoi il se présente comme état de crise totale, paroxystique et permanente, à la fois indéchiffrable dans ses raisons et imprévisible dans ses effets.
Mais si la crise orthodoxe, au sein de la crise globale, dépend pour partie de l’imbrication entre les ordres théologique et politique qui constitue le nœud gordien du moment, encore faut-il la rapporter à l’orthodoxie en ce qu’elle a de particulier et d’irréductible. Le mot même par lequel elle se caractérise représente d’emblée un obstacle puisqu’au sens commun il indique une volonté de conformité extensive, complète et réglementaire, à un système doctrinal conçu comme vérité officielle. L’étymologie grecque du terme induit cependant une compréhension bien différente : est orthos, « se dresse et tient debout », l’humain qui a pour doxa, « luminaire et luminosité », de s’entretenir authentiquement et sincèrement avec le divin.
C’est au sens de la transmission d’une expérience vécue et d’une mémoire vivante du Christ, dans la contemporanéité à sa présence « parmi nous », et non pas en vertu d’une infaillibilité institutionnelle ou d’une adhésion subjective, que l’orthodoxie se veut l’expression de la « juste foi » dans la « juste louange ». Tout en relevant d’une orthopraxie sacramentelle, liturgique et orante sous la forme d’un riche complexe aux résonances bibliques et cosmiques, elle pose pour seul critère de vérité l’advenue du Royaume où s’établit, ici et maintenant, la communion réelle au Verbe mort et ressuscité.
Ainsi, l’articulation entre le temps et l’éternité n’y est ni celle cyclique de l’Asie, ni celle vectorielle de l’Occident. Pour la qualifier en quelque façon, il faudrait la dire épiphanique, animée par un mouvement hélicoïdal, en spirale, qui entretiendrait un incessant affleurement mutuel : après avoir fait mémoire des grands actes du salut, dont l’Incarnation, la Croix et la Résurrection, l’eucharistie byzantine commémore comme advenu le second retour en gloire qui verra la fin des temps. Entre le déjà-là et l’encore-à-venir, à la jointure du créé et de l’incréé, la vérité s’authentifie elle-même dans l’événement pascal de la sainteté tel que reçu par le Peuple de Dieu.
Est orthodoxe, au sens de l’Église, cette radicalité de l’eschatologie anticipée et réalisée dans l’Incarnation, en la personne divine et humaine de Jésus, sujet et objet de sa prédication, qui constitue l’Évangile en « Bonne Nouvelle » annoncée, dans la Pentecôte de l’Esprit, « à l’ensemble des Gentils », à l’entière humanité, tout au long de l’histoire qui est elle-même encore en cours et pourtant achevée. Mais, au sens du monde et des mondes, du peuple et des peuples qui se disent orthodoxes en conséquence du « baptême des nations » en quoi a aussi consisté l’évangélisation, au regard de leur propre historicité, qu’en est-il de l’orthodoxie ? Et comment appréhender le rapport entre ces deux temporalités ?
Il n’est de géopolitique religieuse possible à moins que l’on n’accepte le postulat qu’en ce domaine la théologie l’emporte en valeur explicative sur le flux, que l’intuition fondatrice se déploie dans les faits selon une tension créatrice mais ininterrompue, que les facteurs circonstanciels n’influencent le projet premier qu’à la marge, l’atténuant ou l’accentuant sans le déterminer ou le modifier en substance. À défaut de quoi le fait religieux n’aurait pas pour lui la durée. Afin de comprendre la crise orthodoxe, au lieu d’écumer l’actualité, il s’agit donc, auparavant, de saisir l’orthodoxie telle qu’elle-même se conçoit et se représente, principes et vicissitudes mêlés. C’est la condition pour comprendre en quoi sa singularité de constitution engage un mode non moins singulier de sécularisation religieuse et de polarisation politique.
Primauté de l’origine
Dernière en nombre des trois grandes familles qui forment le christianisme avec ses 250 à 300 millions de fidèles, l’orthodoxie se considère toutefois comme la plus ancienne et la seule continue. Attestant des origines orientales de l’Église, elle déclare en perpétuer la tradition primitive et indivise. D’une part, elle se voit la gardienne du berceau de l’Évangile, là où vécut Jésus, et de l’aire des premières missions que menèrent les apôtres dans les centres urbains de Jérusalem, Antioche et Alexandrie, puis Paul de Tarsesur tout le pourtour méditerranéen, d’Éphèse à Rome en passant par Athènes. D’autre part, elle se pense la dépositaire de foi de la communauté primitive et de la doctrine formulée, après la conversion de l’Empire romain, par les Pères du premier millénaire et telle qu’elle a été dogmatisée par les sept conciles œcuméniques qui se tinrent tous, entre 325 et 787, dans le ressort de Constantinople, la « nouvelle Rome ».
Orientale par l’histoire, l’orthodoxie l’est aussi par la géographie. Longtemps, elle a été cantonnée dans les frontières physiques de l’« Orient chrétien » qui enclos l’Est méditerranéen, le Croissant fertile, la Corne de l’Afrique, le Caucase, l’Anatolie, les Balkans, l’Est européen, et a été assignée aux sphères culturelles de la « romanité d’Orient», qu’elle soit grecque, arabe ou slave. Dans l’usage commun, le terme d’«Églises orientales » recoupe l’ensemble des chrétientés qui se proclament elles-mêmes orthodoxes ou sont issues de la mouvance orthodoxe et qui forment une mosaïque de hiérarchies et de liturgies guère intelligibles pour l’observateur profane. Au sens strict, l’Église orthodoxe se distingue de cette constellation d’entités disparates en ce qu’elle peut asseoir sa revendication à l’intégrité, à l’unité et à l’universalité sur une activité missionnaire constante au cours des deux millénaires d’expansion du christianisme.
Pour mémoire, cette déchirure initiale étant trop souvent omise, les premiers grands schismes durables sont survenus non seulement dès le Ve siècle, mais encore en Orient. Aux marches méridionales de l’Empire romain, qui devient peu à peu « byzantin » sous l’effet des invasions barbares dans sa partie occidentale, les antiques chrétientés des espaces asiate, africain et caucasien entrent en sécession. Ces fractures sont issues de motifs proprement doctrinaux. Elles découlent de la lutte théologique entre le sémitisme d’Antioche et l’hellénisme d’Alexandrie que ni Rome, ni Constantinople, alors alliées, ne réussissent à endiguer. Les confessions et communautés auxquelles elles vont donner lieu se montreront cependant plus persistantes que les hérésies de nature intellectuelle, à l’instar de l’arianisme, car leur séparatisme est à la fois culturel et cultuel.
Se déclarant pour certaines « apostoliques » et pour la plupart « orthodoxes », ayant revêtu diverses appellations au fil des âges, désormais rassemblées sous l’intitulé d’«Églises orientales orthodoxes», on peut les rassembler en deux grands groupes:
- d’une part, l’Église assyrienne ou d’Orient et son extension indo-malabare, dite péjorativement « nestorienne » ou « dyophysite », de filiation antiochienne, à l’exégèse typologique, insistant sur l’humanité de Jésus, qui rejette le troisième concile œcuménique tenu à Éphèse en 431 ayant proclamé Marie comme Théotokos, «génitrice de Dieu». Présente en Perse, elle essaimera jusqu’en Asie avant que les invasions mongoles, auXIIIe siècle, provoquent son effondrement et la force au repli, la cantonnant dès lors à une existence toujours plus réduite ;
- d’autre part, les Églises arménienne, syriaque, copte et leurs extensions afro- éthiopienne et indo-malankare, dites péjorativement « monophysites », d’inspiration alexandrine, à l’exégèse allégorique,insistant sur la divinité du Christ, qui rejettent le quatrième concile œcuménique convoqué à Chalcédoineen 451 et ayant décrété le Christ comme « une personne en deux natures, divine et humaine ». Sises aux limes physiques et mentaux de la romanité, bientôt isolées par l’islam conquérant, elles se constitueront, à l’exception du cas diasporique arménien, en des réalités ethnico- religieuses fortement territorialisées et politiquement contraintes, centrées sur l’impératif de leur survie.
Les deux blocs ainsi formés sont antagoniques et l’unité au sein du second demeure de principe. Ces Églises sont de fait similaires à l’Église orthodoxe par la structure, la mentalité, la pratique, de même qu’elles en sont solidaires par l’histoire, mais ne sont pas en communion avec elle et représentent à ce titre leur propre Orient séparé. Sachant cette limitation, mais aussi les échecs des anciennes tentatives de conciliation, l’Église orthodoxe a renoué le dialogue dès qu’elle a pu, au XXe siècle, avec ses « sœurs » orientales.
Au sein de l’orthodoxie, au sens plein du terme, malgré de sérieux aléas et empêchements, l’évangélisation, qui est inhérente à la nature de l’Église, a été menée à partir de différents relais patriarcaux sans discontinuité et sur l’ensemble des continents : en Europe de l’Est par Constantinople, du IXe au XIVe siècle ; dans l’Arctique, l’Asie centrale, l’Asie du Sud et l’Extrême-Orient par Moscou, du XVe au XIXe siècle ; en Afrique subsaharienne par Alexandrie, au XXe siècle. Avec la circulation des populations inaugurée par les grandes Découvertes, la mission s’est accompagnée d’importants transferts migratoires, pour motifs économiques ou politiques, qui ont permis son implantation croissante dans des univers nouveaux, dont les Amériques, l’Océanie et l’Europe de l’Ouest.
Ce n’est pourtant pas en raison de sa diffusion planétaire que l’orthodoxie dit être l’« Église catholique » que proclame le Credo de Nicée-Constantinople, la confession de foi prototypique élaborée au IVe siècle dont elle se considère la légataire. Elle ne comprend pas la catholicité au sens second d’universalité concrète mais, selon la signification première, telle qu’exprimée chez les Pères à la suite d’Aristote, d’unité suffisante et de totale plénitude parce que parfaitement récapitulative : est « catholique » toute Église locale instituée dans la succession apostolique, la vérité de l’enseignement et la grâce du sacrement qui communie avec les autres Églises locales pareillement instituées dont elle est ontologiquement l’égale en tant que dispensatrice du salut.
Pour autant, l’Église orthodoxe n’est pas la somme additionnée de ces Églises mais leur unité intrinsèque en tant qu’unique « corps du Christ », étant entendu que le concile, ainsi que tout exercice de concertation synodale qui lui est attaché, ne crée pas mais manifeste cette unité. Aussi, si l’Église orthodoxe connaît à divers degrés, national ou régional, linguistique ou culturel, des formes d’organisation collective sous l’égide d’un primat, aucun pouvoir extraordinaire, de type magistériel, n’est accordé à la dite primauté qui demeure la présidence d’un pair parmi ses pairs au service de l’amour mutuel.
L’orthodoxie n’en reste pas moins consciente que la primauté suprême revient à Constantinople, « la nouvelle Rome », en conséquence de la séparation d’avec « l’ancienne Rome », titulaire jusque-là de cette diaconie. Elle attribue la cause de ce deuxième grand schisme au christianisme occidental, arguant que la Chrétienté médiévale et la Réforme moderne représentent le caractère biface d’une même tentation séculariste à laquelle sont exposées, selon elle, l’Église catholique romaine et les Églises protestantes. C’est pourquoi elle considère que le dialogue œcuménique, qui vise l’unité des chrétiens, doit se fonder sur un retour commun et critique à la tradition dont elle juge être le conservatoire et le véhicule. Ce qui lui crée, du même coup, une obligation au témoignage et à la recherche de l’unité.
La notion orthodoxe de tradition échappe à la querelle occidentale entre la Bible et la doctrine en ce qu’elle postule qu’au lieu d’opposer les deux, il faut les concevoir comme un tout organique, articulant ensemble révélation et inspiration. Ainsi, inamovible, la tradition s’avère mobile puisqu’elle ne vaut que comme transmission créatrice et tension dynamique. Une telle conception refuse d’un même mouvement la répétition et l’innovation au profit de la réinvention et ce, non pas au sens d’imaginer l’inexistant mais de redécouvrir le connu dans l’inconnu. Elle engage également que la conscience collective supplante l’arbitraire individuel. Exigeante, elle ne va pas cependant sans heurter, en interne, les dérives zélotes ou chauvines qui travestissent l’orthodoxie soit en une logique positiviste, soit en un tribalisme folklorique, et qui caractérisent sa propre inclination au siècle.
C’est donc au sens métaphorique d’une provenance originelle et d’une vocation mystique, non pas d’une position cartographique, que l’orthodoxie se présente comme l’« Église d’Orient » et, au sens performatif, d’une orthodoxie expérientielle qui dépasse les frontières de l’orthodoxie visible, dont elle n’est pas propriétaire, qu’elle se déclare l’«Église du Christ sur Terre». En bonne théologie, une telle définition entraîne une vocation attestataire et médiatrice qui refuse par principe toute cristallisation fondamentaliste. En mauvaise pratique, ce n’est évidemment pas le cas, d’autant plus lorsque dominent, dans l’inconscient, l’hypermnésie des affrontements historiques et l’amnésie des arrangements politiques.
Ruptures et isolements
L’orthodoxie offre une conception de l’histoire ecclésiastique surprenante, voire dérangeante, tant elle conteste directement ou indirectement celle généralement admise. Mais un tel écart critique rend d’autant plus nécessaire qu’on l’examine pour elle-même. Cette vision souligne à la fois combien le christianisme est d’abord une religion orientale, combien son essor s’inscrit dans le cadre impérial de l’Œcumène et combien sa trajectoire historique reste suspendue au martyre. Ce sont là encore des traits originels. Toutefois, le modèle de la communauté primitive, l’intégrité du dépôt apostolique, l’épreuve de la persécution déterminent à ses yeux non seulement la fondation et la formation initiale, mais aussi la formalisation pérenne de l’Église.
La structuration même de l’Empire romain en un vaste réseau de communication intégrant une rare diversité sous la férule d’une religion civile centralisée a plutôt permis la diffusion rapide de l’Évangileque son endiguement. Avec la conversion personnelle de Constantin et la proclamation de l’édit de tolérance de Milan, en 313, puis l’octroi du statut de religion officielle par Théodose en 380, l’adhésion confessionnelle de l’Empire à l’Église et la conformation administrative de l’Église à l’Empire iront de pair. Cette entente atteindra son acmé sous Justinien, au VIe siècle, et Sainte-Sophie, le temple de la sagesse divine à Constantinople, deviendra le centre du monde, dès lors dessiné en cercles concentriques à mesure de sa christianisation.
Pour l’heure, devenu impérial, le christianisme n’en reste pas moins déconcentré et à dominante orientale, ainsi que le montre le système de la pentarchie, des cinq centres de fondation apostolique et à vocation politique : Rome, forte de son prestige de capitale et de son cosmopolitisme, garde l’exercice d’une primauté entre égaux, mais le déplacement du pouvoir politique à Constantinople, à la confluence de l’Europe et du Levant, l’ouverture d’Alexandrie sur l’Afrique et d’Antioche sur l’Asie, la promotion de Jérusalem en lieu de pèlerinage renouvellent et renforcent ce caractère originel. C’est en Orient qu’apparaissent les grandes écoles d’exégèse et de catéchèse, que naît le monachismeen réaction au risque d’un affadissement de la foi, que se développe le culte de l’icône et que se tiennent les conciles œcuméniques. Ainsi se dessine la première civilisation chrétienne, d’essence orientale, tandis que, dès le Ve siècle, l’empire va enregistrer non seulement le départ de chrétientés dissidentes dans son foreland d’Orient, mais aussi l’effondrement sous les invasions barbares de son hinterland d’Occident.
Les sacs de Rome de 410, 455 et 546 annoncent une division appelée à se creuser. La perte de l’Illyrie, de la plateforme d’échange que forment alors les Balkans, isole l’Est de l’Ouest où l’unité politique et l’unité religieuse connaissent un croisement de courbes entre les sphères spirituelle et temporelle : l’éclatement en une multitude de royaumes mal assurés conforte le rôle centralisateur de la papauté qui érige le latin en langue commune pour pallier le chaos politique et culturel. Le pouvoir juridictionnel et disciplinaire du siège romain, et plus généralement de l’épiscopat, grandit, tandis que le monachisme, constitué en différents ordres, remplit une fonction de bâtisseur et d’éducateur tout en endossant les nouvelles formes de piété dérivées des coutumes des arrivants. Alors que l’Orient va s’attacher à la survivance de la romanité impériale se dessinent au cœur de l’Europe continentale les prémices de l’Empire carolingien. Une forme neuve de civilisation émerge, qui servira de matrice à ce que l’on nommera l’Occident chrétien.
Le premier différend est cependant doctrinal car, dès la fin de l’Antiquité, les visions de la personne, de la grâce et de la communion distinguent théologiens grecs et latins. Ces derniers s’inscrivent dans l’héritage d’Augustin, autorité majeure pour une culture en reconstruction qui a vécu l’effacement de l’héritage classique et de la langue grecque. Auteur certainement génial mais à l’œuvre aussi monumentale que personnelle, ses opinions sont dissonantes par rapport à l’ensemble polyphonique que forment les Pères de l’Église, à commencer par son anthropologie pessimiste qui déroge à l’optimisme ontologique auquel a conclu l’hellénisme chrétien.
Condition mortelle ou péché originel, baptême régénérateur ou purificateur, sacerdoce marié ou célibataire, pain levé ou pain azyme : les querelles se multiplient jusqu’à toucher l’essentiel. Là où les Grecs affirment le Dieu-Trinité, les Latins privilégient le Dieu-essence. Là où les Grecs exaltent le Saint-Esprit, les Latins magnifient le Christ-Roi. C’est la querelle du Filioque : pour les premiers, la transformation par les seconds de la formule du symbole de foi selon laquelle « l’Esprit procède du Père » en « du Père et du Fils » conduit à un effacement de la liberté spirituelle et, donc, au juridisme et moralisme – dispute longtemps vivace dont Dostoïevski se fera l’écho dans sa « Légende du Grand Inquisiteur ».
Advient un éloignement entre les deux conceptions dont la querelle des images, aux VIIIe-IXe siècles, est significative. Pour les défenseurs orientaux de l’orthodoxie, en invoquant l’interdiction biblique de représenter Dieu les iconoclastes nient l’Incarnation : le Verbe indescriptible s’étant fait homme, il peut être décrit dans la chair qu’il a fait sienne et la déification de cette chair, sens même du salut, rend sa représentation source de grâce. L’icône est donc, en ce sens, réelle présence, qui ne saurait pourtant être confondue avec le prototype auquel elle renvoie, objet non pas de latreia (« adoration ») mais deproskinesis (« vénération »). Ce qu’entérine le septième concile œcuménique tenu à Nicée en 787 mais qui ne sera pas reçu à Aix-la-Chapelle où, concernant l’image sainte, l’idée d’une « théologie en couleur » est réduite à l’expédient d’un catéchisme pour illettrés.
La dispute atteint son acmé au IXe siècle, lorsque le siège romain rallie le monde franc, « latino-barbare» ou « romano-germain », dans lequel le monde grec, « romano-oriental », perçoit désormais un dissident religieux et un rival politique. Dans les faits, l’Europe occidentale entre dans son propre Moyen Âge, se préparant à passer de la Romanitas à la Christianitas, du roman au gothique, de la patristique à la scolastique et de la symphonie des deux pouvoirs à la querelle entre les papes et les empereurs. Le conflit ouvert sur le Filioque qui oppose le patriarche Photios de Constantinople aux Carolingiens en est un épisode douloureux et à l’historiographie longtemps falsifiée, ce qui ajoutera à la discorde : il revient désormais aux orthodoxes, comble pour eux de l’inversion, d’avoir à faire la preuve de leur orthodoxie au fur et à mesure de l’inflation des traités latins sur les «erreurs des Grecs».
C’est de là que commence aussi la fabrication, sous couvert savant, de l’objet à haute fonction polémique intitulé « Byzance ». Elle charriera son lot d’inventions caricaturales promises à une étonnante longévité dont la combinaison inégalée de cruauté politique, d’immoralité ecclésiastique et d’abrutissement dévotionnel au seul bénéfice d’oiseuses conversations sur les anges et leur sexe à quoi aurait confiné le prétendu «césaropapisme» – alors que le mot et l’accusation seront forgés au XVIIIe siècle par le protestant Boehmer, mais à l’encontre précisément de l’idée romaine de « souveraineté pontificale ». Elle se soldera surtout par une réécriture de l’histoire marginalisant ou excluant la romanité orientale, au point qu’aujourd’hui encore, dans les études sur la pensée médiévale, s’il est reconnu qu’il existe, à côté de la philosophie latine, une philosophie juive et une philosophie arabo-musulmane, la philosophie byzantine reste une inconnue bien qu’elle soit pile au carrefour des précédentes.
Au même moment où la dispute théologique bat son plein, les missionnaires des deux bords auprès des Slaves se heurtent frontalement dans la zone balkanique et se livrent à rude compétition pour gagner le nord et l’est du continent. Point essentiel, cependant, l’évangélisation « franque » se fait en latin et s’organise selon un modèle unique en vertu du schéma d’unité qui suppose le rattachement au siège romain, là où la « byzantine » est menée en langue vernaculaire et se décline en une multiplicité d’approches condensant en un tout peuple et Église, langue et foi. Ce qui ne sera pas sans incidence sur les constitutions politiques respectives de ces deux univers désormais antagoniques à l’ère moderne.
S’ensuit une ligne de fracture dont on voit encore les effets de nos jours, recoupant la frontière invisible qui court de la Baltique à l’Adriatique et qui sépare sur une base confessionnelle les Polonais des Biélorusses, les Tchèques des Slovaques, les Croates des Serbes, tout en coupant l’Ukraine en son milieu. Deux Europe en procèdent, l’une convaincue que l’axe Athènes-Jérusalem- Rome aboutit à Aix-la-Chapelle puis à Bruxelles, l’autre certaine que ce même axe conduit à Constantinople, puis à Moscou – disjonction dont le Vieux Continent n’est manifestement pas sorti.
L’affaire du Filioque paraît s’être heureusement achevée sur l’ultime concile à teneur œcuménique de 879-880 où l’a emporté, contre les Carolingiens, le souci de conciliation commun au pape Jean VII et au patriarche Photius. Il s’agit cependant d’un faux-semblant car l’événement reste sans suite, laissant libre cours à la dérive des continents doctrinaux. C’est qu’en Occident la réforme grégorienne va donner lieu, à partir du XIe siècle, à une rationalisation accrue de la recherche théologique ouvrant à la scolastique tandis qu’en Orient, entre les IVe et VIIIe siècles, a mûri une synthèse entre la spiritualité et le dogme, entre l’expérience des Pères du désert et la prédication des Pères de l’Église, qui promeut la déification de l’homme par grâce. Sur ce fondement, Byzance va amplifier sa phénoménologie du Saint-Esprit dont le déploiement sera assuré par le mouvement monastique dit hésychaste (d’hesychia, « silence, paix, oraison »), pour lequel il n’est de théologie que mystique. En professant la vision de Dieu et la participation réelle à la vie divine des ici-bas comme le but de la vie chrétienne, et donc de tous les baptisés, l’hésychasme, loin de s’en tenir à une marge élitiste, va infuser la piété populaire.
La conséquence en est une conception de bout en bout charismatique de l’Église, que ramasse la formule « seul celui qui a la prière est théologien ». La figure du contemplatif l’emporte sur celles de l’empereur et du patriarche. Martyrs en un temps sans persécution, prophètes du second avènement du Christ et de son retour en gloire en une ère d’institutionnalisation, les moines maintiennent comme norme le maximalisme évangélique. Ce sont eux qui, lors de chaque crise majeure, se confrontent aux pouvoirs religieux comme politique et les somment de s’inscrire dans la perspective eschatologique du Jugement dernier. Ce sont eux aussi qui, par la diffusion normative de leurs cycles liturgiques et de leurs pratiques ascétiques, confirment qu’il n’est de ministère et de peuple que de Dieu. Et eux encore qui, de la sorte, consacrent l’idée selon laquelle l’orthodoxie se décide ultimement dans sa capacité à sacrifier les intérêts du monde à la vérité de la foi.
La théologie de la déification est définitivement explicitée et canonisée comme doctrine pérenne de l’Église au XIVe siècle tandis que l’empire entre en agonie. Son maître mot est la communion, des trois personnes divines de la Trinité à une même nature, des natures divine et humaine en la personne une du Fils incarné, des myriades de personnes humaines à l’unique vie divine. Le réalisme mystique de la divinisation de l’homme et le réalisme sacramentel de la sanctification de la matière coïncident ainsi dans une vision théocentrique du Cosmos et de l’Histoire, christocentrique de l’anthropologie. Or cette affirmation dogmatique procède du double rejet, conscient et volontaire, des courants scolastique ethumaniste qui font alors leur apparition à Byzance et que les hésychastes assimilent à une même tentation de naturaliser l’Évangile. Ce nouveau front théologique est d’autant plus coûteux politiquement qu’il nuit au soutien déjà relatif de l’Occident et qu’il isole Constantinople face à un islam toujours plus offensif.
Entre-temps, le propre esprit de conquête des Latins, autrement scandaleux pour les Grecs car perçu comme fratricide, aura scellé le divorce. Plus encore que les excommunications réciproques prononcées en 1054, date de pure convenance, par le patriarche œcuménique Michel Cérulaire et le légat pontifical Humbert de Moyenmoutier, le sac de Constantinople par les croisés en 1204 l’aura précipité. L’échec du concile d’union à Lyon, en 1272, l’aura officialisé. Celui de Florence, en 1439, le scelle. La chute de la nouvelle Rome, qui tombe aux mains des Turcs en 1453, le consomme. C’est la fin de l’Église impériale mais aussi le début de « Byzance après Byzance », que symbolise l’érection, en coin des remparts de la ville, à la veille du dernier combat, de l’église du Saint-Sauveur dont les mosaïques célèbrent le Christ comme « Terre des Vivants ».
Deux constantes découlent de cette assomption, sur un mode apocalyptique, de la défaite en victoire. D’une part, l’empire, en tant que figure de communauté politique, demeurera prégnant dans l’imaginaire des peuples orthodoxes au point d’être régulièrement réactivé chez les Slaves, qu’ils soient bulgares, serbes, russes, ou d’engendrer des reconfigurations idéologiques, à l’instar de l’utopie panarabe chez les Levantins. D’autre part, le parti monastique assurera la survie de l’orthodoxie en propageant l’hésychasme comme forme de communion symbolique et en suscitant, à partir du mont Athos, une sorte de «Commonwealth spirituel» dont l’espace, reconsolidé à intervalles réguliers, s’étendra de la Méditerranée orientale à la mer du Nord, en passant par les Balkans. Autrement dit, la tension entre les royaumes et le Royaume se perpétuera.
Dans l’immédiat, les manifestations hostiles et les prétentions hégémoniques du monde franc face à un monde byzantin englouti sous le monde ottoman connaissent pour traduction le principe « plutôt le turban du sultan que la tiare du pape ». Certainement tragique, le conflit parallèle avec l’islam s’est néanmoins doublé de transferts culturels au bénéfice des mondes arabe puis turc. Le poids démographique, institutionnel et culturel des chrétiens orientaux aux débuts de l’Empire ottoman facilite la coexistence civile. Le système du millet, de la communauté ethnique administrée religieusement, ne déroge pas à la dureté de la dhimmitude, mais permet à Constantinople d’exercer sa fonction, bien qu’entravée, de patriarcat œcuménique – non sans risques de confusions toutefois puisque la Valachie, par exemple, gardera un souvenir exécrable des phanariotes, ces membres de l’aristocratie grecque d’Istanbul à qui la Sublime Porte déléguera l’administration de certains territoires majoritairement chrétiens.
L’orthodoxie se trouve, de fait, placée entièrement ou presque sous la domination de l’islam. Grâce aux missions entamées par Cyrille et Méthode, elle se déploie dans cet autre Orient qu’est le monde slave, et le baptême de la Rus’ médiévale, en 988, conduit à l’érection, en 1589, par la seconde Rome, d’un patriarcat à Moscou, venant juste de se libérer du joug tatar et musulman. Déchirée entre Réforme et Contre-Réforme, l’Europe occidentale va néanmoins se montrer uniment hostile à cette nouvelle réalité politique qui constitue alors, et pour longtemps, le seul pays et le seul peuple indépendant de confession orthodoxe. Ce qui ne manquera pas d’inspirer à la Moscovie, au fur et à mesure de sa montée en puissance, la pensée qu’elle pourrait bien être la « troisième Rome » et dupliquer ainsi, en interne, la tension originelle.
Captivités et résistances
Au cours des Temps modernes, l’orthodoxie se voit réduite à survivre. Elle subit la sujétion constante de l’islam et doit faire face à l’emprise renouvelée de l’Occident. Dans l’Empire ottoman, outre l’oppression ordinaire appliquée aux minoritaires et la forclusion dans l’espace communautaire, elle se voit interdite d’expression, tandis qu’il lui faut affronter les prosélytismes catholique et protestant, dotés de moyens disproportionnés de persuasion. Les puissances européennes accordent leur protection aux chrétiens d’Orient à la condition qu’ils rallient leur confession, laquelle leur est devenue, sous l’effet des guerres de Religion, un attribut national.
« Fille aînée de l’Église » et puissance méditerranéenne, la France est à la manœuvre pour le compte de Rome, qui favorise, en l’absence d’une possible union globale, une stratégie d’intégrations parcellaires. Dites « unies » ou, péjorativement, « uniates », les communautés ainsi détachées au profit de la papauté dans la suite des croisades, principalement à la faveur des « échelles du Levant » au XVIIIe siècle, puis du « printemps des missions » au XIXe siècle, subissent le plus souvent, outre une forte européanisation de leurs mœurs, une notable latinisation de leurs ministères et de leurs rites, tandis qu’elles doivent coexister avec les entités de culte proprement romain qui sont érigées en parallèle. Le même dispositif sera appliqué aux anciennes chrétientés des confins, en Abyssinie et au Kerala, où l’union aura pour vecteur le Portugal.
La Réforme n’est toutefois pas en reste. Des « missions » anglicanes dès la fin du XVIIIe siècle, luthériennes, calvinistes puis évangéliques au cours des XIXe et XXe siècles, sont impulsées par les nations et les empires du nord ou du centre de l’Europe, avant d’être finalement supplantées par leurs ramifications et extensions du Nouveau Monde. Elles préemptent à leur tour des pans significatifs de l’orthodoxie dont, un pas plus avant que Rome, elles n’entendent pas annexer le caractère oriental mais qu’elles occidentalisent en totalité. Ce faisant, le Levant devient le seul espace géographique à récapituler l’ensemble des confessions chrétiennes apparues en vingt siècles d’histoire, ce qui ajoute à son caractère de mosaïque mais aussi de poudrière.
Ces vagues de captation, accomplies au nom d’une politique paradoxale de « conversion » qui s’adresse aux chrétiens et élude les musulmans, sont perçues, sur place, par les Églises orientales et par l’Église orthodoxe, comme une prédation spirituelle qui s’ajoute à un contentieux déjà lourd. Tout d’abord, l’octroi d’avantages politiques, éducatifs ou caritatifs qui appuie ces soustractions souligne la solitude et l’impuissance dans lesquelles les maintient l’Empire ottoman. Ensuite, l’arsenal polémique mobilisé à leur encontre par les Européens afin de les discréditer, par ailleurs organisé et entretenu par la Sublime Porte, accuse leur défaut d’armature intellectuelle et de stabilité institutionnelle. Enfin, l’apparition de tels relais d’influence étrangère les expose à la persécution puisqu’elles en sont considérées comme seules responsables et justiciables par le sultan. De fait, certains des Orientaux se rallient, ce qui ne fait qu’accroître leur état de division, mais aussi de dépendance, tout en aggravant leur réputation d’« agents » de l’Occident.
Or, dans l’est de l’Europe, l’union prend le visage de la guerre. C’est par la force militaire et la coercition administrative que les populations de rite byzantin qui sont limitrophes des deux grands ensembles issus de l’évangélisation médiévale sont rattachées aux puissances occidentales. Tel est le sort, en Galicie ou dans les Carpates, des Ukrainiens et des Ruthènes qui, placés sous la mainmise de la confédération polono-lituanienne ou de l’Empire austro-hongrois, ont l’obligation de devenir « gréco-catholiques ». La crispation identitaire des premiers, sur fond de nationalisme grandissant, sera renforcée par leur ré agrégation, tout aussi contrainte, lors des avancées ultérieures de la Russie impériale et de l’Union soviétique. À l’inverse de leurs homologues du Proche-Orient, les Églises «clones» qui sortiront de ce second démembrement manifesteront non pas une nostalgie mais plutôt une aversion envers l’orthodoxie, compliquant ainsi les relations entre les deux Europe.
Pour donner un aperçu de la complexité qui en résulte, on peut regrouper en cinq groupes les différentes Églises qui se sont établies sur la période courant du début du XVe siècle à la fin du XIXe siècle :
Les Églises unies à Rome et issues des Églises orientales
- L’Église chaldéenne, érigée en 1533, rétablie en 1830, siégeant en Iraq, majoritaire par rapport au tronc orthodoxe, l’Église assyrienne, comme c’est aussi le cas pour la branche indienne de cette tradition, l’Église catholique syro-malabare, érigée en 1599 et siégeant au Kerala.
- L’Église arménienne catholique, érigée en 1740 au sein de la diaspora, siégeant au Liban, minoritaire relativement au tronc apostolique (ou orthodoxe).
- L’Église syriaque catholique, érigée en 1656, confirmée en 1783, siégeant au Liban, minoritaire relativement au tronc orthodoxe.
- L’Église copte catholique, érigée en 1895, siégeant en Égypte, très minoritaire relativement au tronc orthodoxe.
Les Églises unies à Rome et issues de l’Église orthodoxe
- L’Église grecque-catholique melkite, érigée en 1724, siégeant en Syrie, réunissant sous un même patriarcat d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem, les fidèles de langue arabe et de rite byzantin, minoritaire bien que significative relativement au tronc orthodoxe.
- L’Église grecque-catholique ukrainienne, érigée en 1595, siégeant en Ukraine, dominante dans l’ouest du pays, minoritaire en soi et très minoritaire dans le reste du pays relativement au tronc orthodoxe.
- L’Église grecque-catholique ruthène, érigée en 1646, siégeant en Ukraine, résiduelle relativement au tronc orthodoxe dans le pays, réunissant un nombre plus significatif de fidèles aux États-Unis.
Les Églises unies à Rome et représentant des cas d’exception, hors les diocèses de rite latin présents de manière sporadique en Orient
- L’Église maronite, érigée en 1182, confirmée en 1584, issue d’un clan syriaque et monothélite (forme amoindrie du monophysisme), allié de Byzance et réfugié dans la montagne libanaise aux VIIe-VIIIe siècle sous l’avancée de l’islam, siégeant au Liban et sans pendant orthodoxe.
- Le patriarcat latin de Jérusalem, érigé en 1099, rétabli en 1847 (au contraire de son homologue le patriarcat latin de Constantinople, érigé en 1204, éteint en 1314), siégeant en Israël, réunissant les fidèles palestiniens de langue arabe et de rite romain, disposant d’une hiérarchie historiquement à dominante italienne et sans effet sur la garde des Lieux saints dévolue à la Custodie franciscaine.
Les Églises protestantes issues de populations ressortant des Églises orientales ou de l’Église orthodoxe, dont ces trois exemples significatifs tirés d’une liste sinon foisonnante de micro communautés
- L’Église évangélique arménienne, érigée à Constantinople/Istanbul en 1846 sous l’impulsion des missions luthériennes allemandes, reconnue comme millet par l’Empire ottoman en 1850 et membre fondateur de l’Union des Églises évangéliques arméniennes du Proche-Orient qui couvre une région allant de Chypre à l’Iran.
- Le Diocèse épiscopalien de Jérusalem, détaché en 1866 de l’évêché protestant de Terre sainte, lui-même érigé en 1841 conjointement par l’Église d’Angleterre et l’Union prussienne des Églises réformées, de langue arabe et ayant juridiction sur tous les fidèles anglicans du Levant.
- Le Synode du Nil, fondé en 1898 sous l’impulsion des missions de l’Union presbytérienne d’Amérique du Nord et devenue indépendante en 1958 sous l’intitulé d’Église évangélique copte, siégeant en Égypte.
Dès la fin du XVe siècle, le durcissement des schismes entre l’Orient et l’Occident puis, au sein même de l’Occident, entre Rome et la Réforme, ouvre l’ère des confessionnalismes. Les professions de foi exclusives que formulent catholiques et protestants prennent valeur de modèle pour les orthodoxes qui se trouvent à rendre compte de leur doctrine dans des langages et selon des raisonnements qui ne sont pas les leurs. Bannie de l’espace public, privée de moyens d’expression, confinée au seul culte, l’orthodoxie se replie sur le sanctuaire invisible que forment ses monastères et ses liturgies, redoublant ainsi son attachement à la signification eschatologique du christianisme.
La destinée de Cyrille Loukaris illustre au mieux cette période difficile. Né en Crète en 1572 et désireux d’entrer dans les ordres, il lui faut partir à Padoue, en Italie, pour assurer son éducation théologique, qu’il mènera du coup en latin et sur un mode scolastique. Présent en tant que jeune prélat au concile de Brest- Litovsk en 1596, alors que la Biélorussie est sous domination polonaise, il doit constater le passage d’une partie de l’épiscopat orthodoxe à Rome, prélude à l’érection de l’Église gréco-catholique d’expression slavonne. Élu patriarche d’Alexandrie en 1602 puis patriarche de Constantinople en 1620, il lui faut regagner par quatre fois, sur moins de deux décennies, le trône œcuménique dont il est régulièrement destitué par le Grand Vizir, chaque élection emportant le paiement d’une taxe et venant enrichir le Trésor. Soucieux de contrer la mainmise de la France, qui lui est hostile, par celle de l’Angleterre, en quête d’influence, Cyrille publie à Genève, en 1629, une confession de foi à tonalité calviniste qui lui vaut l’inimitié des Jésuites mais aussi des moines athonites. Arrêté en 1638 sous l’accusation d’avoir comploté avec la Russie, il est étranglé par un janissaire avant que son cadavre ne soit jeté dans le Bosphore. Pour être personnel, ce destin balançant entre humiliation et résistance, qui n’évite pas la dérive mais aboutit au martyre, récapitule le sort de l’orthodoxie à l’âge moderne.
Précisément dans l’Empire russe, l’accord des pouvoirs hérité de Byzance tourne au désaccord grandissant. L’Église elle-même semble chavirer. Soucieux de réformer la pratique religieuse en la conformant aux usages grecs, critère à ses yeux d’orthodoxie, le patriarche Nikon déclenche le schisme des vieux- croyants qui prend l’allure d’une guerre civile. Convaincu de son rôle politique éminent, il s’impose comme quasi-régent avant d’être déposé en 1666. Jugeant que le siège patriarcal de Moscou est trop puissant, trop indépendant, mais surtout qu’il représente un obstacle à sa politique d’européanisation, le tsar Pierre le Grand décide en 1721 de sa suppression. Il lui substitue un Saint- Synode présidé par un ministre laïc sur le modèle qui est alors de mise dans les pays germaniques et scandinaves de confession protestante.
L’Église se trouve ainsi inféodée à l’État dans sa part institutionnelle. Mais, tandis que l’épiscopat continue de dénoncer à intervalles réguliers ce détournement canonique, le monachisme renouvelle son alliance avec le peuple, exalté de surcroît en « peuple christophore parce que souffrant ». Sera ainsi entretenu en Russie, jusqu’à la veille de 1917, un esprit de résilience qui, comme au Levant, privilégiera l’axe contemplatif et ascétique, favorisant une forme de civilisation commune que l’on peut qualifier d’espace « agro- monastique » rythmé temporellement par le cycle liturgique.
Dans ses deux Orients, levantin et slave, l’âge qui suit la Renaissance se présente donc pour l’orthodoxie comme une ère de captivité. Son retrait de l’Histoire la met entre parenthèses de la modernité et de ses considérations anthropologiques dont les conciles constantinopolitains du XIVe siècle ont par ailleurs et par avance refusé les principes. Ligotée et bâillonnée, l’orthodoxie se montre néanmoins active par le biais de missions extérieures et intérieures qui sont autant d’entreprises de consolidation en des circonstances hostiles.
Dans le courant du XVIIe siècle, Dosithée, le patriarche grec de Jérusalem, réarme la vie intellectuelle en fondant un centre d’imprimerie en Moldavie afin de contrer la prohibition des publications chrétiennes au sein de l’Empire ottoman. Ayant réaffirmé la théologie de la déification lors du synode général de Bethléem en 1672, il lance un vaste mouvement d’hellénisation de l’orthodoxie slave, en visant particulièrement la Russie afin de suppléer aux dérives que cause l’abolition du patriarcat. À la fin du XVIIIe siècle, le mouvement hésychaste connaît un important renouveau qui, parti là encore dumont Athos, va s’étendre à tout le périmètre tracé au IXe siècle et solidifié au XIVe siècle. Le néo-hésychasme gagne vite le monde orthodoxe dans son entier, d’Alexandrie à Moscou, avec la diffusion de la Philocalie, une anthologie des Pères que le moine Nicodème de la Sainte-Montagne publie à Venise en 1782 et qu’il a conçue comme une contre-encyclopédie de la lumière divine à l’âge des lumières de la raison humaine. Cette collection animera l’élan religieux de la pensée et de la littérature russe jusqu’en 1917.
Ce réveil répond à une nouvelle angoisse survivaliste. Que valent, en effet, les cultures traditionnelles face à l’impératif de modernisation politique, sociale et technique qu’entraîne l’envol, depuis l’Occident, des temps nouveaux ? La question traverse chaque vieux monde. C’est à Moscou, toutefois, qu’elle prend un tour philosophique qui, deux siècles plus tard, lui fait garder toute son acuité. La polémique oppose les occidentalistes, pour qui la Russie doit éradiquer son passé afin d’intégrer l’Europe avancée, et les slavophiles, pour qui les Russes doivent approfondir leur héritage afin d’aider l’Europe à surmonter l’écueil nihiliste auquel aboutira, affirment-ils, son progressisme. Le statut accordé à l’orthodoxie distribue les camps : tissu de fables et de superstitions pour les premiers, qui y voient un facteur d’aliénation, elle est ferment de vitalité pour les seconds, qui la conçoivent comme un levier d’émancipation.
Meilleurs connaisseurs de la civilisation européenne que leurs adversaires, les slavophiles s’efforcent d’échapper à l’ornière de la révolution et de la réaction. Ils esquissent une politique tirée de l’orthodoxie qui reposerait sur le mystère des peuples en tant que figures collectives de l’histoire du salut et qu’animerait l’idéal de la sobornost, terme tiré de l’ecclésiologie, signifiant à la fois « communion » et « conciliarité ». Leur tentative d’une troisième voie va cependant donner lieu à un résultat contradictoire : d’une part, s’ensuit une renaissance théologique articulée à la recherche scientifique qui, prônant une lecture créatrice de la tradition chrétienne, déterminera le concile orthodoxe de Moscou en 1917, lequel préfigurera, dans l’esprit et la démarche, le concile catholique de Vatican II à l’orée des années 1960 ; d’autre part, se produit une absorption par l’idéologie impériale qui, construisant de son côté un État autoritaire et une diplomatie offensive, réserve à l’Église orthodoxe le rôle subalterne d’apporter une justification religieuse à son projet politique.
Or force est de noter qu’hier comme aujourd’hui la doctrine russe des relations extérieures repose sur un même trépied : l’établissement de zones tampons aux frontières du pays pour assurer l’imperméabilité de son espace sinon trop vaste à garantir ; le déverrouillage des détroits entre l’Europe et l’Asie pour assurer l’accès aux mers chaudes ; l’immixtion dans l’arc double reliant les Balkans au Caucase et les Balkans au Levant avec une position préservée en Méditerranée orientale pour conforter un double statut de puissance asiatique et européenne. Si l’Église conduit un véritable effort d’évangélisation auprès des peuples que l’empire englobe au fur et à mesure de sa progression, les mondes orthodoxes, premier trait d’union entre ces différents cercles, servent la logique d’expansion à l’œuvre.
Du sauvetage des Géorgiens contre les Perses à l’appui aux Serbes contre les Autrichiens ou de la fondation d’une mission ecclésiastique et savante à Jérusalem au repeuplement monastique de la République de l’Athos, la confection des cartes militaires le dispute à la diffusion des Livres saints. Avec, pour acmé, le projet de rebaptiser Constantinople libérée en Tsargrad, de la restaurer capitale de l’empire enfin parachevé, de rendre Sainte-Sophie à la liturgie dans laquelle les émissaires de Vladimir de Kiev, au XIe siècle, avaient vu « le Ciel descendre sur la Terre ». Et ce bien que l’Église ne cesse de dénier à l’État la moindre légitimité à se concevoir comme une Rome recommencée qui, troisième en rang, se rêverait de surcroît ultime.
Les deux premières guerres de Crimée, péninsule à la fois clé et verrou indispensable à la sortie russe de la Russie, illustrent inversement les succès et revers de cette vision qui s’avère autant théopolitique que géopolitique. En reprenant au calife d’Istanbul et à ses alliés tatars la domination sur l’ancien territoire et diocèse byzantin de Chersonèse, Saint-Pétersbourg s’impose, avec le traité de Kutchuk-Kaïnardji, en 1774, comme le protecteur des chrétiens orthodoxes au sein de l’Empire ottoman. Ce titre lui est toutefois contesté par Paris qui, de son côté, se présente en rempart des chrétiens catholiques. La tension monte jusqu’au mitan du XIXe siècle, le conflit éclatant en Terre sainte, comme au temps des croisades. Des rixes répétées entre moines grecs et latins à Bethléem, à la Nativité, et à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, servent de prétexte à la mobilisation militaire des deux puissances rivales.
L’Empire britannique, soucieux de pouvoir sanctuariser ses routes commerciales, et l’Empire austro-hongrois, désireux de pouvoir mater les insurrections slaves, volent au secours de l’Empire ottoman, épouvanté de ne pas réussir à enrayer sa décomposition ethnico-religieuse. Ils convainquent l’orgueilleux Empire français d’assumer sa prétention à représenter l’Église romaine et universelle en stoppant net l’éternel outsider qu’est l’Empire russe – incidemment, le conflit profitera in fine à la Confédération germanique, qui se veut l’héritière du Saint-Empire éponyme.
Dès avant le début des hostilités, la deuxième affaire de Crimée s’apparente des deux côtés à un conflit sacré, ravivant les blessures religieuses du passé. Mgr Sibour, l’archevêque de Paris, bénit les troupes napoléoniennes, les exhortant à extirper le « schisme photien », tandis qu’à Saint-Pétersbourg son homologue, le métropolite Nikanor, harangue l’armée tsariste, lui demandant d’en finir avec le « schisme filioquiste ». Or, et sans doute faut-il le souligner tant les mesures de temps différent d’une culture à l’autre, cette guerre conçue comme sainte ou s’en approchant a eu lieu il y a de cela un siècle et demi, soit une éternité pour la mentalité occidentale, mais une minute et des poussières dans l’imaginaire oriental.
Cependant, cet imaginaire lui-même implose, toujours au cours du XIXe siècle et par-delà la poussée conquérante de l’Empire russe, sous la décomposition intrinsèque de l’Empire ottoman. Les maux qui frappent « le vieil homme malade » affectent également le monde orthodoxe qui lui est soumis en majeure partie. L’essor politique des indépendances nationales afin de se libérer de la domination islamique, tel qu’il est encadré par les puissances européennes, va contrecarrer le renouveau théologique des courants réformistes qui sont enclins, de leur côté, à s’émanciper de l’emprise occidentale pour mieux réaffirmer leur orientalité. À son tour, l’orthodoxie entre dans une relation conflictuelle avec le mouvement de sécularisation qu’implique la modernité, mais à sa façon, contradictoire, ayant à solutionner la nouvelle équation entre le spirituel et le temporel, requalifiés en Église et État, dans des termes qui ne sont pas génétiquement les siens. Nonobstant les terribles épreuves qu’elle endurera au XXe siècle, cette irrésolution explique l’aporie sur laquelle elle butera à l’orée du XXIe siècle.

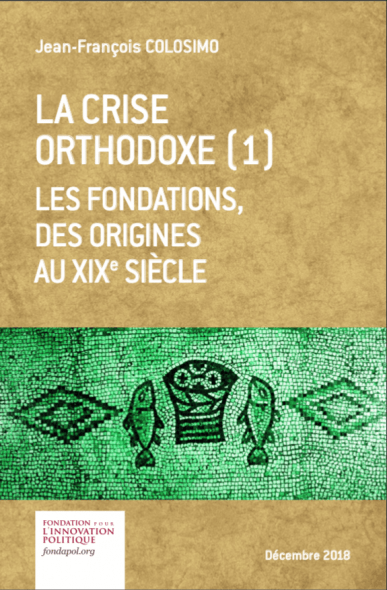











Aucun commentaire.