La crise orthodoxe (2) les convulsions, du XIXème siècle à nos jours
L’affrontement entre les patriarcats de Constantinople et de Moscou oppose deux visions de l’orthodoxie deux conceptions théologiques du christianisme.Désagrégations et persécutions
L’église et les églises
Constantinople et Moscou
Le concile et la déchirure
Le schisme et la prophétie
Résumé
À l’automne 2018, la crise que traverse l’orthodoxie depuis les Temps Modernes trouve pour image ultime, sous l’œil des caméras, l’implosion de l’Église orthodoxe en des Églises orthodoxes. Cette diffraction vient néanmoins de loin. Elle a pour source, au XIXe siècle, l’essor politique des indépendances nationales, encadré par les puissances européennes, qui vient contredire le renouveau théologique des courants réformateurs enclins à s’émanciper de l’emprise occidentale. Elle se creuse au XXe siècle en raison de l’ère de captivité recommencée et abyssale que causent le communisme puis l’islamisme. Elle se nourrit, après 1991, de l’étau géopolitique qui enserre les deux Orients chrétiens que forment l’Est et le Levant.
C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre en quoi l’affrontement entre les patriarcats de Constantinople et de Moscou oppose non seulement deux visions de l’orthodoxie mais aussi deux conceptions théologiques du christianisme, de son rapport au monde, à l’histoire et au fait politique.
Publiée simultanément, la première partie de la présente note s’intitule La crise orthodoxe (1) Les fondations, des origines au XIXe siècle et en éclaire les traits constitutifs.
Jean-François Colosimo,
Philosophe, théologien, président de l’Institut orthodoxe de Paris et directeur des éditions du Cerf.
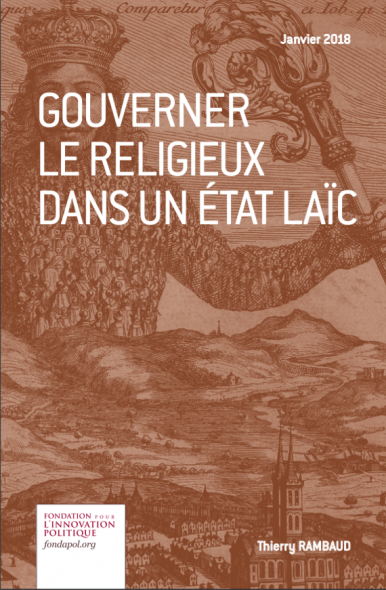
Gouverner le religieux dans un État laïc

La religion dans les affaires : la finance islamique

La religion dans les affaires : la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise)
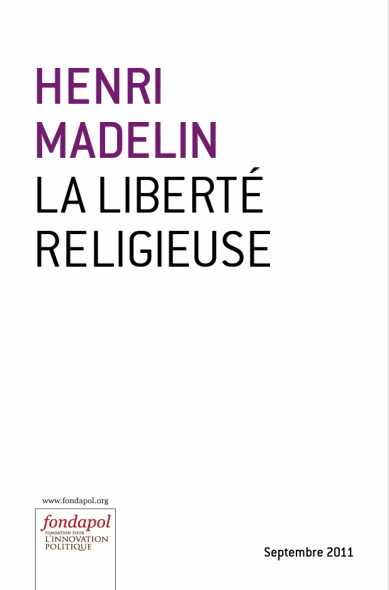
La liberté religieuse

Où va la politique de l’Église catholique ? D’une querelle du libéralisme à l’autre
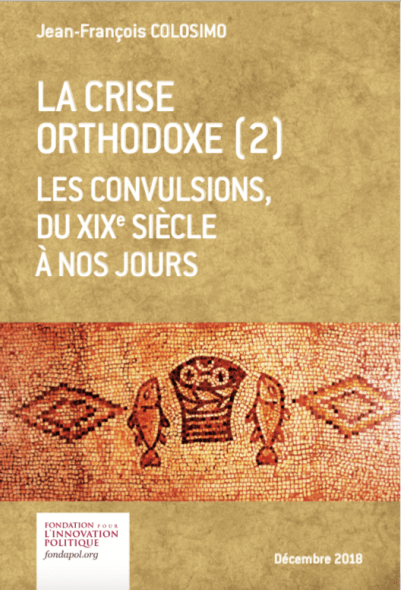
La crise orthodoxe (2) les convulsions, du XIXème siècle à nos jours
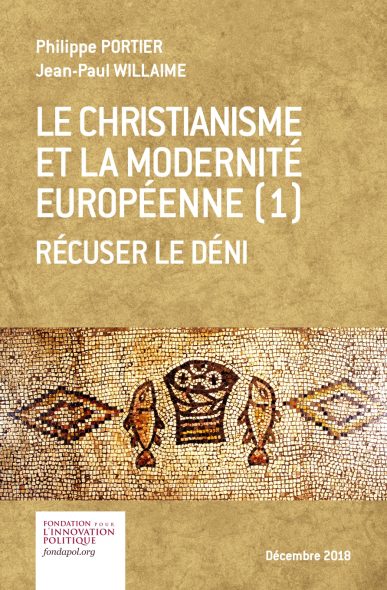
Le christianisme et la modernité européenne (1) récuser le déni
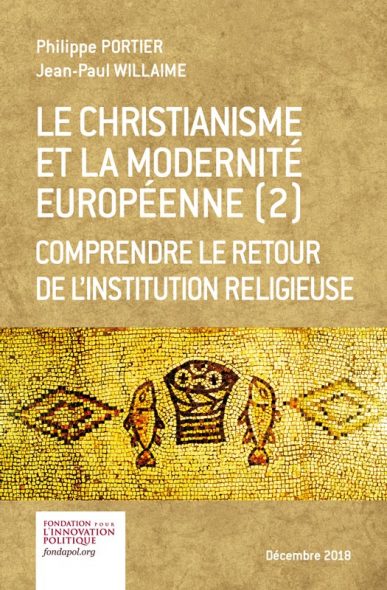
Le christianisme et la modernité européenne (2) comprendre le retour de l'institution religieuse
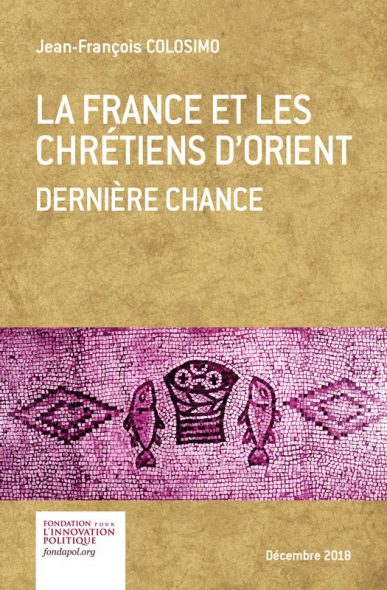
La France et les chrétiens d'Orient dernière chance
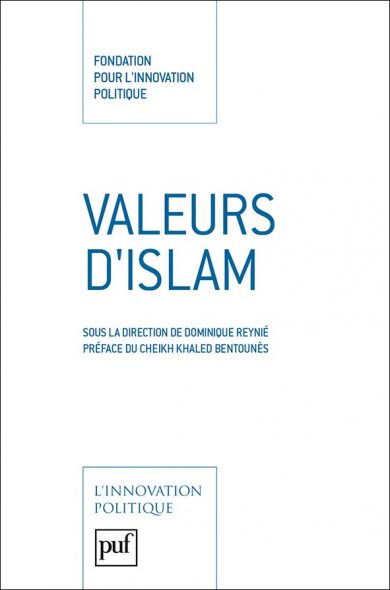
Valeurs d'islam
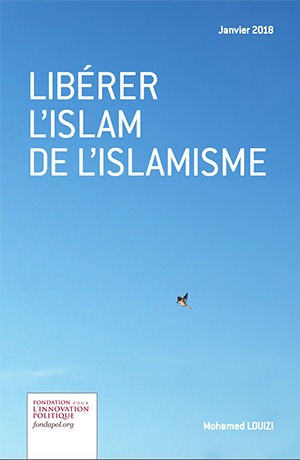
Libérer l'islam de l'islamisme

Portrait des musulmans d’Europe : unité dans la diversité

Portrait des musulmans de France : une communauté plurielle
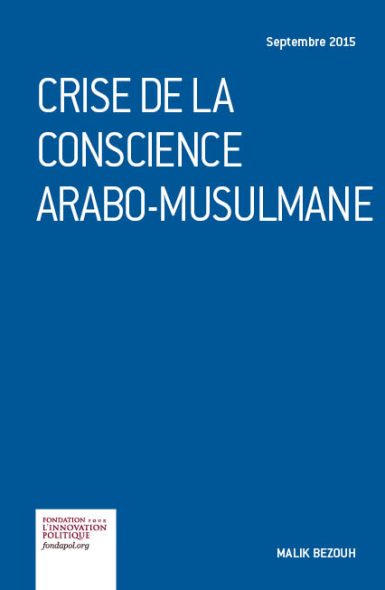
Crise de la conscience arabo-musulmane
Désagrégations et persécutions
Loin de son glorieux passé antique et médiéval, réduite à la captivité en Orient comme à l’Est depuis les Temps modernes, soumise à la domination ottomane et à la férule tsariste de manière inégale mais convergente, l’orthodoxie a développé une logique de résistance théologique qui n’a pas tari, pour autant, son aspiration à la liberté politique. La tectonique des plaques s’appliquant aux empires, au mitan du XIXe siècle elle connaît un premier retour sur la scène de l’histoire. Ce regain est d’essence moderne car il s’inscrit dans les idées du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, empruntées aux Lumières, et des révolutions d’indépendance, nourries par le romantisme. Il se révélera d’autant plus calamiteux que la greffe est exogène et s’applique à un terreau incompatible. C’est toute la leçon des guerres balkaniques où l’appareil ecclésiastique va jouer un rôle déterminant puisque, sans lui, il ne saurait y avoir d’identité collective. Il en a assuré la constitution et composé le code. Il en a permis la préservation dans les pires difficultés. Il lui revient donc d’en assumer la régénération. Mais comment et à quel prix, alors que l’avancée de la révolution est pensée comme un retour à la tradition ?
À partir de 1821 et à l’instar des Grecs auxquels une Antiquité mythifiée vaut les faveurs d’une Europe déjà en mal de genèse, les peuples de culture orthodoxe doivent adopter le modèle occidental issu du traité de Westphalie, lequel unifie nation et confession. Or s’affranchir de l’Empire ottoman, dont les grandes puissances œuvrent à la dislocation, signifie se séparer du patriarcat œcuménique qui y demeure enclavé, quitte à l’entraîner à son tour dans la désagrégation générale. Ainsi la translation de communautés de destins multiples relevant de cadres impériaux, innés ou contraints, dans le format unique et indivisible de l’État-nation va produire à la fois une hybridation du monde orthodoxe et une diffraction de l’Église orthodoxe.
D’une part, le condensé byzantin entre peuple, langue et foi, tel que sédimenté par le système du millet turc, ne peut que se durcir en nationalisme politico-religieux – caractère que les régimes communistes ou post communistes de l’Est reprendront à leur avantage chaque fois qu’il faudra combler le vide idéologique, par exemple dans la Roumanie de Ceaușescu en 1965 ou dans la Yougoslavie de Milošević en 1990. D’autre part, un peuple libre devant se doter d’un État indépendant, il ne peut que s’attribuer une Église également indépendante dès lors que le fait national et le fait ecclésial sont en lui indissociables – mutation du principe cujus regio, ejus religio (« à chaque région sa religion ») en cujus populo, ejus religio (« à chaque peuple sa religion »), laquelle forcera, par exemple, Othon de Bavière à se convertir à l’orthodoxie dès son installation, en 1833, sur le trône d’un royaume d’Hellade que lui auront confectionné sur mesure les puissances européennes, préoccupées de contrôler leurs récents dominions.
Mêlant reconstruction identitaire, reconquête politique et redistribution confessionnelle, les pays nouveaux qui vont se déclarer orthodoxes et que vont former, sur un siècle, la Grèce, puis la Bulgarie, la Serbie et la Roumanie s’inspirent de la Constitution adoptée par les nations nordiques à la suite de la Réforme. Ainsi, leur mode artificiel de sécularisation ne peut que nuire à leur développement, frappé des chizoïdie, mais par-dessus tout porter atteinte à la catholicité de l’Église telle que la conçoit l’orthodoxie. Qui plus est, dans l’impossibilité de véritablement coïncider avec le modèle, ils garderont chacun la «grande idée» d’une reconstitution impériale qui éclaire beaucoup de leurs errances diplomatiques et de leurs déboires militaires lors de conflits où la représentation l’emportera souvent sur la réalité et qui, à l’occasion, iront jusqu’à les faire se confronter.
L’orthodoxie de foi reste-t-elle silencieuse devant cette mutation qui correspond à une occidentalisation bâtarde des mondes qu’elle a suscités ? Les quatre patriarches détenteurs des sièges apostoliques, à savoir Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, livrent en 1872 une encyclique qui condamne prophétiquement la confusion entre la politique et la religion, la nation et la confession, l’État et l’Église comme l’«hérésie moderne par excellence». Pour autant, ils se départagent de toute notion de juridiction universelle qui serait fondée en droit divin puisque, sommés par Rome de se prononcer sur l’infaillibilité pontificale proclamée par le concile de Vatican I en 1870, ils répondent par une nouvelle lettre encyclique, décrétée en 1876, laquelle stipule que « seul le peuple de Dieu est le dépositaire de la vérité de l’Église ».
Le Peuple ou les peuples ? Le patriarcat de Constantinople ne peut arrêter le mouvement des nouvelles auto céphalies, c’est-à-dire l’érection d’Églises autogouvernées ayant à leur tête un primat dont la juridiction s’exerce sur un territoire politiquement, linguistiquement et culturellement défini, lequel territoire pouvant être supranational mais ne correspondant pas moins à une prédominance nationale –ainsi du patriarcat serbe de Belgrade à l’égard de la Yougoslavie. Le trône œcuménique finira par entériner, le plus souvent avec retard, la multiplication de ces Églises autocéphales afin de préserver son statut d’« Église mère », entendu comme centre canonique d’unité et historique de mission, mais l’exercice de sa primauté en deviendra conjoncturel.
La fragmentation de l’orthodoxie se produit dans les mondes slave et balkanique principalement sur un mode étatique, tandis qu’au Levant la volonté d’indépendance se traduit par une concentration ethnique : à l’instigation de Moscou, qui y voit un gain d’influence, le patriarcat d’Antioche, en 1899, démet sa hiérarchie grecque traditionnellement issue du Phanar et s’inscrit résolument dans la Nahda, le programme de renaissance politique et culturelle de l’arabité, dont il devient l’un des fers de lance – l’orthodoxe Michel Aflak sera ultérieurement le fondateur de l’idéologie baasiste, de même que l’orthodoxe Georges Habache, l’animateur du front du refus palestinien, leur ralliement sui generis au socialisme permettant à l’Union soviétique de perpétuer la diplomatie orientale de l’empire tsariste.
Inéluctablement, les relations entre le Trône œcuménique et la Russie, dans son double versant séculier et religieux, s’aggravent. Que ce soit le panslavisme ou le panarabisme, sans oublier le pan-eurasisme, les grands tableaux géopolitiques que dessine l’empire s’établissent contre la «pan-orthodoxie» de l’Église. La situation calamiteuse de cette dernière, en 1.900, est celle d’une politisation soudaine et incontrôlée, porteuse de graves déperditions quant à sa faculté de témoigner de l’« unique nécessaire ». Le XXe siècle écartera ce risque potentiel en faisant de l’ensemble que forment les christianismes orientaux une réalité continûment martyre.
C’est une litanie du désastre dont il faudrait égrener chaque tuerie, chaque charnier, chaque exode. Elle se joue d’abord dans le sanctuaire géographique que représente l’Asie Mineure et qui tourne au laboratoire totalitaire : sur les ruines de l’Empire ottoman, le nationalisme turc, jacobin et laïcisant, cause le premier génocide moderne, qui frappe les Arméniens en 1915 (1.600.000 victimes), et la première purification ethnique moderne, qui touche les Grecs en 1923, lors de l’échange des populations prescrit par le traité de Lausanne (1.500.000 déportés). Par la suite, les uns et les autres seront soumis à un lent mais sûr processus d’extinction dans leur berceau historique, à grand renfort de pogroms et de discriminations dont le tournant définitif consistera dans l’invasion et l’occupation de Chypre par les troupes d’Ankara en 1974. À territoire égal, celui de la Turquie actuelle, comptant pour environ 35% de la population en 1890, les chrétiens ne représentent plus que 0,5% un siècle plus tard, en 1990.
D’autres nationalismes causent un égal reflux au Levant. L’organisation diasporique des Grecs en Méditerranée, vieille de deux millénaires et demi, pâtit pareillement des socialismes arabes qui les jugent indésirables en tant qu’« étrangers » sur des territoires le plus souvent arbitrairement redessinés, mais aussi imaginairement ethnicisés, et les force à l’exil : l’Iraq et la Syrie suivent ainsi peu ou prou l’exemple donné par l’Égypte nassérienne en 1957 lors de l’affaire de Suez. En dépit du projet panarabe dont ils sont les coauteurs, sous la pression de régimes tyranniques et claniques qui les maintiennent dans une citoyenneté de second ordre et les instrumentalisent à des fins de propagande et de diplomatie, les orthodoxes et chrétiens orientaux autochtones suivent le même chemin du départ avec, pour point de non-retour, la guerre du Liban qui éclate en 1975.
En Europe continentale, la virulence nationaliste réveille les mémoires blessées et les cristallise. Dans les Balkans, à partir de 1941, la dictature oustachie, croate et pronazie opère des massacres de masse : aux côtés des Juifs et des Tsiganes voués à la destruction, on estime que plus de 300.000 Serbes ont alors été éliminés pour avoir refusé de se convertir au catholicisme. L’oblitération de ce drame par le régime titiste sera lourde de conséquences lors de la dissolution de la Yougoslavie et des affrontements ethniques et religieux qui s’ensuivront à partir de 1990.
Ces tragédies, pourtant déjà abyssales, trouvent leur accomplissement vertigineux dans le programme d’éradiquer l’orthodoxie que le parti bolchevik met en œuvre dès son accession au pouvoir. Au début de l’année 1917, profitant de la Révolution de février, l’Église russe réunit un concile à tonalité réformiste qui restaure le patriarcat tout en faisant profession d’apolitisme. De surcroît, son action pacificatrice et caritative, adressée à tous les camps en présence et concentrée sur le peuple en déréliction, sera notable tout au long de la guerre civile. Néanmoins, sous le premier communisme soviétique et au regard de son plan d’implantation à marche forcée de l’athéisme, entre 1917 et 1941, ce sont 600 évêques, 40.000 prêtres, 120.000 moines et moniales qui disparaissent dans les camps et 75.000 lieux de culte qui sont rasés. Entre ces deux dates, l’Église orthodoxe russe aura donné plus de martyrs que toutes les Églises chrétiennes réunies au cours de deux millénaires.
En 1941, l’orthodoxie semble défunte au pays des soviets, mais l’invasion allemande fait que Staline, la sortant de l’enfer où il l’a plongée, s’engage à restaurer le patriarcat et à desserrer l’étau en échange du soutien public des quelques hiérarques restants à la «Grande Guerre patriotique». Le troc n’engage pas cependant le « pacte amoral » que dénonceront certains critiques libéraux depuis leurs confortables abris puisque, sous Khrouchtchev, afin de contre balancer le rapprochement contesté avec l’Ouest, une seconde vague de persécution massive suivra dès les années 1960. C’est ainsi que l’Église de Russie aura expérimenté, entre 1917 et 1991, ce qu’aucune autre Église de l’Est n’aura vécu entre 1945 et 1989, à savoir un effacement constant sur trois générations, ne laissant subsister qu’un trou noir – l’assassinat par le KGB du juif converti qu’était le père Alexandre Men, maquillé en crime antisémite, ne viendra clore ce cycle qu’à l’automne 1990.
La mainmise de Staline sur l’Est européen à la sortie de la Seconde Guerre mondiale conduit les « pays frères » de culture orthodoxe à reproduire la politique religieuse du Kremlin qui alterne destruction et instrumentalisation. Le premier cas est illustré par la Bulgarie, où l’athéisme d’État revêt force de programme, avec éliminations, déportations et vandalismes sans limite à la clé. Le second s’incarne en Roumanie où, après une période d’ordalie, l’Église nationale est sommée de collaborer à l’édification du « socialisme à visage humain ». Partout règne cependant une répression constante de l’institution comme des fidèles, l’Albanie se distinguant par l’anéantissement de tous les cultes, politique qu’elle poursuivra de 1967 à 1990.
Cette entreprise d’élimination s’est entre-temps vérifiée, sur tous les continents, dans les autres pays de tradition ou de mission orthodoxe passés au communisme, qu’il s’agisse de l’antique Église d’Abyssinie en Éthiopie ou des récents diocèses fondés en Chine à la fin du XIXe siècle. Lorsqu’en 1988, Mikhaïl Gorbatchev s’adresse au patriarcat de Moscou, anémié après avoir traversé soixante-dix ans d’épreuves fatales sous la coupe inévitable des organes policiers, et lui demande de célébrer le « baptême de la Russie » advenu mille ans plus tôt à Kiev, il prend acte d’une inconcevable résilience. Néanmoins, par- delà les écrasants cas soviétique et, plus largement, communistes, avant même la levée de l’islamisme et des autres fondamentalismes tels que l’hindouisme qui renouvelleront la persécution des chrétiens d’Orient de la Méditerranée à l’océan Indien, force est de constater que l’orthodoxie aura été la seule religion, avec le bouddhisme, qui sera sortie du XXe siècle avec moins de territoires dans l’absolu et moins de populations, au prorata de l’expansion démographique générale, qu’à son entrée.
L’église et les églises
À rebours de l’émancipation espérée, l’orthodoxie a donc subi, sur un siècle, une captivité recommencée encore plus néfaste qu’elle n’avait connu les siècles précédents. C’est sur fond de désagrégation, de dispersion et de destruction qu’elle se voit appelée à répondre de son message dans les suites de 1989, alors que l’ordre mondial pivote, passant de la confrontation entre l’Est et l’Ouest à l’affrontement entre le Nord et le Sud. Sa vocation historique de médiatrice entre l’Orient et l’Occident, cause aussi de nombre de ses malheurs, s’en trouve bousculée alors qu’elle-même peine à remédier à son désordre interne.
À peine l’épreuve communiste a-t-elle cessé, à tout le moins dans ses aspects immédiatement ravageurs, que les chrétientés orientales anciennes, qu’elles s’affirment orthodoxes, qu’elles se déclarent unies à Rome ou qu’elles se rattachent à la Réforme, ont toutes sombré dans la tourmente provoquée par le choc des fondamentalismes, islamiste au Proche-Orient, au Caucase et en Afrique, mais aussi hindouiste en Asie. Pour les plus exposées, la question de leur survie à moyen terme est malheureusement ouverte. C’est par la tragédie de leur probable disparition que les « chrétiens d’Orient » ont finalement acquis une existence géopolitique et médiatique. Dans l’hémisphère Nord, cette reconnaissance ne va pas, sans une captation idéologique de type identitaire, laquelle retarde un peu plus la juste prise en compte de leur indispensable apport à la diversité et à la laïcisation des sociétés auxquelles ils appartiennent, principalement musulmanes.
Quelles évolutions faut-il noter du côté des Églises orientales, dont le terrible sort commun leur fait découvrir l’« œcuménisme du sang versé », selon la formule du pape François, et ce quel que soit leur rattachement confessionnel?
Au Proche-Orient. L’Église assyrienne, également victime de l’entreprise génocidaire des Jeunes-Turcs en 1915, est aujourd’hui résiduelle dans son terreau historique où elle a subi, à partir de 2013, la persécution de Daech : ses centres sont aussi bien aujourd’hui en Californie ou en Île-de-France sous le coup d’un exode massif et elle se trouve morcelée en plusieurs branches antagoniques à la suite de rivalités juridictionnelles. Son homologue et adversaire théologique, l’Église syriaque, qui a connu les mêmes désastres sur les mêmes lieux, manifeste une plus grande unité et vivacité tout en se confrontant à l’égal problème du départ de ses fidèles vers le monde occidental, principalement les États-Unis et l’Allemagne. Elle a opéré en conséquence, sur place, un net rapprochement avec son autre sœur ennemie historique, mais théologiquement plus compatible, l’Église grecque-orthodoxe d’Antioche. En Égypte, l’Église copte, qui constitue la première minorité du monde arabe et compte pour 10% de la population nationale est devenue la cible d’attentats islamistes depuis 1980; elle a perdu son influence intellectuelle, prégnante dans les années 1930, pour s’être modelée sur le communautarisme des Frères musulmans et connaît depuis un mouvement d’exil notable sous la pression d’une ghettoïsation forcée et systématique, mêlant discriminations étatiques, émeutes populaires et meurtres impunis. Les branches unies de l’Orient chrétien ne sont pas moins dans la souffrance. Depuis l’invasion américaine de 2003, l’Église chaldéenne a perdu en Iraq, où elle était dominante, les deux tiers de ses fidèles. Au Liban, l’Église maronite, sortie défaite et amoindrie de la guerre civile, a décroché de sa vocation majoritaire et se trouve désormais divisée entre les factions pro-chiites et pro-sunnites, cet affrontement inter-musulman déterminant désormais l’avenir de la région. Quant à l’Église melkite, de rite byzantin, à cheval sur Damas, Jérusalem, Amman et Le Caire, elle enregistre tous les maux qu’endurent les chrétiens et qui font d’eux, en dépit et sans doute à cause de leur antériorité et créativité dans cet espace de civilisation, des indésirables qu’il faut chasser à défaut de pouvoir toujours les pourchasser.
- Ailleurs. En dépit de la restauration d’une Arménie indépendante en 1991 et des efforts consécutifs d’unification des catholicossats d’Etchmiadzine (Caucase) et de Sis (Proche-Orient), culturellement distincts depuis des lustres et politiquement opposés au cours du XXe siècle, l’Église apostolique arménienne reste profondément disséminée, le métissage des cultures inhérent à la mondialisation affectant désormais son mode de transmission diasporique. Ayant péniblement survécu au programme d’extinction à laquelle l’avait vouée le régime maoïste de Mengistu, l’Église d’Éthiopie s’est scindée à la manière balkanique, l’érection d’une Église d’Érythrée ayant accompagné la création, en 1993, del ’État indépendant éponyme ; toutes deux doivent cependant répondre au même défi de leur encerclement sous la montée de l’islamisme en Afrique de l’Est. Les filiales du christianisme antiochien en Inde, regroupées sous le label générique d’« Églises de saint Thomas » malgré leurs origines, rapports et intrications complexes et qui ont tendance à multiplier les affiliations diverses, sont pour leur part en butte au réveil idéologique de l’hindouité qui les menace de manière grandissante en tant qu’expressions d’une « religion exogène ». Les branches unies traditionnelles, arménienne et copte, partagent le sort de leurs référents, de même que les plus récentes puisque Rome a érigé une Église catholique syro-malankare en 1932, une Église catholique éthiopienne en 1961 et une Église catholique érythréenne en 2015, toutes de statut métropolitain.
- Partout. Les communautés protestantes orientales, bien que souvent très minoritaires, sont soumises à une forte répression en raison du lien supposé de l’évangélisme avec l’influence américaine. C’est le cas particulièrement en Iran ou en Inde.
La catastrophe de civilisation en cours, qui prive le devenir planétaire de relais éprouvés de médiation, n’épargne pas la présence de l’Église orthodoxe en Orient. Les institutions de son ressort, qualifiées communément de « grecques », en sont pareillement tributaires. Tel est le cas du patriarcat orthodoxe de Jérusalem, principal détenteur des Lieux saints, important propriétaire terrien et, à ce titre, otage du conflit israélo-palestinien. Tel est le cas également du patriarcat orthodoxe d’Antioche dont la juridiction s’étend sur la Syrie, le Liban, l’Iraq et le reste du monde arabe mais dont les diocèses d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest concentrent aujourd’hui le plus grand nombre de fidèles. S’il est crucial, ce phénomène de déport géographique mais aussi mental de son centre ancestral de gravité n’est pourtant pas le seul problème de l’orthodoxie à l’échelle universelle – ou, pour employer son propre langage, du « plérôme orthodoxe ».
Le premier état préoccupant de l’Église orthodoxe aujourd’hui est, qu’à l’instar des chrétientés orientales, elle se présente toujours plus au sens commun sous l’allure d’une multiplicité d’Églises orthodoxes. En d’autres termes, sa propre représentation ecclésiologique apparaît en péril, à tout le moins brouillée par-delà les accidents que lui impose l’histoire. Or ce hiatus est aussi de son fait. La diffraction qu’a entraînée le mouvement national des auto céphalies au XIXe siècle non seulement n’a pas trouvé de remède mais s’est encore accentuée au XXe siècle sous le poids du communisme. Elle s’est aggravée au tournant du XXIe siècle, enflant tout au long de la période qui a suivi la chute du mur de Berlin pour arriver à son point ultime aujourd’hui. À aucun moment, à l’âge moderne, l’orthodoxie n’aura connu de mutation heureuse.
Quel tableau peut-on dresser de l’Église orthodoxe à la veille du schisme ?
Le recensement qui suit a pour but d’éclaircir, au moyen de quelques annotations significatives, les raisons fondamentales de la crise actuelle. Sont donc orthodoxes, stricto sensu, parce qu’en communion mutuelle de foi et de sacrement, les Églises suivantes, regroupées en trois grands groupes (« autocéphales », « autonomes», « cas disputés ») :
- Autocépha. Égales, territoriales, auto-administrées et inter-indépendantes, elles élisent souverainement leur primat qui a titre honorifique de patriarche, d’archevêque, de catholicos ou de métropolite au regard de chaque tradition concernée et sans incidence hiérarchique. Ce sont, suivant l’ordre canonique le plus accepté qui est celui du Trône œcuménique et ce, nonobstant la querelle de rang entre Chypre et la Géorgie :
-le patriarcat de Constantinople, réputé de fondation apostolique, érigé en 330, confirmé en 381 et 451, siège à Istanbul, en Turquie, et sonprimat porte le titre d’« archevêque de Constantinople-Nouvelle Rome et de patriarche œcuménique », et il est le dépositaire de l’autorité primatiale sur le « plérôme orthodoxe » depuis le schisme daté par convention de 1054. Réduit par le traité de Lausanne à une institution symbolique, ayant perdu l’essentiel des territoires et des populations au sein de son ressort historique, le Trône œcuménique a su se réinventer en s’agrégeant la totalité de la diaspora grecque sous le patriarche Mélétios IV en 1923, puis en acquérant un rayonnement international sous le patriarche Athénagoras dans les années 1960 et, enfin, en procédant à une approche ouverte de la modernité sous l’actuel patriarche Bartholomée, élu en 1991. Ce précurseur du combat écologique, classé parmi les grandes figures spirituelles, est d’abord un canoniste soucieux d’affirmer la fonction unitaire de l’« Église mère » sur l’ensemble des Églises orthodoxes et il argue à cette fin du caractère libre parce que « crucifié » du siège constantinopolitain, particulièrement à l’égard des prétentions du patriarcat de Moscou.
-le patriarcat d’Alexandrie, réputé de fondation apostolique, entériné en 325 par le premier concile œcuménique, siège à Alexandrie, en Égypte, et son primat porte, selon l’antique tradition, le titre de pape qu’il est seul à partager avec l’évêque de Rome et qui se décline en « pape et patriarche d’Alexandrie et de toute l’Égypte, de Libye, de la Pentapole, d’Éthiopie et de toute l’Afrique ». Voué en principe à disparaître après l’expulsion des Grecs d’Égypte en 1957, écrasé par son puissant voisin copte, le Trône alexandrin a su trouver, sous l’impulsion de fraternités réformistes venues d’Athènes, un fort renouveau dans la mission sur le continent africain ; l’orthodoxie y a l’avantage de proposer un christianisme sans passé colonisateur et à haute consonance symbolique avec les cultures locales. L’épiscopat, d’abord grec, s’est peu à peu ouvert aux autochtones et l’actuel patriarche Théodore II, formé en Grèce et en Russie, précédemment métropolite du Cameroun puis du Zimbabwe, s’est fait le porte-voix de la cause des déshérités dans les enceintes internationales.
-le patriarcat d’Antioche, réputé de fondation apostolique, entériné en 325 par le premier concile œcuménique, siège à Damas, en Syrie, depuis 1388 et son primat porte le titre de «patriarche d’Antioche et de tout l’Orient». Animée par Ignace IV, décédé en 2012, et le métropolite Georges (Khodr) du Mont-Liban, tous deux champions de l’arabité, du dialogue avec l’islam et d’une relation féconde de la modernité, l’Église orthodoxe d’Antioche s’est distinguée, entre autres, en étant la seule confession à ne pas armer de milices durant la guerre du Plus traditionaliste, fondée sur un retour culturel et piétiste à l’hellénisme, la nouvelle hiérarchie, portée par le patriarche Jean IV, qui a été intronisé en 2013, s’est tournée, lors de la guerre de Syrie, vers la Russie, emmenant à sa suite ses homologues antiochiennes, syriaque orthodoxe, mais aussi syriaque-catholique, melkite et maronite, pourtant unies et historiquement liés à la France.
-le patriarcat de Jérusalem, réputé de fondation apostolique, érigé en 451 par le quatrième concile œcuménique, entériné en 531, siège à Jérusalem et son primat porte le titre de «patriarche de la ville sainte de Jérusalem et de toute la Palestine, des terres du Jourdain, de Cana en Galilée et de Sion». Issue de la confrérie du Saint- Sépulcre, dont les membres sont grecs, la hiérarchie hellénique commise à la garde des Lieux saints exerce cependant sa juridiction pastorale sur des fidèles arabes, palestiniens ou jordaniens, ce qui créée un état de tension permanent compliquant la situation générale de conflit dans laquelle le siège de Jérusalem est plongé depuis 1967. En 2005, le patriarche Irénée a été ainsi démis par un synode réuni à Constantinople pour avoir frauduleusement cédé des terrains à une organisation sioniste. Le pontificat de son successeur, Théodore III, est depuis marqué par le puissant retour de la Mission russe qui s’appuie sur le million de migrants venus de l’ex-URSS et sur la volonté que manifeste le Kremlin de se rapprocher de l’État hébreu.
-le patriarcat de Moscou, proclamé en 1488, érigé par Constantinople en 1589, aboli en 1721 par les autorités tsaristes, restauré et reconnu en 1917, siège à Moscou et son primat porte le titre d’« archimandrite de la laure de la Trinité-Saint-Serge, patriarche de Moscou et de toutes les Russies ». Seule organisation de l’ancien régime, avec le KGB, ayant subsisté dans l’après-communisme, vouée à combler le vide spirituel suscité par l’expérience totalitaire, elle a entamé, sous le pontificat d’Alexis II, élu en 1990, un vaste mouvement de ré évangélisation qui s’est traduit par des milliers de baptêmes collectifs et des centaines d’églises restaurées. Le fait qu’elle soit la seule institution à encore couvrir l’ancien territoire de l’Union soviétique (Russie, Biélorussie, Ukraine, Kazakhstan, républiques d’Asie centrale, Pays baltes) tout en disposant d’importantes ramifications internationales sur plusieurs continents, lui a valu les faveurs, jusque-là mitigées, du Kremlin après l’accession de Vladimir Poutine au pouvoir, en Le rôle identitaire et diplomatique que ce dernier veut lui prêter est alors endossé par le métropolite Cyrille de Smolensk, en charge du puissant département des relations extérieures de l’Église moscovite depuis 1989. Il réussit un temps à réorganiser à son avantage les hiérarchies des anciens « pays frères » et à rallier, en 2007, l’essentiel des dissidences orthodoxes russes et anticommunistes qui ont fleuri en exil. Élu patriarche en 2009, à la suite du décès d’Alexis, Cyrille conforme depuis l’Église en organe patriotique collaborant avec l’État, à la fois instance de moralisation intérieure et levier d’action internationale, propice aux mouvements conservateurs et hostile aux évolutions de mœurs, moteur de l’unité des «mondes russes». Arguant de la supériorité numérique, matérielle et politique du patriarcat de Moscou, il revendique également une emprise sur l’entière orthodoxie, concurrençant directement ou indirectement l’autorité de Constantinople.
-le patriarcat de Serbie, érigé par Constantinople en 1220, refondé de manière intermittente entre les XVe et XVIIIe siècles, proclamé en 1879, reconnu par Constantinople en 1920, siège à Belgrade et son titulaire porte le titre d’« archevêque de Peć, métropolite de Belgrade et de Karlovci et patriarche serbe ». Éprouvé par le titisme, puis par la solidarité trop inconditionnelle qu’il a cru devoir manifester à l’égard du peuple serbe lors des guerres d’ex-Yougoslavie entre 1990 et 2000, le patriarcat doit faire face aujourd’hui à la perte du Kosovo, où il maintient sa présence plus que difficilement dans les seuls monastères historiques, à la sécession du Monténégro, agité par des velléités d’autonomie ecclésiastique, et à l’indépendance de la Macédoine, où s’est déclarée, en 1967, une Église nationale et autocéphale qui, depuis 1991, avec l’appui des autorités gouvernementales, lui bloque tout accès à un territoire canoniquement de son ressort. En Serbie même, il lui faut relever le défi d’une société qui, sur le modèle européen de l’Ouest, est entrée en voie de sécularisation rapide.
-le patriarcat de Roumanie, proclamé en 1872 et reconnu par Constantinople en 1885, siège à Bucarest et son primat porte le titre d’« archevêque de Bucarest, métropolite de Hungaro-Valachie et patriarche de toute la Roumanie ». Ayant profité de l’effondrement des Empires centraux pour se former, l’Église de Roumanie a su également traverser la période Forte de sa mixité culturelle, entre slavité et latinité, de son nombre, qui la classe deuxième après l’Église russe, de la qualité de son corps monastique, de son réseau théologique et de son activisme pastoral, elle reste néanmoins marquée par le traumatisme que lui a causé l’expérience totalitaire. Moderniste par certains aspects, traditionaliste par d’autres, elle s’impose, non sans risques de rigidité et d’exclusion, comme le repère et le véhicule de la nation, à rebours de l’instabilité politique régnante. Formé en Occident, d’excellente culture, attendu comme une figure rénovatrice de l’orthodoxie, l’actuel patriarche Daniel, élu en 2007, s’est ainsi concentré, pour l’heure, sur le projet d’édifier la plus grande cathédrale d’Europe en lieu et place du palais de l’Humanité imaginé par Ceausescu. Dans le même temps, une forte émigration force à la croissance soutenue et dynamique de nouveaux diocèses dans les pays d’accueil. Aussi les tendances au repli que manifeste parfois l’Église de Roumanie n’en ressortent que plus regrettables eu égard au rôle pivot que pourrait jouer Bucarest au sein de l’orthodoxie.
-le patriarcat de Bulgarie, préfiguré en 870, fondé en 927, érigé de manière intermittente entre les XIIe et XVIIIe siècles, proclamé en 1870, reconnu en 1945, siège à Sofia et son primat porte le titre de « métropolitede Sofia et patriarche de toute la Bulgarie ». Remarquable par son ancienneté et sa contribution majeure à l’éclosion de l’orthodoxie slave, l’Église de Bulgarie n’est plus que l’ombre d’elle- même. Épuisée par sa traversée quasi létale du communisme, elle n’a pas retrouvé sa place au sein d’une société parmi les plus violemment déchristianisées au XXe siècle et qui peine elle-même à se remettre. Satellisée par Moscou après 1945, elle a eu à endurer l’interminable pontificat de Maxime, patriarche de 1971 à 2012 et acquis à une politique de soumission et de résignation dont ne l’a pas sortie l’élection de Néophyte, acquis au statuquo, en 2013.
-le patriarcat de Géorgie, réputé érigé par Antioche en 486, aboli par les autorités tsaristes en 1811, restauré et reconnu par Constantinople en 1917, entériné par Moscou en 1943, réaffirmé par Constantinople en 1990, siège à Tbilissi et son primat porte le titre ancien de « catholicos, archevêque de Mtskheta-Tbilissi, métropolite d’Abkhazie et de Pitsunda et patriarche de toute la Géorgie ». Titulaire du siège depuis 1977, le catholicos Élie II est le dernier primat de l’orthodoxie à avoir été élu sous la période soviétique. Prenant la tête des manifestations pour l’indépendance en 1988, tenant de la paix civile lors des périodes d’instabilité institutionnelle, tâchant de s’interposer lors du conflit militaire de 2008 avec la Russie, il a néanmoins toujours veillé à garder de bonnes relations avec le Kremlin et le patriarcat de Moscou, dont il suit la ligne ultraconservatrice dans le domaine de la vie publique. Par ailleurs, si l’Église de Géorgie peut s’enorgueillir d’une véritable renaissance monastique, elle se veut le fer de lance orthodoxe contre l’œcuménisme, accusant par-là sa pénurie théologique et son isolement culturel.
-l’Église de Chypre, érigée en 431 par le concile d’Éphèse, reconnue par Constantinople en 478, siège à Nicosie et son primat porte le titre d’« archevêque de la Nouvelle Justiniana et de toute l’île de Chypre ». Illustrée un temps, entre 1959 et 1977, par l’ethnarque Makarios, archevêque et président de l’île, ancien militant indépendantiste et figure éminente des non-alignés, la hiérarchie chypriote s’emploie à gérer la partition de son ressort canonique consécutive à l’invasion turque de Membre de la famille hellénique, proche de la Grèce par la langue et la culture, de Constantinople par la conception de l’orthodoxie, l’Église de Chypre a pour elle, en dépit de sa taille modeste, de fournir en clercs et missionnaires de qualité les anciens patriarcats.
-l’Église de Grèce, proclamée en 1833, reconnue par Constantinople en 1850, siège à Athènes et son primat porte le titre d’« archevêque d’Athènes et de toute l’Hellade ». Vecteur de l’identité du peuple grec, cette Église n’exerce pas toutefois sa juridiction canonique sur l’ensemble du territoire national mais dans les limites frontalières antérieures aux guerres balkaniques de 1912-1913 ; les « nouvelles terres » du Nord, la Crète, le Dodécanèse et le mont Athos restent sous Constantinople tout en étant, dans les faits, administrés par elle. En raison de son rôle dans l’indépendance, elle a tous les attributs d’une religion d’État, reconnue « dominante », dont une relative exemption fiscale, le financement du culte, du clergé et de l’enseignement scolaire religieux par l’argent public et l’équivalence juridique des registres ecclésiastiques et civils. Ces privilèges font l’objet d’une lente dissociation sous les sommations de Bruxelles tandis que, depuis les débuts de la crise qui frappe le pays, l’Église a regagné la ferveur populaire en assumant une solidarité caritative maximale sur ses propres deniers. Le primat actuel, Jérôme, élu en 2008 par les quatre-vingts évêques formant le synode, demeure ainsi l’interlocuteur indispensable de tous les Premiers ministres, Alexandre Tsipras inclus dont la politique de séparation affichée comme volontariste confine dans les faits au compromis historique résigné et camouflé.
-l’Église de Pologne, érigée et reconnue par Constantinople en 1927, entérinée par Moscou en 1948, réaffirmée par Constantinople en 1990, siège à Varsovie et son primat porte le titre de « métropolite de Varsovie et de toute la Pologne ». S’adressant aux populations orthodoxes excentrées, biélorusses, ukrainiennes ou subcarpatiques, du territoire national, cette Église est de fait marginalisée par la prédominance catholique en Pologne où elle est suspectée, de surcroît, d’être inféodée à l’éternel ennemi que représente Moscou. Bien qu’elle constitue la deuxième confession du pays, sa reconnaissance et son rayonnement demeurent limités ; cette situation d’empêchement ne pourra être levée que par le successeur du métropolite Sabbas, né en 1938 et régulièrement accusé dans la presse d’avoir été un agent soviétique. La qualité de l’enseignement théologique orthodoxe en Pologne est cependant indéniable et représente le meilleur atout pour un avenir plus serein et épanoui.
-l’Église d’Albanie, proclamée en 1922, reconnue par Constantinople en 1937, entérinée par Moscou en 1945, abolie par les autorités communistes en 1967, restaurée et réaffirmée par Constantinople en 1991, siège à Tirana et son primat porte le titre d’« archevêque de Tirana et de toute l’Albanie ». Littéralement anéantie à partir de 1967 par le régime d’Enver Hodja, ne disposant plus que de vingt-deux prêtres clandestins en 1990, l’Église d’Albanie renaît de ses cendres sous l’impulsion du patriarche Bartholomée de Constantinople, qui lui a donné pour primat, en 1992, Anastase (Yannoulatos), théologien éminent, figure internationale du dialogue œcuménique et inter religieux ainsi que de la mission en Afrique. S’étant dotée en deux décennies de tous les attributs d’une Église de plein exercice, l’orthodoxie albanaise se caractérise également par son fort engagement humanitaire.
-l’Église des pays tchèque et slovaque, proclamée et entérinée par Moscou en 1951, reconnue par Constantinople en 1998, siège à Prague et son primat porte le titre d’«archevêque de Prešov, métropolite des pays tchèques et de Slovaquie». Prise à partie lors de la séparation, en 1993 entre Prague et Bratislava, cette Église, qui a longtemps subsisté dans l’orbe de la chrétienté kiévienne, présente surtout en Slovaquie et dans les régions limitrophes, a su maintenir son unité canonique. En 2013, la succession de l’archevêque Christophe, consécutivement à sa destitution, a néanmoins donné lieu à une prise de pouvoir autoritaire par l’actuel primat, Rastislav, contre le locum tenens en titre Siméon, opération que Moscou a soutenue et que Constantinople a condamnée, cette Église minime en nombre mais historiquement symbolique ayant cristallisé l’affrontement entre les deux pôles concurrents qui, outre leurs rivalités de pouvoir, configurent deux visions de l’orthodoxie.
- Autono Libres de leur vie interne dans les limites du droit canonique, ces Églises dépendent néanmoins de l’Église autocéphale qui est à leur origine et qui authentifie leur primat, lequel participe à son synode. En pratique, cette liberté de principe connaît cependant divers degrés selon que le statut attribué est d’autonomie plénière, d’auto- administration ou de rattachement. De surcroît, certains cas atypiques, ressortant de privilèges hérités de l’histoire, s’apparentent à cette catégorie :
- singularités : l’archevêché du mont Sinaï, constitué du monastère de Sainte-Catherine (sous Jérusalem), qui témoigne courageusement du christianisme dans un contexte islamiste ; la république monastique du mont Athos (sous Constantinople), qui, bénéficiant d’un important renouveau depuis 1968, tend à incarner une conception inflexible de la tradition ; l’exarchat monastique de Patmos, l’île de l’Apocalypse(sous Constantinople).
- sous Constantinople : l’Église de Crète, les métropoles des terres nouvelles et du Dodécanèse, les archidiocèses grecs de Grande- Bretagne, d’Amérique, d’Australie, l’Église de Finlande, l’Église de Corée, les archidiocèses ruthène, ukrainien et carpatique des États-Unis et du Canada (complexifiant la question de Kiev), l’exarchat russe d’Europe occidentale (tenant plutôt du doyenné), l’exarchat des Philippines.
- sous Antioche : l’archevêché antiochien d’Amérique du Nord.
- sous Moscou : l’Église d’Ukraine, l’Église de Biélorussie (rapprochée du statut d’exarchat), l’Église de Lettonie, l’Église du Japon, l’Église synodale russe siégeant aux États-Unis (dissidente, intransigeante etisolée de 1920 à 2007, date de son ralliement).
- sous Belgrade : l’archevêché d’Ohrid, érigé pour contrer le schisme macédonien.
- Cas disputés. Il s’agit des entités ecclésiales qui ont été déclarées ou se sont déclarées Églises autocéphales mais ne bénéficient que d’une reconnaissance partielle ou inexistante de la part des quatorze Églises en communion plénière tandis que des Églises déclarées autonomes par des Églises autocéphales sont contestées par d’autres :
- en termes d’autocéphalie : l’Église de Macédoine, auto-érigée en 1967, condamnée comme schisme par le patriarcat de Belgrade et unanimement rejetée depuis ; l’Église orthodoxe d’Amérique, érigée par Moscou en1970 au titre de la mission menée en Alaska au XVIIIe siècle et à partir de la Metropolia (entité rassemblant aux États-Unis des diocèses de l’émigration russe ainsi que carpatique, ces derniers anciennement unis à Rome étant revenus à l’orthodoxie au bénéfice de leur exil), rejetée comme non avenue par Constantinople et diminuée de facto en statut par Moscou et l’intégration en 2007 de son adversaire historique, la très traditionaliste Église synodale russe siégeant à New York ; le patriarcat de Kiev, auto-érigé en 1991, unanimement rejeté jusqu’en 2018 et au statut actuellement tangent entre Constantinople et Moscou, le Trône œcuménique l’ayant réintégré en vue de la constitution d’une Église autocéphale d’Ukraine dont le patriarcat de « toutes les Russies » réfute l’hypothèse. Les clergés et fidèles des deux premières participent néanmoins, hors statut, de la communion orthodoxe ;
- en termes d’autonomie : l’Église de Chine, entre Moscou et Constantinople, et en tant que terre de mission ; l’Église de Moldavie, entre Moscou et Bucarest, qui a érigé en réaction à la mainmise russe sur ce territoire limitrophe de la Roumanie une métropole de Bessarabie ; l’Église d’Estonie, entre Moscou et Constantinople, la rupture de communion entre les deux sièges ayant entraîné en 1998 l’érection de deux juridictions distinctes sur le même territoire, en contradiction flagrante avec les principes fondamentaux de l’ecclésiologie.
Enfin, le tableau enchevêtré que présente l’orthodoxie est encore compliqué par ce que l’on nomme la «diaspora ». Ce terme, impropre, recouvre la situation des terres d’émigration, également devenues des terres de conversion, où la juxtaposition en un même lieu de diocèses à base ethnique, linguistique ou nationale contredit là encore l’ecclésiologie orthodoxe. Ces diocèses peuvent représenter des réalités numériques et politiques supérieures à leur « Église mère », dont ils assurent parfois l’entretien. Tel est le cas des archidiocèses grecs d’Amérique, d’Australie, de Grande-Bretagne pour Constantinople ou de l’archidiocèse métropolitain d’Amérique pour Antioche, qui disposent tous d’une autonomie relative. Cette situation de dépendance prévient l’éclosion d’Églises nouvelles inculturées dans les pays de destination. L’anarchie qui en résulte a trouvé pour remède momentané la création d’assemblées épiscopales dans chacun des pays concernés, ces coordinations sans autorité canonique et à finalité de concertation et de représentation ayant été placées, jusqu’au schisme de 2018, sous la présidence du délégué de Constantinople. Ce sont donc les sièges historiques du Sud ou de l’Est qui administrent ces nouvelles réalités dites « diasporiques » généralement sises au Nord ou à l’Ouest, leur importance et leur dynamisme ne trouvant pas de traduction institutionnelle, hormis l’intégration de certains de leurs membres à des corps épiscopaux dont ils doivent se montrer solidaires.
Le miracle est que la vitalité spirituelle et théologique de l’orthodoxie ne souffre pas, en soi, de cette anarchie. Signe accablant toutefois, l’adoption du calendrier réformé par le patriarche Mélétios en 1923,tout en conservant le comput ancien pour fixer la date de la Pâque, a été suivie par les Églises sous influence de l’hellénisme ou soucieuses de modernité, mais déclinée par les Églises slaves qui, se conformant au refus de Moscou, ont gardé le calendrier julien, lequel accumule un retard grandissant sur la marche des astres. Ce qui a fait, d’une part, que les franges traditionalistes ont usé de ce motif symbolique, à l’instar des intégristes catholiques avec la messe en latin, pour donner lieu au schisme dit en l’occurrence « vieux-calendariste », venant doubler celui, pendant depuis quatre siècles, des vieux-croyants; d’autre part, que les orthodoxes offrent au monde pour spectacle de ne pouvoir célébrer la nativité du Christ le même jour. Or, à avoir été laissées en l’état, ces fissures et fêlures accumulées depuis les Temps modernes, moins dommageables pour la foi et la vie dans la foi que pour le témoignage et la réception du témoignage, ont préparé la rupture, quant à elle gravissime, à tout le moins dans son effet d’annonce, de 2018.
Constantinople et Moscou
Ce morcellement recoupe, de surcroît une forte division idéologique qui n’a cessé de s’affirmer depuis 1991. À la sortie du communisme, les Églises orthodoxes de l’Est, à commencer par le patriarcat de Moscou, doivent faire face au défi de leur nécessaire reconstruction tout en étant brutalement exposées, sans préparation, à la mondialisation. Elles redoutent en particulier les dérives sectaires à l’intérieur de leurs frontières et les assauts prosélytes venant de l’extérieur. La convocation d’un concile général, empêchée de facto depuis le XVe siècle, annoncée en 1923 par Constantinople, retardée par la guerre froide, a été préfigurée depuis 1961, au bénéfice de la détente, par toute une série de conférences pan orthodoxes, de travaux préparatoires ainsi que de consultations d’experts en théologie et droit canon. En 1992, il apparaît cependant que l’heure est encore prématurée car, eu égard aux crispations des Églises qui ont eu à subir le totalitarisme, un tel concile pourrait bien être celui d’une réaction outrancière à la modernité – autrement dit dans un esprit, si l’on ose une comparaison avec le catholicisme, plus proche du Syllabus que de Vatican II.
C’est à ce moment que le patriarche Bartholomée innove en réunissant à Constantinople une synaxe des primats de l’orthodoxie : si la formule est discutable puisqu’elle semble donner droit à l’idée d’une communion entre entités closes sur elles-mêmes et dotées chacune d’une sorte de papauté locale, cette instance de coordination pare néanmoins au plus pressé et manifeste, à sa façon, une forme de conciliarité concrète. Elle marque le pouvoir d’initiative du patriarcat œcuménique ainsi que son ministère de l’unité, mais aussi son souci de réinscrire l’Église orthodoxe dans le fil de son ecclésiologie et dans le cours de l’Histoire.
La première de ces synaxes a lieu en 1992, alors que les conflits qui dévorent l’ex-Yougoslavie connaissent un tournant irrémédiable. Elle condamne comme schismatique l’érection d’un patriarcat de Kiev par le métropolite Philarète (Denysenko), jusque-là à la tête de l’orthodoxie ukrainienne sous l’autorité de Moscou, personnage douteux et, surtout, candidat malheureux à l’élection patriarcale de 1990 face à Alexis II. Mais la démonstration de ce front uni permet aussi de notables avancées œcuméniques : la commission mixte catholique-orthodoxe pour le dialogue théologique, investie de part et d’autre au plus haut niveau, qui tient session à Balamand, au Liban, en 1993, stipule que l’uniatisme ne saurait constituer une voie pour l’union, ce qui vide un litige pluriséculaire avec Rome ; en 1995, la commission luthérienne-orthodoxe publie un important document sur l’héritage de l’ère conciliaire, ce qui refonde le dialogue avec la Réforme sur la notion de tradition indivise.
Pour autant, la prétention de Moscou à assurer le rôle de centre dominant au sein de l’orthodoxie précipite une première crise autour de la question estonienne en 1996, crise déjà à fond théologique et politique. Elle consiste, rétrospectivement, en une répétition générale de l’affaire d’Ukraine vingt-deux ans plus tard. Retour à l’histoire : au regard de l’indépendance acquise sur l’empire tsariste dans les suites de 1917 et de l’état du patriarcat de Moscou sous la répression bolchevique, le diocèse d’Estonie demande, en 1923, à entrer sous la juridiction de Constantinople qui l’accepte en lui conférant un statut d’autonomie. L’annexion de 1944 par Staline se traduit par le retour forcé dudit diocèse dans le giron de l’Église russe. L’indépendance retrouvée de l’Estonie en 1991 provoque une vive opposition entre les populations orthodoxes locales et importées sous la soviétisation du pays. En 1994, le patriarche Bartholomée appelle les premiers, depuis la Finlande, à faire valoir leurs droits. Le 4 janvier 1996, il leur adresse une lettre pastorale les confirmant dans ce sens et, le 20 février, il restaure l’Église autonome d’Estonie placée sous son autorité. Le 23 février suivant, Moscou rompt la communion avec Constantinople. La situation de schisme est cependant vite éteinte par l’accord bancal du 16 mai de la même année, entérinant la coexistence d’une double juridiction sur le même territoire.
Ce sont bien deux visions de l’Église mais aussi du lien à l’histoire et du rapport au monde qui s’affrontent. Ainsi de la décision de Constantinople, en 1998, de reconnaître l’autocéphalie que Moscou avait accordée de manière unilatérale en 1951 à l’Église des pays tchèque et slovaque. Le contexte en éclaire les enjeux. La dissolution, en 1993, de la Tchécoslovaquie a amené les deux républiques qui en sont issues à demander leur entrée dans l’Union européenne, laquelle sera actée lors du grand élargissement à l’Est de 2004. Or, en 1998, le sommet panorthodoxe de Thessalonique débouche sur une nouvelle crise : les patriarcats de Moscou et de Belgrade appuient la sortie du patriarcat de Géorgie des relations œcuméniques et obtiennent une déclaration qui, pêle-mêle, dénonce «l’intercommunion confessionnelle, le syncrétisme religieux et les revendications des minorités sexuelles». Face à cette offensive identitaire, Bartholomée parie donc sur l’intégration à l’Europe dont il se fait le promoteur pour la Turquie, considérant que l’adoption d’un régime réel de droits ne peut que profiter au patriarcat œcuménique mais aussi aux « petites nations » nouvellement émancipées de l’Empire soviétique.
Durant tout le temps de son pontificat (1990-2008), la personnalité d’Alexis (Ridiger), issu de l’élite balte russifiée, qui a grandi et a été formé dans les courants réformistes de l’émigration, eux-mêmes héritiers de la renaissance théologique du XIXe siècle, tempère les aspérités de cette lutte. Ce n’est plus le cas depuis l’accession du métropolite Cyrille (Goundiaiëv) au trône moscovite qui, dès son intronisation, le 1er février 2009, se pose en défenseur de l’intégrité de toutes les Russies et, à rebours de la carrière qu’il amenée dans les milieux œcuméniques internationaux, d’une orthodoxie intransigeante, garante d’un traditionalisme aussi bien religieux que moral. L’affrontement avec le patriarche Bartholomée va dès lors être aussi celui de deux personnalités préparées chacune, depuis leur jeunesse, à remplir les plus hautes fonctions afin de relever leur Église de l’abîme.
Né en 1940, Grec de nationalité turque, disciple du métropolite Méliton de Chalcédoine qui fut la cheville ouvrière du pontificat d’ouverture d’Athénagoras, Bartholomée (Dimitrios Archontonis) a reçu une solide formation de canoniste à l’Institut pontifical oriental à Rome, à l’Institut œcuménique de Bossey, en Suisse, et à l’université de Munich. Représentant incontournable de Constantinople dans les diverses enceintes internationales, il a occupé, à partir de l’élection de Dimitrios, en 1972, le poste de secrétaire général du patriarcat, conçu à son intention pour pallier l’immixtion d’Ankara dans le fonctionnement de la « Grande Église ». Aussi est-ce à l’unanimité qu’il est à son tour élu en 1991 sur le Trône œcuménique. Première figure religieuse à prendre fait et cause pour l’environnement et l’écologie, il acquiert la réputation planétaire de «patriarche vert» et entretient une relation personnelle soutenue avec les papes Jean-Paul II, Benoît XVI, mais surtout François, auquel le lient une authentique amitié et une vision commune de l’avenir du christianisme. Décrivant sa propre situation à Istanbul comme « crucifiée », Bartholomée combat inlassablement pour la réouverture de l’Institut de théologie orthodoxe de Halki qui, fermé par les autorités turques en 1971, est la clé de la pérennité sur place de l’institution patriarcale. Défenseur par force mais aussi par conviction d’une conception spirituelle de l’orthodoxie, il n’a cessé de réaffirmer, dans le même temps, la primauté du siège œcuménique, considérant qu’elle est la condition de l’unité orthodoxe et n’hésitant pas à aller au conflit à cet effet.
Issu d’une famille sacerdotale, son grand-père ayant connu le goulag, Cyrille (Vladimir Goundiaïev), né en 1946, entre au séminaire de Leningrad en 1965 sous l’autorité du métropolite Nicodème (Boris Rotov), alors l’homme fort du patriarcat. À la suite de la seconde vague de persécution sous Khrouchtchev, Nicodème tente d’imposer un pacte à l’État soviétique : le département des relations extérieures qu’il préside se fait le propagateur du socialisme et du pacifisme à l’Ouest, tandis que l’étau se desserre pour l’Église à l’Est. Dans le même temps, il se rapproche de Rome, dont il retient surtout le modèle d’organisation hiérarchique et de rayonnement diplomatique fondé sur la puissance de la curie. C’est cette vision qu’il imprime à ses disciples et qu’ils continueront, après sa mort subite en 1978, lors d’une entrevue avec Jean Paul Ier : après l’effondrement de l’URSS, on retrouvera ainsi Juvenal (Poyarkov) vicaire de Moscou, Philarète (Vakhromeïev) exarque à Minsk ou Vladimir (Sabodan) métropolite de Kiev. De tous, Cyrille est le plus brillant et, après une carrière internationale, entre autres au Conseil œcuménique des Églises à Genève, il gravit un à un les échelons du pouvoir pour prendre la succession de Nicodème en 1989. Il réédite le pacte de ce dernier, s’entendant avec Vladimir Poutine pour institutionnaliser le patriarcat en centre de pouvoir en Russie et en instrument d’influence à l’étranger. Progressiste jusque-là, il se fait conservateur pour gagner le trône moscovite, endossant depuis l’anti-œcuménisme ambiant, de même que la nostalgie de l’époque stalinienne ou la croisade contre la libéralisation des mœurs. Il entend ainsi affirmer la suprématie de l’Église russe sur l’entière orthodoxie.
Bien que leurs trajectoires existentielles soient pour partie analogues, l’opposition entre le 270e patriarche de Constantinople et le 16e patriarche de Moscou est front à front. Elle résume, accentuée de part et d’autre par des siècles de vicissitudes, l’antagonisme né à la Renaissance, avec la chute de l’Empire byzantin, et qui a éclaté aux Temps modernes, avec l’essor de l’Empire russe. Elle a pour motif constant la nature de l’Église et, pour motif récent, le sens de la modernité. Elle va trouver pour théâtre le territoire actuel de l’Ukraine, évangélisé par Constantinople au IXe siècle, annexé par Moscou au XVIIe siècle, mais qui est aussi un pays-frontière entre l’Orient et l’Occident chrétiens, l’Est et l’Ouest de l’Europe depuis le VIIIe siècle.
Le concile et la déchirure
De souterrain, le conflit devient public après 1998, dans les suites de l’affaire d’Estonie. Les travaux de la commission mixte catholique-orthodoxe en sont l’une des arènes : la déclaration de Ravenne, en 2007, qui porte sur la primauté et la synodalité, se conclut à la fois sur un rapprochement entre Rome et Constantinople et un éloignement entre Constantinople et Moscou qui dénie moins les droits historiques du siège pétrinien que du trône œcuménique. Dans la quête de l’unité, les conflits internes qui divisent l’orthodoxie constituent désormais le premier obstacle à toute avancée. Sous le pontificat de Benoît XVI, ces luttes intestines jouent momentanément en faveur de l’Église russe qui concentre l’attention du Vatican. C’est elle qu’il s’agit de gagner au titre de l’argument qu’inlassablement elle énonce, à savoir qu’elle compte pour moitié de l’Église orthodoxe, qu’elle dispose seule d’une véritable puissance à agir et que rien ne pourra se faire sans elle. Quitte à réduire la démarche œcuménique à un front commun du conservatisme moral.
Ce calcul bute cependant sur la conscience orthodoxe qui rechigne au moralisme et qui, encline à minimiser les troubles institutionnels au profit d’une vision transfigurée de l’Église, n’en tient pas moins à l’ordre ecclésial tel que formé au cours des âges et tel que reçu en héritage, ce plafond de verre valant aussi pour la hiérarchie moscovite en son for intérieur. Face à la série d’offensives qui vise à le déstabiliser et à le marginaliser, Bartholomée de Constantinople va répliquer en accélérant la convocation d’un concile général, qu’il conçoit également comme la mission de sa vie et l’œuvre de son pontificat.
Les travaux préparatoires, qui courent sur un demi-siècle, ont toutefois montré la fragilité de l’entreprise. Plus que de prédication de la foi, le concile consistera en une démonstration de l’unité. Moins qu’un contenu dogmatique, il apportera un règlement disciplinaire. Sa réunion même se limitera à la proclamation de l’accord obtenu au fil de rencontres bilatérales entre Églises autocéphales. Nécessité fait force de loi et sa tenue serait autrement remise à un horizon inconnu. On ne saurait trop souligner le volontarisme et la patience dont fait alors preuve le patriarcat œcuménique.
Moscou ne l’entend pas ainsi. Cyrille revendique une place centrale dans l’événement conciliaire qui viendrait consacrer son leadership politique. Il lui faut, pour cela, régler ses relations avec Rome afin de se présenter comme l’égal de Bartholomée. Les relations officielles sont inexistantes avec la papauté depuis l’érection du patriarcat au XVe siècle, la Russie est le seul pays resté interdit à Jean-Paul II, le souverain pontife itinérant, et l’hypothèse d’un sommet entre les deux sièges est sans cesse retardée. Alors que Bartholomée a fait entériner la tenue du concile lors de la synaxe des primats de mars 2014 au Phanar et sa convocation imminente lors de celle de Chambésyen janvier 2016, Cyrille se résout à rencontrer François. Leur étrange face-à-face se déroule, en catimini, dans un salon de l’aéroport de LaHavane, à Cuba, le 12 février 2016.
Le dialogue entre les deux hiérarques est de convenance et embarrassé. Ce qui compte est la déclaration commune qu’ont longuement préparée leurs appareils diplomatiques respectifs, la secrétairerie d’État pour François, le département patriarcal des Relations extérieures et le Kremlin pour Cyrille. Son contenu est d’abord géopolitique. Alors que la poussée des formes religieuses modernes que sont l’évangélisme et l’islamisme fait partout craquer les repères habituels, il s’agit d’éteindre les foyers d’une querelle millénaire entre orthodoxes et catholiques sur les deux fronts orientaux que représentent le Levant et l’Est. Le troc est clair : en échange de l’extension de la protection des armées russes aux chrétiens du monde arabe qui sont unis à Rome, Rome se chargera de restreindre les revendications des gréco-catholiques en Ukraine – lesquels, d’ailleurs, ne s’y tromperont pas, dénonçant dès le lendemain un « abandon ».
Affermi par ce semblant de victoire qui, dans l’instant, ne peut que satisfaire Vladimir Poutine, Cyrille renchérit de manière exorbitante sur les conditions qu’il met à la tenue du concile, à commencer par son exigence d’une représentativité proportionnelle à l’importance numérique de chaque autocéphalie. Entre-temps, sous l’effet de la crise qui a éclaté entre Moscou et Ankara à l’occasion de la guerre de Syrie, Bartholomée doit se résigner à transférer le lieu de l’événement d’Istanbul en Crète. Employant à nouveau son pouvoir d’initiative, il décide que le concile se réunira du 19 au 26 juin 2016, le plaçant ainsi sous l’inspiration de la Pentecôte.
Cyrille va dès lors jouer son va-tout. Il refuse de se rendre en Crète, dénonçant les documents préparés depuis 1961, et à la rédaction desquels le patriarcat de Moscou a pleinement participé, comme inachevés et insatisfaisants. Il entraîne à sa suite trois autocéphalies qui constituent un rassemblement hétéroclite : l’Église de Géorgie, au nom de son anti-œcuménisme déclaré, l’Église de Bulgarie, au nom de son traditionnel panslavisme, mais aussi l’Église d’Antioche, entrée dans l’orbe russe et dépendant désormais du Kremlin en raison du conflit syrien. Les deux premières accusent les excès progressistes du concile, la troisième son manque de progressisme. Antioche, de surcroît, n’entend pas siéger avec Jérusalem qui a étendu de manière illégitime sa juridiction sur le Qatar et reproche à Constantinople son inaction, à base de solidarité hellénique, dans cette nouvelle affaire territoriale ayant abouti, en 2014, à la rupture de communion entre les deux patriarcats anciens.
Ce sont donc dix Églises autocéphales sur quatorze qui se retrouvent en Crète à la fin juin 2016 pour proclamer diverses résolutions sur les pratiques ascétiques et sacramentelles, le témoignage et la mission de l’orthodoxie dans le monde contemporain, mais aussi sur la signification de l’autonomie et de la diaspora, ces dernières tendant à entériner le statu quo. Pour Constantinople, la déclaration encyclique du concile revêt force d’obligation pour le plérôme orthodoxe. Pour Moscou, et les dissidents à sa suite, cette rencontre synodale n’a de valeur que préfiguratrice d’un « concile panorthodoxe à venir ».
Bartholomée est allé aussi loin qu’il le pouvait dans la manifestation de l’unité afférente au ministère de la primauté qui lui revient par l’histoire, par le droit, mais aussi et avant tout par sa propre manière de le porter et de l’incarner. Cyrille a bafoué l’autorité du siège œcuménique pour souligner son avantage politique en montrant un net mépris des nécessités ecclésiales. À la manière de Staline demandant : « Le pape, combien de divisions? », il a fait étalage de sa force. Ce sont néanmoins la faiblesse et l’isolement de l’Église russe qui ressortent de ce bras de fer tant il apparaît qu’elle ne peut prouver sa prétention à la puissance que par son pouvoir de nuisance. Or, si le patriarcat de Moscou représente la moitié de l’orthodoxie, l’Ukraine vaut pour moitié du patriarcat.
Le schisme et la prophétie
L’Ukraine, comme l’indique la racine kraj de son nom est une zone frontière qui a pris la dimension d’un pays au point de scission entre les deux Europe. Le mouvement de balancier est récurrent au cours des siècles. L’adoption du christianisme venu de Constantinople, l’invasion tatare, la création d’une entité cosaque, l’incursion ottomane, l’annexion par la Russie font de Kiev un Orient ; l’occupation polonaise et lituanienne, le ralliement d’une partie du clergé à Rome, le romantisme révolutionnaire et la vitalité de minorités telles que, jadis, la communauté juive animée par les idéaux de l’émancipation avant d’être anéantie, en font un Occident. Le rêve répété de l’indépendance, sans cesse miné à l’intérieur par des féodalités fragmentées ou des révoltes populaires, menacé à l’extérieur par des voisins prédateurs, cristallise ainsi un nationalisme exacerbé par la conscience d’un territoire-accordéon et d’une identité composite, si ce n’est contradictoire.
Ce balancement détermine le partage entre l’est et l’ouest du pays qui, en leurs confins, forment respectivement un bastion orthodoxe, majoritairement russophone, autour de Donetsk, cité industrielle, et un bastion catholique de rite byzantin, purement ukrainophone, autour de Lviv, ville universitaire. Le contentieux se nourrit de mémoires antagoniques où alternent conversions forcées et coercitions linguistiques. Ce clivage se retrouve dans la présente carte électorale où le conservatisme, tourné vers Moscou, domine à l’est et le progressisme, tourné vers Bruxelles, domine à l’ouest. Il imprègne les autres régions, hante la capitale et en fait, comme en 2001, en 2004, en 2011 et en 2014, l’otage de forces centrifuges.
Ce balancement détermine le partage entre l’est et l’ouest du pays qui, en leurs confins, forment respectivement un bastion orthodoxe, majoritairement russophone, autour de Donetsk, cité industrielle, et un bastion catholique de rite byzantin, purement ukrainophone, autour de Lviv, ville universitaire. Le contentieux se nourrit de mémoires antagoniques où alternent conversions forcées et coercitions linguistiques. Ce clivage se retrouve dans la présente carte électorale où le conservatisme, tourné vers Moscou, domine à l’est et le progressisme, tourné vers Bruxelles, domine à l’ouest. Il imprègne les autres régions, hante la capitale et en fait, comme en 2001, en 2004, en 2011 et en 2014, l’otage de forces centrifuges.
L’annexion de la Crimée et l’intervention militaire dans le Donbass, voulues par Vladimir Poutine, ont brisé ce cycle alternatif. Elles ont créé également une divergence sans précédent entre le Kremlin et le patriarcat de Moscou qui doit, lui, préserver à tout prix l’intégrité de son territoire juridictionnel, lequel embrasse l’Ukraine, et ne peut envisager de perdre le berceau de sa foi. Or, bien avant que la crise éclate, le patriarcat œcuménique a posé les jalons d’une future autocéphalie, l’impression d’emballement que l’on peut retirer de l’affaire devant être de ce point de vue modérée. Dès avril 2014, Bartholomée s’enquiert des « blessures et souffrances du peuple ukrainien ». En juin 2015, le patriarcat de Kiev, dissident et schismatique, demande à être reçu dans la communion de Constantinople qui, toutefois, en février 2016, tend à apaiser les inquiétudes de Cyrille afin d’assurer la bonne tenue du concile. On sait la suite. C’est plus positivement qu’en juillet 2016 le primat de l’orthodoxie se propose d’examiner la demande du parlement ukrainien que soit érigée une Église locale et indépendante. Les faits de guerre qui se multiplient enrayent toutefois le processus. Il reprend en avril 2018, avec la visite du président Petro Porochenko au Phanar, où il rencontre le patriarche Bartholomée et réitère la même requête. Laquelle est cette fois entendue et, surtout, mise immédiatement en effet, avec une promesse de réalisation à très courte échéance.
Dès lors, l’escalade des déclarations et des actes entre les deux sièges, impliquant également les autres patriarcats, va mener à la rupture de communion que le Saint-Synode de l’Église russe, réuni symboliquement à Minsk, en Biélorussie, prononce le 15 octobre 2018. Le conflit est réel mais dissymétrique et multiforme. Moscou se revendique de l’histoire politique pour perpétuer un lien de dépendance que les Ukrainiens refusent dorénavant en grande majorité, y compris une partie notable des orthodoxes qui composent la première confession du pays. Constantinople argue, de son côté, de l’histoire religieuse : en tant qu’« Église mère », évangélisatrice de la Kiev médiévale, elle n’a jamais concédé formellement ce territoire au patriarcat de Moscou, qui lui doit par ailleurs son existence et, en répondant aux aspirations du peuple ukrainien, elle déclare accomplir sa fonction d’arbitrage.
Les échanges d’argumentaires juridiques et de documents historiques entre les deux parties peuvent paraître artificiels et surannés, particulièrement lorsqu’il y va du droit canon, lequel est soumis plus qu’à son tour, hors contexte, à des reconstructions opportunistes. Les discours d’exclusion frappent pareillement par un appel à la loi, qui représente en soi un symptôme de déperdition de l’ecclésialité. Ainsi Moscou peut accuser Constantinople d’avoir sombré dans le schisme pour avoir réintégré en préalable à l’union de tous les orthodoxes ukrainiens les branches précisément schismatiques que sont l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne apparue en 1920 et le patriarcat de Kiev fondé en 1992, tandis que Constantinople peut blâmer Moscou d’avoir été incapable de surmonter ces séparations et, pire encore, de continuer à les alimenter en refusant le recours à son autorité.
Les interférences géopolitiques viennent s’y ajouter, inévitables dans cette zone tampon et disputée, brouillant un peu plus la donne. Elles sont claires dans le cas de Moscou mais n’épargnent pas Constantinople, proche de Washington en raison de l’influent lobby grec, traditionnellement démocrate, qui existe aux États-Unis et sensible aux pressions des diocèses ukrainiens d’Amérique du Nord qui sont sous sa juridiction. Quant à sa surprenante latitude à agir, elle provient de l’intérêt que trouve la Turquie d’Erdoğan à contrecarrer la Russie à laquelle la lie une alliance contre nature et qui l’empêche de progresser contre les Kurdes en Syrie.
Toutes ces dimensions existent et établissent chacun des sièges à fronts renversés. L’affaire est à même de parachever le divorce déjà entamé entre Cyrille et Poutine, jusque-là alliés, mais dont les obligations et les stratégies devenues divergentes tournent désormais à un profond antagonisme, et ce au détriment du premier. L’intervention de Bartholomée dans la question d’Ukraine risque paradoxalement de renforcer un nationalisme de plus au sein du monde orthodoxe, voire de susciter une inflation des schismes à l’intérieur même de l’orthodoxie ukrainienne. Les Églises qui ont ou n’ont pas participé au concile sont sommées de choisir leur camp, ce qu’elles hésitent à faire, le plus souvent au motif de leurs propres problèmes territoriaux, au risque d’entretenir une situation malsaine de confusion grandissante. Enfin, il est inutile de souligner combien l’état de corruption endémique dont souffre chaque secteur de la vie ukrainienne offre de perspectives aux manipulations de tous bords, qu’elles viennent de Moscou, de Washington ou d’ailleurs. À vue humaine, la crise s’avère durable, sans solution prévisible à moyen terme, avec pour seul gage la qualité des deux protagonistes majeurs de la génération suivante, délégués pour l’heure à la tâche de défendre les positions en présence, et que sont, de part et d’autre, le métropolite Emmanuel (Adamakis) de France et le métropolite Hilarion (Alfeiev) de Volokolamsk.
Tous ces aléas demeurent l’écume d’une lutte plus essentielle. Il n’y a pas lieu de laisser s’étendre l’entreprise de fausse restauration que conduit Cyrille et qui, d’ores et déjà, se solde en Russie par des cathédrales restaurées mais vides tant les forces vives de la société civile jugent son programme de bout en bout politique contraire à la perspective d’une authentique réévangélisation et se sont éloignées de l’Église qu’elles traitent au mieux avec indifférence. Ainsi, tandis que les chefs d’un parti communiste impénitent et fossilisé déclarent être des « orthodoxes athées », la renaissance dont se targue le patriarcat de Moscou n’affiche jamais qu’un taux de pratique de 3%.
Certes, le siège constantinopolitain ne va pas, de son côté, sans critiques et lui aussi a des réformes à accomplir. Ce que n’hésitait pas à affirmer Jean Meyendorff, l’un des grands théologiens orthodoxes du siècle passé qui, d’origine russe et d’éducation française, mena une brillante carrière aux États-Unis avant de brutalement décéder en 1992 : l’orthodoxie a besoin que le patriarcat œcuménique existe et qu’il exerce une primauté réelle que l’on ne saurait confondre avec une simple préséance d’honneur, mais un tel exercice implique des conditions de possibilité et d’efficience non moins réelles. Comment ? En ne maintenant plus qu’une présence symbolique à Istanbul, en adoptant le Mont-Athos qui est de son ressort comme résidence légale et suprapolitique, en transférant son activité à Thessalonique, ville impériale et pontificale à cheval sur la Méditerranée et l’Est, en instaurant un conseil international formé d’un synode tournant afin d’éviter le piège curial et d’un collège d’experts émanant de l’ensemble des Églises, diaspora comprise, et en instituant Patmos comme sa résidence d’été ouverte au dialogue avec les mondes religieux, intellectuels et artistiques, il est clair que le Protos, « le Premier », serait plus libre et plus légitime dans l’accomplissement de « son service pour tous ».
En attendant que puisse être sereinement examinée une telle hypothèse, forcément déchirante au regard des siècles consacrés à résister,le fait est là : le primat de l’orthodoxie a préféré la crise, qui est un moment de vérité, à l’inertie. Il a clairement dit non à l’hégémonie d’une hiérarchie russe qui, au passage, par ses errances idéologiques, trahit jusqu’au renouveau intellectuel et au martyre de l’Église de Russie au XXe siècle. Et, plus généralement, il crève l’abcès des arrangements dont les orthodoxes sont devenus coutumiers avec les certitudes qu’ils professent. C’est de manière prophétique que le patriarche Bartholomée leur tend un miroir qui fait fi de leur habituelle cécité ou hypocrisie sur leurs manquements et faiblesses. Un miroir qui dissipe le mirage de l’empire, des mondes, des peuples orthodoxes, et où l’Église est convoquée pour s’y refléter, telle qu’en elle-même dans la ressemblance à ce qu’elle doit être et dont Byzance ou ses réinventions ne furent que des avatars.
La prophétie ne consiste pas en un pari sur le futur mais en un rappel du sens ultime du plus profond passé sans lequel il ne saurait y avoir le moindre avenir. La finalité de la lutte en cours n’est autre que la coïncidence avec l’Évangile, la faculté de répondre avec exactitude du témoignage qu’attendent ceux qu’inspirent les trésors, bien réels, de l’orthodoxie lorsqu’ils la rencontrent dans son évidence eschatologique. La résurrection théologique, portée en premier lieu dans la diaspora à Paris, par l’Institut Saint-Serge, et à New York, par le séminaire Saint-Vladimir qui en provient, reste entièrement à l’ordre du jour, tant tout progrès dépend de sa réception par le peuple que cette même théologie dit être « de Dieu » et non pas soumis à des puissances terrestres qui sont autant d’impuissances à féconder spirituellement l’histoire.
Le mot krisis, dans ce grec qui est celui de l’Ancien Testament des Septante et du Nouveau Testament de la koinè, qui est à la source d’une intarissable et magnifique hymnographie évoquant le chant des anges, ne signifie-t-il pas l’heure du jugement en vérité ? Pour rendre compte de l’espérance qu’elle recèle, il est plus que temps, et quel qu’en soit le prix, pour l’Église d’Orient de se réorienter, c’est-à-dire, au nom de la promesse qui la fonde et qui l’entretient, de s’en remettre à Celui « qui était, qui est, qui vient » (Ap I, 8).












Aucun commentaire.