La France et les chrétiens d'Orient dernière chance
Le christianisme va-t-il mourir sur les lieux qui l’ont vu naître ? Les chrétiens d’Orient sont-ils condamnés à disparaître ?Penser différemment
Agir diversement
Reprendre l’initiative
Résumé
Le christianisme va-t-il mourir sur les lieux qui l’ont vu naître ? Les chrétiens d’Orient sont-ils condamnés à disparaître? Mais qui sont-ils vraiment ? Pourquoi leur situation immémoriale est-elle devenue subitement intenable ? Pourquoi leur cause n’est-elle pasparticulariste mais universelle ? Pourquoi faut-il la préserver des pulsions émotionnelles et des récupérations identitaires ? En quoi leur exode marque-t-il une catastrophe de civilisation et un coup létal à la biodiversité culturelle ?
Le christianisme va-t-il mourir sur les lieux qui l’ont vu naître ? Les chrétiens d’Orient sont-ils condamnés à disparaître? Mais qui sont-ils vraiment ? Pourquoi leur situation immémoriale est-elle devenue subitement intenable ? Pourquoi leur cause n’est-elle pasparticulariste mais universelle ? Pourquoi faut-il la préserver des pulsions émotionnelles et des récupérations identitaires ? En quoi leur exode marque-t-il une catastrophe de civilisation et un coup létal à la biodiversité culturelle ?
Jean-François Colosimo,
Philosophe, théologien, président de l’Institut orthodoxe de Paris et directeur des éditions du Cerf.

Les protestants en France, une minorité active
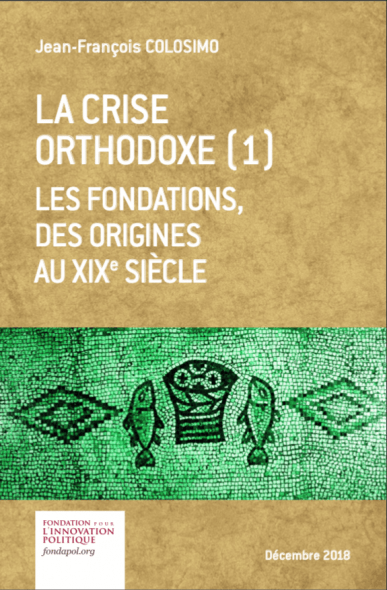
La crise orthodoxe (1) Les fondations, des origines au XIXème siècle
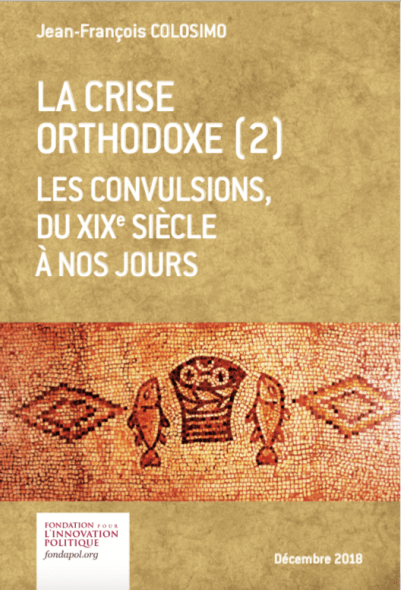
La crise orthodoxe (2) les convulsions, du XIXème siècle à nos jours
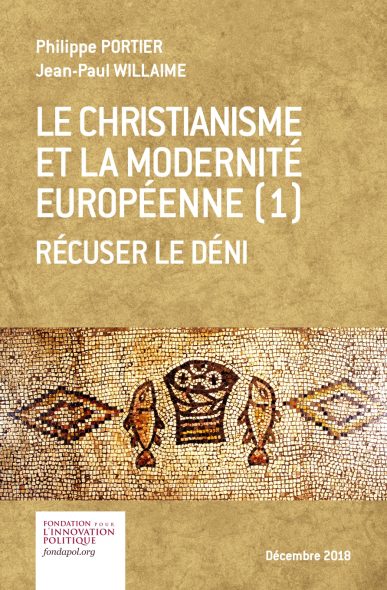
Le christianisme et la modernité européenne (1) récuser le déni
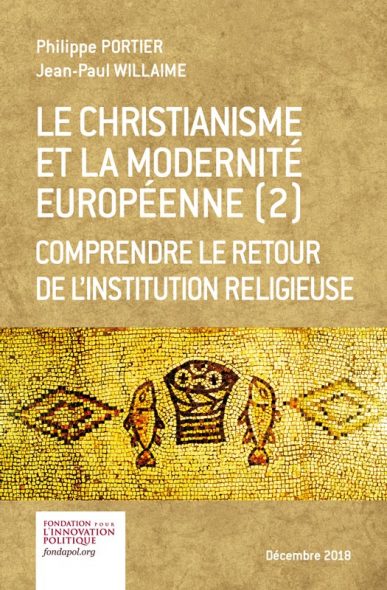
Le christianisme et la modernité européenne (2) comprendre le retour de l'institution religieuse
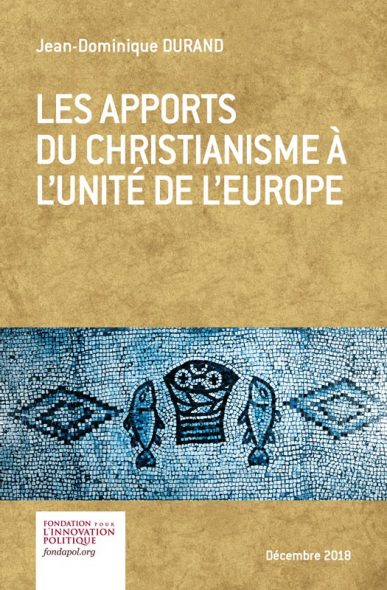
Les apports du christianisme à l'unité de l'Europe

La religion dans les affaires : la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise)
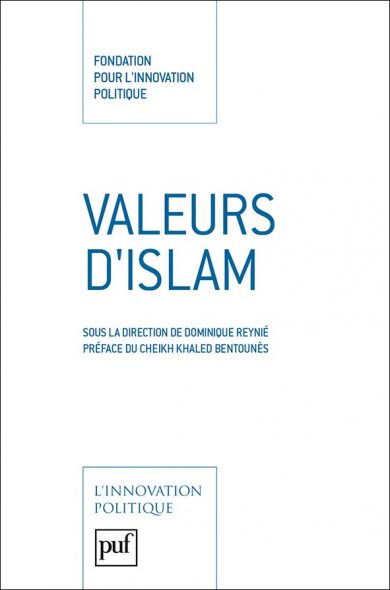
Valeurs d'islam
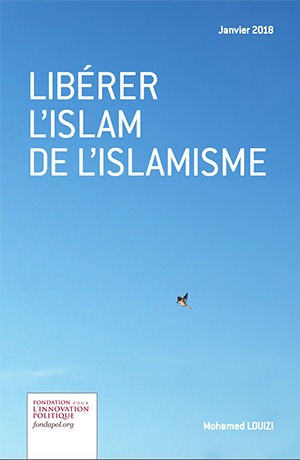
Libérer l'islam de l'islamisme

Portrait des musulmans d’Europe : unité dans la diversité

Portrait des musulmans de France : une communauté plurielle
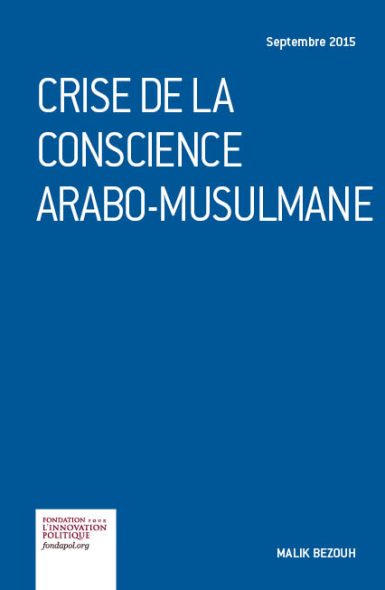
Crise de la conscience arabo-musulmane
Penser différemment
Dépasser le sentiment
Le christianisme va-t-il mourir sur les lieux qui l’ont vu naître ? Le berceau de l’Évangile ne sera-t-il plus, demain, qu’un musée de l’Église ? Les chrétiens d’Orient sont-ils condamnés à disparaître ? À suivre l’actualité, ces questions revêtent une force dramatique. Une vague irrésistible semble engloutir les disciples de Jésus où qu’ils soient au Levant. De Bagdad à Alexandrie, en passant par Damas, s’accumulent en spirale les images des persécutions qu’ils subissent. Sur fond de guerres, d’instabilités et de coercitions, l’exode paraît les emporter, massif et inexorable. La perspective de leur dissolution aggrave le sentiment plus général d’une planète livrée au chaos et d’une décomposition accélérée de l’ordre ancien. La foi dont ils sont les premiers témoins et qui, en deux mille ans, a changé l’humanité, serait-elle entrée en déclin ? Et, avec elle, l’Occident qui en a porté l’expansion aux quatre coins du monde ? Cette fin d’un monde n’annoncerait-elle pas d’autres crépuscules plus définitifs encore ?
Si le constat factuel n’est pas faux, l’appréhension émotive qui en ressort est faussée. Elle s’inscrit dans des représentations globales sur déterminées où se mêlent le retour de la violence religieuse, le choc des civilisations, l’embrasement de l’islam, la domination de l’Amérique et l’étiolement de l’Europe. Elle vient accentuer les craintes sur l’amplification des flux migratoires, le devenir des identités ou le sort de l’universalité. Au prix d’approximations et d’appropriations, la cascade des affects conduit à annexer les chrétiens d’Orient au service de conflits qui ne sont pas les leurs. Quitte, selon une tendance répétée au cours des derniers siècles, à aggraver leur malheur.
La confusion règne, redoublant l’effacement. Indice immédiat, sous l’apathie ou le cynisme des chancelleries, la tragédie des chrétiens d’Orient ne suscite pas l’action diplomatique qu’elle appellerait. L’absence de vrai engagement à leur égard grève un peu plus le sérieux des organisations internationales. Elle entache la réputation de la France qui, traditionnellement, avait fait de leur « protection » un môle de son rayonnement en Méditerranée. L’écueil paraît d’autant plus cruel que la notion d’« intervention humanitaire », prodrome du « droit d’ingérence », fut inventée à leur intention par Napoléon III consécutivement aux massacres de Damas et du Chouf en 1860.
Autre indice, aussi bien dans l’Hexagone comme dans l’hémisphère Nord, la mobilisation populaire n’est pas au rendez-vous. Alors qu’il aurait fallu la concevoir universelle, la cause des chrétiens d’Orient demeure la seule affaire des cercles confessionnels. Politiquement, à gauche comme à droite, elle se voit réduite à un combat particulariste. Au vu de leur caractère religieux affiché, le camp progressiste abandonne à leur sort ces vagues et encombrants cousins antédiluviens afin de se disculper de tout esprit partisan. Pour les mêmes raisons, mais inversées, le camp conservateur les assimile à un cas prétendument démonstratif de l’inévitable partition du monde en blocs à caractère religieux. À l’extrême, le déni vire au détournement. Pour l’identitaire, le métèque qu’était naguère le chrétien oriental devient aujourd’hui sacré, immolé en signe annonciateur de son propre et proche engloutissement sous la poussée de l’islamisme. Ce rapt a contre lui l’histoire et les Églises. Il ne nourrit pas moins une comptabilité biaisée de la comparaison entre là-bas et ici, les partants et les arrivants, les cathédrales détruites et les mosquées construites, qui, sous couvert d’activisme, précipite l’inaction.
Enfin, la confusion porte sur la nature même de la tragédie. Pour ce qui est du présent, les chrétiens d’Orient meurent moins qu’ils n’émigrent et leurs départs sont plus volontaires que forcés. Ce dont on peut s’attrister, mais qu’on ne saurait leur reprocher. À la vague d’éradication ou de marginalisation qui a couru sur le XXe siècle dans le silence des nations succède l’heure de l’ultime sauvegarde. Le fait est que, désormais, l’exil constitue le seul pouvoir de décision autonome dont ils disposent afin d’accompagner les mutations de la globalisation. Le pari de la transplantation qu’ils font n’en reste pas moins perdant à moyen terme. Se maintenir sur place leur est impossible en-deçà d’un certain seuil sociologique. Mais se déporter dans des ailleurs sécularisés induit, sur deux à trois générations, une autre attrition sociologique, résultant cette fois de la dissolution du cadre communautaire hors duquel leurs grands véhicules de transmission, principalement ecclésiaux, ne seront plus que des résidus folkloriques.
Qu’ils restent ou qu’ils partent, les chrétiens d’Orient transitent aujourd’hui entre une variable d’ajustement au sein des relations internationales, un motif idéologique d’autodéfense, une cause exotique de spiritualisme chic ou de désespérance charitable. Il aura fallu que l’islamisme veuille les supprimer pour que germe la velléité d’apprendre qu’ils existent et qu’ils souffrent, leur inscription au grand registre de l’iconographie victimaire datant d’hier à peine, du 11 septembre 2001 et de ses suites, à rebours d’une trajectoire deux fois millénaire. Ne leur échoit donc que le lot d’une émotion intermittente au prorata du sang versé.
Pour qui veut vraiment s’attacher au drame des chrétiens d’Orient, la première tâche est de les libérer des idées reçues afin de retrouver la juste signification de leur destin. C’est-à-dire d’en finir avec une vision qui, sous prétexte de les servir, les desservit. Et ce, pour dégager l’interrogation la plus cruciale qu’ils nous adressent alors qu’elle les dépasse tant ils n’en sont que le signe avant-coureur : le délitement de l’humanité historique, dans sa « biodiversité », à l’âge de la mondialisation.
Réviser l’histoire
L’aliénation n’est pas nouvelle. Non plus que les aperçus parcellaires et les vues partiales qui entretiennent l’image d’une marge accidentelle entre deux univers dominants. Or, les chrétiens d’Orient ne sont pas les cadets égarés, mais les aînés des chrétiens d’Occident à qui ils ont transmis la foi qu’ils ont codifiée. Pareillement, ils ont fourni à l’Islam naissant les éléments constitutifs qui ont permis son édification en tant que civilisation de synthèse. La rivalité mimétique, nourrie par l’amnésie politique, a fait que cette double contribution s’est retournée contre eux. Même si inégalement, la mainmise musulmane et l’emprise européenne ont nourri une dénégation analogue. Or, minoritaire ne signifie pas mineur, non plus que premier, primitif.
Les chrétiens d’Orient ont façonné l’Église indivise, la dotant de ses fondements doctrinaux et institutionnels, les sept premiers conciles œcuméniques s’étant tous tenus en Asie Mineure ; le baptême de leurs cultures, liées aux civilisations anciennes de l’écriture, a précédé de loin celui du continent européen, la conversion du royaume d’Arménie ayant été scellée huit siècles avant l’évangélisation de la Suède ; l’Afrique et l’Asie leur ont été des terres de mission plus d’un millénaire avant l’ère coloniale, les Syriaques ouvrant des églises en Abyssinie et les Assyriens en Chine dès le VIIe siècle. Quant à l’âge d’or de l’Islam, marqué par son rayonnement philosophique au Moyen Âge, force est de noter qu’il se tarit au moment où cesse le transfert des corpus antiques que les chrétiens orientaux reportent alors vers l’Europe renaissante, puis moderne : pas d’Aristote arabe au VIIIe siècle sans les traducteurs syriaques de Bagdad, mais pas de Platon latinisé à Florence au XVe siècle sans les lettrés byzantins de Constantinople, pas d’enseignement des langues sémitiques au XVIIe siècle à Rome sans les clercs venus du Levant et pas d’édition des Pères grecs au XIXe siècle à Paris sans les moines bibliothécaires de l’Athos.
Cette fonction médiatrice dans la sphère culturelle s’est traduite dans l’ordre politique par un savant jeu d’équilibre : en Égypte, lors de la septième croisade, les coptes luttent aux côtés des musulmans contre les Francs menés par Saint Louis et, au sein de l’Empire ottoman, au XVIe siècle, les Grecs administrent les régions danubiennes pour le compte de la Sublime Porte. À partir du XVIIIe siècle, les Églises alimentent le désir de réforme en important les outils de la modernité occidentale, quoi qu’avec des résultats contrastés. En Asie Mineure, leur quasi anéantissement s’effectue non pas sous la pression de l’islam mais sous celle du modèle révolutionnaire, national, et laïciste absolutisé par un jacobinisme d’adoption. Au Levant, leur promotion de l’arabité ainsi que des idées de gauche, mouvances marxistes incluses, visible dans la genèse du parti Baas ou des organisations palestiniennes, bute au contraire sur l’expansion de l’islamisme. Dans les deux cas, plus encore que d’écarter l’attestation de diversité qu’ils manifestent, il s’agit d’écraser la puissance de sécularisation qu’ils portent à l’égard de l’absolutisme, qu’il soit étatique ou religieux. Interdits théologiquement, les voilà condamnés au surenchérissement politique, tout à la fois cautions du rien à signaler et gages d’une inflexible unité aux yeux de régimes autocratiques qui les conçoivent, au mieux, comme des faire-valoir qu’il est bon d’exhiber de temps à autre en vitrine. Ce qui explique leur psychologie de réprouvés, enclins à la solennité ou à la hâblerie pour emmurer leur honte et traiter par-dessus l’épaule la fatalité.
De ce parcours, il faut retenir que les chrétiens orientaux sont aussi orientaux que chrétiens. Cette singularité explique l’irréductible complexité de leurs relations au monde «chrétien-occidental» et au monde « islamo- oriental ». D’où les illusions de perspective. Quand ont-ils commencé de finir ? En 637 avec la prise de Jérusalem par Omar ibn al-Khattâb ? En 2003 avec l’invasion de l’Irak par George W. Bush ? Ou n’ont-ils jamais fini de finir au fil d’une constante oscillation ? Leur nombre n’a pas décru systématiquement sous la domination musulmane et il a même prospéré dans le Machrek de l’après-guerre jusqu’en 1990, le décrochage démographique n’ayant pas été affaire de masse mais de proportion. Les épisodes d’influence ont alterné avec les périodes d’exclusion et les temps de persécution ouverte ont été sporadiques jusqu’aux alentours de 1880, lorsque le mouvement des indépendances en Europe orientale a gagné le Proche-Orient. Certes, des lustres séparent ces communautés rescapées de leurs glorieux commencements, mais il est infondé d’y substituer une légende noire permanente.
S’il faut marquer un tournant, c’est 1915 et le génocide des Arméniens commis par les Jeunes-Turcs d’Union et Progrès, ce qu’Ankara continue de nier tout en candidatant auprès de Bruxelles. L’ère des massacres et des expulsions de masse en Orient se tient là, jusque dans la décennie 1930, et le bilan est abyssal comparé aux pertes heureusement plus restreintes d’aujourd’hui. Avec ce trou noir s’est amorcé le grand reflux qui va croissant depuis. Vieux d’un siècle, il renvoie les grandes puissances à leur part de responsabilité dans la décomposition anarchique de l’Empire ottoman dont les effets délétères continuent de se propager, sous nos yeux, des Balkans à la Mésopotamie.
Entre le XVIIIe et le XXe siècle, l’Europe a appliqué aux chrétiens d’Orient la politique de sujétion découlant de son expérience coloniale, même si enjolivé d’une accointance présumée supérieure. C’est pourquoi, par effet de proximité et de sédimentation, chaque ancienne puissance du Vieux Continent retient volontiers parmi eux un échantillon qu’elle juge exemplaire et dont elle fait un type prééminent ou un interlocuteur privilégié. L’asymétrie est de mise et les distorsions qui s’ensuivent sont prégnantes. Un tropisme auquel la France n’échappe guère.
De François Ier à aujourd’hui, en passant par la IIIe République, nonobstant les variations de régime, Paris s’est exclusivement penchée et appuyée sur les catholiques, statut de fille aînée de l’Église romaine, docile ou rebelle, oblige. L’exception que représente le Liban, pour grande partie une fabrication française, a accru cette tendance. Or les maronites, pour lesquels a été établi l’unique « pays chrétien » du monde arabe, dépourvus de pendant orthodoxe, fortement latinisés depuis les croisades et culturellement tournés vers l’Europe sont les moins orientaux des chrétiens d’Orient. Leur peu de représentativité globale a accentué une représentation imaginaire.
Cette inclination s’étend à la crise actuelle au Levant. Les Français sensibilisés à la question se soucient, à raison, des chaldéens d’Irak qui, unis à Rome, profitent de l’audience que leur procurent diverses associations dédiées–dont l’Œuvre d’Orient, pendant catholique au bureau des affaires religieuses du Quai d’Orsay depuis le Second Empire et qui, comme lui, couvre des uniates levantins aux uniates ukrainiens. Les Grecs-orthodoxes de Syrie, traditionnellement liés à la Russie, ne bénéficient pas de la même attention. On additionne les chrétiens d’Orient en un tout, mais on les traite de manière hémiplégique. Hier par logique d’intérêt. Aujourd’hui, sous le poids de l’habitude. Cette méprise est source de fautes politiques.
Écarter la fiction
Les chrétiens d’Orient existent-ils en tant que tels ? Les hommes et les femmes que l’on nomme ainsi se reconnaissent-ils sous cette appellation ? L’emploient-ils même ? Une telle généralisation présente-t-elle une réelle consistance historique ? Ou relève-t-elle de la facilité coupable ? Générique, le terme escamote l’extrême pluralité que montre, dès que l’on s’y penche, une mosaïque de peuples et de langues, de cultes et de cultures qui sont à la base de communautés de foi singulières, nationales ou transnationales, autonomes ou indépendantes, subordonnées ou non aux trois confessions chrétiennes majeures.
Dans son acception courante, l’intitulé ne recoupe pas la catégorie qui est d’usage dans les milieux savants, en théologie ou en histoire. Dites indistinctement « orthodoxes », les chrétientés orientales d’origine ne sont pas toutes membres de la grande orthodoxie de type gréco-slave qui s’étend également en Europe de l’Est et ce, bien qu’elles lui demeurent mentalement et structurellement apparentées. C’est un lien décisif qu’on oblitère. Parmi ces entités, figurent les Églises afro-sémitique d’Éthiopie et indo-dravidienne du Kerala qui représentent également des exemples d’inculturation et de persécution. Mais on les omet. On ne retient que leurs homologues du Proche-Orient afin de pouvoir mieux les agglomérer en une réalité censément unifiée. Or, ces dernières ne sont pas homogènes. On y compte des communautés récentes, détachées des matrices traditionnelles au cours des sept derniers siècles, avec une nette accélération lors du « Printemps des missions » à la Belle-Époque. Catholiques, protestantes ou évangéliques, elles se distinguent profondément de leurs aînées d’un point de vue canonique ou liturgique tout en partageant les mêmes circonstances sociologiques. D’un côté, l’éloignement géographique sanctionne une césure géoculturelle arbitraire. De l’autre, l’amalgame prévaut au nom d’une conception indistincte des minorités appliquée à des groupes que leur histoire devrait précisément soustraire à la définition et à la condition de minoritaire – un travers manifeste dans l’utile substitut que les médias ont trouvé dans les Yézidis, sujets d’une indéniable urgence humanitaire, mais qui n’engagent ni les mêmes interrogations, ni les mêmes conséquences politiques.
Ces chrétientés n’ont vraiment en commun que le fait d’être toutes attachées à leurs différences et à leurs divergences et qu’elles les pensent le plus souvent comme antagoniques, voire incompressibles. Leur empilement a néanmoins fait du Proche-Orient le seul territoire qui récapitule les divisions advenues en vingt siècles de christianisme et le seul, pareillement, qui présente la palette complète des familles spirituelles et rituelles qui ont éclos entre temps. Le malheur redoublé qui les frappe depuis deux décennies a plus hâté leur rapprochement qu’une coexistence multiséculaire ou l’œcuménisme en vogue ces cent dernières années. Ce front commun, imposé de l’extérieur par l’inimitié, demeure cependant incertain.
C’est que l’histoire interne elle-même des christianismes orientaux se montre conflictuelle. Elle engage les fractures de foi, ayant trait au schisme et à l’hérésie, qui ont rythmé la formation de la tradition chrétienne du premier millénaire. Les facteurs politiques, économiques ou sociaux ont eu leur part dans cet éclatement. Ils n’ont toutefois pas été aussi cruciaux que les convictions dogmatiques. Sans quoi l’existence, la résistance et la permanence de ces communautés seraient inexplicables. Artificielle dans le principe, abusive dans la représentation, la désignation générique ressort en fait de la géopolitique. Et, plus exactement, de la polémologie moderne et contemporaine.
Refuser l’instrumentalisation
Initialement théologique, l’agrégation des chrétiens d’Orient en un tout fictif ne devient usuelle qu’avec les Temps modernes, lorsqu’elle prend un tour politique et sert d’enjeu discriminant entre les mondes islamique et occidental au cours de leurs confrontations récurrentes. Une double prise à partie qui éclaire l’étau fatal d’aujourd’hui en tant que la triangulation initiale est restée inaboutie : tiers indésirable, le chrétien oriental représente toujours un empêchement dirimant pour au moins l’un ou l’autre des acteurs locaux qui le dominent (ainsi du catholique arabe et israélien qui coche chacune des mauvaises cases, confessionnelle, ethnique, citoyenne, au regard de chaque segment de son environnement); mais, tiers victime, il n’a jamais pour sauveurs prédestinés que des oppresseurs objectifs qui refusent de se penser comme tels (ainsi des organisations internationales, musulmanes ou européennes, qui parlent parfois en son nom pour ne pas rater l’occasion de parler d’elles-mêmes). Ce mécanisme que l’on serait tenté d’essentialiser n’a néanmoins rien de fatidique en tant qu’il résulte d’une histoire composite.
L’islam, en ses débuts, a-t-il vu un ensemble organique dans ces populations disparates qui sont tombées sous son joug au fil de huit siècles de conquêtes ? Il n’est d’abord question que de Rum, de « Romains », c’est-à- dire des sujets de Byzance à laquelle l’Oumma entend substituer son propre empire. En tant que « Gens du Livre », les chrétiens participent du statut coranique de la dhimmitude, cette forme d’apartheid religieux qui dispense de la conversion à la condition d’accepter les servitudes et les tribulations afférentes. Mais, hors l’uniformité de ce cadre, les califats arabes entérinent les particularités de leurs nouveaux soumis.
En Occident, sous l’effet de la centralisation romaine, la christianitas latine et médiévale s’emploie pareillement à répertorier chacune des Églises orientales à partir de ses singularités jugées séparatistes. C’est à l’occasion des croisades, concurremment aux notions de « Terre sainte » et de « Lieux saints », que la généralisation fait une première et brève apparition. Elle ne s’impose qu’avec la fin de l’Empire byzantin, après 1453. Privée de répondant, la papauté va développer une politique d’union au coup par coup tout en érigeant les chrétientés orientales en un domaine unifié de savoirs et d’intervention. En fait, elle prend acte de leur intégration complète sous les Turcs, à la seule exception de la Russie tsariste et orthodoxe.
Le pouvoir ottoman, de son côté, systématise le régime de la dhimmitude : ensemble à la fois religieux, administratif et social, le millet détermine l’identité, la citoyenneté et la quotidienneté par l’appartenance confessionnelle. La division favorisant le contrôle, la Sublime Porte multiplie en autant de « nations » chrétiennes les dénominations existantes. Il en résulte en pratique un communautarisme accru qui isole chacune de ces entités, de même qu’une spécification de l’utilité de chacune dans les relations multilatérales avec les puissances occidentales.
Ce fractionnement permet en retour aux États européens de dessiner une politique de relais dont témoignent, depuis Paris, dès le XVIIe siècle, les « échelles du Levant » où le commerce le dispute à l’influence. Elle accompagne, avec l’essor du romantisme, l’émergence du droit des peuples. Les chrétiens d’Orient vont dès lors constituer un sous-chapitre de la question d’Orient et, au XIXe siècle, servir de levier aux empires européens, français, russe et britannique contre l’Empire ottoman. Divisés entre eux, écartelés entre deux mondes hostiles, ils vont se voir partagés entre les puissances censées les protéger, mais elles-mêmes rivales et adverses.
La désignation générique n’est alors effective que chez les orientalistes et les publicistes. Suspendue après 1918, le temps des fabriques nationales, des décolonisations et des indépendances, elle enregistre un regain notable à partir de la guerre du Liban en 1975 qui va s’amplifiant dès les années 1990 sous l’essor de l’islamisme. Retrouvant un emploi polémique après 2001 et les interventions de Washington au Levant, elle est naturalisée consécutivement à l’avènement de Daech en 2013.
Une modification majeure advient cependant, qui a trait à l’essor des deux grands mouvements missionnaires à l’échelle planétaire et d’essence moderne que sont l’islamisme sunnite et l’évangélisme américain. Leur confrontation armée est de type millénariste et la mystique désarmée des chrétiens d’Orient fait d’eux des « hommes en trop ». Les islamistes veulent les éradiquer ; les évangélistes, les absorber. Suppôts ou supplétifs, ils sont condamnés à disparaître.
L’instrumentalisation atteint cette fois, dans le cadre de la mondialisation qui supprime la notion même d’entre-deux, un degré maximal. Ce qui explique l’exode désormais consenti en lieu et place d’une tradition de résistance pluriséculaire. Les tactiques de maintien épuisées, ne subsistent plus que la solitude et la défiance. À l’égard du voisin musulman qui n’arguera pas du primat de la citoyenneté face au djihadiste lui réclamant d’acquitter ses obligations de coreligionnaire. À l’égard du tuteur occidental dont il faudra régler, une fois qu’il sera reparti, la facture de la propagande évangélique et libérale tous azimuts.
Indésirables condamnés à l’humiliation ou stigmates intolérables de l’impiété, signes embarrassants d’une impossible réciprocité ou icônes sacrifiées du martyre par procuration, les chrétiens d’Orient se trouvent plus que jamais piégés dans leur sempiternelle situation d’otages. Aussi ne voient-ils d’issue que la fuite. Qu’il reste quelques-uns des leurs accrochés par grappes à des lieux ancestraux, que ces bantoustans servent à maintenir une présence pittoresque à l’usage du tourisme de masse, ce n’est pas la question. Leur effacement n’est plus une hypothèse, mais déjà une réalité et, par endroits, endémique. C’est cette réalité qui réclame une politique rénovée, cas après cas, avant de pouvoir la ressaisir en totalité.
Agir diversement
Admettre l’erreur
Qu’advient-il de la France qui, à l’orée des années 1980, face au terrorisme ravageant Beyrouth et Paris, renonce à son rôle historique au Liban et, par-là même, envoie un signal de désengagement à l’ensemble des chrétiens d’Orient ? Jusqu’au tournant de 2001, son magistère intellectuel persiste, littéraire, philosophique, mais aussi théologique, l’assise de la francophonie tenant pour beaucoup aux congrégations catholiques. Néanmoins, son influence politique s’effrite. En 2005-2006, seule initiative rompant avec la résignation au déclin, dans la suite du non de Jacques Chirac à la guerre d’Irak, Régis Debray conduit une mission d’État sur les chrétiens d’Orient qui sera étendue, pour complaire à l’Élysée qui ne veut pas déplaire à Bruxelles, au sort régional des minorités.
À Jérusalem, Amman, Beyrouth et Damas, Debray réunit officiels et dissidents, alliés et adversaires de toutes confessions et de tous bords pour traiter du rapport entre tradition religieuse et modernité politique. Sont au menu les principes de liberté de conscience, de citoyenneté de droit et de laïcité de l’État, soit le programme même des chrétiens orientaux et leur apport majeur au progrès des sociétés dont ils participent. La tournée se conclut par la tenue à Paris, les 16 et 17 novembre 2007, d’un colloque international sur leur avenir, en fait ses conditions de possibilité, auquel assistent en nombre patriarches et métropolites exceptionnellement réunis pour cette occasion. Peut-il y avoir alors meilleur soutien de la France ? S’instituer en tiers exigeant afin d’induire la reconnaissance du chrétien oriental comme inhérent et indispensable à l’entier Orient : la ligne Debray est la bonne, la seule légitime et efficiente au sein d’un univers encore relativement stable.
L’entreprise n’avait pas de précédent, pas plus qu’elle n’aura de suite. La correspondance à ce sujet que Régis Debray adresse au président nouvellement élu, Nicolas Sarkozy, restera littéralement lettre morte. L’actualité rattrape cependant peu à peu l’Élysée qui y répond par des mesures symboliques d’accueil, dont en novembre 2010 l’acheminement à Paris, par avion médicalisé, de trente-sept blessés dans l’attentat djihadiste qui a frappé la cathédrale syriaque catholique de Bagdad. Qui refuse le plus fait le moins. L’échéance présidentielle se rapprochant, le 7 janvier 2011, alors qu’il présente ses vœux aux autorités religieuses, Nicolas Sarkozy dénonce « un plan particulièrement pervers d’épuration religieuse du Moyen-Orient. L’outrance du propos qui fait des chrétiens tués en Irak ou en Égypte « collectivement nos martyrs » masque mal l’absence de dessein et ce billet rédigé à l’intention de l’opinion ne se révélera pas gagnant.
Avec l’alternance, sous la présidence Hollande, Paris finit de se disqualifier en s’alignant diplomatiquement comme jamais sur Washington. Déjà ébranlé par la première guerre du Golfe, puis fracturé par la guerre d’Irak, le Proche-Orient implose avec la guerre en Syrie. Au « chaos créateur » voulu par le Pentagone va répondre le « califat restauré » de Daech sur fond d’« islamisation démocratique » promue par les Printemps arabes et de « guerre civile » résurgente entre sunnites et chiites. Or, depuis les années 1990, les Églises constituent une cible privilégiée de la terreur islamiste qui s’assure ainsi d’une certaine impunité et complaisance. Pour la rue musulmane, le chrétien tient lieu de bouc-émissaire à la manière, naguère, du Juif dans les sociétés européennes. Mais, après 2007, les fatwas du futur État islamique dénoncent en lui « un agent objectif de l’Ennemi, du Satan hébreu et croisé ». Selon un schéma apocalyptique, il s’agit désormais de supprimer ce double démoniaque. À l’été 2014, la prise de Mossoul puis de Qaraqosh par Daech sonne le glas pour les chrétiens d’Irak que leurs frères et sœurs à l’entour entendent comme un funeste présage.
La minimisation délibérée de la tragédie des chrétiens d’Orient va caractériser l’inaction de la France sous François Hollande. Les dénégations se succèdent, s’emboîtent et se confortent entremêlant diverses causes. D’abord, l’ignorance du fait religieux en général et la phobie du fait chrétien en particulier qui sont inhérentes à un certain néo-socialisme déculturé. Ensuite, le calcul électoral afin de censément pérenniser un vote musulman rallié lors de la présidentielle, entre autres minorités que la gauche sociétale entend substituer au peuple failli. Enfin, et surtout, l’adoption d’un atlantisme inconditionnel en politique étrangère, le Quai d’Orsay servant d’ultime refuge aux thèses néoconservatrices américaines : l’escalade, entre autres, dans la fraternisation avec le wahhabisme saoudien est telle qu’elle en arrive à gêner Barack Obama.
Les chrétiens d’Orient sont les victimes collatérales du « pas d’amalgame ». Exemples que l’on pourrait multiplier, un tweet du ministère de l’Intérieur recense en juillet 2014 les victimes de la crise du Proche-Orient, à l’exception des chrétiens ; un communiqué du ministère des Affaires étrangères en février 2015 déplore l’assassinat de travailleurs égyptiens en Lybie sans mentionner qu’ils ont été décapités parce que coptes ; soucieux de rattraper la bévue de la RATP qui a interdit la mention «au bénéfice des chrétiens d’Orient» sur les affiches d’un concert parisien, Manuel Valls, en avril 2015, déclare qu’il est impératif de « nommer » ces derniers pour ce qu’ils sont, à savoir « les victimes d’une entreprise d’extermination », mais venant à désigner leurs bourreaux, il s’accommode de mentionner un abstrait et pléonastique « terrorisme effrayant ».
Les tollés qui s’ensuivent, sincères ou feints, forcent le gouvernement à agir. En certificat de solidarité, la place Beauvau reprend la procédure d’accueil aux «minorités vulnérables» d’Irak décidée par Nicolas Sarkozy. Bernard Cazeneuve entérine les maigres visas de réfugiés distribués à Erbil, estimés à trois mille sur le quinquennat, et organise un Noël à l’intention des Chaldéens installés en Île-de-France depuis deux à trois décennies (!). Pour solde de tout compte, dans un accès surprenant de créativité, au Conseil de sécurité des Nations-unies, le Quai d’Orsay, en la personne de Laurent Fabius, fustige le « génocide culturel » (?) commis par l’État islamique. Mais, courant 2016, les postes diplomatiques donnent l’alerte : les primats orientaux-catholiques refusent d’accomplir le voyage traditionnel à Paris. Pire encore, en compagnie de leurs homologues orthodoxes et ex-frères ennemis, ils préfèrent désormais se rendre à Moscou.
C’est que François Hollande a déjà perdu sa guerre là où Vladimir Poutine commence à gagner la sienne. Et, avec, l’adhésion des chrétiens d’Orient qui reprochent à la France l’illusion ou le cynisme qui lui font soutenir, voire armer indirectement ou directement ceux qui demain, en cas de victoire, seraient leurs assassins. Plus que tout, ils condamnent une lecture manichéenne de la situation qui, à leurs yeux, s’apparente à une démission face au réel et aux rapports de force qu’il engage que ce soit avec la Russie, l’Iran, mais aussi le régime syrien dont le socle sociologique, qui s’étend à une partie des classes aisées sunnites, a été largement sous-estimé. Cette fois, le lien est rompu.
Sur le plan intérieur, en parallèle et à partir de 2013, se multiplient les associations qui ont pour objet déclaré la défense des chrétiens d’Orient. Le plus souvent, leurs créateurs, vieux briscards de la manœuvre ou jeunes zélateurs de la contestation, proviennent de la mouvance droitière. À l’instar de leurs aînés des années 1980 qui s’étaient faits les hérauts des phalanges libanaises, ces cadets trouvent dans le désastre du Levant une justification à leurs propres affres et axes militants. Quitte à confondre la survie des Églises qui sont opprimées avec la survivance des régimes qui les ont opprimées, la convergence frelatée des luttes n’étant pas l’apanage des franges gauchistes.
La campagne présidentielle de 2017 aggrave le malaise. François Fillon se saisit des chrétiens d’Orient comme d’un signe de son exception mais sa déroute morale aussi bien qu’électorale dévalorise un peu plus la question. Ce à quoi devrait songer le nouveau chef de file de la droite, Laurent Wauquiez, qui se veut prompt au nom de ses études d’histoire et séjours de jeunesse liés à l’Orient à se porter au-devant d’eux et de leurs malheurs : leur cause est si peu gratifiante que ces chrétiens-là servent incidemment de test gratuit d’authenticité. Sans doute faut-il y voir le motif pour lequel, depuis l’élection, le consensus règne dans la classe politique pour considérer que, dans leur cas, la pétition de principe pourvoit à l’action internationale.
Quelques parlementaires, ouvriers de la première heure et au long cours, continuent de sauver l’honneur dont, pour ne citer qu’eux, le député de gauche François Pupponi, ancien maire de Sarcelles, la deuxième ville assyro-chaldéenne après Los Angeles, et le sénateur de droite Bruno Retailleau qui, probablement avec le souvenir de ses racines vendéennes, a fondé un groupe de liaison diligent et persévérant que soutient le président Larcher. De quoi créditer la chambre haute d’un surcroît de conscience là où la vague des «marcheurs» qui, en juin 2017, submerge l’Assemblée est à porter au déficit des chrétiens d’Orient qui s’évanouissent tout un temps de l’hémicycle avant de n’y réapparaître qu’à leur place prédestinée, c’est-à-dire à la marge.
Plus cultivé que ses prédécesseurs, mais aussi visiblement que ses supporters, Emmanuel Macron lui-même manifeste à l’égard des chrétiens d’Orient, depuis son arrivée au pouvoir, le sens rhétorique de l’à-propos qu’on lui connaît sur d’autres sujets. Quoiqu’à l’occasion. La première lui est donnée le 25 septembre 2017 alors qu’il inaugure en compagnie de son homologue libanais, Michel Aoun, l’exposition que leur a courageusement consacrée l’Institut du monde arabe. Le président de la République joue avec aisance du répertoire des mots-clés et s’engage solennellement : « Je veux dire aux chrétiens d’Orient que la France est à leurs côtés, que notre priorité sera bien la défense de leur histoire ». Dans le même registre de l’obligation sacrée, le 10 avril 2018, il martèle au détour du discours des Bernardins qu’il adresse à l’épiscopat et aux fidèles catholiques de France : « Sacrifier les chrétiens d’Orient, comme le voudraient certains, les oublier, c’est être sûr qu’aucune stabilité, aucun projet ne se construira dans la durée dans cette région.»
Qu’en est-il dans les faits ? Le nouveau pouvoir perpétue les mesures prises par l’ancien sans y avoir pour l’heure ajouté le moindre codicille. Aux dix millions d’euros déjà dépensés en 2015 et 2016 par le Fonds de soutien aux victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen Orient, se sont additionnés les dix autres millions budgétés pour les années 2017-2018 et pareillement consommables en actions humanitaires visant principalement l’Irak et le Liban. Ces deux pays concentrent également l’attention de l’Agence de développement pour des projets circonstanciés aux enveloppes moindres. Le fonds de l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, créée en 2016 à l’initiative de Paris et d’Abu Dhabi, qui siège à Genève et qui est principalement alimentée par l’argent du Golfe, attend la complétion de la contribution financière de la France, par ailleurs minoritaire. Deux subventions, dont la modicité dispense d’indiquer le montant, ont par ailleurs été accordées au titre de la recherche : l’une à des organisations humanitaires pour « la documentation des violations des droits de l’homme commises par Daech » ; l’autre à l’Institut français du Proche-Orient pour l’étude de faisabilité « du recensement et de la cartographie du patrimoine culturel immatériel des communautés ethniques et religieuses affectées par les conflits en Irak et en Syrie ». Enfin, l’État se targue des poursuites pénales engagées par le parquet de Paris à l’encontre personnelle d’acteurs locaux présumés responsables de crimes de guerre, sans plus préciser le calendrier de leur improbable comparution.
Fermez le ban. Un tel programme est-il à la hauteur de la parole d’un président qui assure vouloir incarner le retour de la France dans les affaires du monde ? La vérité est que cette logique de réparation microchirurgicale et déambulatoire, qui tient de l’hôpital en faillite, ne saurait rien réparer. Pour renouer le lien ancestral, il faut renoncer au discours et, encore plus, à l’idée de protection qui, outre son caractère présomptueux et ses parts d’ombre, ne tient plus que de la vignette jaunie. Il s’agit d’accepter l’idée que les chrétiens d’Orient sont devenus l’enjeu d’une confrontation planétaire aux fronts démultipliés dont ils ne constituent pas l’arrière-garde dépenaillée, mais les éclaireurs involontaires. Et d’en tirer, une à une, toutes les conséquences afin de décider d’un véritable plan d’action.
Lutter contre l’extinction
L’urgence devrait obliger à reprendre le dossier dans son épaisseur chronologique tant le premier front n’est pas celui des guerres en cours, mais des guerres achevées. En Turquie, à territoire égal, les chrétiens sont passés d’environ 35% de la population en 1900 à 0,2% en 2000, soit 150.000 individus. Le génocide des Arméniens (1.600.000 victimes) et l’expulsion des Grecs (1.500.000 déportés) ont été suivis de pogroms récurrents et de discriminations constantes. Un reliquat subsiste principalement à Istanbul ainsi que dans le sud-est du pays, qui constitue le sanctuaire historique des Syriaques. Ce sont ces terres où furent décimés leurs aïeux que retrouvent aujourd’hui les réfugiés chrétiens du Levant, de même que, dans le confinement des camps, l’hostilité des musulmans qu’ils ont fuie, tout traitement spécial leur étant refusé.
Dans le reste du pays, le régime islamiste poursuit le programme d’exclusion du régime laïciste, non sans y ajouter ses propres motifs confessionnels : significativement, Recep Erdoğan menace régulièrement de retransformer la basilique-musée de Sainte-Sophie en mosquée. Tout à son projet d’instaurer une politique étrangère néo-ottomane sur la base idéologique des Frères musulmans, il ne manque pas de désigner le christianisme comme l’inconscient de l’Occident et l’ennemi, en conséquence, du monde musulman.
L’immixtion de la Diyan et, l’organe public en charge des affaires religieuses, est totale dans la vie des Églises : tout candidat arménien à l’épiscopat doit ainsi professer son loyalisme par une déclaration préalable de négationnisme. Ultime témoin de Byzance, primat de 230 millions d’orthodoxes à travers le monde, le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, continue de voir ses droits niés par l’État turc. Or, le siège de Constantinople garde un prestige intact sur l’ensemble des chrétiens d’Orient et représente un rempart utile, à l’échelle universelle, contre l’influence rémanente de Moscou. La reconnaissance du caractère international du trône oecuménique, la réouverture de son université théologique de Halki, fermée depuis 1975, et l’affaire chypriote, sont urgentissimes. C’est sans doute la raison pour laquelle Bruxelles renâcle à en faire un impératif dans ses négociations avec Ankara : l’abandon est acté.
La comparaison entre l’univers sunnite turc et l’univers chiite iranien est de ce point de vue accablante. Assyro-Chaldéens depuis l’Évangile et Arméniens depuis le XVIIe siècle, les chrétiens de Perse, valorisés sous les Shahs Qadjar et Pahlavi, ont connu une hémorragie de plus de moitié après la révolution de 1979, passant respectivement à 50.000 et 200.000 individus. Soit, ajoutés aux autres confessions, dont les évangéliques, moins de 1% de la population. Si leur sort s’apparente à celui de leurs concitoyens, plus les limitations et vexations appliquées aux minoritaires, la République islamique garantit la liberté de culte à ces deux christianismes et leur réserve une représentation au parlement. Elle y trouve son intérêt : les Assyriens renforcent le caractère national propre tandis que les Arméniens consolident la relation avec Erevan qui constitue le premier étranger immédiat et accessible pour la jeunesse iranienne, particulièrement en termes de coopération universitaire.
Ainsi, par un paradoxe qui n’est qu’apparent, un régime s’affichant démocratique et candidat à l’Union Européenne s’attache activement à faire disparaître la même diversité qu’un régime autoritaire et anti-occidental ne décourage pas, à tout le moins, systématiquement. Ce chassé-croisé participe d’une logique d’aveuglement dont le troc financier de Bruxelles avec Ankara sur l’endiguement des réfugiés est tristement symptomatique. Il a pour corollaire la suspension de la bataille juridique sur le statut et les libertés des communautés non-musulmanes en Turquie. Or, leur émancipation est intimement liée à celle des communautés musulmanes partageant le même sort, dont les 10 à 15 millions d’alevis qui sont d’inspiration chiite et libérale. Elle devrait être prioritaire.
Assurer le maintien
Malgré la différence de leur dominante confessionnelle, les chrétiens d’Irak et de Syrie partagent une histoire similaire et font face au même état de guerre et de dévastation. Pareillement, ils sont exclus de toute participation au règlement du conflit, fait d’autant plus grave qu’ils ont été dans ces deux pays des contributeurs majeurs à la construction intellectuelle d’une conscience nationale ouverte dont ils demeurent les meilleurs théoriciens et partisans.
Majoritairement chaldéens et syriaques, les chrétiens étaient 1.000.000 en 1980, 600.000 en 2005 et sont tout au plus 300.000 aujourd’hui en Irak. Le gommage des héritiers de l’araméen, la langue du Christ, au pays d’Abraham est en cours. Mis en avant par le pouvoir baasiste et sunnite de Saddam Hussein dont le ministre des Affaires étrangères, Tarek Aziz, faisait partie, ils ont été exposés, après 2003, à l’ostracisme. En 2007, George W. Bush avait pensé les concentrer en une sorte de bantoustan dans la plaine de Ninive qui aurait été vite transformé en charnier, projet que le pape Benoît XVI et la diplomatie vaticane avaient su empêcher. Fuyant vers le nord, ils ont trouvé un refuge fragile auprès des Kurdes qui furent hier leurs oppresseurs et les utilisent désormais comme faire-valoir pour s’assurer le soutien de l’Occident. C’est pourtant du pouvoir de la majorité chiite que dépend l’avenir des Chaldéens d’Irak, particulièrement des autorités religieuses et du mouvement de réconciliation porté par l’ayatollah al-Sistani qui, en représentant éminent de l’authentique tradition duodécimaine, prône la séparation des pouvoirs spirituel et temporel.
En Syrie, la mosaïque se complexifie. Le sunnisme rallie un citoyen sur deux, nonobstant d’importantes fractures internes d’ordre social et politique qui en font un corps divisé. Les islams minoritaires qui se décomposent en alaouites, druzes, ismaéliens et chiites s’en départagent naturellement et regroupent deux à trois Syriens sur dix. Quant aux chrétiens, principalement de tradition syriaque et byzantine, avec une prépondérance intellectuelle grecque-orthodoxe d’où est issue l’idéologie panarabe, ils sont passés de 20% de la population en 1900 à 15% en 2011, soit encore 1,2 million d’individus. À la suite du déclenchement des hostilités, sur les trois années 2012, 2013 et 2014, un quart à un tiers d’entre eux ont fui le pays, dont 150.000 environ pour rejoindre le Liban. Ils se maintiennent aujourd’hui à 8% estimés, mais sont pour l’essentiel déportés sur l’ensemble du territoire.
Les chrétiens de Syrie ont longtemps bénéficié des faveurs du pouvoir alaouite, lié comme les autres hétérodoxies musulmanes locales au chiisme et qui, lui-même minoritaire face à la majorité sunnite, a développé un front des minorités soumis à son emprise despotique. Les différentes Églises historiques ont ainsi souscrit à ce pacte de dépolitisation, l’État leur garantissant en échange une liberté de culte, une vie communautaire et une visibilité culturelle, sans grande comparaison cependant avec les siècles passés ou les régimes voisins.
Entre la tyrannie d’Assad et la barbarie de Daech, les chrétiens ont massivement opté pour la loyauté au régime, sans illusion sur sa nature mais selon une logique de survie par ralliement qu’ils devraient poursuivre géographiquement en cas de partition. L’incompréhension qu’a rencontrée leur attitude dans l’opinion occidentale les a confortés dans la conviction que leur salut tient à la convergence entre l’arc chiite et l’interventionnisme russe.
Pour les chrétiens en Irak comme en Syrie, le soutien de l’Europe se résume à un programme d’aide à la reconstruction dont ils savent qu’il est payé par les monarchies pétrolières du Golfe, lesquelles financent par ailleurs l’islamisme. Au lieu d’assumer leurs devoirs historiques, les anciennes puissances mandataires se satisfont d’une assistance qui relève d’ordinaire des fondations caritatives. Mais, publique ou privée, la restauration de son village ne cause jamais, chez le chrétien concerné, qu’un plus grand empressement à rejoindre l’un ou l’autre de ses cousins par-delà les mers. Il sait, lui, qu’en l’absence d’une charte internationale qui serait militairement garantie par un déploiement de troupes au sol, on lui prépare un mausolée.
Sur la question du départ, les fidèles d’Irak s’opposent profondément à leur hiérarchie, le décalage étant moins notable en Syrie. Dans ces deux pays, de manière marginale et principalement en milieu assyrien, on voit se former des milices combattantes. Très maigres en nombre, elles ne dérogent pas moins au principe ancestral de non-belligérance dont les chrétiens ont su user à leur avantage et elles amenuisent la capacité qui leur est reconnue d’être les seuls ou presque à promouvoir l’intérêt général. De fait, ces groupes armés se trouvent vite inféodés à l’une ou l’autre des factions en présence principalement des Kurdes. Les peshmergas prélèvent ainsi l’impôt du sang sur leurs protégés supposés, mais qui le sont moins hors des grandes villes et du champ des caméras. Sous couvert d’autodéfense, ces milices manifestent cependant une évidence : sans recours à la force, il ne saurait y avoir de maintien consistant des chrétiens au Levant. Ce principe valant autant, voire plus, si ladite force ne relève pas d’un clair mandat international.
Seconder les mutations
Depuis un demi-siècle ou presque, le Liban voisin a cessé de croire que sa constitution communautariste pouvait fonder une coexistence apaisée. En 1975, sous la pression palestinienne, l’oligarchie maronite, animée par une idéologie nationaliste et occidentaliste tout droit sortie des années 1930, déclenche, selon ses propres termes, une « croisade » censée réaffirmer « l’exception du seul pays chrétien » de la région. La guerre civile aboutit au malheur des chrétiens orientaux dans leur entier. Elle vient abonder le procès en insincérité dont l’islamisme charge le « cheval de Troie » de l’arabité dès lors qu’elle n’est pas musulmane tandis qu’en Europe, les ultras prennent exemple du contre-exemple maronite pour appeler à un Armageddon religieux. Résultat, aujourd’hui, le Liban n’a plus de chrétien qu’une minorité angoissée, de maronite qu’une marge divisée, de démocratique qu’un régime périmé – et de « protection » française qu’une vague protestation d’amitié conjuguée au passé décomposé.
Les chrétiens ont perdu leur majorité historique pour s’établir à environ 42% de la population. L’exode leur est depuis longtemps naturel : deux ressortissants libanais sur trois vivraient aujourd’hui en diaspora, un sur quatre selon les registres électoraux mais qui, sept fois sur dix, est un baptisé. Pour autant ce chrétien n’est pas uniforme. Il ne l’est ni cultuellement, ni culturellement, les divisions ecclésiales valant aussi politiquement.
Les événements ont donné raison aux Grecs-orthodoxes, seule communauté à n’avoir pas armé de milice en propre durant la guerre civile, au nom d’un certain républicanisme et d’une arabité assumée. C’est ce socle que tend à rejoindre aujourd’hui la jeunesse maronite. Mais au moment où la fracture traditionnelle entre les différentes confessions chrétiennes s’estompe, les rivalités intra-musulmanes prennent le relais. Le camp maronite est ainsi divisé entre les pro-chiites de Michel Aoun et les pro-sunnites de Samir Geagea.
Par-delà les opportunismes et les arrangements locaux, cette partition est hautement significative et se vérifie depuis que des millions de réfugiés aggravent le déséquilibre : le Liban, théâtre sempiternel des guerres régionales et des conflits internationaux, garde aujourd’hui son intégrité territoriale non pas grâce à l’armée régulière mais grâce au Hezbollah. Aussi dérangeant que puisse paraître ce fait, il précise combien, pour les chrétiens décidés à rester sans plus se référer à un protecteur extérieur et éloigné, l’alliance des minorités sous l’égide d’un chiisme lui-même minoritaire et en cela plus ouvert à l’altérité représente une des rares perspectives d’avenir. Cette mutation ne peut pas ne pas être prise en compte. Elle oblige la France à revenir à une conception multipolaire de la présence chrétienne au Proche-Orient.
Contraindre les faux-semblants
Dans le royaume de Jordanie, souvent cité comme exemple de libéralité, l’inégalité demeure prégnante. À dominante grecque-orthodoxe et grecque-catholique (melkite), les chrétiens y bénéficient en principe de la protection de la dynastie hachémite qui se veut la championne du dialogue interreligieux. Pour autant, leur croissance en nombre (400.000) et en proportion (5%) est principalement due à l’afflux de populations palestiniennes suites aux guerres de 1948, 1967 et 1973. Mais leur participation à la vie politique reste limitée ainsi que leurs particularités sociales minimisées. La crise des réfugiés souligne la précarité de la monarchie qui leur offre ce havre relatif, prêt à craquer sous la nette percée d’un islamisme local virulent. Seul le Vatican continue de privilégier la Jordanie comme un relais diplomatique au regard de ses droits historiques sur Jérusalem bien que les revendications d’Amman aillent en s’atténuant et ne revêtent plus qu’une forme de protestation symbolique.
En Terre sainte précisément, pour l’essentiel orthodoxes, melkites et latins, les chrétiens autochtones ont, un temps, configuré le militantisme palestinien. Ce n’est plus le cas ni à Gaza où le Hamas encadre leurs 1000 derniers représentants, ni en Cisjordanie où ils culminent à 50.000 individus, soit 1,5% de la population. En Israël, ils sont 160.000, soit 2%, pris entre un État de droit favorable et une situation politique et économique contraire. L’État hébreu intégrerait volontiers les Arabes chrétiens au partenariat qu’il réserve aux Druzes, une perspective qu’ils disent refuser par solidarité avec les autorités de l’Autonomie palestinienne tout en les jugeant inefficaces et, pour partie, corrompues.
À l’instar de Bethléem et Nazareth, passées en 80 ans d’un ratio de 90% à 10%, Jérusalem se vide désormais de ses chrétiens. Son statut particulier, alors que la vieille ville demeure disputée entre les différentes confessions se référant l’Évangile, est inquiété par Israël, menacé par les capitales islamiques et désormais dénié par les États-Unis. Le risque de muséification est certain tandis que l’apparition d’un christianisme hébréophone et sioniste d’implantation locale, qu’a rendue possible l’immigration juive d’ex-URSS, ajoute potentiellement à un rare état de morcellement.
En Jordanie et dans les Territoires, les principes de droit commun devraient devenir des faits d’égalité réelle. Ou, à tout le moins, s’en rapprocher. On en est d’autant plus loin que les diplomaties occidentales se satisfont de leur affichage sans questionner leur effectivité. En Israël, la question de l’internationalisation des Lieux–saints et d’une révision équitable du statu quo est vitale. Elle ne pourra se faire sans la concertation des autorités ecclésiastiques locales, c’est-à-dire sans l’appui de leurs centres. Ce serait un enjeu pour la France, apte à assurer son retour dans la région. Mais encore faudrait-il que l’appareil diplomatique se fasse une idée du traitement religieux qui est à appliquer aux affaires politico-religieuses.
Enfin, le drame global des chrétiens d’Orient se déroule sous nos yeux, de manière accélérée, en Égypte. Copte de manière écrasante, le christianisme au pays des pharaons constitue la première minorité du monde arabe. Entre les 5% annoncés par l’État et les 20% revendiqués par l’Église, ils représentent environ 10% de la population, soit 8 millions d’individus. En dépit de ce matelas sociologique, leur exode s’avère notable sous le coup des difficultés quotidiennes où se mêlent discrimination sociale, paupérisation économique et marginalisation politique. À quoi s’ajoutent, depuis la fin des années 1980, les attentats islamistes qui les frappent de manière intensive et restent en grande partie impunis.
Les coptes sont les grands perdant de la modernisation qu’ils ont promue avec l’indépendance. Résolument patriotes, producteurs d’élites intellectuelles, ils mènent également, au début du XXe siècle, une vaste réforme religieuse. Mais, au milieu des années 30, à la faveur de la crise économique qui frappe l’Égypte, les coptes, de moteurs, passent au rang de profiteurs. Ils opposent à la méfiance et au rejet grandissant des musulmans à la fois le renchérissement nationaliste et la revendication particulariste. En réponse à la montée de l’islam politique des Frères musulmans, ils commencent à former leurs propres mouvements communautaires.
En 1952, le putsch de Nasser met fin à l’espoir de l’intégration. L’idéologie de «l’égyptianité» ne survit pas au panarabisme dont le socialisme ethnicisé se nourrit de fortes références à l’islam. La nationalisation des biens et l’abolition des partis privent les coptes d’influence publique, tandis qu’ils sont à nouveau l’objet de toutes sortes de discrimination. Pour contrer cette marginalisation, ils vont réaffirmer leur spécificité religieuse au risque de s’y enfermer. L’exaltation de la piété, dès lors, l’emportera sur la contribution politique ou culturelle.
À partir des années 1970, l’islamisation rampante que promeut Sadate conforte le militantisme du pape Chenouda III (1971-2012) qui rivalise en chauvinisme avec le pouvoir politico-militaire et en rigorisme avec les organisations islamiques. En 1981, la charia ayant été introduite dans la Constitution, Chenouda entre en conflit ouvert avec Sadate qui le destitue et le relègue avant qu’Hosni Moubarak ne le réinstaure sur son siège en 1985. Cette crise a pour effet de désigner les coptes à la vindicte populaire et à la vengeance des islamistes. Émeutes, kidnappings, spoliations, meurtres, puis attentats se succèdent au cours des deux décennies suivantes sans que l’État n’assure sa mission de protection, forçant ainsi l’Église à une position attentiste d’accommodement et de compromis. L’exode s’accélère tandis que le terrorisme islamiste redouble, trouvant en Égypte un lieu emblématique pour sa stratégie de tension et dans les coptes un point de mire pour sa logique d’épuration.
Une fois Moubarak destitué, la jeunesse chrétienne s’engage contre les islamistes dont l’arrivée au pouvoir en 2011-2012 est légitimée par Washington. Cet élan politique subit l’éteignoir de la reprise en mains qu’opèrent les militaires en 2013. Le pape nouvellement élu, Tawadros II, s’efforce de sortir de l’ornière communautariste tandis que le maréchal al-Sissi rejoue, non sans quelque application, l’air de l’unité nationale. Toutefois sa marge est étroite puisqu’il est condamné à favoriser les salafistes afin de contrer les Frères musulmans au sein des classes populaires. Or, pour être en majorité quiétistes, ces mêmes salafistes ne supposent pas moins indue la présence chrétienne.
Les chiffres le disent sans ambages : on estime à 15.000 le nombre des coptes qui, chaque année, se convertissent à l’islam sous l’effet d’une contrainte directe ou indirecte. Ils seraient 400.000 à avoir gagné l’Amérique du Nord et 50.000 à s’être installés en France. Amplifiée par le différentiel démographique, la configuration est létale à l’horizon de quelques décennies. Prisonniers du chaudron fondamentaliste qu’est devenue l’Égypte, suspendus à un État incapable de garantir leur sécurité minimale, les coptes partent de manière croissante même si pour l’heure l’épaisseur de leur nombre tend à masquer cette tendance inquiétante. Leur état redoutable de transition, vers on ne sait ni quoi ni où, vient compléter et uniformiser le tableau tragique qui encadre tous les chrétiens d’Orient.
Reprendre l’initiative
Assumer la prépondérance
Que peut faire la France ? La description, pays après pays, signale toutes sortes de démarches bilatérales en déshérence et qui restent à entreprendre. Des mesures globales sont néanmoins à décider pour autant qu’il existe une volonté politique de ne pas céder devant l’apparente fatalité, de rompre avec une logique d’aveuglement menant au renoncement et de renouer, contre l’instantanéisme des droits de l’homme, avec une diplomatie du temps long, consciente des facteurs et des enjeux civilisationnels. En cela, une telle vision engage pour objectif plus large d’influer sur le devenir de l’islam et des Islams, sur leurs convulsions durables et leurs possibles désenclavements.
Aussi programmatique que puisse paraître leur présentation, voici ces mesures brossées dans leurs grands principes, étant entendu que dans leurs intitulés et leurs périmètres elles devront inclure, chaque fois que requis, le souci des autres minorités et leur étendre les mêmes mesures ou d’autres, similaires et appropriées.
Tout d’abord au plan national :
- Instaurer une coordination de l’ensemble des ambassadeurs auprès des pays concernés du Proche-Orient sous l’égide de l’ambassadeur auprès du Saint-Siège, poste vital d’information pour autant qu’il soit pourvu de façon qualifiée.
- Nommer un haut-commissariat rattaché à Matignon et de constitution interministérielle (Affaires étrangères, Intérieur, Éducation nationale, Culture) doté des moyens d’investigation et d’action adéquats.
- Organiser et accueillir à Paris une assemblée générale des primats religieux et des responsables laïcs des Églises et entités ecclésiales réunissant toutes les confessions pour un séminaire fermé afin de garantir la libre expression des participants et, avec pour ambition, de les constituer en réseau permanent.
Ensuite, toujours à l’initiative de Paris, au niveau européen :
- Créer une mission permanente de l’Union européenne à partir de la représentation parlementaire afin de peser sur l’inertie des institutions et de l’appareil technocratique.
- Définir une politique sérielle d’accueil aux réfugiés valable pour tous les pays membres qui, tout en refusant d’être discriminatoire à l’égard des autres migrants issus de populations majoritaires ou minoritaires, n’éludera pas pour autant d’évidentes spécificités en termes de besoins immédiats et d’aides stabilisantes.
Enfin, depuis l’Élysée, à l’échelle de la communauté internationale, dans le cadre des Nations-unies et du Conseil de sécurité :
- Constituer une Cour pénale relative aux crimes contre l’humanité, crimes de guerre et autres crimes, dont les inégalités et discriminations, ayant juridiction sur la région proche-orientale en totalité.
- Instruire une charte des droits, dont ceux du maintien et du retour, ouverte à la souscription de tous les États, à commencer par ceux impliqués.
- Planifier un processus de sécurisation appuyé par le déploiement de forces armées sous mandat.
De telles mesures seraient-elles efficaces ? Plus ou moins, leur intérêt direct étant d’apporter une réassurance propice à la création d’un mouvement de résistance à l’entropie aujourd’hui inexistant. Sont-elles irréalistes ? Peut-être, mais sans rapport avec l’irréalisme foncier qui fait accepter, par impuissance, l’éventualité qu’une partie du monde soit durablement abandonnée aux fanatismes dont, au premier rang, l’islamisme sunnite. Le combat pour les chrétiens d’Orient ne se distingue pas, en cela, d’une lutte pour la diversité dans tous ses états.
Voir hier pour prévoir demain
Cependant, l’intégration de ces mesures n’est pas tout. Elles se résumeraient vite à peu si elles n’étaient pas menées avec méthode. Les lieux et les temps disposent d’un droit de suite en géopolitique dont on ne peut abstraire le fait religieux, envisager des actions durables réclame de méditer le caractère irréductible de nœuds constants. Invariablement depuis des siècles, les chrétiens d’Orient se sont tenus sur trois limes qui ont distribué le partage du monde. Ce passé continue à gouverner le futur ou doit, à tout le moins, animer la vision que l’on peut chercher à en formuler.
La plus proche de ces marches, millénaire, a opposé la première à la troisième Rome, Moscou, par le truchement de la deuxième, Constantinople. Dès le IXe siècle, autour de l’évangélisation des Slaves, s’est cristallisée la scission entre les deux Europes, occidentale et orientale. La dispute sur la translation de l’Empire romain a ainsi causé une ligne de fracture courant de la Baltique à la Méditerranée et zigzagant de Riga à Split. Sur cette frontière se sont affrontées les missions carolingienne et byzantine, les Églises latine et grecque, les empires centraux et périphériques, ainsi que les diverses coalitions réunies lors des deux guerres mondiales. C’est autour d’elle que se sont agrégées puis désagrégées la Yougoslavie ou la Tchécoslovaquie, que s’est articulée la coulée verte aménagée par l’occupation ottomane, mais aussi que se divise aujourd’hui l’Ukraine qu’elle traverse en son centre. C’est encore en vertu de cet axe que la Crimée a déjà provoqué une croisade au mitan du XIXe siècle sous le prétexte de rixes entre moines orthodoxes et catholiques en Terre sainte. Les acteurs internationaux et locaux sont aujourd’hui les mêmes, l’enjeu crucial demeurant la domination de l’arc double reliant les Balkans au Caucase et au Levant.
Autre tracé de fracture, le Caucase, précisément, porte de l’Asie, a été le théâtre des guerres entre Parthes et Romains, Sassanides et Byzantins, Ottomans et Russes. La ligne frontière, qui le scinde en deux de la mer Noire et à la Caspienne en passant par le Haut-Karabagh, sépare aujourd’hui la Géorgie et l’Arménie, bastions du christianisme oriental, des républiques musulmanes où se concentre l’islam actif et activiste de la Fédération de Russie – suite à la poussée du fondamentalisme wahhabite, instrumentalisée sans doute mais ni engendrée, ni souhaitée par le Kremlin. Verrou et passoire, ce foyer interne de fondamentalisme et de terrorisme constitue aussi une plate-forme d’exportation pour le salafisme et le djihadisme venus du Moyen-Orient, via les républiques turcophones, à destination des Ouïghours de Chine.
Enfin, troisième limes, la ceinture occidentale de la Perse a toujours formé un sas infranchissable pour l’Empire romain, puis pour l’Empire byzantin dont l’expansion s’est immanquablement arrêtée à hauteur de l’actuelle Kirkouk, carrefour traditionnel des invasions. L’Empire ottoman, sunnite par obligation, ne dépassera cette ligne qu’au prix de guerres et de concessions le forçant à reconnaître l’influence de l’Empire safavide, chiite par conversion, sur la région. C’est à cette ligne que se cantonne présentement la politique américaine de « pacification », vite repliée au Nord, et qui barre le regain d’ottomanisme que manifeste la Turquie dont les ambitions sur place, généralement diplomatiques et parfois militaires, se compliquent du foyer séparatiste qu’y ont constitué les Kurdes et qui sert de refuge aux Chaldéens d’Irak. Enfin, cette même ligne terrestre se continue de manière maritime à travers le golfe Persique en direction de l’Inde où un musulman sur trois est chiite et où les chrétiens de tradition syriaque sont majoritaires dans l’État côtier du Kerala.
Sur chacun de ces nœuds, les chrétiens d’Orient représentent une pointe avancée. Sur chacun de ces points également, l’autre Europe qu’est la Russie et l’autre islam qu’est l’Iran mènent grand jeu. Sur chacun de ces points enfin, preuve que le sursaut est toujours possible, la diplomatie vaticane ne cesse d’avancer et de créer des ponts inespérés.
Toutefois, ignorant la grammaire du passé afin de se comporter comme le meilleur allié de l’Amérique et du monde sunnite, Paris a délibérément nié ces réalités primordiales au cours des deux dernières décennies, celles précisément consécutives au tournant du 11 septembre 2001. Comme si traiter le réel pour ce qu’il est revenait à l’approuver ou comme si le démentir par les mots suffisait à l’annuler dans les faits. La France a commencé de payer le prix de ses errances par une absence flagrante à la table des négociations sur l’avenir de la Syrie sur laquelle elle avait eu mandat au siècle dernier. Il n’y a aucune raison que ce dévissage ne s’arrête à moins d’un effort de lucidité, à moins qu’elle n’assume à nouveau les devoirs que lui commande son histoire et qu’elle n’en propose une vision rénovée.
Il y va aussi, plus profondément, de la vocation de la France et de sa permanence à être « la voix des sans-voix ». Ne concevoir d’autre avenir pour les chrétiens d’Orient que d’être des « riens » en Occident équivaudrait à approuver le choc des civilisations comme le seul futur de l’humanité globale et à abandonner les musulmans à l’enfermement, à la guerre civile, à la déréliction, alors que c’est d’eux dont il est ultimement question ainsi que le savent et le disent les meilleurs des chrétiens d’Orient qui ne sont prêts ni à partir, ni à se départir. Une telle démission française reviendrait à apposer un paraphe vague et brouillon en bas du protocole consignant le suicide moral de l’esprit européen.

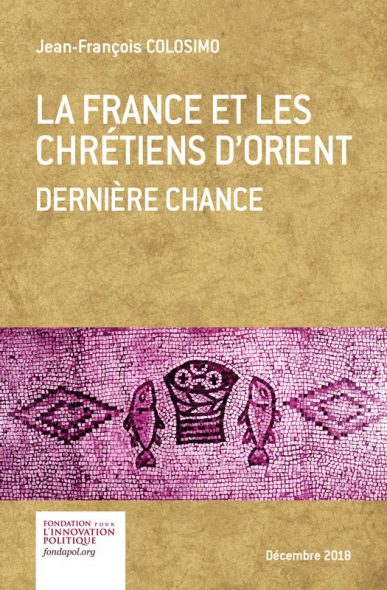











Aucun commentaire.