La responsabilité
Les deux piliers de la responsabilité.
Responsabilité et autonomie
Autonomie et indépendance.
Responsabilité et culpabilité.
Responsabilité et sanction
L’État préventif
Conclusion : pour une solidarité assurantielle
Que l’idée de responsabilité soit une des valeurs-clés des sociétés démocratiques, c’est l’évidence. Elle est la condition du respect de la dignité de la personne humaine et, par là même, des rapports non-écrits de civilité ; elle est au fondement des engagements passés au titre des contrats civils ; elle est garante enfin de la confiance à l’égard des institutions administratives et politiques, sur le plan intérieur comme dans le vaste champ des relations internationales. Cette idée pourtant est de formulation tardive. Pour être centrale à l’organisation des sociétés modernes, elle n’apparaît, dans les langues européennes, qu’à la fin du XVIIIe siècle (1783). Selon le philosophe du droit Michel Villey, « sa vraie carrière ne commence qu’au siècle suivant ». Certes, la première occurrence du mot « responsable » dans notre langue remonte à 1284. Il s’agit d’un renvoi au latin respondere, qui signifie « se porter garant » d’un contrat matrimonial. Spondere, en droit romain, signifie prendre un engagement solennel, plus particulièrement par les fiançailles ou le mariage (d’où le verbe « épouser », qui dérive de la même étymologie). La racine grecque du mot désigne le rite de la libation, plutôt que l’acte d’engagement lui-même, tel que la signature d’un traité. Le caractère religieux de cette racine est confirmé par l’emploi du verbe respondere, dont le sens premier est l’engagement en retour, le pacte, contracté entre le fidèle et l’oracle qu’il a consulté. On est loin, avec cette référence d’origine religieuse, de l’idée d’une capacité morale inhérente à la personne. Aussi bien l’Église n’a-t-elle d’abord connu dans la faute que le substitut du péché, dont la réparation est due au regard de la volonté divine, dans la perspective du salut. Selon ce schéma anthropologique, la notion de « réparation » est inséparable du postulat de la perfection de la Création et, pour expliquer l’existence du mal, du dogme de la réversibilité des mérites et des peines qui s’ensuit. Il faut attendre le phénomène que Paul Hazard a appelé « la crise de la conscience européenne », à partir de la fin du XVIIe siècle, pour qu’émerge, de Leibniz à Kant en passant par Rousseau, l’idée de l’inscription dans la conscience individuelle d’une volonté autonome, distincte de l’ordre du monde, et engageant la responsabilité de l’individu.
Les deux piliers de la responsabilité.
Il n’est pas inutile, pour la clarté du propos esquissé ici, d’en résumer en quelques pages l’articulation et l’argumentaire avant d’entrer dans sa démonstration. Tardive, l’idée de responsabilité a été obscurcie par la difficulté avec laquelle elle s’est dégagée de ses sources religieuses. On peut même se demander si elle s’en est jamais affranchie, et si elle n’est pas sur le point d’y revenir dans un climat général de crise de la légitimité démocratique, qui voit revenir au premier plan une critique des Lumières proche des thèmes de la contre-révolution : cette hypothèse sera, sur un sujet aussi vaste que complexe, le fil conducteur des pages qui suivent. L’atroce supplice de Damien, coupable d’avoir défié le Cosmos en portant à Louis XV un coup de canif, inspirait encore à Joseph de Maistre, un des pères de la pensée contre-révolutionnaire, dans le premier entretien des Soirées de Saint-Pétersbourg, publiées après sa mort en 1821, la fameuse métaphore du bourreau : « Toute grandeur, toute puissance, toute subordination repose sur l’exécuteur ; il est l’horreur et le lien de l’association humaine. Ôtez du monde cet agent incompréhensible ; dans l’instant même l’ordre fait place au chaos, des trônes s’abîment et la société disparaît. Dieu, qui est l’auteur de la souveraineté, l’est donc aussi du châtiment ; il a jeté notre terre sur ces deux pôles : car Jéhovah est le maître des deux pôles, et sur eux il fait tourner le monde. » Aujourd’hui, à coup sûr, aucun juriste ne s’exprimerait ainsi ! Mais, la cruauté physique en moins, le pilori planétaire rendu possible par la médiatisation des grands procès du village global n’est pas si éloigné de la stratégie cathartique du bouc émissaire que ce texte rappelait il y a près de deux siècles. Tout se passe comme si, en dépit ou à cause de l’abandon quasigénéral de la peine de mort, le contenu prêté à la notion de responsabilité dans les sociétés démocratiques accompagnait, dans un sens régressif aussi bien que progressif, les fluctuations, les doutes, les tensions, les rechutes qui ont marqué et caractérisent encore les avancées et les reculs de l’idée de laïcité chez les Républicains actuels, de nouveau hantés par leur rapport à Dieu. Au point même que, aujourd’hui, la question se pose de savoir si le phénomène souvent analysé comme une « crise » de la responsabilité à tous les niveaux – individuel, civil et politique –, ne doit pas être plutôt interprété comme un retour à la conception holiste – totalisante – dans laquelle la société, substituant sa vigilance à celle de la conscience individuelle, retrouverait, toutes choses égales par ailleurs, la place dévolue à la « divine providence » avant la révolution des Lumières. On s’efforcera de poursuivre cette démonstration sur deux plans, en analysant la relation entretenue par l’idée de responsabilité avec les deux concepts dont elle est inséparable. Le premier est la notion moderne d’autonomie individuelle, apparue au XVIIIe siècle, et à laquelle elle donne son sens. Une première ambiguïté, à cet égard, devra être levée : il est faux que l’on ne soit d’abord responsable que de soi-même ! Autant que juridique, la responsabilité est un concept politique. Une autre incertitude, liée à la première, pèse sur les notions de responsabilité collective – gouvernementale ou nationale – et de responsabilité sans faute. S’il est devenu banal d’invoquer les effets pervers de ces deux notions comme des facteurs importants de la « crise » de la responsabilité à l’époque contemporaine, il faut toujours se rappeler qu’il n’est pas d’autonomie du sujet qui puisse être pensée sans la prise en compte du libre engagement par ce dernier d’une responsabilité qui ne le concerne pas seulement lui-même. En sorte que, contrairement à une idée reçue, le fait pour l’individu de s’affirmer autonome n’est pas a priori incompatible avec les notions de responsabilité collective et de responsabilité sans faute, en apparence contradictoires dans les termes, mais contenues en puissance dans les articles 1382 et suivants du Code civil. La plupart des ambiguïtés et des prétendues ruptures qui obscurcissent l’usage contemporain de la notion d’autonomie sont les conséquences de l’oubli du lien indissociable qui rattache celle-ci à la notion de responsabilité depuis les Lumières. L’autonomie se voit de plus en plus fragilisée par l’évolution du droit, en réponse à des demandes communautaires qui contestent l’individualisme démocratique, mais qui affirment leur droit à la reconnaissance au nom du pluralisme, sans voir que leur revendication identitaire rejoint les fondements psychologiques du holisme. Il s’agit là de formes d’aliénation dont les remèdes sont à rechercher dans l’éducation et dans le droit. Le second concept inséparable de la notion de responsabilité individuelle est la sanction. De même que la capacité de chacun d’assumer donne son sens à la notion moderne d’autonomie, la sanction est la règle qui détermine et conditionne l’exercice de cette responsabilité. En principe, la sanction, au sens classique du mot, vise à assurer pénalement le respect d’une obligation juridique et intervient donc après la commission de la faute, ou du dommage. Or elle s’étend de plus en plus, et de façon systématique, en amont de la faute ou du dommage, en constituant la prise de risque elle-même comme un délit. Elle conduit ainsi un nombre croissant de règles pénales à normaliser des conduites qui relèvent en principe du libre arbitre, et qui étaient, de fait, régulées naguère par des codes non-écrits de civilité. L’immense question ici posée, et soulevée par Bentham dès le début du XIXe siècle, est celle de la possibilité pour l’individu d’intérioriser un comportement responsable, de prendre des risques et de les assumer, dès lors que la protection de sa sécurité et sa propre capacité de nuisance sont encadrées par des normes qui semblent, selon le mot de Tocqueville, chercher à lui épargner « jusqu’à la peine de vivre ». Dans ce mouvement, le retour à une conception holiste de la responsabilité est également perceptible. La notion de sanction tend à renouer avec la racine qui la fait dériver du latin sacer, « qui ne peut être touché, sacré, maudit » ; autrement dit, elle ressaisit, de façon implicite, l’esprit du vocabulaire religieux qui, en identifiant l’ordre social à l’ordre harmonieux de la Création, abaisse la frontière entre l’espace public et la sphère privée ; avec pour effet de réduire la place laissée à l’autonomie de l’individu, et d’étioler en lui jusqu’au goût de la liberté. Il est probable que le remède à ces dérives de moins en moins clairement perçues, mais n’en répondant pas moins à une forte demande sociale, passe par le débat public, nécessaire pour obliger le législateur à modérer ses interventions, et par un système de solidarité assurantiel, de mutualisation des risques, seul capable de rendre les citoyens plus responsables.
Responsabilité et autonomie
En émancipant l’individu, la révolution des Lumières a brisé les cadres qui soumettaient celui-ci à la fatalité de ses appartenances ; elle a renversé la relation qui le reliait aux déterminismes de sa naissance, de sa religion, de sa classe et de sa race. Le sujet, qui émerge au XVIIIe siècle, ne se définit plus par rapport au monde, c’est le monde qui prend sens par rapport à lui. En passant pour ainsi dire du plan vertical, surplombé par la volonté divine, au plan horizontal, qui situe ses représentations et sa volonté de plain-pied avec celle des autres hommes, autrement dit en évoluant, au fil d’un long processus apparu à la Renaissance, de la condition holiste de l’homo hierarchicus, à la condition de l’homo aequalis – pour reprendre la distinction puissante de Louis Dumont –, il découvre, à travers l’épreuve du conflit, la liberté. Celle-ci n’est plus octroyée, elle ne se borne plus au « droit de faire tout ce que les lois permettent », comme le pensait Montesquieu – lequel définissait encore la liberté par rapport aux lois (Esprit des lois, XI, III). Inscrite dans sa conscience, contenue en puissance dans sa volonté, elle acquiert ainsi un statut ontologique. D’entrée de jeu, il faut insister sur ce point, l’individu n’est pas seulement responsable de lui-même. Il est responsable aussi bien vis-à-vis de lui-même que du monde qui l’entoure. Il est responsable, et non maître, ni même « comme maître et possesseur de la nature », au sens cartésien, dès lors que la relation bijective qui s’instaure entre lui, l’Autre, la nature et l’histoire – dont il devient sujet et acteur – l’oblige à se percevoir tout ensemble comme autonome et dépendant, législateur et sujet, doté de droits, mais aussi de devoirs. À l’évidence, le projet qui se construit là ne sort pas tout armé du cerveau de Jean-Jacques Rousseau et d’Emmanuel Kant. C’est également un projet pour plusieurs siècles, appelé à évoluer en fonction des événements et des mœurs. Mais à l’armature de cette partition nouvelle, sont adossées les réponses à la plupart des objections qui continuent de lui être adressées, aussi bien par la pensée contre-révolutionnaire, néo-traditionaliste ou néo-nietzschéenne et, près de nous, néo-conservatrice, que par les philosophies anti-libérales postmarxistes, de Marcuse à Althusser, qui ont culminé en mai 1968, et dont les arguments ont refait surface après la chute de l’Union soviétique en 1989. De quelque horizon qu’elles soient venues, ces critiques ont cherché à ébranler sur leurs bases les deux idées fondatrices de la philosophie de la responsabilité : la raison, accusée d’obéir à une ambition prométhéenne et de plaquer des abstractions sur le réel, au détriment des libertés et au mépris des leçons de l’expérience ; et l’autonomie de l’individu, confondue avec le « be yourself », le culte de l’indépendance prôné par les libertaires et les idéologues de mai 1968. Considérée sous cet angle, déconnectée de l’idée de responsabilité, l’autonomie serait vouée à une double impasse : celle du solipsisme ou celle de la désinhibition des désirs. Elle conduirait en toute hypothèse à l’opposé du processus de responsabilisation contenu dans le projet initial d’émancipation. Rien de plus injuste, en fait, et surtout rien de plus faux que ces deux procès de l’individualisme des Lumières : il faut les dénoncer à leur tour car ce sont eux, aujourd’hui, qui constituent le principal obstacle idéologique à l’autonomie de l’individu et au libre exercice de sa responsabilité. Le premier, celui de la raison, a trouvé son expression la plus accomplie en 1993 dans l’encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II, qui allait jusqu’à imputer à la raison sans la foi la paternité des totalitarismes du XXe siècle. Quatre ans après la grande célébration de 1989, en un moment où l’on avait cru reconnaître le triomphe de la démocratie et des droits de l’homme, s’est ouverte en effet une vague de reflux par rapport à l’héritage des Lumières qui n’avait pas connu d’équivalent depuis la révolution bergsonienne, elle même contemporaine, en 1889, du premier centenaire de la Révolution française. Et le principal moteur de ce reflux fut la mise en cause, en apparence évidente, du rationalisme prométhéen, accusé d’avoir provoqué, via le marxisme-léninisme, la dérive qui a conduit au Goulag. Or il faut relire Raymond Aron pour comprendre ce que le marxisme doit au socialisme utopique des années 1830 et 1840, lequel cherchait, avec la bénédiction des chrétiens sociaux, à concilier l’individualisme égalitaire avec la nostalgie des sociétés holistes dont le modèle était inspiré aussi bien de l’Antiquité que d’un Ancien Régime soudain idéalisé, tel que le docteur Benassis le décrit dans Le médecin de campagne de Balzac. Avant Marx, Benjamin Constant avait, en 1819, répondu d’avance à cette contestation, dans sa célèbre conférence sur La liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, en expliquant la Terreur jacobine, plus tard invoquée par Lénine comme l’ancêtre du bolchevisme, non par un prométhéisme de la raison, mais par la prétention de plaquer sur la dynamique individualiste enclenchée en 1789 le rêve de fusion organique et de transparence de la Cité antique. Compte tenu de l’évolution des esprits, expliquait-il, la réalisation de cette utopie obligeait à une greffe du holisme sur l’aspiration à l’autonomie, greffe qui ne pouvait être réussie sans le recours à la contrainte. L’accusation adressée aux Lumières d’avoir voulu plaquer sur le réel les catégories abstraites de la « raison pure » était d’une totale mauvaise foi : elle reproduisait le reproche de constructivisme adressé à la pensée des Lumières par la droite contre-révolutionnaire, depuis Joseph de Maistre jusqu’à Hayek. Cette critique, attachée à dénoncer les « effets pervers » de la notion de responsabilité-autonomie – condamnée, selon ses critères, à atteindre le but inverse de celui qu’elle se proposait –, méconnaissait le fond de la réflexion kantienne. Loin d’enfermer l’homme dans l’empyrée de la raison, celle-ci vise à le faire échapper à l’ordre divin. La raison, selon la Critique de la raison pure, est législatrice, mais elle n’a pas accès au règne qui déborde le champ des catégories de l’entendement et de la perception. En sorte que, si l’histoire n’a de sens que par rapport à l’homme, l’homme n’est pas pour autant fondé à prendre, vis-à-vis de l’histoire, le point de vue de Dieu. Loin d’être impérialiste, l’universalisme kantien prend en compte l’espace et la durée. Contrairement à la légende qui veut que, selon la formule de Péguy, le kantisme n’ait pas de mains, cette philosophie s’est voulue une pratique autant qu’une théorie. Tirant les conséquences des transformations objectives de la conscience occidentale, sa philosophie de la responsabilité correspond au nouveau statut du Moi dont Rousseau a été, outre-Rhin, l’inspirateur. Témoin l’exemple que Kant donne à l’appui de l’impératif catégorique, tel qu’il est formulé dans les Fondements de la métaphysique des mœurs : « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature » (trad. Victor Delbos, 2ème section). Dans cet exemple, un désespéré veut se tuer. Il n’est plus question de lui interdire le suicide pour une cause religieuse, au nom de la volonté divine. En revanche, son acte mettrait en cause un des fondements de « l’ordre universel », qui ne peut être autre, en l’occurrence, que l’ordre social. En d’autres termes, selon Kant, ce n’est pas accomplir un acte de liberté que de refuser d’assumer une responsabilité – le respect de la vie – qui engage chacun envers les autres membres de la société. L’universel kantien n’est plus dans le Ciel, mais dans la conscience de chacun : chez Kant comme chez Rousseau, l’homme n’est pas intrinsèquement bon – contrairement à une interprétation fautive de la réflexion de JeanJacques Rousseau – il l’est en puissance. Il possède en lui la capacité de discerner entre les notions du Bien et du Mal – ce qui n’est pas la même chose que la capacité de trancher, de manière absolue, entre ce qui est bien et ce qui est mal, certitude que s’arrogeait l’Église, en fonction d’une injonction venue d’en haut, et qui a conduit et conduit encore les idéologues, à travers les âges, à dire le droit du point de vue de Dieu et à assassiner au nom de la vertu. On mesure ainsi les implications du transfert horizontal opéré par la morale kantienne : il instaure l’ère de la différence et du contrat. Jusqu’à son « sapere aude », qui s’impose à l’individu, il n’existait qu’un rapport d’identité – ou, selon Leibniz, d’harmonie – entre le Moi et l’autre, comme entre le Moi et le monde. Chacun était substituable à son semblable sous le regard de Dieu qui unifiait l’univers, et nul n’avait de raison d’être mécontent de son sort. Ainsi Durkheim a-t-il défini les « sociétés mécaniques ». Leurs membres y « éprouvent les mêmes sentiments, adhèrent aux mêmes valeurs » et « reconnaissent le même sacré ». La perception de la différence apparaît avec la configuration horizontale de l’espace politique : les individus deviennent égaux en droits parce qu’ils sont différents en droits. Il n’y a, dit Rousseau, de connaissance possible de l’homme en général qu’à partir de l’étude de chaque individu en particulier, qu’il commence à expérimenter sur lui-même. Et la nouveauté du contrat social défini par Jean-Jacques Rousseau repose sur le respect dû à l’autonomie de chaque volonté. Ainsi le changement de plan introduit par Rousseau et par Kant implique-t-il dans son mouvement une double dynamique de liberté, et par là même de responsabilité : il dissocie la politique du sacré et place théoriquement les gouvernés au même niveau que leurs gouvernants. Ainsi, de Kant à Max Weber, dont la philosophie de la responsabilité a profondément marqué la pensée politique libérale contemporaine, le même fil court, et les mêmes malentendus se retrouvent. En mettant l’accent sur la nécessité de considérer l’homme comme une fin et non comme un moyen, le premier met en garde contre la tentation de sacrifier les principes à l’utilité sociale. Étant tout sauf un idéaliste, il n’en tient pas moins compte du réel. Quant à Max Weber, en mettant en évidence ce qu’il appelle « la guerre des Dieux », les conflits de valeurs, le caractère inévitable de la distinction par le politique entre l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité, il insiste sur le devoir pour celui-ci de ne jamais perdre de vue l’éthique de la conviction : étant tout sauf un relativiste, il maintient la référence aux principes dans l’exercice des responsabilités.
Autonomie et indépendance.
L’obstacle du second reproche adressé aux Lumières, concernant le danger du solipsisme anarchiste, libertaire ou hédoniste se trouve ainsi levé. On sait l’usage qu’en fait Alain Renaut, dans sa critique de la notion d’indépendance, indûment attachée, selon lui, à la notion d’autonomie. Or, associée à l’idée de responsabilité, l’indépendance est loin d’être contradictoire avec la sociabilité du sujet, et loin, également, de conduire l’autonomie dans une impasse. Elle apporte au contraire une réponse aux revendications multiculturalistes qu’encourage la critique de la notion d’indépendance, qui de toute façon est un mythe, puisque nous sommes dépendants au moins de notre langue et de notre culture. Dans l’acception kantienne, la « différence » comme fondement du droit distingue des individus, non des groupes ; elle n’a rien à voir avec le « droit à la différence », tel qu’il est entendu par les multiculturalistes, communautaristes ou communautariens convaincus de la nécessité de faire droit aux mouvements sociaux reposant sur un principe d’identité et non d’adhésion. Ces groupes, d’autant mieux entendus qu’ils sont déterminés et d’autant plus déterminés qu’ils sont minoritaires – comme l’a montré Mancur Olson dans sa Logique de l’action collective –, ne manifestent pas par hasard deux exigences conjointes, qui vont au rebours de la conception libérale de la responsabilité : d’un côté une meilleure reconnaissance par la République des valeurs identitaires – soutenues par des revendications d’ordre parfois sentimental, plus souvent d’ordre sexuel, mémoriel, ethnique, religieux, voire, en réaction, nationaliste – ; et, de l’autre, l’instauration d’une « laïcité positive » qui ouvrirait une brèche autorisant, au sein de l’espace public, une présence plus grande, et qui deviendrait vite déterminante, du sacré. Autant de dérives qui, au prétexte de « réenraciner » l’individu dans les héritages censés fonder son identité, rétrécissent le champ de son autonomie et concourent à son aliénation. Ces avancées apparentes dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’autonomie individuelle et de l’accomplissement de ses choix existentiels sont en réalité autant de régressions du point de vue de la notion moderne de responsabilité, sans laquelle précisément il n’est pas d’autonomie. Elles relèvent de la même aspiration nostalgique à plaquer du communautaire sur de l’individuel que Benjamin Constant avait diagnostiquée chez les Jacobins. Elles enferment l’individu – et peu importe que ce soit de son gré – dans le déterminisme de l’appartenance dont le projet des Lumières cherchait à l’affranchir : le voici désormais, pour ainsi dire, assigné à cette appartenance sous le regard de l’autre, et, du même coup, fiché, recensé et discriminé, serait-ce de façon « positive ». Tout aussi gravement, les revendications identitaires abaissent la frontière entre l’espace public et la sphère privée, et donnent au pouvoir des prétextes croissants à étendre son emprise. Enfin, ce qui se profile derrière les illusions selon lesquelles les sociétés démocratiques vivraient une nouvelle révolution culturelle, voire anthropologique, comparable à celle des Lumières, n’est pas autre chose qu’un renversement de l’individualisme contre lui-même, et un retour de flamme de l’intolérance, opposant des « identités meurtrières » entre elles, au nom d’un principe d’autonomie dévoyé. Pour éviter de tomber dans ce piège, ce qui manque le plus est moins une philosophie de la responsabilité, qu’un effort d’éducation par l’enseignement de l’histoire et de la langue. À défaut de convaincre de la thèse que l’on esquisse ici, le but à atteindre est, par la délibération publique, de permettre au moins d’en appeler du peuple mal éclairé au peuple mieux éclairé, sur des questions qui mettent en jeu rien moins que l’avenir de la démocratie. En faisant le pari de Léo Strauss, selon lequel « tous les hommes éduqués de manière libérale sont des hommes politiquement modérés » (« Éducation libérale et responsabilité », in Le libéralisme antique et moderne, PUF, 1990, p. 45). Il y faut aussi une réponse institutionnelle, qui affermisse le modèle individualiste de représentation et récuse les formes d’interpellation politique reflétant les intérêts de groupes identitaires. Mission impossible, penseront les uns, compte tenu de la crise du modèle français d’intégration. La tâche est difficile, en effet, mais réalisable, si l’on voit plutôt, par rapport aux autres nations européennes, du Nord comme du Sud, le verre français à moitié plein ; et si l’urgence de maintenir en vie les « immortels » principes républicains et laïques, garants des libertés publiques, est assumée conjointement par le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Il y a quelques années, on pouvait encore diagnostiquer la force dans notre pays de ce qu’on proposait alors d’appeler un Surmoi républicain. Il faudra beaucoup de patience et de psychologie pour rendre à ce Surmoi la place qu’il a perdue.
Responsabilité et culpabilité.
Cet effort sera d’autant plus nécessaire que la crise intellectuelle de la notion de responsabilité s’accompagne d’une crise de la responsabilité politique dans le fonctionnement de nos institutions. Si en effet l’autonomie est nécessairement afférente à l’individu, et s’il n’est pas d’ouverture de la subjectivité aux autres et au monde sans responsabilité, cette dernière, en tant que concept politique, peut et même doit être partagée. Le modèle de ce partage est celui de la responsabilité gouvernementale. Détachée de la procédure pénale de l’impeachment, devenue rarissime, mais dont l’esprit se retrouve encore aujourd’hui dans les cas de départ plus ou moins volontaire de ministres mis en examen, la notion de responsabilité gouvernementale ne relève nullement de la culpabilité, même si elle peut être mise en cause à la suite d’une faute. Elle est née dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, avec la démission de Robert Walpole en 1742 ; elle a été appliquée de façon régulière en France dès la première Restauration, que Charles X tenta de faire jouer en se séparant de ses ministres, puis en dissolvant le parlement dans le vain espoir d’éviter le verdict de la rue en juillet 1830. Elle intéresse notre propos, dans la mesure où la responsabilité politique mise en jeu dans les débuts – non encore démocratiques – du régime parlementaire impliquait déjà la formation, au côté d’un monarque irresponsable, de gouvernements homogènes et solidaires, chargés de mettre en œuvre une politique sur laquelle ils étaient amenés à poser la question de confiance. On retrouve ici la notion bijective de réciprocité entre le politique et la société, que Rousseau, dans le Contrat social, considère comme indispensable à l’expression de la volonté générale : la loi doit être conçue et appliquée dans des conditions égales pour tous, sans privilégier d’individu ni de groupe, pour s’imposer à tous comme légitime. De même, le retrait de la confiance du parlement implique le retrait collectif du gouvernement. À l’ère démocratique, le problème majeur soulevé par la responsabilité politique a été posé, dès la fin du XIXe siècle, par la violation de la règle de la réciprocité, à la fois dans l’élaboration de la loi, soumise aux pressions des lobbies et, au niveau gouvernemental, en raison de la substitution à la majorité sortie des urnes de « majorités » ministérielles, ou plutôt de replâtrages, imposés par les combinaisons des partis. Ces détournements de la légitimité démocratique ont provoqué deux fois la chute de républiques, en 1940 et en 1958. En France, le passage de l’émiettement partisan de la IVe République à la bipolarisation de la Ve a abouti à un dysfonctionnement inverse : le pouvoir démesuré d’un président de la République considéré comme irresponsable, sauf impeachment, en tant que garant de la séparation des pouvoirs, et disposant cependant de deux armes de dissuasion imparables : la nomination aux postes stratégiques de l’État, et la dissolution de l’Assemblée, qui ne peut pas, en retour, le contraindre à partir par un vote de défiance. L’obstacle ainsi opposé à la mise en jeu par les gouvernants de leur responsabilité politique a eu pour effet d’inciter l’autorité judiciaire à occuper l’espace abandonné par ceux-ci – avec pour effet de transgresser les limites du politique et de rompre à son profit l’équilibre des pouvoirs. De même, la progression du droit, encore modeste, mais continue dans les relations internationales, s’impose à mesure que les menaces – terroriste, écologique, numérique – franchissent les frontières et sortent du champ de compétence, donc de responsabilité des dirigeants politiques. La limitation du pouvoir de nomination du chef de l’État, encore très mal contrôlé, l’obligation pour celui-ci de se retirer en cas de désaveu d’une dissolution ou d’un référendum, et la possibilité pour l’Assemblée de le contraindre à poser la question de confiance sur des sujets majeurs, selon des mécanismes étudiés pour éviter un retour à l’instabilité de la IVe République, seraient les moyens les plus simples, et les plus immédiats de réinjecter de la responsabilité au sommet de l’État, c’est-à-dire là où elle est le plus nécessaire et peut servir d’exemple. Une autre manifestation du partage de la responsabilité politique, sans que pour autant la culpabilité soit en cause, est la notion mémorielle de responsabilité collective. La question a été posée par Karl Jaspers en 1946 dans son fameux essai sur La Culpabilité allemande (Die Schuldfrage), mais à un moment où elle était assez brûlante pour être posée, précisément, en termes de culpabilité. Or s’il est vrai que les peuples sont responsables de leurs dirigeants politiques, ils n’en sont pas pour autant coupables des fautes commises par ces derniers. Et moins encore les générations suivantes, sauf à faire intervenir, avec Jaspers, le concept de culpabilité métaphysique après un crime dépassant l’entendement. Les générations qui ont suivi peuvent réparer, autant que faire se peut, les fautes inexpiables des générations antérieures sur le plan symbolique et sur le terrain des dommages matériels. Elles ne peuvent pas, en revanche, partager la culpabilité de leurs pères, ni s’en déclarer solidaires dans la repentance. La même réserve peut être adressée au discours, resté si populaire, dans lequel, en juillet 1995, le président Chirac impliqua « la France » dans la culpabilité des crimes commis par le régime de Vichy. Dans les papiers de Jefferson, datant du début du XIXe siècle, Mireille Delmas-Marty a relevé cette formule qui va loin : « En vertu du droit naturel, une génération est à une autre ce qu’une nation indépendante est à une autre nation indépendante. » Dans le même esprit, Condorcet avait fait inscrire dans le texte, jamais appliqué, de la Déclaration des droits de l’homme de 1793 qu’« un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer la Constitution : une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures » (Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, 2010, p. 172). Ce rappel du contexte, à la fois temporel et spatial, qui conditionne l’exercice de la responsabilité est à méditer au moment où un nombre croissant de principes de droit engageant l’avenir, comme la précaution ou l’équilibre budgétaire, se trouvent inscrits, ou sur le point de l’être, dans une Constitution qui se veut paradoxalement intangible et qui prétend, de ce chef, engager les générations futures. On peut se demander, avec Mireille Delmas-Marty si le recours extensif à des mesures liant la postérité, non à des règles du jeu, mais à des normes relevant en principe de la responsabilité des seuls contemporains, ne s’inscrit pas, consciemment ou non, dans un processus de normalisation illimité. L’hypothèse selon laquelle les sociétés démocratiques contemporaines, et plus particulièrement la nôtre, tendent à sortir de la logique individualiste – reposant sur le principe de réciprocité – est d’autant plus justifiée que la responsabilité collective est de plus en plus couramment invoquée à propos des personnes morales. Comme Jean Carbonnier le note avec humour dans Droit et passion du droit sous la Ve République (Flammarion, 1996, p. 142) : « Figurez-vous un juge d’instruction de Béziers mettant l’ordre des Dominicains en examen pour cause de génocide sur la population cathare. Comme si l’histoire, claire ou obscure, ne relevait pas avant tout de sentiments contradictoires qu’aucun droit ne saurait réduire à l’unité. » Les cas de mise en cause de la responsabilité sans faute, dont s’effraient les chefs d’entreprise, les dirigeants du secteur public, ou encore les médecins, installent ainsi, au nom de la protection des victimes, un climat d’insécurité, de soupçon, qui détruit des réputations en renversant au détriment de l’accusé la charge de prouver son innocence. Là où on espérait que la confiance des citoyens dans la loi comme moyen de lutter contre l’arbitraire prendrait appui sur le sentiment de leur égalité devant le droit, la résistible ascension de la notion d’équité portée non plus par les individus mais par des groupes de pression politiques de force très inégale accroît la méfiance à l’égard de la justice et le scepticisme à l’égard de ses décisions. Il est frappant que le législateur, autrement dit le politique, joue dans ce recul de la responsabilité individuelle devant le rouleau compresseur de la responsabilité collective un rôle beaucoup plus décisif que le juge. C’est encore Jean Carbonnier qui observe (ibid, p. 140) que la réforme du Code pénal de 1994 est allée à l’opposé de l’allègement et de la simplification que l’on pouvait attendre d’une loi moderne, favorable aux libertés individuelles. Au lieu de quoi le texte a cédé à la tentation du contrôle social. « Il y aurait même, souligne-t-il, plutôt régression vers la bigarrure et le baroque de l’ancien droit. Sans l’horreur des supplices, il est vrai – nous en serions incapables –, mais c’est le même mécanisme mental d’imagination punitive. […] On aperçoit même quelques unes de ces pénalités en miroir qu’affectionnent les droits archaïques et les mères de famille : le mauvais garnement sera puni par où il a péché, privé d’auto, de chéquier, de chasse, de bistro, etc. Michel Foucault a montré comment l’infantilisation concourt à la punition. La tonalité, chez lui, était tragique. Elle est, dans le nouveau Code pénal, innocemment tutélaire. » La régression du droit pénal qui, sous le couvert de responsabiliser le délinquant, rejoint la conception holiste qui sanctionnait la faute, dérangeant l’ordre du monde, et non la personne, l’individu pris dans sa singularité, est aussi étonnante que spectaculaire. C’est au politique qu’incombe la responsabilité de cette dérive, et à lui, donc, d’abord, qu’il appartient de la réparer. Reste à présent à comprendre comment et pourquoi le projet même de réhabiliter la notion de responsabilité suscite autant de doute et de méfiance dans notre démocratie. La réponse est sans doute à rechercher du côté de son rapport avec la sanction, populaire quand il s’agit de lutter contre l’insécurité, impopulaire quand elle oblige le citoyen à assumer les conséquences de ses actes : de fait, ses avatars reflètent les fluctuations et incohérences dont pâtit, dans notre démocratie, l’idée que chacun se fait de la – et de sa – responsabilité.
Responsabilité et sanction
Si l’on considère l’idée de responsabilité par rapport à sa sanction, on peut distinguer deux visions du monde qui recoupent, grossièrement, l’opposition entre la droite et la gauche. Selon la droite, qui demeure imprégnée par l’héritage judéo-chrétien, l’individu est frappé par le péché originel – traduisons par l’incomplétude de la nature humaine – à la fois d’une présomption de culpabilité, qui le condamne mais autorise le pardon, et du sceau de l’irresponsabilité, qui ne le condamne pas moins, puisque sa faute est indétachable de son imperfection, et qu’elle suffit à l’exclure de la société. Il est jugé coupable d’avoir transgressé les règles de la société, tout en étant considéré a priori comme irresponsable ! L’argument reproduit le schéma de la théodicée : de même que Dieu n’a pu vouloir le mal, et que, dans l’ordre de la Création, à tout mal correspond un bien, la faute s’inscrit dans une harmonie secrète que l’individu doit assumer, mais dont la fin lui échappe. La peine, qui privilégie la prison, a pour but à la fois de dissuader le coupable et de lui permettre de se racheter. La fonction de la société est de le rappeler à ses devoirs envers elle, en le contraignant, par la loi et la sanction pénale qui l’accompagne, à prendre conscience des responsabilités qui l’engagent envers elle – responsabilités le plus souvent comptabilisées au pluriel, comme une liste de devoirs, et non comme une essence, au singulier. Dans cette perspective, la sanction, frappant la faute indépendamment des circonstances de sa commission, est le prix qu’il lui faut payer pour que la reconnaissance de son autonomie lui soit rendue. La vision du monde de gauche est symétrique : l’autonomie qui m’est reconnue a priori est la condition de l’exercice de ma responsabilité. Mais dès lors que la société prend la place abandonnée par l’ordre du monde, ou de la nature, la faute est nécessairement une tache dans l’engagement contracté par l’humanité de maîtriser son propre destin, et l’auteur du délit, tout en assumant la responsabilité de son acte, se trouve fondé à se décharger de sa culpabilité sur l’imperfection de l’environnement politique, économique et social qui l’a rendue possible. Dans cette hypothèse, l’individu est à la fois responsable, puisqu’il est considéré comme l’auteur à part entière de ses actes, mais non coupable, dès lors que l’exercice de sa volonté se heurte à une imperfection qui n’est pas a priori la sienne, mais celle de la société. L’origine de ce schéma a été illustrée, aux origines de la Révolution française, par la confrontation entre la vision du monde de Joseph de Maistre et celle de Jean-Jacques Rousseau. Dans l’esprit du premier, l’homme est coupable, mais irresponsable. Pour le second, l’individu est responsable, mais il est innocent. Cette structure, depuis, est demeurée intacte : la droite sanctionne la culpabilité, au nom du danger que l’« irresponsable », au sens moral, fait peser sur la société, et elle cherche à adapter, selon les besoins, l’appareil pénal à la situation créée par la délinquance. La gauche fait porter par la société le poids de la faute dont l’auteur n’est considéré comme responsable que par accident. La première est favorable à la sanction, au sens de la répression du fautif, la seconde, à la prévention, au sens de l’amendement de la société. Cette symétrie ne signifie nullement que la conception de la responsabilité prédominante à gauche soit plus libérale que celle de la droite. Chacune d’elles comporte une ligne de fuite qui les conduit l’une et l’autre à converger vers l’instauration d’un véritable « ordre moral », au sens d’un régime dans lequel l’obligation morale est prise en charge par la loi. Dans la vision de la droite, héritée du providentialisme, le Bien et le Mal s’équilibrent dans l’ordre des fins dont l’homme n’a pas la clé. À gauche, l’absolu de l’éthique est sans partage, le Diable n’est pas au Ciel, mais sur terre, et la volonté humaine ne doit avoir de cesse qu’elle en supprime la trace. Dès lors que ces représentations morales sont transférées sur le terrain politique, il suffit de confronter les points de vue de Rousseau et de de Maistre pour en mesurer les ravages. Voici Rousseau : « Sans les égards que l’on doit à la faiblesse humaine cette convention [le contrat social] serait dissoute par le droit, s’il périssait dans l’État un seul citoyen qu’on eût pu secourir, si l’on retenait à tort un seul en prison et s’il se perdait un seul procès avec une injustice évidente. » Les résonances très actuelles d’un tel propos ne doivent pas dissimuler à quel degré d’intolérance un tel absolutisme moral peut conduire. Voici de Maistre : « Plus on examine l’univers, et plus on se sent porté à croire que le Mal vient d’une certaine division qu’on ne sait expliquer, et que le retour du Bien dépend d’une force contraire qui nous pousse sans cesse vers une certaine unité tout aussi inconcevable » (Soirées de Saint-Pétersbourg, 6ème entretien). D’où la nécessité, faute de pouvoir entrer dans ce mystère, de résister au relativisme et de refaire unité en s’en remettant à un législateur, tel qu’on le « distingue à peine du prêtre », et que « la politique et la religion se fondent ensemble ». Qu’elles procèdent d’un absolutisme ou d’un relativisme moral, qu’elles soient exprimées par un conservateur ou un révolutionnaire, les deux logiques tendent à légitimer l’instauration d’un ordre moral qui est l’autre nom de la morale d’État. En reliant en effet responsabilité et autonomie de l’individu, la révolution des Lumières avait dissocié le domaine de la morale et de la religion de celui du droit. À la fin du Second Empire, le Républicain Jules Barni, traducteur de Kant, a rappelé cette distinction fondamentale en des termes d’une rare limpidité, qui méritent d’être longuement cités : « Le domaine de la politique est celui du droit, c’est-à-dire de tout ce qui peut nous être légitimement imposé par une contrainte extérieure. Ajoutez au règlement du droit naturel, droit antérieur et supérieur en soi à toute convention, mais qu’il faut bien fixer par des lois positives, celui des intérêts collectifs auxquels il peut nous convenir de pourvoir par des conventions publiques, qui deviennent aussi des lois pour chacun de nous, et vous aurez tout le domaine de la politique ; sa juridiction ne s’étend pas au-delà. Le reste, c’est-à-dire tout ce qui dans la morale n’est pas de droit, appartient exclusivement au for intérieur, au domaine de la conscience. Que la politique, que la démocratie particulièrement, soit intéressée à l’observation de ces devoirs qui ne regardent que la conscience, qu’elle en favorise même l’action, s’il est possible, par les moyens qui sont de son ressort, à la bonne heure ; mais elle n’a pas le droit de les imposer par la force dont elle dispose. Lorsqu’elle méconnaît la limite de sa juridiction et qu’elle empiète sur le domaine propre de la morale, elle tombe dans une tyrannie insupportable ; elle est condamnée à employer les plus détestables moyens, l’espionnage des mœurs, l’inquisition des consciences […] ; et elle favorise ce qu’il y a de plus odieux au monde, l’hypocrisie » (J. Barni, La morale dans la démocratie (1868), Kimé, 1992, p. 41). En sortant du seul tribunal de la conscience pour devenir législatrice, la morale inspire des philosophies de la sanction qui, venues de droite ou de gauche, imputent à l’individu non seulement la responsabilité de ses fautes, mais lui font obligation de se conformer à des règles de conduite, à des normes de comportement qui, jusqu’à une date récente, ne relevaient que de son libre arbitre, et des codes non-écrits de la civilité. Loin d’avoir conforté l’individu dans l’affirmation de son autonomie, la crise, à gauche, du mythe de la volonté générale et, à droite, la quasi-disparition de la croyance dans le péché originel ont accéléré le transfert de la morale dans la sphère de compétence des pouvoirs publics ; elles ont favorisé, de la part des élites de l’État, une confusion croissante entre l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité. Il n’est pas étonnant que, à la faveur de la grande vague d’étatisation qui a suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, des responsables de droite (Beveridge, de Gaulle) et de gauche (Blum, Mendès France) se soient accordés à développer les bases de l’État providence. Il est plus étonnant, en revanche, que la philosophie du système alors mise en place soit devenue, en dépit des alternances, et dans l’ensemble du droit européen, social et pénal, une véritable religion d’État. Si son adoption par les peuples de l’Union a atteint un point de non-retour qui rendrait sa remise en cause plus coûteuse que son maintien, elle n’en comporte pas moins en termes de participation à la vie publique et de libertés publiques, des effets démobilisateurs, voire aliénants qui en ont substantiellement transformé l’esprit. Tocqueville a eu, en son temps, grand mérite à les prédire, mais aujourd’hui elles crèvent les yeux et il semble que les dirigeants des grandes démocraties s’aveuglent sur elles pour ne pas avoir à les corriger.
L’État préventif
En son principe, l’État providence s’est présenté à la fois comme assureur et garant de la solidarité. Le système ne se bornait pas à couvrir les risques. Il espérait devenir l’éducateur du citoyen. D’un côté, il pansait les plaies : santé, accidents du travail, chômage, charge d’enfants. De l’autre il renvoyait chacun à la conscience de sa responsabilité propre en le faisant responsable du sort de tous. Tel était le sens, fondamentalement civique, du choix de la répartition : en même temps que ma personne, j’assure l’autre, quel qu’il soit – serait-il ivrogne, fumeur, conducteur maladroit ou skieur imprudent. Je sais que ce dernier paye aussi pour moi, dans des conditions telles que chacun, certain que la même règle s’appliquera à tous, sera amené – du moins puis-je l’espérer – à adopter de son plein gré une conduite responsable, le moins possible à la charge des autres. Étant entendu que, en cas de délit relevant du pénal, l’assurance du dommage corporel par la société n’est nullement exclusive de la sanction de la faute. La conception de la responsabilité qui inspire, à l’origine, l’État providence repose sur l’égalité et la réciprocité des droits, et sur l’acceptation du conflit, qui favorisent l’intériorisation de conduites responsables. Le raisonnement est le même que celui que Rousseau appliquait aux conditions d’expression de la volonté générale. Elle se situe, en son principe, dans la droite ligne des Lumières. Le malheur est qu’il est plus facile d’intérioriser des droits que des devoirs. Chacun, en fait, s’est abrité derrière l’État providence pour n’en faire qu’à sa tête, en sorte que le système a dû évoluer vers une logique de prévention, dès lors que la logique de l’égalité formelle et de la réciprocité ne fonctionnait plus. Il a fallu multiplier les normes préventives pour modifier les comportements et dissuader les assurés de prendre des risques. Là où naguère la sanction intervenait en aval de la faute, la pénalisation des conduites susceptibles d’entraîner des conséquences coûteuses s’est banalisée en amont, en sorte que la marge de liberté laissée à l’individu pour choisir sa conduite et engager sa responsabilité s’est réduite comme une peau de chagrin. On est puni, non plus pour le dommage que l’on a causé, ni même du fait de son imprudence ou de sa négligence, ni encore du fait d’autrui ou des choses, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, mais pour le simple fait de s’être mis en situation de commettre une imprudence ou une négligence. Dans ce processus normalisateur, la sanction préventive va au-delà de la mise en cause de la responsabilité sans faute ou de la mise en danger d’autrui. Elle frappe, par anticipation, des conduites susceptibles de provoquer un dommage virtuel qui n’aura sans doute jamais lieu, ou d’entraîner pour la société un coût financier reposant sur de fausses évidences économiques, sur des anticipations difficiles à démontrer. Elle substitue un réseau de plus en plus dense de normes, accompagnées de règles pénales, aux codes non-écrits de civilité. Le pire est que cette dérive, qui consacre un échec des systèmes mis en place après la guerre et un recul du projet humaniste des Lumières, a été perçue comme une consécration. Bentham, le père de la doctrine de la prévention au XIXe siècle, était persuadé d’avoir trouvé, avec l’architecture de sa prison panoptique, qui plaçait les prisonniers sous la surveillance permanente d’un poste de contrôle central, la synthèse idéale entre l’autonomie du sujet et son alignement sur les normes de vie en société. En comparant le système de l’inspection, dont l’irruption vous prend en défaut, et la méthode de la surveillance, exposée dans son Panoptique, qui vous tient en permanence sous son regard, il était émerveillé par la supériorité de sa trouvaille : « L’objet de l’une était la détection, l’objet de l’autre est la prévention. Dans le premier cas, l’individu qui détient l’autorité est un espion ; dans le second, un moniteur. L’une visait à percer les plus secrets replis du cœur ; l’autre, limitant son attention aux actions patentes, laisse les pensées et les imaginations à l’ordinaire qui est le leur, et dont le lieu se situe plus haut. » Le panoptique évitait, certes, le recours à la contrainte. Mais il soulevait précisément l’objection préjudicielle selon laquelle l’individu, surveillé en permanence, serait conduit, de façon insensible et inconsciente, à intérioriser des normes aliénantes. Le danger de l’idée de prévention, telle qu’elle triomphe dans les sociétés démocratiques au point d’atteindre un paroxysme, consiste moins dans les risques qu’elle écarte, et dont la nécessité est souvent indiscutable, que dans la renonciation passive à l’exercice de la responsabilité, dans l’indifférence à l’indifférenciation qu’elle engendre. Dans des nations où le lien social cède la place aux identités de groupes, où les revendications de droits réels – dits opposables – au travail, au logement, à l’air pur, etc. se banalisent tout en posant à l’État des problèmes insurmontables, l’individu s’habitue de moins en moins à admettre que la liberté a un coût, et de plus en plus à refuser, sous la pluie de règles qui répondent à ces demandes, de payer le prix de cette liberté. Les associations, les corporations et les communautés – consuméristes, anti-tabagiques, féministes, etc. –, admises, depuis près de vingt ans, à se porter parties civiles, traquent passionnément le responsable et contribuent au développement d’une « victimologie » qui entretient, à travers des demandes de droits assorties de sanctions contre la moindre blessure de mémoire, la moindre stigmatisation, une inflation incontrôlable de normes et de jurisprudences préventives. Il est vrai que l’extension de ces normes répond à deux phénomènes propres à la modernité. D’un côté, le progrès matériel, qui, comme le redoutait John Stuart Mill, abaisse le seuil de tolérance aux nuisances. De l’autre, la montée des incivilités, qui multiplie les faits de petite délinquance. La question est de savoir si la meilleure façon de faire progresser le sens des responsabilités est de limiter les occasions de conflit, ou au contraire de leur permettre de s’affronter au réel et de se trouver ainsi contraintes de s’autoréguler. Assez de situations historiques attestent que, à trop vouloir éviter le conflit, on récolte la violence. Si encore les victimes pouvaient considérer que la reconnaissance de leurs droits augmente leur dignité ! Mais la surenchère des mesures préventives aboutit à nier, dans la victime, et sa qualité de victime, et sa dignité. Jusqu’à une date récente, l’ivrogne, par exemple, était traité comme une victime : par souci de respecter la liberté de la société dans son ensemble, chacun consentait à faire en sa faveur une exception d’irresponsabilité. L’alcool étant un plaisir d’ordre privé, nul ne se jugeait fondé à fixer une limite à sa consommation, sauf à sanctionner les délits publics dont il pouvait être la cause. Aujourd’hui, l’alcool, dont seul l’abus est dangereux, est de plus en plus assimilé à une drogue « addictive » et le buveur à un coupable. Est-il pour autant considéré comme plus responsable ? On concevrait que, pour le pousser à se réformer tout en respectant sa liberté, la société l’incite à contracter une assurance privée. Mais ce serait porter atteinte au principe d’égalité. La société, s’estimant fondée à le protéger contre lui-même, préfèrera donc l’astreindre à « réparation » – c’est-à-dire au sevrage. Le but est de le protéger contre lui-même, sous le contrôle de l’expert et du juge. Par un curieux renversement de l’ancien rêve anarchiste, qui plaçait l’être singulier au sommet de ses hiérarchies, l’individu est devenu ainsi l’ennemi mortel du nouvel ordre préventif. La priorité est de l’empêcher de nuire – ce qui suppose non qu’il soit sanctionné après la faute, mais mis en situation de ne pas commettre de faute. Comme ce processus permet, du même coup, au sujet infantilisé de se retourner contre la société pour faire porter à cette dernière la responsabilité de n’avoir pas anticipé le risque, ou prévu la situation de faute, l’individu s’en accommode, voire en redemande. Sans souci des conséquences qui peuvent en résulter pour sa liberté, voire pour sa simple dignité : la banalisation de la dénonciation et le renversement, au détriment de l’accusé, de la charge de démontrer son innocence sont les effets inévitables de la généralisation du soupçon. À l’individualisme responsable des Lumières s’oppose, de la sorte, terme pour terme, un particularisme créancier. Face à cette dérive, la principale urgence est de restaurer l’arbitrage du politique. Seul le débat politique peut, en posant au moins la question de la position du curseur, fixer des limites à l’inflation des normes préventives. À trop surestimer les contraintes, à trop confondre le social et le politique, on a laissé faire, jusqu’ici, l’expert et le juge. Le juge exploite le flou du droit – sa propension naturelle étant d’intervenir le plus possible. L’expert tend vers l’organisation et la réparation pure et simple. La déresponsabilisation de l’auteur de la faute, la normalisation des conduites, la désignation de boucs émissaires, la remise en cause de la présomption d’innocence et l’abandon de la prescription, constituent autant d’atteintes aux garanties protégeant le justiciable contre l’arbitraire, et autant de régressions par rapport au droit de la responsabilité. Elles apparaissent ainsi, à bien des égards, comme les conséquences, non de la sagesse, mais de la dépolitisation du pouvoir. En dernière analyse, la clé du problème de la responsabilité réside dans l’aptitude de notre société à réhabiliter la sanction. La sanction oblige l’individu à assumer les conséquences de ses actes : elle le laisse libre de choisir ses conduites, mais à un coût suffisamment élevé pour l’incliner à réfléchir. Telle aurait pu être, au départ, l’inspiration du principe de précaution : inciter l’entrepreneur à prendre librement ses risques dans une situation d’incertitude, en le prévenant qu’il ne pourra pas se dédouaner de ses responsabilités s’il en résulte des dommages « graves et irréversibles ». Au lieu de quoi l’article 5 de la Charte de l’environnement, qui précise le contenu de ce principe, et qui a été inscrit dans la Constitution française en 2005, a choisi de mettre en place des procédures publiques d’évaluation et des mesures de protection « provisoires et proportionnées » destinées à parer à ces dommages « même lorsque leur réalisation est incertaine en l’état des connaissances scientifiques », et même lorsqu’il s’agit de procédés technologiques utilisés en masse depuis longtemps, au point de faire d’objets familiers des diables, tels que les téléphones mobiles. Ainsi, de débat en débat et de révision en révision, la Charte de l’environnement inscrite dans notre Constitution n’est pas, comme on voudrait le faire croire, le point de départ d’une nouvelle sagesse. Si nécessaires et novatrices que ses intentions se veuillent, elle contribue, bien plutôt, à rendre manifestes les archaïsmes du dirigisme administratif et de l’acharnement juridique qui minent tout esprit de responsabilité. Elle trahit les dérives d’une doctrine de la prévention qui ambitionne d’encadrer les conduites dans une logique holiste de négation du conflit. On aurait compris que, en réponse à la menace de nuisances irréversibles, la notion de précaution s’imposât, sur le modèle de la « prudence » politique, comme une utile procédure. Mais portée à ce degré de radicalité, théorisée en « principe », elle concourt à la transformation des mentalités qui conduit le législateur à ériger la prévention en idéologie. Elle entretient le fantasme d’une bureaucratie qui rêve de transformer le hasard en destin et d’englober sous sa domination la société toute entière. La pollution de la planète est une réalité que nul ne conteste. Elle fait peur, parce qu’on la juge irréversible. Cette peur a renforcé, depuis plus de trente ans, les tentatives philosophiques de subversion de l’héritage des Lumières. Le principe responsabilité, de Hans Jonas, qui remettait en cause l’humanisme kantien en 1979, et La Société du risque, de Ulrich Beck, annonçant non sans lucidité en 1986 le retour d’un « Moyen Âge du danger » et une transformation de « l’individualisme de l’âge moderne en son contraire le plus exact », font écho, pour une oreille exercée, à la révolution bergsonienne et à la critique des méfaits de l’individualisme, du matérialisme et de la raison qui ont marqué la crise intellectuelle de 1900, dont Romain Rolland a montré, en son temps, l’importance en la comparant à un « tremblement de terre » – tremblement qui a libéré les vecteurs intellectuels du fascisme. Le vrai problème qui se pose à l’intelligence contemporaine est de savoir comment commuer la peur en responsabilité. Le biologiste Philippe Kourilsky, auteur, en 2000, avec Geneviève Viney, d’un rapport marquant sur le principe de précaution, est un des rares scientifiques qui propose, en réponse à ce défi, une solution humaniste et libérale : elle consiste, de la part des chercheurs, à poser pour principe que, plus leurs libertés individuelles sont abondantes, plus leur devoir d’altruisme est élevé. La recherche de synthèses, susceptibles d’envisager sous un nombre maximum d’approches l’ensemble des paramètres d’un problème scientifique à l’intérieur de groupes interdisciplinaires reliés sur une base volontaire, ouvre de vastes perspectives au problème du passage de la responsabilité individuelle à la responsabilité collective, rendu de plus en plus nécessaire par le changement d’échelle des risques écologiques. Le dialogue et la confrontation avec autrui ne sont certes pas des idées nouvelles. Mais, dans un contexte où la responsabilité individuelle se voit mise en procès en même temps que la raison, la piste ainsi ouverte rétablit avec bonheur la confiance dans l’une et dans l’autre. Autant il est clair, en dépit de tous les heideggériens de la terre, que les problèmes soulevés par la technique seront résolus par une technique supérieure, autant il est probable que la condition de ce dépassement repose sur la construction d’un savoir en nom collectif, étayé sur une rationalité supérieure. Bien décourageants et dépourvus d’imagination apparaissent, par comparaison, les discours qui, au nom du principe de précaution, imputent les désordres écologiques mondiaux aux effets incontrôlés du capitalisme de marché. Outre le fait que 70 % de ces désordres sont imputables aux caprices de la nature, le marché mériterait moins d’être incriminé si ses règles étaient moins dévoyées. Bertrand de Jouvenel faisait remarquer en 1967 que l’eau, qui va manquer, serait nettement mieux préservée si son prix correspondait à sa rareté. Il en va de même pour le pétrole. Si ses cours s’étaient mieux ajustés à la réalité des réserves disponibles, le développement de sources d’énergies de substitution moins polluantes aurait été beaucoup plus rapide et inventif. Ce n’est pas davantage progresser dans le sens de l’autonomie que d’invoquer, dans l’article 1er de la Charte intégrée à la Constitution, un « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Au lieu d’encourager les citoyens à devenir responsables, c’est contribuer à en faire des créanciers. Une chose est de donner à chacun la possibilité de se défendre en cas de nuisance démontrée – ce qui est de droit commun – une autre est d’inverser la charge de la preuve en permettant à tout citoyen de faire valoir un droit contre lequel l’accusé devra se défendre. Réciproquement, le concept de pollueur-payeur, qui semble aller de soi, n’est pas moins contraire à l’objectif affiché, puisqu’il implique que l’acceptation préalable de payer ouvre pour l’entrepreneur un « droit » de polluer. À la clé de la querelle du principe de précaution, on retrouve, sans surprise, la même préférence des technocrates et des experts pour les normes, et la même méfiance à l’égard d’un débat politique confrontant les points de vue de citoyens éclairés et responsables.
Conclusion : pour une solidarité assurantielle
À l’occasion de ce bref parcours des multiples aspects de la « crise » de la responsabilité dans les démocraties contemporaines, nous avons trouvé une constante : un syndrome de régression. La nostalgie d’un ordre communautaire, identitaire, transparent, frugal et sans conflit conquiert aisément les imaginations, en une époque où la crise économique et financière fragilise l’individu devant l’État, et où l’exercice des responsabilités se heurte à la surenchère des revendications de droits. J’ai montré ailleurs (Le Siècle de Monsieur Pétain, Perrin, 2005) par quels mécanismes le réflexe de repli dans le cocon rassurant d’une identité locale, biologique, ethnique ou religieuse est une constante de la culture politique française en temps de crise. Il est probable que, bien plutôt qu’à une rupture et à une mutation si volontiers proclamées dans des situations similaires, la société française soit confrontée à une rechute, à l’issue de laquelle elle ressaisira le fil un moment lâché de l’héritage des Lumières. Reste la question de savoir comment maintenir les chances de renouveau de l’esprit de responsabilité dans une société dont la vitalité souffre d’être actuellement soumise au rouleau compresseur de ce que François Ewald appelle « l’évidence sécuritaire ». Au-delà des réponses d’ordre intellectuel et institutionnel suggérées dans ces pages, il est possible d’espérer contenir la dérive préventive de l’État providence en renouant avec son inspiration première et en réinjectant de la responsabilité dans son modèle de répartition. Une solution, d’autant moins utopique qu’elle est inscrite de longue date dans la tradition sociale française, devrait être cherchée du côté du mutualisme, et de ce qu’on pourrait appeler la solidarité assurantielle. Le principe en a été posé il y a plus d’un siècle, lors du vote de la loi de 1898 sur les accidents du travail, qui s’inspirait en partie du « solidarisme » de Léon Bourgeois. Solidarité, de Léon Bourgeois, pour avoir été rapidement oublié après sa publication en 1896, n’en constitue pas moins un de ces jalons qui fixent une culture à travers une doctrine. La doctrine, contractuelle, donc individualiste, reprenait la notion rousseauiste de réciprocité entre le citoyen et la société, en l’étendant aux relations entre les générations. Le même état d’esprit, nous le trouvons, au même moment, dans un essai, Les accidents du travail et la responsabilité civile, publié par l’historien du droit et théoricien de l’individualisation de la peine, Raymond Saleilles, en 1897. Nous le trouvons surtout dans les débats parlementaires qui ont entouré le vote de la loi de 1898 sur les accidents du travail, et qui ont été analysés par François Ewald dans son ouvrage monumental L’État Providence (Grasset, 1986). Le principe de base était la responsabilité. Ce principe posé, le législateur était obligé de convenir qu’un chantier moderne comporte des risques qui ne peuvent engager la seule responsabilité du travailleur blessé. Même si ce dernier a commis une erreur, cette erreur ne peut être assimilée à une faute : il est rare qu’on fasse exprès de se couper la main. D’où l’idée d’une solidarité nécessaire. En cas d’accident du travail, on jugeait normal que l’accidenté fût considéré comme une victime, et que la responsabilité de l’employeur fût engagée – de la même façon que, dans la loi Badinter de 1985, la responsabilité de l’automobiliste a été considérée comme prévalente par rapport à celle du piéton, mais sans qu’il en fût tiré les mêmes conséquences. Sur cette base, il est apparu en 1898 que la solvabilité de l’employeur devait être garantie dans son propre intérêt comme dans celui de l’employé. Le législateur a donc invité l’employeur à s’assurer auprès d’une mutuelle. Le coût de l’assurance étant proportionnel au nombre d’accidents survenus sur le chantier, l’employeur avait intérêt à faire le maximum pour améliorer les conditions de sécurité de son entreprise. En d’autres termes, ce que la notion de responsabilité personnelle perdait du fait de la solidarité, elle le retrouvait à travers l’assurance. L’indemnisation et la sécurité du travailleur étaient garanties, sans que la société eût à fixer des normes, à exiger des contreparties, et à intervenir autrement que par le contrôle. Il est d’usage, depuis les années 1980, chez les spécialistes des problèmes sociaux, de regretter que le système français de sécurité sociale qui a été mis en place après la Libération n’ait pas su choisir entre le modèle allemand de l’assurance, et le modèle anglais de la solidarité. Si artificiel que soit ce débat, il semble que si notre protection sociale avait su rester fidèle à la logique de la solidarité par l’assurance, dont la loi de 1898 propose l’archétype, les acteurs sociaux seraient un peu plus responsables, la sécurité sociale un peu moins en déficit et que l’imagination préventive et normalisatrice de l’État providence trouverait moins de prétextes à se donner libre cours.

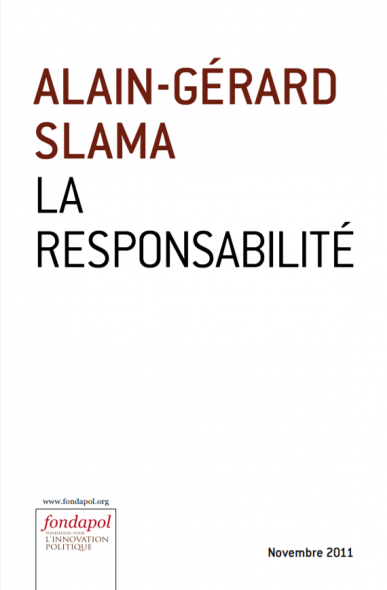











Aucun commentaire.