La révision constitutionnelle de 2008 : un premier bilan
Préface
Introduction – Dix ans. après
L’encadrement du pouvoir exécutif
Le renforcement du Parlement
L’amélioration de la garantie des droits
Conclusion
Préface
La Constitution de la Ve République entre dans sa soixantième année. Elle a traversé de nombreuses épreuves, dont celle, à trois reprises, de la cohabitation. Elle a doté notre pays d’institutions stables et efficaces. Elle a élargi l’assise du régime républicain en démontrant sa capacité à fonctionner au service de tendances politiques différentes qui, toutes, se sont montrées satisfaites des moyens qu’elle a mis à leur disposition.
Inhabituelle dans l’histoire constitutionnelle française, à la notable exception de la IIIe République, pareille longévité tient à l’adaptabilité de la Constitution de 1958, dont le texte a été vingt-trois fois modifié et le sera peut-être une fois encore dans les mois qui viennent. Au cours des soixante ans écoulés, trois étapes principales ont marqué l’évolution institutionnelle de notre pays.
La première étape a été franchie avec la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962, en vertu de laquelle le président de la République est élu au suffrage universel direct. Renforcé par l’élection des députés au scrutin majoritaire à deux tours, le changement ainsi apporté à l’équilibre institutionnel mis en place en 1958 a conféré à la Ve République son caractère propre. Le chef de l’État y dispose de prérogatives spécifiques de grande importance, notamment avec le droit de dissolution et celui de recourir au référendum, mais il exerce surtout un rôle politique prépondérant puisque la coutume lui reconnaît le droit, en dehors des périodes de cohabitation, de mettre fin aux fonctions du Premier ministre. En d’autres termes, à l’inverse des régimes parlementaires, dans lesquels le chef du gouvernement détient à lui seul la totalité du pouvoir exécutif, et des régimes présidentiels, dans lesquels il en va de même pour le chef de l’État, le partage des rôles entre le président de la Ve République et le Premier ministre obéit à des règles coutumières, parfois ambiguës mais marquées du sceau d’un présidentialisme théorisé par le général de Gaulle dès 1964. En outre, à l’exception des périodes de cohabitation, la réduction à cinq ans de la durée du mandat présidentiel décidée par la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 et l’inversion du calendrier électoral adoptée en 2002, qui a pour effet de lier étroitement le scrutin présidentiel et les élections législatives, ont accentué le caractère présidentialiste du régime.
Dans le même temps, si les pouvoirs reconnus au président de la République ont une portée réelle bien supérieure aux attributions de ses homologues des IIIe et IVe Républiques, et si cette évolution semble rencontrer l’adhésion de l’opinion publique, l’acception présidentialiste de la Constitution porte la marque d’une certaine fragilité. Si la concordance des scrutins favorise celle des majorités, présidentielle et parlementaire, elle ne la garantit pas. Par ailleurs, elle demeure exposée au décès ou à la démission du président de la République comme à l’exercice de son droit de dissolution de l’Assemblée nationale. Enfin, si le mode de scrutin retenu pour l’élection des députés devait ne plus permettre de dégager des majorités nettes, la prépondérance du rôle du président de la République dans l’exercice du pouvoir exécutif serait menacée.
La deuxième évolution marquante de la Constitution de 1958 est liée aux transferts et aux partages de souveraineté qui, depuis l’adoption de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 portant ratification du traité de Maastricht, ont conduit à des révisions constitutionnelles dont l’objet même concernait, pour reprendre les termes utilisés par le Conseil constitutionnel, les « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». De ce point de vue, la réduction du champ de la souveraineté nationale a consisté à transférer ou partager des compétences régaliennes mais aussi à priver l’État de certaines de ses prérogatives traditionnelles au profit de l’Union européenne. Surtout, les révisions constitutionnelles adoptées les 25 juin 1992, 25 janvier 1999, 25 mars 2003, 1er mars 2005 et 4 février 2008 ont consacré la primauté du droit européen, y compris dérivé, sur la loi nationale et ont donné un fondement constitutionnel spécifique à la construction européenne. Le Conseil constitutionnel en a tiré les conséquences en reconnaissant l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international.
Cette évolution est sans conteste l’une des plus importantes qu’ait connue la Constitution de 1958. Elle a été conduite, force est de le constater, en dépit d’une certaine réticence populaire, puisque le traité de Maastricht n’a été adopté que par 51% des suffrages exprimés lors du référendum de septembre 1992, que le traité « établissant une Constitution pour l’Europe » a été rejeté lors du référendum de mai 2005 et que le traité de Lisbonne, au contenu quasiment identique, a dû être ratifié par la voie parlementaire. Pour autant, ainsi que l’a relevé le Conseil constitutionnel en 2004, l’exigence constitutionnelle qui s’attache à la primauté du droit européen ne trouverait pas à s’appliquer dans les cas où le droit européen serait contraire à une règle ou à un principe « inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ».
La troisième évolution la plus forte de la Constitution de 1958 procède de la révision du 23 juillet 2008. Adoptée d’extrême justesse par le Congrès, cette révision constitutionnelle a repris l’essentiel des soixante-dix-sept propositions du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République. Elle reste, à ce jour, la plus importante des lois constitutionnelles promulguées depuis 1958, non seulement parce qu’elle comportait quarante-sept articles, mais aussi parce qu’elle avait pour ambition de transformer le visage de la Ve République, de la rendre, selon la formule retenue par le Comité, « plus démocratique ».
La révision constitutionnelle de 2008 a introduit des transformations importantes dans le fonctionnement de la Ve République. Il nous est donc apparu utile, dix ans plus tard, d’en dresser un bilan critique et de déterminer dans quelle mesure les innovations qu’elle a introduites dans le fonctionnement des institutions ont abouti.
Encadrer l’exercice du pouvoir exécutif, renforcer le rôle du Parlement, garantir des droits nouveaux aux citoyens : c’est à l’aune de ces trois objectifs que le rapporteur général du Comité s’efforce, dans les pages qui suivent, d’apprécier dans quelle mesure la révision de 2008 a eu des effets heureux sur la pratique institutionnelle.
Bilan positif quant à l’encadrement du pouvoir exécutif, bilan nuancé pour ce qui concerne le renforcement du rôle du Parlement ; succès inattendu, et parfois critiqué, pour ce qui a trait à la protection des droits et libertés du fait de la création du Défenseur des droits, de l’irruption de la question prioritaire de constitutionnalité dans le paysage juridique français et de la judiciarisation de la vie publique au profit du Conseil constitutionnel : telles sont les conclusions de ce travail.
Il en ressort que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a incontestablement marqué l’histoire de la Ve République, qu’elle en a transformé le visage. Pour autant, elle n’en a pas modifié les spécificités. En encadrant et en modernisant l’exercice des attributions du pouvoir exécutif, elle n’a pas porté atteinte à ce qui est le propre du régime : un pouvoir exécutif fort. En renforçant le rôle du Parlement, elle s’est bornée à rééquilibrer le fonctionnement des institutions, avec un succès d’ailleurs inégal. En améliorant la protection des droits et libertés des citoyens, elle a rendu à la Constitution la place centrale que des juridictions supranationales étaient en train de lui ravir.
Dix ans plus tard, l’appréciation globale que l’on peut porter sur la révision constitutionnelle de 2008 est donc positive. Elle a fait naître un équilibre institutionnel nouveau, qu’il importe de laisser se parfaire.
Présidentialisation du régime décidée en 1962 et accentuée en 2000, transfert et partage de souveraineté favorisés depuis 1992 au profit de l’Union européenne, rééquilibrage des institutions en 2008 : telles sont les évolutions marquantes de la Constitution de 1958 à l’aube de ses soixante ans d’existence.
Chacune de ces évolutions a été utile à notre pays. Aucune d’entre elles n’a altéré les institutions à la fois robustes et souples que le caractère national rend indispensables au fonctionnement harmonieux et efficace du régime républicain. À l’heure où semble se profiler une nouvelle révision constitutionnelle, nous ne pouvons que former le vœu que son utilité soit dûment établie.
Édouard Balladur Jack Lang
Introduction – Dix ans. après
Adoptée d’extrême justesse par le Congrès, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 avait repris l’essentiel des soixante-dix-sept propositions du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République. Elle reste, à ce jour, la plus importante des lois constitutionnelles promulguées depuis 1958, non seulement parce qu’elle comportait quarante-sept articles, mais aussi parce qu’elle avait pour ambition de transformer le visage de la Ve République, de la rendre, selon la formule retenue par le Comité, « plus démocratique ». Il s’agissait, selon ce dernier, de renforcer le rôle du Parlement et de promouvoir les droits et libertés pour mettre fin à un déséquilibre qui ne correspondait plus « aux exigences d’une démocratie irréprochable ».
La révision constitutionnelle de 2008 fut en son temps critiquée, et le demeure quelque peu, au moins par une partie de la doctrine. Issue des travaux d’un comité composé majoritairement d’universitaires réputés raisonnables et réformistes, elle reflétait un consensus académique « de bon ton » et n’aurait eu d’autre objet, conformément au modèle libéral européen, que de remettre notre pays dans le droit chemin démocratique dont il se serait écarté en 1958. La réflexion interministérielle préalable à son examen par le Parlement aurait été succincte, les assemblées parlementaires n’auraient pas substantiellement modifié le « paquet » dont elles étaient saisies et la révision aurait été adoptée sans ferveur particulière, la discussion parlementaire se bornant à ajouter au texte du gouvernement l’extension de l’habilitation à « favoriser l’égalité des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales », et à prévoir un référendum d’initiative conjointe (un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales) qui n’a jamais reçu le moindre début d’application. Ce nonobstant, la révision de 2008 aurait bouleversé les équilibres institutionnels, ainsi sans doute que les membres du Comité en avaient secrètement formé le vœu.
On ne disconviendra pas que la révision constitutionnelle de 2008 a introduit des transformations importantes dans le fonctionnement de la Ve République. Tel était au demeurant son objet même. Pour autant, a-t-elle, comme on va le répétant en certains milieux, dénaturé le régime ? Dix années plus tard et alors que la perspective d’une nouvelle révision constitutionnelle se fait jour, il est utile de dresser un bilan critique de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et de déterminer dans quelle mesure les innovations qu’elle a introduites dans le fonctionnement des institutions se sont révélées heureuses et abouties.
La révision constitutionnelle de 2008 poursuivait, on s’en souvient, un triple objectif : encadrer l’exercice du pouvoir exécutif, renforcer le rôle du Parlement et garantir des droits nouveaux aux citoyens. On examinera donc les effets de la révision de 2008 au regard des dispositions principales relevant de ces trois critères d’appréciation.
L’encadrement du pouvoir exécutif
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a entendu rendre plus démocratique l’exercice des pouvoirs du chef de l’État. C’est ainsi, et le symbole était fort s’agissant de l’une des attributions les plus emblématiques du président de la Ve République, que l’article 16 de la Constitution a été réformé en ouvrant la possibilité, pour le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, de saisir le Conseil constitutionnel aux fins de vérifier, passé un délai de trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, si les conditions prévues pour leur mise en œuvre sont toujours réunies, et en prévoyant que le Conseil constitutionnel se saisit de plein droit de la question passé un délai de soixante jours.
De même, et alors que le comité Balladur, au terme d’un débat particulièrement nourri, n’avait pas proposé de modifier l’article 6 de la Constitution, la révision constitutionnelle a prévu qu’il serait dorénavant interdit au président de la République d’exercer plus de deux mandats consécutifs. Pour le reste, la révision de 2008 a entendu moderniser les modalités d’exercice des attributions essentielles du chef de l’État.
À cette fin, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ajouté à l’article 18 de la Constitution, qui, dans la droite ligne du « cérémonial chinois » instauré contre Adolphe Thiers par la loi de Broglie en 1873, se bornait à prévoir que «le président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat», deux alinéas ainsi rédigés : « Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote » et « Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet ».
Ces dispositions nouvelles ont fait l’objet, en leur temps, de nombreuses critiques, tirées de ce que la possibilité ainsi offerte au président de la République de s’exprimer devant la représentation nationale portait en germes la possibilité d’une responsabilité de ce dernier devant le Parlement. Autrement dit, la nouvelle rédaction de l’article 18 serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Pour peu nourrie qu’elle soit, l’expérience n’a, à ce jour, pas justifié ces craintes. Le chef de l’État n’a usé de cette faculté qu’à quatre reprises depuis 2008 : Nicolas Sarkozy, le 22 juin 2009, pour tracer les grandes lignes de la politique économique et sociale en réaction à la crise économique et financière ; François Hollande, le 16 novembre 2015, après les attentats meurtriers du 13 novembre ; Emmanuel Macron, les 3 juillet 2017 et 9 juillet 2018, pour fixer les grandes orientations de sa politique et annoncer les modifications constitutionnelles qu’il appelait de ses vœux.
On observera que, quand bien même les députés de l’opposition pourraient-ils, une fois revenus au Palais-Bourbon, déposer une motion de censure contre le gouvernement, au motif que celui-ci applique la politique annoncée par le président de la République au Congrès, il n’y aurait rien là, bien au contraire, qui mettrait en péril la nature parlementaire du régime et rien n’indique qu’une telle pratique soit en voie d’être systématiquement utilisée. La nouvelle rédaction de l’article 18, dont il n’a pas été fait un usage abusif, traduit plutôt une conception moins étroite que jadis de la séparation des pouvoirs. Loin de l’usage protocolaire du droit de message dans sa version d’origine, la nouvelle rédaction de l’article 18 paraît donc inviter le président de la République à rendre compte de son action devant le Parlement sans méconnaître la conception française de la séparation des pouvoirs, fondée sur la collaboration fonctionnelle de pouvoirs organiquement séparés. Pour autant, comme souvent en matière institutionnelle, la pratique dessinera peu à peu les contours de l’usage que le président de la République fera du nouvel article 18. Il sera à cet égard intéressant d’observer si, comme on lui en prête l’intention, l’actuel président de la République prend l’habitude de s’adresser au Congrès une fois par an. Mais il va de soi que les considérations qui précèdent seraient privées de toute pertinence s’il advenait qu’à la faveur d’une révision de la Constitution le président de la République fût admis à assister au débat qui peut suivre son discours devant le Congrès et à répondre aux intervenants.
Poursuivant le même objectif de modernisation et d’encadrement des prérogatives présidentielles, la révision de 2008 s’est efforcée de porter remède à ce qu’il pouvait y avoir de discrétionnaire dans l’exercice du pouvoir de nomination dévolu, par l’article 13 de la Constitution, au président de la République. Dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle de 2008, le dernier alinéa de l’article 13 prévoit qu’une loi organique détermine les emplois ou fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du président de la République s’exerce après avis de la commission compétente de chaque assemblée, le chef de l’État ne pouvant procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. La loi organique ainsi prévue a été promulguée le 23 juillet 2010. Elle énumère les emplois et fonctions relevant de cette procédure en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation. Les règlements des assemblées ont, quant à eux, prescrit que, pour pouvoir exprimer leur avis, les commissions auditionnent le candidat et que, sauf si la loi l’interdit, l’audition peut être publique. Le but recherché en 2008 est ainsi atteint : le président de la République ne peut proposer que des personnalités capables de franchir l’obstacle de l’audition publique sans se ridiculiser. Pour le dire autrement, il doit donc tenir compte de leurs compétences pour soumettre leur nom aux commissions parlementaires.
Il a beaucoup été dit que l’exigence d’un avis défavorable à la majorité des trois cinquièmes privait l’exercice de tout risque sérieux pour les candidats. L’expérience a montré que cette majorité des trois cinquièmes pouvait être frôlée voire atteinte (ce fut le cas en janvier 2015 pour une nomination au Conseil supérieur de la magistrature), et, comme il vient d’être dit, on ne saurait trop insister sur les vertus de l’audition par les commissions parlementaires. S’agissant de l’encadrement du pouvoir exécutif, on peut donc affirmer que la révision constitutionnelle de 2008 a atteint les objectifs que le pouvoir constituant lui avait assignés. Pour autant, le partage des responsabilités entre le président de la République et le Premier ministre demeure flou, et contraire aux dispositions combinées des articles 5, 8, 20 et 21 de la Constitution. Demeure entier l’intérêt qui s’attacherait à prévoir, à l’article 5 de la Constitution, que le chef de l’État « définit la politique de la Nation » et, à l’article 20, que le gouvernement « conduit la politique de la Nation » et dispose « à cet effet » de l’administration et de la force armée. De même, tirant les conséquences de ce que la responsabilité du président de la République chef des armées est plus importante que les textes ne le prévoient et de ce que le partage des rôles avec le Premier ministre « responsable de la défense nationale » aux termes de l’article 21 de la Constitution demeure imprécis, y aurait-il lieu de prévoir, dans cet article 21, que le Premier ministre « met en œuvre les décisions prises dans les conditions prévues à l’article 15 en matière de défense nationale » ? On regrettera donc, sur ce point, que les propositions du comité Balladur n’aient pas été suivies et que la pratique institutionnelle demeure contraire à la lettre des dispositions combinées des articles 5, 8, 20 et 21 de la Constitution. Plus l’exercice des attributions du chef de l’État se révèle impérieux, plus l’ampleur du décalage entre le droit et le fait prend de relief.
Mais il est vrai que poser cette question revient à s’interroger sur la nature même du régime, et que nul ne semble prêt à sortir d’une ambiguïté qui, jusqu’alors, a plutôt conforté la solidité des institutions qu’elle ne l’a compromise.
Le renforcement du Parlement
C’est l’aspect le plus important, à défaut d’être le plus novateur, de la révision constitutionnelle de 2008. Le comité Balladur avait relevé que le parlementarisme rationalisé, dont la Constitution du 4 octobre 1958 porte la marque, a sans doute été utile, voire indispensable en son temps mais que, face à un pouvoir exécutif qui, en raison notamment du fait majoritaire, avait gagné en cohérence et en capacité d’action, il n’était que temps de prévoir que le Parlement remplisse mieux le rôle qui lui incombe dans toute démocratie moderne : voter les lois et contrôler le gouvernement. Autrement dit, le constat du Comité était que l’arsenal dont la Constitution dote le Premier ministre faisait du pouvoir exécutif le véritable inspirateur et le seul pilote du travail législatif, que, depuis 1962, le fait majoritaire avait resserré ce corset au point que le Parlement tendait à ressembler à une chambre d’enregistrement et la responsabilité du gouvernement à une fiction, et que la tutelle de l’exécutif sur le Parlement était d’autant plus offensante qu’elle était devenue inutile. Dans la lignée des recommandations du Comité, la révision constitutionnelle de 2008 a donc pris le parti de rudoyer, sans l’anéantir, la logique du parlementarisme rationalisé. Dans la mesure où cette logique était en quelque manière constitutive de la Ve République, d’aucuns vont jusqu’à penser que, ce faisant, la révision constitutionnelle de 2008 a porté un coup sévère au régime mis en place par le général de Gaulle.
Il est de fait que la révision constitutionnelle de 2008 a modifié la Constitution de telle sorte que la discussion parlementaire en séance publique se fait désormais sur la base du texte adopté par la commission permanente compétente (article 42), que la moitié de l’ordre du jour prioritaire est dorénavant fixé, hors textes financiers, par la Conférence des présidents (article 48), que les assemblées peuvent à nouveau adopter des résolutions en tous domaines et non plus dans un nombre limité de cas (article 34-1), que l’arme de l’article 49-3, c’est-à-dire la possibilité pour le Premier ministre d’engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte, celui-ci étant réputé adopté si aucune motion de censure n’est votée, est limitée à un texte par session, que toute intervention militaire à l’étranger doit donner lieu à information du Parlement et sa prolongation au-delà de six mois être autorisée par un vote (article 35), et que la Cour des comptes se voit attribuer le soin d’assister le Parlement dans son rôle de contrôle de l’action du gouvernement (article 47-2). Autrement dit, en modifiant de la sorte les rapports entre les pouvoirs et les méthodes du travail gouvernemental comme du travail parlementaire, la révision constitutionnelle de 2008 aurait procédé à rien moins qu’à l’abandon des traits distinctifs du parlementarisme rationalisé qu’étaient la maîtrise de l’ordre du jour, la discussion des textes sur la base du projet du gouvernement, la prohibition des résolutions ou encore la possibilité illimitée d’engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte.
Pourtant, le reproche de dénaturation des institutions de la Ve République ainsi adressé à la révision constitutionnelle de 2008 est en lui-même excessif. D’une part, les textes essentiels à la vie de la nation (révisions constitutionnelles, lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale) continuent à fairel’objet d’une inscription prioritaire à l’ordre du jour et les lois de finances et de financement de la sécurité sociale peuvent donner lieu à l’engagementillimité de la responsabilité du gouvernement selon le mécanisme de l’article 49-3 ; d’autre part, l’élargissement de la possibilité, pour les assembléesparlementaires, d’adopter des résolutions est encadré, puisque la recevabilité des projets de résolution est soumise à l’appréciation du gouvernement, qui peut s’opposer à leur inscription à l’ordre du jour s’il estime que l’adoption ou le rejet des propositions de résolution serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. Pour le dire autrement, si la révision constitutionnelle de 2008 a modifié certains des mécanismes du parlementarisme rationalisé, elle a davantage veillé à les adapter aux conséquences du fait majoritaire qu’à s’en affranchir totalement. Il suffit de comparer la procédure législative résultant de cette révision à celle en vigueur dans les grandes démocraties parlementaires pour se convaincre que l’«exception française» n’a, en cette matière, pas disparu. Il est donc très exagéré de prétendre que la révision constitutionnelle de 2008 aurait porté un coup fatal au régime en affaiblissant les mécanismes du parlementarisme rationalisé.
Plus féconde est la question de savoir si les réformes ainsi introduites ont abouti et ont produit les effets heureux qui en étaient attendus quant à la revalorisation du rôle du Parlement. De ce point de vue, on accordera volontiers aux critiques les plus sourcilleux de la révision constitutionnelle de 2008 que les résultats obtenus ne sont guère à la hauteur des espérances. Force est de constater ainsi que la revalorisation, réelle, du travail en commission ne s’est traduite ni par un renforcement du rôle du Parlement, ni par une amélioration de la qualité de la loi. Or, de toutes les innovations introduites par la révision de 2008 en matière de travail parlementaire, c’est bel et bien la discussion en séance publique non plus sur le texte initial du gouvernement mais sur le texte du projet de loi tel qu’amendé par la commission qui était la plus importante. Les commentateurs avisés ne s’y étaient pas trompés en 2008, le Conseil d’État, notamment, ayant manifesté des réserves tenant, en fait, à ce que le texte du gouvernement est, le plus souvent, le sien, supposé par construction de meilleure qualité que celui résultant du travail des commissions… Le nouvel article 42 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a eu pour effet que les ministres sont désormais tenus d’être bien davantage présents en commission qu’ils ne l’étaient auparavant, sans pour autant, mais nul ne pensait le contraire, être dispensés également d’être présents dans l’hémicycle lors de la discussion publique. L’objectif poursuivi était que les discussions techniques se déroulent en commissions, la séance publique étant le lieu privilégié du débat proprement politique. À la vérité, cet objectif n’a pas encore été atteint, s’il doit l’être jamais : les amendements techniques et rédactionnels n’ont pas disparu, il s’en faut de beaucoup, de la séance publique et la distinction entre le technique et le politique est demeurée lettre morte. Sans doute le pouvoir exécutif a-t-il perdu son rôle de pilote exclusif de la procédure législative, mais on ne peut tenir pour acquis que le temps supplémentaire que les ministres sont tenus de consacrer au travail parlementaire en commissions soit toujours productif. Dans tous les cas, le Parlement ne semble guère plus que par le passé corédacteur de la loi et sa contribution au travail législatif se borne encore, le plus souvent, à amender et sous-amender les projets de loi. En d’autres termes, la modification apportée à l’article 42 ne semble pas avoir encore produit les effets heureux qui en étaient attendus pour la revalorisation du travail parlementaire.
Une appréciation de même nature peut être portée sur une autre disposition de la révision constitutionnelle de 2008, celle qui, au troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution, prévoit que « la présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale et le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique », ladite loi organique, promulguée le 15 avril 2009, ayant exigé, conformément à l’intention du pouvoir constituant, que les projets de loi seraient assortis d’une étude d’impact. L’objectif poursuivi par cette importante réforme, délibérément mise en place pour endiguer l’inflation normative dont souffre notre pays, était que l’étude d’impact réponde à trois questions : faut-il une loi pour régler le problème posé ? Dans l’affirmative, les inconvénients résultant de la mesure proposée sont-ils proportionnés aux bénéfices escomptés ? S’il existe plusieurs scénarios de mise en application de la mesure envisagée, quel est celui qui présente le plus d’avantages pour le moins d’inconvénients ?
On pouvait nourrir de grands espoirs quant aux effets de cette réforme, même si on pouvait regretter que l’existence d’une étude d’impact digne de ce nom ne soit pas une condition de la recevabilité des projets de loi, et ce même si les projets de loi constitutionnelle, les projets de loi de ratification d’un traité, les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale et les projets de loi d’habilitation autorisant le gouvernement à agir par voie d’ordonnances n’entraient pas dans le champ de la réforme. Il aurait suffi que le Conseil d’État, dans un premier temps, et le Conseil constitutionnel, dans un second temps, attachent à l’existence de l’étude d’impact la même importance que le pouvoir constituant de 2008. Tel n’a pas été le cas. Le Conseil d’État a parfois assorti de remarques sévères les études d’impact présentées par le gouvernement, notamment en 2015 lors de l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, mais il n’est pas allé plus loin. Quant au Conseil constitutionnel, il a neutralisé la disposition organique en deux décisions. D’une part, il a estimé, lors de l’examen du projet de loi organique du 15 avril 2009 (décision no 2009-579 DC du 9 avril 2009), que l’élaboration de l’étude d’impact ne pouvait pas commencer en amont du processus décisionnel aboutissant à un projet de loi. Ce faisant, le Conseil constitutionnel a voulu ignorer que la raison d’être d’une étude d’impact est précisément d’inventorier les différentes options, y compris celles qui ne sont pas législatives. D’autre part, le Conseil constitutionnel a porté un second coup sévère au dispositif en jugeant, sans excès de motivation (décision no 2014-12 FNR du 1er juillet 2014), qu’était suffisante l’étude d’impact dont était assorti le projet de loi sur la délimitation des régions et la modification du calendrier électoral. C’était pourtant la première occasion qu’avait le Conseil constitutionnel de statuer dans le cadre de la procédure prévue par le quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution selon laquelle, en cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. Autrement dit, l’exigence d’une étude d’impact circonstanciée a été vidée de son contenu et tout se passe à nouveau comme si les études d’impact, souvent lacunaires dans l’évaluation des effets positifs ou négatifs des mesures législatives envisagées, se résumaient à un exposé des motifs à peine amélioré.
Il est donc à craindre que, sauf revirement de jurisprudence du Conseil constitutionnel et durcissement des appréciations du Conseil d’État sur les projets de loi dont il est saisi, il ne faille, à la faveur d’une prochaine révision constitutionnelle, améliorer le mécanisme mis en place en 2008 afin de lui donner sa pleine effectivité, plus que jamais nécessaire.
S’agissant du renforcement du rôle du Parlement, le bilan de la révision constitutionnelle de 2008 est donc nuancé. Le principal reproche que l’on peut adresser à ce volet de la révision de 2008 n’est sans doute pas d’avoir sapé les fondements de la Ve République. Il est plutôt de n’avoir qu’imparfaitement atteint ses objectifs, faute notamment d’être parvenu à modifier le comportement des parlementaires. Mais il est vrai que, dans ce domaine, les évolutions ne peuvent être réellement appréciées que sur la longue période et que, dix ans, encore marqués par les derniers feux du cumul des mandats, constituent une période courte.
Plus rapides en revanche ont été les évolutions apportées à la vie institutionnelle par l’amélioration de la garantie des droits et libertés voulue par la révision de 2008.
L’amélioration de la garantie des droits
Outre la création du Défenseur des droits à l’article 71-1 de la Constitution, la révision constitutionnelle de 2008 a apporté à la protection des droits et libertés des citoyens une novation fondamentale par la création, à l’article 61-1, de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Dans la mise en majesté du juge constitutionnel qui procède de cet aspect de la réforme et dans la judiciarisation de la vie publique qui en résulte, d’aucuns ont voulu voir la marque d’un recul de la démocratie représentative au profit de la démocratie des droits. Pour apprécier la portée de cette critique, on doit tout d’abord rappeler qu’avant la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la promulgation de la loi organique du 10 décembre 2009 prise pour l’application de son article 29, le contrôle de la conformité des lois à la Constitution, introduit dans la pratique de notre droit depuis une date relativement récente, était réservé au contrôle des lois adoptées mais non encore promulguées, de sorte que seul le « flux » des lois nouvelles pouvait ressortir de ce contrôle, à la diligence des plus hautes autorités de la République et de soixante parlementaires. Il en résultait que le « stock » des lois existantes, c’est-à-dire celles antérieures à 1958 et celles sur lesquelles, pour des raisons diverses, parfois accidentelles mais plus souvent politiques, le Conseil constitutionnel ne s’était pas prononcé demeuraient valides, sans qu’il soit loisible au juge judiciaire ou administratif de les déclarer contraires à la Constitution, quand bien même cette contrariété aurait été revêtue du sceau de l’évidence.
Cette situation, qui avait certes l’avantage de cantonner le Conseil constitutionnel dans un rôle de régulateur des pouvoirs publics plus que de juge, présentait un double inconvénient. D’une part, l’existence de textes législatifs manifestement contraires à la Constitution introduisait un élément de trouble dans l’ordre juridique et était susceptible de priver les citoyens de la faculté de faire valoir la plénitude de leurs droits ; d’autre part, les lois existantes pouvaient tomber sous le coup de l’appréciation de cours supranationales (Cour de justice de l’Union européenne, Cour européenne des droits de l’homme) et même un juge national, judiciaire ou administratif, pouvait priver la loi de son effet s’il estimait que le traité devait prévaloir sur la loi contraire. En d’autres termes, le système existant avant 2008 avait ceci de paradoxal que la loi internationale offrait aux citoyens une meilleure garantie de la protection de leurs droits et libertés que la Constitution issue de leur vote. Cette dissymétrie était d’autant moins acceptable que les principes dont les juges supranationaux faisaient application étaient, le plus souvent, voisins des principes constitutionnels nationaux. Fallait-il se satisfaire d’un système qui attachait plus de prix à la norme de droit international qu’à la Constitution elle-même ? Le comité Balladur ne l’a pas pensé, qui a proposé que soit mis en place un mécanisme de contrôle a posteriori de la conformité de la loi à la Constitution et suggéré que ce mécanisme soit repris de celui retenu en 1993 par le comité consultatif présidé par le doyen Vedel.
Ainsi est né l’article 61-1 de la Constitution, qui ajoute au contrôle a priori, lequel demeure, un contrôle a posteriori, que peut déclencher tout justiciable estimant que la loi dont il lui est fait application comporte des dispositions contraires aux droits et libertés que garantit la Constitution. La question peut être soulevée devant n’importe quel juge, judiciaire ou administratif, qui la renvoie à sa cour suprême. S’ils l’estiment nouvelle et sérieuse, la Cour de cassation ou le Conseil d’État, selon le cas, renvoient la question au Conseil constitutionnel, qui statue dans les trois mois.
Comme on pouvait le penser, l’irruption de la QPC dans le paysage juridique français l’a profondément transformé et, surtout, a donné au Conseil constitutionnel un rôle nouveau, tour à tour encensé ou critiqué par la doctrine. Il est de fait que ce mécanisme n’a pas seulement permis de purger les inconstitutionnalités flagrantes entachant les lois votées avant 1958. Contrairement à ce que d’aucuns espéraient, le flot des QPC ne s’est pas tari avec le temps : le nombre d’affaires jugées chaque semaine par le Conseil constitutionnel est de deux à quatre, malgré le filtrage opéré par le Conseil d’État et la Cour de cassation. Il s’ensuit que le Conseil constitutionnel juge près de trois fois plus d’affaires par an qu’avant la révision constitutionnelle de 2008 et que le nombre de QPC jugées a dépassé le nombre total des lois qui ont fait l’objet d’un contrôle a priori depuis 1958. Surtout, le Conseil constitutionnel est devenu une véritable juridiction, où se déroulent audiences publiques et où résonnent les plaidoiries, parfois brillantes, des avocats. Le taux de censure, de un sur trois, n’est pas anecdotique et affecte non seulement des dispositions anciennes mais aussi des textes récents, voire très récents. Ce sont ainsi des pans entiers du droit positif qui sont remis en cause, notamment en matière pénale, fiscale, sociale, commerciale ou civile.
Dresser la liste des domaines du droit affectés par le mécanisme de la QPC suffit à montrer que, bien davantage que le contrôle de constitutionnalité a priori, la QPC a permis au « constitutionnalisme » d’irradier toutes les branches du droit, ce dont, selon les cas, la doctrine se réjouit ou s’inquiète. Il n’en est pas moins vrai que la jurisprudence née de la QPC devient, en certaines matières, tellement subtile qu’elle peut apparaître de moins en moins lisible. Surtout, elle confère au juge constitutionnel un rôle central dans le jeu d’aller-retour entre le Parlement et la rue de Montpensier. Comme la transposition des directives européennes, la censure a posteriori de la loi oblige le Parlement à légiférer « sous contrainte », notamment lorsque la censure du Conseil constitutionnel porte sur la proportionnalité des restrictions apportées aux droits et libertés, ou encore lorsqu’elle sanctionne l’incompétence négative du législateur.
Cette jurisprudence sourcilleuse, illustrée ces dernières années par les décisions rendues en matière pénale (garde à vue, détention provisoire, perquisitions, saisies, transaction pénale, régime pénitentiaire, exécution des peines, sanctions tombant sous le coup de la règle non bis in idem) ou dans le domaine de la lutte contre le terrorisme (zones de sécurité, consultation de sites djihadistes, saisies de données informatiques) met en relief les cas dans lesquels le Parlement peut être regardé comme légiférant sous la dictée du juge constitutionnel. Faut-il en conclure que la démocratie représentative est en voie d’effacement, qu’elle est supplantée par une « démocratie des droits », dont l’acteur majeur serait le juge et non plus les élus de la nation ? Doit-on noircir encore ce sombre tableau en affirmant que la marge de manœuvre du Parlement, et par suite de la démocratie représentative, se réduit à grande vitesse sous la pression combinée du juge constitutionnel et des cours supranationales ? Ce serait, à notre sens, aller un peu vite en besogne. Dix ans de QPC ont sans doute transformé le paysage juridique français, mais on ne saurait se plaindre de ce que les droits et libertés garantis par la Constitution soient mieux protégés dans une part croissante du droit positif.
Que le Parlement soit parfois contraint de « revoir sa copie » tient moins au caractère impérieux et sourcilleux de la jurisprudence constitutionnelle qu’aux imperfections mêmes de la loi et à l’obstination parfois déraisonnable du gouvernement, qui persiste à croire que l’adoption d’une loi suffit à régler tous les problèmes. Ajoutons que le filtrage des QPC par le Conseil d’État et la Cour de cassation est, par lui-même, de nature évolutive. On peut imaginer que les deux cours suprêmes durcissent peu à peu leur jurisprudence et renvoient moins facilement au Conseil constitutionnel les QPC dont ils sont saisis. Il fut un temps, pas si lointain, où la Cour de cassation rechignait, non sans céder à la provocation, à transmettre les QPC, pendant que le Conseil d’État avait fait le choix de les transmettre très largement, aux fins de fixation de la jurisprudence. Depuis lors, un équilibre a été trouvé. Il est sans doute perfectible et ne manquera d’être amélioré tant il est vrai que le dialogue des juges est une donnée qui ne peut être sous-estimée.
Enfin, le Conseil constitutionnel ne peut être tenu pour responsable ni de la mauvaise qualité de la loi, ni de l’inflation normative. À cet égard, on ne peut que former le vœu que les formations consultatives du Conseil d’État exercent une vigilance accrue sur la constitutionnalité des textes dont elles sont saisies et que le législateur en tienne compte. Certains auteurs ont proposé qu’un remède plus radical soit porté aux conséquences résultant des empiétements du juge constitutionnel. Ils suggèrent que la Constitution soit révisée de telle sorte qu’une disposition législative déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel puisse être maintenue en vigueur dès lors que le Parlement se prononcerait en ce sens par un vote à la majorité qualifiée intervenant dans un certain délai à compter de la censure. Un tel « lit de justice » législatif constituerait le pendant au « lit de justice constitutionnel » dont la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993 avait donné l’exemple en matière de droit d’asile. La proposition est digne d’intérêt et s’écrirait aisément. On peut toutefois se demander si l’occasion ne pourrait pas être saisie pour étendre ce mécanisme aux cas dans lesquels une disposition législative serait déclarée contraire à un traité par une cour supranationale et si cette manière de « contredit législatif » ne pourrait également emprunter la voie du référendum de l’article 11.
Quoi qu’il en soit, si l’irruption de la QPC dans l’ordre juridique français a sans doute apporté des bouleversements qui n’avaient pas tous été perçus par le pouvoir constituant de 2008, il est tout de même heureux, quelque critique que l’on puisse adresser à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et à la juridictionnalisation de cette institution, que les droits et libertés des citoyens soient mieux protégés que naguère et le soient par l’effet de la Constitution elle-même.
Conclusion
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a incontestablement marqué l’histoire de la Ve République ; elle en a transformé le visage, elle n’en a pas altéré les spécificités. En encadrant et en modernisant l’exercice des attributions du pouvoir exécutif, elle n’a pas porté atteinte à ce qui est le propre du régime : un pouvoir exécutif fort. En renforçant le rôle du Parlement, elle s’est bornée à rééquilibrer le fonctionnement des institutions, avec un succès d’ailleurs inégal. En améliorant la protection des droits et libertés des citoyens, elle a rendu à la Constitution la place centrale que des juridictions supranationales étaient en train de lui ravir.
Dix ans plus tard, le bilan de la révision constitutionnelle de 2008 est donc largement positif, même s’il doit être, on l’a vu, nuancé sur certains points. Un équilibre institutionnel nouveau est né, qu’il importe de laisser se parfaire à mesure que les effets heureux de la suppression du cumul des mandats ne manqueront pas de produire et que la professionnalisation du Conseil constitutionnel s’imposera d’elle-même au fil des nominations de ses membres.
Voilà pourtant que se profile à l’horizon une nouvelle révision constitutionnelle. Il est trop tôt, à l’heure où ces lignes sont écrites, pour porter une appréciation complète et argumentée sur le projet dont a été saisie l’Assemblée nationale et qui comporte, outre des dispositions exclusivement constitutionnelles, des dispositions relevant de la loi organique et de la loi ordinaire.
Sur les dispositions proprement constitutionnelles, on ne voit pas bien, s’agissant du Conseil supérieur de la magistrature, en quoi le remplacement de l’avis simple par l’avis conforme pour la nomination des magistrats du Parquet changera une pratique désormais bien établie. Que la Constitution soit modifiée de telle sorte que les anciens présidents de la République cessent d’être membres de droit du Conseil constitutionnel est une mesure attendue, dans la logique de la juridictionnalisation de l’institution. En revanche, la suppression de la Cour de justice de la République serait une lourde erreur, et il est quelque peu étonnant que le débat public ait jusqu’alors évité la question. Inscrit dans la Constitution, le remplacement de cette juridiction spécialisée par une juridiction de droit commun battrait en brèche le principe de la séparation des pouvoirs et, par l’insécurité juridique qu’elle créerait pour les membres du gouvernement, inciterait les ministres à rejoindre la cohorte des « prudents ou des empêchés » dont le chef de l’État a dit craindre l’émergence lors de ses vœux à la Cour de cassation.
Multiplier les cas dans lesquels les ministres seraient tenus de quitter leurs fonctions alors que les accusations lancées contre eux seraient dénuées de fondement, exposer l’action ministérielle au harcèlement de plaignants et parties civiles de tous ordres, admettre les inévitables empiétements des juges judiciaires sur la gestion des affaires de l’État qui peut poser des questions qu’ils n’ont pas coutume de résoudre : est-on vraiment prêt à franchir ce pas, au risque de bafouer le principe de la séparation des pouvoirs ?
Quant aux dispositions du projet relatives à la procédure parlementaire, elles prennent l’allure d’une reprise en main de celle-ci par l’exécutif et fragilisent l’équilibre institutionnel mis au jour dans la foulée de la révision de 2008. Il est vrai que, dans la mesure où les dispositions organiques et ordinaires par ailleurs envisagées par le gouvernement introduisent une dose de 17 % de représentation proportionnelle pour l’élection des députés, le phénomène majoritaire qui, depuis 1962, domine la vie politique, tendra sans doute à s’estomper. Dès lors, le retour en force du parlementarisme rationalisé peut s’expliquer, au moins du point de vue du gouvernement, mais on peut sérieusement douter qu’il en résulte un surcroît de démocratie pour la Ve République.
Assorti de dispositions législatives organiques et ordinaires prévoyant, notamment, une limitation des mandats électifs dans le temps qui rudoie l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et une diminution drastique du nombre des parlementaires dont on perçoit mal la justification, le « paquet » constitutionnel soumis à l’examen des assemblées apparaît inutile quand il n’est pas dangereux, ne serait-ce que dans la mesure où il a d’ores et déjà donné lieu à l’adoption d’amendements dénués de sérieux. Peut-être est-il de nature à bouleverser les logiques institutionnelles de la Ve République et s’apparente-t-il, à bien des égards, à un saut dans l’inconnu.
En regard, la révision constitutionnelle de 2008, si critiquée par les gardiens de la saine doctrine, apparaîtra pour ce qu’elle a voulu être : une tentative équilibrée d’adaptation de la Ve République aux nécessités du temps.

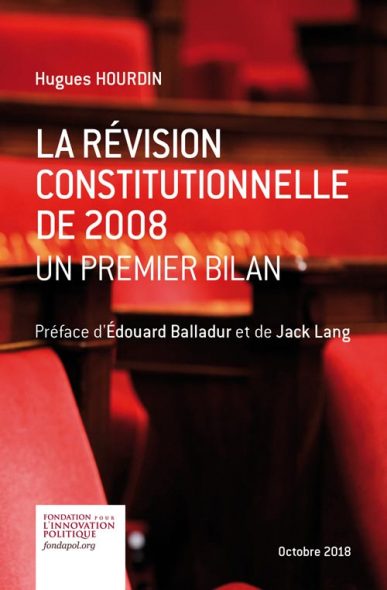











Aucun commentaire.