Le christianisme et la modernité européenne (1) récuser le déni
Introduction
La querelle des héritages
L’Europe face à ses héritages
Religion, théologie et éthique : l’impensé de la laïcité
Le christianisme comme sécularisation : le fondement de la modernité ?
La religion comme structure sociale et filiation
De l’oubli de la tradition à sa critique ignorante
Le christianisme dans la refondation du monde
Subjectivation
Différenciation
Rationalisation
Résumé
On a parfois tendance, aussi bien en France que dans l’Union européenne, à occulter le rôle important de la religion chrétienne dans la généalogie de la modernité. Cette note se propose de récuser ce déni, en insistant sur le rôle (paradoxal) joué par la réflexivité chrétienne dans lasortie de l’univers théocratique et dans l’émergence de la civilisation démocratique.
La seconde partie de cette note, publiée simultanément, s’intitule Le christianisme et la modernité européenne (2) Comprendre le retour de l’institution religieuse. Après avoir abordé les résistances religieuses qui ont fait obstacle à la constitution de la modernité occidentale et qui ont souvent débouché sur la mise à l’écart des Églises, elle vise à montrer comment les institutions religieuses font aujourd’hui leur retour dans l’espace public.
Philippe Portier,
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (PSL-Sorbonne)
Jean-Paul Willaime,
Directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études (PSL-Sorbonne).
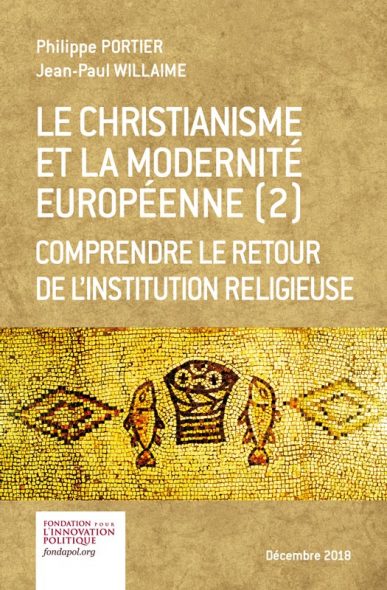
Le christianisme et la modernité européenne (2) comprendre le retour de l'institution religieuse
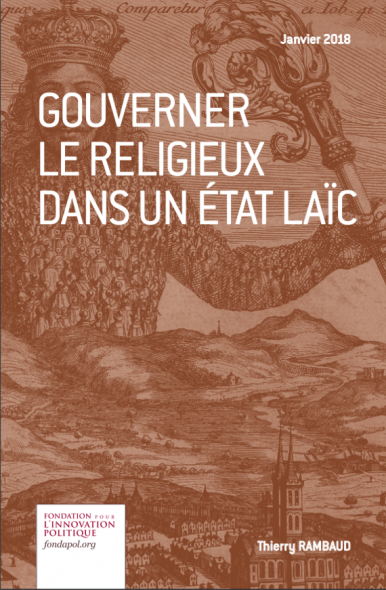
Gouverner le religieux dans un État laïc

La religion dans les affaires : la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise)

La religion dans les affaires : la finance islamique
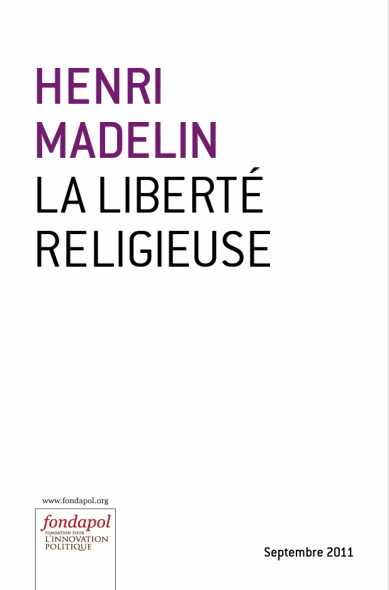
La liberté religieuse

Où va la politique de l’Église catholique ? D’une querelle du libéralisme à l’autre
Introduction
Voir Yves Lambert, « Âges, générations et christianisme en France et en Europe », Revue française de sociologie, vol. 34, n° 4, octobre-décembre 1993, p. 525-555
Vincent Delecroix, Apocalypse du politique, Desclée de Brouwer, 2016, 133.
Jean-Marie Donegani, «La mondanisation du salut», Recherches de science religieuse, 100, n° 3, juillet- septembre 2012, p. 363
Comment considérer, du point de vue des sciences sociales, les apports du christianisme à la production de la modernité européenne ? Le sujet est non seulement complexe, mais il est aussi discuté tant la question du rapport au christianisme, dans notre société sécularisée et notre république laïque, reste sensible. Comme si reconnaître ces apports était gênant car remettant en cause un récit largement partagé : la modernité, en Occident, se serait construite contre la religion et constituerait avant tout une «sortie de la religion», en particulier, du christianisme. Mais que signifie « sortir du christianisme » ? Certes, les taux d’appartenance et de pratique ont chuté1 mais cela signifie- t-il que nous soyons véritablement sortis du christianisme ? D’un certain christianisme, assurément, oui, celui qui se concevait comme système englobant de la société ; mais du christianisme en général, cela est moins sûr.
En effet, « l’histoire du christianisme est traversée d’un bout à l’autre par les mises en garde, venues de son propre sein, contre les effets de son institutionnalisation et, ce qui n’est pas la même chose, de sa compromission avec le pouvoir séculier, et par le rappel à la pureté du message évangélique2 ». En intégrant dans sa logique interne une autocritique de ses réalisations, la religion chrétienne participe de facto à un principe important de la modernité : la réflexivité permanente. Puisqu’il est évident que nous sortons d’une certaine configuration socioculturelle du christianisme, pourquoi en exclure une autre configuration? Il faudrait d’abord dire de quel christianisme nous sortons, ce qui permettrait d’être plus attentifs aux recompositions chrétiennes contemporaines, et s’interroger ensuite sur ce que signifie exactement « sortir ». Comme l’a fort justement fait remarquer Jean-Marie Donegani, « cette sortie du christianisme peut être interprétée soit comme on sort d’un pays, soit comme on sort de ses parents3 ». La première interprétation accentue la rupture puisque, dans ce cas, on quitte un monde, le monde chrétien, pour entrer dans un autre, le monde moderne. La seconde interprétation a une tout autre signification puisqu’elle pointe une continuité entre le monde moderne et le monde chrétien : ce dernier ne serait pas étranger à l’émergence du premier. Disons-le d’emblée, cette seconde interprétation nous paraît plus juste que celle qui privilégie unilatéralement la rupture. Sans nier les résistances et les conflits qui ont ponctué l’émergence de la modernité occidentale, le schéma de la « guerre des deux France » (catholique et laïque) a occulté le rôle important du christianisme dans la généalogie de cette modernité et masque aujourd’hui les reconfigurations du rôle du christianisme dans l’ultra modernité contemporaine. C’est ce que cette note, écrite en deux parties et à quatre mains, voudrait montrer. Pour ce faire, nous nous sommes limités à l’Europe occidentale, ce qui explique que nous nous intéressions au christianisme catholique et protestant, et fassions peu mention du christianisme orthodoxe. Focalisé sur le christianisme comme corpus symbolique constituant une des sources de la modernité occidentale, ce texte n’aborde pas la question de la situation actuelle de cette religion, ni de sa vitalité mesurée à l’aune des taux d’appartenance, de pratiques cultuelles, d’ordinations, ni de sa diversité observée à travers les clivages et tensions internes qui la traversent. Les deux auteurs de ce texte ont étudié ces éléments importants dans d’autres publications.
La querelle des héritages
L’Europe face à ses héritages
Voir sur le débat français, Philippe Portier, « “Les racines chrétiennes de la nation’’, Parcours d’une controverse», in Olivier Da Lage (dir.), L’essor des nationalismes religieux, Paris, Demopolis,
Voir Edgar Morin, Penser l’Europe, Gallimard,
Voir Ronan McCrea, Religion and the Public Order of the European Union, Oxford University Press, 2010.
Pour une analyse plus détaillée, voir Jean-Paul Willaime, Europe et Les enjeux du XXIe siècle, Fayard, 2004.
« Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne», signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, « Préambule », 10
Ibid., p. 51.
Comme l’a révélée, en 2000, la querelle à propos de la mention des héritages religieux dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la référence à une dimension religieuse en général ou, plus précisément, au christianisme fait polémique4.
Pour les uns, il est évident que le fait que le christianisme représente une dimension importante de l’histoire et de la culture de l’Europe – et donc de son identité – implique qu’il doit être reconnu. Ne pas le faire serait ne pas vouloir prendre en compte ce qui a contribué à ce que nous sommes. Si on admet que l’hindouisme a joué un rôle important dans la civilisation de la péninsule indienne, que le bouddhisme a joué un grand rôle en Asie du Sud-Est, le confucianisme et le taoïsme en Chine, l’islam dans l’aire arabo-musulmane et dans quelques autres aires culturelles, pourquoi ne pas admettre que le profil civilisationnel de l’Europe a quelque chose à voir avec le christianisme ? L’universalité séculière dont se prétend porteuse cette civilisation, celle de la démocratie et des droits humains fondamentaux, de la science, du libre examen et du questionnement critique, n’est pas tombée du ciel. Cette universalité a émergé d’un terreau nourri par les apports de Jérusalem, d’Athènes et de Rome, est née des interrelations entre judaïsme et christianisme, d’une part, entre philosophie grecque et droit romain, d’autre part. Un terreau diversifié, donc, et qui a nourri de multiples tensions et conflits (de la querelle des investitures à la laïcité). Un terreau où le christianisme occupe une place importante. C’est parce que l’Occident a créé cette dimension universaliste affirmée que les Occidentaux se sont particulièrement préoccupés de l’« amélioration » de soi et des autres, y compris en justifiant des entreprises coloniales au nom de la civilisation et du progrès. Si la civilisation occidentale s’est voulue missionnaire en prétendant que ses idéaux et ses normes avaient une portée universelle, cela est dû à la rencontre entre le christianisme et des philosophies séculières questionnant ses affirmations et ses prétentions. Comme l’a bien montré Edgar Morin, l’Europe, c’est une dialogique entre la foi et le doute5. Aujourd’hui, alors que les Églises chrétiennes ont renoncé au pouvoir temporel, nous observons les incontestables affinités de l’éthique chrétienne avec les idéaux républicains de liberté, d’égalité et de fraternité. Sans nier les reconfigurations contemporaines du paysage religieux et convictionnel de l’Europe et les effets de la sécularisation, ni les conflits qui ont régulièrement opposé les autorités chrétiennes aux autorités civiles et tout en reconnaissant que les progrès dans la connaissance apportés par la science et les avancées vers plus de liberté et d’égalité apportées par la démocratisation ont souvent rencontré l’opposition des Églises, pourquoi occulterions-nous les apports essentiels et variés du christianisme à la civilisation européenne, y compris dans ses dimensions universalistes ?
Mais, pour d’autres, il est tout aussi évident qu’il n’y a aucune raison aujourd’hui de mentionner une quelconque dimension religieuse de l’Europe. D’une part, pour une raison empirique : de facto, le paysage religieux et philosophique de l’Europe actuelle est beaucoup plus diversifié que par le passé et il compte désormais une proportion non négligeable de personnes sans religion, dont certaines se revendiquent athées convaincus. Il n’y aurait donc aucune raison de faire une référence spéciale à la religion, encore moins à une religion particulière : le christianisme. Et ce, même si plusieurs pays de l’Union européenne font état, dans la façon dont ils expriment leur identité nationale et jusque dans leur texte constitutionnel, d’une référence au christianisme catholique, orthodoxe ou protestant. D’autre part, pour une question de principe : les constructions politiques, notamment celle de l’Europe, apparaissent et veulent apparaître comme des constructions séculières n’ayant plus rien à voir avec une religion. L’Europe, tout en respectant les relations religions-État de chaque pays membre, veut être laïque. Elle l’est effectivement, mais tout en recherchant constamment et dans une tension féconde un équilibre entre héritage chrétien et héritage de l’humanisme séculier6.
La dialogique entre la foi et le doute continue. Le caractère fondamentalement séculier de l’Europe ne devrait pas oblitérer tout ce que l’Europe doit au christianisme, d’autant plus qu’il est incontestable que celui-ci a joué un rôle important dans son histoire. Comme nous le verrons ci-après, le christianisme occupe une place importante dans la généalogie de la modernité occidentale.Cette querelle européenne du préambule a bien révélé la gêne que suscite la question religieuse en Europe, particulièrement en France. À ceux qui revendiquaient trop fortement une dimension religieuse en réclamant une Invocation Dei dans les textes européens ou bien une référence exclusive au christianisme se sont opposés ceux qui, au contraire, considéraient que le simple fait de mentionner les héritages religieux, même de façon pluraliste, constituait une atteinte intolérable à la laïcité. Les excès des uns, qui ont tendance à voir le religieux partout, et les excès des autres, qui ne veulent le voir nulle part, témoignent du malaise des Européens vis-à-vis de la question religieuse. Le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée au Sommet européen de Nice en décembre 2000 avait notamment amené la France à refuser, au nom de la laïcité, la formulation suivante : « S’inspirant de son héritage culturel, humaniste et religieux, l’Union se fonde sur les principes indivisibles et universels de la dignité de la personne. », et c’est finalement la formulation suivante qui a été retenue : «Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité», formulation qui amoindrit la référence au religieux, la met plus à distance, la patrimonialise pourrions-nous dire7.Dire que nous sommes conscients d’un patrimoine spirituel, n’est-ce pas d’abord noyer les religions dans la catégorie plus large et floue du spirituel (au prétexte de tenir compte des spiritualités non religieuses) ? N’est-ce pas ensuite refuser de reconnaître que cette dimension religieuse a été et peut encore rester un pouvoir actif d’inspiration ? Cachez ce religieux que je ne saurais voir…
Quelques années plus tard, et après les péripéties relatives à sa ratification par les différents pays membres de l’Union européenne, il est intéressant de constater que le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, s’ouvre sur un préambule déclarant : « S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit8. » Cette fois-ci, non seulement il est fait mention des « héritages religieux » mais il a également été accepté, à travers l’expression « s’inspirant », l’idée que des traditions religieuses avaient contribué également, à côté d’autres traditions, à l’émergence de quelques valeurs considérées comme universelles en démocratie. Ce qui n’est pas rien, car c’est reconnaître explicitement que des héritages religieux – et donc, là, nous pouvons penser au judaïsme et au christianisme – ont contribué à la gestation de notre modernité occidentale. Quant à l’article 16C du même traité, qui concerne spécialement les religions et organisations philosophiques non confessionnelles, certains auraient souhaité qu’il n’existe pas, plus précisément qu’il n’y ait pas un article spécifique consacré aux groupes religieux mais que la référence à ceux-ci soit intégrée dans les articles concernant les associations. Dans cet article 16C, l’alinéa 3 est aussi significatif : « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations9. »
Autrement dit, tout en admettant que les relations religions-État relèvent du droit national et non du droit communautaire, tout en déclarant respecter les dispositifs nationaux construits dans chacun de ses vingt-sept État membres, l’Union européenne semble néanmoins reconnaître l’existence et les contributions des religions sans que cela soit perçu comme une remise en cause de la laïcité – même si certains ne partagent pas cet avis et estiment que cet alinéa 3 fait la part belle aux religions.
Religion, théologie et éthique : l’impensé de la laïcité
User d’une catégorie générale du religieux ou des religions est inévitable, et le régime laïc se doit de respecter toutes les croyances, dans les limites du respect de la loi et des droits fondamentaux. Cette neutralisation laïque des contenus religieux a cependant un inconvénient : elle n’invite pas à s’intéresser de plus près aux doctrines et discours religieux, aux différentes conceptions de l’Homme et du monde qu’elles véhiculent, à leurs théologies.
Or, du point de vue de leurs contributions aux fondamentaux de la modernité, toutes les expressions religieuses ne se valent pas. Nous parlons d’expressions religieuses et non de religions, car il y a une pluralité interne à chaque religion faite, dans des proportions variées, de sensibilités libérales et de sensibilités orthodoxes. Par ailleurs, chaque système religieux peut évoluer. Au sein du christianisme comme au sein de l’islam, il y a des expressions radicales qui posent ou peuvent poser problème au regard de la démocratie et des droits humains fondamentaux, de l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’acceptation des lois du pays, de la laïcité, etc. Tout en reconnaissant que l’islam fait partie des héritages religieux de l’Europe et que nombre de ses expressions sont compatibles avec la modernité occidentale, on doit reconnaître qu’il a cependant moins contribué à l’émergence de cette modernité que le judaïsme et le christianisme, et que, aujourd’hui encore, malgré des évolutions sensibles parmi les minorités musulmanes des pays d’Europe, l’islam a moins fait son aggiornamento que le christianisme. C’est un constat historique et philosophique qui ne devrait pas faire polémique. En revanche, à l’évidence, l’islam a été et reste une dimension importante de la civilisation arabo-musulmane et d’autres civilisations (par exemple à travers le chiisme dans la civilisation persane). Mais il est significatif que nous n’osons pas plus parler de « civilisation arabo-musulmane » que de « civilisation occidentalo- chrétienne » (même si cette notion est officiellement utilisée dans divers pays, par exemple en Allemagne).
Les sociétés occidentales se veulent universelles et ont tendance à occulter les traditions religieuses qui ont contribué à les façonner. C’est plus le regard des autres qui leur rappelle que leur universalité est culturellement et religieusement colorée. Il faut accepter d’entrer dans les particularités d’un système religieux pour s’en apercevoir. Et accepter de reconnaître que, pour des raisons historiques diverses, la théologie musulmane, dans la variété de ses expressions, est moins avancée que la théologie chrétienne dans son travail d’interprétation et de reformulation de ses fondamentaux dans le cadre de la modernité occidentale. Le fait que ce soit un immense défi pour l’islam ne signifie pas que les diverses traditions musulmanes en soient incapables, des essais théologiques de penseurs musulmans commencent d’ailleurs à le montrer. Cela signifie qu’il faut considérer les contenus religieux, être attentif à la façon même dont on se définit comme religieux. C’est aussi parce qu’il y a des liens particuliers de la modernité occidentale avec les héritages juif et chrétien que les dialogues inter religieux revêtent, dans l’espace mondial des modernités multiples, une grande importance pour la civilisation occidentale elle-même.
Le christianisme, dans la diversité de ses expressions confessionnelles, n’est plus le système englobant de sens, le sacred canopy (« dais sacré ») qu’il a longtemps été pour les sociétés occidentales. C’est la fin d’une configuration théologico-politique où le corpus chrétien articulait sacralisation du politique et affirmations temporelles du spirituel. Les institutions chrétiennes ne sont plus rectrices de la société, le christianisme est devenu un réservoir de sens à la disposition des individus qui s’y intéressent. Il constitue désormais une sous-culture minoritaire, une religion parmi d’autres, dans les sociétés sécularisées de l’Europe de l’Ouest. Mais cette transformation de la condition sociétale du christianisme n’est pas étrangère au christianisme lui-même.
Le christianisme comme sécularisation : le fondement de la modernité ?
C’est en effet au cœur même de cette religion de l’incarnation qu’est le christianisme que s’est de plus en plus affirmée la dédivinisation du monde, son autonomie, autrement dit la valorisation du séculier, la reconnaissance de sa valeur propre. Pourquoi ? Parce que le christianisme, bien qu’il ait participé à toutes sortes de sacralisations, est en réalité une religion désacralisante, une religion pour laquelle rien n’est sacré, en particulier pas les pouvoirs politiques. Le christianisme a fortement contribué à laïciser les pouvoirs, et ce y compris parce qu’il a éclaté en diverses confessions se disputant la légitimité de leur version de la vérité chrétienne. Le fait que toutes sortes de résistances et de conflits aient marqué l’affirmation croissante de cette autonomie du séculier, le fait que, durant des siècles, le christianisme se soit presque fondu dans une configuration théologico-politique l’identifiant à un certain état de la société et de ses pouvoirs, ces faits incontestables n’invalident pas la thèse selon laquelle le christianisme – et le judaïsme – ont quelque chose à voir avec l’émergence de la modernité occidentale, qu’ils en sont un peu les parents. Selon Vincent Delecroix, qui parle de « déthéocratisation de la parole biblique », «la religion biblique est effectivement une religion désacralisante10», même si tous les montages théologico-politiques sacralisants auxquels elle a participé donnent l’impression du contraire. Dans la logique chrétienne, il y a une constante tension entre la souveraineté de Dieu sur le monde séculier et l’utopie du Royaume qui critique et déconstruit en permanence cette souveraineté. Vincent Delecroix, qui souligne cette tension structurelle du christianisme en se référant à saint Augustin, affirme : « La transcendance de Dieu n’est pas un vain mot politique.Dieu n’est pas dans la cité. […] Le messianisme juif, l’eschatologie chrétienne ont brisé ou défait l’entrelacs organique entre le religieux et le politique de la société ancienne11 ».
Plus concrètement, nous ne pouvons nier le fait que le christianisme, dans la diversité de ses expressions confessionnelles (catholique, protestante, anglicane, orthodoxe), a joué un rôle important dans l’histoire et la culture de l’Europe. Le reconnaître, ce n’est ni sous-estimer les contributions d’autres religions (en particulier le judaïsme), ni sous-estimer les apports des pensées philosophiques agnostiques ou antireligieuses. Ce n’est pas non plus oublier que ce rôle important du christianisme s’est exercé pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur, à travers des apports civilisationnels majeurs dans les domaines artistiques, éducatifs, de la santé et de la solidarité, dans les domaines juridiques, économiques, philosophiques, politiques et éthiques.Pour le pire, à travers les atrocités des croisades, de l’Inquisition, des guerres de Religion et de l’antisémitisme. Se focaliser sur le meilleur en soulignant les importants apports du christianisme à la production de la modernité ne signifie en rien oublier le pire.
Mais sommes-nous sommés de choisir entre les contempteurs de la religion et ses défenseurs inconditionnels ? Pour les premiers, les crimes et méfaits du christianisme, ses oppositions à l’avancée des libertés et au progrès disqualifieraient cette religion, identifiée à tout jamais à l’intolérance, au conservatisme et au fanatisme. Il faudrait donc non seulement s’en émanciper au plus vite mais aussi militer pour en réduire l’influence sociale et la rendre le moins visible possible. Pour les seconds, les apports et vertus du christianisme seraient au contraire tels qu’ils légitimeraient à tout jamais cette religion comme un vecteur essentiel de civilisation. Une civilisation moderne à l’émergence de laquelle le christianisme aurait fortement contribué dans ses différentes dimensions : les libertés démocratiques et les progrès scientifico- techniques, d’une part ; le souci moral et une conception fondamentale de la dignité humaine et de l’égalité homme-femme, d’autre part.
La religion comme structure sociale et filiation
Conseil œcuménique des Églises (COE), « Vers un témoignage Un appel à établir des relations responsables dans la mission et à renoncer au prosélytisme », oikoumene.org, 19 septembre 2017.
Jan Assmann, Le Monothéisme et le langage de la Les débuts bibliques de la religion radicale, Bayard, 2018, p. 11.
Marc Augé, in cit.
Du point de vue des sciences humaines et sociales, les religions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Pour les auteurs de cette note, les religions sont des systèmes de représentations et de pratiques rituelles à travers lesquels les hommes et les femmes disent le sens de leur condition humaine en se référant à une entité invisible qui peut prendre des formes diverses (Dieu, des dieux, les esprits…). Les hommes et les femmes qui partagent un même langage symbolique (un même système religieux) se sentent reliés entre eux : la religion (religare) crée du lien social tant diachroniquement que synchroniquement. Diachroniquement, à travers une chaîne de témoins significatifs, telles les figures présentes dans le christianisme d’Abraham, de Moïse, de Jésus, de Marie, de saint Augustin, de saint Thomas, de saint François d’Assise, de Martin Luther, de Jean Calvin, d’Ignace de Loyola, de Thérèse de Lisieux, de Martin Luther King et de Jean-Paul II. Ce lien social diachronique est un lien de filiation à des ancêtres spirituels dont les chrétiens se sentent héritiers, des figures qui les ont précédés et dont ils se sentent redevables. Synchroniquement, avec le sentiment qu’au-delà des différences de langues et de culture un catholique français voyageant à l’autre bout du monde se retrouvera en pays symbolique de connaissance s’il assiste à une messe, même s’il ne comprend pas la langue dans laquelle elle est célébrée. Les identifications religieuses créent des « nous » transnationaux et transhistoriques,autrement dit génèrent des sentiments communautaires à travers le monde et à travers les siècles.
Ce lien à la fois diachronique et synchronique est d’autant plus fort qu’il repose sur un patrimoine partagé, un monde symbolique de représentations et de pratiques qui fait sens aux trois acceptions du mot « religion » : la signification, la direction (l’orientation) et la sensation. La religion c’est aussi, selon la deuxième étymologie du mot (religere), la relecture permanente de textes liés à une fondation de sens (Sinnstiftung, en allemand), la Bible pour les chrétiens. Il s’agit donc, dans ce sens, d’un partage de significations à travers des textes et leurs interprétations, d’orientations à travers une ou des conception(s) de la vie bonne, de sensations à travers des émotions partagées dans les rites, les louanges, les prières propres à une religion. Donc d’un monde de sens en perpétuelles discussions, réinterprétations et controverses, confronté constamment au défi de la transmission à d’autres générations et au défi de la conversion de personnes détachées de toute appartenance religieuse ou adeptes d’autres religions ou philosophies.
Le christianisme est ce qu’en font les hommes et les femmes, les institutions et mouvements qui s’en réclament dans une société donnée, à un moment donné. Dans l’approche des phénomènes religieux comme dans l’approche des réalités politiques, il faut se garder de tout anachronisme.Autrement dit, ne pas imputer au catholicisme du XXIe siècle les pratiques de l’Inquisition médiévale ou les massacres des protestants lors de la Saint-Barthélemy (1572) comme ne pas imputer aux protestants de notre époque l’antisémitisme de Luther à la fin de sa vie ou l’intransigeance de Calvin face à Michel Servet. Celles et ceux qui ont un présupposé négatif à l’égard du christianisme ont tendance à déshistoriciser leur perception de cette religion et à ne retenir d’elle que les atrocités qui ont été commises en son nom. D’autres se plaisent à associer au christianisme le judaïsme et l’islam pour faire le procès des monothéismes qui, au nom de leur croyance en un Dieu unique, seraient par nature porteurs de violence. Affirmer, comme le fait l’anthropologue Marc Augé, que « le monothéisme est prosélyte » et qu’« un grand nombre de nos malheurs viennent de là 12 » est inexact pour le judaïsme et réducteur pour le christianisme. S’il est vrai que la dimension missionnaire fait partie de l’ADN du christianisme et s’il est tout à fait incontestable que des violences et des atrocités ont été commises au nom du christianisme, il est historiquement tout aussi incontestable que cette dimension prosélyte ne s’est pas exprimée de la même manière au cours des siècles, qu’elle est par exemple très différente au temps des croisades, de l’Inquisition et au temps de la création des grandes sociétés missionnaires à la fin du XIXe siècle puis au temps des décolonisations du XXe siècle. Il y a prosélytisme et prosélytisme et il faut toujours historiciser le regard. Ainsi le Conseil œcuménique des Églises (COE), dans un texte de 1997 distinguant entre « témoignage chrétien authentique et prosélytisme », a vigoureusement dénoncé ce dernier comme une violence inadmissible imposée à l’autre et profitant souvent de son état de faiblesse13. La plupart des confessions chrétiennes respectent aujourd’hui la liberté religieuse et ont fait leurs les droits humains fondamentaux, en particulier le droit de ne pas avoir de religion ou le droit d’en changer. À l’inverse, prétendre que les polythéismes seraient, quant à eux, plus portés à la tolérance est tout aussi contestable. Tout en soutenant la thèse que le monothéisme biblique, dans sa tradition deutéronomiste, serait à l’origine d’une « religion radicale » porteuse de violence, l’égyptologue Jan Assmann reconnaît lui-même que « le langage de la violence n’est pas spécifique au monothéisme. On le trouve aussi en abondance dans les textes des religions polythéistes14 ». Par ailleurs, le fait que Marc Augé pronostique une sortie du religieux «évidente tôt ou tard» après avoir rappelé que « l’homme est un animal symbolique15 » laisse profondément perplexe…
De l’oubli de la tradition à sa critique ignorante
Michel Onfray, Décadence, Flammarion, 2017.
Jean-Marie Salamito, Monsieur Onfray au pays des Réponses sur Jésus et le christianisme, Salvator, 2017.
Ibid.
Voir Jean-Michel di Falco, Timothy Radcliffe et Andrea Riccardi (dir.), Livre noir de la condition des chrétiens dans lemonde, XO Éditions,
Voir Andrea Riccardi, « Les médiations de Sant’Egidio », in Denis Lacorne, Justin Vaïsse et Jean-Paul Willaime (dir.), La Diplomatie au défi des Tensions, guerres, médiations, Odile Jacob, 2014, p. 295-302.
Michel Onfray a été critiqué par Jean-Marie Salamito, historien du christianisme antique, pour son ouvrage Décadence16 où il ferait preuve de ce que l’historien de la Sorbonne n’hésite pas à qualifier de « christophobie » (dans un contexte où l’on se querelle sur la question de savoir s’il est pertinent ou non de parler d’islamophobie). « La christophobie onfrayenne a les mêmes ressorts que les autres négationnismes actuels : Onfray contredit la communauté scientifique des historiens, comme les climato-négationnistes contredisent la communauté scientifique des climatologues17 », écrit Jean-Marie Salamito, qui pense par ailleurs que « ce qui est un mythe n’est pas l’inexistence de Jésus, mais la théorie de sa non-existence18 ». Dans le domaine de l’histoire des religions, on est aussi confronté aux fake news et, dans un contexte de postvérité, au fait que, s’agissant de religions, trop de gens pensent que l’on pourrait dire n’importe quoi au prétexte qu’on serait dans le domaine de la croyance et non dans celui du savoir. À cet égard, on ne peut qu’encourager le développement d’un enseignement des faits religieux à l’école publique car aborder objectivement les religions comme des faits sociaux et culturels relevant de la même déontologie et méthodologie que d’autres dimensions de la vie des sociétés serait une contribution à l’éducation citoyenne dans des sociétés pluralistes. Pour autant, expliquer qu’il y a une histoire de la production des textes sacrés et une histoire de leur réception à des époques et dans des contextes divers, ce n’est pas ignorer que ces textes font sens pour des millions de gens et prennent place dans des pratiques et des vécus religieux que l’on peut aussi décrire et analyser.
Choisir de décrire et d’analyser les apports du christianisme à la production de la modernité occidentale, c’est aussi refuser un présupposé relativement répandu dans le monde intellectuel français, à savoir que loin d’avoir contribué à la modernité, le christianisme aurait été son principal frein et opposant. Autrement dit, la modernité se serait construite contre et non avec le christianisme. Ce dernier aurait été et serait toujours, particulièrement dans ses expressions catholiques et orthodoxes, un puissant vecteur culturel qui s’opposerait systématiquement aux « avancées modernes », par exemple, aujourd’hui, celles légalisant le mariage entre deux personnes de même sexe ou la gestation pour autrui. Un christianisme qui, profitant d’une opportunité politique favorable dans tel ou tel pays, serait prêt à revenir sur certaines conquêtes modernes, à l’image de ce qui se passe actuellement en Pologne au sujet de l’interruption volontaire de grossesse. C’est une position qui identifie le christianisme, ou la religion en général, à une force conservatrice, voire réactionnaire, contre laquelle les modernistes ont dû se battre pour faire progresser les choses. Certes, un christianisme conservateur existe et ces modernistes ont effectivement de bonnes raisons de le combattre. Il ne faut pas pour autant généraliser et en conclure que, selon un jeu à somme nulle, plus il y aurait de modernité moins il y aurait de religion. La modernité, dans ce cas, est considérée comme une sortie de la religion, une émancipation par rapport à la tradition légitimée et défendue par la religion. Cette grille de lecture selon laquelle l’émancipation moderne passerait nécessairement par une sortie du religieux se trouve aujourd’hui renforcée par ce que l’on observe notamment dans les aires musulmanes, dans des pays comme l’Arabie saoudite, berceau du wahhabisme, où les femmes viennent seulement de se voir reconnaître le droit de conduire une voiture, ou comme le Pakistan où, sous le coup d’une accusation de blasphème, une femme peut être emprisonnée et condamnée à mort, voire lynchée avant même d’être appréhendée. Sans parler des atrocités commises par Daech au nom de l’islam et dont de nombreux musulmans sont les premières victimes, de l’extrémisme hindou et des problèmes que rencontre l’importante minorité musulmane en Inde, ou encore des graves attaques perpétrées contre les Rohingyas dans la Birmanie bouddhiste. En Europe même, des courants populistes mettent en avant le christianisme pour défendre une identité nationale qu’ils estiment menacée par l’européanisation et la mondialisation. Cela implique, par exemple, des atteintes à la démocratie en Pologne depuis l’arrivée au pouvoir en 2015 du parti Droit et Justice ou des dénonciations du « libéralisme occidental » au nom de « l’identité nationale et chrétienne » dans la Hongrie de Viktor Orbán.
Au vu des scènes d’horreur impliquant telle ou telle religion que nous rapportent les médias presque chaque jour, au vu des fondamentalismes qui inspirent des conceptions simplistes et des comportements sectaires, on peut facilement en conclure que, décidément, le religieux, c’est bien le fanatisme, l’obscurantisme, et que le monde se porterait mieux sans. Le problème, c’est que l’on ne peut réduire le religieux à ces fanatismes et obscurantismes, car ce sont aussi des valeurs spirituelles qui inspirent des pratiques pacifiques et des comportements altruistes. Une fois de plus, il faut insister sur la nécessité de s’intéresser aux contenus, aux théologies des systèmes religieux : il y a dans diverses expressions du religieux, juives, chrétiennes, musulmanes, bouddhistes…, des exigences intellectuelles et éthiques de haut niveau, des intelligences religieuses et des engagements solidaires qui viennent enrichir la modernité occidentale tout en reconnaissant ses mérites.
Dans le contexte actuel – il n’en a pas toujours été ainsi –, le christianisme apparaît plus persécuté que persécuteur19. Si les confessions chrétiennes ont un lourd passé de violences et de guerres jusqu’au XXe siècle en Europe, avec le conflit de l’Irlande du Nord et les guerres de l’ex-Yougoslavie, au XXIe siècle le christianisme n’apparaît pas, loin s’en faut, comme la religion la plus meurtrière. On peut même dire qu’il se manifeste plus aujourd’hui par sa contribution à des missions de paix et de conciliation qu’à des actes de violences. Les médiations effectuées à travers le monde par la communauté Sant’Egidio (fondée à Rome en 1968) sont par exemple reconnues par les autorités politiques20. Ainsi, le 18 avril 2017, en France, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l’Intérieur ont signé un protocole d’accord avec cette communauté catholique et d’autres institutions religieuses (Conférence des évêques de France, Fédération protestante de France, Secours catholique,Fédération de l’entraide protestante…) dans lequel tous s’engageaient, en partenariat avec le gouvernement, dans un projet « couloirs humanitaires » pour accueillir en France des réfugiés de toutes confessions en provenance du Liban.
La reconnaissance de la liberté de conscience et du pluralisme religieux et convictionnel a été un long processus parsemé de conflits, et le christianisme, notamment le catholicisme en France avec ce que l’on a appelé « la guerre des deux France », s’est aussi opposé à ces évolutions, mais cela ne devrait pas empêcher de reconnaître que le corpus chrétien constitue bien l’une des sources de notre modernité européenne occidentale, qu’il a pris une part essentielle dans sa généalogie.
Le christianisme dans la refondation du monde
Voir Charles Taylor, L’Âge séculier, Seuil, 2008.
Voir Olivier Christin, La Paix de L’autonomisation de la raison politique au XVIe siècle, Seuil, 1997.
Voir Perry Anderson, Les Passages de l’Antiquité au féodalisme, La Découverte, 1977.
- Voir Philippe Portier, « L’essence religieuse de la modernité Éléments pour un renouvellement de lathéorie de la laïcité », in Jacqueline Lagrée et Philippe Portier (dir.), La Modernité contre la religion ? Pour une nouvelle approche de la laïcité, PUR, 2010, p. 7-23.
Maurizio Bettini, Contre les racines, Flammarion, «Champs actuel », 2017, p. 18. Sur ce thème, lire également Philippe Portier, « La France a-t-elle des racines “essentiellement chrétiennes” ? », propos recueillis par Frédéric Joignot, lemonde, 24 septembre 2016.
Marcel Gauchet, Le Désenchantement du monde, Gallimard, 1985, II.
L’Europe entre dans le monde moderne autour de 1700. Elle rompt alors avec l’ordre totalisant du religieux : au principe d’hétéronomie qui rattachait toute chose à la loi de Dieu se substitue la logique de l’autonomie, que caractérisent trois éléments essentiels : la subjectivation, la différenciation et la rationalisation.
Tout d’abord, donc, la logique de l’autonomie consacre une nouvelle figure du sujet. Jusqu’alors, on concevait l’homme comme une créature en situation de dépendance à l’égard de Dieu qui l’avait porté à l’existence. Charles Taylor a pu parler de « moi poreux » pour décrire cette composition ontologique qui décrit le sujet à partir de son incomplétude native21. Rien de tel dans le monde moderne : on s’installe dans le temps du « moi plein », fondé, loin de toute soumission à un ordre extérieur, sur le principe d’auto constitution de la conscience. L’homme était hier rivé à ses devoirs ; le voici aujourd’hui doté de droits qui lui permettront de construire à son gréson propre séjour terrestre. Émerge ensuite une nouvelle figure du politique. Les sociétés du passé faisaient du prince un instrumentum Dei : établi par la Providence, le prince avait vocation à conduire les êtres sur le chemin du salut, dans la conformité à la loi de Dieu. Insistant, à rebours, sur son origine humaine – c’est la thèse du contrat social –, le monde moderne ne lui donne d’autre fonction que d’assurer la paisible coexistence de ses assujettis. Si le religieux demeure, c’est à titre de croyance privée, parfois aussi à travers les institutions qui le portent, comme organe supplétif de l’État et non plus comme fondement de la convivance politique.
Enfin, avec l’autonomie, s’impose une nouvelle figure de l’histoire. La tradition, qu’on analysait hier comme une production de la Providence, était le mode d’évaluation des actions humaines : le passé était l’étalon du présent. S’il arrivait certes que de l’inédit affleure dans la marche du temps, on s’empressait d’en résorber l’effet de rupture en le présentant comme le prolongement de ce qui avait déjà été. À partir de 1492, la tendance change : au « passéisme » se substitue un régime « futuriste » d’historicité. Tout est tendu vers la transformation du monde. Il faut, et dans tous les domaines, que le passé s’abolisse pour que s’affirme la liberté des hommes. Cette entreprise d’arrachement n’est pas sans lien avec l’émergence de la rationalité instrumentale : l’esprit moderne invite ceux qu’il inspire à faire montre, sans souci des règles d’hier, de la plus grande efficacité dans l’agencement des moyens pour que s’accomplissent les objectifs qu’ils ont définis en toute indépendance.
Subjectivation, différenciation, rationalisation. D’où proviennent donc ces processus qui ôtent à la puissance religieuse sa force configuratrice ? Rien ne serait plus réducteur que de leur trouver une origine unique tant les facteurs s’entremêlent. Bien sûr, le facteur politique a sa part dans le surgissement du monde nouveau. Nous pensons en particulier à la stratégie des élites étatiques. Leur projet était en effet d’affirmer le pouvoir souverain de l’État central contre la puissance romaine et contre les communautés religieuses internes. Cette entreprise de concentration de la puissance est liée à l’éclatement de la scène religieuse qui a contraint l’institution politique à se tenir en surplomb de la broussaille des vérités confessionnelles22. Bien sûr, au nom du principe Cujus regio, ejus religio (« À chaque région sa religion »), selon lequel la religion du prince détermine la religion du pays qu’il dirige, le pouvoir réunifiera bientôt son peuple autour de la même croyance ; ce sera toutefois sans remettre en cause sa plénitude de puissance. Et 1789 marque le point d’aboutissement du processus : plus rien ne demeure de l’hétéronomie, que maintenait tout de même l’onction de Reims. Tout procède du pouvoir de l’humain, de lui seul. On ne peut méconnaître non plus le facteur économique. Portée par le développement du commerce au long cours que permet, dans le cadre de la première « mondialisation », la découverte des nouveaux continents, une première bourgeoisie se constitue. Celle-ci estime que sa prospérité ne peut se construire qu’en abattant les contraintes de l’économie scolastique : il importe, pensent ses hérauts, que les règlements gothiques s’effacent pour laisser au monde la possibilité d’innover et de prospérer. Perry Anderson a pu rappeler que, dès le XVIIe siècle, cette élite économique fait alliance avec l’élite monarchique pour reléguer auxmarges la puissance ecclésiale, souvent attachée quant à elle aux règles du « bon vieux temps »qu’elle a contribué à configurer23.
Reste le facteur philosophique. La période comprise entre les XVIe et XVIIIe siècles est le moment de l’invention d’une nouvelle philosophie, toute séculière, du politique. Nous nous mettons à penser le monde autrement. Machiavel ouvre le ban : au portrait du prince platonicien rivé à l’accomplissement de la justice, il substitue la figure du prince réaliste porté simplement par le désir de la puissance. Les règles de la politique moderne sont déjà quasiment là : plus rien de l’exercice du pouvoir ne doit se rapporter à la transcendance. Il faudrait aussi, parmi d’autres auteurs, citer Locke, qui inaugure un ordre réellement libéral: en son œuvre se juxtaposent déjà le principe de souveraineté de l’État et celui, annoncé par Descartes, d’autonomie du sujet, sur fond de séparation du politique et du religieux.
Dans le discours qui vient d’être tenu, on voit se dessiner comme un système parfait d’équilibre. Il semblerait que la modernité et la religion soient nécessairement des antonymes que tout oppose : la victoire de la première procède de la défaite de la seconde. Mais nous voulons nuancer ici cette thèse de la modernisation-liquidation en tentant de réévaluer la place de la religion chrétienne dans le processus d’émergence de la modernité européenne. Il ne s’agit pas bien sûr de nier dans cet essai généalogique la place décisive des Lumières (au plan culturel) dans la constitution de notre présent, mais de montrer comment celles-ci ont été travaillées par les idées venues de la tradition chrétienne.
Dans ses Leçons de philosophie de l’histoire et dans ses Principes de philosophie du droit, Hegel parlait, à cet égard, de « mondanisation » et, parfois, de « sécularisation » du christianisme. Nous reprendrons cette idée à travers notre argumentation en trois temps. On rappellera d’abord en quoi il est, dans l’univers de sens propre au christianisme, des potentialités capables d’accompagner le processus de modernisation. Dans la seconde partie de cette note, publiée simultanément et intitulée Le christianisme et la modernité (2) Comprendre le retour des institutions religieuses, nous verrons que les interprétations du récit chrétien ont cependant longtemps contribué à l’enracinement d’une société mécanique hostile au principe d’indidualisations des conditions. Nous y étudierons finalement les évolutions récentes, qui, depuis l’automne du Moyen Âge, ont permis aux discours chrétiens d’accompagner l’enracinement de la modernité. Ce schéma d’exposition veut exclure toute tentation d’essentialisme : il ne s’agit pas de prétendre que la modernité européenne est le produit direct de la pensée chrétienne. On peut parler, à la manière de Max Weber, d’« affinités électives », qui n’ont pu prendre forme concrète qu’à la faveur du travail, riche de bifurcations, de la théologie sur elle-même, dans l’entrelacs de surcroît des mutations de la société globale. Point donc de causalité immédiate, mais bien plutôt des influences, dont on s’emploie ici à décrire la genèse et l’efficace. Ajoutons donc que, si nous pointons ici un lien entre christianisme et modernité, ce n’est pas pour rejeter du côté de l’archaïsme les autres systèmes religieux : certaines lectures de l’hindouisme ou de l’islam ont pu contribuer à produire, ailleurs, d’autres formes de modernité24
L’anthropologue italien Maurizio Bettini a mis en garde, il y a peu, contre le discours contemporain des « racines » : « S’il est en effet quelque chose qui caractérise la culture, c’est précisément sa capacité de muter, de se transformer au cours des temps : appartenir à l’espèce humaine signifie en premier lieu posséder le don et la possibilité du changement25. » Sans doute. On aurait tort toutefois de voir dans le présent le résultat d’un acte pur d’invention : l’histoire n’est pas le fruit de sujets « désincarnés et abstraits, existant hors culture » ; elle se construit à partir de « socles de significations » déjà là, qui, en dépit des transferts culturels, rendent les sociétés incommensurables les unes par rapport aux autres. La modernité européenne ne peut sans doute pas être approchée sans cette épistémologie de l’antécédence. Ces formes de réflexion s’inscrivent bien dans la continuité d’un univers chrétien (lui-même annoncé par le judaïsme) qui s’est construit autour d’un certain « art des séparations » : séparation du sujet et de la société, séparation du temporel et du spirituel, séparation de l’histoire et de la tradition. Comme l’écrit Marcel Gauchet, il convient de « reconnaître la spécificité chrétienne comme facteur matriciel et déterminant dans la genèse des articulations qui singularisent fondamentalement notre univers, qu’il s’agisse du rapport à la nature, des formes de pensée, du mode de coexistence des êtres ou de l’organisation politique26 ».
Subjectivation
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, II., deuxième partie, chap. II, in Œuvres, II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1992, p. 613-614.
Aristote, Politique, 1254a18.
Ga III, 28 (trad. Émile Osty).
Voir, sur ce point, l’exégèse de Raphaël Draï, La Sortie d’É L’invention de la liberté, Fayard, 1986.
Saint Augustin, Les Confessions, livre XIII, XI, trad. Patrick Cambronne, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade » 1998, p. 1094.
Arrêtons-nous d’abord sur le concept de sujet, central dans le monde moderne. Les sociétés holistes attachent l’homme à ses communautés d’appartenance, elles-mêmes organisées sur le fondement d’un principe hiérarchique. La modernité le saisit à partir de sa faculté propre d’autodétermination : selon Alexis de Tocqueville, « l’aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi ; la démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part27 ». Le christianisme des origines n’adhérait nullement, lorsqu’il pensait l’agencement social, à ce modèle solipsiste. Il comportait cependant, en rupture avec les philosophies antérieures de l’Antiquité, une conception inédite de la « personne ». Hier encore, la substance de chaque être se trouvait liée à son statut politique, à son rôle social, à son essence sexuelle. Dans sa Politique, Aristote incite même à saisir les esclaves comme des êtres naturellement destinés à leur fonction28. Plus rien de cela ne demeure dans le monde chrétien. On envisage la personne à partir des deux notions d’égalité et de liberté, sans leur donner immédiatement une traduction sociopolitique. Égalité, tout d’abord. Dans ses rencontres, Jésus ne marque aucune différence entre les puissants et les faibles. L’apôtre Paul exprime son message dans cette formule : « Il n’y a pas de Juif ni de Grec, il n’y a pas d’esclave ni d’homme libre, il n’y a pas d’homme et de femme ; car tous, vous êtes un en Christ Jésus29. » L’assertion procède d’un raisonnement théologique : Dieu a créé tous les êtres à l’identique, sans établir nulle distinction entre eux, en les gratifiant d’un amour tel, de surcroît, qu’il les a tous appelés au même salut.
Liberté, ensuite. L’alliance relève d’un choix intime : à chaque homme revient le pouvoir de douter ou d’adhérer, de ne pas croire ou de croire. Dieu offre un chemin : il est possible de le refuser. L’Ancien Testament ne cesse, depuis le Déluge jusqu’à la confusion de Babel, de témoigner de cette plasticité de l’adhésion, que le Nouveau Testament illustre aussi à travers les divers refus opposés à l’invitation du Christ de se mettre à sa suite. L’inverse vaut également: la Bible contient d’innombrables témoignages de ces croyants – on le voit dans l’épisode de la fuite d’Égypte30 – qui bravent les pouvoirs politiques pour demeurer, conformément à leur conscience, dans la fidélité à Dieu. Cette affirmation de la liberté a partie liée avec une philosophie de la volonté à laquelle saint Augustin a donné toute son ampleur, comme dans cette formule des Confessions : « Je suis, je connais, je veux31. » Sans doute faut-il ajouter à cette anthropologie une troisième composante qui surplombe les deux autres : les êtres sont égaux et libres, ils sont sacrés pareillement, comme le montrent le récit de la Création – qui affirme que l’Homme est la seule créature voulue pour elle-même – et celui de l’Incarnation – qui voit Dieu prendre l’enveloppe physique de sa créature, ce qui dote cette dernière d’une valence quasi divine. Le propos ne débouche pas d’emblée sur une conception démocratique du monde, mais il fait signe cependant vers une théorie de la liberté de conscience – de la « liberté subjective », écrit Hegel –, qui permet à l’Homme de se tenir à distance, s’il le souhaite, de la norme que les pouvoirs voudraient lui imposer.
Différenciation
Qu’en est-il, de là, du rapport au politique ? L’Antiquité ne connaît pas l’idée de différenciation des sphères : à Athènes, les Panathénées, qui honoraient Athéna poliade, étaient des fêtes politiques, sportives et religieuses, et Rome rendait un culte à l’empereur. Rien de tel dans la modernité, sauf quand elle retrouve le chemin de la «religion politique»: elle se construit sur l’assise de la séparation pratique des ordres ; le temporel et le spirituel doivent se tenir l’un vis-à-vis de l’autre en situation d’extériorité réciproque. Pour en arriver là, il a fallu que s’inventent, comme deux réalités distinctes, la catégorie du politique et la catégorie du religieux. Or, cette distinction-là, c’est bien dans la proposition chrétienne qu’elle trouve son premier foyer d’émergence. Deux récits de l’Évangile en portent témoignage. Le premier concerne le tribut dû à César. Pour le mettre en difficulté, les pharisiens demandent à Jésus si les Juifs doivent payer l’impôt à l’autorité romaine : «Pénétrant leur astuce, il leur dit : “Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l’effigie et l’inscription ?” Ils dirent : “De César.” Il leur dit : “Ainsi donc, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu32.”» Le second regarde le procès de Jésus : «Pilate […] appela Jésus et lui dit : “C’est toi le roi des Juifs ?” […] Jésus répondit : “Mon royaume à moi n’est pas de ce monde. Si mon royaume à moi était de ce monde, mes gens à moi auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais non, mon royaume à moi n’est pas d’ici33.” » Bien que les deux réponses de ces récits créent, comme nous le verrons plus loin, une béance herméneutique, elles introduisent un modèle nouveau d’articulation du politique et du religieux. D’un côté, elles conduisent à remiser l’esprit pharaonique des temps anciens : désormais, le roi ne pourra plus se prétendre prêtre ; il devra reconnaître l’existence d’une sphère religieuse insoluble dans la sphère politique, et admettre, ce qui lui interdit de vouloir sacraliser son pouvoir par la religion, que son règne ici-bas ne peut concurrencer en dignité le Royaume d’en haut34. De l’autre, elles permettent d’annoncer l’esprit autonomique des temps modernes : pas plus qu’il ne peut absorber le religieux, le politique ne peut se faire absorber par lui ; il dispose d’un espace propre où peut s’exercer une puissance, dont même les papes de l’ère grégorienne reconnaîtront la légitimité. Marcel Gauchet écrit ainsi : « Après le Christ, on ne peut plus être à la fois roi et prêtre […]. Une fois l’authentique incarnation du divin dans l’humain opérée, […] c’en est fait, en théorie, de la possibilité même de vouloir valablement réassocier ce dont Christ a définitivement éclairé l’irrémédiable disjonction. Il y a deux ordres de rôles, comme il y a, irrécusablement séparés par leur consubstantialité en Christ, deux ordres de réalité, ce qui relève du gouvernement de ce bas monde et ce qui regarde les obligations envers l’autre monde. Puissance sur les corps et direction des âmes35. » Un principe est ainsi posé, dans lequel des sociologues de l’État, tels Bertrand Badie et Pierre Birnbaum, ont pu y voir les prémisses même de la laïcité : « L’État de droit, laïc et bureaucratique [est le] produit de la profonde dissociation que la culture catholique établit entre le temporel et le spirituel36. »
Rationalisation
Lynn White, « The Historical Roots of our Ecological Crisis », Science, 155, n° 3767, 10 mars 1967, p. 1205
Ibid.
Gn I, 28 (trad. Émile Osty).
Comme l’écrit Lynn White, cit., p. 1205 : «Spécialement dans sa forme occidentale, le christianisme est la religion la plus anthropocentrique que le monde ait connue. »
Ibid., p. 1206.
Reste la question de l’histoire. L’Occident moderne a voulu en effet, plus sans doute que les autres aires géographiques, se projeter dans l’accumulation sans fin des biens économiques, en rompant avec la stabilité matérielle des sociétés traditionnelles. S’agit-il là d’un coup de force de la bourgeoisie contre le monde chrétien ? Certaines analyses ont remis en cause cette idée couramment développée, en marquant, tout à rebours, la dépendance de l’idée de croissance à l’égard de la matrice chrétienne. On le voit notamment dans les travaux de l’historien médiéviste américain Lynn White, qui explique, par exemple, qu’il existe une affinité entre la pensée judéo-chrétienne et la performance économique : bien que cette pensée se focalise sur les mœurs et la spiritualité, il est possible de trouver des discours d’« une foi implicite dans le progrès perpétuel qui était inconnue aussi bien de l’Antiquité gréco-romaine que de l’Orient. Elle puise ses racines dans la téléologie judéo-chrétienne37 ».
La démonstration de White s’appuie, tout d’abord, sur une exégèse du dépôt scripturaire. La Genèse, explique-t-il, a introduit une « révolution psychique et culturelle majeure dans l’histoire humaine38 ». Auparavant, on pensait le monde à partir du principe de continuité des règnes. Dans chaque arbre, chaque fleuve ou chaque animal, résidait un esprit. De sorte qu’avant d’entreprendre une action affectant la nature, il fallait apaiser les forces qui l’habitaient, en veillant à ne pas rompre les équilibres primordiaux. La Bible, elle, instaure une séparation entre l’Homme et la nature : créé à l’image de Dieu, l’être humain n’est pas un être semblable aux autres ; il est à part, au-dessus, et, voulu pour lui-même, il est doté de qualités propres, comme celle de disposer d’une âme et d’une raison dont il doit user afin de transformer le monde alentour. Le montre bien cette injonction de la Genèse : «Dieu les bénit [l’homme et la femme] et Dieu leur dit : “Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur la terre39.”» Lynn White accorde, d’autre part, une importance décisive au moment médiéval, au cours duquel, en appui sur la puissance que donne aux hommes la conception anthropocentrique du monde contenue dans le message biblique, s’inventent de nouveaux moyens de production : l’Occident voit apparaître alors, souvent autour des monastères, des charrues techniquement plus perfectionnées qui permettent de produire davantage tout en libérant une main-d’œuvre qu’on trouvera bientôt dans les villes, alors aussi en pleine croissance40. Tout est prêt en tout cas, malgré l’influence d’un saint François d’Assise qui tente d’infléchir l’imaginaire de la domination, pour que s’exprime, sur cette assise anthropocentrique, un tempérament prédateur, orienté vers la conquête illimitée de l’univers. Pour Lynn White, la relation entre récit biblique et développement économique n’est cependant pas totalement automatique. La médiation de la théologie a toute sa part dans le processus historique. Le christianisme latin s’est montré davantage soucieux de la transformation du monde ; le christianisme oriental, de sa contemplation : « Le saint grec contemple ; le saint occidental agit. Les implications du christianisme pour la conquête de la nature apparaîtront donc plus facilement dans l’atmosphère occidentale41. » Nous avons donc vu que les idées de la modernité – séparation du sujet et de la société, du politique et du religieux, de l’histoire et de la tradition – sont aussi visibles dans la pensée judéo-chrétienne et qu’il existe bien une continuité entre les deux.

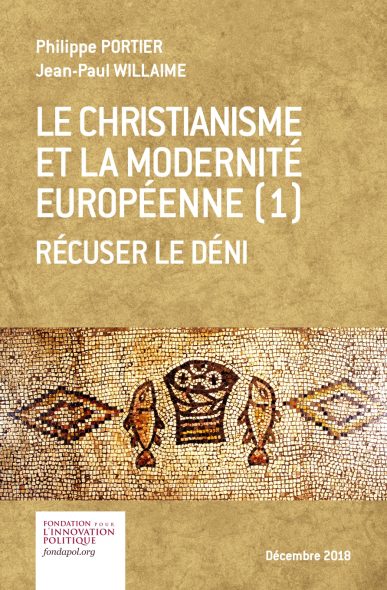











Aucun commentaire.