Le christianisme et la modernité européenne (2) comprendre le retour de l'institution religieuse
Résistance face à la modernité
Politique et religion : séparation mais primauté
Le conflit avec la modernité capitaliste
Le christianisme dans l’avènement de la modernité
D’un droit naturel garanti par Dieu à un monde fondé par l’homme
Le christianisme comme critique interne de la modernité
Ultramodernité et retour du religieux
Désenchantement du monde et radicalisation d’une sécularisation
Une laïcité de reconnaissance et de dialogue
Conclusion
Résumé
L’époque contemporaine, qualifiée ici d’ultramoderne, est marquée par un retour du religieux. Dans les incertitudes et les insécurités identitaires qui caractérisent notre époque, le christianisme retrouve, sinon du pouvoir, au moins de l’influence. C’est même sa perte de pouvoir dans et sur la société, et son acceptation du cadre démocratique, qui lui permettent d’être apprécié aussi bien comme producteur de sens et d’espérance dans une société désorientée que comme incubateur d’actions solidaires dans un environnement où le lien social est en crise.
La première partie de cette note, publiée simultanément et qui s’intitule Le christianisme et la modernité européenne (1) Récuser le déni, tente de montrer le rôle joué par le christianisme dans l’avènement et le développement de la modernité en Europe.
Philippe Portier,
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (PSL-Sorbonne)
Jean-Paul Willaime,
Directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études (PSL-Sorbonne).
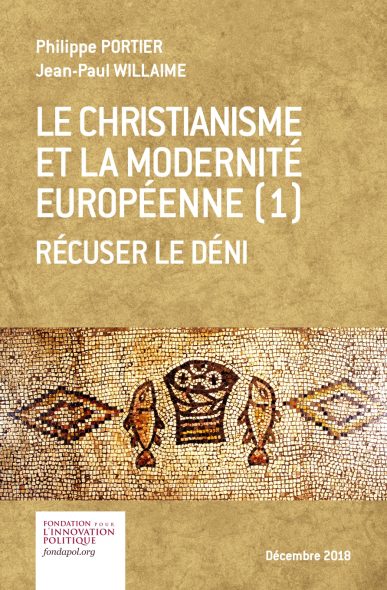
Le christianisme et la modernité européenne (1) récuser le déni
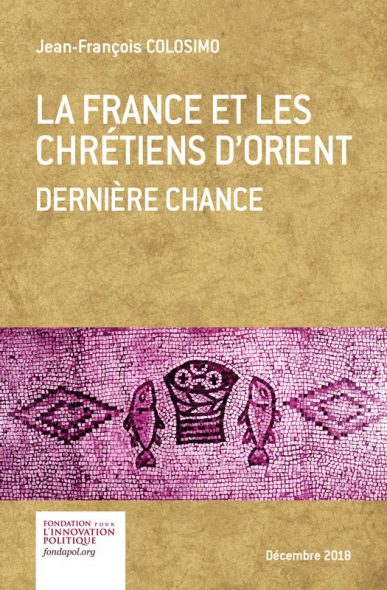
La France et les chrétiens d'Orient dernière chance
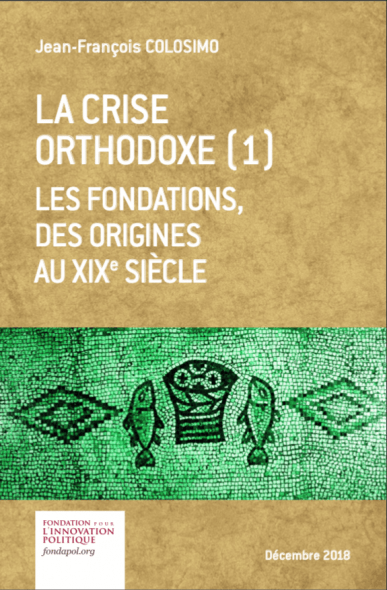
La crise orthodoxe (1) Les fondations, des origines au XIXème siècle
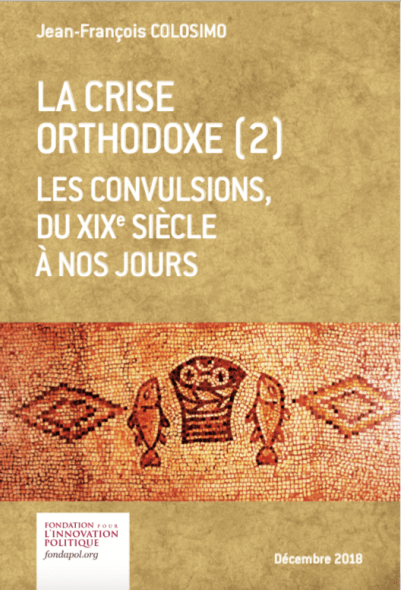
La crise orthodoxe (2) les convulsions, du XIXème siècle à nos jours
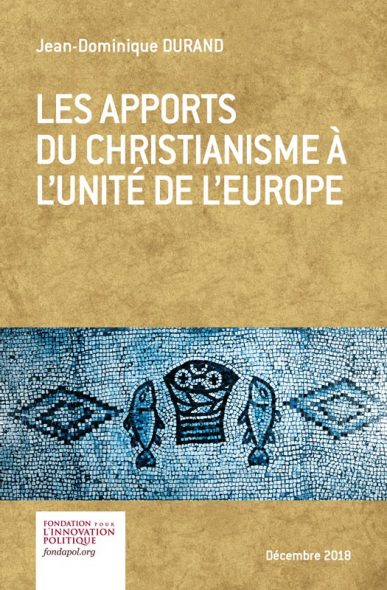
Les apports du christianisme à l'unité de l'Europe
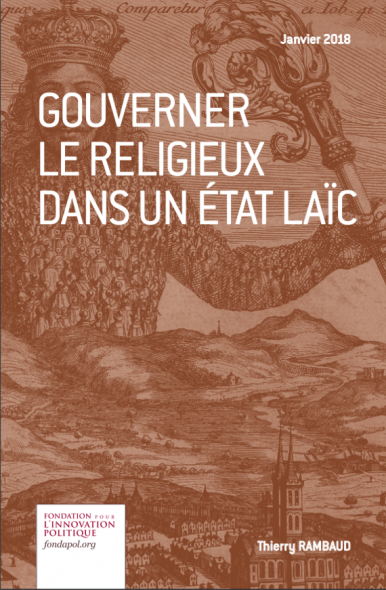
Gouverner le religieux dans un État laïc

La religion dans les affaires : la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise)
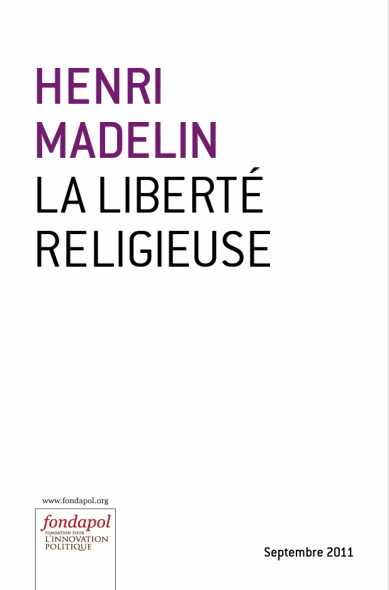
La liberté religieuse

Où va la politique de l’Église catholique ? D’une querelle du libéralisme à l’autre
Résistance face à la modernité
Lynn White, « The Historical Roots of our Ecological Crisis », Science, 155, n° 3767, 10 mars 1967.
Louis Dumont, Essais sur l’individualisme, Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Seuil, 1983, 34.
Pour l’utilisation de cette notion, voir Ernst Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen [1912], Mohr VerlagPaul Siebeck, 1994 (trad. anglaise : The Social Teaching of Christian Churches, Harper Torchbooks, 1960).
Selon le rapprochement établi par Louis Dumont.
Ernst Troeltsch, The Social Teaching of Christian Churches, cit., p. 52.
Dans la première partie de cette note, Le christianisme et la modernité européenne (1) Récuser le déni, nous avons repéré dans le corpus chrétien des principes inédits : valorisation de la conscience, séparation du politique et du religieux et consécration de l’histoire. Il reste que ces principes ne contiennent pas une signification immédiate, ils ont besoin d’une interprétation. Or, dans un premier temps de l’Histoire du christianisme, cette interprétation n’a pas fait corps avec l’individualisme tel que nous le connaissons depuis les Lumières. Inscrits« dans une société païenne, puis chrétienne, qui n’a pas cessé d’être holiste1», l’Église et ses théologiens ont évidé, pour une part, l’axiologie à l’instant décrite de son potentiel individualisant (transformer le monde est un choix de l’individu) en la replaçant dans un cadre organiciste (transformer le monde pour être en adéquation avec le Royaume du ciel, qui est le lieu important pour notre âme). L’anthropologue Louis Dumont décrit ainsi ce moment logique : « Quelque chose de l’individualisme moderne est présent chez les premiers chrétiens et dans le monde qui les entoure, mais ce n’est pas exactement l’individualisme qui nous est familier2. »
Nous évoquions la personne. Elle est centrale dans le christianisme, qui apporte à l’humain une puissance de décision qu’aucun autre système de pensée ne lui avait donnée à ce point, pas même le stoïcisme. S’agit-il, pour autant, de défendre l’idée d’une subjectivité pure, auto-constituante, capable de réinventer à son gré l’ordre social ? La réponse est clairement négative. Dans sa substance, l’Homme ne se définit pas autrement, selon la formule d’Ernst Troeltsch, qu’en tant qu’« individu-en-relation-à-Dieu3» : si autodétermination il y a, c’est dans le fait seulement d’accepter ou de refuser l’alliance avec le Créateur, dans la perspective du salut. Deux conséquences sociopolitiques en résultent. D’une part, le christianisme originel récuse l’idée d’une complétude du monde visible. Ce séjour terrestre n’est qu’un lieu de passage, souvent une vallée de larmes, qui n’a pas de valeur en soi. Il est, comme le voulait saint Augustin, le « noviciat de l’éternité ». Sans doute, les chrétiens y cheminent-ils, en acceptant même de se soumettre aux puissances politiques qui la régissent4, ils ont cependant leur cœur ailleurs : leur royaume n’est pas de ce monde. Nous sommes très loin de la croyance moderne dans le progrès infini, se déployant ici même et s’offrant comme fin ultime de l’existence. D’autre part, le christianisme originel réfute l’idée d’une autonomie de l’univers terrestre. Faut-il donc, sous prétexte qu’on en relativise l’importance, tout ignorer du monde où l’on vit, au point de le laisser à son indétermination absolue ? Non. Dès le départ, il y a, chez les chrétiens, une volonté d’aménager ce séjour terrestre dans le but d’en faire un lieu propitiatoire au salut. Dans la pensée moderne, la construction du monde procède de la volonté décisoire des êtres. Ce n’est pas le cas dans la pensée chrétienne, telle en tout cas qu’elle s’exprime chez les premiers Pères de l’Église. Le monde terrestre, où il faut bien vivre quelque temps, ne trouve pas en lui-même son principe d’agencement, mais en Dieu, lui qui nous a portés à l’existence et nous recevra au ciel. Pour relier l’existence à la transcendance, des médiations normatives sont nécessaires. Elles prennent corps dans la Bible mais également dans la loi naturelle, que mettent au premier plan, sur le fondement du legs stoïcien, saint Paul, déjà, Lactance, Origène et saint Augustin lui-même : le sujet est astreint à faire siennes les disciplines que déterminent ses énoncés. Ernst Troeltsch décrit ainsi cette articulation de la conscience et de la loi : « L’idée directrice est l’idée de Dieu comme loi de nature universelle, spirituelle et physique, qui règne uniformément sur toutes choses […] et produit les différentes positions de l’individu dans la nature et dans la société, et devient dans l’homme la loi de la raison5. »
Politique et religion : séparation mais primauté
On souligne aussi, parfois, le tournant d’Étienne III, au VIIIe siècle.
John Neville Figgis, Studies in Political Thought from Gerson to Grotius, 1414-1625 [1907], Harper Torchbooks, 1960, 5.
La révocation de l’édit de Nantes de 1685, liée à la devise « une foi, une loi, un roi », signale bien que la participation àune même collectivité politique nécessitait alors l’unité de foi des sujets du royaume.
Voir Philippe Portier, « Les élections dans l’Église latine », in Pascal Perrineau et Dominique Reynié (dir.), Dictionnaire du vote, PUF, 2001, p. 321-323.
On pourrait considérer que cette emprise de la loi supérieure ne s’exerce que dans la sphère intime et qu’elle n’a pas vocation à s’étendre jusque dans l’ordre politique. Ce n’est pas le cas. Si la formule « rendez à César ce qui est à César » établit une distinction des ordres, elle n’affirme nullement leur équivalence, ni a fortiori la souveraineté de l’État : le politique ne vaut, idéalement, qu’en tant qu’il fait droit à la loi supérieure. Dès les débuts du christianisme, il est clairement établi que la régulation des conduites par la loi naturelle vaut, tout autant que pour les sujets, pour le prince qui les gouverne. Comme le note déjà Origène contre Celsus au début du IIIe siècle, qui annonce là la théorie thomiste de la possible résistance au pouvoir, les lois positives qui contredisent la loi naturelle ne méritent pas le nom de lois : ce sont des violences qui justifient l’objection du chrétien.
Qu’en est-il alors de la relation entre l’Église et l’État ? La pensée chrétienne, telle qu’elle se constitue à partir du moment où le christianisme, au IVe siècle, est décrété religion officielle de l’Empire romain par Théodose, est marquée par l’idée que les deux réalités ne sont pas dissociables. Les autorités ecclésiales estiment que le prince doit articuler son pouvoir (potestas) avec l’autorité (auctoritas) du pontife. Dans un premier temps, avec Gélase, on insiste subtilement sur l’interrelation entre les deux puissances : le prince obéit au prêtre dans les choses divines ; le prêtre, au prince dans les choses terrestres, sachant que les décisions temporelles ne valent que si elles sont conformes aux lois spirituelles. Dans un second temps, avec Grégoire VII et ses fameux Dictatus papæ6, on insiste davantage sur la hiérarchisation : le politique est en tout point soumis au religieux. C’est le temps de la « prêtrise royale », qui revendique sa suprématie sur le prince, même dans le domaine des temporalia. La nouvelle situation est ainsi résumée par John Neville Figgis : «Au Moyen Âge, l’Église n’était pas un État. C’était l’État […]. L’autorité civile était simplement le département de police de l’Église7.» Cette association de la loi politique et de la loi morale, de l’État et de l’Église, s’est traduite, même lorsque s’affirme à partir du XVIIe siècle une monarchie absolue8, par une politique de la vérité, qui récuse, à peine de châtiment (on se souvient de l’Inquisition), toute possibilité d’expression à l’hétérodoxie. En France, il faudra attendre 1789 pour que s’affirme la possibilité d’un espace public ouvert à l’expression de l’hétérogénéité des expériences du monde. Nous n’arguerons pas du fait que l’Église a été le lieu de développement de toute une pratique de l’élection, depuis l’accès aux fonctions de pape jusqu’à l’accès aux charges d’abbé, pour estimer que s’est inventée en son sein une structure démocratique. Sans doute, toutes les procédures que les démocraties connaissent aujourd’hui (règles de majorité, exigences du secret, vérifications par des scrutateurs) trouvent- elles déjà au Moyen Âge droit de cité dans les consistoires, les chapitres et les monastères. Il reste que, dans la philosophie qui le fonde, le rite électoral n’a rien de moderne : loin d’exprimer une décision humaine, il n’est que l’instance médiatrice de la volonté divine9.
Le conflit avec la modernité capitaliste
Mt XXV, 40 (trad. Émile Osty).
Voir Jacques Le Goff, Les Trois Ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Gallimard, 1978.
Voir Bronislaw Geremek, La Potence ou la pitié. L’Europe et les pauvres du Moyen Âge à nos jours, Seuil, 1987.
Voir Myriam Greilsammer, L’Usurier chrétien, un Juif métaphorique ? Histoire de l’exclusion des prêteurs lombards (XIIIe-XVIIe siècle), PUR, 2012.
Calvin ne condamne pas le prêt à intérêt en soi, mais le prêt à intérêt qui « mord les pauvres gens et qui les ronge ». Calvin argumente en faveur d’un prêt à intérêt qui « ne prenne pas usure du pauvre » et qui ne se contente pas d’un arrangement privé, mais tienne compte de « ce qui est expédient pour le public », qui « n’excède pas la mesure que les lois publiques de la région ou du lieu concèdent » (lettre de Calvin en réponse à la demande écrite de Claude de Sachin, le 7 novembre 1545, transcription moderne d’Édouard Dommen et Marc Faessler, in « Calvin et le prêt à intérêt », in Paul Dembinski (dir.), Pratiques financières, regards chrétiens, Desclée de Brouwer, 2009).
Abordons enfin la question du progrès, dans son expression économique. La thèse de LynnWhite, telle qu’exposée dans la première partie de la note Le christianisme et la modernité européenne (1) Récuser le déni, est sans doute excessive. Au Moyen Âge, en tout cas, le monde chrétien manifeste en effet de lourdes résistances à l’égard de l’idéologie du marché ; il tient que la propriété doit se placer au service non point de l’accumulation aveugle mais, selon la règle d’usage posée par Lactance dès le IIIe siècle, du bien de tous, et d’abord de ceux qui sont dans le besoin. Deux exemples permettent d’approfondir l’analyse. Le premier concerne la pauvreté. Au moment de l’entrée dans la modernité, le pauvre apparaît souvent comme un anti-modèle : son insuccès est saisi comme une marque d’indiscipline morale. Bientôt même,les légistes appelleront l’État à mettre en place des ateliers pénitentiaires (workhouses) afin de les contraindre au travail. Rien de tel dans l’univers médiéval. La société saisit le pauvre comme une présence de chair qu’il faut soutenir dans son épreuve. Alors que la richesse peut faire obstacle au salut, la pauvreté apparaît comme un moyen de sanctification. C’est sur l’enseignement du Christ que s’adosse la société : « En vérité je [Jésus] vous le dis : pour autant que vous l’avez fait à l’un de mes moindres frères que voilà, c’est à moi que vous l’avez fait10. » Cela ne débouche pas certes sur un projet de révolution – le christianisme consacre l’imaginaire des trois ordres11–, mais, du moins, sur une mise en cause de l’accumulation sans fin et sur l’injonction faite aux riches d’aider les nécessiteux12. Diffusées par les ordres mendiants au moment de la révolution urbaine, ces conceptions seront, par-delà la charité privée qui existait auparavant, au fondement de grandes institutions caritatives (charités, hôpitaux, hospices, tables des pauvres…) et qui se retrouveront à l’origine des institutions d’assistance mises en place par les Églises au XIXe siècle en réponse aux déstructurations produites par la révolution industrielle. Le second exemple regarde le prêt à intérêt. L’économie moderne se fonde sur le crédit. Or, en dépit des autorisations offertes aux marchands lombards13, l’Église romaine, pour sa part, restera longtemps fermement attachée à cette idée que l’argent ne peut produire de l’argent. La thèse est posée dans la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin– où se trouve défendue aussi la théorie du «juste prix», que reprendront les corporations jusqu’au XVIIIe siècle. Si le protestantisme introduit une autre conception14, le magistère catholique la rappelle encore au XVIIIe siècle, alors que le capitalisme progresse de toutes parts. En 1745, dans son encyclique Vix pervenit, le pape Benoît XIV affirme fortement qu’en la matière, le principe est l’interdit : on ne peut récupérer plus d’argent qu’on en a prêté. L’argumentation lie la propriété et le travail : puisqu’on n’est plus propriétaire de l’argent qu’on a transféré à son débiteur, on ne peut exiger de le faire travailler pour soi. Des exceptions interviennent à la marge, notamment si le prêt démunit le prêteur (damnusemergens), si celui-ci prend le risque de ne pas être remboursé à temps (periculum sortis) ou s’il perd des possibilités de gain par ailleurs (lucrum cessans). Rome confirmera cette ligne directrice jusqu’au milieu du XXe siècle.
Le christianisme dans l’avènement de la modernité
Les Lumières, annoncées par Machiavel et Hobbes, vont venir, de l’extérieur même du christianisme, abolir les barrières opposées à la conquête du monde par le sujet autonome. Elles mettent en forme la grande transformation des sphères d’activité sociale : le politique, l’économie, la culture n’ont plus de comptes à rendre à Dieu et à son Église. Tout se construit sur l’assise de la seule souveraineté de l’Homme, qui se veut désormais, selon la formule de l’auteur du Léviathan, « un dieu pour lui-même ».
Faut-il, de là, considérer le monde moderne comme le produit d’un jeu à somme nulle, dans lequel les gains de la raison procéderaient des pertes de la croyance ? Nous voulons montrer ici, sans vouloir minimiser évidemment l’importance des courants non chrétiens, que les chrétiens ont eu leur part aussi dans l’irruption du nouvel ordre des choses, en s’adonnant à un travail de déconstruction de leur propre doctrine médiévale. Parallèlement, cette analyse veut indiquer que la modernité n’est pas privée de toute originalité, ce que l’on voit à l’œuvre, par exemple, dans les propos de Carl Schmitt ou même de Karl Löwith, lorsqu’ils évoquent, pour le premier, la «sécularisation du politique», pour le second, la « sécularisation de l’histoire », mais que son originalité doit beaucoup aux reconfigurations de l’ethos chrétien.
La bifurcation du christianisme est d’abord le fruit de la pensée nominaliste. Le Moyen Âge ascellé un lien entre ce monde et l’autre à partir de la loi naturelle. Saint Thomas d’Aquin, avait renforcé ce dispositif à la faveur de la redécouverte, via le monde musulman, de la philosophie grecque : le propre de ce modèle était de faire de l’ordre intra mondain le réceptacle d’une loi extérieure à lui-même. Or voici bientôt que le lien se distend entre ce monde et l’autre. Dès le XIVe siècle, les théologiens nominalistes – le terme n’apparaît qu’à la fin du XVe siècle –, souvent issus du courant franciscain15, construisent, avec Guillaume d’Ockham, une théorie de l’autonomie en s’appuyant sur une nouvelle philosophie de l’être. Dans l’ordre traditionnel, l’univers décrit une harmonie où chaque élément séjourne à la juste place que Dieu lui a assignée. Comme l’écrit Michel Villey, « le monde n’est pas qu’une poussière d’individus, une poussière d’atomes en désordre. Il révèle un ordre, des classes où chacun vient se ranger16 ». Chez les nominalistes, en revanche, il n’est pas d’essence des choses, il n’est que des individualités s’auto déterminant sous le regard de Dieu. Par exemple, explique Ockham, l’ordre des Franciscains n’existe pas en tant que tel ; il n’existe que des moines franciscains répartis dans toute l’Europe, qui décident, par un acte de leur volonté, de se regrouper, avant, s’ils le souhaitent, de se séparer. Dans ce modèle, « les choses ne peuvent être, par définition, que “simples, isolées, séparées”. Être, c’est être unique et distinct17 ». Cette conception de l’être fait cause commune avec la conception d’un Dieu de volonté : Dieu est potentia absoluta, capable d’abolir à tout moment l’ordre qu’il a posé, ce qui ôte du coup aucosmos son évidence ontologique.
D’un droit naturel garanti par Dieu à un monde fondé par l’homme
Voir Hans Blumenberg, La Légitimité des temps modernes, Gallimard, 1988.
Calvin écrit ainsi : « Les hommes ont été créés pour s’employer à faire quelque chose et non pour être paresseux et oisifs » (Jean Calvin, Commentaires bibliques, I, « Le livre de la Genèse », Kerygma et Farel, 1978, 53). Pour une analyse de la pensée de Calvin sur ce point, voir Jean-Paul Willaime, « Les réformes protestantes et lavalorisation religieuse du travail », in Daniel Mercure et Jan Spurk (dir.), Le Travail dans l’histoire de la pensée occidentale, Les Pressesde l’Université Laval, 2003, p. 61-87.
Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme [1904-1905], Gallimard, 2003, 233-234.
En 1644, le pasteur Roger Williams, fondateur de Rhode Island, écrit ainsi : « C’est la volonté et le commandement de Dieu […] que soit garantie à tous, dans chaque nation et dans chaque pays, la liberté des consciences et des cultes, même ceux des plus païens, des juifs, des Turcs ou des anti chrétiens » (Roger Williams, La Doctrine sanguinaire de la persécution pour motif de conscience, in Études théologiques et religieuses, supplément au no 2013/1 du tome 88 63).
Alexandre Vinet, Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l’Église et de l’État, Chez Paulin,1842, 216.
Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Gallimard, 1996.
« Discours du pape Pie XII aux journalistes catholiques réunis à Rome pour leur quatrième congrès international », 17 février 1950.
Pour une analyse de l’œuvre de Michaël Löwy sur ce point, voir Philippe Portier, « Catholicisme et modernité dansl’œuvre de Michaël Löwy », in Vincent Delecroix et Erwann Dianteill (dir.), Cartographie de l’utopie. L’œuvre indisciplinée de MichaëlLöwy, Editions du Sandre, Paris, 2011, 96-114.
Sur cette évolution, voir Jean-Claude Lavigne, « Interdit ou toléré ? Le prêt à intérêt après Vix pervenit (1745) », Finance & Bien commun, vol. 21, n° 1, 2005, p. 85-92.
« Discorso di Sua Santità Pio XII ai partecipanti al congresso nazionale dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti » (« Discours de Sa Sainteté Pie XII aux participants au Congrès national de l’Union chrétienne des entrepreneurs »), 7 mars 1957.
« Lettre encyclique Centesimus annus du souverain pontife Jean-Paul II à ses frères dans l’épiscopat, au clergé, aux familles religieuses, aux fidèles de l’Église catholique et à tous les hommes de bonne volonté à l’occasion du centenaire de l’encyclique Rerum novarum », mai 1991, IV, 42
Ibid chap. IV.
S’ensuit une nouvelle philosophie du droit. Puisque le droit naturel n’existe pas, puisqu’il n’est plus ici-bas aucune garantie divine apportée à l’ordre des choses, le monde social ne peut se construire désormais que sur le principe de l’auto- affirmation humaine. Dans ce contexte, le droit positif, appuyé sur la volonté rationnelle du décideur, suffit à organiser l’être-ensemble. Nous saisissons la révolution mentale opérée ici. Le pouvoir n’est lié à aucune règle substantielle : il devient à lui-même son propre maître. C’est à lui-même d’apprécier les règles d’agencement du mariage.
Dans ce schéma, qui conduit Ockham à remettre en cause l’autorité politique du pape, les droits subjectifs ne sont pas loin : on pose déjà l’idée selon laquelle le prince doit être au service des individualités qu’il dirige. Le schéma moderne est cependant encore in statu nascendi, il faudra la rupture du cogito pour que le monde franchisse le cap de la modernité18. Le protestantisme, dont nous avons pu souligner les liens avec le nominalisme, ajoute une pierre à l’édifice moderne. Le capitalisme ne tient pas dans le fait simplement d’attendre du profit des mécanismes de l’échange. Toutes les sociétés connaissent, peu ou prou, cette posture : nous ne pouvons imaginer travailler à perte, sauf dans les situations travaillées par la logique du don. Nous pourrions même ajouter que l’inventivité techno scientifique a marqué, avant l’Occident, les mondes chinois et arabes. C’est davantage un esprit qui caractérise le capitalisme : il ne s’agit pas ici de simplement accumuler des richesses, mais de les produire en mettant en œuvre un esprit de rationalité, par lequel on agence de la manière la plus efficace les moyens dont on dispose aux fins économiques qu’on se donne, dans le cadre d’une stratégie de conquête illimitée. Il ne suffit pas d’être riche, il faut l’être chaque jour davantage encore. Ce schéma de croissance, longtemps spécifique au monde occidental, suppose une mentalité toute de rigueur, articulée à des qualités d’économie, de calcul et de prévision.
La question est de savoir pourquoi, aux XVIe et XVIIe siècles, cette « organisation rationnelle du travail » s’est faite jour. Max Weber établit une corrélation entre son essor et celui du protestantisme. Luther est peu évoqué par le sociologue allemand. Cependant, le théologien allemand transforme la relation de l’homme à la nature en posant que c’est en s’investissant dans ce monde, selon la logique de la « profession-vocation » (Beruf en allemand), qu’il réalise son destin, et non en y renonçant, comme le voulait le modèle catholique du moine. Weber s’arrête bien davantage sur le protestantisme calviniste, tel qu’il se développe chez les puritains. Le modèle du Genevois se construit autour de l’idée de prédestination : le salut dépend d’un acte de pure volonté de la part de Dieu. Ce schéma de la justification par la grâce renvoie à l’idée qu’il est des élus et des réprouvés, dont le sort est indépendant de leurs œuvres apparentes.
À quoi se reconnaît alors l’élection ? Elle reste mystérieuse. Nous pouvons en trouver un indice cependant dans le fait de travailler ici-bas à la plus grande gloire de Dieu19, dans un assujettissement absolu à ses commandements. Cet investissement dans le travail ne doit faire signe vers aucune dépense ostentatoire, où se dirait, contre la loi de l’Écriture, le goût hédoniste de la vie. Le respect de Dieu suppose un travail acharné certes, mais aussi un usage sobre, « ascétique », de ses résultats : à la consommation de plaisir doit se substituer le réinvestissement du profit dans le cycle même de la production. Pour Weber, sans parler de cause, nous pouvons y voir du moins une invitation à la croissance : « L’ascèse protestante intra mondaine […] a eu pour effet psychologique de lever les obstacles que l’éthique traditionnelle opposait à l’acquisition des biens, de rompre les chaînes qui entravaient la recherche du gain, non seulement en la légalisant, mais en la considérant comme directement voulue par Dieu20. » Qu’en est-il de la question politique ? Le protestantisme a œuvré aussi en faveur de l’avènement de la démocratie. Comment ? En retravaillant la question de la liberté de conscience. Sans doute, Luther, au début du XVIe siècle, la considère-t-il comme une « liberté intérieure », qu’il faut préserver de la tutelle d’un État dont il admet (tendanciellement) la souveraineté. Tel est bien le sens de son Traité de l’autorité. Peu à peu, cependant, le protestantisme décline la liberté au for externe, au point d’alimenter, de Roger Williams21 à Pierre Bayle et Alexandre Vinet, une pensée de la séparation laïque. Et on peut retenir cette citation d’Alexandre Vinet : « Là où l’incrédulité est impossible, la foi est impossible aussi !22 ».
Reste le catholicisme. Dans certains des écrits, Max Weber a laissé quelques réflexions à son sujet, où il signale l’impossibilité de concilier cette « religion de la communauté » avec les préceptes individualistes de la civilisation libérale. Gramsci lui fait écho dans ses Cahiers de prison23, lorsqu’il rappelle que le catholicisme a été la structure fondatrice de la société féodale, son « intellectuel organique», et qu’il en est demeuré, le monde moderne installé, l’intellectuel « traditionnel ». Ces analyses sont utiles pour penser le catholicisme jusqu’au milieu duXXe siècle. Sans doute ne valent-elles plus aujourd’hui. La structure intransigeante, sans disparaître totalement, a dû se réagencer. On voit Rome, depuis quelques décennies, apporter son écot aussi au fonctionnement de la société moderne. Au niveau politique, l’Église s’est ralliée à la démocratie. Léon XIII a lancé le mouvement avec l’encyclique Intersollicitudes (1892), sous-titrée « L’Église et l’État en France », incitant les catholiques français à se rallier à la République, puis Pie XII, après la Seconde Guerre mondiale, a reconnu la valeur substantielle des régimes constitutionnels, en indiquant par exemple dans son discours aux journalistes catholiques réunis à Rome en 1950 : « Laissons à part, évidemment, le cas où l’opinion publique se tait dans un monde d’où même la juste liberté est bannie et où, seule, l’opinion des partis au pouvoir, l’opinion des chefs ou des dictateurs est admise à faire entendre sa voix. Étouffer celle des citoyens, la réduire au silence forcé, est, aux yeux de tout chrétien, un attentat au droit naturel de l’homme, une violation de l’ordre du monde tel que Dieu l’a établi24. » Vision des choses que confirmera de manière emblématique Jean Paul II,quand il condamnera les Marcos, Pinochet, Jaruzelski et autres Duvalier.
Le doute demeurait sur la laïcité. Il a été levé au moment du concile Vatican II lorsque la déclaration Dignitatis humanæ sur la liberté religieuse a admis qu’il ne pouvait y avoir de contrainte externe, ni tout bonnement de discrimination, en matière de foi. Au niveau économique, la doctrine s’est de même progressivement transformée, au point que des auteurs comme Michael Löwy ont pu dire que l’Église s’était appariée au capitalisme, en substituant au « romantisme restitutionniste » d’hier un « romantisme modernisateur25 ». Lathèse de Löwy peut se soutenir. L’examen des textes du magistère montre bien que l’esprit d’entrepreneuriat, auquel il s’était longtemps opposé par peur de la chrématistique, a pénétré aussi la culture catholique. Le magistère adhère d’abord aux techniques du capitalisme. Nous le voyons par exemple si l’on se penche sur la question, déjà abordée, du prêt à intérêt. L’Église, sous Grégoire XVI, dans les années 1830, a d’abord donné dans l’accommodement pastoral en acceptant l’absolution pour le prêteur, tout en réaffirmant l’interdit doctrinal posé par l’encyclique Vix pervenit de 1745. En 1891, dans sa lettre encyclique Rerum novarum, Léon XIII se satisfait, quant à lui, de dénoncer l’« usure dévorante26 » : c’est déjà moins le prêt à intérêt en soi qui est visé que le taux excessif qui pourrait l’accompagner, surtout lorsqu’il s’agit du prêt à la consommation dont usent les plus pauvres27. Le code de droit canonique de 1983 l’autorise explicitement comme une condition nécessaire du progrès économique.
Mais l’Église semble bien s’être convertie aussi aux principes du capitalisme. Il y avait eu dans la pensée de l’Église des éléments faisant signe d’une recherche d’efficacité dans l’entreprise. Pie XII l’avait ainsi clairement dit déjà dans ses discours aux chefs d’entreprise, en 1957 : « Il faut que les chefs d’entreprise et les dirigeants, dès maintenant et avec beaucoup plus de vigueur que par le passé, s’occupent de la formation technique des personnes appliquées à la production. […] Plus grande encore sera cette exigence avec les procédés automatiques non seulement durant la période de transformation mais aussi par la suite, pour la manutention et le fonctionnement des nouveaux appareils. Nous prévoyons même que l’ère de l’automation renforcera toujours davantage la prééminence des valeurs intellectuelles de la classe productrice : science, faculté d’invention, organisation, prévoyance28. » Jean Paul II ira dans le même sens dans plusieurs de ses textes, notamment en 1991 dans sa lettre encyclique Centesimus annus : « Peut-on dire que, après l’échec du communisme, le capitalisme est le système social qui l’emporte et que c’est vers lui que s’orientent les efforts des pays qui cherchent à reconstruire leur économie et leur société ? […] Si sous le nom de “capitalisme” on désigne un système économique qui reconnaît le rôle fondamental et positif de l’entreprise, du marché, de la propriété privée et de la responsabilité qu’elle implique dans les moyens de production, de la libre créativité humaine dans le secteur économique, la réponse est sûrement positive, même s’il serait peut-être plus approprié de parler d’“économie d’entreprise”, d’“économie de marché”, ou simplement d’“économie libre”29. Nous n’omettrons pas cependant que cette ouverture vis-à-vis du marché s’opère dans l’équilibre qu’autorise la loi maintenue de la “destination universelle des biens30” ».
Le christianisme comme critique interne de la modernité
Pasteur Claude Baty, in Fédération protestante de France, Vérité, Solidarité, Exemplarité, avant-propos, mars 2012, p. 5.
Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, Dans un monde qui change, retrouver le sens politique, introduction, octobre 2016.
Déclaration de François Hollande, président de la République, sur la place des religions en France et sur la lutte contre le terrorisme, le racisme et l’antisémitisme, 5 janvier 2016.
Ibid.
Ibid.
« Déclaration de Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, sur le dialogue entre l’État et les religions », Strasbourg, 3 octobre 2015.
Ibid.
« Transcription du discours des vœux du Président de la République aux autorités religieuses », 4 janvier 2018
Ibid.
« Déclaration de Emmanuel Macron, président de la République, sur le protestantisme, la laïcité et sur les défis du monde contemporain », Paris, 22 septembre 2017.
Ibid.
Voir Jean-Paul Willaime, Le Religieux dans l’espace Vers une laïcité de reconnaissance et de dialogue, Éditions Olivétan,2008, et Philippe Portier, L’État et les religions en France, Une sociologie historique de la laïcité, PUR, 2016.
Les christianismes contemporains sont-ils liés, sans restriction, à l’histoire telle qu’elle va? Sûrement pas. Dans leurs écoles dominantes, en tout cas en Europe, ils associent, en une sorte de critique interne de la modernité, discours d’approbation et projet de transformation.
Pour ce qui est du discours d’approbation, comme on vient de le voir, les Églises adhèrent à l’économie de marché ; elles défendent aussi la démocratie délibérative, au point de renoncer, en tout cas ad extra, au privilège de véridiction qu’ils revendiquaient hier encore. Sur ce dernier point, il y a lieu de faire référence à deux textes récents, où s’exprime tout un ethos du dialogue. Le premier est dû à la Fédération protestante de France qui, en 2012, s’exprimait ainsi à la veille des élections présidentielles et législatives : «Nous avons la faiblesse de croire que toute notre réflexion est irriguée par l’eau vive de l’Évangile. C’est ainsi que la Fédération protestante de France qui ne réclame rien, souhaite contribuer au débat sur les grandes orientations politiques discutées actuellement dans notre pays31.» Le second texte est issu des évêques catholiques qui déclarent, en 2016 : « Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays, et que nous sommes préoccupés par sa situation. Il ne s’agit pas pour nous d’alimenter la morosité par de sombres constats ; mais, en regardant les choses en face, d’apporter résolument notre pierre, notre réflexion, au débat que notre pays se doit d’avoir32. »
Quant au projet de transformation, il ne s’agit nullement de tout accepter du subjectivisme actuel. Les Églises s’inquiètent en particulier des déconstructions sociales et morales auxquelles il conduit. On les voit du coup, même si c’est en développant des propositions parfois différentes, militer en faveur d’une régulation de la sphère économique, mais aussi d’une stabilisation de la sphère familiale. Cette présence critique du religieux répond du reste, on va le voir, à l’attente d’un pouvoir politique qui se pense volontiers désormais en situation d’impotence symbolique et matérielle face à un social qui se dérobe. Nous l’avons perçu notamment dans les réflexions de l’actuel président de la République Emmanuel Macron qui, tout en appelant les religions à faire leurs les exigences de la liberté, les invitait par ailleurs à apporter toute leur part de réflexivité à un monde où même les instances de la modernité (l’État, la raison, le progrès) se trouvent frappées de décroyance.
Le 5 janvier 2016, quelques mois après les tragiques attentats de novembre 2015, le président François Hollande, en adressant ses vœux aux représentants des cultes, les remercia pour avoir su « trouver les mots et les gestes pour exprimer votre compassion à l’égard de toutes les victimes, de leurs familles et de leurs proches33». Puis il précisa la façon dont il voyait le rôle des religions dans la vie publique : « Il revient à toutes les forces spirituelles de concourir à élever les nations et les peuples au-delà de leurs seuls intérêts matériels et à agir pour la paix et pour la tolérance. […] Les organisations d’inspiration religieuse apportent à notre société une solidarité à l’égard des plus démunis et également envers les migrants34. » Appelant ensuite les autorités religieuses à s’exprimer « autant qu’il est possible pour faire en sorte que ceux qui doutent parfois, ceux qui s’interrogent souvent, ceux qui craignent d’être victimes puissent trouver espoir et confiance », il conclut: « Nous sommes chacun à notre place mais, tout en ayant des démarches différentes, nous participons au même objectif : unir notre pays et concourir à la paix35. » Cette posture témoignant d’une laïcité qu’on pourrait qualifier, avec quelque malice, de «positive» est d’autant plus significative qu’elle émane d’un président de la République socialiste qui, lors de sa campagne, avait exprimé un point de vue beaucoup moins bienveillant à l’égard des religions (dans son discours du Bourget du 22 janvier 2012, il avait par exemple évoqué la démocratie « plus forte que les marchés, plus forte que l’argent, plus forte que les croyances, plus fortes que les religions36 »).Quant à Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur et des Cultes, il s’était exprimé en ces termes aux États généraux du christianisme à Strasbourg, le 3 octobre 2015 : « Les chrétiens ont en effet un rôle essentiel à jouer aux côtés des croyants d’autres confessions, dans le traitement des maux que connaît notre société anxieuse, éreintée par le chômage, inquiète des mutations du monde qui l’entoure, profondément en quête de sens. À mes yeux, les valeurs qu’ils défendent contribuent particulièrement à la cohésion sociale, car elles rejoignent celle du pacte républicain37. » Puis, concédant que «la République elle-même ne fit pas toujours preuve de tolérance à l’égard d’une Église perçue comme un redoutable adversaire, plutôt que comme une source d’inspiration dans la recherche du bien public », il salua « cette proximité spirituelle entre la République et l’Église » en faisant remarquer que Jean-Paul II, lors de son homélie au Bourget en 1980, avait fait observer que les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité étaient des idées chrétiennes38.
Le 4 janvier 2018, recevant les représentants des cultes à l’occasion de la cérémonie des vœux, le président Emmanuel Macron est allé tout à fait dans le même sens, soulignant qu’«il est naturel que le président de la République s’entretienne régulièrement avec vous parce que vous participez à la vie de la nation39 ». Évoquant la révision des lois bioéthiques, le président précisa : « Il est impensable de penser trouver le bien commun de notre société sans prendre [les religions] pleinement en considération40. » À plusieurs occasions, le président Macron souligna aussi que la République n’attendait pas que les croyants renoncent à leur foi et à leurs convictions ou modèrent même celles-ci, mais qu’ils pouvaient pleinement faire valoir leurs positions, la seule condition étant de respecter la laïcité de l’État et toutes les règles de la République. À l’Hôtel de Ville de Paris, le 22 septembre 2017, le président Macron déclara ainsi aux protestants réunis pour commémorer les 500 ans de la Réforme : « Ma conviction profonde est que je ne rendrais nullement service à la laïcité si je m’adressais à vous comme à une association philosophique. […] La République ne vous demande pas de nier votre foi ou de l’oublier. Elle la reconnaît dans sa plénitude41. » Puis le président alla jusqu’à dire à cette minorité chrétienne qui défendit très tôt la République et la laïcité : « Nous avons aussi besoin que vous restiez la vigie de la République, son avant-garde dans les combats philosophiques, moraux, politiques qui sont ceux de notre temps42. »
Le mardi 26 juin 2018, au cours de sa rencontre – qui a suivi l’intronisation canoniale – avec la communauté ecclésiale française installée à Rome et de la conférence de presse qui a clôturé son séjour, Emmanuel Macron est revenu sur la relation chaleureuse et profonde – il a parlé de « rencontre philosophique » – que le voyage romain lui a permis de nouer avec le pape François. Il a évoqué surtout le lien qui unit la France et l’Église catholique. Inscrits dans la ligne de l’allocution prononcée aux Bernardins en avril 2018, ses propos à la communauté française se sont noués autour de deux points essentiels.
Le président a tout d’abord insisté sur l’héritage chrétien de la France : « Nous ne pouvons pas avancer si nous ne savons pas d’où nous venons, a-t-il expliqué. Ne pas vouloir voir ces racines, c’est se priver de pouvoir saisir […] les défis contemporains. » Cela l’a amené à défendre l’idée que les religions, et particulièrement l’Église catholique, avaient toute leur place dans le travail de « promotion du bien commun ». Une telle participation, a-t-il ajouté, est d’ailleurs compatible avec la laïcité française : « La laïcité française, ça n’est pas la lutte contre une religion, c’est un contre sens, c’est la liberté de croire et de ne pas croire.» D’autre part, Emmanuel Macron a signalé que cette dette à l’égard du catholicisme n’était ni exclusive, ni injonctive. L’histoire avance ; il convient, sachant que « les lois ne sont décidées que par ceux qui représentent et ont la souveraineté du peuple », que le pouvoir politique puisse l’accompagner, dans le respect de ces «principes non négociables», selon l’expression de Benoît XVI, que sont «la considération pour la personne, pour la dignité de chacun et la volonté de respecter les droits comme un absolu». Dans sa conférence de presse, le président a fait application de cette dialectique à la question bioéthique. Tout en se montrant respectueux des convictions catholiques, notamment sur le « principe de vie » et la «filiation », l’État, a-t-il déclaré, doit faire droit, « en même temps », à la « liberté de la femme » et à son « projet parental » : « Sur ces sujets, on doit accepter que la société évolue. On ne peut mieux exprimer, dans cette attitude à l’égard des religions, le déploiement de ce que nous avons appelé ailleurs une «laïcité de reconnaissance et de dialogue43». L’institutionnalisation prochaine d’une « instance de dialogue avec les cultes » en est une preuve supplémentaire.
Ultramodernité et retour du religieux
Cette posture du politique vis-à-vis du religieux s’inscrit dans un nouveau régime de modernité que, pour bien signifier qu’il ne s’agit pas d’une sortie de la modernité mais d’une radicalisation de celle-ci, nous avons choisi d’appeler ultra modernité. Autant la première modernité valorisait le changement au nom de logiques de certitudes, de croyances au progrès s’appuyant sur les techno sciences, le développement économique, les idéaux (dans des versions de droite ou de gauche) d’une société plus juste et plus prospère, de la démocratie, de l’éducation, de l’égalité, autant l’ultra modernité est dominée par des logiques d’incertitudes et de fortes insécurités culturelles. Des incertitudes nourries par la crise énergétique et écologique, le réchauffement climatique, le danger nucléaire, la désutopisation du politique et le désenchantement démocratique. Bref, des incertitudes générées par l’ébranlement des idéologies du progrès et la difficulté à se projeter dans un futur crédible. Des insécurités liées à la mondialisation, à la relativisation des cadres nationaux de l’action publique, aux phénomènes migratoires et à la diversification croissante des populations dans une même société, à la difficulté de distinguer le vrai du faux (notamment avec le développement des fake news). Des insécurités liées aussi aux brouillages des identités nationales, professionnelles, de genre, d’âges – adultification de l’enfant et puérilisation de l’adulte, dit Neil Postman44 –, convictionnelles – des croyants-doutants, des doutants-croyants –, bref des identités multiples, éclatées, mouvantes, floues, (ZygmuntBauman parle de «modernité liquide45»).
Désenchantement du monde et radicalisation d’une sécularisation
Voir Carlo Strenger, Allons-nous renoncer à la liberté ? Une feuille de route pour affronter des temps incertains, Belfond, 2018, p.3. Carlo Strenger fait ici référence aux deux conceptions de la liberté d’Isaiah Berlin.
L’ultra modernité, c’est l’aboutissement de tout le processus qui a amené l’être humain occidental à s’émanciper de nombreuses contraintes collectives, religieuses et autres, qui limitaient sa liberté individuelle. Aujourd’hui, cette dernière n’est tendanciellement plus freinée que par la liberté des autres et quelques règles indispensables au vivre-ensemble. Mais cette liberté est vide, elle n’a pas de contenu, c’est une liberté négative remarque Carlo Strenger, une liberté qui nous expose à toutes sortes d’aliénations, de dépendances, une liberté qui, nous faisant l’objet de manipulations extérieures, nous plongerait dans un « fondamentalisme du marché ». Carlo Strenger écrit : « Alors que la liberté négative recouvre l’affranchissement des contraintes extérieures, la liberté positive correspond à la véritable autonomie de l’individu. Et celle-ci nécessite raison, savoir et discipline46. » Elle nécessite des choix pour remplir de contenus cette liberté négative où l’Homme risque de s’autodétruire par manque de solides étais à son existence. Dans une société libérale, la question du sens de la vie est renvoyée à la sphère privée, à l’intimité de chacun, la société en elle-même n’étant plus porteuse de sens. Elle est radicalement sécularisée. En ultra modernité, c’est la radicalisation même de la sécularisation qui ramène le religieux au cœur de la vie collective publique. C’est un retour actif et visible de la participation des acteurs et institutions religieuses à l’élaboration du bien commun individuel et collectif, alors même que nous avions cru pouvoir enfermer le religieux dans la conscience individuelle privée (le for intérieur) et dans la pratique de rites à l’intérieur d’édifices de culte (ce à quoi le christianisme n’a jamais voulu être réduit). Un retour qui accepte de s’inscrire dans le cadre du débat public démocratique et qui ne demande rien d’autre que de participer, à côté et avec d’autres, à une discussion collective sans que la qualité religieuse des contributeurs soit un quelconque motif de disqualification ou de marginalisation.
Une des caractéristiques de ce nouveau régime de modernité est qu’il représente en effet une radicalisation de la sécularisation. Celle-ci fut d’abord une sécularisation-transfert, c’est-à-dire une sécularisation se traduisant par le passage d’une tutelle religieuse à une tutelle séculière (sécularisation des biens du clergé, sécularisation de l’éducation scolaire et de l’action sociale, l’État prenant de plus en plus en charge des activités qui relevaient auparavant des Églises). L’État et le politique eux-mêmes, en passant de la monarchie de droit divin à une république laïque, exemplifient particulièrement ce processus. Pourquoi parlons-nous d’une radicalisation de la sécularisation ? Parce que les idéaux séculiers que l’on a eu tendance à présenter comme des alternatives aux idéaux religieux se trouvent eux-mêmes désenchantés. Ce n’est plus la croyance aux promesses du politique venant remplacer la croyance aux promesses religieuses, la croyance en l’autorité des maîtres d’école se substituant à celle des prêtres, la reconnaissance du professionnalisme des assistantes sociales remplaçant l’engagement existentiel des femmes et hommes de charité, la confiance accordée aux techniciens et savants remplaçant celles accordées aux savoirs et techniques traditionnels. Car toutes ces autorités séculières sont-elles même ébranlées.
Cette sécularisation des idéaux séculiers eux-mêmes est particulièrement nette dans le domaine du politique, avec la montée de l’incroyance envers le politique, envers les politiques. En dépit des tentatives rhétoriques de raviver l’enchantement républicain, celui-ci ne joue plus, la société est radicalement sécularisée et ses membres ne croient plus à rien de façon absolue. Le possible étant de moins en moins identifié au souhaitable, resurgit la nécessité d’établir des limites. Dans une telle conjoncture, il est frappant de constater, aussi bien chez des philosophes agnostiques comme Régis Debray, André Comte-Sponville ou Jürgen Habermas que chez des philosophes inscrits dans une tradition religieuse comme Pierre Manent, Olivier Abel ou Jean-Marc Ferry, diverses façons de reconsidérer la place et le rôle du religieux dans le cadre de sociétés sécularisées et pluralistes dans le sens d’une reconnaissance de la légitimité de leur participation aux débats publics à condition qu’elles ne veuillent rien imposer. Il ne s’agit pas d’un retour du religieux au sens où l’on reviendrait à un état antérieur des relations Églises-État, comme si les religions reprenaient du pouvoir sur la société et les individus. Il s’agit de la reconfiguration de la place et du rôle du religieux dans des sociétés radicalement sécularisées où les promesses séculières sont elles-mêmes désenchantées.
Dans une telle conjoncture, aussi bien le religieux que le séculier évoluent et réaménagent leurs rapports : un christianisme de plus en plus démythologisé et valorisant son éthique universelle de la fraternité rencontre positivement un politique « déseschatologisé » et désenchanté à la recherche de ressources convictionnelles motivantes pour construire la société de demain. De là ces synergies positives entre le politique et le religieux, qui n’interdisent pas des conflits et des désaccords profonds comme on l’a vu à propos du «mariage pour tous».
Une laïcité de reconnaissance et de dialogue
Voir Jean-Paul Willaime, « La prédominance européenne d’une laïcité de reconnaissance des religions », in Jean Baubérot, Micheline Milot et Philippe Portier (dir.), Laïcité, laïcités. Reconfigurations et nouveaux défis, MSH Éditions, 2014, p. 101-122.
Mt XXV, 35 (trad. Émile Osty).
Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, op. cit.
Forum des regards protestants, « Charte pour une parole publique crédible », fr, 20 octobre 2016.
Vincent Delecroix, cit., p. 360.
Voir Samuel Huntington, Le Choc des civilisations, Odile Jacob, 1997.
En France comme à l’échelle européenne prévaut de plus en plus, malgré la réactivation de crispations laïcistes visant particulièrement l’islam, une laïcité de reconnaissance et de dialogue47, qui articule le principe de séparation religions-État et, dans une indépendance réciproque et dans le respect de la neutralité de l’État, un principe de coopération des pouvoirs publics avec les religions dans un certain nombre de domaines : l’éducation, la solidarité sociale, le vivre-ensemble, les défis écologiques, la paix, etc. Dans une telle conjoncture, les relations et dialogues inter religieux et inter convictionnels sont d’une particulière importance et les autorités publiques, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale, les encouragent explicitement au nom de la fraternité républicaine.
Particulièrement parce qu’il est une religion de l’Incarnation à dimension universaliste, le christianisme s’inscrit sans problème dans cette configuration favorable à la participation des religions à la vie publique. En Europe occidentale, les Églises catholique et protestante ont peu à peu appris à intégrer dans leur auto compréhension le fait qu’elles ne représentent plus aujourd’hui la norme religieuse. C’est le passage du christianisme hérité au christianisme par choix. Cette nouvelle condition sociétale du christianisme lui permet de faire valoir sans complexe ses positions et ses actions dans des sociétés pluralistes où l’État peine à réguler une pluralité accentuée de conceptions de l’Homme et du monde et d’options éthiques.
Il n’est pas inutile de rappeler que les groupements religieux mobilisent profondément les personnes qui y participent. Comme les partis politiques, ces groupements ont de fortes dimensions affectives et militantes. Ce sont des ressources convictionnelles qui incitent à l’action, notamment dans le domaine de la solidarité. Il est tout à fait significatif de constater que les Églises chrétiennes sont souvent en pointe sur la question du droit d’asile et de l’accueil des réfugiés, dans la défense de la dignité des migrants, s’appuyant sur ces paroles du Christ : «J’étais étranger et vous m’avez recueilli48. » Il est fréquent aujourd’hui de voir des mobilisations chrétiennes en faveur de l’engagement civique (contre l’abstention électorale), les religions venant ainsi au secours d’un politique désenchanté et décrédibilisé. En 2016, les évêques de France s’inquiétaient ainsi de «la crise du politique». Il ne s’agissait pas pour les autorités catholiques d’imposer quoi que ce soit mais de participer au débat public en appelant à un éveil des consciences49. Quant aux protestants, en octobre de la même année, ils publiaient une charte en joignant notamment notre pays à mieux entrer dans une « culture du “dissensus”, du désaccord honoré comme respectable, fondateur, soutenable, productif50 ». Ces deux textes sont des exemples du sens de la responsabilité publique des autorités chrétiennes et de leur insertion positive dans le débat démocratique.
Au terme d’un parcours philosophique profond et original sur le théologico- politique, Vincent Delecroix conclut qu’à condition de se « défaire du principe de la religion en elle […], la parole évangélique du Royaume peut proposer une articulation théologico-politique qui non seulement ne soit pas une rechute dans la soumission de l’ordre politique au religieux, mais qui soit susceptible de libérer le politique de lui-même et de le reconduire à lui-même dans cette libération, qui fasse vivre un indispensable manque en lui, une hantise bienvenue qui l’empêche de s’en sommeiller et de créer des monstres51». L’interpellation religieuse qui empêche le politique de sommeiller, comme une hantise permanente pour ce dernier, voilà une évocation du rôle des autorités religieuses vis-à-vis du politique qui n’est pas si loin des postures actuelles des Églises chrétiennes à l’égard du pouvoir. Face au risque de ne pas traiter humainement les réfugiés, les étrangers et les Français en situation d’extrême précarité (y compris les personnes âgées et les personnes handicapées), et face aux risques de stigmatisation de certaines populations (comme les Roms), les autorités religieuses mobilisent l’éthique de la fraternité chrétienne. Au Secours catholique, à l’Entraide protestante, à la Cimade, de nombreux bénévoles puisent dans les ressources éthiques du christianisme pour s’engager dans des actions de solidarité et interpeller les pouvoirs publics sur leur devoir d’humanité.
Mais le christianisme n’intervient pas seulement dans le domaine de l’éthique sociale, les Églises s’engagent également sur le terrain de la diversité culturelle et religieuse en cherchant à faire de celle-ci un atout plus qu’un obstacle à l’intégration. Face à ceux qui avancent l’argument du « choc des civilisations52» qui opposerait les religions, notamment le christianisme par rapport à l’islam, les religions répondent par l’intensification des relations inter religieuses et le développement de dialogues inter religieux à l’échelon local, régional, stato- national, telle la Conférence des responsables de culte en France (CRCF), créée en 2010, et international. Ces initiatives sont accueillies positivement par les municipalités et les organismes internationaux (Conseil de l’Europe, Alliance des civilisations soutenue par l’ONU…).
Sur bien d’autres sujets, les religions font aussi entendre leur voix : la sexualité, le genre, la filiation, la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, la légalisation de l’euthanasie… Dans ce dernier domaine, tout spécialement, certaines voix laïques ont eu tendance à vouloir renvoyer les Églises dans leur sacristie en leur enjoignant de se limiter à ce qui les concernerait uniquement, à savoir les questions spirituelles et le culte. Comme si les religions se limitaient au for intérieur et à des pratiques dans les édifices du culte ! N’aurait-on pas finalement tendance à accueillir sélectivement le rôle des religions dans l’espace public, de façon positive dans certains domaines, notamment celui de l’éthique sociale, et de façon négative dans d’autres, notamment celui de l’éthique sexuelle et familiale ? Or la participation des groupes religieux au débat public n’est pas à géométrie variable selon les sujets et sa légitimité ne dépend pas de son degré de conformité aux tendances séculières du moment. L’essentiel est de respecter les lois du pays et d’inscrire son action dans le cadre démocratique d’une république laïque où, même si les voix chrétiennes sont rigoureusement opposées à une évolution, celle-ci peut être acceptée et déboucher sur une loi qui deviendra la loi de tous. Une laïcité démocratique et non autoritaire ne doit pas disqualifier et illégitimer les interlocuteurs religieux au prétexte qu’ils seraient contre certaines évolutions, y compris si elles ont été légalisées. En matière de bioéthique, il peut y avoir des désaccords raisonnables où la diabolisation de l’autre, qu’elle vienne du côté religieux ou du côté laïc, ne devrait pas être de mise. Si, par des voies de fait, empêcher des structures hospitalières de pratiquer des IVG est illégal, des acteurs religieux doivent pouvoir continuer à exprimer leur désaccord avec l’IVG et même à militer pour un changement de loi s’ils ne troublent pas l’ordre public et n’empêchent pas l’application de la loi (dans le cas de l’IVG, les médecins peuvent d’ailleurs faire valoir leur liberté de conscience pour ne pas en pratiquer). La même logique prévaut pour le mariage entre personnes de même sexe (dans ce cas, les officiers d’État civil ne peuvent pas faire valoir la clause de conscience pour ne pas célébrer de tels mariages). Quant à la condition genrée de l’être humain et à l’égalité des hommes et des femmes, il y a différentes façons de les concevoir et il n’y a aucune raison qu’un État séculier excommunie certaines conceptions au profit d’autres.
Autrement dit, des tensions sont inévitables entre les religions et les évolutions dominantes dans la société. Ces tensions sont non seulement inévitables, mais elles sont structurelles et témoignent d’une bonne santé de la laïcité. C’est en effet le devoir de la démocratie de permettre loyalement l’expression de ces tensions plutôt que de vouloir les annihiler au seul profit d’un des deux pôles du débat : le séculier et le religieux (et ce d’autant plus que le débat est au sein même des mondes religieux comme il l’est à celui des mondes séculiers). C’est ce que Paul Ricœur appelait une « laïcité positive de confrontations » qui rend justice à la diversité de la société civile. Dans les démocraties d’Europe de l’Ouest, plutôt que de s’arc-bouter sur une conception défensive de la laïcité visant à protéger la société des religions, on adopte de plus en plus une conception inclusive de la laïcité qui, suffisamment assurée d’elle-même, peut prendre positivement en compte les apports des composantes religieuses de la société. C’est une façon de redécouvrir que les religions nourrissent aussi des engagements solidaires et profondément altruistes, qu’elles sont des réservoirs d’engagements et d’espérances qui peuvent socialiser les personnes, en particulier les jeunes, dans une normativité structurée et structurante, les prémunir contre le pessimisme et leur donner envie d’agir quelles que soient les difficultés du présent.
Reconnaître ce réservoir de convictions et d’actions que représente le christianisme, comme d’autres religions, ce n’est pas pour autant oublier que, comme toute réalité militante et convictionnelle, le christianisme peut générer, et a de fait généré, dans certaines circonstances, des attitudes intolérantes, voire des fanatismes et des violences. Constater le déploiement croissant d’une laïcité de reconnaissance et de dialogue, ce n’est pas pour autant oublier le précieux rempart que la laïcité représente pour prévenir et lutter contre toutes les expressions religieuses qui ne respecteraient pas le pacte républicain et ses règles. La laïcité, c’est aussi une protection contre les menées cléricales et absolutistes que peuvent avoir les religions lorsqu’elles veulent imposer par la contrainte leur normativité à leurs membres (au risque de cléricalisme interne et de dérives sectaires), voire étendre leur normativité à toute la société (risque de cléricalisme externe et de césaro-papisme). Les religions peuvent mener aux communautarismes si elles tendent à «enfermer» leurs membres dans leur réseau en les coupant le plus possible de la société environnante, voire à leur faire percevoir la société globale comme une réalité diabolique qu’il faut fuir et combattre. Le christianisme n’est pas indemne de ces tendances, avec un catholicisme traditionaliste identitaire qui a des sympathies pour l’extrême droite et des franges fondamentalistes du protestantisme qui voudraient reconquérir la société. Mais il faut reconnaître que, dans ces deux confessions chrétiennes, ces tendances sectaires sont assez minoritaires. Cela n’exclut pas que des jeunes et des moins jeunes en perte de repères puissent être fanatisés par des meneurs religieux (comme certains ont pu l’être par des conceptions politiques radicales justifiant la violence). Force est de constater que si, dans le contexte français, des phénomènes de radicalisation constituent une menace réelle pour la sécurité et la paix civile et que la recrudescence de l’antisémitisme est fort inquiétante, ces phénomènes restent heureusement relativement limités.
Conclusion
Jean-Paul Willaime, « Reconfigurations ultramodernes », Esprit, no 333 (3/4), « Effervescences religieuses dans lemonde », mars-avril 2007, 155.
Entre la sectarisation communautaire des identités religieuses et un espace public qui ne serait universel que par abstention des identités, il y a place, dans le respect des règles de la République, pour une reconnaissance citoyenne et laïque des religions dans la sphère publique. Les Églises chrétiennes investissent cette place avec conviction et leurs apports sont souvent appréciés. Il faut rappeler que les valeurs de la démocratie, en particulier celle des droits de l’homme, sont fragilisées lorsqu’elles ne sont pas résolument transmises et légitimées à travers des cultures particulières et portées par des organisations ayant une base sociale large. Les Églises chrétiennes ont toute leur place dans cette mission d’éducation et de promotion de ces valeurs. À une autre occasion, j’écrivais que « l’heure n’est plus où la communauté des citoyens devait être conquise en émancipant les individus de leurs ancrages symboliques ; aujourd’hui c’est bien plutôt ces ancrages symboliques qui peuvent contribuer à former des communautés de citoyens alors que celles-ci sont menacées par les effets croisés de l’individualisation et de la mondialisation53 ». Si l’humanisme démocratique s’est souvent construit en opposition aux religions, ces dernières pourraient, dans un monde séculier désenchanté, en devenir de précieux garants.
Le christianisme, dans la diversité de ses expressions confessionnelles, est d’autant plus à l’aise dans cette défense de l’humanisme démocratique qu’il n’est pas étranger à son émergence même. Si le christianisme a pu être considéré comme un frein, voire un obstacle, à l’avancement d’une modernité conquérante et sûre d’elle-même émancipant les individus des pouvoirs religieux, si nous avons pu avoir tendance à l’excommunier de la vie publique au nom d’une conception du religieux le réduisant à ses aspects privés et individuels, nous reconnaissons aujourd’hui à nouveau ses contributions au bien commun. Dans les incertitudes et les insécurités identitaires du régime ultramoderne, le christianisme retrouve, non du pouvoir, mais de l’influence. C’est même sa perte de pouvoir dans et sur la société et son acceptation du cadre laïque de notre République qui lui permettent d’être apprécié aussi bien comme fournisseur de sens et d’espérance dans une société quelque peu déboussolée que comme incubateur d’actions solidaires dans un environnement où le chacun pour soi tend à se développer.

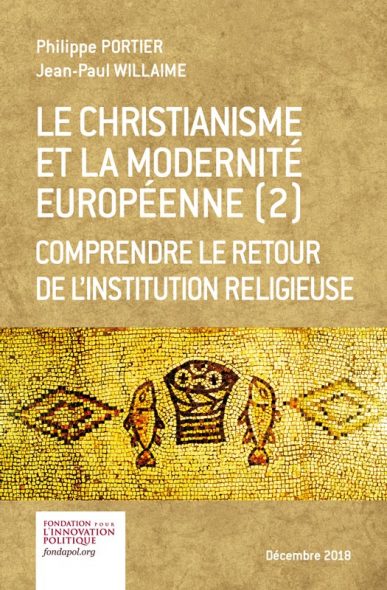











Aucun commentaire.