Le détournement populiste du courant libertarien (1)
Des origines de l'anarcho-capitalisme au populisme de droiteLe chemin de Damas de Javier Milei
Libéralisme, libertar[ian]isme et anarcho-capitalisme
Libertariens et anarcho-capitalistes : des libéraux radicalisés ?
Une brève histoire de la mouvance libertarienne aux États-Unis des années 1950 aux années 1990
De l’anarcho-capitalisme au « populisme de droite » : histoire d’une dérive
Murray Rothbard : le disciple de Mises devenu anarcho-capitaliste
Les relations entre libéraux et conservateurs américains dans l’après-guerre
Rothbard, théoricien du paléo-libertar[ian]isme et de l’alliance avec la droite populiste
Les fondements idéologiques de la fusion entre libertariens et ultraconservateurs
Un programme populiste de droite
Un léninisme anarcho-capitaliste ?
Les racines intellectuelles lointaines de l’anarcho-capitalisme et du populisme libertarien
Une tradition aux racines d’abord typiquement étasuniennes
Résumé
Dans le premier volume de cette note, nous retraçons le développement du mouvement libertarien au cours de la seconde moitié du xxe siècle. Nous montrons les spécificités idéologiques, par une étude de ses racines plus ou moins lointaines. Nous le distinguons d’autres courants plus ou moins proches de lui, mais avec lesquels il ne saurait être confondu, pour peu que l’on veuille faire l’effort nécessaire pour essayer de voir clair dans une mouvance libérale infiniment plus diverse que ne veulent l’admettre ses ennemis, qui pensent pouvoir décrédibiliser à bon compte un courant de pensée vieux de plusieurs siècles en le réduisant à des avatars radicaux et à ses franges les plus extrémistes.
Nous examinons également la stratégie d’union entre une partie (il faut bien le reconnaître, largement majoritaire aujourd’hui) du courant libertarien anarcho-capitaliste et la frange la plus conservatrice de la droite religieuse, sous la houlette notamment de Murray N. Rothbard, grand stratège de ce qui a été appelé le « fusionnisme » ou la « stratégie paléo ».
Jérôme Perrier,
Normalien, agrégé d’histoire et docteur en histoire de l’IEP de Paris.

L'individu contre l'étatisme
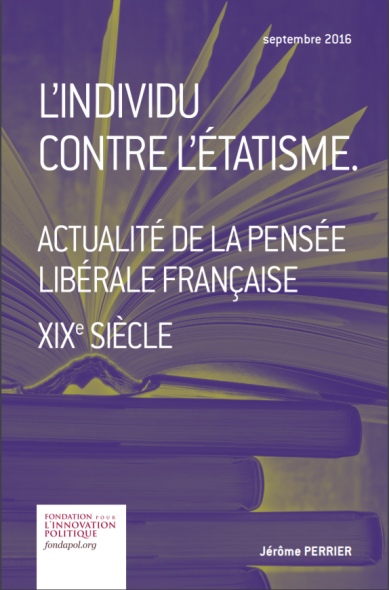
L'individu contre l'étatisme
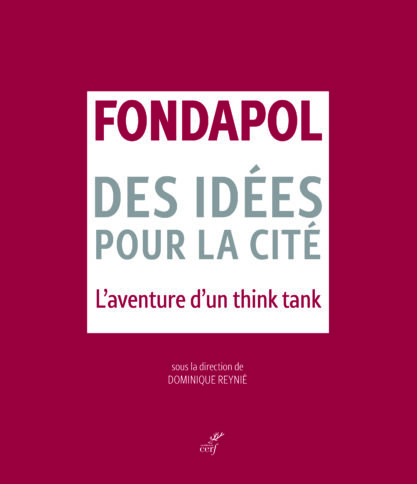
Fondapol - Des idées pour la Cité - L'aventure d'un think tank
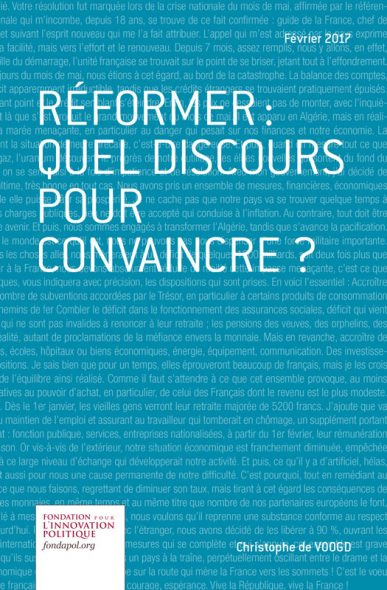
Réformer : quel discours pour convaincre ?
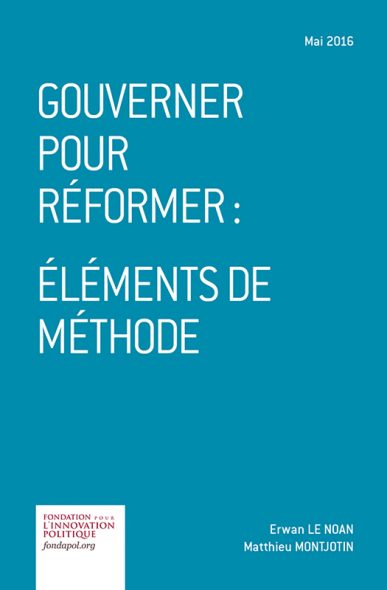
Gouverner pour réformer : Éléments de méthode

L'État innovant (2) : Diversifier la haute-administration
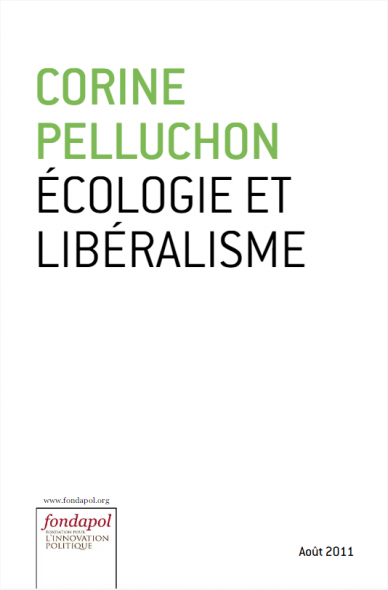
Ecologie et libéralisme
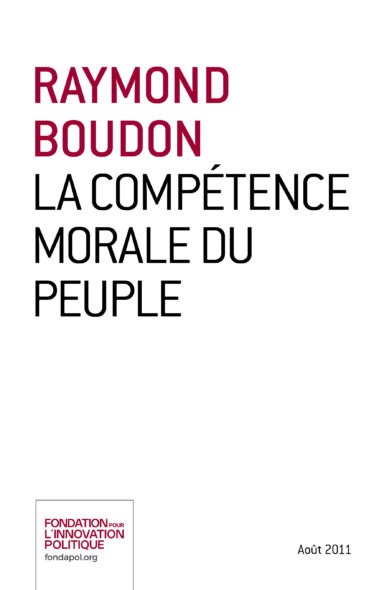
La compétence morale du peuple

L’État administratif et le libéralisme : une histoire française
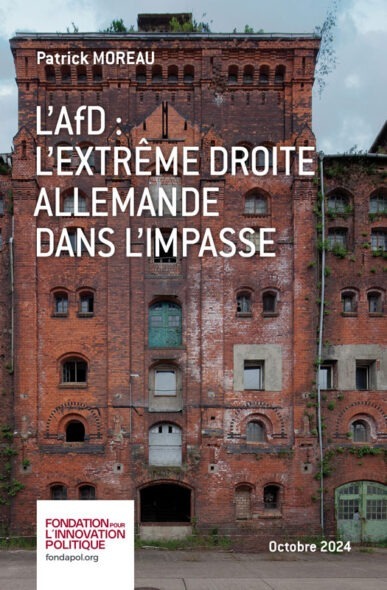
L’AfD : l'extrême droite allemande dans l'impasse

Le FPÖ au défi de l'Europe : radicalité idéologique et contrainte électorale en Autriche

Les Européens abandonnés au populisme
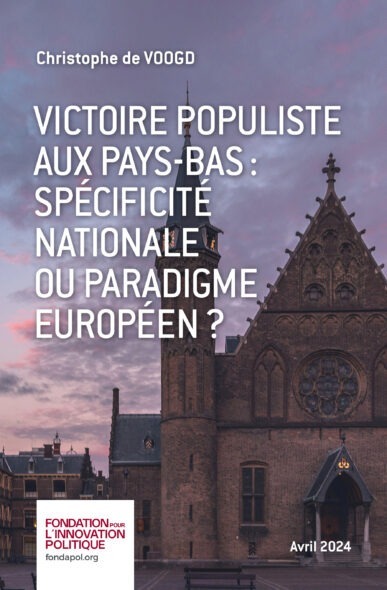
Victoire populiste aux Pays-Bas : spécificité nationale ou paradigme européen ?
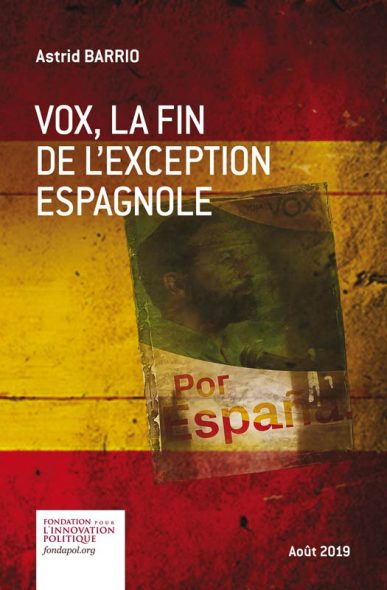
Vox, la fin de l'exception espagnole

Les "Démocrates de Suède" : un vote anti-immigration
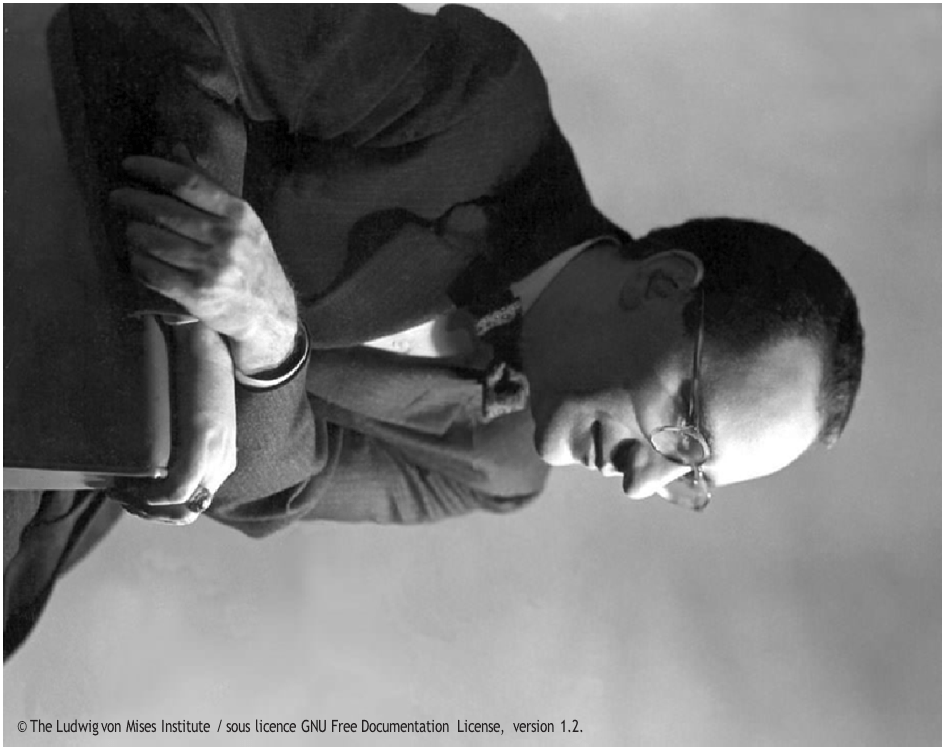
Le chemin de Damas de Javier Milei
Murray Rothbard, Man, Economy and State, D. Van Nostrand, 1962, Chapitre 10 : « Monopoly and Competition », [en ligne].
Malgré les remarquables travaux de Sébastien Caré. Voir en particulier : La pensée libertarienne : genèse, fondements et horizons d’une utopie libérale, Paris, PUF, 2009 ; Les libertariens aux États‑Unis : sociologie d’un mouvement asocial, Rennes, PUR, 2010.
À en croire l’intéressé, c’est en 2013 que Javier Milei, qui enseigne alors l’économie à l’université, aurait eu une subite révélation en lisant un texte de l’économiste libertarien américain Murray N. Rothbard (1926-1995). Ce texte, intitulé « Monopole et concurrence », aurait provoqué chez lui une subite conversion, puisqu’à la suite de ce puissant ébranlement intellectuel, le quadragénaire argentin se serait plongé avec l’avidité du néophyte dans l’abondante littérature libertarienne et anarcho-capitaliste made in USA, reniant du jour au lendemain tout ce qu’il avait pu apprendre et enseigner jusque-là. Le buisson ardent du jeune universitaire argentin est en fait le chapitre 10 de l’ambitieux traité de théorie économique de Rothbard, Man, Economy and State, publié en 1962. Dans ce chapitre, celui qui se veut encore le disciple de l’économiste libéral autrichien Ludwig von Mises, entend réhabiliter les monopoles, dès lors que ceux-ci ne sont pas l’œuvre de l’État. On peut y lire par exemple :
« Un thème populaire dans la littérature est la prétendue nuisance d’une ‘‘concurrence à mort’’. Curieusement, la concurrence à mort ou ‘‘excessive’’ est associée par les critiques à l’obtention d’un prix de monopole. […] Mais, en premier lieu, qu’y a-t-il de mal dans un tel monopole ? Qu’y a-t-il de mal dans le fait qu’une entreprise plus efficace à servir le consommateur reste sur le marché, si les consommateurs refusent de soutenir l’entreprise inefficace ? […] Ainsi, l’élimination des firmes inefficaces […] aide également les consommateurs par le transfert de ressources, des producteurs qui gaspillent vers des producteurs efficaces. Ce sont principalement les entrepreneurs qui subissent les conséquences de leurs erreurs, erreurs survenues lors de leurs prises de risque volontaires. […] Car la vente d’un produit à de très bas prix, voire avec des pertes à court terme, est une aubaine pour les consommateurs et il n’y a aucune raison de déplorer ce cadeau qui leur est fait. […] Le seul problème que l’on puisse concevoir est celui qui est habituellement cité : une fois que l’entreprise unique a éliminé du marché tous ses concurrents, via des ventes à prix très réduits, alors le monopoleur final réduira ses ventes et augmentera ses prix jusqu’à un prix de monopole. Même en acceptant provisoirement le concept de prix de monopole, cette situation ne semble pas devoir se présenter bien souvent1 ».
Si Rothbard réhabilite le rôle des monopoles au nom de la souveraineté des consommateurs au sein de ce qu’il appelle un « ordre catallactique » (c’est-à-dire un ordre spontané produit par le marché), il condamne en revanche fermement tous les monopoles liés à l’État, et s’avère ainsi très critique à l’égard des syndicats, qu’il assimile au phénomène monopolistique. Il écrit par exemple :
« Défendre l’abolition coercitive des règlements du travail impliquerait un véritable esclavage des travailleurs vis-à-vis des diktats du consommateur catallactique. Mais, répétons-le, il est certain que la connaissance des diverses conséquences de l’activité syndicale affaiblirait grandement l’adhésion volontaire de nombreux travailleurs (ou autres) à la mystique du syndicalisme. Les syndicats sont donc théoriquement compatibles avec un marché libre pur. Mais dans la réalité, il est évident pour tout observateur compétent qu’ils acquièrent presque tous leurs pouvoirs par l’exercice de la force, plus précisément de la force contre les briseurs de grève et contre la propriété des employeurs. Ils bénéficient presque toujours d’une impunité implicite pour utiliser la violence contre les ‘‘jaunes’’. […] Au plan théorique, nous pouvons dire qu’il est possible d’avoir des syndicats sur un marché libre, même si nous pouvons empiriquement douter de l’étendue qu’ils y auraient. Sur le plan analytique, nous pouvons dire que, lorsque les syndicats sont autorisés à utiliser la violence, l’État ou toute autre agence chargée de faire appliquer la loi a implicitement délégué ce pouvoir aux syndicats. Ils sont alors devenus des ‘‘États privés’’ ».
Voilà quelques exemples des idées qui ont enflammé l’esprit de Javier Milei en cette année 2013 et l’ont conduit à estimer que tout ce qu’il avait enseigné jusque-là à ses étudiants en économie était parfaitement caduc. Plus largement, cette conversion a provoqué une véritable césure dans la vie de l’universitaire argentin, puisqu’à compter de cette date, animé de la foi ardente du converti, il s’est engagé à corps perdu dans la diffusion hors des salles de cours des idées anarcho-capitalistes, prêchant désormais « la bonne parole » dans les médias grand public (radio et télévision notamment), avant de se lancer sur le marché politique en 2021, avec une frénésie et une violence verbale aux antipodes de la bienséance académique.
Comprendre les idées de Javier Milei suppose donc, d’abord, d’y voir plus clair sur l’histoire et les fondements de la mouvance libertarienne et anarcho-capitaliste, dont l’idéologie est largement méconnue en France2.
Libéralisme, libertar[ian]isme et anarcho-capitalisme
Aux États-Unis, les liberals représentent la gauche progressiste, ouverte sur les questions culturelles et plutôt favorable à l’intervention de l’État. D’où de fréquents contresens puisqu’en Europe le libéralisme se définit d’abord par des critères économiques et tend plutôt à être classé à la droite de l’échiquier politique. Voir sur cette question Alain Laurent, Le libéralisme américain, histoire d’un détournement, Paris, Les Belles Lettres, 2006.
On peut aussi parler de « libertarianisme » ou de « libertarisme » (les deux termes étant équivalents).
Si la majorité d’entre eux fondent leur doctrine sur une approche jusnaturaliste, une minorité de libertariens a une approche utilitariste (comme par exemple David Friedman, fils de Milton).
Charles Koch Fondation à sa création en 1974 (devenu Cato Institute en juillet 1976), ce think tank libertarien américain basé à Washington a été créé par Edward Crane, Murray Rothbard et Charles Koch.
Cette revue universitaire a été fondée en 1997 par Murray Rothbard, rédacteur en chef jusqu’à sa mort en 1995. Rothbard va occuper une place centrale dans le phénomène étudié.
Le « paléo-libertarianisme » (ou « stratégie paléo ») est une alliance entre l’aile droitière du courant libertarien et l’aile conservatrice et populiste de la droite républicaine. Cette alliance a été formalisée dans le contexte politique américain de l’après-guerre froide par Murray Rothbard et Lew Rockwell (ils collaborent entre 1990 et 1994 au Rothbard‑Rockwell Report, une newsletter très influente dans les milieux anarcho- capitalistes). Néanmoins, les prémices de cette stratégie de rapprochement entre anarcho-capitalistes et conservateurs de droite apparaissent chez Rothbard dès les années 1970.
Même si les idées que Javier Milei embrasse à partir de 2013 ont des racines lointaines (comme nous le montrerons plus loin), elles constituent d’abord un produit d’importation typiquement états-unien, dont il convient dans un premier temps de dessiner à grands traits les fondements idéologiques, avant, dans un second temps, d’en rappeler brièvement l’histoire, durant la seconde moitié du xxe siècle.
Au préalable, il est toutefois indispensable de préciser quelques points de vocabulaire, pour faciliter la compréhension et éviter les confusions, si fréquentes sur ces questions. Le terme « libertarien » (Libertarian) apparaît outre-Atlantique dès les années 1940, mais se développe surtout deux décennies plus tard dans le but de se distinguer des liberals de gauche3, favorables à l’intervention des pouvoirs publics au nom de la justice sociale, mais aussi du libéralisme classique (classical liberalism), désireux de limiter le rôle de l’État, tout en reconnaissant sa nécessité. Le courant libertarien4 rassemble des individus qui radicalisent les thèses du libéralisme classique, jusqu’à l’anarchisme pour les plus fondamentalistes. Ceci dans le cadre d’une culture politique américaine qui est foncièrement individualiste et attachée à la propriété privée. C’est la raison pour laquelle on appelle aussi « anarcho-capitalisme » la frange la plus radicale de la mouvance libertarienne. Le point commun des individualités diverses et variées5 qui l’animent, est leur rejet viscéral de l’État et leur volonté de substituer au pouvoir politique des mécanismes de marché totalement dérégulés, qu’ils jugent susceptibles de fournir des services répondant à tous les besoins de la société sans exception, y compris la justice et la sécurité.
Nous verrons que durant les années 1960, ce courant libertarien s’est rapproché de la gauche radicale anticapitaliste au nom de certains combats communs comme la lutte contre la guerre du Vietnam, le refus de la conscription ou encore le combat pour la dépénalisation de l’avortement et de l’usage de certaines drogues. Pourtant, la structuration du courant libertarien durant la décennie 1970 (avec notamment la création du parti libertarien en 1971, du Cato Institute6 en 1974, ou encore du Journal of Libertarian Studies en 19777) va s’accompagner d’une claire rupture avec la gauche contestataire et d’un rapprochement stratégique croissant avec la droite conservatrice et populiste. On parlera alors de « paléo-libertarianisme8 ». Cette combinaison des vues libertariennes sur le libre marché et du conservatisme culturel de la droite « paléo-conservatrice » (qui a pour idéal la société d’avant la modernité, celle des pionniers, fondée sur le travail, la famille et la religion) a été principalement théorisée par Murray Rothbard et débouchera sur une forme de populisme de droite destinée à élargir en direction de la masse des prolétaires et des classes moyennes des idées jusque-là cantonnées au monde étudiant et académique. C’est cette mutation profonde que nous allons maintenant pouvoir analyser après ces précisions de vocabulaire indispensables à la bonne compréhension d’un phénomène complexe.
Libertariens et anarcho-capitalistes : des libéraux radicalisés ?
Milton Friedman n’est pas la seule figure libérale de l’université de Chicago. La tradition libérale au sein de son département d’économie remonte aux années 1930 (avec Frank Knight et Henry Simons) et elle comptera d’autres personnalités éminentes après-guerre, comme les deux prix Nobel James Buchanan, chef de file de l’école du Public Choice, et Gary Becker, théoricien du « capital humain ».
Friedman dénonce toute intervention de l’État sur la masse monétaire.
La position jusnaturaliste s’appuie sur une doctrine juridique qui soutient que la source et le fondement du droit résident dans la nature humaine et non dans l’autorité étatique.
Friedrich von Hayek, La Présomption fatale. Les erreurs du socialisme, PUF, 1988.
Pour une approche synthétique de la riche pensée hayékienne, on peut se reporter à Thierry Aimar, Hayek, du cerveau à l’économie, Paris, Michalon, 2019.
Voir Renaud Fillieule, L’école autrichienne d’économie, une autre hétérodoxie, Presses universitaires du Septentrion, 2010.
Droit, législation et liberté, t. 3, p. 49.
C’est là une différence avec son fils, David Friedman, né en 1945, et qui défend des idées anarcho- capitalistes dès la publication de The Machinery of Freedom en 1973.
Milton Friedman, Capitalisme et liberté, [1962], Flammarion, coll. Champs essais, 2016.
Le terme est apparu aux États-Unis dans les années 1970 chez des libertariens partisans d’un État minimal et soucieux de se distinguer des anarcho-capitalistes qui entendaient abolir l’État. Force est néanmoins de constater que son usage est resté marginal. Nous l’utilisons pour la clarté de l’analyse.
Mais aussi moins originale. Si Mises aura finalement une influence plus importante qu’Hayek sur le courant libertarien, on peut dire – sans vouloir être partial – qu’Hayek est un penseur plus original, plus varié dans ses centres d’intérêt, et sans doute plus profond que Mises.
Il s’agit de la traduction anglaise d’un ouvrage paru en allemand en 1940, sous le titre Nationalökonomie. Preuve s’il en fallait une de l’idiosyncrasie française en matière de libéralisme, il faudra attendre 1985 pour disposer de sa traduction française parue aux PUF (et épuisée depuis bien longtemps) mais à laquelle on peut accéder [en ligne].
Cf. Bernard Quiriny, « L’État dans la pensée de Ludwig von Mises », Droit prospectif. Revue de la recherche juridique, 2021/2, pp. 887-905.
Ludwig von Mises, L’Action humaine, Sixième partie : L’économie de marché entravée, chap. XXVII : Le gouvernement et le marché, 2. L’intervention, (7e §) [en ligne].
Émigré aux États-Unis en 1938, Oppenheimer avait publié trente ans plus tôt un livre intitulé L’État, dans lequel il décrivait celui-ci, non comme le résultat d’un contrat social originaire, mais comme issu de la dépossession violente d’individus paisibles et laborieux par des tribus conquérantes. De cette conception découlait l’opposition qu’il faisait entre les deux moyens d’assurer la conservation de soi : les moyens économiques (le travail et l’échange) et les moyens politiques (l’appropriation sans compensation du travail d’autrui). C’est cette même idée que reprend Rothbard qui, comme toute la mouvance libertarienne américaine, voyait en Oppenheimer une icône anti-étatiste. Même si Oppenheimer eut aussi en Allemagne une influence considérable sur des libéraux autrement plus modérés, à l’image des ordolibéraux Röpke ou Ludwig Erhard.
Cf. Pablo Stefanoni, « Javier Milei en 10 phrases choc : le paléolibertarien qui veut prendre l’Argentine », Le Grand Continent, 18 septembre 2023.
Murray Rothbard, Anatomy of the State, 1974.
Murray Rothbard, L’Éthique de la liberté, op. cit., pp. 378-379. Rothbard consacre d’ailleurs tout un chapitre à critiquer les conceptions minarchistes de Nozick (après avoir critiqué celles d’Hayek dans un autre chapitre).
Il ne dit rien en revanche de Milton Friedman, peut-être pour ménager son fils David, libertarien avéré.
Soulignons d’emblée que la mouvance libérale, libertarienne et anarcho-capitaliste est fort hétérogène, et que, comme tout courant idéologique, elle accueille en son sein une myriade de sensibilités. Notre objectif ne sera donc pas ici d’être exhaustifs, et nous privilégierons la clarté, au risque de certaines simplifications.
On peut ainsi très schématiquement distinguer, au sein de la mouvance libéralo-libertarienne américaine de la seconde moitié du xxe siècle, trois principaux courants, du plus modéré au plus extrême.
La frange la plus tempérée constitue un avatar de ce que les Américains appellent classical liberalism, pour bien le distinguer des liberals de gauche, favorables à l’intervention de l’État (et dont Rawls a fourni la justification théorique la plus aboutie avec sa célèbre Theory of Justice, parue en 1971). Ces partisans du libéralisme économique au sens européen du terme peuvent eux-mêmes se diviser en deux courants principaux. D’abord les adeptes d’une approche macroéconomique et mathématisée de la discipline, héritiers de la tradition « néoclassique » et de son paradigme utilitariste, dont la figure de proue est Milton Friedman (1912-2006), qui enseigne à l’université de Chicago9 et recevra le Prix Nobel en 1976. Ses talents pédagogiques permettront à ses idées qualifiées de « monétaristes10 » de toucher un large public, grâce en particulier à ses livres, Capitalisme et Liberté (1962) et Libre Choix (1980). Sans oublier des émissions télévisées et d’innombrables interventions dans les médias qui feront de lui une figure centrale dans la lutte contre les idées keynésiennes dominantes dans le monde académique jusqu’aux années 1970. Milton Friedman a eu aussi une influence non négligeable en Amérique latine, notamment dans le Chili du général Pinochet, où ses élèves, baptisés les Chicago boys, appliqueront rigoureusement ses idées.
L’autre courant « néo-libéral » (pour utiliser un terme fort à la mode mais qui pose plus de problèmes qu’il n’en résout) est assez différent, et trouve ses origines chez l’économiste d’origine autrichienne Friedrich von Hayek (1899-1992) son grand théoricien. Cet autre prix Nobel (1974) est en réalité bien plus qu’un simple économiste puisque ni ses grandes œuvres (La Constitution de la liberté et Droit, législation et liberté), ni le best-seller qui l’a rendu célèbre en 1945, La Route de la servitude, ne sont à proprement parler des livres d’économie. Il s’agit bien plutôt d’ouvrages de philosophie politique dans lesquels Hayek s’oppose aux théoriciens qu’il qualifie de « constructivistes » car ils échafaudent des projets de société à partir de constructions intellectuelles scientistes, sorties tout droit d’esprits au rationalisme intempérant. Si Hayek argumente en faveur d’une limitation du pouvoir étatique, il ne fonde pas sa position sur l’affirmation de droits individuels inviolables (cette position jusnaturaliste11 dérivée de Locke sera celle de la plupart des libertariens les plus radicaux qui théoriseront une souveraineté absolue de l’individu). L’auteur de La Route de la servitude appuie ses thèses sur des considérations de type utilitariste, selon lesquelles l’État serait inévitablement inefficace, du fait même des limites de la raison humaine. En effet, Hayek critique d’abord et avant tout ceux qui entendent modeler la société conformément à leurs idéaux, à commencer bien sûr par les socialistes, qui témoignent ainsi d’une « présomption fatale12 », pour reprendre le titre de son dernier livre, paru en 1988. Tous les travaux d’Hayek en économie – mais aussi en psychologie et en épistémologie – ont fondamentalement consisté à démontrer que la planification est inapte à appréhender le monde dans sa complexité. Seul le marché, conçu comme un ordre spontané (la « catallaxie »), permet d’assurer la circulation des informations indispensables à la bonne allocation des ressources, et ce faisant au bon fonctionnement de l’économie13.
Un tel plaidoyer est assez éloigné du dogme libertarien intangible selon lequel l’État est en soi une force illégitime et usurpatrice, intrinsèquement mauvaise et liberticide. Notons aussi que l’épistémologie d’Hayek est très différente de celle de Milton Friedman puisque l’Autrichien récuse l’approche macroéconomique et mathématisée de son collègue de l’université de Chicago14. Et si ces deux figures éminentes du libéralisme économique d’après-guerre ont en commun d’être favorables à un État beaucoup plus modeste que l’État keynésien alors en plein essor (y compris aux États-Unis depuis le New Deal), là encore des différences existent entre eux. Les deux hommes n’ont naturellement aucun problème avec l’exercice des fonctions régaliennes (sécurité intérieure et extérieure), mais désapprouvent en revanche l’interventionnisme social croissant – que La Route de la servitude présentait précisément à la fin de la guerre comme une dérive susceptible de conduire les démocraties libérales occidentales vers une forme de collectivisme rampant.
Reste qu’Hayek va certainement plus loin que Milton Friedman dans l’acceptation de dépenses publiques reconnues comme légitimes. Il écrit ainsi dans Droit, législation et liberté :
« Du fait que dans ce livre nous nous occupons principalement des limites qu’une société libre doit fixer aux pouvoirs de contrainte du gouvernement, le lecteur peut avoir l’impression inexacte que nous considérons le maintien de l’autorité de la loi et la défense contre les ennemis extérieurs comme les seules fonctions légitimes du gouvernement. Certains théoriciens ont jadis en effet préconisé cet ‘‘État minimal’’ […] Loin de plaider pour un tel ‘‘État minimal’’, il nous apparaît hors de doute que dans une société évoluée le gouvernement doive se servir de son pouvoir fiscal pour assurer un certain nombre de services qui, pour diverses raisons, ne peuvent être fournis, du moins adéquatement, par le marché15 ».
Pour Hayek, ces services incluent des « biens collectifs », comme la définition des poids et mesures, mais aussi « la plupart des routes », ainsi que « la fourniture d’informations variées allant du cadastre aux cartes, aux statistiques et à la certification de qualité de certains biens et services offerts sur le marché », pour ne prendre que quelques exemples. De fait, force est de constater que Milton Friedman concède une liste plus limitée des fonctions à ses yeux légitimes de l’État libéral, même s’il se défend lui aussi fermement d’être anarchiste16 :
« Un État qui maintiendrait la loi et l’ordre, qui nous servirait de moyen pour modifier les droits de propriété et les autres règles du jeu économique, qui se prononcerait sur les disputes concernant l’interprétation de ces règles, qui veillerait à l’application des contrats, qui encouragerait la concurrence, qui nous fournirait un cadre monétaire, qui se préoccuperait de faire échec aux monopoles […], qui compléterait enfin le rôle de la charité privée et de la famille en protégeant l’irresponsable, qu’il s’agisse d’un fou ou d’un enfant – un tel État aurait, il en faut convenir, d’importantes fonctions à remplir. Le libéral conséquent n’est pas un anarchiste17 ».
Ce faisant, Milton Friedman se rapproche plus encore que ne le fait Hayek de la frange du libéralisme classique qui est favorable à un « État minimal » – un courant que d’aucuns18 qualifieront de « minarchiste » afin de mieux le distinguer de la fraction anarcho-capitaliste, favorable quant à elle à une disparition pure et simple de l’État. Ce courant minarchiste a trouvé un fondement philosophique dans l’œuvre du philosophe Robert Nozick (1938-2002), professeur à Harvard, et qui, avec son livre Anarchie, État et Utopie publié en 1974, entendait répondre à Rawls, dont la Théorie de la justice, parue trois ans plus tôt, était en passe de devenir la « Bible » des liberals de gauche favorables à une intervention de l’État au nom de la justice sociale. Si Nozick fournissait le fondement philosophique de ce courant minarchiste, sa justification économique était directement issue des travaux de l’autrichien Ludwig von Mises (1881-1973). Cet émigré viennois arrivé aux États-Unis en 1940 (il obtiendra la nationalité américaine en 1946), appartenait à la troisième génération des représentants de l’école autrichienne d’économie (après celle de Menger, le fondateur, et celle de Böhm-Bawerk). Il fut le maître d’Hayek à l’université de Vienne et resta ami avec lui toute sa vie, même si lui-même développait une version du libéralisme plus intégriste que celle de son ancien élève19. Si Mises ne parvint jamais, contrairement à ce dernier, à obtenir outre-Atlantique un poste académique éminent (il restera un simple Visiting Professor à la Graduate School of Business Administration de l’université de New York), il n’en a pas moins exercé une influence considérable sur ceux qui compteront dans la mouvance libertarienne ultérieure. Cette influence s’est exercée notamment à travers son grand traité d’économie intitulé Human Action (1949)20, mais aussi à travers le séminaire qu’il organisa à New York à partir de 1947. Ce séminaire fut en effet suivi par un bon nombre de futurs anarcho-capitalistes, à commencer par Murray Rothbard, sur le parcours duquel nous reviendrons plus loin en détail, tant son rôle est absolument central pour le sujet qui nous occupe. Mises était clairement un partisan de l’État minimal, strictement cantonné à ses fonctions régaliennes21, mais sans que l’on puisse pour autant le qualifier d’anarchiste. Il s’en défendait tout à fait explicitement, malgré des accents qui parfois s’en rapprochent, comme en atteste cet extrait de L’Action humaine :
« Il importe de se rappeler que l’intervention du gouvernement signifie toujours, soit l’action violente, soit la menace d’y recourir. Les fonds qu’un gouvernement dépense pour n’importe quel but sont levés par le fisc. Impôts et taxes sont payés parce que les payeurs craignent de résister au percepteur. Ils savent que toute désobéissance ou résistance est sans espoir. Aussi longtemps que tel est l’état de choses, le gouvernement est en mesure de prélever l’argent qu’il veut dépenser. Gouverner est en dernière analyse se servir d’hommes en armes, policiers, gendarmes, soldats, gardiens de prison et exécuteurs. L’aspect essentiel du pouvoir, c’est qu’il peut imposer ses volontés en matraquant, tuant et emprisonnant. Ceux qui réclament davantage de gouvernement réclament en fin de compte plus de contrainte et moins de liberté22 ».
Nul doute que de telles phrases ont pu servir d’inspiration à nombre de disciples de Ludwig von Mises, qui vont fonder l’aile la plus radicale du courant libertarien, et que l’on peut à bon droit qualifier d’« anarcho- capitalistes », dans la mesure où ils réclameront, contrairement à leur aîné, la disparition pure et simple de l’État.
Nul ne l’illustre mieux que Rothbard, pour qui il y a deux manières de s’enrichir, exclusives l’une de l’autre. D’abord, la voie naturelle, qui consiste pour l’homme à utiliser son esprit et son talent afin de produire et d’échanger les ressources de son travail contre des produits créés par d’autres agents économiques. Ensuite, la voie politique, qui vise à accroître ses richesses en accaparant les marchandises ou les services d’autres individus par le recours à la force et à la violence. En développant cette idée, Rothbard s’inscrit clairement dans le sillage des analyses du sociologue libéral Franz Oppenheimer (1864-1943), même si ce dernier exercera une influence bien au-delà du courant libertarien23. Rothbard écrit pour sa part que l’État n’est rien d’autre que l’institutionnalisation de la prédation et du parasitisme (annonçant certaines phrases chocs de Javier Milei, qui a affirmé pour sa part préférer encore la mafia à l’État24) :
« Le crime, au mieux, est sporadique et incertain ; le parasitisme est éphémère, et la ligne de conduite coercitive et parasitaire peut être contestée à tout moment par la résistance des victimes. L’État fournit un canal légal, ordonné et systématique, pour la prédation de la propriété privée ; il rend certain, sécurisé et relativement ‘‘paisible’’ la vie de la caste parasitaire de la société. Comme la production doit toujours précéder la prédation, le marché libre est antérieur à l’État. L’État n’a jamais été créé par un ‘‘contrat social’’ ; il est toujours né par la conquête et par l’exploitation25 ».
À ce système de prédation forcée, les anarcho-capitalistes opposent une utopie capitaliste dans laquelle toutes les activités sociales – fussent-elles les fonctions les plus éminemment régaliennes comme la justice ou la sécurité – seraient confiées au libre marché. En effet, puisque la liberté est le droit naturel pour chaque individu de disposer de lui-même et de ce qu’il a acquis par l’échange ou par le don, la propriété et la liberté deviennent parfaitement indissociables. Quant à l’État, il peut être totalement privatisé, y compris les rues, les écoles, les services de police, la justice, ou même l’armée. On est loin, on le voit, d’Hayek qui se défendait d’être partisan d’un État minimum, ou même de Nozick présenté parfois, un peu trop rapidement, comme un théoricien libertarien, voire anarchiste. Aux yeux de Rothbard, l’auteur d’Anarchy, State, and Utopia développe au contraire une « justification erronée et contradictoire de l’État ». Constatant les désaccords majeurs qui existent entre le célèbre professeur de Harvard et les anarcho-capitalistes radicaux, Rothbard ajoute que pour sa part, il « ne considère pas que la défection de Nozick soit une grande perte pour les libertariens26 ». Au-delà du cas Nozick, Rothbard publie en 1982 un livre intitulé The Ethics of Liberty, dont la plus grande partie est consacrée à une sévère critique d’un certain nombre de libéraux classiques, parmi lesquels Isaïah Berlin, mais également Hayek, James Buchanan, et même Mises, que son disciple juge désormais beaucoup trop timoré27.
Après avoir esquissé les principes doctrinaux des différents courants qui constituent la mouvance libéralo-libertarienne, essayons maintenant de résumer très brièvement les grandes lignes de l’histoire de ce mouvement passablement hétéroclite, durant la seconde moitié du xxe siècle.
Une brève histoire de la mouvance libertarienne aux États-Unis des années 1950 aux années 1990
Pour avoir un aperçu complet de l’histoire du mouvement, voir Sébastien Caré, Les Libertariens aux États‑Unis, op. cit.
Cf. Patricia Commun, Les ordolibéraux. Histoire d’un libéralisme à l’allemande, Paris, Les Belles Lettres, 2016 ; Jean Solchany, Wilhelm Röpke, l’autre Hayek. Aux origines du néolibéralisme, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2020.
Il existe différents travaux publiés en français sur cette institution, pas tous à charge. L’un des plus documentés est le livre de Serge Audier, Néo‑libéralisme(s). Une archéologie intellectuelle, Paris, Grasset, 2012. Le pluriel a toute son importance dans ce titre et permet à cet épais ouvrage d’échapper aux caricatures que l’on trouve trop souvent dans la littérature de langue française sur cette institution et sur les débats qui l’animent depuis son origine.
À ne pas confondre avec son frère Karl, foncièrement anti-libéral.
L’expression « laissez-faire » (ou « laisser-faire ») est d’origine française, et elle est devenue d’usage courant dans la littérature anglo-saxonne (dans sa langue d’origine), mais le mot n’a pas le sens qu’on lui donne le plus souvent. Il ne veut pas dire, initialement, que ces libéraux entendent refuser tout rôle à l’État. En réalité, la maxime originelle est : « laissez faire, laissez passer ». Attribuée par Turgot à Vincent de Gournay, cette expression remonte au xviie siècle, lorsque le marchand Legendre avait répondu à Colbert, qui lui demandait ce que l’État pouvait faire pour l’aider : « Laissez-nous faire » – sous-entendu : laissez-nous produire et échanger librement, sans interférer inutilement dans nos affaires.
Andrew Koppelman, Burning Down the House. How Libertarian Philosophy was Corrupted by Delusion and Greed, St. Martin’s Press, 2022.
Le libertarianisme (ou libertarisme), étant né d’un profond sentiment anti-étatiste, émerge véritablement aux États-Unis après l’expérience du New Deal à la fin des années 1930 et se développe pleinement dans les années 1960, au moment de la Great Society de Johnson28. La fin de la Seconde Guerre mondiale constitue également un moment important, puisqu’elle voit la parution simultanée de plusieurs livres qui vont jouer un rôle décisif dans la conversion de nombreux individus aux idées libertariennes. C’est le cas de La Source vive (1945), premier roman à succès d’Ayn Rand, future égérie du mouvement et dont nous reparlerons, ou encore de l’essai qui fera connaître Hayek en dehors des cercles académiques, La Route de la servitude (1944), un brûlot alertant contre le risque de glissement vers un étatisme incontrôlé à l’heure même où le monde vient de vaincre le totalitarisme nazi.
L’immédiat après-guerre est aussi le moment où les partisans du classical liberalism s’organisent au sein de la Société du Mont Pèlerin pour ranimer la flamme libérale à l’heure du keynésianisme triomphant. Fondée en 1947, cette organisation, qui rassemble la fine fleur des adversaires de l’interventionnisme étatique assimilé à une forme de collectivisme rampant, rassemble divers courants, allant des ordolibéraux allemands29 favorables à un État dont la mission essentielle serait d’encadrer le marché, jusqu’aux partisans de l’État modeste, réduit à ses fonctions régaliennes, inspirés par Hayek, Mises et Milton Friedman. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui vont l’emporter au début des années 1960, si bien que la Société du Mont-Pèlerin est aujourd’hui considérée en Europe comme le creuset du « néo-libéralisme30 », expression souvent utilisée sans la moindre distance critique comme synonyme de laisser-faire, ou d’« ultralibéralisme » – autre expression relevant plus de la polémique ou de l’invective idéologique que de la réflexion proprement dite.
Comme nous l’avons vu, le libertar[ian]isme, même s’il n’est pas sans lien avec la frange la plus radicale des membres de la Société du Mont Pèlerin, offre une vision de l’économie et de la société qui se situe à des années-lumières de celle des ordolibéraux allemands, mais aussi des Français Jacques Rueff et Bertrand de Jouvenel, des Britanniques Karl Popper, Lionel Robbins, et Mickael Polanyi31, ou bien encore de Salvador de Madariaga, pour ne citer que quelques-unes des figures les plus connues de ce que d’aucuns, dans des raccourcis faciles, décrivent comme « La Mecque du néo-libéralisme ».
Nous avons déjà fourni quelques repères préalables concernant les délicates questions de vocabulaire, mais il n’est sans doute pas inutile de préciser que le terme « libertarien » a été forgé en 1947 par l’économiste antimarxiste et antikeynésien Leonard E. Read, fondateur de la Foundation for Economic Education, avant qu’un de ses collègues, Dean Russell (un économiste, auteur d’une thèse sur le protolibertarien français Frédéric Bastiat, dont nous aurons à reparler), ne le reprenne quelques années plus tard dans un article paru dans la revue conservatrice The Freemen. Le mot devient alors très vite d’un usage courant, au moment précisément où nombre de partisans du « laissez-faire32 » économique, entament une relation ambigüe – et destinée à un bel avenir – avec certaines franges du conservatisme américain.
Dans l’après-guerre, ce dernier tend en effet à agréger trois courants philosophiquement assez éloignés : l’anticommunisme, le traditionalisme religieux et le laissez-fairisme économique. Un alliage instable dont le caractère composite apparaît au grand jour au moment de l’élection présidentielle américaine de 1964, avec la candidature de Barry Goldwater, issu de la frange la plus radicale du parti républicain, favorable notamment à la ségrégation raciale. Le piètre résultat électoral du sénateur de l’Arizona, littéralement écrasé par Johnson, n’empêche nullement qu’il ait pu séduire une frange non négligeable des adversaires de l’interventionnisme étatique, à l’image par exemple d’un Milton Friedman, qui fut l’un de ses conseillers économiques.
Les années 1960 voient en revanche s’opérer sur les campus américains un rapprochement entre une partie de la jeunesse libertarienne et de la gauche radicale engagée dans l’opposition à la guerre du Vietnam et plus encore à la conscription. De là, l’essor d’un libertar[ian]isme de gauche qui voit aussi dans la ségrégation raciale une forme inacceptable de coercition exercée par le gouvernement, tout en réclamant par ailleurs la légalisation de l’avortement ainsi que celle des stupéfiants, le tout dans l’ambiance libertaire que respira une bonne partie de la jeunesse des pays développés33. Les États-Unis ne firent pas exception, même si la convergence entre les jeunes libertariens et la gauche radicale y sera bien plus éphémère que celle que nombre d’anarcho-capitalistes vont bientôt nouer avec une partie de la droite la plus conservatrice. Mais cette évolution – sur laquelle nous reviendrons – débutera durant la décennie suivante. À la fin des années 1960, on n’en est pas encore là, et la création en 1968 du magazine Reason (le mensuel des « esprits libres et des marchés libres », diffusé à 50.000 exemplaires) est parfaitement emblématique des troubled sixties. De même qu’en politique étrangère, le refus de la guerre du Vietnam a conduit nombre de ces libertariens à afficher des positions isolationnistes, avec d’autant plus de facilité qu’ils considèrent comme évident qu’un conflit militaire est la forme la plus extrême – et donc la plus illégitime – de violation par l’État de la souveraineté absolue de l’individu, à laquelle ils croient plus que tout. D’où, alors, l’existence d’un fossé entre cette frange du courant libertarien (surtout parmi les jeunes générations) et les conservateurs qui, obnubilés quant à eux par l’anticommunisme, acceptent sans barguigner le conflit vietnamien.
Ce fossé rend d’autant plus saisissant le rapprochement, manifeste dès la décennie suivante, entre les libertariens de droite (que l’on appellera plus tard « paléo-libertariens ») et la frange la plus conservatrice et populiste des Républicains. De cette mutation décisive, nul n’est plus représentatif que Murray Rothbard, dont il nous faut maintenant relater le parcours de manière plus approfondie.
De l’anarcho-capitalisme au « populisme de droite » : histoire d’une dérive
Certains font remonter cette haine à son expérience très négative de l’enseignement public en tant qu’élève. Sans nous prononcer sur les racines psychologiques de cette haine, il est tout à fait exact que les écoles publiques resteront, tout au long de sa vie, l’une de ses cibles favorites.
Le principal artisan du virage conservateur, pour ne pas dire réactionnaire, d’une majorité de libertariens américains durant la décennie 1970, est incontestablement Murray Rothbard. Ancien disciple du libéral Ludwig von Mises, devenu ensuite anarcho-capitaliste, il va côtoyer l’extrême gauche dans les années 1960, avant d’effectuer un virage spectaculaire en prônant de plus en plus ouvertement une alliance étroite avec la droite extrême la plus décomplexée, le tout au nom d’une haine viscérale de l’État qui constitue à n’en pas douter l’épine dorsale de sa vision idéologique et le grand objectif de sa vie34.
Murray Rothbard : le disciple de Mises devenu anarcho-capitaliste
Cf. Serge Audier, Néo‑libéralisme(s), op. cit., p. 292.
Dans une note de Janvier 1958. Ibid., p. 550.
Né en 1944, Lew Rockwell est un économiste qui se définit comme « anti-État, anti-guerre et pro-marché ». Il a été très proche de Rothbard, avec lequel il publia au début de la décennie 1990 le Rothbard‑Rockwell Report, une newsletter très influente (Ron Paul par exemple y contribua brièvement, après la mort de Rothbard). Très actif dans la diffusion des idées libertariennes, Lew Rockwell est président-fondateur du Ludwig von Mises Institute, vice-président du Center for Libertarian Studies, et il publie le Journal of Libertarian Studies.
Voir le deuxième volume de cette note.
David Gordon, The essential Rothbard, Auburn, Alabama, Ludwig von Mises Institute, 2007, p. 11.
Murray Rothbard, The Essential Von Mises, Bramble Minibooks, 1973.
Il en existe depuis 2007 une traduction française aux éditions Charles Coquelin, sous la direction de Guido Hülsmann (biographe de Ludwig von Mises), avec la traduction d’Hervé de Quengo, à qui l’on doit la traduction de très nombreux textes libéraux, libertariens et anarcho-capitalistes jusque-là indisponibles en français, sur son riche site [en ligne].
Quelqu’un d’aussi peu susceptible d’être qualifiée de libertarienne qu’Hillary Clinton a déclaré un jour qu’elle avait eu, comme tout un chacun outre-Atlantique, sa période Ayn Rand. Sur Ayn Rand, on se reportera à Alain Laurent, Ayn Rand ou la passion de l’égoïsme rationnel, Paris, Les Belles Lettres, 2011 ; et Stéphane Legrand, Ayn Rand, femme Capitale, Éditions Nova, 2017.
Cité par David Gordon, The essential Rothbard, op. cit., p. 13.
C’est là, de fait, un point commun avec Rothbard lui-même.
Traduction de l’auteur.
Un ancien conseiller du candidat républicain Barry Goldwater.
Qui présidera la Société du Mont Pèlerin au début de la décennie 2000.
Nous renvoyons ici au livre d’un excellent connaisseur du libéralisme français du xixe siècle, Aurelian Craiutu, Faces of Moderation. The Art of Balance in an Age of Extremes, University of Pennsylvania Press, 2016.
Les libertariens dénient à l’État le droit d’enrôler quiconque et de l’envoyer à la mort, puisqu’il s’agit évidemment là de la plus grave atteinte que l’on puisse porter à la souveraineté absolue de l’individu. Ou pour parler la langue de Rothbard, la violation la plus flagrante de l’axiome de non-agression.
Murray Rothbard, For a New Liberty. The Libertarian Manifesto, 1973, chapitre 2 : “Propriété et échange” (traduction de l’auteur).
Randolph Bourne, La santé de l’État, c’est la guerre, Le passager clandestin, 2012.
Ronald Radosh, né en 1937, ancien marxiste rallié plus tard au patriotisme américain et au conservatisme social, est alors présenté comme « favorable à une économie socialiste décentralisée ». Cf. Ronald Radosh, Murray Rothbard (eds), A New History of Leviathan. Essays on the Rise of the American Corporate State, 1972.
Murray Rothbard, “Right-Wing Populism: a Strategy for the Paleo Movement”, The Rothbard‑Rockwell Report, janvier 1992. Les citations suivantes sont tirées de ce texte, que nous reproduisons dans le second volume de cette note.
Murray Rothbard, “The Religious Right. Toward a Coalition”, The Rothbard‑Rockwell Report, février 1993.
Né dans le Bronx en 1926 au sein d’une famille juive d’origine russe et polonaise qui comptait de nombreux communistes (bien que son père affichât des convictions de droite), le jeune Murray fit ses études à l’université de Columbia, où il obtint un doctorat en économie en 1956 grâce à une thèse consacrée à la panique de 1819, la première crise économique de l’histoire des États-Unis. Durant ses années d’études, Rothbard travailla pour le Volker Fund, qui était à l’origine une fondation de charité, avant de se transformer, entre le New Deal et les années 1960, en un foyer patronal de diffusion des idées anti-interventionnistes. Selon Serge Audier, il aurait « rédigé pour l’organisation, en tant qu’expert principal, des fiches de lecture et des ‘‘notices strictement confidentielles’’, notamment sur Hayek, jugé trop étatiste et interventionniste35 », le jeune impétrant n’hésitant pas à décrire les travaux de celui qui était alors l’une des figures les plus éminentes de la galaxie libérale comme une « mosaïque de confusion36 ». Dans le cadre du Volker Fund, Rothbard se lia d’amitié avec Frank S. Meyer, un ancien communiste converti au conservatisme et devenu le rédacteur en chef du magazine National Review, fondé en 1955 par William F. Buckley. Meyer et Buckley peuvent être considérés comme le pendant droitier de ce que Rothbard et Lew Rockwell 37 seront du côté libertarien. Les quatre hommes peuvent en effet être considérés comme les pères du « fusionnisme », cette doctrine/stratégie d’union des anarcho-capitalistes et des conservateurs culturels au sein du mouvement « paléo ». Javier Milei est en quelque sorte l’héritier, avec son mélange d’anti-collectivisme forcené, de valeurs culturelles conservatrices, voire réactionnaires, et de nostalgie pour l’âge d’or argentin d’avant 191638.
Le jeune Rothbard fit aussi la connaissance durant ces années 1950 de Leonard Read, qui avait fondé en 1946 la Foundation for Economic Education, l’un des premiers think tanks américains destiné à promouvoir le libre marché (et soutenu financièrement par le richissime industriel Charles Koch). Là, il côtoya également Floyd Arthur Harper, lui-même fondateur en 1961 d’un autre groupe de réflexion libertarien, l’Institute for Human Studies. De ce think tank, lui aussi soutenu par Koch, l’un des biographes de Rothbard écrit qu’il « ne supportait pas seulement le libre marché, mais doutait également de la nécessité même d’un gouvernement39 ». Plus importante encore pour la suite de son parcours, fut la rencontre au sein du Volker Fund et de la FEE de Ludwig von Mises, dont Rothbard se mit à suivre assidûment le séminaire à l’université de New York. Celui qui radicalisera bientôt le libéralisme de Mises pour devenir anarchiste, reconnaîtra volontiers sa dette à l’égard des nombreux écrits de l’économiste autrichien, depuis L’Action humaine, son opus magnum paru en 1949, jusqu’à divers essais destinés à un plus large public, comme Omnipotent Government et Bureaucracy, publiés tous deux en 1944. Bien que nettement plus radical que son maître (Mises, encore une fois, ne fut jamais anarchiste), Rothbard ne cessera pourtant de lui rendre hommage tout au long de sa vie, estimant même que l’auteur de La mentalité anticapitaliste (un autre de ses essais publiés en 1956) était devenu « le centre du mouvement libertarien américain d’après-guerre ; un guide et une éternelle inspiration pour nous tous40». C’est d’ailleurs dans la lignée de L’Action humaine (son « couronnement et sa réalisation monumentale ») que l’élève rédigera en 1962 sa propre somme théorique, intitulée Man, Economy and State41. Là où le maître voulait établir la « méthodologie correcte de la science économique », baptisée « praxéologie » (ou science de l’action), le disciple entendra pour sa part fonder une véritable « science libertarienne ». Si les deux hommes ont bien la même approche théorique (leur « a priorisme » s’oppose au paradigme positiviste que développe alors l’école de Chicago, friande de statistiques et de formalisations mathématiques), Mises et Rothbard n’en fondent pas moins leur vision de la société sur des bases philosophiques fort différentes, le premier s’inscrivant dans une perspective clairement utilitariste (le capitalisme est d’abord, à ses yeux, le système le mieux à même de satisfaire les besoins matériels de l’homme), tandis que le second raisonne quant à lui – comme du reste l’immense majorité des libertariens les plus extrêmes – sur une vision jusnaturaliste qui radicalise le paradigme lockéen, en faisant de la souveraineté absolue de l’individu un droit inaliénable (d’où le refus de reconnaître une quelconque légitimité à l’État).
Au milieu des années 1950, Rothbard côtoya aussi la célèbre romancière Ayn Rand qui publiait alors son roman-fleuve Atlas Shrugged (paru bien plus tard en français sous le titre La Grève), aussitôt devenu un livre-culte bien au-delà de la sphère libertarienne puisqu’il passe pour être le livre le plus vendu aux États-Unis après la Bible42. Rothbard semble avoir entretenu une relation tendue avec la pasionaria de « l’égoïsme rationnel », tout en participant un temps à son cercle « objectiviste ». La romancière se voulait en effet rationaliste et « aristotélicienne », sans que ses capacités proprement philosophiques n’aient jamais impressionné grand monde, au point même de lui valoir un solide mépris du monde académique. Mépris à peu près proportionnel, il faut bien le reconnaître, à son succès populaire. Il est vrai que cette émigrée russe était farouchement anticommuniste, ce qui lui donnait un écho certain en cette période de guerre froide, même si cela la mettait en porte à faux vis-à-vis des tendances isolationnistes de Rothbard, ainsi que du pacifisme d’une grande partie de la jeunesse des années 1960.
Si l’école autrichienne d’économie (à travers principalement Mises) joua un rôle décisif dans la maturation de la pensée personnelle de Rothbard, celle-ci s’est aussi forgée au contact d’autres sources, comme des auteurs anarchistes individualistes américains, peu connus en France mais célèbres dans leur patrie. C’est le cas notamment de Lysander Spooner (1808-1887), un militant antiesclavagiste partisan d’un libre marché radical et adversaire déclaré de certains monopoles comme l’US Post Office. Spooner fut aussi l’auteur d’une série de pamphlets, intitulés No Treason, qui dénonçaient l’accusation de trahison portée contre d’anciens soldats confédérés. Rothbard écrira de ces textes qu’ils constituaient « le plus grand plaidoyer en faveur de la philosophie politique anarchiste jamais écrit43 ». L’autre anarchiste individualiste qui exerça une influence non négligeable sur Rothbard (celui-ci estimait qu’il était « un brillant philosophe politique » malgré son « ignorance abyssale de l’économie ») fut Benjamin R. Tucker (1854-1939), traducteur de Proudhon et de Max Stirner, et défenseur de la libre pensée comme de l’amour libre. Dans son journal Liberty, Tucker diffusait également les idées d’Herbert Spencer, ainsi que les thèses anarchistes de Bakounine. Il rompra néanmoins avec les anarchistes socialistes européens sur la question de la propriété privée (que les libertariens érigeront pour leur part au rang de dogme intouchable). Comme Spooner, il poursuivait enfin de sa verve corrosive tous les monopoles entravant le libre marché, qu’il s’agisse des tarifs douaniers, de la rente foncière, ou encore des brevets. Notons pour finir que Tucker, comme Spooner (et à l’image de leurs héritiers anarcho-capitalistes au siècle suivant), fondaient leur antiétatisme radical sur le droit naturel et sur la défense d’une liberté individuelle sans borne, tout en prenant toujours soin de distinguer le libre marché à l’échelle interpersonnelle, éminemment vertueux, du capitalisme des puissants qu’ils exécraient à cause de sa connivence avec l’État, ce grand dispensateur de privilèges.
Comme nous l’avons vu, Rothbard, durant les années 1960, a semblé partager brièvement, comme beaucoup d’autres, un certain nombre des idées véhiculées par les libertaires de gauche, ce qu’atteste par exemple le texte qu’il publia en 1965 sous le titre“Left and Right.The Prospect for Liberty44”. Il s’opposait explicitement dans ce texte au conservatisme, dans lequel il disait voir un adversaire aussi redoutable que le socialisme. Parlant du xIxe siècle, il écrivait en effet :
« Bientôt se développèrent en Europe occidentale deux grandes idéologies politiques, centrées autour de ce nouveau phénomène révolutionnaire : l’une était le Libéralisme, le parti de l’espoir, du radicalisme, de la liberté, de la Révolution industrielle, du progrès de l’humanité ; l’autre était le Conservatisme, le parti de la réaction, le parti qui aspirait à restaurer la hiérarchie, l’étatisme, la théocratie, la servitude, et l’exploitation de classe de l’ordre ancien. Comme le libéralisme avait de l’avis général la raison de son côté, les Conservateurs ont assombri le climat idéologique par des appels obscurantistes au romantisme, à la théocratie et à l’irrationalisme. Les idéologies politiques étaient polarisées, avec le Libéralisme à l’extrême ‘‘gauche’’ et le Conservatisme à l’extrême ‘‘droite’’ du spectre politique. Le fait que le véritable libéralisme soit essentiellement radical et révolutionnaire a été brillamment perçu à l’aube de son impact par le grand Lord Acton (l’une des rares figures de l’histoire de la pensée à avoir eu l’heur de devenir plus radical en vieillissant)45. Acton a écrit que ‘‘le Libéralisme souhaite ce qui devrait être, indépendamment de ce qui est’’. En élaborant cette vision, du reste, c’est Acton et non Trotsky qui est parvenu au concept de ‘‘révolution permanente46’’ ».
Ce texte est paru au printemps 1965 dans une revue portant le même titre, Left & Right, fondée par Rothbard, Karl Hess47, George Reschet Leonard Liggio48. Même si son existence fut éphémère (1965-1968), la revue témoigne du malaise ressenti alors par Rothbard et ses amis devant le soutien apporté par de nombreux conservateurs à la guerre du Vietnam. Un désaccord qui, sans le conduire à rompre à proprement parler avec la droite conservatrice, le conduisit néanmoins à affirmer sa conviction selon laquelle « les catégories actuelles de ‘‘gauche’’ et de ‘‘droite’’ sont devenues trompeuses et obsolètes ». Tout en précisant bien que cela ne pouvait en aucun cas signifier qu’il se reconnaissait dans des positions « centristes », la modération – que l’on peut pourtant à bon droit considérer comme un élément constitutif du libéralisme49 – n’ayant jamais été son fort, et ce à aucun moment de sa vie. Parmi les objectifs de la revue Left & Right, dont Rothbard fournissait l’essentiel des textes, figurait la volonté d’encourager le dialogue entre les libertariens et la New Left américaine, antitotalitaire et hostile au climat de guerre froide (plus pacifiste qu’isolationniste en réalité). La revue ne pouvait en effet rester insensible à la grande révolte libertaire des années 1960, et c’est ainsi qu’elle organisa par exemple en 1968 à New York un débat entre Rothbard et l’essayiste-militant écologiste et socialiste libertaire Murray Bookchin.
Toutefois, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, c’est surtout la guerre du Vietnam qui explique cette brève lune de miel avec la gauche libertaire, Rothbard étant resté tout au long de sa vie farouchement opposé à toute forme d’interventionnisme militaire. Son rejet viscéral de l’État l’a en effet toujours emporté chez lui sur son rejet du communisme – un rejet du reste ambigu puisque s’il ne pouvait approuver le collectivisme inhérent à cette doctrine, il n’était pas sans admirer le génie tactique d’un certain nombre de ses théoriciens, à commencer par Lénine. Nous y reviendrons.
Le conflit vietnamien constitua donc une opportunité pour le mouvement libertarien puisque le refus plus circonstanciel d’une partie de la jeunesse américaine d’aller se faire tuer en Asie rencontrait leur rejet doctrinal de toute conscription et de toute guerre50. En effet, Rothbard a fait du principe de non-agression l’axiome fondamental de sa doctrine, le définissant comme suit dans son Libertarian Manifesto publié en 1973 :
« Le Credo libertarien repose sur un axiome central : qu’aucun homme ni groupe d’hommes ne peut agresser quelqu’un en portant atteinte à sa personne ou à sa propriété. On peut appeler cela l’‘‘axiome de non-agression’’, ‘‘agression’’ étant défini comme prendre l’initiative d’utiliser ou de menacer d’utiliser la violence physique à l’encontre d’une autre personne ou de sa propriété. Agression est donc synonyme d’invasion. Si personne ne peut agresser quelqu’un d’autre, en bref, si chacun a le droit absolu d’être ‘‘libre’’ de toute agression, il s’ensuit immédiatement que le libertarien approuve sans réserve ce qu’on appelle généralement les ‘‘libertés civiles’’ : liberté d’expression, de publication, d’association, liberté de se livrer à des ‘‘crimes sans victimes’’ tels que la pornographie, les déviations sexuelles et la prostitution (que le libertarien ne considère pas du tout comme des ‘‘crimes’’, puisqu’il ne s’agit pas de violation [violent invasion] d’une autre personne ou de sa propriété). En outre, il considère la conscription comme un esclavage à grande échelle. Et puisque la guerre, et plus particulièrement la guerre moderne, entraîne l’exécution massive de civils, le libertarien considère de tels conflits comme du meurtre de masse, et donc comme quelque chose d’absolument illégitime51 ».
En ce sens, l’isolationnisme de Rothbard et des libertariens les plus radicaux ne constitue pas une simple opportunité tactique destinée à attirer une jeunesse en révolte, mais doit plus fondamentalement être vu comme un élément essentiel de leur rejet absolu du Léviathan étatique. Rothbard avait d’ailleurs pu mûrir ses idées en matière de politique étrangère auprès de fervents isolationnistes comme Frank Chodorov, un individualiste intransigeant qui édita à partir de 1951 la revue The Freeman. Les deux hommes partageaient pleinement l’idée qui avait donné son titre au célèbre essai de Randolph Bourne, à savoir que « la guerre est la santé de l’État52 ». De fait, l’opposition radicale à toute politique étrangère agressive fait partie de ces quelques points sur lesquels Rothbard n’a jamais varié d’un iota tout au long de sa vie.
Ceci est d’autant plus vrai durant la guerre froide que Rothbard a toujours été convaincu que le communisme s’effondrerait de lui-même. C’est là une conviction qui a été ancrée dans son esprit par la lecture de son maître Ludwig von Mises, puisque ce dernier avait démontré dès 1922, dans Socialism que toute planification centralisée était vouée à l’échec. De là était née sa conviction que l’effondrement de l’Union soviétique n’était qu’une question de temps et ne nécessitait nullement de vouloir chercher à la précipiter par l’usage de la force. Un tel optimisme pouvait paraître bien naïf à bon nombre de conservateurs de la Old Right, à une époque où Moscou parvenait à donner le change sur la scène internationale en affichant une puissance militaire redoutable, qui justifiait précisément aux yeux de nombreux conservateurs une politique plus offensive. C’était notamment le cas de la National Review de William Buckley, à laquelle Rothbard avait collaboré dans ses jeunes années, et qui défendait désormais, sous la plume notamment de James Burnam et de Frank S. Meyer, une position farouchement antisoviétique, faisant passer l’anticommunisme avant les considérations philosophiques de leurs amis libertariens.
Si la guerre du Vietnam est donc l’occasion pour Rothbard de prendre ses distances avec une partie de cette droite conservatrice, et, inversement, d’entamer un dialogue constructif de circonstance avec la frange libertaire de la gauche, il ne faut toutefois pas conclure de ces accointances passagères que Rothbard serait durablement acquis à un positionnement ni-gauche ni-droite.
De manière tout à fait significative, dans l’introduction d’un recueil d’articles paru en 1972 sous le titre A New History of Leviathan, que Rothbard codirige avec Ronald Radosh53, voici comment il est présenté :
« Murray N. Rothbard est l’un des leaders intellectuels de la nouvelle ‘‘aile droite du mouvement libertarien’’ – un mouvement qui a émergé de ce qu’on appelle désormais la ‘‘vieille droite’’, la tradition libertaire américaine commençant avec Jefferson et Paine et se poursuivant au xxe siècle dans la pensée et la politique de personnes telles que H. L. Mencken, Garet Garrett, Oswald Garrison Villard, John T. Flynn et le sénateur Robert A. Taft. Fervent partisan du capitalisme de laissez-faire, Rothbard est un économiste du libre marché, un ancien collaborateur de la National Review et un membre du comité exécutif de l’Union nationale des contribuables ».
Faire du Rothbard de cette époque une sorte de crypto-gauchiste qui se serait ensuite renié n’a donc aucun sens, même s’il était alors indéniablement plus œcuménique qu’il ne le deviendra par la suite. Un œcuménisme qui l’amena à participer en 1971 à la fondation du Parti libertarien, tout en émettant des réserves sur la stratégie d’un mouvement selon lui « dominé par un groupe néo-randien, pro-guerre54 ». Tout au moins jusqu’à la convention de 1975, durant laquelle les « isolationnistes » proches des thèses de Rothbard prirent le contrôle du parti et purent ainsi « développer le libertarisme comme un credo conscient, séparé et distinct du conservatisme de Buckley et a fortiori de la droite de plus en plus étatiste et pro-droits civiques ». Malgré cette inflexion idéologique, le Parti devint selon Rothbard « de plus en plus insignifiant » au début des années 1980, même « si la campagne présidentielle de Ron Paul en 1988 fut une dernière tentative désespérée de transformer le Parti libertarien […] en un parti dans lequel les gens de la classe moyenne et de la classe ouvrière pourraient se sentir chez eux ». Et Rothbard de conclure que si « l’effort était noble », il « échoua » néanmoins car « les effectifs n’étaient tout simplement pas là ». Ce qui conforta le théoricien de l’anarcho-capitalisme le plus radical dans sa promotion d’une stratégie populiste visant à se rallier les masses par une alliance avec une droite aussi conservatrice en matière culturelle qu’isolationniste en politique étrangère.
C’est cette stratégie que nous allons maintenant analyser plus en détail, avec la naissance de ce que l’on va bientôt appeler le « paléo-libertarianisme » et la stratégie de « fusionnisme » avec la frange la plus droitière des Républicains conservateurs. Une dérive droitière engagée après la guerre du Vietnam et qui atteindra son acmé avec la fin de la guerre froide, comme en témoigne, parmi tant d’autres, ce texte de février 1993, dans lequel on peut lire :
« En résumé, la tâche des paléo-libertariens est de sortir du gouffre sectaire libertaire et de forger des alliances avec les ‘‘réactionnaires’’ culturels et sociaux, ainsi que politico-économiques. La fin de la guerre froide, ainsi que la montée du ‘‘politiquement correct’’, ont rendu totalement obsolète la vision libertaire standard selon laquelle les libertariens sont soit à mi-chemin, ou ‘‘au dessus’’ de la droite et la gauche55 ».
Les relations entre libéraux et conservateurs américains dans l’après-guerre
Le livre est paru en français en 2006 aux Belles Lettres, sous le titre : La Liberté et le Droit.
Cité par Serge Audier, Néo‑Libéralisme(s), op. cit., p. 533. Il utilise ici un terme promis à un grand avenir dans la sphère libertarienne, mais qui prendra un tout autre sens sous la plume de Rothbard.
Il lui préfère en privé, on l’a vu, celui de « paléo-libertarien » (que Rothbard reprendra, mais dans un sens différent).
Outre le discours que nous publions dans le second volume de cette note, on peut se reporter, sur ce point, à l’émission de France Culture, « Le Temps du débat », datée du 12 décembre 2023, et consacrée au thème : « Argentine : le libertarisme est-il un programme ? » (on peut écouter l’émission en ligne).
Publié en annexe de sa Constitution of Liberty, parue en 1960. Bien que ce soit là l’un des textes majeurs d’Hayek, il faudra attendre 1994 pour en avoir une traduction française (aux éditions Litec), devenue aujourd’hui introuvable. Où l’on voit, une fois de plus, que la maitrise de l’anglais est absolument indispensable à quiconque entend étudier un tant soit peu sérieusement les courants libéraux et libertariens…
Voir Philippe Nemo, La Philosophie de Hayek, Paris, PUF, 2023, et Vincent Valentin, Les conceptions néo‑libérales du droit, Paris, Economica, 2002.
Pour mieux comprendre l’enjeu de ce glissement idéologique majeur, dont les conséquences se font pleinement sentir aujourd’hui aux États-Unis, en Argentine et ailleurs, il convient d’abord de faire un léger pas de côté. En élargissant notre focale et en examinant, au-delà du cas de Rothbard et des anarcho-capitalistes, comment ont évolué après la Seconde Guerre mondiale les relations entre d’autres courants plus modérés du libéralisme et la mouvance conservatrice, elle-même fort diverse.
De fait, à partir des années 1950, la droite américaine a connu un renouveau qui s’est accompagné d’importants clivages, entre notamment ce que l’on a appelé le New Conservatism et la Old Right isolationniste et laissez-fairiste. Deux importantes revues ont alors symbolisé ce renouveau conservateur : la National Review, créée en 1955 et dirigée par William F. Buckley Jr, et Modern Age, une revue académique fondée en 1957 par Russell Kirk. Ce dernier était l’auteur d’un livre intitulé The Conservative Mind. From Burke To Eliot (1953), dans lequel il se réclamait explicitement des idées du célèbre penseur contre-révolutionnaire irlandais du xvIIIe siècle Edmund Burke. Kirk – qui, par ailleurs, ne ménageait pas ses critiques à l’égard du libéralisme d’un Hayek ou d’un Mises – fut l’un des principaux conseillers de Barry Goldwater, dont la victoire lors de la Convention républicaine de 1964 face à un candidat modéré, a été un moment de cristallisation essentiel pour la droite radicale américaine. Le candidat qui arborait fièrement le drapeau conservateur n’en était pas moins entouré d’un certain nombre de libéraux classiques, voire de libertariens, dont il partageait le rejet du Welfare State. C’est ainsi – nous l’avons vu – que le jeune Milton Friedman, qui s’était fait connaître du grand public deux ans plus tôt avec la parution de Capitalism and Freedom, fut l’un de ses conseillers, participant activement à la rédaction de son programme économique. L’équipe de Goldwater s’était aussi montrée ouverte à d’autres courants libéraux représentés au sein de la Société du Mont Pèlerin, y compris des libéraux autrichiens, proches d’Hayek et de Mises. On pouvait même trouver parmi les soutiens du candidat d’authentiques libertariens, comme le théoricien du droit italien Bruno Leoni, l’un des dirigeants de la Société du Mont Pèlerin, auteur notamment de Freedom and the law, paru en 196156. Outre l’hostilité à l’impôt fédéral progressif sur le revenu et sa volonté d’attaquer de front le pouvoir syndical, Leoni approuvait la critique que faisait Goldwater des politiques d’intégration et du démantèlement par la Cour suprême des législations discriminatoires, au nom d’une lecture progressiste de la Constitution.
Après la publication tonitruante de La Route de la servitude, et celle, plus confidentielle, au même moment, de Bureaucracy et Omnipotent Government, les Autrichiens Hayek et Mises ont été portés aux nues par nombre de conservateurs, bien que l’un et l’autre aient tenu à prendre leurs distances avec ce courant de pensée – tout en n’hésitant pas à nouer des alliances avec lui, notamment au sein de la Société du Mont Pèlerin. Mises en particulier éprouvait un certain malaise à l’idée qu’on puisse l’identifier à une philosophie dont il se sentait à bien des égards éloigné. Il écrivait ainsi en 1957 dans une correspondance privée : « Je suis parmi les contemporains encore vivants de Karl Marx, de Guillaume 1er et d’Horatio Alger : en bref, je suis un paléo-libertarien57 ». Dans une lettre de février 1961, le même Mises écrivait à Hayek :
« Je suis d’accord avec votre refus de l’étiquette du ‘‘conservatisme’’. Dans son Up from Liberalism, Buckley – qui est une personne fine et instruite – a défini clairement sa position : ‘‘Le conservatisme consiste en la reconnaissance tacite que tout ce qui est vraiment important dans l’histoire humaine est derrière nous, que les recherches fondamentales ont déjà été effectuées, et qu’il est donné à l’homme de connaître quelles sont les grandes vérités qui en ont émergé.Tout ce que nous réserve l’avenir ne peut dépasser l’importance pour l’humanité de ce qui est arrivé dans le passé. […] Avec des mots différents, Origène, Augustin et Thomas d’Aquin ont affirmé la même idée. Il est tristement vrai que ce programme est plus attirant que tout ce qui a été dit sur la liberté et sur les bénéfices idéaux et matériels de l’économie libre ».
On le voit, Mises est d’autant moins enclin à se dire conservateur que, dans le contexte de l’après-guerre, conserver les choses en l’état signifiait entériner l’interventionnisme croissant mis en place depuis plusieurs décennies en Europe, mais aussi aux États-Unis, à travers notamment les expériences du New Deal et de la Great Society. En ce sens, même s’il ne prononce jamais le terme, Mises serait plutôt, en matière économique, un « réactionnaire » au sens strict du terme 58, c’est-à-dire un partisan du retour à l’âge d’or de l’État minimum tel qu’il existait encore au xIxe siècle (c’est là du reste un point que l’on retrouve chez quelqu’un comme Javier Milei, qui ne cesse d’en appeler au retour à l’âge d’or argentin qu’il situe avant la Première Guerre mondiale59). Une telle position, notons-le, correspond bien davantage au libéralisme de type minarchiste qu’à l’anarcho-capitalisme qui entend pour sa part abolir purement et simplement l’État. Non revenir en arrière, vers un âge d’or révolu, mais faire au contraire un grand bond en avant, vers un monde nouveau, enfin débarrassé de l’hydre étatique. Un monde qui n’a jamais existé que dans quelques esprits utopiques.
Le rapport d’Hayek au conservatisme est encore différent. Même s’il n’approuvait pas davantage que ne le faisait Mises les positions traditionalistes d’un Russell Kirk, et même s’il prononça en 1957 une conférence intitulée « Pourquoi je ne suis pas conservateur60 », il est indéniable que la pensée d’Hayek contient une dimension indubitablement conservatrice. C’est en particulier le cas de sa conception du droit telle qu’il la théorise dans Law, Legislation and Liberty, l’un de ses maîtres livres, dont les trois volumes sont parus respectivement en 1973, 1976 et 197961.
Pour Hayek, le droit civil, ou nomos, est constitué de l’ensemble des règles du jeu social, abstraites et générales, qui se sont constituées à la faveur d’un processus évolutif et qui assurent de facto un ordre social spontané en rendant compatibles les objectifs différents d’individus nombreux. Ce droit coutumier existe donc indépendamment des volontés humaines individuelles (tout comme une langue), et ne saurait donc varier en fonction des humeurs du moment ou des opinions des uns et des autres. Les règles de juste conduite qui émergent au fur et à mesure du temps sont celles qui ont fait preuve de leur valeur dans la structuration de la société, et c’est pourquoi ce droit préexiste à l’État et limite sa souveraineté (trouver les institutions qui garantiront le plus efficacement ce respect du droit ainsi entendu est l’objet même de la Constitution de la Liberté qu’il publie en 1960). Le droit en tant que nomos doit donc être soigneusement distingué de la législation, ou thésis, qui édicte des normes et des commandements particuliers dont la sanction est assurée par une autorité publique qui dispose du monopole de la contrainte et peut donc enjoindre à un individu d’agir d’une façon déterminée. Ces commandements édictés par le législateur constituent le droit public.
La conception du droit d’Hayek, tout comme ses conceptions économiques du reste, découle logiquement de sa théorie de la connaissance qui insiste sur les limites de la rationalité humaine et sur l’importance des ordres spontanés que sont le marché et la culture, qui ne sortent pas tout droit d’un esprit omniscient, mais sont le résultat d’une myriade d’interactions qui constituent une société complexe et une tradition séculaire. Son rationalisme évolutionniste met donc en valeur ce qui s’est transmis au fil des générations par le biais d’un savoir pratique d’où ont germé le droit de propriété, la notion de contrat, la concurrence et finalement, la liberté individuelle elle-même. Autant de règles de juste conduite qui ont été sélectionnées par l’histoire pour leur efficacité sociale, parce qu’elles rendaient le groupe plus efficient. Il serait d’ailleurs erroné de voir dans cette conception une forme de « darwinisme social », et à tout prendre, il conviendrait mieux de parler de « lamarckisme social ». En effet, contrairement à Darwin pour qui les animaux les moins adaptés sont éliminés par un environnement hostile, Lamarck défendait les capacités transformatives des espèces, estimant que le milieu sélectionne non pas en « éliminant » les espèces mais en « transformant » les organismes. Certes, la théorie de Lamarck a été invalidée pour ce qui est de la sélection naturelle, donnant ainsi raison à Darwin, mais il n’en est nullement de même pour la sélection culturelle, puisque la science ne saurait de la même manière invalider l’hypothèse d’Hayek selon laquelle les sociétés humaines ont progressé par la transmission des règles de bonne conduite les mieux adaptées.
Reste qu’il est aisé de comprendre qu’une telle théorie n’est pas sans affinités profondes avec le conservatisme. Dans un tel schéma, en effet, il n’est guère de place pour des changements abrupts de législation, quand bien même la demande sociale s’en ferait sentir fortement. Comment penser en effet qu’une évolution séculaire puisse être légitimement interrompue par une demande sociale soudaine, comme cela arrive pourtant assez fréquemment dans nos sociétés modernes – que l’on pense aujourd’hui aux droits LGBT ou même au droit à l’avortement ? La reconnaissance des droits des femmes ou des minorités sexuelles a plus évolué en trois décennies que durant toute l’histoire antérieure. Comment penser un tel bouleversement des mentalités dans un schéma de type hayékien ? Celui-ci ne renvoie-t-il pas tout volontarisme juridico-politique à une forme d’hyper-rationalisme ou d’hybris rationaliste ? Que répondre, en suivant un tel schéma, aux anarcho-capitalistes qui réclament d’opérer au plus vite une révolution radicale mettant à terre un édifice étatique multiséculaire ? Il est clair que les partisans d’Hayek et ceux de Rothbard ne parlent tout simplement pas le même langage. Et il n’y a rien de bien surprenant à voir Hayek, lorsqu’on lui demande de qualifier son positionnement politique, ressusciter le vieux terme d’Old Whig, qui renvoie au libéralisme anglais du xvIIIe siècle. Celui-là même dont se réclamait Edmund Burke, adversaire résolu de la Révolution française et des principes qui l’ont animée. Il serait possible de démontrer – mais ce n’est pas notre objet ici – qu’il y a une affinité profonde entre la pensée contre-révolutionnaire de Burke et l’évolutionnisme culturel d’Hayek, qui de manière tout à fait significative voit dans la France rationaliste des Lumières l’une des manifestations les plus évidentes de la présomption rationaliste fatale qu’il condamne.
Rothbard, théoricien du paléo-libertar[ian]isme et de l’alliance avec la droite populiste
Insistons sur l’ironie qu’il y a à voir un anarcho-capitaliste très tôt critique envers un Hayek dont il dénonçait dès les années 1950 le manque d’audace dans son rejet de l’État, prendre une vingtaine d’années plus tard la tête d’un ralliement à une droite autrement plus conservatrice que l’auteur de la Route de la servitude !
Après ce détour indispensable pour mieux resituer dans un cadre plus général le phénomène que nous plaçons au cœur de notre analyse, nous devons maintenant en revenir à Rothbard, qui fut, on l’a compris, le théoricien le plus en vue de la mouvance anarcho-capitaliste et dans le même temps l’acteur essentiel du rapprochement a priori contre-nature avec la droite ultraconservatrice. Rapprochement entamé durant la décennie 1970 et poursuivi jusque dans les dernières années de sa vie62.
Plutôt que de suivre pas à pas les étapes de cette évolution, ce qui demanderait d’y consacrer un livre entier (qui reste à écrire en français), le mieux est encore d’aller directement au point d’aboutissement pour mesurer ainsi le chemin parcouru et comprendre les lignes de failles qui ont permis un glissement tectonique de si grande ampleur. Avant d’examiner en quoi le rapprochement entre anarcho-capitalistes (devenus « paléo-libertariens ») et conservateurs de la Old Right (devenus « paléo-conservateurs ») a obéi à une stratégie politique, pour ne pas dire politicienne, attachons-nous d’abord aux éléments de correspondance idéologiques qui ont rendu possible cette convergence, pourtant au départ bien improbable.
Les fondements idéologiques de la fusion entre libertariens et ultraconservateurs
Pour lire la version complète de ce texte-programme et sur le contexte politique précis dans lequel il s’inscrit, nous renvoyons au second volume de cette note, dans lequel nous en publions l’essentiel.
S’il n’existe pas en français (du moins à notre connaissance) de travaux scientifiques analysant en profondeur ce phénomène, on peut se reporter à Tristan Hugues, “A space for freedom : the Paleolibertarian coalition”, Journal of Political Ideologies, 2023, pp. 1-20.
Sous la plume de Rothbard et de Lew Rockwell, comme nous l’avons déjà dit.
La dénonciation récurrente des campagnes anti-tabac dans les années 1980 et 1990 fait écho aux réactions hostiles que provoquera en 2020 la lutte contre le Covid. Les paléo-libertariens y verront une violation par l’État de la propriété absolue des individus sur leur corps, et donc leur santé. Ce qui rendra délicate, dès lors, leur critique du droit à l’avortement.
C’est au sein de la puissante Federalist Society que cette promotion de l’originalisme se fera au sein du monde des juristes américains, dont chacun sait à quel point ils jouent aux États-Unis un rôle sans commune mesure avec celui de leurs homologues français. Nous renvoyons ici au stimulant essai publié par Laurent Cohen-Tanuggi en 1985 : Le Droit sans l’État (PUF).
Murray Rothbard, “Right-Wing Populism: a Strategy for the Paleo Movement”, op. cit.
Car même si ce rapprochement va conduire les intéressés à se renier sur un certain nombre de points précis (nous y reviendrons plus tard), force est de constater qu’il ne s’agit pas tout à fait de l’alliance de l’eau et du feu, tant il est vrai qu’un certain nombre de passerelles idéologiques ont rendu possible ce qui n’en est pas moins un saut au regard de certaines positions passées des intéressés.
C’est sans doute le texte “Right-Wing Populism : a Strategy for the Paleo Movement63”, publié en janvier 1992 dans le Rothbard-Rockwell-Report, qui exprime avec le plus de clarté les principes au nom desquels le rapprochement entre libertariens et conservateurs populistes de droite a pu se faire (c’est pourquoi nous en publions une grande partie dans le second volume de cette note64). Le nœud de l’argumentation rothbardienne tourne en effet autour de l’opposition entre les dominés (le peuple écrasé d’impôts et de mépris) et les dominants (à savoir les hommes de l’État, mélange de politiciens, de technocrates, de patrons de grandes entreprises et d’intellectuels stipendiés). C’est bien cette opposition, dont le féroce manichéisme ferait passer les romans d’Ayn Rand pour des manuels d’œcuménisme, qui va permettre à Rothbard de concilier le combat qui a toujours été le sien contre l’hydre étatique et le concubinage idéologique avec les « conservateurs » de stricte obédience. Car tous désignent un ennemi commun : les élites de la côte Est (les diplômés de la Ivy League) qui peuplent les lieux de pouvoir et imposent grâce à cette position dominante une idéologie progressiste destinée d’abord à entretenir et à faire prospérer la pieuvre étatique.
Concrètement, les anarcho-capitalistes de droite (rebaptisés « paléo-libertariens » au début des années 199065), vont entamer aux côtés des héritiers de la Old Right (qualifiés au même moment de « paléo-conservateurs »), une véritable croisade contre le Warfare-Welfare State, sorte d’hydre à plusieurs têtes. Aux yeux de cette coalition libertaro-réactionnaire, cet « État-providence impérialiste » est en effet composé de divers éléments. D’abord le Big governement, avec ses programmes sociaux et leur revers, une fiscalité confiscatoire. Ensuite, l’interventionnisme militaire, destiné à alimenter le complexe militaro-industriel au nom d’une idéologie démocratique appelée à convertir le monde entier. Enfin, un prurit législatif destiné à promouvoir le multiculturalisme tout en luttant contre ce que les populistes de droite jugent être de prétendues discriminations, afin de mieux nourrir l’insatiable appétit réglementaire et coercitif du Léviathan. Telle est le noyau de l’argumentation, qui fait système dans la mesure où chaque élément est censé illustrer la thèse centrale du combat de David (le petit contribuable blanc spolié et humilié) contre Goliath (l’élite aux commandes d’un État prêt à tout pour persévérer dans son Être et accroître sa volonté de puissance).
Il ne reste plus dès lors – selon la sensibilité de chacun, les circonstances et les interlocuteurs – qu’à insister davantage sur tel point plutôt que sur tel autre, sans paraître atteindre à la cohérence de l’ensemble du discours. Les « paléolibertariens » seront intarissables sur la spoliation fiscale, sur le caractère ruineux et illégitime des interventions militaires extérieures, ou bien encore sur le caractère liberticide des réglementations visant à lutter contre les inégalités sociales, les diverses discriminations (raciales, sexuelles, etc.), les impératifs sanitaires66 ou encore la protection de l’environnement (une autre de leurs cibles favorites, que l’on retrouve aujourd’hui à satiété dans la rhétorique de Milei, Trump et tant d’autres). Les « paléoconservateurs », eux, mettront davantage l’accent sur la promotion d’un ordre moral chrétien, sur les immixtions scandaleuses de l’État fédéral en violation flagrante des sacro-saints principes Jeffersoniens, ou encore sur la dénonciation du combat pour les droits civiques et pour tous les « faux droits » des minorités (femmes, minorités sexuelles et raciales, etc.). Le tout au nom de la liberté d’expression la plus absolue et du droit des États fédérés, sans oublier une lecture littérale (dite « originaliste ») de la Constitution, qui renvoie à la lettre- même du texte de 1787, loin des interprétations volontaristes promues par les juristes progressistes du xxe siècle67. On le voit, la fusion de deux idéologies au départ fort éloignées, finit par faire système et par trouver un équilibre autour du pivot que constitue le « populisme de droite » dont Rothbard définit ainsi le programme en janvier 1992 :
« L’idée fondamentale du populisme de droite est que nous vivons dans un pays et dans un monde étatisés. Que l’élite dirigeante qui les domine est constituée d’une coalition comprenant les membres d’un État obèse, les dirigeants de grandes sociétés, et divers autres lobbies influents. Plus précisément, la vieille Amérique de la liberté personnelle, de la propriété privée et de l’État minimal a fait place à une coalition de politiciens et de bureaucrates associés à des élites financières et commerciales (par exemple les Rockefeller, les membres de la Trilatérale) voire dominés par elles ; et cette nouvelle classe de technocrates et d’intellectuels, comprenant les universitaires du Nord-Est et les élites médiatiques, représente dans la société la classe qui crée l’opinion. Bref, c’est une moderne alliance du Trône et de l’Autel qui nous dirige, sauf que le Trône s’incarne dans divers groupes de la grande industrie et que l’Autel est fait d’intellectuels étatistes laïcs, même si, au milieu de tout ce laïcisme, on peut encore trouver une dose appropriée de chrétiens partisans de l’‘‘Évangile’’ Social68 ».
Un programme populiste de droite
Cette année-là il publie un livre intitulé A Program for Monetary Stability. L’ouvrage, édité aux Fordham University Press, n’a jamais été traduit en français, comme bien d’autres livres de Friedman du reste, ce qui ne laisse pas d’interroger sur le caractère insulaire de la réflexion académique française dans certains domaines.
Friedrich Hayek, Pour une vraie concurrence des monnaies, Paris, PUF, 2015.
C’est le titre d’un des chapitres de son grand traité d’économie, L’Action humaine.
La défense de l’isolationnisme est par exemple très forte chez des auteurs qui ont profondément marqué la sphère libertarienne, comme Albert Jay Nock (1870-1945), Garet Garrett (1878-1954) ou encore John T. Flynn (1882-1964). Leur isolationnisme allant de pair avec leur rejet de l’interventionnisme étatique, ces figures de la droite intellectuelle américaine ont, en toute logique, trouvé en Franklin D. Roosevelt, artisan du New Deal et de l’implication des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, leur cible favorite.
Au sens strict du terme puisque l’originalisme consiste à revenir à l’esprit initial des Pères Fondateurs, après des décennies de ce qu’ils considèrent comme des dérives interprétatives progressistes.
Dans ce manifeste, dont l’écho fut important dans la sphère libertarienne et conservatrice, Rothbard ne se contente pas d’en rester aux grands principes, mais il énonce aussi un programme politique précis, en huit points. Ceux-ci méritent d’être détaillés.
1. Diminution radicale des impôts
Rothbard entend diminuer drastiquement tous les impôts, mais tout particulièrement l’impôt sur le revenu qui à ses yeux « opprime le plus, politiquement et personnellement ». Il entend donc « travailler à la suppression de l’impôt sur le revenu et sur l’abolition de la bureaucratie qui l’administre ». Si la fiscalité apparaît en premier dans ce programme, c’est que l’impôt est comme le sang qui irrigue les veines du Léviathan étatique qu’il entend terrasser. Le rendre exsangue suppose donc de lui couper pour ainsi dire les vivres.
2. Couper radicalement dans l’État-providence
Si l’impôt est le sang qui fait vivre l’État, la classe parasitaire qui vit de l’assistance publique est pour Rothbard son principal soutien au sein de la population. Il entend donc « éliminer l’empire de la sous-classe par la suppression du système d’assistance ou, à défaut de suppression, par des coupes importantes et par sa restriction ». Couper les vivres des assistés revient à ses yeux à priver l’État du support d’une catégorie de citoyens qui vit aux dépens des autres, tout en étant improductive.
3. Supprimer les privilèges raciaux et autres privilèges de groupe
Pour Rothbard, il s’agit de démanteler tout l’édifice de la discrimination positive (ce qu’il appelle les « quotas racistes »), en soulignant que « ces quotas-là prétendent se fonder sur la construction des ‘‘droits civiques’’, laquelle nie le droit de propriété de tout Américain ». On voit qu’ici Rothbard rejoint l’une des revendications principales de la droite réactionnaire en la reliant, assez artificiellement il faut bien le dire, à la notion de droit de propriété, cardinale comme on le sait chez les libertariens. De fait, dans sa définition de l’« axiome de non-agression », concept-clé du libertarianisme tel qu’il l’avait exposé en 1973 dans le Libertarian Manifesto, cette dimension-là du droit de propriété n’était nullement explicitée :
« Le libertarien s’opposant à l’agression contre le droit de propriété privée, il s’oppose tout aussi vigoureusement à l’intrusion du gouvernement dans les droits de propriété et dans l’économie de marché au travers de contrôles, réglementations, subventions ou interdictions. Car si chaque individu a le droit de posséder et de ne pas être agressé et volé, alors il a aussi le droit de se défaire de sa propriété (par la transmission ou l’héritage) et de l’échanger contre la propriété d’autres personnes (liberté de contrat et économie de marché libre) sans subir d’intrusion. Le libertarien est donc en faveur d’un droit de propriété sans restriction et du libre-échange, c’est- à-dire d’un système capitalistique de laissez-faire. Il s’oppose également à la redistribution des richesses par l’imposition, qu’il considère comme une agression contre la propriété privée ».
4. Reconquérir les rues : pas de quartiers pour les criminels
Par là, Rothbard entend « les violents criminels qui courent les rues – voleurs, agresseurs, violeurs, assassins – et non les ‘‘criminels en col blanc’’ ou les auteurs de prétendus ‘‘délits d’initié’’ », laissant donc entendre que la lutte contre ce que l’on appelle aujourd’hui la délinquance financière ne saurait être à ses yeux une priorité. Quant à ceux qui pourraient penser qu’un libertarien ne saurait avoir la moindre sympathie pour toute forme de répression policière que ce soit, ils en sont pour leurs frais puisque Rothbard ajoute, pouvant difficilement être plus clair : « les flics [cops] doivent être libres d’agir et autorisés à administrer une punition immédiate, leur responsabilité étant évidemment engagée en cas d’erreur ».
5. Se réapproprier les rues : éliminer les clochards
Redoublant le ton martial assez inusité dans la littérature libertarienne, Rothbard insiste : « libérons les flics [unleash the cops] pour qu’ils nettoient les rues des clochards et des vagabonds ». Et d’ajouter : « Où ces derniers iront-ils ? Mais qui s’en soucie ? On peut espérer qu’ils disparaîtront, c’est- à-dire qu’ils sortiront des rangs de la classe chouchoutée et dorlotée des clochards pour rejoindre les rangs des membres productifs de la société ». Nous avons vu que le terme de « darwinisme social » était éminemment discutable à propos de quelqu’un comme Hayek, mais force est de constater qu’il n’en est pas de même ici pour Rothbard, tant le vocabulaire employé ne s’embarrasse guère de nuances et atteint même une violence, qui certes n’est pas rare chez lui (nous y reviendrons), mais qui est d’autant plus choquante ici qu’elle se pare d’un cynisme sans vergogne.
6. Supprimer la banque centrale : à bas les banksters
Le rejet de la manipulation monétaire par le gouvernement est un thème récurrent chez les libéraux, que l’on trouve par exemple dans la doctrine « monétariste » développée par Milton Friedman dans les années 196069. L’école autrichienne est toutefois allée plus loin encore en la matière puisque Hayek – qui ne passe pourtant pas, on l’a vu, pour le plus radical des libéraux du siècle dernier – va jusqu’à remettre en cause le monopole de l’État en matière d’émission monétaire en prônant un système dans lequel diverses institutions auraient le pouvoir de créer des monnaies qui se feraient ainsi concurrence, dans l’espoir que la bonne chasse la mauvaise70. Quant à Ludwig von Mises, dont nous avons vu l’influence considérable qu’il a eue sur la naissance et l’essor du courant libertarien, il a réfléchi aux questions monétaires dès la publication en 1912 de son livre The Theory of Money and Credit. Depuis lors, il n’a cessé de dénoncer « la manipulation de la monnaie et du crédit71 », estimant que le premier objectif de toute politique monétaire saine devait être d’empêcher les gouvernements de s’engager dans l’inflation en créant les situations qui encouragent les banques à étendre le crédit. Lorsque Rothbard publie en 1974 un essai prônant le retour à l’étalon-or, intitulé The Case for a 100 percent Gold Dollar, il s’inscrit donc dans une longue tradition de réflexion sur les questions monétaires au sein de l’école libérale autrichienne. Dans son texte programmatique de janvier 1992, il n’entre pas dans le détail de la réforme monétaire qu’il appelle de ses vœux mais reconnaît simplement que « la monnaie et la banque sont des questions compliquées ». Tout en ajoutant que la banque centrale américaine, la Fed, n’est rien d’autre qu’un « cartel organisé de “banksters”, qui crée l’inflation, ce qui dépouille la population et détruit l’épargne de l’Américain moyen ». Par où l’on retrouve le manichéisme de type populiste évoqué plus haut : parmi les hommes de l’État qui s’acharnent à dominer et spolier le petit peuple innocent, les banquiers-gangsters (à commencer par les banquiers centraux) figurent en bonne place, aux côtés des politiciens, des technocrates, des patrons de grandes multinationales liées au gouvernement, sans oublier bien sûr les intellectuels stipendiés pour fournir une justification idéologique à ce système de kleptocratie généralisée.
7. « America First »
La façon dont Rothbard justifie ce point mérite d’être cité in extenso, car loin de fournir une argumentation rigoureuse à un isolationnisme que les libertariens partageaient avec une longue tradition intellectuelle américaine72, il préfère adopter un ton polémique. Qu’on en juge :
« Un point clé, et qui n’est pas là pour ne venir qu’en septième position par ordre de priorité. L’économie américaine n’est pas seulement en récession : elle stagne. La famille moyenne est moins bien lotie aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Come home, America. Cessons de distribuer des aides à tous ces mendiants étrangers. Arrêtons toute aide ‘‘au développement’’, qui n’est qu’une aide aux banksters, à leurs titres et à leurs industries d’exportation. Arrêtons tout ça et résolvons nos problèmes intérieurs ».
Bien sûr, un texte comme celui-ci ne peut pas ne pas avoir, en 2025, une étonnante résonance avec l’actualité la plus immédiate, au point – mais ce n’est pas la seule fois, loin de là – que les analyses de Rothbard peuvent paraître visionnaires. Mais le point sur lequel nous voudrions insister est que, là encore, l’argument isolationniste se greffe sur le noyau argumentatif du discours populiste : la dénonciation d’une entreprise confiscatoire perpétrée par des élites (mondialisées) aux dépens du pauvre contribuable américain, qui n’en peut mais.
8. « Défendre les valeurs de la famille »
Il est intéressant de constater que ce dernier point, essentiel pour les alliés conservateurs auxquels Rothbard tend la main, n’arrive qu’en dernière position et donne lieu à une argumentation d’où est exclue toute considération morale. Rothbard ajoute en effet : « Ce qui veut dire écarter des familles les hommes de l’État, supprimer le pouvoir étatique au nom du Droit des parents », et, « à long terme, supprimer les écoles publiques et les remplacer par des écoles privées ». Il critique d’ailleurs au passage le projet de « bons scolaires » et de crédit d’impôt mis en avant par des libéraux comme Milton Friedman (chaque parent se verrait octroyer une subvention que ceux-ci remettraient ensuite à l’établissement scolaire de leur choix). Rothbard estime qu’en adoptant un tel système « les choses ne feront qu’empirer parce que les hommes de l’État y contrôleraient toujours davantage les écoles privées », alors qu’à ses yeux la « bonne solution consiste à décentraliser, et revenir à la gestion locale, communale, des écoles ».
On le voit, la défense des valeurs familiales, cheval de bataille de la droite conservatrice, n’est pas l’occasion pour Rothbard d’entonner une ode aux valeurs traditionnalistes prisées par la droite chrétienne, mais il est facile de voir comment son approche purement économique de la question scolaire converge avec les intérêts de cette frange la plus conservatrice de la société, soucieuse d’arracher les jeunes âmes à la férule de l’État pour les placer sous celle de Dieu, par l’intermédiaire des familles et des Églises.
De fait, Rothbard se sent obligé de faire un geste supplémentaire en direction de cette droite traditionnaliste, en ajoutant un « point supplémentaire », à savoir qu’« à défaut de privatisation » et « en attendant qu’elle arrive », les « écoles publiques doivent admettre qu’on y fasse des prières », ce qui suppose d’« abandonner cette absurde interprétation du premier amendement de la Constitution que font les athées de gauche et selon laquelle ce premier amendement interdirait la prière dans les écoles publiques ». Et de conclure : « Nous devons revenir au bon sens et au contenu originel pour ce qui concerne la manière d’interpréter la Constitution ».
Ce point mérite commentaire car l’un des vecteurs de perfusion des idées libertariennes en direction des positions les plus conservatrices, et vice- versa, est constitué par la théorie « originaliste » telle que la promeut au premier chef la puissante Federalist Society, l’une des associations de juristes les plus influentes du pays, créée en 1982 (avec le soutien des frères Koch). Nous avons déjà évoqué ce point, mais il mérite qu’on y insiste.
C’est en effet cette association qui, sous la houlette de juristes conservateurs aussi activistes que Leonardo Leo, a inlassablement œuvré depuis quarante ans à la propagation de l’interprétation de la Constitution devenue aujourd’hui dominante aux États-Unis, et qui consiste à essayer de retrouver les intentions initiales des Pères fondateurs. Ce qui revient concrètement, dans la plupart des cas, à limiter drastiquement l’action du gouvernement fédéral. La Federalist Society peut se targuer d’avoir joué un rôle décisif dans le basculement conservateur de la Cour suprême puisque cette dernière compte aujourd’hui six de ses membres qui sont issus de cette pépinière réactionnaire73 (le premier d’entre eux fut Clarence Thomas, nommé en 1991 par George H. Bush). Donald Trump, lorsqu’il a justifié ses nominations à la Cour suprême a d’ailleurs ouvertement fait de l’appartenance à la Federalist Society un critère déterminant de son choix.
Mais revenons au texte programmatique de Rothbard de 1992. Conscient des critiques et des reproches de revirement que peuvent à bon droit lui adresser ceux qui ont suivi ses combats passés, il croit devoir conclure son manifeste de la manière qui suit :
« Pour finir : chaque point de ces programmes populistes de droite est entièrement cohérent avec une position purement libérale. Cependant, toute politique du monde réel est une politique de coalition et il y a d’autres domaines où les libéraux pourraient bien transiger avec leurs partenaires conservateurs, traditionalistes ou autres au sien d’une coalition populiste. Par exemple, à propos des valeurs familiales, prenons les sujets délicats de la pornographie, de la prostitution ou de l’avortement. Ici, les libertariens partisans de la légalisation et de la possibilité d’avorter devraient être prêts à accepter un compromis sur la base d’une position décentralisée : ceci signifie mettre un terme à la tyrannie des tribunaux fédéraux et abandonner ces questions aux divers États américains, ou, mieux encore, aux régions et aux quartiers ».
Une fois encore, ce texte peut sembler avoir un côté prophétique au regard de notre actualité, mais ce qu’il montre surtout, de manière indéniable, c’est que si le rapprochement entre anarcho-capitalistes et conservateurs traditionnalistes a été rendu possible par un certain nombre de points de convergences que nous avons décrits (au prix, encore une fois, de quelques contorsions idéologiques), il relève tout autant d’un calcul politique assumé et un brin cynique.
De fait, Murray Rothbard, pourtant féru de théories abstraites, est également un stratège politique qui n’hésite pas à s’adapter aux circonstances du moment, et qui est prêt pour cela à faire preuve de la souplesse nécessaire pour parvenir à son but : gagner la guerre culturelle, préalable indispensable à la réalisation de ses idées les plus utopiques. C’est cette dimension tactico-stratégique qu’il nous faut maintenant détailler plus avant.
Un léninisme anarcho-capitaliste ?
Murray Rothbard, Toward a Strategy for Libertarian Social Change, avril 1977. Toutes les citations suivantes sont tirées de ce texte que nous traduisons et que l’on peut trouver dans sa langue originale [en ligne].
Citizens for a Sound Economy était une organisation politique conservatrice créée en 1984 par Charles et David Koch et qui exista jusqu’en 2004. Ron Paul en a été le premier président.
Murray Rothbard, “Right-Wing Populism. A Strategy for the Paleo Movement”, pp. 5-6, op. cit.
Rothbard n’a en réalité pas attendu l’effondrement du communisme pour théoriser sa manœuvre de rapprochement avec la droite la plus conservatrice dans le but explicite d’élargir l’audience de l’idéologie antiétatique qu’il défend avec acharnement et constance depuis des décennies. En effet, dès avril 1977, dans une importante note confidentielle destinée à l’Institut Cato des frères Koch74, l’auteur du récent Libertarian Manifesto définissait une stratégie de conquête des masses en 24 points. Il y affirmait tout d’abord qu’il ne fallait pas rester dans l’univers éthéré des idées (c’est-à-dire se cantonner à une stratégie gramscienne visant à conquérir l’hégémonie culturelle) mais qu’il convenait de s’intéresser aussi aux modalités concrètes du combat politico-idéologique en s’initiant aux arcanes de la tactique politique (ce qui revient en quelque sorte à adopter une vision plus léniniste). « Les idées ne se propagent pas et ne progressent pas d’elles-mêmes, dans un vide social », écrit-il ainsi. « Nous devons donc nous préoccuper non seulement de l’idéologie, mais aussi de la formation des personnes qui feront avancer les principes ». Ce faisant, Rothbard souligne les limites du combat mené par des libéraux à la Hayek ou Friedman (Milton) au sein de la Société du Mont Pèlerin. Ces universitaires bon teint considéraient que la conquête des élites devait rester leur priorité dans la mesure où « les idées importent », comme l’écrivait leur grand adversaire Keynes dans sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie :
« Les idées, justes ou fausses, des philosophes de l’économie et de la politique ont plus d’importance qu’on ne le pense généralement. À vrai dire le monde est presque exclusivement mené par elles. Les hommes d’action qui se croient parfaitement affranchis des influences doctrinales sont d’ordinaire les esclaves de quelque économiste passé. Les visionnaires influents, qui entendent des voix dans le ciel, distillent des utopies nées quelques années plus tôt dans le cerveau de quelque écrivailleur de Faculté.
Nous sommes convaincus qu’on exagère grandement la force des intérêts constitués, par rapport à l’empire qu’acquièrent progressivement les idées ».
Loin de nier cette importance des idées, Rothbard les juge néanmoins insuffisantes :
« Dans la mesure où les libertariens ont réfléchi à la stratégie, ils ont simplement adopté ce que j’ai appelé ‘‘l’éducationnisme’’ : à savoir que les actions reposent sur des idées, et que par conséquent les libertariens doivent essayer de convertir les gens à leurs idées en publiant des livres, des brochures, des articles, des conférences, etc. Il est certainement vrai que les actions dépendent des idées, et que l’éducation aux idées libertariennes est un élément important et nécessaire pour convertir les gens à la liberté et pour réaliser un changement social. Mais une telle compréhension n’est que le début d’une stratégie libertaire ».
De cette insuffisance Rothbard en déduit la nécessité vitale d’organiser un mouvement structuré dans le but explicite de faire advenir« le plus rapidement possible » dans le monde réel « la victoire » ultime des libertariens que doit être « l’abolition immédiate de l’esclavage ou de toute autre oppression étatique ». Il n’y a pas pour Rothbard de mouvement libertarien digne de ce nom « s’il n’est pas orienté vers le but de changer le monde réel pour le conformer à l’idéal libertaire ; comme le dit Marx dans ses Thèses sur Feuerbach : ‘‘Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de diverses manières ; il s’agit cependant de le changer’’ ».
Pour mieux déterminer les moyens d’action de cette avant-garde que doit être le « mouvement » libertarien, enfin sorti du confort douillet des amphithéâtres et de la léthargie des colloques universitaires, Rothbard étudie soigneusement la stratégie passée des léninistes et des nazis pour en déduire les grandes lignes de ce que doit être un mouvement efficace, sachant tirer les leçons du passé, à commencer par ce qu’il considère être « l’échec du libéralisme classique ». Pour lui, « les libertariens ne doivent pas adopter le gradualisme », mais entendent au contraire « obtenir la liberté le plus tôt et le plus rapidement possible ». Rien ne serait pire à ses yeux que le « juste milieu » tel que le pratiquent « la plupart des politiciens », car « si les partisans du but ‘‘pur’’ ne l’affirment pas et ne le maintiennent pas, personne ne le fera et le but ne sera donc jamais atteint ». Rothbard théorise donc une forme de volontarisme, convaincu que « dans le domaine de la justice, la volonté de l’homme est tout », et que « les hommes peuvent déplacer des montagnes, si seulement les hommes en décident ainsi ». Ce qui le conduit à assumer sans sourciller que la fin justifie les moyens, en n’hésitant pas à s’inspirer en la matière de l’exemple communiste, ou plus exactement léniniste. En effet, pour lui, une « passion radicale » n’a rien d’« utopique » dès lors qu’elle sait adapter ses moyens à ses objectifs : « Les critiques, par exemple, qui accusent les communistes d’être prêts à tuer des capitalistes pour atteindre l’objectif d’une dictature du prolétariat en prétendant ‘‘croire que la fin justifie les moyens’’ ont tort ; le problème avec les communistes n’est pas qu’ils croient que l’objectif des moyens employé est d’atteindre des fins, mais que leurs fins (par exemple la dictature du prolétariat) sont incorrectes ». Difficile d’être plus clair.
Rothbard se livre d’ailleurs à une longue analyse de la stratégie léniniste, voyant clairement en lui un modèle dont les libertariens doivent s’inspirer :
« L’objectif fondamental de la propagande et de l’agitation marxistes est ‘‘d’expliquer aux masses leurs propres intérêts’’, ou, en termes marxistes, de transformer ou ‘‘d’élever’’ la ‘‘fausse conscience’’ des classes exploitées et opprimées en une conscience correcte de leur situation. En bref, les marxistes, comme les libertariens, identifient certaines classes majoritaires de la société qui sont opprimées par d’autres classes minoritaires. […] Les marxistes, comme les libertariens, visent à démontrer à la majorité opprimée la véritable nature de son exploitation, supprimant ainsi la légitimité de l’État existant dans l’esprit des opprimés, privant ainsi l’État de son soutien nécessaire. […] Les deux groupes ont une théorie sur qui sont les ‘‘bons’’ et qui sont les ‘‘méchants’’, et les deux groupes souhaitent expliquer aux bons trompés la nature des méchants et la poursuite de leur oppression du premier groupe. La différence réside dans les perceptions contrastées de qui sont les bons et les méchants ».
Dans cet art de cultiver une vision manichéenne et de désigner des boucs émissaires susceptibles de mobiliser les masses, les marxistes ne sont d’ailleurs pas les seuls ni même les plus efficaces. Les nazis ont été encore plus habiles à ce jeu-là et peuvent, de ce point de vue, servir eux aussi de modèle. Rothbard considère en effet qu’« Hitler, comme Lénine, avait une capacité exceptionnelle à garder fermement à l’esprit son objectif ultime au milieu de tous les zigzags tactiques ». Plus concrètement, le stratège libertarien trouve dans le précédent de la conquête du pouvoir par les nazis la démonstration qu’« aucun mouvement ‘‘révolutionnaire’’ – c’est-à-dire aucun mouvement en faveur d’un changement social radical – ne peut réussir s’il n’a pas une idée claire de qui sont les bons et les méchants ». De fait, le populisme paléo-libertarien va fondamentalement consister à dresser le peuple contre ses élites (c’est-à-dire les hommes de l’État), en se faisant l’avant-garde du premier :
« Si les nazis avaient une théorie claire et nette des bons contre les méchants, et que les marxistes ne l’ont pas, les libertariens possèdent également une théorie claire et nette des deux groupes. Par conséquent, les libertariens sont capables de donner une image bien plus convaincante des ennemis et des amis potentiels que les marxistes ne peuvent jamais en produire.
En bref, pour les libertariens, l’État est toujours l’ennemi, les méchants, tandis que le public opprimé (tous les groupes et toutes les professions à l’exception des fonctionnaires et des clients de l’État) ce sont les bons, réels ou potentiels. En bref, les libertariens croient que l’État a été capable de mobiliser une machine de propagande tout au long de son histoire avec l’aide d’intellectuels alliés pour induire une ‘‘fausse conscience’’, un soutien et une légitimité parmi la vaste majorité qui constitue le public non étatique opprimé mais trompé. Les libertariens ne sont pas attachés à une classe économique particulière (comme le prolétariat). Notre base électorale potentielle est constituée de tous les exploités par l’État […] L’étatisme n’est pas seulement une tyrannie au service d’idées abstraites ; c’est un système massif d’exploitation économique de la majorité productive par une minorité parasitaire au pouvoir. L’étatisme est dans l’intérêt rationnel des exploiteurs. Dans l’Amérique contemporaine, il est dans l’intérêt des groupes d’affaires et des syndicats qui obtiennent des privilèges, des cartels et des subventions à profusion de l’État, et des intellectuels et techniciens qui forment la bureaucratie qui contrôle l’État et reçoivent des subventions de ses caisses. C’est cette vérité générale, et les faits concrets particuliers qui la constituent, qui doivent être continuellement exposés au public exploité. Il n’y a pas de meilleur moyen d’éveiller les fausses consciences à la vérité que de montrer à la masse du public qu’elle est trompée et exploitée par ses dirigeants ».
Cette stratégie populiste visant à désigner des « méchants » pour mieux mobiliser les masses en faisant des élites « libérales » (au sens américain du terme), c’est-à-dire les élites de gauche favorables à l’État, la classe à abattre, le conduira aussi à prendre ses distances vis-à-vis de certaines organisations et personnalités avec lesquelles il avait pourtant longtemps collaboré, à l’image des frères Koch :
« Il existe deux stratégies alternatives pour le mouvement libertarien. L’une est la stratégie Koch-Crane, la stratégie du Cato Institute, de Citizens for a Sound Economy75, etc. C’est l’antipode d’une stratégie populiste de droite : c’est la stratégie qui consiste à se rapprocher des coulisses du pouvoir, à faire du lobbying et à influencer les élites de haut rang, à les pousser doucement sur une voie plus libertaire. Il est clair que cette stratégie […] a été couronnée de succès en termes d’acquisition de respectabilité, de contacts officiels, d’emplois à Washington. […] Mais elle n’a pas réussi à obtenir de gains significatifs pour le principe libertaire. Au contraire : tout ce que cette stratégie de lobbying a réussi, c’est à désamorcer à la fois le mouvement conservateur et le mouvement libertaire, et à en faire les chiens de garde du pouvoir76 ».
L’autre stratégie, dont il s’est fait l’ardent défenseur et le théoricien, c’est précisément la stratégie populiste que l’on retrouve aujourd’hui de façon spectaculaire aussi bien dans la rhétorique trumpiste que dans celle d’un Javier Milei, sans oublier des mouvements comme celui du Tea Party dans les années 2008-2010. Ce sont là des points que nous aborderons dans le second volume de notre note. Auparavant, nous voudrions conclure ce premier volet en montrant que tant les idées anarcho-capitalistes que la synthèse populiste vers laquelle elle s’est orientée depuis près d’un demi-siècle, plongent leurs racines plus loin encore dans l’histoire que nous ne l’avons dit jusqu’ici.
Les racines intellectuelles lointaines de l’anarcho-capitalisme et du populisme libertarien
Pour terminer cette entreprise de contextualisation du populisme libertaro-conservateur que nous avons entreprise, nous voudrions montrer que si ce courant a pris son essor à la fin du xxe siècle, il a en réalité des racines idéologiques bien plus lointaines. Des racines qui plongent au cœur de l’histoire des États-Unis et de sa culture politique foncièrement individualiste, mais que l’on doit aussi aller chercher de l’autre côté de l’Atlantique, y compris en France.
Une tradition aux racines d’abord typiquement étasuniennes
David Gordon, The essential Rothbard, op. cit., p. 60.
Ibid., p. 7.
Voir ces trois ouvrages de Spooner parus aux Belles Lettres : Outrage à chef d’État. Suivi de Le Droit naturel (1991), Les Vices ne sont pas des crimes (1993) et Plaidoyer pour la propriété intellectuelle (2012).
Dans son pamphlet Universal Wealth Shown to be Easily Attainable, paru en 1879.
Ronald Creagh, Histoire de l’anarchisme aux États‑Unis d’Amérique (1826‑1886), Éditions La Pensée Sauvage, 1981, chapitre 3.
Ronald Creagh, op. cit.
Henry Louis Mencken, « Immunisé ! », (1950), cité dans La Gloire des athées : 100 textes rationalistes et antireligieux, de l’Antiquité à nos jours, éd. Les Nuits rouges, 2006, pp. 541-542.
Ayn Rand, La Grève, Paris, Les Belles Lettres, 2011. En 1958, une traduction française était parue en Suisse mais elle était incomplète et quasiment inaccessible.
Comte de Saint Simon, L’Organisateur, 1819, « Premier extrait de l’Organisateur ». Connu sous le nom de la « Parabole ».
John Galt au premier chef, mais aussi Dagny Taggart (son adjointe), Hank Rearden (l’inventeur d’un métal révolutionnaire), ou encore Francesco d’Anconia (l’héritier d’une des compagnies de cuivre les plus importantes de la planète).
Voir par exemple David Gordon, The Essential Rothbard, op. cit., p. 33.
Ce faisant, la critique de la raison bureaucratique à laquelle se livre l’école du Public Choice, rencontre un thème très fréquent chez les auteurs libéraux, et a fortiori libertariens. Que l’on pense, par exemple, au livre Bureaucracy publié par Ludwig von Mises en 1944.
Pour ceux qui voudraient avoir un aperçu ludique des travaux de cette école, nous ne saurions trop conseiller la désopilante série britannique Yes Minister !, écrite dans les années 1980 par Antony Jay et Jonathan Lynn (et dont on peut facilement trouver des épisodes sur internet). Voir à ce propos : Jérôme Perrier, « Le Public Choice pour les nuls : Yes (Prime) Minister », Contrepoints, 17 décembre 2015 [en ligne].
Jérôme Perrier, L’individu contre l’étatisme. Actualité de la pensée libérale française. xixe siècle, Fondapol, septembre 2016 [en ligne].
Joseph Schumpeter, dans son Histoire de l’analyse économique, range sous cette appellation de « groupe de Paris » ce qu’il appelle les « ultras du laissez-faire », parmi lesquels il cite Yves Guyot, Paul Leroy-Beaulieu, Gustave de Molinari ou encore Léon Say. On peut élargir considérablement leur nombre et les bornes chronologiques en faisant remonter ce groupe au fondateur Jean-Baptiste Say. Voir notamment Michel Leter, « éléments pour une étude de l’école de Paris (1803-1852) », in Philippe Nemo et Jean Petitot (dir.), Histoire du libéralisme en Europe, PUF, coll « Quadrige Manuels », 2006, pp. 429-509. Voir Jérôme Perrier, op. cit.
Murray Rothbard, An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, vol. 2, Classical Economics, Edward Elgar Publishing Ltd., 1995 ; [en ligne] voir notamment le chapitre 1, « J.-B. say: the French tradition in smithian clothing », et le chapitre 14, « After Mill: Bastiat and the French laissez‑faire tradition »
On se souvient du président Reagan se gaussant des Français qui n’auraient pas eu de mot pour dire « entrepreneur », ignorant manifestement que les anglo-saxons utilisent un mot d’origine française !
Frédéric Bastiat, « L’État », Journal des Débats, 25 septembre 1848.
Il a beaucoup « impressionné » quelqu’un comme Rothbard, qui le définira même dans son Austrian Perspective on the History of Economic Thought comme le premier « anarcho-capitaliste ». Voir aussi David Gordon, The Essential Rothbard, op. cit., p. 13.
Le terme est forgé par un autre membre du groupe de Paris, Ambroise Clément (1805-1886) dans un article portant ce titre et paru dans le Journal des économistes en juillet 1848. Il y dénonce successivement les « vols aristocratiques » (la rente foncière), les « vols réglementaires » (la frénésie régulatrice des pouvoirs publics), les « vols industriels » (ce que Frédéric Bastiat appelle pour sa part le « sisyphisme » et que l’on baptisera plus tard la « politique de l’emploi », c’est-à-dire une politique qui consiste à subventionner les entreprises non compétitives ou à les protéger à coups de barrières douanières), sans oublier les « vols philanthropiques » (la « charité légale » financée par l’impôt), et enfin les « vols administratifs » (ce que d’aucuns dénonceront plus tard comme la tyrannie bureaucratique). Autant de thèmes qui auront une très riche postérité dans la littérature libertarienne du siècle suivant.
Outre Rothbard lui-même, ce « Cercle Bastiat » comprenait Ralph Raico, Ronald Hamowy, George Reisman, Leonard Liggio, Robert Hessen, etc.
Le courant libertarien qui s’est développé aux États-Unis dans les années 1970 en radicalisant la critique de l’État pour aboutir à son rejet pur et simple, a en effet des racines diverses et anciennes, même s’il s’enracine principalement dans la culture politique étasunienne.
Tout d’abord, nombre d’auteurs libertariens – à commencer par Rothbard lui-même – ne cachent pas leur profonde admiration pour Thomas Jefferson, défenseur des droits individuels, de l’autonomie des États fédérés, et partisan d’un gouvernement fédéral limité, seul à même de préserver les libertés civiles et économiques. Comme chacun sait, lors des débats qui ont animé la création des États-Unis à la suite de la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776, Jefferson a défendu l’idée selon laquelle le gouvernement devait être le plus libéral, c’est-à-dire le plus léger possible, son rôle devant se limiter, pour l’essentiel, à la préservation des libertés fondamentales. Jefferson et ses amis estimaient en effet que ce gouvernement devait rester en permanence sous le contrôle des citoyens par la voie d’une décentralisation maximale. À l’opposé, le groupe des fédéralistes, animé par John Adams, George Washington, et Alexander Hamilton, souhaitait un gouvernement plus puissant, plus armé, et plus centralisé. Si Jefferson et ses alliés ont perdu leur bataille pour un gouvernement faible, ils n’en sont pas moins restés des références incontournables pour tous les libertariens – et au-delà. Dans la même veine, ces derniers font également de Thomas Paine l’un de leurs héros, notamment à travers son livre Common Sense, publié en 1776. Fondé sur la tradition jusnaturaliste d’inspiration lockéenne, ce célèbre texte donne à l’État pour mission essentielle de protéger les droits souverains et inaliénables que les individus possèdent par nature (liberté de conscience, liberté de jouir de leur propriété, etc.). Ce faisant, Paine a constitué pour Rothbard et ses amis « une avancée cruciale dans la théorie libertarienne relative à la doctrine du contrat social à l’origine de l’État77 ».
Les libertariens américains trouvent également une source d’inspiration non négligeable dans l’individualisme anarchiste américain qui eut deux grandes figures au xIxe siècle, à savoir Lysander Spooner et Benjamin R. Tucker. Le biographe de Rothbard, David Gordon, peut en effet écrire à son propos : « Il a développé une synthèse unique combinant les thèmes des individualistes américains du xIxe siècle tels que Lysander Spooner et Benjamin Tucker avec l’économie autrichienne78 ».
Spooner (1808-1887), que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer rapidement, était un anarcho-individualiste forcené qui n’hésitait pas à écrire que « tout gouvernement n’est qu’une association secrète de voleurs et d’assassins » et « toute législation est une absurdité, une usurpation et un crime79 ». Un antiétatisme aussi radical n’a alors guère d’équivalent en Europe (à quelques très rares exceptions, que nous examinerons), puisque Spooner est si viscéralement opposé à toute immixtion de l’État dans l’économie qu’il lui dénie même la compétence de l’émission monétaire80, anticipant – comme nous l’avons vu – certaines thèses libertariennes du siècle suivant, reprises aujourd’hui par quelqu’un comme Javier Milei. Si la défense intransigeante du droit de propriété, y compris intellectuelle, telle que Spooner la développe dans The Law of Intellectual Property (1855) est assez conforme à la culture politique américaine, il adopte en revanche une position plus marginale et plus radicale lorsqu’il entend mettre fin au monopole légal de la violence en substituant à l’État des associations volontaires de protection mutuelle. Ce faisant, il est l’un des rares (avec le Belge Gustave de Molinari) à annoncer clairement les utopistes anarcho-capitalistes du siècle suivant qui estiment que même les fonctions les plus éminemment régaliennes gagneraient à être remplies par un libre marché intégralement généralisé.
Benjamin R. Tucker (1854-1939), dont nous avons aussi déjà eu l’occasion de parler précédemment, se présentait comme le disciple à la fois de Max Stirner (un philosophe allemand anti-hégélien, auteur en 1844 d’un livre qui aura une grande influence sur les courants libertaires : L’Unique et sa propriété) ; Joseph Proudhon (théoricien français du socialisme libertaire) ; et Herbert Spencer (adversaire résolu de l’étatisme, dont l’œuvre fut en réalité plus complexe et plus subtile que le « darwinisme social » auquel on la réduit trop souvent). Ces trois auteurs, quoiqu’extrêmement différents, avaient en commun d’être de fervents individualistes et de nourrir une profonde aversion pour l’État. De fait, le combat contre l’étatisme, mais aussi contre les grands capitalistes liés au pouvoir politique, sera au cœur des campagnes menées par la revue Liberty, fondée par Tucker en 1881, et qui attirera tout ce que le pays et l’Europe comptaient alors d’anarcho-individualistes et de défenseurs intransigeants du droit de propriété. Tucker fut aussi le disciple de Josiah Warren (1798- 1874), parfois considéré comme le premier anarchiste américain81. Le périodique que ce dernier dirige en 1833, The Peaceful Revolutionist (Le révolutionnaire paisible), est l’un des tout premiers périodiques libertaires, défendant l’idée de souveraineté de l’individu – une idée qui sera ensuite reprise par des auteurs aussi différents que le libéral modéré John Stuart Mill ou le libéral plus radical Herbert Spencer. Cette idée de la souveraineté de l’individu est également défendue aux États-Unis par un autre penseur représentatif de l’anarchisme individualiste américain, Stephen Pearl Andrews (1812-188682), à qui l’on doit toute une série de publications qui annoncent par bien des aspects la littérature libertarienne du siècle suivant, comme The Constitution of Government in the Sovereignty of the Individual (1851), ou encore The Sovereignty of the Individual (1853). Si la plupart des œuvres d’Andrews abordent la philosophie, la politique et la morale (il est par exemple un défenseur de l’amour libre, chose singulière dans un pays aussi puritain), il publie son unique ouvrage d’économie en 1851, avec The Science of Society. C’est du reste ce livre qui conférera à son auteur une certaine célébrité, puisque Benjamin R. Tucker le considérera par exemple comme le meilleur ouvrage sur l’anarchisme de toute la littérature de langue anglaise.
Plus connu et appartenant à la génération suivante, le journaliste Albert Jay Nock (1870-1945) rédigea en 1926 une biographie intellectuelle de Jefferson, partageant sa conception d’un gouvernement limité à la stricte garantie des libertés et de la sécurité. Bien que n’étant pas à proprement parler un anarchiste, Nock est devenu une référence du courant libertarien aux États-Unis grâce à un pamphlet devenu culte ne serait-ce que par son titre : Our Enemy, the State (1935). Quinze ans plus tôt, Nock avait créé l’hebdomadaire The Freeman, qui s’insurgera au moment du New Deal contre le fait que les partisans de cette expérience interventionniste, inédite aux États-Unis, osent s’approprier le terme de liberalism en le détournant de sa définition originelle. Nock se fera aussi connaître par une défense absolue de la liberté d’expression, dans un ouvrage paru en 1937 sous le titre Free Speach and Plain Language. Pour toutes ces raisons, il fut considéré comme l’un de leurs maîtres, par nombre de libertariens, à commencer par Rothbard ou Leonard Read, le fondateur de la Foundation for Economic Education (FEE).
De nombreux autres auteurs pourraient être cités pour avoir un aperçu complet des racines proprement américaines de la pensée libertarienne telle qu’elle prit son essor dans la seconde moitié du xxe siècle, mais deux méritent qu’on s’y attarde brièvement. Le premier est Henry Louis Mencken, l’écrivain préféré de Rothbard et de nombre de ses amis. Défenseur de la liberté de conscience, celui qui est parfois qualifié d’« anarchiste de droite » s’opposa à la fois à l’État et au puritanisme, développant des idées libertaires aux forts relents élitistes (il est notamment l’auteur d’un ouvrage intitulé The Philosophy of Friedrich Nietzsche et traduisit aussi L’Antéchrist du célèbre philosophe allemand), quitte à frôler parfois le racisme. Dans le magazine The American Mercury, qu’il fonda en 1924, sa plume acerbe dénonçait les institutions ecclésiastiques et la religion organisée, secouant avec intrépidité les piliers de la moralité conventionnelle dans une Amérique profondément puritaine. En effet, si Mencken est considéré comme l’un des écrivains américains les plus influents du début du xxe siècle, force est néanmoins de constater que son œuvre, par certains aspects tout au moins, est à contre-courant de la pensée dominante aux États-Unis, comme en attestent ses violents propos anti-religieux, à l’image de celui-ci :
« La convention sociale la plus curieuse de la formidable époque que nous vivons est celle selon laquelle les opinions religieuses doivent être respectées. L’évidence des effets pervers d’une telle idée doit être claire pour tout le monde. Tout ce qu’elle permet, c’est 1) de jeter un voile de sainteté sur ces opinions qui sont une complète violation de la décence intellectuelle, et 2) de transformer tout théologien en libertin patenté. […] En fait il n’y a rien dans les opinions religieuses qui justifie qu’elles dussent bénéficier de plus de respect que les autres. Au contraire elles ont tendance à être remarquablement stupides. […] Non, il n’y a rien de notable ni de digne dans les idées religieuses. Elles aboutissent pour la plupart à un tissu de non-sens particulièrement puéril et assommant83 ».
Nul doute que si Mencken était l’écrivain préféré de Rothbard, ce dernier devait bien se garder de mettre en avant ce péché mignon lorsqu’il parlait de stratégie politique avec ses amis paléo-conservateurs…
La dernière figure majeure qui mérite qu’on s’y arrête – même si l’on en a déjà parlé – est Ayn Rand, dont l’influence ne peut être surestimée. Cette Russe émigrée aux États-Unis en 1926 était adepte d’un capitalisme de laissez-faire fondé sur ce qu’elle appelait une stricte « séparation de l’État et de l’économie ». À l’image de l’immense majorité des libertariens, l’auteur d’Atlas Shrugged concevait l’homme comme un individu doté de droits naturels inaliénables, à commencer par le droit de propriété (propriété de soi et du produit de son activité). Chacun doit donc vivre pour lui-même et chercher son bonheur, en vertu d’un « égoïsme rationnel » qu’elle oppose à « l’altruisme sacrificiel » qu’elle exècre. De cette éthique découle naturellement une défense intransigeante du capitalisme intégral, ne reconnaissant à l’État qu’un rôle strictement limité à la protection de la vie, de la propriété et de la liberté de l’individu, rejetant toute forme de redistribution sociale ou de collectivisme qui évoque à ses yeux le destin funeste de sa patrie d’origine rongée par le cancer bolchévique. Sans être anarchiste à proprement parler ni même très en phase avec la droite conservatrice sur les questions culturelles, cette athée militante, au tempérament quelque peu sectaire et autoritaire, n’en devint pas moins la pasionaria des idées libertariennes, jouant un rôle décisif dans la diffusion auprès du grand public d’une vision exaltée du capitalisme laissez-fairiste. En ce sens, la lutte pour l’hégémonie culturelle et la conquête des masses telle que les libertariens comme Rothbard l’ont théorisée dans une perspective mi-gramscienne mi-léniniste, a sans doute été davantage accomplie par les romans randiens que par la littérature grise ou plus ou moins souterraine des combattants de l’anarcho-capitalisme.
Cette importance d’Ayn Rand a longtemps été méconnue en France, sans doute parce que l’atmosphère qui imprègne ses romans est aux antipodes de l’univers intellectuel dans lequel nous baignons. Atlas Shrugged a été tiré à plus de onze millions d’exemplaires. Mais il faudra attendre 2011 pour en avoir une traduction française, sous le titre La Grève84.
Ce roman-fleuve de plus de 1400 pages se veut une sorte d’interminable conte philosophico-économique, ou d’épopée industrielle, qui met en scène le caractère prométhéen de l’individu, à travers le personnage de John Galt. Ce dernier est un entrepreneur de génie, inventeur d’un nouveau moteur révolutionnaire, qui refuse de développer son invention et décide d’entraîner avec lui, dans un véritable mouvement de sécession, tous les « hommes de l’esprit » (industriels innovants, scientifiques autonomes, artistes iconoclastes et autres travailleurs indépendants), afin de protester contre une société de plus en plus collectivisée et réglementée. Ce roman dystopique est en quelque sorte une version moderne de la « Parabole » de Saint-Simon85 (1819). Il se veut surtout une exaltation de l’homme libre, qui ne doit rien à autrui, sorte de géant moderne qui porte littéralement le monde sur ses épaules et qui décide un jour, par révolte, de l’ignorer, de le laisser tomber (d’où le titre du livre en anglais, qui peut être traduit littéralement par « Atlas haussa les épaules »). Si la qualité littéraire de l’écriture randienne relève nécessairement d’une appréciation subjective (que penser par exemple du discours de John Galt qui explique le sens de son combat dans un morceau de bravoure s’étalant sur plusieurs dizaines de pages ?), force est de constater que le livre a quelque chose de fascinant par le manichéisme même qu’il met en scène. Le roman oppose en effet systématiquement les figures du Bien que sont les entrepreneurs et les créateurs individuels86, constamment en butte à l’étatisme prédateur, spoliateur et redistributeur, qui constitue à l’inverse l’archétype du Mal, sous les figures du bureaucrate, du politicien ou de l’intellectuel organique stipendié par l’État. Un manichéisme qui est littéralement aux antipodes de celui qui s’exprime si facilement de ce côté-ci de l’Atlantique, puisque tout ce qui rappelle l’État ou les valeurs communautaires y est décrit sous les couleurs les plus noires, alors qu’à l’inverse tout ce qui renvoie à l’initiative individuelle, à la quête égoïste du profit et à l’audace créatrice, est exalté. En ce sens, le roman peut être vu comme une sorte d’Évangile libertarien où l’exaltation du moi créateur et de la volonté individuelle de puissance dessine un monde héroïque où les entrepreneurs ont remplacé les saints et les héros de jadis comme modèles du génie humain.
Si cette vision de la société ne peut que paraître caricaturale à un esprit hexagonal, l’extraordinaire succès du livre aux États-Unis, bien au-delà des cercles libertariens, est la démonstration imparable que la romancière a su faire écho à une conception de l’individu, de la société et de l’État profondément ancrée dans la culture américaine. De fait, l’immigrée russe Ayn Rand ne cachera jamais sa profonde admiration pour les valeurs « jeffersoniennes » qui voient dans les intrusions grandissantes de l’État au xxe siècle – notamment avec la mise en place du Welfare-State à la faveur du New Deal puis de la Great Society – le dévoiement, pour ne pas dire la négation pure et simple, de la société individualiste qu’elle chérit avec d’autant plus d’ardeur qu’elle y voit l’antithèse absolue du collectivisme qui règne alors dans sa patrie d’origine. Il n’est dès lors pas étonnant qu’Atlas Shrugged ait pu faire figure de « Bible » pour des générations de libertariens, aux États-Unis et ailleurs dans le monde (sauf peut-être en France…).
Chez Ayn Rand, on vient de le voir, tout ce qui relève du marché et de l’entreprise privée est valorisé, tandis que tout ce qui renvoie à la sphère étatique est vu sous un angle terriblement négatif (les représentants de l’État, qu’ils soient politiciens ou bureaucrates, y sont toujours présentés comme des parasites malfaisants). Il convient de noter ici qu’il existe également aux États-Unis, dans le domaine académique cette fois, tout un courant de pensée libéral qui a cherché à donner ses lettres de noblesse à cette opposition, sous une forme il est vrai, infiniment moins caricaturale. C’est ce que l’on appelle l’école du Public Choice, fondée dans les années 1960 par deux professeurs de l’université G. Mason de Virginie, James Buchanan (prix Nobel d’économie 1986) et Gordon Tullock. Cette école, qui est elle aussi fort peu connue en France, a eu une influence non négligeable dans les cercles libertariens87. Elle entend expliquer le comportement des électeurs et des hommes de l’État (qu’ils soient hommes politiques ou hauts fonctionnaires), en s’interrogeant sur les motivations rarement désintéressées qui sont les leurs. Les travaux qui se réclament de cette approche contractualiste (en partie issue de l’école de Chicago) visent à étendre l’analyse économique au champ politique afin de démontrer que si l’homo œconomicus peut à bon droit être soupçonné de chercher rationnellement à maximiser son profit (matériel et symbolique), l’homo politicus peut tout aussi légitimement être suspecté de vouloir accroître le sien (c’est-à-dire, d’abord et avant tout, vouloir se faire élire ou réélire). De la même façon, l’homo bureaucraticus cherchera lui aussi son intérêt, qu’il trouvera le plus souvent dans l’accroissement de son pouvoir, de ses privilèges symboliques et plus encore du budget affecté à ses services88. Appliquant ainsi au marché politique un raisonnement de type micro-économique (le self-interest postulate), les théoriciens du Public Choice entendent rompre avec la vision manichéenne qui oppose un marché (économique) vicié, où règneraient l’égoïsme et la cupidité, à une sphère publique plus noble dans la mesure où elle détiendrait le privilège du désintéressement et le monopole de la défense de l’intérêt général89. Sans tomber dans une caricature inverse, les auteurs se réclamant de l’école du Public Choice considèrent qu’il n’y a aucune raison pour que l’homme se conduise de façon radicalement différente, selon qu’on l’observe dans le champ économique (autrement dit dans sa vie quotidienne) ou dans le champ politique. Dès 1962, avec la publication de The Calcul of Consent – Legal Foundation of Constitutional Démocracy (dans lequel Buchanan et Tullock formulent les principes de base de leur approche), ces économistes libéraux entendent mettre en garde contre les dérives de l’État démocratique moderne, happé par la défense des intérêts particuliers et fatalement entraîné à accroître démesurément la dépense publique. Ce faisant, les deux hommes s’inscrivent davantage dans la filiation du libéralisme classique que dans la philosophie anarcho-capitaliste, même s’ils concluent que la logique pernicieuse du marché politique exige une réduction drastique du périmètre d’intervention de l’État – seule à même, selon eux, d’enrayer l’essor d’un nouveau Léviathan, et donc de sauver la démocratie libérale.
On vient de le voir, le courant libertarien ne peut se comprendre en dehors de son enracinement profond dans la culture politique américaine, viscéralement individualiste. Toutefois, on peut aussi trouver de l’autre côté de l’Atlantique des auteurs et des courants de pensée qui ont exercé une influence non négligeable sur les partisans les plus radicaux de l’anarcho-capitalisme. C’est vrai de l’ensemble de la vieille Europe, berceau du libéralisme classique, mais tout particulièrement de la France qui passe pourtant pour être l’un des bastions les plus solides de l’anti-libéralisme.
et c’est pourquoi nous y avons déjà consacré de très nombreuses pages. Mais nous voudrions, pour conclure, dire quelques mots d’une autre généalogie qui remonte plus loin encore dans le temps et qui nous emmène dans la France du xIxe siècle, avec ce que l’on a appelé « l’école de Paris » ou le « groupe de Paris91 ».
Soulignons d’emblée que cette filiation est d’autant plus légitime que Murray Rothbard s’en est lui-même fait l’historien dans son dernier livre, An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, paru un mois après sa mort en janvier 1995. Un ouvrage volumineux, dans lequel il consacre de très nombreuses pages à ce qu’il appelle « l’école française du laissez-faire92 », qu’il ne cesse de couvrir d’éloges. À l’inverse du libéralisme britannique du xIxe siècle, imprégné de philosophie utilitariste et de ce fait relativement accommodant vis-à-vis de l’intervention de l’État dans l’économie, l’école libérale française est alors réputée tout à la fois « laissez-fairiste » et « optimiste » (en ce sens qu’elle fait confiance au marché pour résoudre la question sociale encore plus prégnante à l’époque qu’aujourd’hui). Ces économistes libéraux français du xIxe siècle, disciples déclarés de Jean-Baptiste Say, vont se regrouper autour d’une revue, le Journal des économistes, qui, de 1841 à 1940, sera le point de ralliement de tous les libéraux défendant vigoureusement la liberté individuelle contre l’emprise croissante de l’État, jugée délétère.
Au risque de déranger bien des idées reçues (de part et d’autre de l’Atlantique, du reste93), force est d’admettre que cette école libérale française du xIxe siècle incarne une vision souvent plus inflexible dans son refus de l’interventionnisme étatique que son pendant britannique. C’est que la plupart des libéraux hexagonaux, en bons héritiers des Lumières, considèrent la liberté comme un droit « naturel », là où leurs homologues d’outre-Manche, influencés par l’utilitarisme benthamien et millien, rejettent cette notion de droit naturel, tout en acceptant un degré non négligeable d’interventionnisme étatique dès lors que celui-ci est destiné à favoriser « le plus grand bonheur du plus grand nombre » (objectif déclaré de la doctrine utilitariste). C’est d’ailleurs bien cette référence aux droits naturels qui sera mise en exergue par les libertariens américains du xxe siècle pour voir dans l’école française d’économie une source d’inspiration indiscutable.
Il ne saurait naturellement être question ici de mentionner tous les noms qui peuvent à bon droit être rattachés à cette mouvance individualiste, anti-étatiste, et à certains égards proto-libertarienne, mais on peut néanmoins en citer quelques-uns, en distinguant globalement trois générations qui couvrent l’ensemble du xIxe. La première est celle des précurseurs, au début du siècle, avec Jean-Baptiste Say (le fondateur), Charles Comte ou encore Charles Dunoyer. La génération suivante va globalement de la fin de la monarchie de Juillet au début du Second Empire, et comporte de nombreux représentants, à commencer par le plus illustre d’entre eux, Frédéric Bastiat, qui est la « figure centrale » de l’école française du laissez-faire, au point de devenir une icône pour les libertariens du siècle suivant, qui se plairont souvent à citer la définition qu’il donnait de l’État : « la grande fiction par laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde94 ». Mais cette deuxième génération compte aussi des noms moins connus aujourd’hui, quoique fort célèbres à l’époque, comme Adolphe Blanqui (à ne pas confondre avec son frère cadet, Auguste, le célèbre révolutionnaire surnommé « l’Enfermé »), Michel Chevalier, Charles Coquelin, Gilbert Guillaumin, Jean-Gustave Courcelle-Seneuil, Joseph Garnier, Édouard Laboulaye, Hippolyte Passy ou encore Horace Say (fils de Jean-Baptiste). Enfin, une troisième génération correspond à la fin du second Empire et au début de la IIIe République, avec des personnages comme Henri Baudrillart, Yves Guyot, Paul Leroy-Beaulieu, Frédéric Passy, Léon Say (fils d’Horace et petit-fils de Jean-Baptiste), ou encore le Franco-Belge Gustave de Molinari, dont certains textes présentent une radicalité qui annonce par certains aspects celle d’un Rothbard, un siècle plus tard. Un temps directeur du Journal des économistes, Molinari rédigea par exemple un article resté fameux95, dans lequel il allait jusqu’à théoriser la privatisation de la police ! On comprend aisément qu’une prise de position aussi iconoclaste ait pu être invoquée ultérieurement par des anarcho-capitalistes américains pour faire de Molinari leur précurseur, même si l’honnêteté oblige à dire que ce texte est assez isolé dans l’ensemble des écrits de l’intéressé, et qu’il rencontra par ailleurs l’hostilité de tous ses amis libéraux. En réalité, Molinari incarne la frange la plus radicale, pour ne pas dire la plus extrême, d’une mouvance très riche en individualités diverses et variées quant à leur tempérament et leurs prises de position. Même s’ils partagent tous un attachement viscéral à la liberté individuelle et une méfiance instinctive à l’égard d’un État jugé trop interventionniste et/ou paternaliste, il serait parfaitement caricatural de faire de l’école libérale française du xIxe siècle une chapelle uniment proto-libertarienne.
Il convient par ailleurs de remarquer que la pensée libérale des publicistes du groupe de Paris est une philosophie du droit, au moins autant qu’une réflexion strictement économique s’intéressant à la production, à la distribution et à la consommation de richesses. Ses membres développent en effet toute une théorie de l’État et de la démocratie, ce qui explique d’ailleurs en grande partie pourquoi ils conservent une indéniable actualité. Il convient toutefois de prendre ses distances avec la lecture anarchisante qu’en feront un siècle plus tard, outre-Atlantique, leurs « descendants » libertariens, pour lesquels leurs aînés français auraient activement milité contre l’État. En réalité, les choses sont infiniment plus complexes, dans la mesure où les libéraux de l’école de Paris ne sont en rien des anarchistes et s’opposent bien davantage à ce qu’ils considèrent comme un risque d’étatisme qu’à l’État lui-même. En effet, ils dénoncent moins un État « fort » qu’un État « obèse » et « tatillon », qui prétendrait intervenir à tout bout de champ, et cela dans des domaines qui, selon l’orthodoxie libérale, devraient rester en dehors de ses compétences légitimes – essentiellement régaliennes. En ce sens, ils sont beaucoup plus proches du futur minarchisme d’un Nozick que du futur anarchisme d’un Rothbard. Pour dire les choses encore autrement, les libéraux français qui gravitent autour du Journal des économistes voulaient en réalité remettre l’État « à sa place » plutôt que le supprimer.
Cette critique de l’interventionnisme étatique (à une époque, rappelons-le, où celui-ci était pourtant infiniment moindre qu’aujourd’hui !) s’accompagne aussi, au sein du groupe de Paris, d’une défense intransigeante de la propriété – considérée comme un droit naturel et sacré – et d’une condamnation virulente de la « spoliation légale96 » que constitue à leurs yeux une fiscalité excessive (à une époque, là encore, où la pression fiscale était sans commune mesure avec ce qu’elle est aujourd’hui). Ce sont là, indéniablement, deux thèmes qui trouveront un écho certain chez les libertariens du siècle suivant. En effet, si Jean-Baptiste Say (à la suite d’Adam Smith) s’est beaucoup interrogé sur le processus de « création » des richesses, ses disciples qui gravitent autour du Journal des économistes, ont cherché à prolonger les réflexions du maître en s’interrogeant sur les différents modes d’« acquisition » de subsistances dans la société moderne. C’est ainsi que, dès 1825, dans L’Industrie et la Morale, Charles Dunoyer juge que, dans la société postrévolutionnaire de son temps, le progrès s’identifie à la victoire de l’« industrie » (un mot qui a alors le sens général d’activité productive) sur la « passion des places », nouvel avatar de l’amour des privilèges d’Ancien Régime. Une vingtaine d’années plus tard, Frédéric Bastiat reprendra son combat, même si sa mort prématurée, en 1850, à l’âge de 49 ans, ne lui permettra que d’esquisser la philosophie de la « spoliation » qu’il entendait établir. Selon Bastiat, les nations modernes sont souvent présentées comme divisées en « trois classes » : l’aristocratie, la bourgeoisie et le peuple. Mais là où les socialistes concluent qu’il y a le même antagonisme entre les deux dernières classes qu’entre les deux premières (la bourgeoisie ayant simplement pris la place de l’aristocratie pour mieux dominer et exploiter le peuple des prolétaires), Bastiat pour sa part ne voit dans la société que deux catégories : les gens qui gagnent leur vie par leur propre travail, et ceux qui subviennent à leurs besoins en captant des revenus prélevés par l’État sur l’ensemble des citoyens, que ce soit par le couple impôts-subventions ou bien par une politique de protection douanière (le libre échange sera l’un de ses chevaux de bataille, auquel il consacrera le plus grand nombre de pages, dans un style pamphlétaire assez éblouissant). Il est tout à fait évident que ces analyses annoncent celles, développées un siècle plus tard, par le sociologue libéral Franz Oppenheimer (1864-1943) qui distinguera deux manières de s’enrichir : la voie naturelle du talent, du travail et de l’échange, et la voie politique de l’accaparement et de la redistribution par la force et la violence publique. Idée qui, nous l’avons vu, sera reprise et amplifiée par Rothbard et nombre d’autres libertariens. Le même Rothbard qui, dans les années 1950, avait baptisé « Cercle Bastiat97 » la réunion de ses disciples dans son appartement new-yorkais et qui fera longuement son apologie dans le dernier de ses livres.



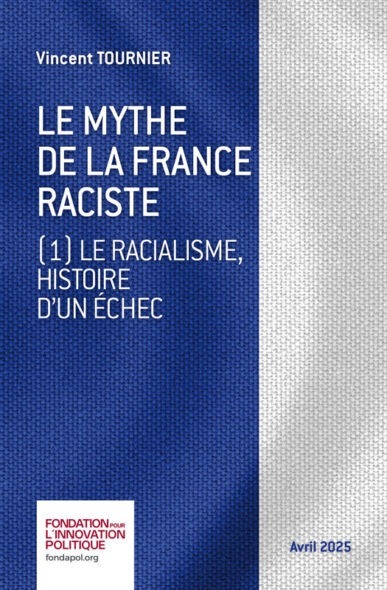








Aucun commentaire.