Le détournement populiste du courant libertarien (2)
Le populisme paléo-libertarien de Javier MileiL’antilibéralisme des fondamentalistes paléo-libertariens
L’idéal-type libéral
En quoi les (paléo-) libertariens violent-ils un certain nombre de principes libéraux fondamentaux ?
La question clé des monopoles
La question de l’immigration
Le libéralisme culturel
La question de l’avortement
L’obsession du wokisme et la question des discriminations
Discours de Javier Milei à Davos (janvier 2025)
Un pays marqué par l’héritage populiste du péronisme
JAVIER MILEI – Discours prononcé à Davos, le 25 janvier 2025
Murray N. Rothbard, « Le populisme de droite », janvier 1992
Le contexte politique de 1992
La riche postérité d’un texte programmatique
Murray N. Rothbard, « Populisme de droite : une stratégie pour le mouvement paléo », Rothbard-Rockwell Report, Janvier 199268
Un programme populiste de droite
Résumé
Dans ce second volume, nous voudrions achever notre propos en deux mouvements successifs. Montrer d’abord, à partir d’exemples très concrets, combien les idées véhiculées par ces populistes libertaro-conservateurs les conduisent à renier certains principes pourtant cardinaux de la pensée libérale, et ce depuis ses origines.
Illustrer ensuite les dérives antilibérales d’un courant de pensée largement aveuglé par sa haine de l’État, avec la publication d’un long discours prononcé le 25 janvier 2025 par le président argentin Javier Milei à l’occasion du Forum de Davos, suivie de celle d’un texte-programme écrit en janvier 1992 par son maître à penser Murray Rothbard, dans le but de théoriser la stratégie d’alliance entre paléo-libertariens et paléo-conservateurs, que nous avons analysée dans le premier volume de cette note.
Jérôme Perrier,
Normalien, agrégé d’histoire et docteur en histoire de l’IEP de Paris.

Le détournement populiste du courant libertarien (1)

L'individu contre l'étatisme
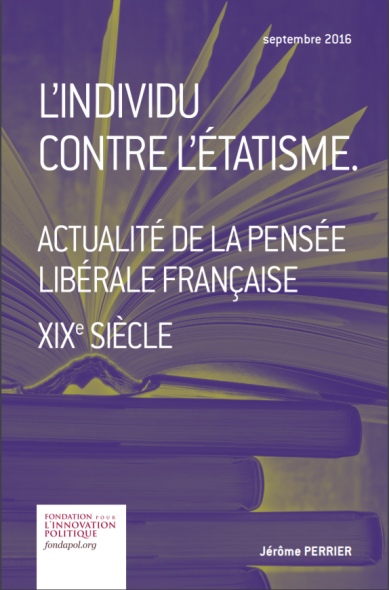
L'individu contre l'étatisme
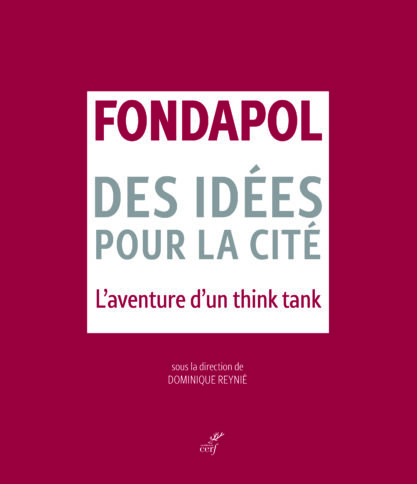
Fondapol - Des idées pour la Cité - L'aventure d'un think tank
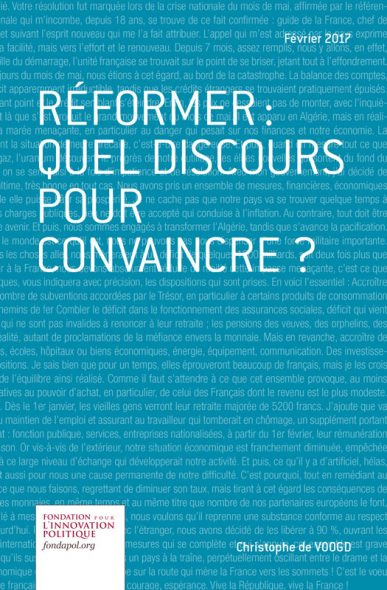
Réformer : quel discours pour convaincre ?
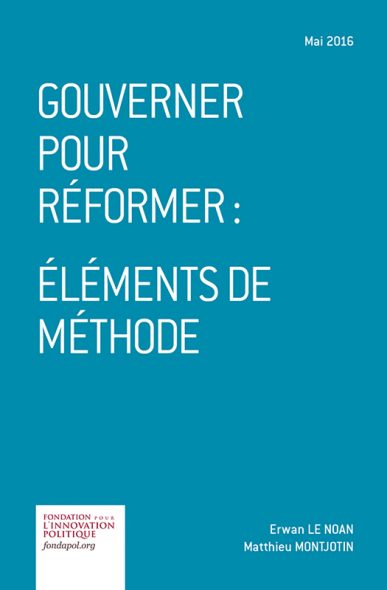
Gouverner pour réformer : Éléments de méthode

L'État innovant (2) : Diversifier la haute-administration
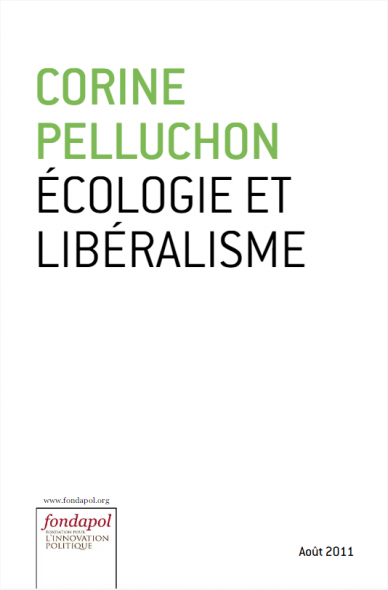
Ecologie et libéralisme
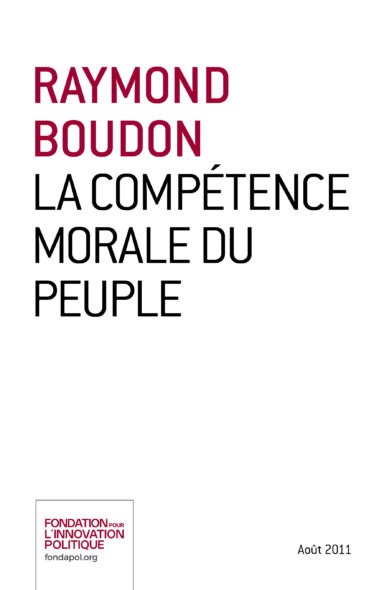
La compétence morale du peuple

L’État administratif et le libéralisme : une histoire française
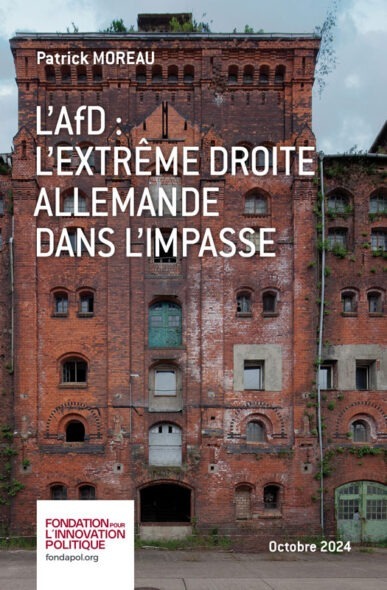
L’AfD : l'extrême droite allemande dans l'impasse

Le FPÖ au défi de l'Europe : radicalité idéologique et contrainte électorale en Autriche

Les Européens abandonnés au populisme
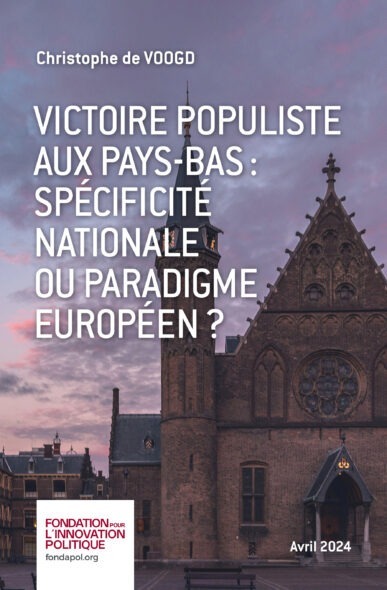
Victoire populiste aux Pays-Bas : spécificité nationale ou paradigme européen ?
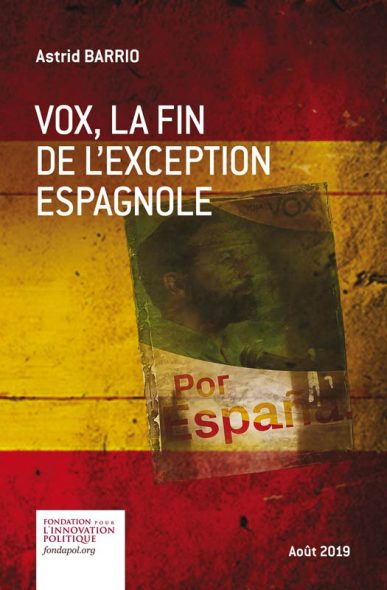
Vox, la fin de l'exception espagnole
Javier Milei passe devant Donald Trump au gala de l’America First Police Institute, le 14 novembre 2024 à Palm Beach, Floride.
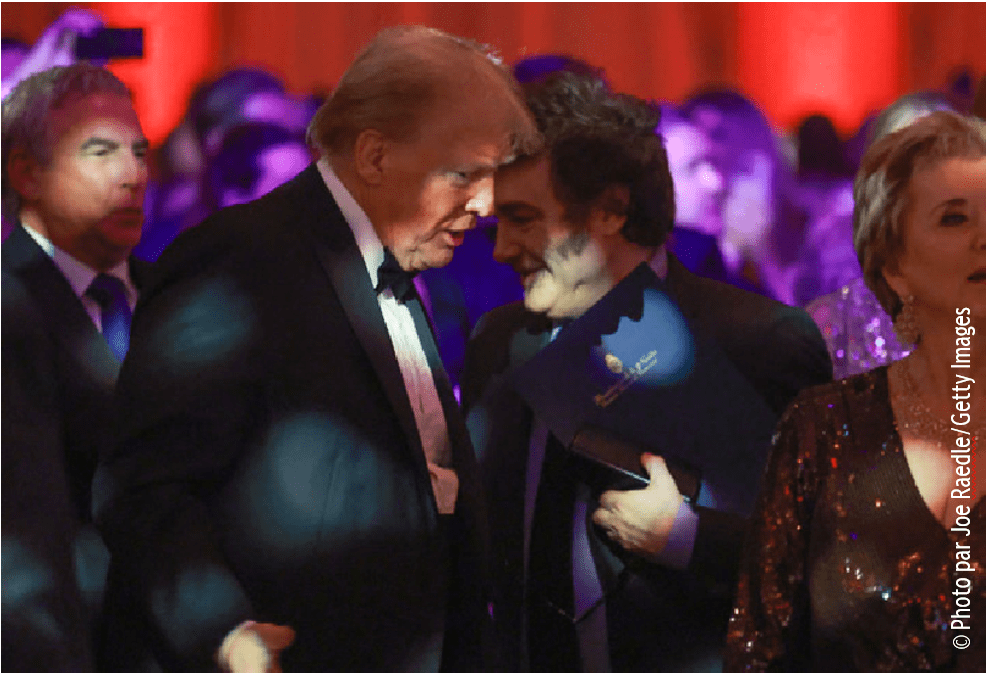
L’antilibéralisme des fondamentalistes paléo-libertariens
Nous allons commencer par nous demander si les anarcho-capitalistes devenus libertaro-populistes ont encore quelque chose à voir avec le libéralisme proprement dit. Bien sûr, pour répondre à cette question, il est nécessaire de donner au préalable une définition du libéralisme, ce qui est loin d’être simple. Nous proposerons ce que nous appellerons un idéal-type du libéralisme, que l’on peut trouver formulé, pour ainsi dire à l’état pur, chez quelques auteurs classiques à l’image de Benjamin Constant qui entendait défendre la « liberté en tout, en religion, en philosophie, en littérature, en industrie, en politique ». Nous montrerons qu’un libéralisme cohérent devrait être à la fois politique, économique et culturel, et viser à la défense des droits individuels face à tout type de domination, même si le conditionnel que nous employons avec prudence entend souligner combien rares sont les auteurs qui respectent cette cohérence et échappent à une forme d’hémiplégie malheureusement trop fréquente. Nous verrons que sur certaines questions comme le monopole, l’immigration ou encore les choix de vie (avortement et droits LGBT notamment), les paléo-libertariens sont en flagrante opposition avec des piliers essentiels du libéralisme.
L’idéal-type libéral
Le mot peut surprendre concernant un homme dont les positions politiques ont parfois été taxées d’opportunisme, au point d’en avoir conservé une solide réputation de girouette (notamment à cause de son attitude au moment des Cents Jours). Reste que sur le plan des principes, il est difficile de trouver un théoricien du libéralisme plus cohérent que Benjamin Constant. Voir notamment Stephen Homes, Constant et la genèse du libéralisme moderne, Paris, PUF, 1994.
Seuls les plus extrémistes des anarcho-capitalistes refuseraient certainement de voir en Constant un authentique libéral.
Sa compagne Germaine de Staël y aurait également quelques titres, même si elle occupe sans doute – injustement ? – une place moindre dans le Panthéon des auteurs libéraux. Sur leur libéralisme commun, voir Lucien Jaume (dir.), Coppet, Creuset de l’esprit libéral, les idées politiques et constitutionnelles du groupe de Mme de Staël, Economica/Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2000.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, le mot a alors une signification plus large qu’aujourd’hui et peut être traduit par : « activité économique » ou « activité productive ».
C’est nous qui voulons voir dans ces deux textes le meilleur résumé possible des axiomes fondamentaux du libéralisme, non les deux auteurs, qui n’ont pas ici la prétention de nous fournir une quelconque définition.
Même si, bien entendu, la nature même du libéralisme économique peut faire l’objet de débats.
Ceci renvoie à la classique distinction entre libertés négatives et libertés positives. Voir notamment Isaiah Berlin, Éloge de la liberté, Calmann-Lévy, 1988. Voir aussi L’Essai sur les libertés de Raymond Aron, disponible en poche dans la collection Pluriel.
Nous avons vu que sur la question des monopoles économiques, les libertariens, à la suite de Mises notamment, ont une position minoritaire par rapport à la plupart des courants libéraux qui font de la lutte contre ces monopoles un des piliers de la libre concurrence qu’ils jugent à la fois juste (refus des privilèges au nom du principe d’égalité des chances) et efficace (le monopole serait un frein à l’innovation). Mais la question des monopoles dépasse de très loin les simples questions économiques (que l’on pense par exemple au thème du monopole de l’enseignement), et là, les libertariens rejoindraient les autres courants libéraux dans leur ferme condamnation.
C’est le cas d’un auteur comme Jean-Marie Guyau (à ne pas confondre avec Yves Guyot, dont nous avons déjà parlé) qui, en 1878, dans son livre La Morale d’Épicure, défend l’idée stimulante – quoique controversée – selon laquelle la philosophie utilitariste aurait des racines dans l’épicurisme antique.
Sur l’utilitarisme, on ne peut que renvoyer à l’ouvrage classique du grand philosophe et historien libéral Élie Halévy, La Formation du radicalisme philosophique, en trois volumes, parus initialement entre 1901 et 1904 aux éditions Félix Alcan, et réédité aux PUF.
Cf. Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis, dont les deux volumes sont initialement parus en anglais en 1945.
Karl Polanyi (1886-1964) est l’auteur de La Grande Transformation, devenu un classique de la littérature antilibérale. Son frère Mikaël (1891-1976), émigré lui aussi de Hongrie en Angleterre dans les années 1930, est notamment l’auteur d’un important recueil d’articles paru en 1951 sous le titre The Logic of Liberty (traduit en français aux PUF en 1989 sous le titre La Logique de la Liberté), dans lequel, avant Hayek, il explique la supériorité des ordres spontanés sur les ordres centralisés, dans le domaine scientifique autant qu’économique.
On Liberty, 1859. On peut trouver ce grand classique du libéralisme en format de poche, dans la collection Folio, sous le titre : De la Liberté.
Le libéralisme n’est pas un système sorti d’un esprit éminent (comme le marxisme par exemple), mais une vaste nébuleuse qui regroupe des courants divers – et même divergents, sur certaines questions – qui sont nés à la sortie des guerres de religion avant de se développer au fil des siècles qui ont suivi. C’est néanmoins au xIxe qu’on en a certainement donné la formulation la plus cohérente (la plus « pure » serait-on tenté de dire, comme on le dit d’un alliage débarrassé de toute scorie), notamment de part et d’autre de la Manche.
S’il y a nécessairement une part d’arbitraire dans le fait de choisir comme modèle tel auteur plutôt que tel autre, il nous semble néanmoins que nul n’a plus de titres qu’un penseur aussi consensuel1 dans la galaxie libérale que Benjamin Constant (1767-1830), à pouvoir prétendre servir de référence commune aux diverses obédiences, des plus modérées à certaines2 des plus radicales. Qui, en effet, mieux que cet héritier des Lumières, adversaire déclaré de l’autocratie napoléonienne, peut résumer ce qui forme le noyau dur, l’essence même, de toute philosophie de la liberté3 ? Qu’on en juge par ces quelques lignes extraites de la préface à ses Mélanges de littérature et de politique, publiés en 1829 (un an avant sa mort) et qui mériteraient d’être gravées au fronton du temple du libéralisme s’il en existait un :
« J’ai défendu quarante ans le même principe, liberté en tout, en religion, en philosophie, en littérature, en industrie, en politique : et par liberté, j’entends le triomphe de l’individualité, tant sur l’autorité qui voudrait gouverner par le despotisme, que sur les masses qui réclament le droit d’asservir la minorité à la majorité. Le despotisme n’a aucun droit. La majorité a celui de contraindre la minorité à respecter l’ordre : mais tout ce qui ne trouble pas l’ordre, tout ce qui n’est qu’intérieur, comme l’opinion ; tout ce qui, dans la manifestation de l’opinion, ne nuit pas à autrui, soit en provoquant des violences matérielles, soit en s’opposant à une manifestation contraire ; tout ce qui, en fait d’industrie4, laisse l’industrie rivale s’exercer librement, est individuel, et ne saurait être légitimement soumis au pouvoir social ».
Pour faire pendant à ce texte qui pourrait prétendre donner le meilleur résumé possible de ce que nous appellerons, faute de mieux, le « noyau philosophique » du libéralisme, nous voudrions citer un autre auteur, britannique cette fois, John Stuart Mill. Il donne une autre « définition5 », d’autant plus intéressante qu’elle s’inscrit dans une perspective utilitariste, là où Constant s’inscrit, lui, dans celle du droit naturel. Ce faisant, nous retrouvons ainsi les deux grandes branches idéologiques dans l’héritage desquelles s’inscrivent pour ainsi dire tous les libéraux, comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner dans le volume précédent. Voici alors ce qui pourrait être une autre définition, pour ainsi dire canonique, du libéralisme telle qu’on la trouve dans le manifeste de John Stuart Mill publié en 1859, et intitulé on ne peut plus simplement On Liberty :
« Voilà donc la région propre de la liberté humaine. Elle comprend d’abord le domaine intime de la conscience qui nécessite la liberté de conscience au sens le plus large : liberté de penser et de sentir, liberté absolue d’opinions et de sentiments sur tous les sujets, pratiques ou spéculatifs, scientifiques, moraux ou théologiques. La liberté d’exprimer et de publier des opinions peut sembler soumise à un principe différent, puisqu’elle appartient à cette partie de conduite de l’individu qui concerne autrui ; mais […] ces deux libertés sont pratiquement indissociables. C’est par ailleurs un principe qui requiert la liberté des goûts et des occupations, la liberté de tracer le plan de notre vie suivant notre caractère, d’agir à notre guise et de risquer toutes les conséquences qui en résulteront, et cela sans en être empêché par nos semblables tant que nous ne leur nuisons pas, même s’ils trouvaient notre conduite insensée, perverse ou mauvaise. […] Une société quelle que soit la forme de son gouvernement n’est pas libre, à moins de respecter globalement ces libertés ; et aucune n’est complètement libre si elles n’y sont pas absolues et sans réserve. La seule liberté digne de ce nom est de travailler à notre propre avancement à notre gré, aussi longtemps que nous ne cherchons pas à priver les autres du leur ou à entraver leurs efforts pour l’obtenir ».
On remarquera que l’économie n’occupe pas une place à part dans ces deux « définitions », même si elle découle en toute logique des principes qu’ils énoncent. Ce qui nous conduit au cœur même de notre propos, à savoir qu’un libéralisme qui se veut cohérent ne peut exclure aucune dimension de sa revendication de liberté : ni la politique (un despotisme libéral est un oxymore et n’a rigoureusement aucun sens) ; ni les mœurs (où l’on voit que le libéralisme conservateur est un libéralisme hémiplégique) ; ni l’économie (où l’on voit que ceux qui, à gauche notamment, se réclament du libéralisme en matière politique et culturelle, pour mieux le rejeter en matière économique, sont tout autant pris en flagrant délit d’incohérence que les conservateurs6). C’est la raison pour laquelle un populisme paléo-libertarien, qui allie une défense intransigeante de la liberté économique à un conservatisme culturel mêlé d’une pratique politique faisant fi de l’idée même de séparation des pouvoirs, constitue une mutilation de l’idéal libéral qui conduit à le dénaturer complètement. D’une philosophie fondée sur la modération et la défense de l’individu contre toutes les formes de domination ne reste plus qu’une caricature de la liberté : celle du renard dans le poulailler.
Pour le montrer, nous devons d’abord essayer de définir les axiomes fondamentaux qui sont nécessaires pour pouvoir parler de libéralisme « cohérent ». Et en premier lieu, comme nous y invitent nos deux auteurs, il convient de souligner que le libéralisme est d’abord une forme d’individualisme (qu’il ne faut pas confondre avec l’égoïsme, qui est une notion morale, pour ne pas dire moralisatrice) puisqu’il entend défendre l’individu et son droit (ou sa capacité, selon les sensibilités7) à choisir librement son projet de vie, sans être contraint par une quelconque autorité (politique, religieuse, voire économique) à l’abandonner ou à en changer. De là découle nécessairement un nombre de libertés très concrètes :
– liberté de pensée/de conscience (dimension politique et culturelle du libéralisme) ;
– liberté d’expression (dimension politique) ;
– liberté d’entreprendre (dimension économique).
Autant de libertés qui coïncident avec un certain nombre de valeurs et de droits :
– l’égalité des droits et le respect des minorités (puisque l’individu n’est jamais que la plus petite des minorités possibles) ;
– le pluralisme, qu’il soit politique, idéologique ou religieux, mais aussi économique, puisque la lutte contre les monopoles, quels qu’ils soient8, est un des piliers de tout libéralisme cohérent ;
– le respect de la propriété, dont le principe même ne peut être remis en cause, même si des discussions sont légitimes sur sa possible limitation (que les libertariens refuseront là où une majorité de libéraux l’accepteront à condition qu’elle reste limitée et justifiée de manière rigoureuse) ;
– la limitation des pouvoirs, qu’ils soient politiques (l’État d’abord, qui fait figure de Léviathan redoutable), religieux (les Églises qui entendent imposer une vérité révélée nécessairement liberticide) ou économique (les grandes entreprises d’autant plus redoutables pour la liberté qu’elles sont inévitablement liées, d’une manière ou d’une autre, à la puissance publique). Bien sûr, les divergences pourront être considérables entre les divers courants libéraux qui se focaliseront contre un type de pouvoir plutôt qu’un autre : les conservateurs mettront surtout l’accent sur le danger étatique, les libéraux « culturels » sur les « Églises », et les libéraux « sociaux » sur les dangers du grand capitalisme de connivence. Reste que le libéral qui entend rester cohérent devra rester vigilant à l’égard de tous ces léviathans, qui représentent, à des degrés divers, des menaces pour la liberté.
Encore une fois, on trouve des différences considérables entre les auteurs qui se proclament libéraux, d’autant qu’il y a, comme nous l’avons vu, plusieurs manières de justifier idéologiquement les revendications de liberté. Il existe en effet une tradition qui se réclame du droit naturel, et qui a notamment – mais pas seulement – les faveurs des courants les plus radicaux du libéralisme, à commencer par les libertariens qui en donnent une définition intransigeante à travers l’idée de souveraineté « absolue » de l’individu. Une telle idée ne peut que conduire à l’anarchisme puisqu’elle dénie à toute autorité politique la moindre légitimité, même si, comme nous le verrons, ses partisans sont souvent moins vigilants vis- à-vis des pouvoirs économiques et religieux. Face à cette tradition libérale fondée sur le droit naturel s’est développée une conception utilitariste du libéralisme, dans le sillage de Jeremy Bentham et de John Stuart Mill, même si certains n’hésitent pas à en chercher les origines lointaines jusque dans la pensée antique9. Cette tradition libérale d’origine utilitariste se veut du reste pragmatique puisque, recherchant « le plus grand bonheur du plus grand nombre » (tel est l’axiome de base de l’utilitarisme10), elle admet comme légitime une certaine intervention de l’État, au point que John Stuart Mill sera considéré à la fin de sa vie comme un socialiste libéral, et jugé par nombre de libertariens comme un traître à la cause. Reste qu’il est peu d’auteurs qui aient davantage que Mill insisté sur les vertus du pluralisme, y voyant là la grande supériorité de ce que Karl Popper (un autrichien naturalisé britannique qui deviendra l’une des grandes figures du libéralisme européen du xxe siècle) appellera les « sociétés ouvertes11 ». On peut en effet lire dans On Liberty une telle ode au pluralisme, dessinant l’un des piliers les plus vitaux de tout l’édifice libéral. On le retrouvera dans l’œuvre d’Hayek ou de Mickaël Polanyi (à ne pas confondre avec son frère Karl12) défendant tous deux les ordres sociaux polycentriques et spontanés, en les jugeant infiniment plus efficaces que toute forme de planification (dans le domaine économique, mais également en matière de recherche scientifique). Pour John Stuart Mill, guide sûr pour les défenseurs des libertés :
« Pourquoi la famille des nations européennes continue-t-elle de progresser ? Pourquoi n’est-elle pas une partie stationnaire de l’humanité ? Ce n’est certes pas grâce à leurs prétendues qualités supérieures, car là où elles existent, c’est à titre d’effet, et non de cause ; mais c’est plutôt grâce à leur remarquable diversité de caractère et de culture. En Europe, les individus, les classes, les nations sont extrêmement dissemblables : ils se sont frayé une grande variété de chemins, chacun conduisant à quelque chose de précieux ; et bien qu’à chaque époque ceux qui empruntaient ces différents chemins aient été intolérants les uns envers les autres, et que chacun eût préféré obliger tous les autres à suivre sa route, leurs efforts mutuels pour freiner leur développement ont rarement eu un succès définitif. Et, peu à peu, chacun en est venu à accepter bon gré mal gré, le bien qu’apportaient les autres. Selon moi, c’est à cette pluralité de voies que l’Europe doit son développement varié. Mais déjà elle commence à perdre considérablement cet avantage. Elle avance décidément vers l’idéal chinois de l’uniformisation des personnes13 ».
À l’heure de la concentration des outils numériques et autres réseaux sociaux entre les mains de quelques acteurs géants aux visées monopolistiques, cet éloge du pluralisme comme cœur même de la philosophie libérale mérite d’être rappelé inlassablement.
En quoi les (paléo-) libertariens violent-ils un certain nombre de principes libéraux fondamentaux ?
Nous laisserons de côté la question du libre-échange, que Javier Milei, contrairement à Donald Trump, se garde bien de remettre en cause, tant l’économiste argentin sait pertinemment qu’il s’agit là d’un dogme intangible pour la quasi-totalité des libéraux, libertariens et autres anarcho-capitalistes.
Une fois énumérés ce que nous pensons pouvoir affirmer être les piliers d’un libéralisme « cohérent », il sera plus facile de montrer, à travers quelques exemples concrets, comment certains libertariens radicaux alliés au conservatisme religieux (en Argentine avec Milei ou aux États-Unis avec Trump) trahissent à n’en pas douter des valeurs pourtant au cœur de toute philosophie authentiquement libérale. Nous prendrons successivement des exemples économiques (la question des monopoles14), politiques (avec la question de l’immigration) et « culturels » (avec notamment le droit à l’avortement, les droits LGBT et plus largement la question des discriminations). Ces débats nous permettront de voir si le libéralisme dont ils se revendiquent fièrement, au point de prétendre en représenter la seule version orthodoxe ou pure, incorpore bien les trois dimensions que nous estimons inséparables – politique, économique et culturelle –, ou si au contraire l’idéologie qu’ils défendent n’est pas foncièrement hémiplégique.
La question clé des monopoles
Pour reprendre le titre d’une célèbre intervention d’Élie Halévy, lors d’une séance de la Société française de Philosophie du 28 novembre 1938.
Tel est le terme alors employé, dans un sens parfaitement contraire à celui que le mot a pris dans les décennies suivantes, et tel qu’il est aujourd’hui couramment utilisé, au risque de semer la confusion en substituant parfois la polémique idéologique au strict respect des nuances et de la rigueur historiques. Pour une première approche de cet important moment de l’histoire du libéralisme de l’avant-Seconde Guerre mondiale, on peut se reporter utilement à Serge Audier, Le Colloque Lippmann : aux origines du néo-libéralisme, éditions Le Bord de l’Eau, 2008.
Il participa au colloque avant de faire partie après-guerre de la Société du Mont Pèlerin. Ce haut fonctionnaire issu de l’école Polytechnique et de l’inspection des Finances exercera des responsabilités importantes dans l’administration française puis au sein des institutions européennes, même si la postérité a surtout retenu le fameux « plan Rueff » mis en œuvre avec Antoine Pinay au moment du retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958. On sait moins qu’il a écrit de nombreux livres et qu’il joua un rôle non négligeable dans la défense des idées libérales. Voir notamment Christopher S. Chivvis, The Monetary Conservative. Jacques Rueff and Twentieth-century Free Market Thought, Northern Illinois University Press, 2010.
Nous renvoyons à l’introduction de Xavier Méra au troisième tome de la traduction française du livre, paru en 2007, et que l’on peut librement trouver [en ligne].
Pablo Stefanoni, « Javier Milei en 10 phrases choc. Le paléolibertarien qui veut prendre l’Argentine », Le Grand Continent, 18 septembre 2023.
Nous avons vu que c’est par la lecture d’un texte de Rothbard relatif à la question des monopoles que Javier Milei a connu en 2013 une subite conversion aux thèses libertariennes les plus radicales. C’est là une question clé, même si elle ne saurait se limiter à une stricte querelle d’économistes. En effet, la défense du pluralisme est un principe fondamental du libéralisme, et c’est la raison pour laquelle l’idée même de monopole heurte tous les auteurs libéraux, quel que soit le domaine où il s’applique, que l’on pense par exemple à la question du monopole de l’enseignement qui a longtemps mobilisé une partie des libéraux contre les visées monopolistiques de l’État ou de l’Église.
Sur le plan strictement économique, la dénonciation des monopoles privés s’incarne dans la lutte antitrust, dont les États-Unis ont donné une illustration fameuse avec le Sherman Anti-Trust Act du 2 juillet 1890, la première tentative du gouvernement américain pour limiter les comportements anticoncurrentiels des grandes entreprises, signant par là-même la naissance du droit de la concurrence moderne. Le principe de cette lutte antitrust est soutenu par un grand nombre de penseurs libéraux, comme l’illustre par exemple le célèbre Colloque Lippmann qui a rassemblé à Paris, en août 1938, 26 économistes et intellectuels libéraux afin de réfléchir à la manière de sauver un libéralisme alors en butte à la double offensive idéologique du communisme et du fascisme, durant ce que l’historien libéral Élie Halévy a appelé « l’ère des tyrannies15 ». Dans l’esprit de l’initiateur de cette rencontre, le journaliste américain Walter Lippmann (comme dans celui de la grande majorité des participants au colloque), cette entreprise de rénovation du libéralisme devait passer par une remise en cause du libéralisme laissez-fairiste d’antan, au profit d’un « néo-libéralisme16 » qui acceptât une intervention plus importante de l’État dans la vie économique et sociale. L’un des piliers de ce nouveau libéralisme devait notamment résider dans la lutte contre les monopoles : la défense de la concurrence était l’un des domaines où cette intervention de l’État paraissait parfaitement légitime à bon nombre de libéraux patentés, comme le Français Jacques Rueff17, ou encore les ordolibéraux allemands qui, après la guerre, théoriseront l’espace économique européen comme un marché institutionnel où la concurrence devait être garantie et promue par une autorité de régulation puissante.
Si la concurrence reflète des valeurs foncièrement libérales comme la diversité et le pluralisme, c’est aussi un gage d’émulation, condition même de l’innovation, là où les rentes de situation ne peuvent conduire qu’à la sclérose et à la stagnation. Il n’en reste pas moins, comme nous l’avons vu, que la notion même de monopole a été remise en cause par les franges les plus radicales du libéralisme, en particulier du côté de l’école autrichienne. C’est le cas de Ludwig von Mises, qui écrit ainsi dans son opus magnum, L’Action humaine, qu’à l’exception de certains marchés de matière première, le monopole n’existe pas en tant que capacité qu’auraient certaines entreprises privées à supprimer la concurrence, c’est-à-dire la « souveraineté du consommateur » qu’est censée établir l’économie de marché. En effet, écrit-il :
« Le domaine du monopole apparaît comme extrêmement vaste. Les produits des industries de transformation sont plus ou moins différents l’un de l’autre. Chaque usine fabrique des produits différents de ceux des autres établissements. Chaque hôtel a le monopole de la vente de ses services sur le site de ses immeubles. Les services professionnels d’un médecin ou d’un juriste ne sont jamais parfaitement égaux à ceux que rend un autre médecin ou juriste. À part certaines matières premières, denrées alimentaires et autres produits de grande consommation, le monopole est partout sur le marché. Pourtant, le simple phénomène de monopole est sans signification ou importance dans le fonctionnement du marché et la formation des prix. Il ne donne au monopoliste aucun avantage pour la vente de ses produits. […] Il y a toujours concurrence catallactique sur le marché. […] Il y a des gens qui soutiennent que la théorie catallactique des prix n’est d’aucun usage pour l’étude de la réalité parce qu’il n’y a jamais eu de ‘‘libre’’ concurrence et qu’à tout le moins aujourd’hui il n’existe plus rien de tel. Toutes ces thèses sont fausses. Elles comprennent le phénomène de travers et ignorent tout simplement ce que la concurrence est réellement. C’est un fait que l’histoire des dernières décennies est un répertoire de mesures politiques visant à restreindre la concurrence. C’est l’intention manifeste de ces plans que de conférer des privilèges à certains groupes de producteurs en les protégeant contre la concurrence de rivaux plus efficaces. Dans de nombreux cas, ces politiques ont créé la situation requise pour l’apparition de prix de monopole. […] La compétition catallactique a été considérablement limitée, mais l’économie de marché fonctionne toujours, bien que sabotée par les immixtions du pouvoir politique et des syndicats. […] L’objectif ultime de toutes ces politiques anticoncurrentielles est de substituer au capitalisme un système socialiste de planification dans lequel il n’y aurait plus du tout de concurrence. Tout en versant des larmes de crocodile à propos du déclin de la concurrence, les planificateurs visent à l’abolition de ce système concurrentiel ‘‘insensé’’ ».
En d’autres termes, le monopole en tant que tel, c’est-à-dire en tant que phénomène susceptible d’annihiler la concurrence et de mettre fin à la souveraineté du consommateur, ne saurait être l’œuvre d’entreprises privées, mais uniquement de l’État. Même si Mises admet toutefois une exception, à savoir la possible émergence de prix de monopole dans le cas où un monopole ou un cartel ferait face à une demande inélastique au-dessus du prix concurrentiel. C’est cette exception que Rothbard entend pour sa part démonter dans son grand traité de théorie économique, L’Homme, l’Économie et l’État, paru en 196218. Sans rentrer dans le détail d’une argumentation serrée, il nous suffit toutefois de comprendre qu’il s’agit là pour Rothbard, une fois de plus, de poursuivre le combat engagé par son ancien maître autrichien en radicalisant encore ses positions. En l’occurrence, en démontrant que la notion de monopole ne saurait « en aucune circonstance » être conçue comme une entrave au bon fonctionnement de l’économie de marché, sauf bien entendu si elle est l’œuvre de l’État. Un État qui reste plus que jamais le grand ennemi à abattre. Ce faisant, Rothbard prend le contrepied d’une longue tradition d’économistes libéraux patentés, ralliés sur cette question précise à l’opinion de l’immense majorité de leurs confrères, toutes sensibilités confondues. C’est précisément la raison pour laquelle, la lecture du chapitre 10 de L’Homme, l’Économie et l’État, consacré au déboulonnage d’une des statues apparemment les plus solides de la science économique, a pu exercer sur l’économiste Javier Milei la fascination propre à toute entreprise iconoclaste – pour ne pas dire sacrilège. Le futur président argentin en a alors conclu que tout ce qu’il avait pu enseigner jusque-là à ses étudiants était fallacieux : « Quand j’ai fini de lire Rothbard, je me suis dit : “Pendant plus de 20 ans, j’ai trompé mes étudiants. Tout ce que j’ai enseigné sur les structures de marché est faux. C’est complètement erroné !”19 ».
La question de l’immigration
Dans son introduction au recueil de tribunes publiées par Rothbard dans le Rothbard-Rockwell Report entre 1990 et 1994. Cf. Llewellyn H. Rockwell Jr (eds), The Irrepressible Rothbard, The Center For Libertarian Studies, 2000, p. 268-269 [en ligne].
Jean-Baptiste Say, Cours complet d’économie politique pratique, 1828.
Bien qu’il existe, nous l’avons dit, une frange de libertariens qui se réclament d’une philosophie utilitariste, à l’image d’un David Friedman par exemple.
Benjamin Constant, Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, Paris, Les Belles Lettres, 2004. Cette réédition est la première depuis la parution initiale en 1824.
Benjamin Constant, Œuvres complètes, volume 3, Écrits littéraires (1800-1813), De Gruyter Mouton, 1995, p. 346.
Jean-Baptiste Say, Traité d’économie politique, 1803, t. I.
Gustave de Molinari, La Viriculture, ralentissement du mouvement de la population, dégénérescence, causes et remèdes, Paris, Guillaumin, 1897.
Il est vrai que sur certaines questions il est minoritaire au sein de la mouvance libérale, comme par exemple sur la question coloniale, qu’il approuve à la différence de nombre d’autres libéraux.
Force est de constater que la dénonciation de l’immigration n’occupe pas chez Javier Milei la place centrale qu’elle occupe chez Donald Trump, car l’économiste argentin sait pertinemment que la libre circulation des personnes est un dogme intangible des libéraux de toute obédience. Il le reconnaît du reste lui-même dans le discours que nous publions à la fin de cette note, puisqu’il affirme : « La libre circulation des biens et des personnes étant à la base du libéralisme, nous le savons bien, l’Argentine, les États-Unis et bien d’autres pays ont été rendus grands par ces immigrants qui ont quitté leur patrie à la recherche de nouvelles opportunités ». Pour tenir un discours critique à l’égard du phénomène migratoire, Milei est contraint d’opérer une acrobatie intellectuelle en arguant que « le wokisme a également dénaturé la cause de l’immigration », puisque, à l’entendre, « de la tentative d’attirer des talents étrangers pour promouvoir le développement, nous sommes passés à une immigration de masse motivée non pas par l’intérêt national mais par la culpabilité ». Ce faisant, Milei n’innove guère en réalité, puisque le courant paléo-libértarien lui a ouvert la voie trente ans plus tôt aux États-Unis.
De fait, dans leur volonté de rapprochement avec la droite populiste, Rothbard et Lew Rockwell, les concepteurs de la stratégie « fusionniste » dont nous avons abondamment parlé dans le volume précédent, ont cherché bien avant Javier Milei (et de manière plus argumentée que dans le discours que nous publions) à justifier le refus de l’immigration, sans pour autant paraître renier leurs principes libertariens. C’est ce dont témoigne parfaitement Lew Rockwell, le compagnon de route de Rothbard, lorsqu’il écrit cinq ans après la mort de ce dernier20 :
« Mais comment un anarchiste peut-il soutenir les restrictions à l’immigration ? Comme il l’écrit dans The Ethics of Liberty (1982), ‘‘il ne peut y avoir aucun droit humain à immigrer, car quelle propriété quelqu’un d’autre a-t-il le droit de fouler aux pieds [to trample] ? En bref, si ‘Primus’ souhaite migrer maintenant d’un autre pays vers les États-Unis, nous ne pouvons pas dire qu’il a le droit absolu d’immigrer sur cette terre ; car que dire de ces propriétaires qui ne veulent pas de lui sur leur propriété ?’’ Je cite ce passage pour démontrer l’inanité d’une autre accusation contre Murray : il aurait changé sa position sur l’immigration ouverte en une position ‘‘nativiste’’ à cause de sa nouvelle amitié avec les paléoconservateurs. Comme le montre ce volume, ses dernières opinions sur le sujet étaient une conséquence de sa position générale en faveur de droits de propriété stricts. Ainsi, il ne restreindrait pas l’immigration dans laquelle les gens contractent pour travailler (la citoyenneté étant une question entièrement différente) ».
Ce faisant, les libertariens n’en renient pas moins ouvertement une liberté (celle de circuler librement) considérée comme naturelle par l’immense majorité des penseurs libéraux, dont un bon nombre ont eux-mêmes été des immigrés (que l’on pense, pour le seul xxe siècle, à Ayn Rand, Hayek, Mises, Popper, Mickaël Polanyi, et tant d’autres encore). Il serait trop long et fastidieux de faire une revue des positions de tous les courants du libéralisme sur cette question, et nous nous contenterons d’évoquer ici cette école française laissez-fairiste dont les anarcho-capitalistes se sont souvent proclamés avec fierté les héritiers. Son fondateur Jean-Baptiste Say explique par exemple que la liberté de circulation est une conséquence directe du respect du droit de propriété, comme s’il répondait directement à Rothbard. On peut en effet lire dans son Cours complet d’économie politique pratique, publié en 1823 :
« La faculté locomotive, cette faculté de pouvoir changer de place, et de transporter nos capacités dans le lieu où elles peuvent nous rendre le plus de services ; cette faculté si merveilleuse à laquelle nous donnons si peu d’attention, fait partie de nos biens, de même que toutes les autres facultés que nous tenons de la nature, et les atteintes qu’on y porte, sont par conséquent des atteintes à la propriété. Un peuple qui n’est point choqué que l’on entrave sous différents prétextes, la faculté qu’ont les hommes de changer de lieu, n’est point animé d’un véritable respect pour la propriété, et n’est point encore assez instruit pour avoir le sentiment de tous les heureux fruits que peut produire le plein et entier usage de nos facultés. Je ne me serais pas cru obligé d’insister sur ce point, si ce n’était qu’il m’a semblé utile de montrer à ceux mêmes qui conviennent que les propriétés doivent être respectées, combien ils sont sujets à démentir leur doctrine par les actes auxquels ils prennent part, ou qu’ils approuvent21 ».
Ce texte est d’autant plus remarquable qu’il semble répondre, comme par anticipation, aux arguments des paléo-libertariens comme Rothbard invoquant le droit de propriété, sacré à leurs yeux, et en ce qu’il parle le langage du droit naturel, dont nous avons vu à maintes reprises qu’il était le fondement philosophique sur lequel s’appuyaient la grande majorité des libertariens les plus radicaux pour légitimer leurs positions, à la différence des utilitaristes, volontiers accusés d’être mous et/ou inconséquents22.
Jean-Baptiste Say n’est d’ailleurs pas isolé parmi les libéraux français lorsqu’il défend une telle position. Pour Benjamin Constant, « si, dans un pays, les efforts d’un travailleur sont inutiles, il peut chercher ailleurs un ciel plus propice et des circonstances plus favorables », tout en précisant qu’il regrette les « lois prohibitives » qui dénient aux plus pauvres ce droit d’aller tenter leur chance ailleurs. « Avec une législation pareille, ajoute Constant, il n’y a aucun excès qu’on ne doive attendre, il n’y a pas de désordre qui nous puisse étonner23 ». De fait, le développement même des passeports au xIxe siècle est unanimement blâmé par les penseurs libéraux qui, à l’unisson de leur père spirituel qu’est en quelque sorte Benjamin Constant, regrettent le temps béni où chacun pouvait jouir de « cette liberté complète d’aller et de venir, sans qu’âme qui vive s’occupe de vous, et sans que rien rappelle cette police dont les coupables sont le prétexte, et les innocents le but24 ».
L’argument fondé sur le droit naturel n’est du reste pas le seul à être mobilisé pour défendre la libre circulation des personnes. Des arguments de type utilitariste sont aussi utilisés, afin de démontrer que l’immigration est bénéfique pour le pays d’accueil, et pas uniquement pour le migrant. Ainsi Jean-Baptiste Say écrit-il en 1803 : « Une acquisition vraiment profitable pour une nation, c’est celle d’un étranger qui vient s’y fixer en transportant avec lui sa fortune. Il lui procure à la fois deux sources de richesses : de l’industrie [entendre : du travail] et des capitaux. Cela vaut des champs ajoutés à son territoire ; sans parler d’un accroissement de population précieuse quand il apporte en même temps de l’affection [lire : une reconnaissance envers le pays d’accueil] et des vertus25 ». L’argument mis ici en avant consiste à démontrer que l’immigrant, qu’il retourne au bout de quelques années dans son pays d’origine ou bien qu’il demeure dans sa nouvelle patrie, a quoi qu’il en soit accompli pour cette dernière une œuvre productive, et donc accru sa richesse. C’est pourquoi quelqu’un comme Gustave de Molinari, en qui les anarcho-capitalistes américains du xxe siècle verront le libéral le plus conséquent du Groupe de Paris et le plus proche de leurs idées, écrira en son temps que l’immigration est « toujours avantageuse », dans la mesure où « l’immigration n’apporte généralement que les individus les plus entreprenants et les plus vigoureux26 ».
Bien sûr, les libéraux du xIxe siècle ne prônent pas une abolition pure et simple des frontières, pas plus qu’ils ne dénient à l’État le droit d’interdire l’entrée sur son territoire à des personnes qu’il estimerait représenter une menace pour l’ordre public. Mais à leurs yeux l’interdiction doit demeurer l’exception ; en aucun cas la règle. En effet, comme l’écrit Paul Leroy-Beaulieu, l’une des figures les plus éminentes de l’École de Paris27, si l’État ne lui paraît pas légitime pour empêcher un étranger d’acquérir une propriété, de prendre un emploi qui lui est proposé, ou encore de fonder une famille et de s’employer à la nourrir, il peut en revanche tout à fait repousser des populations qu’il estimerait indésirables car représentant une menace pour l’ordre social. Il développe par exemple, en juillet 1887, un plaidoyer en faveur d’une immigration libre – quoique maîtrisée –, en utilisant une argumentation à la fois utilitariste et jusnaturaliste, comme en attestent ces lignes :
« La vieille maxime que l’étranger est l’ennemi tend à ressusciter dans presque tous les pays du monde, tellement il est vrai que les progrès dont se targue le genre humain dans l’ordre moral ne sont jamais définitivement acquis, qu’il faut sans cesse les défendre, et qu’un retour offensif de la barbarie primitive menace toujours notre précaire et fragile civilisation. […] Le retour à la politique d’isolement national est malheureusement le trait le plus caractéristique des dix dernières années. On commence par prohiber les produits ; l’on finit par vouloir prohiber les personnes. Quand on n’interdit pas à l’étranger de résider dans le pays, on lui défend d’y devenir propriétaire. […] Si nous dénonçons cette tendance, c’est qu’elle nous paraît conduire à des embarras économiques et, un jour plus ou moins éloigné, à des catastrophes politiques. Rien n’est plus opposé au droit des gens, ou du moins à son interprétation moderne. […] Nous tenons, quant à nous, qu’un peuple n’a ni intérêt ni droit à proscrire en masse de son territoire les étrangers ou à leur y rendre par des taxes spéciales la résidence impossible ; qu’un peuple n’a également ni intérêt ni droit à interdire aux étrangers l’achat de propriétés. Nous soutenons, en outre, qu’un peuple est suffisamment armé quand il impose aux étrangers qui sont sur son territoire la reconnaissance de toutes les lois du pays, et qu’il les naturalise à partir de la seconde génération. L’usage habile et résolu de la naturalisation suffit pour qu’un peuple tourne à son profit l’immigration des étrangers. […] L’État n’a qu’à se réserver le droit de prohiber individuellement les étrangers dangereux, et même en masse les bandes de mendiants ou de bohémiens, de saltimbanques et de vagabonds, les seules immigrations qui nuisent à un pays28 ».
Pour conclure, il est donc manifeste que pour les libéraux français du xIxe siècle (dont, une fois encore, les libertariens américains du siècle suivant aimeront tant se réclamer), le droit de libre circulation des personnes doit être la règle, pour des raisons tenant à la fois aux principes (il s’agit à leurs yeux d’un droit naturel) et à des considérations utilitaristes (l’immigration est bénéfique pour le pays d’accueil). Le refus de laisser des populations étrangères s’installer dans une autre contrée pour y travailler – en respectant bien entendu le pays hôte – ne peut se justifier que par des considérations relatives à l’ordre public, et certainement pas pour flatter les sentiments xénophobes ou les craintes irrationnelles à l’égard de l’étranger entretenues par des discours démagogiques.
Le libéralisme culturel
Murray N. Rothbard, For a New Liberty. The Libertarian Manifesto, op. cit.
David Friedman, The Machinery of Freedom. Guide to a Radical Capitalism, 1973 (traduit en français en 1992 par Les Belles Lettres, sous le titre : Vers une Société sans État).
Murray Rothbard, The Religious Right. Toward a Coalition, février 1993.
On connaît la place que la critique de l’environnement occupe dans le discours du climatosceptique Donald Trump mais que reprend volontiers Javier Milei lorsqu’il dénonce par exemple en janvier 2021 dans son discours à Davos, le « sinistre écologisme radical et la bannière du changement climatique ». Notons que cette critique était déjà mise en avant par quelqu’un comme Rothbard dès le début des années 1990, puisqu’il s’en prend alors à « l’interminable litanie des postulats hystériques et pseudo-scientifiques des dernières années », à l’image du discours écologiste sur le « réchauffement de l’atmosphère ». Cf. Murray Rothbard, postface à l’édition française de L’Ethique de la liberté, octobre 1990.
Ibid.
Comme chacun sait, les catholiques, pourtant minoritaires aux États-Unis, ont été aux avant-postes du combat de longue haleine contre l’avortement, qui a remporté une victoire décisive en 2021 avec la remise en cause par la Cour suprême de l’arrêt Roe v. Wade qui remontait à 1973.
Selon la tradition libérale classique, à laquelle se rattache in fine le courant libertarien, la loi n’a pas à se substituer à la morale en se prononçant sur les comportements individuels, dès lors que ces derniers ne portent pas atteinte aux droits d’autrui. En effet, la fonction exclusive de la loi – c’est-à-dire la justification du pouvoir politique, détenteur du monopole de la violence légitime – est d’assurer le strict respect des droits individuels en punissant les atteintes à ces mêmes droits. Nous avons vu que Rothbard lui-même, dans les années 1960, pouvait écrire que « le libertarien approuve sans réserve ce qu’on appelle généralement les ‘‘libertés civiles’’ : liberté d’expression, de publication, d’association, liberté de se livrer à des ‘‘crimes sans victimes’’ tels que la pornographie, les déviations sexuelles et la prostitution29 ». C’est cette même conception qu’exprime David Friedman (fils de Milton, et libertarien affirmé, contrairement à son père), lorsqu’il écrit : « L’idée centrale du libertarisme, c’est qu’on doit laisser les gens mener leur propre vie comme ils l’entendent. Nous rejetons totalement l’idée qu’il faille protéger les gens eux-mêmes par la force. Une société libertarienne n’aurait pas de lois contre la drogue, le jeu, la pornographie – et pas de ceinture de sécurité obligatoire30 ». On pourrait ainsi multiplier à l’envi les déclarations du même acabit, mais le meilleur résumé de cette cohérence libertarienne est le canadien Tim Moen, qui lors de sa candidature aux élections législatives de 2014, a choisi comme slogan de campagne : « Je veux que les couples gays mariés puissent défendre leurs plants de marijuana avec leurs fusils ».
Force est pourtant de constater qu’un tel point de vue, qui peut au moins se targuer d’une forme de logique, est loin de refléter le positionnement de la grande majorité des libertariens aujourd’hui. Beaucoup, à l’image de Javier Milei, préfèrent abandonner le libéralisme culturel à la gauche pour mieux surfer sur les tendances conservatrices de la société selon cette stratégie d’alliance avec la droite populiste, dont nous avons longuement exploré la généalogie dans le premier volume de cette note. Dans un article-fleuve, intitulé “The Religious Right. Toward a Coalition”, et rédigé juste après l’élection du Démocrate Bill Clinton à la Maison-Blanche, Rothbard, une fois de plus, a reconnu sans ambages son alignement sur la droite chrétienne en matière culturelle :
« Comment se fait-il que moi, un libéral pro-choice, je me sois levé et j’aie applaudi lorsque le révérend Falwell a annoncé, après l’élection, qu’il pourrait ressusciter la Majorité morale ? […] La plupart des libertariens pensent aux conservateurs chrétiens dans les mêmes termes sinistres que les médias de gauche, sinon plus : leur objectif est d’imposer une théocratie chrétienne ; d’interdire l’alcool et d’autres moyens de plaisir hédonique, et d’enfoncer les portes des chambres pour imposer une police des mœurs dans le pays. Rien n’est plus faux : les conservateurs chrétiens tentent de riposter contre une élite de gauche libérale qui a utilisé le gouvernement pour attaquer et pratiquement détruire les valeurs, les principes et la culture chrétiens31 ».
Comment mieux dire que la stratégie de fusion avec la droite religieuse prend ici clairement le pas sur la cohérence idéologique, et que dans le combat contre l’hydre étatiste, l’alliance avec la droite la plus conservatrice et la plus illibérale en matière culturelle est une tactique d’autant plus assumée qu’elle paraît indispensable, aux yeux de ses instigateurs, à une conquête des masses populaires. Il n’est même plus question de faire semblant de rester fidèle aux traditions de pensée que l’on a pourtant mises en avant pendant de longues années, à l’époque où l’on entendait fonder une « science libertarienne » cohérente et solide comme l’airain. Il ne s’agit plus désormais que d’être efficace dans un combat idéologique sans merci destiné à conquérir l’hégémonie culturelle en faisant feu de tout bois dans le but explicite de rassembler la coalition la plus large. En usant pour ce faire d’une propagande manichéenne qui ne s’embarrasse plus ni de détails ni de logique. Car l’heure n’est plus à la bienséance des colloques universitaires ou à la rigueur argumentative des joutes académiques. Il s’agit désormais, ni plus ni moins, d’opérer une « révolution populiste par la base » (celle « des hommes blancs d’ascendance européenne »), contre « les élites dirigeantes égalitaristes, collectivistes et internationalistes », ce qui suppose de « se concentrer sur leurs doléances et leurs préoccupations » en s’appropriant leurs revendications : « des impôts élevés, trop de régulation gouvernementale (y compris la victimologie, les politiques de discrimination positive, l’environnementalisme antihumain32) ; le système de protection sociale et l’État-providence ; la violence criminelle », sans oublier, bien entendu, « l’immigration par des hordes d’étrangers non assimilés à la culture américaine », ou encore « l’attaque du sécularisme contre la religion chrétienne33 ».
Comment mieux dire que ce sont bien les nécessités de cette coalition populiste et de la propagande propre à la souder qui l’emportent désormais clairement sur la cohérence des idées de liberté ? C’est ce qu’illustre parfaitement la question de l’avortement, dont on sait à quel point elle est cardinale dans les obsessions de la droite religieuse, notamment américaine34.
La question de l’avortement
Murray Rothbard, “The Religious Right. Toward a Coalition”, The Rothbard-Rockwell Report, IV n°2, février 1993 [en ligne].
Une position que défend Javier Milei. Cf. Pablo Stefanoni, « Javier Milei en 10 phrases-choc : le paléolibertarien qui veut prendre l’Argentine », op. cit.
Murray Rothbard, L’Éthique de la liberté, op. cit.
Selon le titre de l’une de ses chroniques, parue dans The Rothbard-Rockwell Report en août 1994, Rothbard affirmait d’ailleurs, non sans provocation, que les fumeurs étaient « la minorité la plus persécutée d’Amérique » !
“The Religious Right. Toward a Coalition”, op. cit. Le Dixième Amendement stipule que « Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elle aux États, sont conservés par les États respectivement, ou par le peuple. »
Rothbard lui-même reconnaît que « la question de l’avortement est plus difficile », et l’on comprend aisément pourquoi. Le problème n’est pas tant qu’il se reconnaisse lui-même comme pro-choice, mais tient à ce que la plupart des arguments pro-life sont faciles à réfuter selon une logique strictement libertarienne35. En effet, à ceux qui crieront au péché en invoquant leurs convictions religieuses, il suffira de leur répondre que la loi ne saurait se mêler de morale, et que ce sont là des questions qui relèvent des convictions intimes et des choix de vie de chacun, l’État- Léviathan ne pouvant en aucune manière s’en mêler. Mais ce qui est plus problématique encore pour les libertariens comme Rothbard, c’est qu’ils ne cessent de proclamer sur tous les tons que le droit de propriété ne souffre aucune exception, à commencer par la propriété sur soi et sur son propre corps. C’est par exemple au nom de ce principe que les libertariens défendent le droit pour un individu à faire commerce de ses organes36 ou bien qu’ils dénoncent de longue date le « puritanisme de gauche » lorsqu’il s’en prend à « toutes les formes de plaisir, déclarées à quelque degré que ce soit ‘‘dangereuses pour la santé37’’ », à l’image de ce qu’ils appellent « l’hystérie anti-tabac38 ». De la même manière, lorsqu’en 2021, avec l’épidémie de Covid, des autorités décideront des confinements, les libertariens invoqueront le droit de propriété sur son corps (donc sur sa santé) pour dénoncer les restrictions de circulation imposées au nom d’impératifs de santé publique. Comment les mêmes peuvent-ils dénier aux femmes la propriété absolue sur leur corps ?
De fait, Rothbard ne tente même pas de donner une justification théorique digne de ce nom à une position philosophique anti-avortement, mais il oriente habilement le débat vers le domaine institutionnel, voyant dans cette diversion une ruse destinée à désamorcer un conflit apparemment sans issue, lui fournissant, par là-même, de manière providentielle, cette « marge considérable pour une coalition entre les libertariens pro-choice et la droite religieuse pro-life ». Marge cruciale car un désaccord sur cette question, absolument vitale aux yeux de la droite religieuse, ruinerait sa stratégie « fusionniste ». C’est ainsi qu’il explicite ce qui a tout l’air d’un subterfuge :
« Une interdiction nationale ne fonctionnera tout simplement pas, en plus d’être politiquement impossible à faire passer en premier lieu. Les paléo-libertariens pro-choice peuvent dire aux pro-life : ‘‘Écoutez, une interdiction nationale est sans espoir. Arrêtez d’essayer de faire passer un amendement sur la vie humaine dans la Constitution. Au lieu de cela, pour cette raison et bien d’autres, nous devrions décentraliser radicalement les décisions politiques et judiciaires dans ce pays ; nous devrions mettre fin au despotisme de la Cour suprême et du système judiciaire fédéral ; et ramener les décisions politiques aux niveaux étatique et local’’. Les partisans du droit à l’avortement devraient donc espérer que l’arrêt Roe v. Wade sera un jour renversé et que les questions d’avortement seront renvoyées aux niveaux étatique et local – plus la décentralisation sera grande, mieux ce sera. Que le Kentucky et le Missouri restreignent ou interdisent l’avortement, tandis que la Californie et New York conservent le droit à l’avortement. Espérons qu’un jour, des localités de chaque État prendront de telles décisions. Le conflit sera alors largement désamorcé. Celles qui veulent avorter ou pratiquer l’avortement pourront déménager ou voyager en Californie (ou dans le comté de Marin) ou à New York (ou dans le West Side de Manhattan) ».
En d’autres termes, en renvoyant la question de la légalité de l’avortement à l’échelon local, on désamorce une querelle qui pourrait être un obstacle majeur à l’alliance entre les anarcho-capitalistes et cette « droite chrétienne [qui] compte de nombreuses personnes merveilleuses », alliance à laquelle Rothbard œuvre depuis tant d’années. L’habileté est double. Outre qu’elle évite la gageure de devoir fonder sur des principes libertariens l’interdiction de l’avortement, elle renvoie à un courant puissant au sein de la droite américaine, à savoir le rejet de l’État fédéral et la défense des États fédérés. Ces derniers semblent à tout prendre moins dangereux que « Washington D.C. » à un ennemi déclaré de tout pouvoir politique comme l’est Rothbard. C’est pourquoi il ne cesse de dire qu’il faut en « revenir au dixième amendement oublié39 », en attendant bien entendu que toute forme étatique puisse être définitivement annihilée. Ce faisant, il rejoint le combat de la puissante Federalist Society, dont nous avons déjà eu l’occasion de rappeler le rôle crucial qu’elle joue au sein de la droite américaine, puisqu’elle travaille depuis sa création en 1982 à la victoire des idées conservatrices parmi les juristes américains, par le biais notamment d’une lecture « originaliste » de la Constitution.
L’obsession du wokisme et la question des discriminations
“The Religious Right. Toward a Coalition”, op. cit.
Woman’s Own, 31 octobre 1987.
Sébastien Caré, Les libertariens aux États-Unis. Sociologie d’un mouvement asocial, op. cit.
Voir [en ligne]. On peut aussi se reporter à Matthew Hongoltz-Hetling, Chacun pour soi ! Libertariens, survivalistes, pro-armes… ours ! L’histoire vraie d’une cité idéale, Éditions Arthaud, 2023 ; et à Timothée Demeillers, Voyage au Liberland : gloire et déboires d’une aventure libertarienne au cœur de l’Europe, Éditions Marchialy, 2022.
C’est, dans le célèbre roman d’Ayn Rand, la petite vallée, située quelque part dans les montagnes du Colorado, où les grévistes emmenés par John Galt se sont regroupés, faisant sécession vis-à-vis d’une société qu’ils ne supportent plus parce qu’elle heurte leurs principes individualistes radicaux.
“On Resisting Evil”, The Rothbard-Rockwell Report, septembre 1993.
C’est aussi le nom donné à l’un des chapitres de l’anthologie de ses tribunes parues dans le The Rothbard- Rockwell Report. Rothbard intitule significativement une de ses chroniques de 1992 “Kulturkampf !”.
Si l’avortement occupe une place absolument centrale dans le combat de la droite religieuse américaine et constitue pour les paléo-libertariens une hypothèque qu’ils ne peuvent pas ne pas lever s’ils veulent concrétiser leur alliance stratégique avec les conservateurs, il est tout à fait intéressant de noter que les thèmes qui constituent aujourd’hui ce que l’on appelle la mouvance « woke » et que les courants populistes ont choisie comme leur ennemi préféré (le discours de Milei que nous publions en témoigne à l’envi), étaient déjà présents il y a quarante ans. Ainsi, dès la publication, en 1982, de son Éthique de la liberté, Rothbard s’en prend au « Nouveau Puritanisme » qui fait selon lui « bon ménage avec la Victimologie Officielle, puisqu’il s’accompagne d’une censure sociale, et même légale, contre certaines recherches scientifiques, ou l’expression d’opinions qui pourraient, dans la terminologie officielle, ‘‘heurter’’ ou simplement ‘‘négliger’’ la sensibilité des Communautés de victimes ». Il entend donc, dès cette époque, mener un combat sans merci contre ce qu’il appelle « la Nouvelle Pensée Officielle », y mettant une « rudesse » et une « verve », dont il regrette qu’elle ne soit « désormais socialement permises que si elles ont pour cible le mâle blanc chrétien ». Soit la base même de ce qui est devenu aujourd’hui l’électorat de Donald Trump. Un électorat blanc, masculin et chrétien que Rothbard reprochait déjà à la gauche libérale américaine de présenter comme le grand « Oppresseur » des Noirs, des natives, des femmes, des gays, ou même tout simplement de « l’environnement ».
On le voit : tous les thèmes des contempteurs du « wokisme » sont déjà présents, et Rothbard multiplie dans de très nombreux textes les attaques contre les mesures antidiscriminatoires, qu’elles concernent les minorités raciales aussi bien que sexuelles. L’argument invoqué est toujours celui de la liberté, qu’il s’agisse de la liberté d’expression pour justifier les propos racistes ou homophobes, ou de la liberté de contrat pour condamner les mesures pénalisant les discriminations à l’embauche.
« La bataille se joue aujourd’hui sur un terrain très différent. Elle porte sur les lois ‘‘anti-discriminatoires’’, qui rendent illégaux le travail, l’embauche ou l’association en fonction de l’orientation sexuelle ou de l’anti-orientation sexuelle. Dans le cas des homosexuels, comme dans le cas des Noirs, des femmes, des hispaniques, des ‘‘handicapés’’ et d’innombrables autres groupes victimologiques visés par les mesures ‘‘anti-discriminatoires’’, on découvre de nouveaux ‘‘droits’’ égalitaires qui sont censés être appliqués par la majesté de la loi. En premier lieu, ces ‘‘droits’’ sont inventés aux dépens des droits réels de chaque personne sur sa propre propriété ; en second lieu, tout ce discours sur les ‘‘droits’’ n’a aucune pertinence, puisque le problème de l’embauche, du licenciement, de l’association, etc. est une question qui doit être résolue par les personnes et les institutions elles-mêmes, sur la base de ce qui convient le mieux à l’organisation concernée. Les ‘‘droits’’ n’ont rien à voir avec cette affaire. Troisièmement, la Constitution a été systématiquement pervertie pour abandonner un gouvernement minimal strictement limité au profit d’une croisade menée par les tribunaux fédéraux pour multiplier et faire respecter ces faux droits jusqu’au bout. Sur la fausseté des discours sur les droits dans ces domaines : supposons que je décide d’ouvrir un restaurant chinois. Je prends la décision commerciale consciente de n’embaucher que des serveurs chinois qui parlent chinois et anglais, car je veux attirer une clientèle majoritairement chinoise. Ne devrais-je pas avoir le droit d’utiliser ma propriété pour n’embaucher que des serveurs chinois ? Le même type de décision commerciale devrait être juste et ne pas être contesté si je souhaite embaucher uniquement des hommes, uniquement des femmes, uniquement des Noirs, uniquement des blancs, uniquement des homosexuels, uniquement des hétéros, etc40 ».
La logique purement libertarienne de cette argumentation – que l’on retrouve dans la défense d’une liberté d’expression absolue – peut paraître imparable, mais à l’unique condition qu’on en accepte également la conclusion logique. En effet, admettre que chacun puisse dire publiquement absolument tout ce qu’il veut, ou bien exclure qui il entend de ses relations sociales, c’est oublier que l’homme, qu’il le veuille ou non, vit en société, et que la question de la cohabitation entre individus nécessairement animés de valeurs et de projets de vie différents ne peut se régler sur la seule base du droit à se défendre en cas d’attaque physique (en vertu de l’axiome de non-agression déjà évoqué). Admettre que chacun est libre d’exclure l’autre de sa sociabilité dès lors que l’on ne porte pas atteinte à son intégrité physique, c’est entrer dans une logique de ségrégation dont on ne voit pas très bien quelles sont les limites. Nous avons vu que les libertariens comme Rothbard s’accommoderaient parfaitement de l’interdiction de l’avortement dans certains États, dès lors que les femmes auraient la possibilité d’aller s’installer dans des États ou des comtés qui continueraient de le pratiquer. Mais alors pourquoi ne pas imaginer également que les Noirs américains, ou les Gays américains, ou les Démocrates, aillent tous s’installer en Californie ou à New York afin de pouvoir s’y marier et y vivre selon les valeurs qui sont les leurs ? Selon une stricte logique libertarienne, cette ségrégation de fait serait parfaitement acceptable, dans la mesure où ils radicalisent la célèbre déclaration de Margaret Thatcher selon laquelle « la société, ça n’existe pas », mais en revanche « il y a des hommes, des femmes et des familles41 ». Que le propos ait largement dépassé la pensée de Margaret Thatcher (qui était plus conservatrice que libérale), c’est là un point qui pourrait être discuté. Je doute en effet que l’ancienne Première ministre britannique ait jamais remis en cause le fait qu’il y eût une société britannique, par exemple lorsqu’il s’est agi d’aller reconquérir les Malouines pour les restituer à la Couronne, mais là n’est pas notre propos. Cette conception purement atomistique de la société est en revanche parfaitement conforme à une pensée libertarienne extrémiste qui pousse jusqu’au bout la logique de la souveraineté absolue de l’individu, au point d’aboutir à ce que Sébastien Caré a très justement appelé un « mouvement asocial42 ». À ceci près qu’une telle vision est purement et simplement fausse, puisque toute l’histoire de l’humanité la dément. Ni plus ni moins. Nul en effet n’a jamais vu dans l’histoire un quelconque Robinson sur son île, ni même du reste une quelconque communauté de Robinsons ayant décidé de cohabiter entre eux sur la stricte base d’un règlement de copropriété. Car telle est bien l’utopie libertarienne, et comme toute utopie, elle est basée sur le rêve et sur un pur déni de réalité.
Ce qui ne veut pas dire que les fantasmagories ne puissent pas avoir de puissants effets sociaux. Sans même parler des exotiques tentatives de militants anarcho-capitalistes pour fonder sur quelque île déserte ou territoire perdu un Liberland aux allures de Disneyland libertarien43, c’est un fait que l’on voit déjà, çà et là aux États-Unis, certains citoyens quitter leur État pour un autre afin de pouvoir n’y côtoyer que des gens qui partagent leurs valeurs (chrétiennes conservatrices pour l’immense majorité d’entre eux). Ils appliquent du reste là une logique qui n’est pas très différente de celle qui a cours sur les réseaux sociaux, où l’on peut choisir librement ses « amis », et exclure de son cercle social quiconque ne pense pas comme soi, créant ainsi des bulles de filtres aux effets de radicalisation tout à fait redoutables. Mais comment ne pas voir qu’il s’agit là d’une logique terrifiante, qui contredit plusieurs principes libéraux fondamentaux ? D’abord, cette ségrégation ne saurait être volontaire pour tout le monde, et obliger quelqu’un à partir vivre ailleurs parce que les habitants de sa région d’origine ne partagent pas ses valeurs ou ses idées et font régner une pression morale devenue insupportable, c’est violer purement et simplement un droit fondamental. De plus, entériner cette logique, c’est aussi admettre pour la majorité le droit d’imposer ses idées à la minorité, ce qui là encore est contraire au cœur même de la philosophie libérale, qui fait – nous l’avons dit – de la défense des minorités (et de la plus petite des minorités qu’est l’individu) un principe intangible.
Enfin, comment ne pas voir que cette logique est porteuse d’un risque de guerre civile dès lors que l’on renonce à ce qui fait l’essence même de la loi dans un régime de liberté : permettre à des individus ayant des intérêts et des choix de vie différents de cohabiter pacifiquement ?
Ce dilemme entre ségrégation et guerre civile larvée est du reste parfaitement identifié et assumé par Rothbard, qui a comme souvent le mérite d’aller au fond des choses. Il écrit en effet dans un texte de septembre 1993, intitulé : ‘‘On Resisting Evil’’ :
« Dans les mouvements conservateurs et libertariens, il y a eu deux formes principales de capitulation, d’abandon de la cause. La forme la plus courante et la plus évidente est celle que nous connaissons tous trop bien : la capitulation. […] Dans cette forme, qui est courante dans le mouvement libertaire mais qui est également répandue dans certains secteurs du conservatisme, le militant décide que la cause est sans espoir et abandonne en décidant de quitter le monde corrompu et pourri, et de se retirer d’une manière ou d’une autre dans une communauté pure et noble qui lui soit propre. Pour les Randiens, c’est “le Ravin de Galt44”, tiré du roman de Rand, Atlas Shrugged. D’autres libertariens continuent de chercher à former une communauté clandestine ; à ‘‘capturer’’ une petite ville de l’Ouest, à entrer dans la ‘‘clandestinité’’, dans la forêt, ou même à construire un nouveau pays libertaire sur une île, dans les collines, ou ailleurs. Les conservateurs ont leurs propres formes de retraitisme. Dans chaque cas, l’appel surgit d’abandonner le monde pervers et de former une petite communauté alternative dans une retraite au fin fond des bois. Il y a longtemps, j’ai qualifié cette vision de ‘‘retraitisme’’. On pourrait qualifier cette stratégie de ‘‘néo-Amish’’, sauf que les Amish sont des agriculteurs productifs et que ces groupes, je le crains, n’atteignent jamais ce stade. […] Notre position devrait être, selon les mots célèbres de Dos Passos, même s’il les a prononcés en tant que marxiste, ‘‘d’accord, nous sommes deux nations’’. L’Amérique telle qu’elle existe aujourd’hui, ce sont deux nations : l’une est leur nation, la nation de l’ennemi corrompu, de Washington D.C., de leur système scolaire public de lavage de cerveau, de leurs bureaucraties, de leurs médias, et l’autre est notre nation, beaucoup plus grande, la nation majoritaire, la nation bien plus noble qui représente l’Amérique plus ancienne et plus vraie. Nous sommes la nation qui va gagner, qui va reprendre l’Amérique, peu importe le temps que cela prendra. C’est en effet un grave péché d’abandonner cette nation et cette Amérique sans victoire45 ».
Deux solutions, on le voit : la sécession à la mode John Galt, le héros randien de La Grève, ou bien l’affrontement idéologique sans merci, avec la volonté déterminée de gagner la bataille culturelle46 en imposant ses valeurs au camp minoritaire, selon une logique autoritaro-populiste parfaitement illibérale.
Discours de Javier Milei à Davos (janvier 2025)
Ce qui ne veut pas dire que l’Argentine n’ait pas connu des expériences économiques que l’on peut qualifier de libérales. Mais nous avons suffisamment montré à quel point le libéralisme et l’anarcho-capitalisme ne peuvent en aucun cas être considérés comme synonymes.
Juan Gonzalez, El Loco. Javier Milei, El Hombre que Obedece a su Perro, Ediciones Península, 2024.
Pablo Stefanoni, « Javier Milei en 10 phrases choc : le paléolibertarien qui veut prendre l’Argentine », op. cit.
Javier Milei, “Capitalism, Socialism, and the Neoclassical Trap”, in D. Howden, P. Bagus, (eds), The Emergence of a Tradition. Essays in Honor of Jesús Huerta de Soto, Volume II. Palgrave Macmillan.
David Copello, « L’inquiétante étrangeté du président Milei », La Vie des idées, 12 décembre 2023.
Cela n’a pas empêché Javier Milei de promettre très récemment au Simon Wiesenthal Center d’ouvrir les archives liées aux réseaux clandestins qui ont permis à des milliers de nazis (dont Eichmann et Mengele), de fuir l’Europe après la Deuxième Guerre mondiale et de se réfugier en Amérique latine (et notamment en Argentine).
Nous avons beaucoup insisté jusqu’ici sur l’influence des idées libertariennes venues des États-Unis dans l’espoir de mieux percevoir quelle est la cohérence profonde de la vision du monde et de la société que développe Javier Milei, qui préside depuis 2023 aux destinées d’un pays dans lequel ces idées étaient jusqu’à son élection extraordinairement marginales47. Toutefois, avant de lire le discours que le président argentin a tenu à Davos en janvier 2025 et qui s’avère parfaitement emblématique des thèses économiques radicales et des valeurs conservatrices qu’il défend, il convient au préalable de préciser quelques éléments de contexte, touchant à sa vie même et à sa personnalité haute en couleurs, mais aussi à l’histoire politique, si singulière, de son pays l’Argentine.
Intellectuel public connu pour ses redoutables talents de débatteur, il n’hésite pas à recourir à l’invective et à la grossièreté, multipliant les outrances au point de se forger une solide réputation d’anticonformisme, et même d’excentricité. Une réputation qui ne tient pas qu’à son style provocateur, mais tout autant – sinon plus encore – aux idées disruptives qu’il défend publiquement, de la libéralisation de la vente d’armes et d’organes, à la privatisation des rues, en passant par la possibilité de créer, un jour, un marché libre pour la vente d’enfants.
Surnommé El Loco48 (le fou), Milei fait figure de trublion antisystème, suffisamment provocant pour oser qualifier le Pape (argentin, comme chacun sait, mais surtout contempteur des inégalités sociales engendrées par le capitalisme) d’« idiot » et de « représentant du Malin sur terre49 ». Et ce, alors que lui-même aime à citer la Bible pour étayer ses critiques envers l’État, à l’image du libertarien espagnol Jesús Huerta de Soto, à qui il a publiquement rendu hommage dans un ouvrage collectif paru en 202350. Milei a aussi exprimé son désir de se convertir au judaïsme et de devenir ainsi le premier président juif d’Argentine. L’homme est par ailleurs un adepte fervent des sciences occultes, puisqu’il se serait rapproché des sectateurs du paranormal à la suite de la mort de son chien en 2017, décidant même de faire cloner ce dernier, tout en essayant d’entrer en contact télépathique avec lui51. Son animal de compagnie ne serait du reste pas son seul interlocuteur, puisqu’il prétendrait entrer également en contact avec certaines de ses idoles décédées, comme les penseurs libertariens Ayn Rand et Murray Rothbard. De telles bizarreries pourraient évidemment prêter à sourire, si elles ne s’inscrivaient pas dans un pays, l’Argentine, où les relations entre spirituel, paranormal et politique ne sont pas totalement inédites. Le pays a en effet connu un précédent célèbre en la personne du général Juan Perón qui, quelques semaines avant le décès de sa deuxième épouse, Eva, la fit déclarer par le Congrès « Cheffe Spirituelle de la Nation », avant de faire embaumer son corps pour pouvoir l’exposer dans un mausolée public. Le coup d’État militaire de 1955 empêchera la réalisation de ce projet mais le même Perón, redevenu président après 18 ans d’exil, prit comme secrétaire personnel, José López Rega, un homme bien connu pour ses affinités avec le spiritisme et l’astrologie. Celui qui était alors surnommé El Brujo (le sorcier) eut un ascendant considérable sur le chef de l’État qui, comme nous allons le voir, a laissé une marque indélébile sur l’histoire de son pays.
Mais revenons-en à Javier Milei. L’intellectuel médiatique et iconoclaste décide de s’engager dans la politique active en 2020. Quelques mois plus tôt, en août 2019, il avait rejoint le « Parti libertarien » (Partido Libertario), créé un an plus tôt. En septembre 2021, Milei crée la surprise dans la province de Buenos Aires en rassemblant 13,7% des voix, lors des primaires, à l’issue d’une campagne durant laquelle il a inlassablement dénoncé une « caste politique » constituée de « politiques inutiles, parasites, qui n’ont jamais travaillé ». Semblant appliquer rigoureusement la stratégie populiste théorisée par son idole Rothbard, le discours de Javier Milei trouve alors un écho certain, aussi bien chez les électeurs de la droite radicale que dans les classes populaires épuisées par la crise économique. Autant de citoyens exaspérés qui plus est par des mois de confinement, et qui se laissent volontiers séduire par cet outsider dans lequel ils veulent voir une alternative aux partis traditionnels, dont ils estiment qu’ils ont failli.
Devenu député en décembre 2021, Milei trouve une nouvelle manière de transgresser les règles du jeu politique traditionnel et de faire parler de lui en mettant en jeu chaque mois son salaire, lors d’une tombola géante, à laquelle participent plus d’un million d’Argentins. En 2023, il est candidat à l’élection présidentielle avec un programme radical, prévoyant notamment la diminution drastique des dépenses publiques. Il apparaît ainsi en meeting, une tronçonneuse à la main, afin de symboliser sa farouche volonté de tailler de manière drastique dans les dépenses publiques, en commençant par supprimer certains ministères inutiles (comme celui de l’Éducation et celui de la Santé…). Il promet également la suppression de la Banque centrale et la dollarisation de l’économie argentine afin de vaincre le mal endémique argentin qu’est l’inflation. Il crée enfin la polémique en choisissant comme colistière Victoria Villarruel, incarnation de la droite dure, régulièrement accusée de nier les crimes de la dictature militaire sanglante des années 1976-198352.
Au soir du premier tour de l’élection présidentielle, le 22 octobre 2023, Milei arrive en deuxième position, avec 29,99% des voix, derrière le centriste Sergio Massa, soutenu par la coalition péroniste sortante. Le candidat libertarien s’allie alors avec la droite conservatrice en vue du second tour, rompant ainsi avec sa stratégie dégagiste antérieure, qui englobait droite traditionnelle et gauche péroniste dans son rejet de la « caste » politique. Cette stratégie d’alliance est alors vécue comme une trahison par une partie de ses troupes, mais elle lui permet néanmoins de l’emporter confortablement, avec plus de 55% des voix, faisant démentir les sondages qui annonçaient un scrutin serré.
Un pays marqué par l’héritage populiste du péronisme
Il a exercé trois mandats : 1946-1952, 1952-1955 et 1973-1974 (date de sa mort).
Il ne fut d’ailleurs jamais un phénomène de classe puisqu’il a toujours cherché à réconcilier les couches populaires et la bourgeoisie active en les unifiant par un discours nationaliste.
Candidat au premier tour de l’élection présidentielle de 2003, l’ancien président Carlos Menem propose alors un plan de dollarisation de l’économie argentine, ce qui ne l’empêche pas de recueillir plus de 24% des voix. C’est là, on le sait, une idée qui sera reprise par Javier Milei, qui considère que « le premier mandat de Menem a été le meilleur de toute l’histoire argentine ». Cf. Pablo Stefanoni, « Javier Milei en 10 phrases… », op. cit.
Le fait est que le libéralisme et la démocratie ont toujours eu des relations compliquées, comme le montre très bien le lumineux petit livre de Norberto Bobbio, Libéralisme et Démocratie, Paris, éditions du Cerf, 1996.
On ne peut ni comprendre cette victoire de Javier Milei ni la radicalité des idées qui l’ont porté au pouvoir, si l’on ne se souvient pas que l’Argentine est un pays dont l’histoire politique est tout à fait singulière, avec un passé populiste qui n’est pas sans importance, s’agissant notamment de la question centrale du rôle de l’État dans l’économie. De fait, la victoire surprise de Javier Milei ne peut s’entendre si l’on ne tient pas compte du contexte économique et politique particulier dans lequel elle a eu lieu. Le contexte immédiat d’abord, avec une situation économique désastreuse marquée par un taux de pauvreté dépassant les 40%, une inflation galopante – une plaie très ancienne en Argentine, mais que le pays n’avait plus connue à un tel degré de gravité depuis les années 1990 –, ainsi qu’une dette publique abyssale. Le contexte politique ensuite, qui suppose de prendre un peu de recul historique. Milei succède au président Alberto Fernández en battant au second tour Sergio Massa, soit deux hommes qui incarnent un courant politique protéiforme mais essentiel dans l’histoire politique argentine : le péronisme.
Il ne saurait être question d’en retracer l’histoire, fût-ce de manière succincte, mais quelques rappels sont néanmoins nécessaires tant nous avons affaire ici à une spécificité argentine décisive pour comprendre la rupture que représente la victoire de Milei. Incarnation la plus fameuse du populisme latino-américain, le péronisme renvoie d’abord à une figure historique, Juan Domingo Perón (1895-1974), un militaire devenu Président à trois reprises53 en s’appuyant sur les masses populaires face à une armée encline en Amérique latine à soutenir les intérêts des classes possédantes au nom de l’ordre social. Entre 1946 et 1949, Juan Perón organisa une redistribution sociale massive en faveur des classes populaires, et gagna ainsi rapidement le soutien des plus modestes, et notamment des ouvriers. La revendication de justice sociale fut donc un puissant moteur du péronisme qui a toujours cherché à s’appuyer directement sur le peuple, instaurant une forme de pouvoir charismatique, au point d’incarner comme nul autre le paradigme populiste latino-américain. Mais si Juan Perón a privilégié sa relation avec les masses, il a été puissamment aidé dans cette entreprise par sa seconde épouse, Eva. Décédée d’une leucémie en 1952, cette dernière (surnommée « Evita ») fut adulée par une partie de la population, de son vivant et après sa mort, au point qu’il n’est pas exagéré de parler à son propos d’un véritable culte de la personnalité. Reste que la doctrine péroniste a aussi été une modalité de la modernisation de l’Argentine, avec la promotion de l’industrie face aux intérêts des grands propriétaires terriens, l’affirmation d’un État fort et centralisé, et la revendication d’une neutralité internationale, puisque le péronisme entendait représenter une troisième voie entre capitalisme et socialisme. Renversé par un putsch militaire en 1955, Perón fut condamné à l’exil mais parvint à se faire réélire en 1973, avant de mourir un an plus tard. Sa troisième épouse, Isabel, lui succéda alors en tant que vice-présidente, et poursuivit son œuvre politique en s’appuyant sur le parti qu’il avait créé en 1947 et qui prit le nom de « parti justicialiste » en 1971. L’expérience fut interrompue par la dictature militaire qui dura de 1976 à 1983, faisant plus de 30.000 « disparus », sans oublier la désastreuse guerre des Malouines qui provoqua sa chute. Après le retour de la démocratie, le péronisme connut une profonde transformation puisqu’il s’incarna aussi bien dans des expériences économiquement libérales (comme entre 1989 et 1999 sous la présidence de Carlos Menem) que dans des expériences de gauche (comme entre 2003 et 2015 avec les gouvernements de Nestor et Cristina Kirchner). On le voit, le péronisme est un phénomène politique relativement complexe qu’il est assez difficile de situer sur l’échiquier politique54. Reste que son héritage populiste (qui est un phénomène plus large propre à toute une partie de l’Amérique latine) et économique (avec des problèmes endémiques comme l’inflation) est essentiel pour comprendre le sens de l’élection de Milei.
De ce point de vue, il serait insuffisant de dire que ce dernier est simplement « anti-péroniste ». En effet, Milei admet volontiers être un admirateur du premier mandat de Carlos Menem, lorsque celui-ci a engagé au début des années 1990 une politique « néo-libérale » destinée à lutter drastiquement contre l’inflation en imposant une parité fixe entre le peso argentin et le dollar55. Reste que cette cure libérale a provoqué une très vive réaction populaire, conduisant une partie de la gauche argentine à adopter le slogan dégagiste « qu’ils s’en aillent tous ! », montrant par là-même que la dénonciation virulente de la caste politique au pouvoir n’est, en Argentine, ni une invention de Milei, ni l’apanage de l’extrême droite.
Il est un dernier point, qui mérite d’être signalé. C’est le fait que Javier Milei a adopté une vision décadentiste de l’Argentine, invoquant fréquemment l’âge d’or du pays, pour le situer avant… 1916. C’est-à-dire durant la période dite de la « République conservatrice » (1880-1916), pendant laquelle l’économie du pays se développa fortement, au point de figurer alors parmi les dix premières puissances mondiales en termes de PIB. Cette prospérité était fondée sur la conquête de vastes terres agricoles encore vierges, mais aussi sur la modernisation de l’économie à la faveur d’une intégration poussée dans l’économie mondiale (c’est l’époque de ce que les historiens appellent la « première mondialisation »), avec un développement substantiel des investissements étrangers et des exportations (surtout agricoles). Sans oublier l’arrivée massive d’immigrants européens. On comprend que cette période puisse susciter la nostalgie d’un Javier Milei, qui juge que cette prospérité était d’abord le résultat d’un État modeste, sachant se cantonner à ses missions régaliennes, laissant les acteurs privés libres d’engager la modernisation du pays. Au risque de fortes inégalités sociales, et même si l’économie échouait à prendre le chemin de l’industrialisation, s’orientant vers l’exportation quasi exclusive de matières premières, notamment agricoles. Définir l’Argentine d’avant 1916 comme un âge d’or, c’est enfin oublier que cette date est aussi celle de l’instauration du suffrage universel. Comme si la démocratie était une partie du problème56.
JAVIER MILEI – Discours prononcé à Davos, le 25 janvier 2025
| « Bonjour à tous. Combien de choses ont changé en si peu de temps ! Il y a un an, je me tenais ici, devant vous, dans la solitude, et j’ai dit quelques vérités sur l’état du monde occidental qui ont été accueillies avec surprise et étonnement par une grande partie de l’establishment politique, économique et médiatique occidental. Et je dois admettre que, dans un sens, je comprends. Un président d’un pays qui, en raison d’un échec économique systématique pendant plus de 100 ans, de positions pusillanimes dans les principaux conflits mondiaux et d’une fermeture au commerce, a perdu pratiquement toute pertinence internationale au fil des ans… Un président de ce pays monte à cette tribune et dit au monde entier qu’ils ont tort, qu’ils vont à l’échec, que l’Occident s’est égaré et qu’il faut le remettre sur la bonne voie. Un président de ce pays, l’Argentine, qui n’était pas un homme politique, qui n’avait aucun soutien législatif, qui n’avait aucun soutien de la part des gouverneurs, des hommes d’affaires ou des groupes de médias. Dans ce discours, ici, devant vous, je vous ai dit que c’était le début d’une nouvelle Argentine, que l’Argentine avait été infectée par le socialisme pendant trop longtemps et qu’avec nous, elle allait embrasser à nouveau les idées de la liberté, un modèle que nous résumons dans la défense de la vie, de la liberté et de la propriété privée. Je vous ai également dit qu’en un sens, l’Argentine était le spectre du futur Noël de l’Occident, car nous avions déjà vécu tout ce que vous viviez et nous savions déjà comment cela se terminerait. Un an plus tard, je dois dire que je ne me sens plus si seul, je ne me sens plus si seul parce que le monde a embrassé l’Argentine. L’Argentine est devenue un exemple mondial de responsabilité fiscale, de respect de nos obligations, de la façon de mettre fin au problème de l’inflation et aussi d’une nouvelle façon de faire de la politique, qui consiste à dire la vérité en face des gens et à faire confiance aux gens pour qu’ils comprennent.
Je ne me sens pas non plus seul, car tout au long de cette année, j’ai pu trouver des camarades dans cette lutte pour les idées de la liberté aux quatre coins de la planète. Du merveilleux Elon Musk à la féroce dame italienne, ma chère amie, Giorgia Meloni ; de Bukele au Salvador à Victor Orbán en Hongrie ; de Benjamin Netanyahou en Israël à Donald Trump aux États-Unis. Lentement, une alliance internationale de toutes les nations qui veulent être libres et qui croient aux idées de liberté s’est formée. Et lentement, ce qui semblait être une hégémonie mondiale absolue de la gauche en politique, dans les institutions éducatives, dans les médias, dans les organismes supranationaux ou dans des forums tels que Davos, s’est fissuré et l’espoir pour les idées de la liberté commence à émerger. Je suis ici aujourd’hui pour vous dire que notre bataille n’est pas gagnée, que si l’espoir renaît, il est de notre devoir moral et de notre responsabilité historique de démanteler l’édifice idéologique du wokisme maladif. Tant que nous n’aurons pas réussi à reconstruire notre cathédrale historique, tant que nous n’aurons pas réussi à faire en sorte que la majorité des pays occidentaux embrasse à nouveau les idées de liberté, tant que nos idées ne seront pas devenues la monnaie courante dans les couloirs d’événements comme celui-ci, nous ne pouvons pas abandonner car, je dois le dire, des forums comme celui-ci ont été les protagonistes et les promoteurs du sinistre agenda du wokisme qui fait tant de mal à l’Occident. Si nous voulons changer, si nous voulons vraiment défendre les droits des citoyens, nous devons commencer par leur dire la vérité. Et la vérité, c’est qu’il y a quelque chose de profondément erroné dans les idées qui ont été promues dans des forums comme celui-ci. Je voudrais prendre quelques minutes, aujourd’hui, pour en discuter. Peu de gens aujourd’hui nient que le vent du changement souffle sur l’Occident. Il y a ceux qui résistent au changement, ceux qui l’acceptent à contrecœur mais qui finissent par l’accepter, les nouveaux convertis qui apparaissent lorsqu’ils le considèrent comme inévitable et, enfin, ceux d’entre nous qui se sont battus toute leur vie pour son avènement. Chacun d’entre vous saura dans quel groupe il se reconnaît, il y a sûrement un peu de chaque dans cette assemblée, mais tous reconnaîtront certainement que le temps du changement frappe à la porte. Les moments de changement historique ont une particularité : ce sont des moments où les formules en place depuis des décennies sont épuisées, où les façons de faire qui étaient considérées comme uniques cessent d’avoir un sens et où ce qui, pour beaucoup, était des vérités incontestables est finalement remis en question. C’est une époque où les règles sont réécrites et où l’on récompense ceux qui ont le courage de prendre des risques. Mais une grande partie du monde libre préfère encore le confort du connu, même si c’est la mauvaise voie, et s’obstine à appliquer les recettes de l’échec. Et la grande enclume qui apparaît comme un dénominateur commun dans les pays et les institutions qui échouent, c’est le virus mental de l’idéologie woke. C’est la grande épidémie de notre époque qu’il faut soigner, c’est le cancer qu’il faut éliminer. Cette idéologie a colonisé les institutions les plus importantes du monde, depuis les partis et les États des pays libres de l’Occident jusqu’aux organisations de gouvernance mondiale, en passant par les institutions non gouvernementales, les universités et les médias, et a façonné le cours de la conversation mondiale au cours des dernières décennies. Tant que nous n’aurons pas éliminé cette idéologie aberrante de notre culture, de nos institutions et de nos lois, la civilisation occidentale et même l’espèce humaine ne pourront pas retrouver la voie du progrès qu’exige notre esprit pionnier. Il est indispensable de briser ces chaînes idéologiques si nous voulons entrer dans un nouvel âge d’or. C’est pourquoi je souhaite consacrer quelques minutes aujourd’hui à briser ces chaînes, mais parlons d’abord de ce pour quoi nous nous battons. L’Occident représente le sommet de l’espèce humaine, le terreau fertile de son héritage gréco-romain et de ses valeurs judéo-chrétiennes a planté les graines de quelque chose d’inédit dans l’histoire. En s’imposant définitivement face à l’absolutisme, une nouvelle ère de l’existence humaine s’est ouverte. Dans ce nouveau cadre moral et philosophique qui plaçait la liberté individuelle au-dessus des caprices du tyran, l’Occident a pu libérer la capacité créatrice de l’humanité, lançant un processus de création de richesses jamais vu auparavant. Les données parlent d’elles-mêmes : jusqu’en 1800, le PIB mondial par habitant est resté pratiquement constant. Toutefois, à partir du xIxe siècle et grâce à la révolution industrielle, le PIB par habitant a été multiplié par 20, ce qui a permis à 90% de la population mondiale de sortir de la pauvreté alors que la population avait été multipliée par huit. Cela n’a été possible que grâce à une convergence de valeurs fondamentales, le respect de la vie, de la liberté et de la propriété, qui a rendu possible le libre-échange, la liberté d’expression, la liberté de religion et les autres piliers de la civilisation occidentale. À cela s’ajoute notre esprit faustien, inventif, explorateur, pionnier, qui teste sans cesse les limites du possible. Un esprit pionnier qui est aujourd’hui représenté, entre autres, par mon cher ami Elon Musk, qui a été injustement vilipendé par le wokisme, ces dernières heures, pour un geste innocent qui ne fait que signifier sa gratitude envers le peuple. En résumé, nous avons inventé le capitalisme sur la base de l’épargne, de l’investissement, du travail, du réinvestissement et du travail acharné. Nous avons permis à chaque travailleur de multiplier sa productivité par 10, 100 ou même 1000, déjouant ainsi le piège malthusien. Cependant, à un moment donné du xxe siècle, nous nous sommes égarés et les principes libéraux qui nous avaient rendus libres et prospères ont été trahis. Une nouvelle classe politique, sous des idéologies collectivistes, et profitant des moments de crise, a vu une occasion parfaite d’accumuler du pouvoir. Toute la richesse créée par le capitalisme jusqu’alors et à l’avenir serait redistribuée dans le cadre d’un plan centralisé, donnant ainsi le coup d’envoi d’un processus dont nous subissons aujourd’hui les conséquences désastreuses. Poussant un programme socialiste, mais opérant insidieusement au sein du paradigme libéral, cette nouvelle classe politique a déformé les valeurs du libéralisme. Elle a remplacé la liberté par la libération, en utilisant le pouvoir coercitif de l’État pour distribuer la richesse créée par le capitalisme. Leur justification était l’idée sinistre, injuste et aberrante de justice sociale, complétée par des cadres théoriques marxistes visant à libérer l’individu de ses besoins. Et au cœur de ce nouveau système de valeurs, le postulat fondamental selon lequel l’égalité devant la loi ne suffit pas, car il existe des injustices de base cachées qui doivent être corrigées, représente une mine d’or pour les bureaucrates qui aspirent à la toute-puissance. Voilà ce qu’est fondamentalement le wokisme, le résultat de l’inversion des valeurs occidentales. Chacun des piliers de notre civilisation a été transformé en une version déformée de lui-même par l’introduction de divers mécanismes de sa version culturelle. Des droits négatifs à la vie, à la liberté et à la propriété, nous sommes passés à un nombre artificiellement infini de droits positifs. Ce fut d’abord l’éducation, puis le logement, et de là, des choses dérisoires comme l’accès à Internet, au football télévisé, au théâtre, aux soins esthétiques et à une foule d’autres désirs ont été transformés en droits humains fondamentaux, des droits que, bien sûr, quelqu’un doit payer. Et qui ne peuvent être garantis que par l’expansion infinie de l’État aberrant. En d’autres termes, du concept de liberté comme protection fondamentale de l’individu contre l’intervention du tyran, nous sommes passés au concept de libération par l’intervention de l’État. C’est sur cette base que s’est construit le wokisme, un régime de pensée unique, soutenu par différentes institutions dont le but est de criminaliser la dissidence. Le féminisme, la diversité, l’inclusion, l’égalité, l’immigration, l’avortement, l’environnementalisme, l’idéologie du genre, entre autres, sont autant de têtes d’une même créature dont le but est de justifier l’avancée de l’État par l’appropriation et la déformation de nobles causes. Examinons-en quelques-unes. Le féminisme radical est une distorsion du concept d’égalité et, même dans sa version la plus bienveillante, il est redondant, puisque l’égalité devant la loi existe déjà en Occident. Tout le reste n’est que recherche de privilèges, et c’est ce que le féminisme radical vise en réalité, en opposant une moitié de la population à l’autre alors qu’elles devraient être du même côté. Nous allons même jusqu’à normaliser le fait que, dans de nombreux pays prétendument civilisés, si vous tuez une femme, cela s’appelle un féminicide, et que cela entraîne une peine plus lourde que si vous tuez un homme, simplement en raison du sexe de la victime. Inscrire de fait dans la loi que la vie d’une femme vaut plus que celle d’un homme, brandir l’étendard de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes… Lorsque l’on examine les données, il est clair qu’il n’y a pas d’inégalité pour une même tâche, mais que la plupart des hommes ont tendance à avoir des métiers qui payent mieux que la plupart des femmes. Pourtant, ils ne se plaignent pas que la majorité des prisonniers soient des hommes, ni que la majorité des plombiers soient des hommes, ni que la majorité des victimes de vols ou de meurtres soient des hommes, et encore moins que la majorité des personnes tuées dans les guerres soient des hommes. Mais si l’on soulève ces questions, nous sommes traités de misogynes dans les médias ou même dans ce forum, simplement pour avoir défendu un principe élémentaire de la démocratie moderne et de l’État de droit, à savoir l’égalité devant la loi et les données. Le wokisme se manifeste en outre dans le sinistre écologisme radical et la bannière du changement climatique. Préserver notre planète pour les générations futures est une question de bon sens – personne ne veut vivre dans une poubelle. Mais là encore, le wokisme a réussi à pervertir cette idée élémentaire de préservation de l’environnement pour le plaisir des êtres humains, et nous sommes passés à un environnementalisme fanatique où l’homme est un cancer qu’il faut éliminer, et où le développement économique n’est rien de moins qu’un crime contre la nature. Cependant, lorsque l’on affirme que la Terre a déjà connu cinq cycles de changements brusques de température et que, dans quatre d’entre eux, l’homme n’existait même pas, on nous traite de complotiste afin de discréditer nos idées, sans tenir compte du fait que la science et les données sont de notre côté. Ce n’est pas une coïncidence si ces mêmes personnes sont les principaux promoteurs de l’agenda sanguinaire et meurtrier de l’avortement, un agenda conçu sur la base du postulat malthusien selon lequel la surpopulation détruira la terre et que nous devons donc mettre en œuvre un mécanisme de contrôle de la population. En réalité, ce principe a déjà été adopté, à tel point que le taux de croissance de la population sur la planète commence aujourd’hui à poser un problème. Quelle tâche ils se sont assignée avec ces aberrations de l’avortement ! Depuis ces forums est promu l’agenda LGBT, voulant nous imposer que les femmes sont des hommes et que les hommes ne sont des femmes que si c’est ainsi qu’ils s’autoperçoivent, et ils ne disent rien lorsqu’un homme se déguise en femme et tue son rival sur un ring de boxe ou lorsqu’un prisonnier prétend être une femme et finit par violer toutes les femmes qui croisent son chemin en prison. Sans aller plus loin, il y a quelques semaines, le cas de deux homosexuels américains qui, en arborant le drapeau de la diversité sexuelle, ont été condamnés à 100 ans de prison pour avoir abusé et filmé leurs enfants adoptifs pendant plus de deux ans, a fait la une des journaux du monde entier. Je tiens à préciser que lorsque je parle d’abus, il ne s’agit pas d’un euphémisme, car dans ses versions les plus extrêmes, l’idéologie du genre constitue une véritable maltraitance des enfants. Ce sont des pédophiles, je veux donc savoir qui ose cautionner ces comportements. Ils causent des dommages irréversibles à des enfants en bonne santé par des traitements hormonaux et des mutilations, comme si un enfant de moins de cinq ans pouvait consentir à une telle chose. Et s’il arrivait que leur famille ne soit pas d’accord, il y aurait toujours des agents de l’État prêts à intervenir au nom de ce qu’ils appellent l’intérêt du mineur. Croyez-moi, les expériences scandaleuses menées aujourd’hui au nom de cette idéologie criminelle seront condamnées et comparées à celles qui ont eu lieu pendant les périodes les plus sombres de notre histoire. Et pour couvrir cette multitude de pratiques abjectes, il y a l’éternelle victimisation toujours prête à lancer des accusations d’homophobie ou de transphobie et autres inventions dont le seul but est de tenter de faire taire ceux qui dénoncent ce scandale duquel les autorités nationales et internationales sont complices. D’autre part, dans nos entreprises, dans nos institutions publiques et dans nos universités, le mérite a été écarté par la doctrine de la diversité, ce qui implique une régression vers les systèmes nobiliaires d’antan. On invente des quotas pour toutes les minorités que les politiciens peuvent imaginer, ce qui ne fait que nuire à l’excellence de ces institutions. Le wokisme a également dénaturé la cause de l’immigration. La libre circulation des biens et des personnes étant à la base du libéralisme, nous le savons bien, l’Argentine, les États-Unis et bien d’autres pays ont été rendus grands par ces immigrants qui ont quitté leur patrie à la recherche de nouvelles opportunités. Cependant, de la tentative d’attirer des talents étrangers pour promouvoir le développement, nous sommes passés à une immigration de masse motivée non pas par l’intérêt national mais par la culpabilité. L’Occident étant la cause supposée de tous les maux de l’histoire, il devrait se racheter en ouvrant ses frontières au monde entier, ce qui aboutirait nécessairement à une colonisation inversée, qui s’apparente à un suicide collectif. C’est ce que l’on voit aujourd’hui à travers les images de hordes d’immigrés abusant, violant ou tuant des citoyens européens qui n’ont commis que le péché de ne pas avoir adhéré à une religion particulière. Mais quand on s’interroge sur ces situations, on est taxé de raciste, de xénophobe ou de nazi. Le wokisme a imprégné nos sociétés si profondément, promu par des institutions telles que celle-ci, que l’idée même de sexe a été remise en question par l’infâme idéologie du genre. Cela a conduit à une intervention encore plus importante de l’État par le biais d’une législation absurde, l’État devant par exemple financer des hormones et des opérations chirurgicales d’un million de dollars pour se conformer à la perception que certains individus ont d’eux-mêmes. Nous ne voyons que maintenant les effets d’une génération entière qui a mutilé son corps, encouragée par une culture de la relativité sexuelle, et qui devra passer toute sa vie en traitement psychiatrique pour faire face à ce qu’elle s’est infligée, mais personne ne dit rien sur ces questions. Non seulement cela, mais ils ont également soumis la grande majorité à l’esclavage des perceptions erronées d’une infime majorité et, en plus, le wokisme cherche à prendre en otage notre avenir. En occupant les chaires des universités les plus prestigieuses du monde, il forme les élites de nos pays à remettre en question et à nier la culture, les idées et les valeurs qui ont fait notre grandeur, endommageant ainsi davantage notre tissu social. Que reste-t-il pour l’avenir si nous apprenons à nos jeunes à avoir honte de notre passé ? Tout cela a été incubé et s’est développé de manière de plus en plus notoire au cours des dernières décennies, après la chute du mur de Berlin, curieusement les pays libres ont commencé à s’autodétruire lorsqu’ils n’ont plus eu d’adversaires à vaincre. La paix nous a rendus faibles, nous avons été vaincus par notre propre complaisance. Toutes ces aberrations et d’autres encore, que nous ne pouvons énumérer pour des raisons de temps, sont ce qui menace l’Occident aujourd’hui et sont, malheureusement, les croyances que des institutions comme celle-ci ont promues pendant quarante ans. Personne ici ne peut prétendre être innocent. Vous avez vénéré pendant des décennies une idéologie sinistre et meurtrière comme s’il s’agissait d’un veau d’or et avez remué ciel et terre pour l’imposer à l’humanité. Cette même organisation, ainsi que les organismes supranationaux les plus influents, ont été les idéologues de cette barbarie. Les agences multilatérales de prêt ont été un bras extorqueur et de nombreux États nationaux, en particulier l’Union européenne, en ont été et en sont un bras armé. Des citoyens au Royaume-Uni d’aujourd’hui ne sont-ils pas emprisonnés pour avoir révélé des crimes aberrants, véritablement épouvantables, commis par des migrants musulmans et que le gouvernement veut étouffer ? Ou encore, les bureaucrates de Bruxelles n’ont-ils pas suspendu les élections roumaines simplement parce qu’ils n’aimaient pas le parti qui avait gagné ? Face à chacune de ces discussions, le wokisme tente de discréditer ceux qui remettent ces choses en question en nous étiquetant d’abord, puis en nous censurant : si vous êtes blanc, vous devez être raciste, si vous êtes un homme, vous devez être misogyne ou membre du patriarcat, si vous êtes riche, vous devez être un capitaliste cruel, si vous êtes hétérosexuel, vous devez être hétéronormatif, homophobe ou transphobe. Pour chaque questionnement, ils ont une étiquette, qu’ils essaient ensuite de censurer par des moyens de facto ou de jure. Car sous le discours de la diversité, de la démocratie et de la tolérance qu’ils prétendent tenir, se cache en réalité la volonté manifeste de détruire la dissonance, la critique et, par essence, la liberté, afin de continuer à faire vivre un modèle dont ils sont les principaux bénéficiaires. N’avons- nous pas entendu ces jours-ci que certaines autorités européennes importantes, plutôt rouges, pour ainsi dire, appellent ouvertement à la censure ; ou qu’en réalité, il n’y a pas de censure, mais que ceux qui pensent différemment de l’idéologie woke doivent être réduits au silence. Et quel type de société peut résulter du wokisme ? Une société qui a remplacé le libre-échange des biens et des services par une distribution arbitraire des richesses sous la menace d’une arme, qui a remplacé les communautés libres par une collectivisation forcée, qui a remplacé le chaos créatif du marché par l’ordre stérile et sclérosé du socialisme. Une société pleine de ressentiment, où il n’y a que deux sortes de personnes, celles qui paient des impôts nets d’une part et celles qui sont les bénéficiaires de l’État, de l’autre. Et je ne parle pas de ceux qui reçoivent une aide sociale parce qu’ils n’ont pas assez à manger, je parle des entreprises privilégiées, des banquiers qui ont été renfloués lors des crises des subprimes, de la plupart des médias, des centres d’endoctrinement déguisés en universités, de la bureaucratie d’État, des syndicats, des organisations sociales, des entreprises publiques et de tous les secteurs qui vivent des impôts payés par ceux qui travaillent. Je parle du monde décrit par Ayn Rand dans La Grève, qui s’est malheureusement concrétisé. Un schéma dans lequel le grand gagnant est la classe politique, qui devient à son tour l’arbitre et la partie de cette répartition. Je le répète : la classe politique est à la fois l’arbitre et la partie intéressée dans cette répartition. Et comme toujours, c’est celui qui distribue qui obtient la meilleure part. Là où, sous les différences cosmétiques entre les différents partis se cachent des intérêts communs, des partenaires, des arrangements et un engagement inaltérable que rien ne changera, c’est pourquoi il les a tous appelés le Parti de l’État. Un système qui se cache derrière un discours bienveillant où, selon eux, le marché échoue et ce sont eux qui sont chargés de résoudre ces échecs par la réglementation, la force et la bureaucratie. Mais la défaillance du marché n’existe pas. Je vais le répéter encore une fois : la défaillance du marché n’existe pas. Parce que le marché est un mécanisme de coopération sociale où les droits de propriété sont échangés volontairement. Les prétendues défaillances du marché sont une contradiction dans les termes, la seule chose qu’une telle intervention génère, ce sont de nouvelles distorsions du système des prix, qui à leur tour entravent le calcul économique, l’épargne et l’investissement et finissent donc par générer plus de pauvreté ou un enchevêtrement de réglementations, comme celui qui existe en Europe par exemple et qui tue la croissance économique. Comme je le dis souvent dans mes conférences : « si vous pensez qu’il y a une défaillance du marché, allez vérifier si l’État n’est pas au milieu, et si vous le trouvez, ne refaites pas l’analyse — parce qu’elle est fausse ». Pour cette même raison, puisque le wokisme n’est ni plus ni moins qu’un plan systématique de l’État-parti pour justifier l’intervention de l’État et l’augmentation des dépenses publiques, cela signifie que notre première croisade, la plus importante si nous voulons retrouver l’Occident du progrès, si nous voulons construire un nouvel âge d’or, doit être la réduction drastique de la taille de l’État. Non seulement dans chacun de nos pays, mais aussi dans tous les organismes supranationaux. Car c’est la seule façon de couper ce système pervers, de le vider de ses ressources, de rendre au contribuable ce qui lui appartient et de mettre fin à la vente de faveurs. Il n’y a pas de meilleure méthode que d’éliminer la bureaucratie de l’État pour qu’il n’y ait pas de possibilité de vendre de telles faveurs. Les fonctions de l’État devraient à nouveau être limitées à la défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Toute autre fonction que l’État s’arrogerait se ferait au détriment de sa mission fondamentale et aboutirait inexorablement au Léviathan omniprésent dont nous souffrons tous aujourd’hui. Nous assistons aujourd’hui à l’épuisement global de ce système qui nous a dominés au cours des dernières décennies. Tout comme en Argentine, dans le reste du monde, le seul conflit pertinent de ce siècle et de tous ceux qui l’ont précédé devient plus aigu : le conflit entre les citoyens libres et la caste politique qui s’accroche à l’ordre établi, redoublant d’efforts en matière de censure, de persécution et de destruction. Heureusement, dans le monde libre, une majorité silencieuse s’organise et, dans tous les coins de notre hémisphère, l’écho de ce cri pour la liberté résonne. Nous sommes confrontés à un changement d’époque, à un tournant copernicien, à la destruction d’un paradigme et à la construction d’un autre, et si les institutions d’influence mondiale, telles que cette assemblée, veulent tourner la page et participer de bonne foi à ce nouveau paradigme, elles devront assumer la responsabilité du rôle qu’elles ont joué au cours de ces dernières décennies et reconnaître devant la société le mea culpa qui est exigé d’elles. En conclusion, je voudrais m’adresser directement aux dirigeants du monde, à tous ceux qui dirigent aussi bien les États nationaux que les grands groupes économiques et les organisations internationales, qu’ils soient présents ici ou qu’ils nous écoutent depuis chez eux. Les formules politiques des dernières décennies que j’ai décrites dans ce discours ont échoué et s’effondrent sur elles-mêmes. Cela signifie que penser comme tout le monde pense, lire comme tout le monde lit, dire comme tout le monde dit ne peut que conduire à l’erreur, même si nombreux sont ceux qui persistent à marcher vers le précipice. Le scénario des 40 dernières années est épuisé et quand un système s’essouffle, l’histoire s’ouvre. C’est pourquoi je dis à tous les dirigeants mondiaux : il est temps de sortir de ce scénario, il est temps de sortir de ce scénario, il est temps d’être audacieux, il est temps d’oser penser et d’oser écrire nos propres vers parce que lorsque les idées et les textes du présent disent tous les mêmes choses et disent les mauvaises choses, être courageux consiste précisément à être extemporané, à aller à rebours, à ne pas se laisser éblouir par les passagers, en perdant de vue l’universel ; il consiste à retrouver des vérités qui étaient évidentes pour nos prédécesseurs et qui sont à la base du succès civilisationnel qu’a été l’Occident, mais que le régime de la pensée unique des dernières décennies a perçu comme une hérésie. Comme l’a dit un jour Churchill, « plus nous regardons en arrière, plus nous pouvons voir loin ». En d’autres termes, nous devons retrouver les vérités oubliées de notre passé afin de dénouer le nœud du présent et de faire un nouveau pas en avant en tant que civilisation vers l’avenir. Et qu’est-ce que je vois quand je regarde en arrière ? Que nous devons adopter, une fois de plus, les dernières thèses qui ont fait leurs preuves en matière de réussite économique et sociale. C’est-à-dire le modèle de la liberté, la réappropriation des idées de liberté, le retour au libéralisme. C’est ce que nous faisons en Argentine, c’est ce que je suis sûr que le président Trump fera dans cette nouvelle Amérique, et c’est ce que nous invitons toutes les grandes nations libres du monde à faire pour arrêter à temps ce qui est clairement une voie menant à la catastrophe. En définitive, ce que je vous propose, c’est de rendre à l’Occident sa grandeur. Aujourd’hui, comme il y a 215 ans, l’Argentine a brisé ses chaînes et vous invite — comme le dit notre hymne — tous les mortels du monde à entendre le cri sacré : liberté, liberté, liberté, liberté. Que les forces du ciel soient avec nous. Merci beaucoup à tous et… vive la liberté, putain ! » |
Murray N. Rothbard, « Le populisme de droite », janvier 1992
Pour mieux comprendre l’importance de ce texte, il convient d’abord d’en préciser le contexte politique précis, avant d’en esquisser très brièvement la riche postérité.
Le contexte politique de 1992
Celui-ci est d’ailleurs explicité dans la première partie du texte, que nous avons choisi de ne pas publier à cette place car elle a moins d’intérêt pour le sujet qui nous occupe.
Duke avait aussi été candidat à l’investiture du Parti démocrate pour l’élection présidentielle américaine de 1988. Non désigné, il s’était présenté sous l’étiquette du Parti populiste et avait obtenu 0,04% des votes.
Gouverneur de Louisiane durant trois mandats (1972–1980, 1984–1988 et 1992–1996), Edwin Edwards est resté célèbre pour avoir déclaré que personne ne pouvait le battre, à moins qu’il ne soit « pris en flagrant délit au lit avec un garçon vivant ou une fille morte », ce qui rend presque anodine la célèbre boutade de Donald Trump déclarant en 2016 : « Je pourrais tirer sur quelqu’un en pleine 5e Avenue, et je ne perdrais aucun électeur ».
Qu’il rencontre alors et avec lequel il devient ami. Voir l’introduction de Lew Rockwell dans The Irrepressible Rothbard, op. cit.
“Pat Buchanan and the menace of anti-anti-semitism”, The Rothbard-Rockwell Report, décembre 1990.
La victoire de Bush aux primaires a entraîné la candidature indépendante du milliardaire populiste Ross Perot, qui remporta finalement 19% des voix et fit ainsi perdre le président sortant face à Bill Clinton
Voir Gaël Brustier, « Pat Buchanan, le prophète du trumpisme », Slate.fr, 31 janvier 2017.
Ce manifeste programmatique publié en janvier 1992 par Murray Rothbard, dans la newsletter libertarienne qu’il publie depuis deux ans aux côtés de son ami Lew Rockwell, sous le titre de Rothbard-Rockwell Report, s’inscrit d’abord dans un contexte politique très précis57, celui des élections au poste de gouverneur de Louisiane, en novembre 1991. Lors de ce scrutin, le candidat républicain (finalement battu) est David Duke, ancien chef du Ku Klux Klan, nationalement connu pour sa défense de la suprématie blanche, ainsi que pour sa promotion des idées néonazies et des thèses complotistes58. Lors des primaires, Duke l’avait emporté contre Clyde Holloway, le candidat conservateur bon teint soutenu par l’Establishment du parti, tandis qu’à gauche, le populiste Edwin Edwards59 l’avait emporté sur le gouverneur sortant Buddy Roemer, un Démocrate « réformateur » soutenu par le gouvernement Bush dans sa tentative de faire barrage au raciste Duke. Cette élection intéresse Rothbard précisément parce qu’elle lui semble démontrer que le populisme a le vent en poupe. Tout en déplorant par ailleurs que se soit déclenchée contre Duke « une campagne massive d’hystérie, de panique et de haine, orchestrée par tous les courants de l’élite dirigeante, de la gauche à la droite officielles, du président Bush et du parti Républicain officiel aux activistes de gauche locaux, en passant par les médias nationaux de New York et Washington et les élites locales ». Toutefois, ce qu’il qualifie de « vieilles lunes diaboliques du Ku Klux Klan ou d’Adolf Hitler » l’intéressent moins dans cette élection que le fait qu’elle lui paraît démontrer que le populisme (qu’il va ensuite longuement théoriser dans son texte) représente l’avenir, déclarant même que « 1992 est l’année, peut-être le début d’une décennie voire d’un siècle à venir de populisme ». De fait, durant cette année 1992, Rothbard va être conduit à soutenir l’ultraconservateur, populiste et protectionniste Pat Buchanan60 lors des primaires républicaines, en dénonçant notamment les accusations d’antisémitisme qui sont alors proférées contre lui61. Si Buchanan est finalement battu par le président sortant, tout en obtenant un score inattendu de 23%62, il n’en incarne pas moins une synthèse idéologique, qu’il développera en 1998 dans un livre intitulé The Great Betrayal. How American Sovereignty and Social Justice Are Being Sacrificed to the Gods of the Global Economy, qui rejoint par bien des aspects le discours trumpiste qui nous est devenu aujourd’hui familier63, mais qui n’est pas non plus sans affinités avec certaines des thèses « paléo-libertariennes » développées par Rothbard.
La riche postérité d’un texte programmatique
Voir à ce sujet : Theda Skocpol, Vanessa Williamson, The Tea Party and the remaking of Republican conservatism, Oxford University Press, 2012. Parmi les publications en langue française, on renverra à Marion Douzou, « Du Tea Party à Donald Trump : la radicalisation du Parti républicain aux États-Unis », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°152, 2022, pp. 107-125. Voir aussi la note pour la Fondapol rédigée en mars 2011 par Henri Hude, sous le titre : Comprendre le Tea Party [en ligne].
Si le conservatisme religieux ou la dénonciation de la pression fiscale sont des éléments qui ne varient guère au fil des différents épisodes de cette histoire, d’autres – comme le protectionnisme par exemple – sont plus ou moins mis en avant selon le contexte et les personnalités.
Un personnage important, dont la violence verbale a indéniablement marqué un tournant dans le refus croissant des Républicains d’entretenir un dialogue constructif avec certains Démocrates modérés. Voir à ce propos l’intéressant documentaire d’Alice Cohen réalisé en 2024 et intitulé Droite radicale, la conquête de Washington.
Voir sur cette question : Dominique Colas, Le Léninisme, Paris, PUF, 1982.
De fait, le texte programmatique de ce dernier dont nous publions ci-dessous la plus grande partie est plus important encore par sa postérité que par son contexte initial, même si nous ne ferons ici que l’esquisser à grands traits, en évoquant certains épisodes bien connus. Il ne saurait évidemment s’agir pour nous de faire en quelques lignes l’histoire du Tea Party64 durant les années 2008-2010 ni même d’en proposer une quelconque analyse un tant soit peu approfondie, pas plus du reste que nous n’entendons retracer dans le détail l’émergence soudaine du trumpisme à partir de 2015. Nous nous contenterons de rappeler comment ces phénomènes politiques de grande ampleur s’inscrivent dans une mutation de la droite conservatrice américaine qui, par bien des aspects, correspond à ce que Rothbard avait théorisé dès la fin des années 1970.
L’histoire du Tea Party et, après lui, du trumpisme, s’inscrit dans un mouvement long qui a consisté pour l’aile la plus droitière du Parti républicain à chercher à prendre le contrôle de l’appareil tout en imposant une ligne idéologique radicale, faite d’un mélange de conservatisme culturel, d’isolationnisme et de rejet de l’État fédéral spoliateur (« Washington », sorte d’hydre malfaisante). Cet alliage à la composition plus ou moins stable65, et que nous avons longuement étudié dans sa dimension libertarienne, a débouché sur plusieurs épisodes saillants, avant même l’irruption du Tea Party et du trumpisme, comme la candidature de Barry Goldwater en 1964, la candidature avortée de Pat Buchanan en 1992, ou encore la vague républicaine au Congrès en 1994, sous la houlette de Newt Gingrich66. Le Tea Party et le trumpisme s’inscrivent en effet dans cette histoire longue, même s’ils sont également intimement liés au contexte plus immédiat des deux mandats de Barack Obama. C’est en effet d’abord contre sa réforme de l’assurance maladie (l’Obamacare) que le Tea Party va soudainement éclore en 2009 et parvenir à mobiliser des masses impressionnantes d’opposants en colère contre ce qu’ils considèrent être une menace vitale pour les valeurs traditionnelles qu’ils défendent. Si le mouvement peut alors paraître surgir de nulle part, c’est évidemment là une impression trompeuse, tant il est vrai qu’il s’appuie en réalité sur une sphère médiatique extrêmement puissante (à commencer bien sûr par la formidable caisse de résonance qu’est Fox News, créée en 1996), mais aussi sur un réseau serré de think tanks que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer pour certains d’entre eux. Le discours du Tea Party va atteindre un degré de violence inusité avec des dérapages racistes récurrents, nombre de ses militants les plus exaltés n’hésitant pas à comparer le président Obama à un singe ou un putois, lorsque ce n’est pas à Hitler. Une violence verbale que l’on retrouve, il faut le noter, aussi bien chez Javier Milei que chez Murray Rothbard et nombre d’autres libertariens, paradoxalement héritiers d’une rhétorique hystérique de guerre civile larvée théorisée jadis par Lénine67. Quoi qu’il en soit, cette violence ne va pas empêcher (bien au contraire ?) le Tea Party de déboucher en novembre 2010 sur une vague électorale populiste, à l’occasion des élections de mi-mandat, qui sont une défaite cuisante pour le camp démocrate mais aussi pour bon nombre de républicains modérés. C’est que le Tea Party a su s’appuyer, durant cette campagne, sur une culture politique populiste qui est aussi ancienne qu’efficace aux États-Unis, comme nous avons déjà eu l’occasion de le montrer.
Ce n’est en effet pas la première fois que les élites washingtoniennes sont présentées comme corrompues et opposées au petit peuple blanc, paré de toutes les vertus et arborant fièrement son conservatisme – c’est-à-dire sa volonté de préserver les principes jeffersoniens qu’il considère être à l’origine de la grandeur du pays.
Si en 2008 et 2012, Ron Paul, un authentique libertarien, va échouer à changer le Parti républicain de l’intérieur en se présentant, en vain, à deux reprises à la primaire républicaine, c’est bien l’arrivée en 2016 d’un outsider charismatique en la personne de Donald Trump, qui va relancer la rhétorique populiste et nationaliste, et permettre à l’aile extrémiste de droite, désormais totalement décomplexée, de prendre enfin la tête du parti. Cette histoire est celle de notre présent, mais le texte de Rothbard que nous publions ici nous permet de voir à quel point ce présent était annoncé il y a plus de trente ans de manière quasi visionnaire.
Murray N. Rothbard, « Populisme de droite : une stratégie pour le mouvement paléo », Rothbard-Rockwell Report, Janvier 199268
Nous en proposons ici la traduction d’Hervé de Quengo, remaniée par François Guillaumat que l’on peut trouver [en ligne]. Nous avons déjà eu l’occasion de souligner combien le site d’Hervé de Quengo est une ressource précieuse pour quiconque veut avoir accès à la traduction française de certains textes appartenant aux traditions libérale, libertarienne et anarcho-capitaliste.
| Qu’est-ce que le populisme de droite ?
« L’idée fondamentale du populisme de droite est que nous vivons dans un pays et dans un monde étatisés. Que l’élite dirigeante qui les domine est constituée d’une coalition comprenant les membres d’un État obèse, les dirigeants de grandes sociétés, et divers autres lobbies influents. Plus précisément, la vieille Amérique de la liberté personnelle, de la propriété privée et de l’État minimal a fait place à une coalition de politiciens et de bureaucrates associés à des élites financières et commerciales (par exemple les Rockefeller, les membres de la Trilatérale) voire dominés par elles ; et cette nouvelle classe de technocrates et d’intellectuels, comprenant les universitaires du nord-est [de la Ivy League] et les élites médiatiques, représente dans la société la classe qui crée l’opinion. Bref, c’est une moderne alliance du Trône et de l’Autel qui nous dirige, sauf que le Trône s’incarne dans divers groupes de la grande industrie et que l’Autel est fait d’intellectuels étatistes laïcs, même si, au milieu de tout ce laïcisme, on peut encore trouver une dose appropriée de chrétiens partisans de l’‘‘Évangile’’ Social. La classe dominante des hommes de l’État a toujours eu besoin d’intellectuels pour justifier ce principe de gouvernement et pour tromper les masses afin qu’elles se complaisent dans leur asservissement, c’est-à-dire continuent à payer les impôts et à accepter la férule étatique. Dans les temps anciens, dans la plupart des sociétés, c’était une forme de clergé ou d’Église d’État qui tenait ce rôle. Aujourd’hui, en des temps moins religieux, nous avons les technocrates, les experts en ‘‘sciences sociales’’ et les intellectuels médiatiques, qui fournissent sa justification au système étatique et peuplent les rangs de sa bureaucratie. Les libéraux ont souvent observé le problème mais, en tant que stratèges du changement social, ils ont raté leur coup. Suivant ce qu’on pourrait appeler le ‘‘modèle hayékien’’, ils ont cherché à propager la bonne parole, pour convertir à la liberté les élites intellectuelles, en commençant par les grands philosophes, puis, en descendant lentement l’échelle intellectuelle au cours des décennies, en persuadant les journalistes et autres faiseurs d’opinion dans les médias. Nul doute que les idées sont la clé, et que la diffusion d’une doctrine correcte constitue une part nécessaire de toute stratégie libérale. On pourrait dire que le processus prend trop de temps, mais une stratégie à long terme est importante et se différencie de la futilité tragique du conservatisme officiel, qui ne s’intéresse qu’au moindre des deux maux de l’élection en cours et qui perd par conséquent sur le moyen terme, pour ne pas parler du long terme. Toutefois, la véritable erreur n’est pas tant l’accent mis sur le long terme que l’ignorance de ce fait fondamental : le problème ne tient pas uniquement à une erreur de la part des intellectuels. Il tient aussi à ce que les intellectuels sont des profiteurs du système en place : ils sont à titre crucial des membres de la classe dominante. Le processus de conversion hayékien présuppose que tout le monde, ou du moins tous les intellectuels, ne s’intéresse qu’à la vérité et que l’intérêt matériel des personnes n’entre jamais en jeu. Or, quiconque a quelque connaissance des intellectuels et des universitaires devrait perdre toute illusion là-dessus, et rapidement. Toute stratégie libérale doit reconnaître que les intellectuels et les faiseurs d’opinions font partie intégrante du problème de base, non seulement en raison de leurs erreurs, mais aussi en raison de leur propre intérêt personnel, qui est lié au système dominant. Pourquoi donc le communisme a-t-il implosé ? Parce que le système, à la fin, marchait si mal que même la nomenklatura en a eu marre et a jeté l’éponge. Les marxistes ont souligné à juste titre qu’un système social s’effondre quand la classe dirigeante est démoralisée et a perdu sa volonté de pouvoir : cette démoralisation, l’échec manifeste du système communiste l’avait finalement apportée. Cependant, ne rien faire, ne compter que sur une instruction appropriée des élites, cela veut dire que notre propre système de domination étatique ne s’arrêtera pas avant que toute notre société, comme celle de l’Union soviétique, soit réduite aux décombres. Il est certain que nous ne devons pas nous arrêter là. Une stratégie de libération doit être bien plus active et plus agressive. D’où l’importance, pour les libéraux et pour les conservateurs partisans de l’État minimal, de disposer d’une stratégie à deux coups : non seulement diffuser les bonnes idées, mais aussi dénoncer la corruption des élites dirigeantes, exposer à quel point elles profitent du système existant, et plus précisément comment elles nous volent, nous. Arracher leur masque aux élites constitue une ‘‘campagne négative’’ des plus essentielles. Cette stratégie à deux coups est donc : (a) de construire un cadre pour nos propres faiseurs d’opinions antisocialistes et partisans de l’État minimal, sur la base d’idées correctes ; et (b) d’atteindre directement les masses, de court-circuiter les médias dominants et les élites intellectuelles, de soulever les masses contre les élites qui les pillent, les escroquent et les oppriment, à la fois socialement et économiquement. Cependant, cette stratégie doit fusionner l’abstrait et le concret ; elle ne doit pas seulement s’en prendre aux élites sur le plan abstrait, mais doit particulièrement concentrer son attention sur le système étatique en place, sur ceux qui constituent les classes dominantes. Les libéraux se sont longtemps interrogés sur les personnes et les groupes qu’il faudrait atteindre. La réponse simple : ‘‘tout le monde’’, ne suffit pas parce que, pour peser sur la politique, il faut concentrer sa stratégie sur les groupes les plus opprimés et sur ceux ont la plus grande influence sociale. La réalité du système actuel est qu’il est constitué d’une alliance malsaine entre la grande entreprise démocrate-sociale et des élites des médias qui, par le truchement d’un État obèse, privilégient et exaltent une sous-classe parasitaire, laquelle pille et opprime l’ensemble des classes moyennes et travailleuses de l’Amérique. Par conséquent, la bonne stratégie pour les libéraux et les paléoconservateurs est une stratégie de ‘‘populisme de droite’’, c’est-à-dire : exposer et dénoncer cette alliance maudite et inviter à descendre de notre dos cette alliance médiatique entre la social-démocratie et sous-classe exploiteuse des classes moyennes et travailleuses. |
Un programme populiste de droite
| Un programme populiste de droite, dès lors, doit se concentrer sur deux aspects : démanteler les domaines-clefs de la domination par les hommes de État et par les soi-disant élites, et libérer l’Américain moyen des manifestations les plus flagrantes et les plus oppressives de cette autorité. En somme :
1. Diminution radicale des impôts. De tous les impôts, sur les ventes, sur les entreprises, sur la propriété, etc., mais particulièrement celui qui opprime le plus, politiquement et personnellement : l’impôt sur le revenu. Nous devons travailler à la suppression de l’impôt sur le revenu et sur l’abolition de la bureaucratie qui l’administre. 2. Couper radicalement dans l’État-providence. Éliminer l’empire de la sous-classe par la suppression du système d’assistance ou, à défaut de suppression, par des coupes importantes et par sa restriction. 3. Supprimer les privilèges raciaux et autres privilèges de groupe. Supprimer, donc, la discrimination positive, les quotas racistes, etc. en soulignant que ces quotas-là prétendent se fonder sur la construction des ‘‘droits civiques’’, laquelle nie le Droit de propriété de tout Américain. 4. Reconquérir les rues : pas de quartiers pour les criminels. Et par là j’entends, bien sûr, les violents criminels qui courent les rues — voleurs, agresseurs, violeurs, assassins — et non les ‘‘criminels en col blanc’’ ou les auteurs de prétendus ‘‘délits d’initié’’. Les flics doivent être libres d’agir et autorisés à administrer une punition immédiate, leur responsabilité étant évidemment engagée en cas d’erreur. 5. Se réapproprier les rues : éliminer les clochards. Encore une fois : libérons les flics pour qu’ils nettoient les rues des clochards et des vagabonds. Où ces derniers iront-ils ? Mais qui s’en soucie ? On peut espérer qu’ils disparaîtront, c’est-à-dire qu’ils sortiront des rangs de la classe chouchoutée et dorlotée des clochards pour rejoindre les rangs des membres productifs de la société. 6. Supprimer la banque centrale : à bas les ‘‘banksters’’. La monnaie et la banque sont des questions compliquées, mais on peut présenter la réalité de façon vivante : la Fed comme cartel organisé de ‘‘banksters’’, qui crée l’inflation, ce qui dépouille la population et détruit l’épargne de l’Américain moyen. Les centaines de milliards volés aux contribuables pour les donner aux banksters des S&L paraîtront dérisoires comparés à l’effondrement à venir des banques commerciales. 7. America First. Un point clé, et qui n’est pas là pour ne venir qu’en septième position par ordre de priorité. L’économie américaine n’est pas seulement en récession : elle stagne. La famille moyenne est moins bien lotie aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Come home, America. Cessons de distribuer des aides à tous ces mendiants étrangers. Arrêtons toute aide ‘‘au développement’’, qui n’est qu’une aide aux banksters, à leurs titres et à leurs industries d’exportation. Arrêtons tout ça et résolvons nos problèmes intérieurs. 8. Défendre les valeurs de la famille. Ce qui veut dire écarter des familles les hommes de l’État, supprimer le pouvoir étatique au nom du Droit des parents. A long terme, cela veut dire supprimer les écoles publiques et les remplacer par des écoles privées. Nous devons toutefois comprendre que les projets de ‘‘bon solaire’’ et même de crédit d’impôts ne constituent pas, malgré ce qu’en dit Milton Friedman, des progrès transitoires conduisant à terme à l’enseignement privatisé. Au contraire, les choses ne feront qu’empirer parce que les hommes de l’État y contrôleraient toujours davantage les écoles privées, et de plus en plus vite. La bonne solution consiste à décentraliser, et revenir à la gestion locale, communale, des écoles. Un point supplémentaire : nous devons rejeter une fois pour toutes les idées des ‘‘libéraux’’ de gauche qui affirment qu’il faudrait transformer en cloaque tout ce sur quoi les hommes de l’État ont mis la main : à défaut de privatisation, en attendant qu’elle arrive, nous devons tenter de gérer les institutions étatisées de la manière la plus propice à leur transformation ultime en entreprises normales, ou la placer sous contrôle local. Cela signifie toutefois ceci : les écoles publiques doivent admettre qu’on y fasse des prières. Nous devons abandonner cette absurde interprétation du Premier Amendement que font les athées de gauche et selon laquelle celui-ci interdirait la prière dans les écoles publiques, ou une crèche de Noël dans les préaux d’école ou dans les jardins publics. Nous devons revenir au bon sens et au contenu originel pour ce qui concerne la manière d’interpréter la Constitution. Pour finir : chaque point de ces programmes populistes de droite est entièrement cohérent avec une position purement libérale. Cependant, toute politique du monde réel est une politique de coalition et il y a d’autres domaines où les libéraux pourraient bien transiger avec leurs partenaires conservateurs, traditionalistes ou autres au sien d’une coalition populiste. Par exemple, à propos des valeurs familiales, prenons les sujets délicats de la pornographie, de la prostitution ou de l’avortement. Ici, les libertariens partisans de la légalisation et de la possibilité d’avorter devraient être prêts à accepter un compromis sur la base d’une position décentralisée : ceci signifie mettre un terme à la tyrannie des tribunaux fédéraux et abandonner ces questions aux divers États américains, ou, mieux encore, aux régions et aux quartiers. » […] |



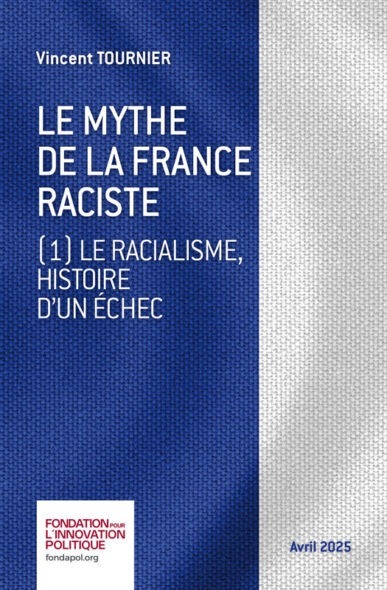







Aucun commentaire.