Le mythe de la France raciste (1)
Le racialisme, histoire d'un échecIntroduction
Le rejet du radicalisme : fondations anthropologiques
Une culture égalitaire
Le mariage chrétien : exogamie et alliances
La relativisation des liens du sang dans l’aristocratie
Le culte de la méritocratie
Un terreau culturel antiracialiste
La foi dans l’éducation
La filiation sociale contre la filiation biologique
Une conception ouverte de la nation
L’assimilation : un rêve français
Des conditions défavorables pour le racialisme
Les traites négrières et l’échec du racialisme
L’absence du racialisme pendant la colonisation
Le rejet de la race dans le discours savant
Aux sources politiques de l’antiracisme
Résumé
Formalisées au travers d’expressions telles que « racisme structurel » ou « racisme systémique », des accusations particulièrement sévères ont été lancées contre la France au cours des dernières années. Ces accusations, jamais sérieusement étayées, sont d’autant plus injustes qu’elles entrent en contradiction flagrante avec une histoire nationale profondément réfractaire aux théories de la race. La première partie de cette note propose d’analyser les principales raisons qui, au fil du temps, à la suite d’une série de conjonctures et de bifurcations originales, ont conduit à neutraliser la question de la race.
Ce processus de longue durée, fruit des conditions propres à l’histoire de France, repose sur une multitude de facteurs décisifs que l’on propose d’analyser ici : l’héritage chrétien, le mariage exogamique, la sociologie des élites aristocratiques, la valorisation de l’éducation, la conception de la nation ou encore l’attitude des intellectuels.
Vincent Tournier,
Maître de conférences de sciences politiques, Institut d’études politiques de Grenoble.
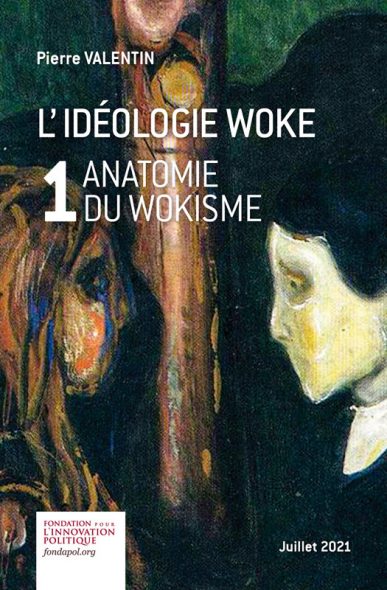
L’idéologie woke. Anatomie du wokisme (1)
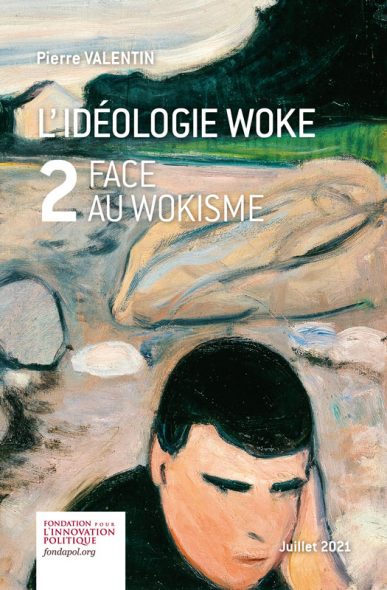
L’idéologie woke. Face au wokisme (2)

L’inévitable conflit entre islamisme et progressisme aux États-Unis

La montée en puissance de l'islamisme woke dans le monde occidental
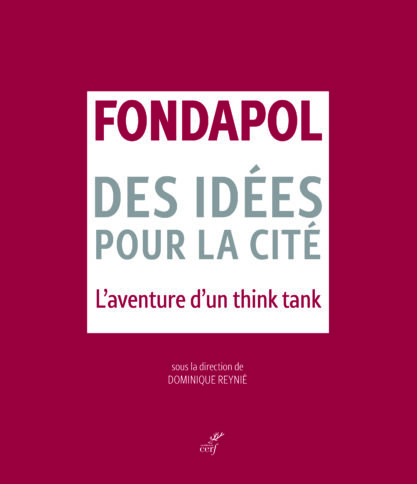
Fondapol - Des idées pour la Cité - L'aventure d'un think tank

La fraternité

Liberté, égalité, fraternité

Introduction
Vini Lander, « Structural racism: what it is and how it works », The Conversation, 30 juin 2021, [en ligne] ; Pierre-André Taguieff, L’antiracisme devenu fou. Le « racisme systémique » et autres fables, Hermann, 2021.
Une recension serait longue et fastidieuse. Un aperçu peut être obtenu en cherchant les expressions « racisme systémique » ou « racisme structurel » sur le site universitaire The Conversation, lequel se décline dans plusieurs pays. Pour le Canada, on peut consulter le document « La lutte contre le racisme systémique et la discrimination au Canada » disponible sur le site du gouvernement.
Voir « Racisme institutionnel », Multitudes, vol.4, n°23, 2005 ; « Un racisme institutionnel en France ? », Migrations et Société, vol. 1, n°163, 2016. Certains universitaires adoptent des positions ambiguës. Le politologue Patrick Weil explique par exemple dans une émission intitulée « Racisme structurel » que « la notion de ‘racisme structurel’ est à utiliser avec beaucoup de précautions. Je pense que nous avons en France, une forme de politique qui a un racisme institutionnel » (« Les sociétés face au racisme structurel », France culture, 8 juin 2020). En 2017, l’historien Pap Ndiaye, futur ministre de l’Éducation nationale, a contesté l’expression de « racisme d’État » défendue par Sud-Education 93, mais il a soutenu qu’« il existe bien un racisme structurel en France » (« Pap Ndiaye : ‘Il existe bien un racisme structurel en France’ », Le Monde, 18 décembre 2017).
« Un rapport phare de l’ONU offre un programme pour éradiquer le racisme systémique », Haut-commissariat pour les Droits de l’homme, Nations-Unis, 29 juin 2021. On retrouve l’expression « racisme systémique » sur les sites du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, ou sur les sites de nombreuses ONG (voir par exemple « Racisme structurel » sur le site de l’ONG Inter-agency Network for Education in Emergencies).
Sondage IFOP pour l’Express réalisé les 23 et 24 février 2021 auprès de 1011 personnes de 18 ans et plus.
Sondage IFOP pour Sud Radio réalisé les 16 et 17 juin 2020 auprès de 1020 personnes de 18 ans et plus.
William Macpherson, The Stephen Lawrence inquiry, février 1999.
Fabrice Dhume, « Du racisme institutionnel à la discrimination systémique ? Reformuler l’approche critique », Migrations Société, vol. 163, n° 1, 2016, pp. 33-46 [en ligne] ; Valérie Sala Pala, « Faut-il en finir avec le concept de racisme institutionnel ? », Regards Sociologiques, n°39, 2010, pp.31-47 [en ligne].
Michel Foucault, « Il faut défendre la société », Cours au Collège de France (1975-1976), 2012 [en ligne].
Le terme « racisme » désigne les attitudes individuelles, alors que le terme « racialisme » concerne les idées et les représentations qui s’élaborent à partir de la race.
« Racisme d’État », « racisme structurel », « racisme institutionnel », « racisme systémique » : toutes ces expressions, et bien d’autres encore comme « privilège blanc » ou « blanchité », se sont banalisées1.
Si elles sont moins présentes en France qu’en Amérique du nord ou au Royaume-Uni2, elles sont désormais couramment utilisées par une partie des élites3 et des institutions internationales4. Elles ont aussi su convaincre une grande partie de l’opinion, notamment chez les jeunes. En février 2021, 54% des Français estiment que le « racisme systémique » correspond à une réalité (66% chez les moins de 35 ans5) et 30% des Français (47% chez les 18-24 ans) pensent que le « racisme d’État » correspond à une réalité6.
Entre juin 2020 et février 2021, la proportion de Français qui voient le « privilège blanc » comme une réalité est passée de 32% (52% chez les moins de 35 ans) à 46% (61% chez les jeunes).
Qu’entend-on par racisme structurel, systémique ou institutionnel, expressions relativement interchangeables ? L’expression « racisme institutionnel » est apparue en 1999 dans un rapport britannique consacré au meurtre d’un jeune homme noir par la police (rapport Macpherson). Elle désigne l’ensemble des processus qui, basés sur des stéréotypes racistes, désavantageraient les membres des minorités ethniques7. Quant au racisme structurel, il est défini par l’université de Cambridge comme les « lois, règles ou politiques officielles d’une société qui produisent et entretiennent, sur la base de la race, un avantage inéquitable continu pour certaines personnes et un traitement inéquitable ou néfaste pour d’autres8 ».
À s’en tenir à ces définitions, il paraît évident que la France n’est pas concernée tant on chercherait en vain des traces du racialisme dans la législation et les institutions. Mais le problème ne s’arrête pas là. L’utilisation des termes de « système » ou de « structure », lesquels ont un riche passé en sciences sociales, désignent des éléments liés entre eux dont l’assemblage forme un tout cohérent, ce qui laisse entendre que le phénomène est généralisé et omniprésent. Dire que le racisme a une dimension structurelle ou systémique signifie que celui-ci est de nature endémique et qu’il se loge au cœur même des institutions et de la société ; en somme, il imprègne les politiques de l’État comme la culture de la société.
Dans le cas de la France, une telle analyse se heurte à une impasse : les anomalies sont trop nombreuses pour que cette analyse puisse être sérieusement retenue. Même ses partisans sont mal à l’aise9. Et pour cause : dans l’histoire de France, tout va justement à l’encontre de la thèse du racisme structurel ou systémique.
Mais cette contradiction ne suffit pas à ébranler les convictions. Pour les partisans du racisme structurel, même si le racisme ne se donne pas à voir de manière explicite à travers la législation, il n’en imprègne pas moins le fonctionnement des institutions et de la société. La société française est donc accusée de reposer, hier comme aujourd’hui, sur une entreprise de domination et d’exclusion fondée sur la race, comme l’avait déjà soutenu Michel Foucault en 1976 lorsqu’il expliquait que toute société connaît une « guerre des races », et même que tout pouvoir assoit sa domination sur un « racisme d’État10 ».
C’est pourtant la thèse exactement inverse que nous proposons de défendre dans ce texte, à savoir que la société française, en raison d’une culture et d’une histoire spécifiques s’est constituée sur une base profondément réfractaire au racialisme comme au racisme11. En disant cela, il ne s’agit pas de nier l’existence du racisme, ni de tomber dans un déterminisme historique qui remplacerait un culturalisme par un autre.
La thèse que nous voulons soutenir est plutôt qu’au cours du temps, sous l’effet de contraintes et de circonstances singulières, la société française a suivi une série de bifurcations qui l’ont amenée à récuser le racisme. Ce cheminement n’était pas donné d’avance ; il résulte d’un ensemble d’ingrédients dont la combinaison a débouché sur une situation originale que l’on pourrait qualifier, quitte à paraître grandiloquent, de « miracle français ».
Une fois ce constat dressé, nous tâcherons de comprendre pourquoi une thèse aussi éloignée de la réalité que celle du racisme structurel ou systémique a pu se développer et gagner les esprits, ce qui nous conduira à faire un détour par l’analyse des mythes.
Le rejet du radicalisme : fondations anthropologiques
Pour comprendre la situation française, il est nécessaire de revenir sur les mécanismes de long terme qui ont façonné la psychologie collective des Français, notamment celle des élites.
Ces mécanismes ont fonctionné par sédimentation : ils se sont accumulés au cours du temps, constituant par strates successives un environnement intellectuel et culturel défavorable à l’idéologie de la race.
Une culture égalitaire
Louis Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Seuil, 1983.
Alain Laurent, Histoire de l’individualisme, PUF, Que Sais-Je, 1993.
Olivier Pétré-Grenouilleau, Les Traites négrières, essai d’histoire globale, Gallimard, 2004. Voir aussi Olivier Pétré-Grenouilleau « Le siècle des abolitionnistes », L’Histoire, 353, mai 2010.
Le rejet du racialisme est inséparable de la culture égalitaire, et même égalitariste, qui s’est développée en France, et ce bien avant la Révolution française. Cette culture est le fruit d’une longue histoire qui doit beaucoup au processus de construction de l’État qui, comme l’a analysé Tocqueville, est allé de pair avec une éthique individualiste.
L’héritage chrétien a constitué la toile de fond de cette culture égalitaire. En consacrant des principes tels que la dignité et l’égalité des hommes, sur lesquels le droit naturel moderne a pu se développer, le christianisme a favorisé une conception humaniste et universelle qui a valorisé l’individu au détriment d’une vision holiste de la société12.
La célèbre formule de Saint Paul dans l’« Épître aux Galates » (« il n’y a plus ni Juif ni Grec ; il n’y a plus ni esclave ni homme libre ; il n’y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ ») a favorisé une conception monogéniste du monde, thèse qui attribue une origine unique à l’ensemble de l’humanité, par opposition à la thèse polygéniste.
C’est à partir de ce socle chrétien que la Renaissance, puis les Lumières, ont pu bâtir une représentation universelle de l’homme. On songe notamment à Pic de la Mirandole qui vante la « dignité de l’homme », à Descartes pour qui « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » ou encore à Rousseau qui entend s’adresser « au seul animal doué de raison, c’est-à-dire à l’homme ». Ces auteurs entretenaient une relation complexe – et parfois conflictuelle – avec le christianisme mais ils n’en baignaient pas moins dans des références religieuses. De cette matrice est sorti le « paradigme individualiste13 », support de la pensée politique moderne.
Ces principes de dignité et d’égalité, forgés par le christianisme et repris par la philosophie occidentale, ont rendu l’esclavage moralement inacceptable, ce qui a conduit à son abolition. Il s’agit là d’une originalité majeure car toutes les autres civilisations ont vu l’esclavage comme un fait de nature, y compris la civilisation antique. Seul l’Occident chrétien a été en mesure de faire émerger un mouvement abolitionniste14.
Parallèlement, la valorisation de la dignité et de l’égalité a pu générer en Occident un sentiment de supériorité morale sur les autres civilisations. Ce sentiment de supériorité est aujourd’hui dénigré mais il résultait en partie de cette conception universelle de l’individu et de ses droits. Lors de la célèbre controverse de Valladolid, convoquée par l’empereur Charles Quint au milieu du XVIe siècle, le juriste espagnol Sepulveda a justifié la conquête des Indes (les Amériques) par le droit des peuples supérieurs de civiliser les peuples sauvages. Cet argumentaire peut choquer mais il découle de la dénonciation de pratiques jugées barbares telles que le cannibalisme et les sacrifices humains, bien réelles au demeurant, et inconnues en Europe.
Si l’Occident n’a pas échappé à la soif de conquêtes, il s’est singularisé par la volonté d’accompagner son expansion par la transmission de valeurs humanistes. Cette ambition n’était pas exclusive d’autres objectifs moins respectables, ni de dérives ou d’hypocrisie, mais elle n’en a pas moins constitué une singularité importante par rapport aux autres civilisations dont témoigne aujourd’hui encore la tradition tout occidentale pour l’ingérence humanitaire ou l’accueil des étrangers – passion qui n’est pas sans rappeler l’injonction chrétienne pour l’amour du prochain.
Le mariage chrétien : exogamie et alliances
La culture chrétienne n’explique cependant pas tout. Les valeurs religieuses sont susceptibles d’être interprétées de diverses manières et elles peuvent déboucher sur des cultures très différentes. La comparaison entre la France et d’autres pays chrétiens suffit à le montrer, y compris sur la question de l’esclavage puisque celui-ci a perduré dans le sud des États-Unis jusqu’en 1865, ou dans la Russie orthodoxe jusqu’en 1861, alors qu’il a été proscrit en France dès 1315 par le roi Louis X le Hutin.

Source :
Source : « Ordonnance royale du 3 juillet 1315 » dans Eusèbe Jacques de Laurière, Ordonnances des rois de France de la troisième race, Volume 1, 1723, p.587 [en ligne].
| Transcription en français moderne de l’ordonnance du roi Louis X, dit le Hutin
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos chers et fidèles maîtres Saince de Chaumont et Nicolle de Braye, salut et affection. Puisque, selon le droit naturel, chacun doit naître libre, et que, par certains usages et coutumes établis depuis une grande ancienneté et conservés jusqu’à présent en notre royaume, et parfois à cause des fautes de leurs prédécesseurs, plusieurs personnes de notre peuple commun sont tombées en servitude et en diverses conditions qui nous déplaisent grandement. Considérant que notre royaume est appelé le royaume des Francs et voulant que la réalité corresponde à ce nom, ainsi que d’améliorer la condition des gens sous notre nouveau gouvernement, nous avons, après délibération en notre grand conseil, ordonné et ordonnons que, généralement, partout en notre royaume, en tant qu’il nous appartient à nous et à nos successeurs, ces servitudes soient ramenées à liberté. Ainsi, tous ceux qui, par origine ou ancienneté, ou récemment par mariage ou résidence en des lieux de condition servile, sont tombés ou pourraient tomber en servitude, se verront accorder la liberté sous des conditions justes et convenables. Et afin que notre peuple commun ne soit plus accablé ou lésé par les collecteurs, sergents et autres officiers qui, par le passé, ont été chargés de percevoir les droits de mainmorte et de formariage, comme cela a été le cas jusqu’à présent, ce qui nous déplaît, et afin que les autres seigneurs possédant des hommes de corps prennent exemple sur nous et les affranchissent à leur tour, nous, qui avons pleine confiance en votre loyauté et votre sagesse, vous commettons et mandons, par la teneur de ces présentes lettres, de vous rendre dans la baillie de Senlis et dans les ressorts de celle-ci. Là, en tous lieux, villes, communautés et auprès de toutes personnes singulières qui réclameront cette liberté, vous devrez traiter et conclure avec eux certaines compositions, par lesquelles nous recevions une compensation suffisante pour les revenus que ces servitudes pouvaient nous procurer, à nous et à nos successeurs, et leur accorder, en tant qu’il nous appartient à nous et à nos successeurs, une liberté générale et perpétuelle, selon ce qui a été dit plus haut et ce que nous vous avons plus amplement déclaré et confié de vive voix. Et nous promettons en bonne foi que nous, pour nous et nos successeurs, ratifierons et approuverons, tiendrons et ferons tenir et observer tout ce que vous ferez et accorderez sur ces sujets. Quant aux lettres que vous délivrerez pour les traités, compositions et accords d’affranchissement des villes, communautés, lieux ou personnes singulières, nous les acceptons dès à présent, et leur fournirons nos propres lettres en la matière, chaque fois que nous en serons requis. Et nous donnons mandement à tous nos juges et sujets de vous obéir en ces choses et de vous prêter toute diligence. Donné à Paris, le 3e jour de juillet de l’an de grâce 1315 ». |
Une vaste étude réalisée par une équipe de chercheurs a montré que les interdits chrétiens en matière de consanguinité ont eu des effets très importants sur le développement de valeurs telles que l’individualisme ou la confiance. Shulz et al., « The Church, intensive kinship, and global psychological variation », Science, 8 novembre 2019 [en ligne].
Jack Goody, L’évolution de la famille et du mariage en Europe, Armand Colin, 1985.
Marie-Louise Surget, « Mariage et pouvoir : réflexion sur le rôle de l’alliance dans les relations entre les Evreux-Navarre et les Valois au xive siècle (1325-1376) », Annales de Normandie, 2008, 58(1-2), pp. 25-56.
La religion chrétienne n’est donc pas une condition suffisante. D’autres facteurs doivent être pris en compte, en commençant par le mariage chrétien tel qu’il a été imposé par l’Église.
Instauré par la réforme grégorienne du XIe siècle, le mariage chrétien proscrit un large spectre d’unions pour cause de consanguinité (sept degrés de parenté, ramenés à quatre lors du concile de Latran en 1215). Cette norme exogamique oblige à échanger les femmes en dehors du groupe d’appartenance. Le modèle exogamique ne se retrouve pas dans d’autres civilisations où le mariage endogamique entre cousins est parfois très valorisé, ce qui va de pair avec un fort contrôle des femmes.
La conception chrétienne du mariage, à laquelle l’aristocratie a tenté de résister, a produit des effets considérables sur les mœurs15. En délégitimant les liens du sang sur lesquels reposait le mariage païen, le mariage chrétien oblige à trouver un conjoint en dehors du clan ou de la lignée, parfois même en dehors de l’aristocratie, ce qui réduit l’importance de la race. Dans le même mouvement, l’Église s’est singularisée par l’importance donnée à la parenté spirituelle (parrainage et marrainage), laquelle a reçu une importance équivalente à la parenté biologique, ce qui est une autre manière de relativiser la place du sang16.
Avec le mariage chrétien – dont les autres caractéristiques sont la monogamie, l’indissolubilité et le consentement des époux – les élites aristocratiques ont été contraintes d’élargir le champ de leurs alliances17, ce qui a encouragé le dépassement des liens claniques ainsi que la pacification des mœurs.
La relativisation des liens du sang dans l’aristocratie
Le Dictionnaire de Furetière définit ainsi la race : « Lignée, génération continuée de père en fils : ce qui se dit tant des ascendants que des descendants » (cité par Daniel Teysseire, « De l’usage historico-politique de race entre 1680 et 1820 et de sa transformation », Mots, n°33, décembre 1992).
Arlette Jouanna, La France du XVIe siècle, 1483-1598, PUF, Quadrige, 2009 [1996].
Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Calmann-Lévy, 1973 [1939].
Originellement, les élites aristocratiques ont fortement valorisé l’idéologie de la race , entendue dans son sens initial de lignage ou de généalogie18. Cette idéologie attribue au sang noble des qualités supérieures justifiant ainsi la domination d’une élite, comme cela se fait dans toutes les sociétés prémodernes.
La noblesse française a cependant connu de profonds bouleversements qui ont relativisé le rôle de la lignée. Contrairement à une idée reçue, la noblesse n’a jamais été un ordre totalement fermé19. À l’anoblissement par les armes – dont l’importance découle de la fréquence des guerres – sont venus s’ajouter deux types d’anoblissement : l’anoblissement par l’exercice des charges (qualifiées d’anoblissantes) et l’anoblissement par la volonté du roi puisque ce dernier a fini par imposer son monopole pour accéder à la noblesse.
La lettre d’anoblissement est à la fois un moyen pour le roi de s’entourer de gens fidèles et talentueux, et une variable d’ajustement pour remplir les caisses du royaume, notamment après la guerre de Sept ans (1756-1763) et la guerre d’Indépendance des États-Unis (1775-1783), très coûteuses pour la monarchie.
À force de renouvellements, la noblesse s’est diversifiée. Ce brassage explique pourquoi les règles de la civilité et de la bienséance ont fait l’objet d’une codification scrupuleuse dans les milieux aristocratiques où dominait la noblesse de robe. Forcés de se côtoyer et de briller devant le roi, les aristocrates sont amenés à rivaliser dans les belles manières. La civilité permet de se faire reconnaître comme aristocrate et de se distinguer du commun20. De cette rivalité, Molière a tiré l’une de ses pièces les plus fameuses, Le Bourgeois gentilhomme, conçue au moment où Louis XIV promouvait nombre de riches bourgeois pour consolider son administration et son pouvoir.
Le culte de la méritocratie
Olivier Tholozan, Henri de Boulainvilliers : L’anti-absolutisme aristocratique légitimé par l’histoire, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999 [en ligne].
C’est paradoxalement cette volonté de réaffirmer la prééminence de l’ancienne noblesse au détriment du roi qui a contribué au succès des idées libérales de Montesquieu : sa thèse sur la séparation des pouvoirs a fourni un argument supplémentaire aux aristocrates qui s’opposaient à la monarchie absolue. Voir Jean-François Jacouty, « Une contribution à la pensée aristocratique des Lumières. La théorie des lois politiques de la monarchie française de Pauline de Lézardière », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, vol. 17, n°1, 2003, pp.3-47. Voir aussi Jacques de Saint-Victor, La Chute des aristocrates. 1787-1792 : naissance de la droite. Perrin, 1992.
Rafe Blaufarb, « Une révolution dans la Révolution : mérite et naissance dans la pensée et le comportement politiques de la noblesse militaire de province en 1789-1790 », Histoire, économie & société, vol. 33, n° 3, 2014, pp.32-51.
Ludmila Pimenova, « Analyse de cahiers de doléances : l’exemple des cahiers de la noblesse », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 103, n°1, 1991.
Arlette Jouanna, La France du XVIe siècle, op. cit.
Éric Saunier, « Comment les francs-maçons devinrent révolutionnaires », dans Peuples en révolution : d’aujourd’hui à 1789, Presses universitaires de Provence, 2014 ; du même auteur, « Les francs-maçons et la Révolution française », dans La Franc-maçonnerie, exposition virtuelle de la BNF, 2014 [en ligne].
L’inflation des titres nobiliaires a eu toutefois son revers : elle a provoqué des critiques de la part de la noblesse traditionnelle, dite d’extraction, qui prétendait incarner la noblesse authentique en raison de l’ancienneté de son lignage et de son mode de vie aristocratique.
Pour écarter ou dénigrer les nouveaux venus, les aristocrates de vieille souche ont mis en avant le sang et la race. Ils ont aussi tenté de justifier leur prééminence par la théorie dite « germaniste » de la noblesse selon laquelle les nobles descendent des anciens Francs21. Le but de cette théorie était de relativiser la noblesse des nouveaux aristocrates (puisque les vrais aristocrates sont censés descendre des Francs). Pour l’aristocratie traditionnelle, il s’agissait également de défendre ses droits face au pouvoir absolu du roi22, tout en affirmant sa supériorité naturelle face à une haute administration en pleine croissance, devenue indépendante en raison de la vénalité des offices.
Cette réaction nobiliaire, qui se renforce à la fin de l’Ancien Régime, exaspère les aristocrates de fraîche date tout comme que les bourgeois aspirant à devenir nobles. Mais si ces nouveaux aristocrates critiquent la noblesse d’extraction, ils lui envient son prestige et sa prééminence puisqu’elle bénéficie d’un quasi-monopole dans l’accès aux plus hautes fonctions militaires et ecclésiastiques23. L’attitude hautaine des vieilles familles aristocratiques, dont les cahiers de doléances portent la trace24, est d’autant moins acceptée que les vieux lignages sont contraints de vivre dans l’oisiveté : en effet, s’ils ne veulent pas tomber dans la « dérogeance », c’est-à-dire perdre leurs titres, ils doivent éviter de se livrer à des activités jugées viles, en l’occurrence les travaux manuels ou le commerce25.
Dans cette compétition au sein des élites de l’Ancien Régime, l’idéologie de la race s’est donc présentée comme un obstacle et une menace pour la réussite sociale de la noblesse récente. C’est pourquoi cette idéologie va faire l’objet d’un puissant rejet au profit d’un autre critère : le mérite.
Au culte du sang et des bonnes manières, caractéristique de la noblesse traditionnelle, va donc répondre le culte du travail et du mérite. On en trouve la manifestation dans une célèbre répartie du Mariage de Figaro (« Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus ») et, plus tard, dans la fameuse parabole de Saint-Simon, qui opposera de manière cruelle l’oisiveté des frelons au travail fructueux des abeilles.
C’est dans ce bouillonnement idéologique au sein des élites aristocratiques que se cultivent les idées égalitaires, socle du projet révolutionnaire. Une grande partie de la Révolution française vient de ce basculement des élites vers un autre système de valeurs, basé notamment sur le rejet des privilèges de naissance, sans qu’il soit initialement question de supprimer la monarchie (laquelle sera maintenue jusqu’en 1792 et gardera longtemps de solides partisans).
La Révolution française illustre ainsi la formule de Vilfredo Pareto selon laquelle « l’histoire est le cimetière des aristocraties ». La Révolution peut en effet être vue comme une révolte au sein même de l’aristocratie par des élites constituées de nobles récents ou aspirant à l’être qui se sentent dénigrés par une aristocratie jalousée et déclinante mais toujours prééminente. La maçonnerie a contribué à la fermentation des idées contestataires : c’est au Grand Orient de France, créé en 1773, que s’est développée la critique de la religion et de l’aristocratie au nom du progrès et du travail26.
C’est dans ce bouillonnement des élites d’Ancien régime que va se recruter la fine fleur de la Révolution. Robespierre, Danton, Mirabeau, La Fayette, Du Pont de Nemours, Talleyrand, Barnave, Brissot, Saint-Just : tous les ténors ont en commun d’avoir pris en horreur l’attribution des privilèges fondés sur la race ou la lignée, au détriment du talent et du mérite. Cette frange « révolutionnaire » de l’aristocratie pèse d’autant plus qu’elle a su trouver des alliés du côté de la bourgeoisie et du clergé, par exemple les abbés Sieyès ou Grégoire.
De ce conflit fondateur est resté un héritage spécifiquement français : l’aspiration à faire partie d’une élite qui se distingue de la population par ses manières et ses goûts aristocratiques, tout en valorisant la méritocratie comme moyen d’accéder aux positions sociales élevées.
Le phénomène des grandes écoles, qui naît sous l’Ancien Régime et va prospérer par la suite, véritable singularité française, est le résultat de cette aspiration basée sur la méritocratie et la distinction, consolidée par la volonté de l’État de contrôler la formation des cadres.
Un terreau culturel antiracialiste
Ce premier tableau doit être complété par d’autres éléments qui ont contribué à enrichir et approfondir le terreau culturel hostile au racialisme.
Parmi ces éléments se trouvent l’attachement au rôle déterminant de l’éducation, une conception sociale de la filiation, une vision ouverte de la nation et la valorisation de cette notion très française qu’est l’assimilation.
La foi dans l’éducation
« On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père / Le peu de soin, le temps, tout fait qu’on dégénère / Faute de cultiver la nature et ses dons / Ô combien de Césars deviendront Laridons ! », Jean de la Fontaine, « L’Éducation », Fables choisies, Livre VIII, fable 24, 1678 [en ligne].
La croyance dans le pouvoir de l’éducation a ajouté un puissant antidote à la théorie des races. Cette croyance est tellement ancrée dans la psychologie nationale que, encore aujourd’hui, l’école est instinctivement appelée pour résoudre tous les problèmes de la société.
La valorisation de l’éducation est bien antérieure à Jules Ferry. Elle est le fruit d’une longue évolution qui combine un volet culturel et un volet politique.
Du côté culturel, on trouve le concept chrétien de « cire molle », concept apparu au XIIe siècle avant d’être repris sous une forme laïcisée par les philosophes des Lumières à travers la notion de « perfectibilité » (Rousseau). Ce concept stipule que la nature humaine est suffisamment plastique pour pouvoir être modelée au gré des éducateurs.
Il doit son succès au fait que les élites tant aristocratiques que bourgeoises, le voient d’un bon œil. La race en fait les frais, comme le confirme la fable de La Fontaine intitulée « L’Éducation ». Dans cette fable, inspirée du récit de Plutarque Comment il faut éduquer les enfants, très couru au XVIe siècle, La Fontaine décrit le destin opposé de deux chiens issus de la même race, César et Laridon. Seul le premier, qui est bien nourri et bien éduqué, reste conforme à son rang. La fable se clôt par une ode à l’éducation, seule capable de sauvegarder une « heureuse nature27 ».
La valorisation de l’éducation a eu pour effet de recentrer la famille sur la cellule conjugale. Ce recentrement s’effectue d’abord dans les milieux aisés avant de gagner le reste de la société, comme l’a analysé Philippe Ariès28. Les enfants deviennent une valeur dans laquelle les parents investissent.
Ils sont l’objet d’affection et d’attention, ce qui provoque une baisse de la natalité. Les premières années d’éducation se font désormais dans la famille.
Par ailleurs, les clivages politico-religieux vont achever de consolider l’attachement à l’éducation. Lors de la Réforme, l’Église doit répondre au défi que lui lance le protestantisme puisque ce dernier entend s’affranchir de la médiation assurée par le clergé dans la relation de chacun avec Dieu. La Contre-Réforme catholique s’est donc jouée en grande partie sur le terrain éducatif.
Mais en se définissant comme une institution enseignante, l’Église subit à son tour les critiques du camp laïque. Les jésuites, dont l’ordre a été créé en 1540, sont les premiers visés. Dans son Essai d’éducation nationale (1763), acte de naissance d’une guerre scolaire qui va s’étaler sur plus de deux siècles, Louis-René de La Chalotais explique qu’il faut chasser les jésuites de l’enseignement et confier l’éducation à l’État.
L’enjeu de cette opposition entre l’Église et l’État n’est autre que le contrôle de la formation des enfants. La compétition est d’autant plus âpre que les deux camps s’appuient sur la même foi dans la toute-puissance de l’éducation et qu’ils croient au rôle médiateur de l’institution. De la même façon que l’Église entend exercer une médiation entre Dieu et les fidèles pour le salut des âmes, les républicains voient dans l’État un instrument pour prendre en charge le destin de la Nation, à condition évidemment de remplacer le clergé séculier par un clergé profane, ce qui sera assuré par les hussards noirs de la République.
La filiation sociale contre la filiation biologique
« L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari » (article 312 du Code civil). Notons que la loi de 1972 précisait que « Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père ». Cette phrase a été supprimée en 2006, affaiblissant ainsi la possibilité pour les pères de contester la filiation.
L’allergie française envers la race découle aussi de la mise à distance de la filiation biologique. Cette relativisation relève de deux préoccupations : l’ordre public et le natalisme.
L’étatisme français incite en effet à privilégier la paix et la stabilité des familles, au détriment de la vérité biologique. Le droit civil français s’est construit sur le principe de la paternité sociale, fidèle en cela à l’adage romain Pater is est quem nuptiæ demonstrant – le père est celui que les noces démontrent – repris à l’identique dans le Code civil29.
Juridiquement, le mariage crée une présomption de paternité, de sorte que le père se confond avec le mari. Lorsque les couples ne sont pas mariés, la paternité passe par une déclaration de reconnaissance qui, une fois établie, peut difficilement être contestée. En l’absence de reconnaissance, la paternité est imposée par les tribunaux sans qu’il soit besoin de fournir une preuve biologique : il suffit alors d’établir une possession d’état par un acte de notoriété, autrement dit démontrer à l’aide de témoins qu’il existe un lien filial (article 310-3 et suivants du Code civil).
La paternité sociale a pour but de préserver l’ordre dans les familles. Ce qui est jugé prioritaire est la stabilité juridique de la famille, en raison de ses lourdes implications (état civil, éducation, héritage). C’est pourquoi la recherche en paternité est fortement restreinte. Ce n’est qu’en 1912 que celle-ci est autorisée par la loi. Cette recherche est toutefois circonscrite aux procédures judiciaires, donc soumise à l’appréciation du juge, et sous réserve du consentement écrit de la personne (dans l’affaire Yves Montand, une difficulté particulière s’est posée puisqu’une filiation était revendiquée post-mortem, et qu’elle s’est du reste révélée fausse). Toute recherche privée est strictement interdite (article 16-11 du Code civil). En cas d’infraction, les sanctions vont jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende.
Par ailleurs, le Code napoléonien a repris un autre principe du droit romain : l’adoption. En vigueur sous l’Antiquité, l’adoption était proscrite sous l’Ancien Régime, ce qui était cohérent avec l’idéologie de la race. Restaurée par le Code civil, l’adoption française se distingue de l’adoption sous l’Empire romain, mais aussi de l’adoption qui est en usage dans les sociétés traditionnelles (le fa’a’amu en Polynésie) ou islamiques (la kafala) dans la mesure où elle est créatrice d’une véritable filiation juridique. L’adoption est certes un phénomène minoritaire mais sa présence dans le droit n’en constitue pas moins un révélateur de la conception proprement sociale de la parenté.
Dans le cas des mères, où le lien biologique n’est pas contestable, c’est la préoccupation nataliste qui est venue apporter un dispositif original, en l’ocurrence l’accouchement anonyme, ou accouchement sous X. Les inquiétudes pour la natalité française se sont en effet renforcées à la fin du XIXe siècle, notamment à cause de la rivalité avec l’Allemagne. L’hécatombe de la Première Guerre mondiale a conforté cette inquiétude, comme l’indiquent plusieurs mesures : loi de 1920 sur la contraception, débats sur le vote familial, création des allocations familiales en 1932. L’accouchement sous X apparaît d’abord timidement en 1904 (le préfet peut renoncer à produire un acte de naissance) et il a par la suite été formalisé dans le décret-loi du 2 septembre 1941, toujours en vigueur, lequel permet aux mères de renoncer à leur maternité sans que les pères puissent faire valoir leurs droits.
Une conception ouverte de la nation
Walter Bruyère-Ostells, « Les étrangers dans les armées françaises de 1789 à 1945 », Inflexions, vol. 34, n°1, 2017 [en ligne].
En 1993, le Conseil constitutionnel a refusé de ranger le droit du sol parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en arguant du fait que la loi de 1889, qui instaure le droit du sol sous condition de résidence, répondait surtout aux besoins de la conscription (décision du 20 juillet 1993).
Bronwen Manby, « Les lois sur la nationalité en Afrique : une étude comparée », Open Society Foundations, octobre 2009 [en ligne].
Enest Renan, « Qu’est-ce qu’une nation », conférence à la Sorbonne, 11 mars 1882.
Plusieurs facteurs d’ordres économique, démographique et militaire se sont conjugués pour développer une conception ouverte de la nation et de la nationalité.
Gagnée précocement par la Révolution industrielle, et contrairement au reste de l’Europe, la France a été une terre d’immigration à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, d’abord d’origine européenne, puis d’origine maghrébine et africaine après 1945.
Si cette immigration a pu se produire, c’est parce qu’elle a bénéficié d’un contexte favorable. Le royaume de France se présente comme l’addition de territoires et de populations disparates (appelées jadis des races) qu’il a fallu faire cohabiter, ce qui incite à dépasser les barrières ethniques. De surcroît, la France a été souvent en guerre, notamment en raison de sa situation géographique puisque son territoire est entouré de pays qui ont eu des ambitions hégémoniques (l’Angleterre au nord, l’Allemagne à l’est, l’Espagne au sud).
À cause de ses nombreuses guerres, et par inquiétude pour sa natalité, la France a continuellement fait appel aux étrangers pour renforcer ses armées. Des régiments entiers d’étrangers (Irlandais, Suédois, Italiens, Croates, Polonais, Suisses, Allemands, etc.) ont servi la France sous l’Ancien Régime. Cette mixité n’a pas disparu avec la création d’une armée nationale sous la Révolution30. Les étrangers ont continué à servir en nombre, depuis les armées révolutionnaires et napoléoniennes jusqu’aux guerres mondiales en passant par les armées coloniales (tirailleurs sénégalais, spahis marocains, algériens ou tunisiens). La célèbre Légion étrangère, créée en 1831 pour répondre à la colonisation de l’Algérie, est emblématique de cette intégration par les armes, via l’impôt du sang.
L’extension en 1912 du service militaire aux populations issues des colonies a pu se faire sans difficultés, ce qui n’est pas rien dans un pays qui associe étroitement la citoyenneté au port des armes. Cette situation a révulsé les troupes allemandes, lesquelles n’hésiteront pas à massacrer des tirailleurs sénégalais en juin 1940. En 1939, un décret-loi a invité les bénéficiaires du droit d’asile à s’engager dans l’armée française en échange d’une naturalisation.
Forte de cette situation géopolitique et démographique, la France a instauré un droit de la nationalité original qui mêle droit du sang et droit du sol. Contrairement à une idée reçue, le droit du sol n’est ni une invention de la Révolution française, ni un principe exclusif du droit français. Introduit d’abord en 1851 sous la forme du double droit du sol, il s’est élargi en 1889 sous la forme d’un droit du sol partiel, attribué non pas à la naissance mais à la majorité, sous réserve d’une certaine durée de résidence.
En vertu de cette législation, la nationalité n’est pas attribuée automatiquement à la naissance, comme le ferait un authentique droit du sol, mais au terme d’un processus de « socialisation31 ». La loi de 1889 part du principe que celui qui naît en France devient français à l’issue d’une acculturation. Autrement dit, on ne naît pas français, on le devient.
En introduisant le lieu de naissance dans l’accès à la nationalité, la France se distingue des autres pays d’Europe continentale qui ne connaissent souvent que le droit du sang. Elle se distingue encore plus radicalement des pays africains qui, non contents d’ignorer le droit du sol, disposent souvent d’une procédure de naturalisation difficile, discriminatoire et partielle, parfois explicitement raciale ou basée sur la religion comme c’est le cas en Afrique du Nord32.
L’approche française est pragmatique : il s’agit de franciser les étrangers qui arrivent en France dans le but d’accroître la puissance démographique et militaire du pays, mais aussi d’éviter le ressentiment contre les étrangers dispensés d’obligations militaires. La loi de 1889 visait également à couper court aux risques de revendications territoriales sur l’Algérie de la part de l’Espagne ou de l’Italie puisque ces deux pays y avaient chacun une importante diaspora. Après la guerre de 1914, la loi de 1927 facilitera encore les naturalisations pour combler l’hécatombe des tranchées.
La priorité a été donnée à la démographie au détriment de la race et de la généalogie. Le rejet de la race dans la définition de la nation a été exposé avec force par Ernest Renan dans sa célèbre conférence de 1882 à la Sorbonne33. Dans son plaidoyer, devenu emblématique de la conception française de la nation, Ernest Renan écarte fermement la race (ainsi que d’autres critères comme la langue ou la religion) au profit de la seule volonté : est Français celui qui a « la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis ». Si le culte des ancêtres ne disparaît pas, il prend chez Renan un sens collectif et mythologique : « Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j’entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà la condition essentielle pour être un peuple ».
Si cette définition de la nation vise conjoncturellement à justifier les revendications françaises sur les territoires perdus en 1871 (l’Alsace et la Moselle), elle reprend une idée qui parcourt l’histoire du nationalisme français : la France est d’abord le fruit d’un engagement volontaire. D’une certaine façon, en mettant en avant la volonté, Ernest Renan renoue avec la tradition chrétienne qui conçoit l’appartenance à la communauté chrétienne comme un choix personnel et spirituel.
L’assimilation : un rêve français
Abdellali Hajjat, « Généalogie du concept d’assimilation. Une comparaison franco-britannique », Astérion, n°8, 2011.
Diderot, Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé l’Homme, 1774.
Ernest Renan, op. cit.
Voir Jean-Marc Chouraqui, « Les communautés juives face au processus de l’émancipation », Rives nord- méditerranéennes, 14, 2003 [en ligne].
Pierre Birnbaum, Les fous de la République, Fayard, 1992.
On retrouve des critères comparables aux États-Unis, où la naturalisation est conditionnée à des critères de durée de résidence, de maîtrise de la langue, de mœurs, de connaissance de l’histoire des États-Unis ou encore de loyauté envers la Constitution et la nation.
La conception française de la nationalité est indissociable d’un principe qui a caractérisé l’histoire nationale : l’assimilation. Cette notion, structurellement opposée à la race, a une longue histoire. C’est au XIVe siècle que le mot émerge pour désigner le fait de « rendre semblable34 ». Il subit alors l’influence du christianisme dans le double sens de communion avec Dieu et d’entrée dans la communauté des croyants (par opposition à l’excommunication).
Le mot a ensuite connu un processus de sécularisation sous l’influence des sciences naturelles. Le dictionnaire de l’Académie française définit l’assimilation comme une « action par laquelle les choses sont rendues semblables » (1762), définition que l’on retrouve dans L’Encyclopédie. Diderot met en avant l’assimilation pour expliquer, en réponse à Helvétius, que l’assimilation égalise les individus en ceci qu’elle « brouille les rangs » et annule la lignée35.
L’idée s’élargit au XIXe siècle avec la construction nationale. Ernest Renan défend la métaphore du « chaudron » pour décrire la fusion des races : « Le Français n’est ni un Gaulois, ni un Franc, ni un Burgonde. Il est ce qui est sorti de la grande chaudière où, sous la présidence du roi de France, ont fermenté ensemble les éléments les plus divers36 ».
C’est avec la question juive que l’assimilation a été mise en œuvre de manière quasiment idéaltypique37. Les débuts de la Révolution ne sont pas favorables aux Juifs, lesquels ont été exclus de la citoyenneté. Stanislas de Clermont-Tonnerre, député monarchiste libéral, prend leur défense : « il faut refuser tout aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus ; il faut qu’ils ne fassent dans l’État ni un corps politique ni un ordre ». Le député Adrien Duport (ou Du Port) propose un décret sur l’égalité politique, adopté le 27 septembre 1791 ; il prévoit que, comme tous les citoyens, les Juifs puissent jouir des droits civiques dès lors qu’ils prêtent le « serment civique ».
Une question se pose toutefois : les Juifs peuvent-ils obtenir les droits civiques s’ils conservent leurs lois et coutumes, donc s’ils restent soumis aux règles de la religion hébraïque ? Un amendement est adopté dès le lendemain qui prévoit que « la prestation du serment civique par les Juifs sera regardée comme une renonciation formelle aux lois civiles et politiques auxquelles les individus juifs se croient particulièrement soumis ». Cette formule est jugée trop radicale puisqu’elle laisse entendre que les Juifs doivent renoncer à leur religion. Une version plus modérée est approuvée, qui se contente d’indiquer que le serment « sera regardé comme une renonciation à tout privilège et exemption précédemment introduite en leur faveur ».
Il revient à Napoléon d’avoir poussé à son terme la logique visant à faire coïncider la citoyenneté et le mode de vie. À l’issue du « Grand Sanhédrin » (réunion des rabbins) qu’il organise en 1806, il appelle les Juifs à renoncer à certaines pratiques comme la polygamie, la répudiation ou les mariages non mixtes ; il exige aussi d’eux l’adoption des noms et prénoms français sous peine d’expulsion (décret du 20 juillet 1808) et leur loyauté envers la France (le décret du 17 mars 1808 enjoint aux rabbins de rappeler « en toute circonstance l’obéissance aux lois », notamment celles « relatives à la défense de la patrie »).
Cette assimilation sous contrainte a été une réussite. Au XIXe siècle, les Juifs se sont intégrés dans la société française, au point de fournir plusieurs grandes figures républicaines ou « Juifs d’État » qui ont fait carrière dans la haute administration, les arts ou l’enseignement au service des idéaux républicains38. « Je n’ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines », disait l’écrivain Romain Gary, juif d’origine russe, naturalisé en 1935.
L’assimilation est intégrée dans le droit à partir des années 1930, au moment où le pays connaît une importante vague migratoire. Elle est mentionnée deux fois dans l’ordonnance du 19 octobre 1945, d’abord à propos de la procédure de naturalisation, laquelle nécessite une « assimilation à la communauté française » (article 69), puis à propos des personnes qui sont nées en France de parents nés à l’étranger, lesquelles deviennent françaises à leur majorité sauf si elles manifestent un « défaut d’assimilation » (article 46). L’ordonnance d’octobre 1945, désormais intégrée dans le Code civil (article 21-24), précise que « nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française39 ». En juin 2011, le législateur a complété cette phrase en ajoutant la connaissance « de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française ». Une loi de 2003 a également élargi le défaut d’assimilation à des critères non linguistiques, et prévoit que la naturalisation après 4 ans de mariage peut être refusée en cas de défaut d’assimilation (une loi de 2006 a introduit la polygamie parmi les critères du défaut d’assimilation).
L’assimilation implique de restreindre certaines libertés individuelles, par exemple dans le choix du prénom des enfants. La francisation des noms juifs, impulsée par Napoléon, n’a fait que généraliser une politique mise en place pour l’ensemble de la population (loi du 11 germinal an XI de la République, 1er avril 1803) jusqu’à son abandon en janvier 1993. La loi du 25 octobre 1972 « relative à la francisation des noms et prénoms » prévoyait encore que « toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française ». Face à une forte immigration en provenance du Maghreb, il était alors convenu que la meilleure façon d’éviter les discriminations consistait à franciser les noms. Égalitariste par nature, l’assimilation vise à faire passer inaperçus les nouveaux arrivants. Autrement dit, elle rend invisible. Elle est la contrepartie d’une forte immigration : si tout le monde ne naît pas français, tout le monde peut le devenir. L’assimilation est optimiste : elle repose sur la confiance dans les institutions. Si le droit du sol a pu être instauré en 1889, peu de temps après les lois Ferry, c’est parce que l’école garantit que les enfants qui ont vécu en France vont subir un processus d’acculturation efficace.
Des conditions défavorables pour le racialisme
Bien que le terreau anthropologique et culturel français s’avère particulièrement hostile au racialisme, l’histoire n’était pas écrite d’avance. Une autre voie était possible. À deux moments, la France aurait pu basculer dans une logique raciale : lors des traites négrières et lors de la colonisation.
Mais cela n’a pas été le cas, à la fois parce que les conditions ne s’y sont pas prêtées, et parce que les forces jouant en sens contraire ont pesé plus lourd.
Les traites négrières et l’échec du racialisme
Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani, Race et histoire dans les sociétés occidentales (XV-XVIIe siècle), Albin Michel, Bibliothèque Histoire, 2021.
Les traites négrières occupent une place importante dans l’histoire de l’Occident, mais elles n’ont pas remis en cause les fondements anti-racialistes de la société française.
Il aurait pu en aller autrement, comme le montrent les changements dans l’intitulé du « Code noir ». Initialement en effet, l’édit royal de 1685 sur l’esclavage ne mentionnait pas la couleur de peau. Son titre originel était « Édit du roi touchant la police des îles de l’Amérique française ». L’objectif de ce texte était de réglementer un statut, non une race. Ce n’est qu’à partir des années 1720 que l’expression « Code noir » s’est diffusée, et que la mention « esclave nègre » fait son apparition40.
Les royaumes africains ont une responsabilité écrasante dans cette racialisation de l’esclavage. En acceptant de vendre des Africains aux Européens pour s’enrichir, ces royaumes ont instauré une coïncidence entre un statut (l’esclavage) et une couleur de peau, créant ainsi les conditions du racisme moderne. Les conséquences ont été désastreuses pour les Noirs.
Ce n’est pas le racisme qui a créé l’esclavage, c’est l’esclavage des Africains qui a créé le racisme41.
Malgré tout, la France a su éviter le racialisme. Ni le Code noir, ni aucun des textes qui suivent n’ont défini l’esclavage par l’appartenance raciale. L’homme noir n’est pas forcément esclave : il peut être affranchi ou né libre. Les Noirs et les métis peuvent quitter leur statut d’esclaves, notamment par le biais du mariage. Les « libres de couleur » subissent certes d’importantes restrictions mais leur situation doit être jugée à l’aune d’une société qui n’est pas égalitaire. Du reste, ils peuvent s’enrichir et posséder à leur tour des esclaves. Toussaint Louverture, qui a pris la tête de la révolte de Saint- Domingue, était propriétaire d’une vingtaine d’esclaves à la veille de la Révolution française. Son cas est loin d’être isolé : d’après un inventaire établi par le CNRS, 30 % des propriétaires d’esclaves indemnisés en 1825 et 1849 étaient eux-mêmes d’anciens esclaves – parfois, il est vrai, pour racheter des membres de leur famille42.
Deux signes montrent que la tentation racialiste a existé en France. Le premier concerne les mariages interraciaux, lesquels ont été interdits à la fin de l’Ancien Régime avec l’arrêt du Conseil d’État du roi du 5 avril 1778. Cet arrêt a provisoirement mis un terme à une pratique qui se développait depuis qu’un édit de 1716 avait autorisé les maîtres à venir en France avec leurs esclaves, ce qui a provoqué une hausse de la population noire et des unions mixtes. S’occuper d’un enfant noir a même été une mode chez les aristocrates : madame du Barry, la célèbre maîtresse de Louis XV, a pris sous sa protection un enfant noir, Zamor, qui causera d’ailleurs sa perte lorsqu’il la dénoncera au tribunal révolutionnaire.
Le second signe est le rétablissement de l’esclavage par Napoléon en 1802. Il est généralement admis que l’Empereur n’était ni raciste, ni esclavagiste, mais pragmatique. S’il décide de rétablir l’esclavage, c’est en raison des circonstances internationales et en réaction à la trahison de Toussaint Louverture, lequel a instauré une tyrannie locale et ambitionné de faire sécession avec la France.
Mais d’autres mesures adoptées par Napoléon avaient une tournure nettement plus racialiste : l’interdiction faite aux militaires noirs de venir à Paris (mai 1802), l’interdiction de la présence des Noirs sur le territoire métropolitain (juin 1802) ou encore la prohibition des mariages interraciaux (janvier 1803).
Toutefois, ces mesures racialistes sont demeurées ponctuelles et limitées. L’interdiction des mariages interraciaux a disparu en 1848 avec l’abolition de l’esclavage dans les colonies. Elle n’a pas connu la même histoire qu’aux États-Unis où la prohibition de ces unions a commencé dès le XVIIe siècle et s’est prolongée jusqu’à une décision de la Cour suprême de 1967, et même au-delà pour certains États.
L’absence d’une population noire sur le territoire métropolitain a certainement contribué à cet échec du racialisme. La France s’est lancée tardivement dans la traite négrière et, contrairement à d’autres pays, elle n’a pas ramené d’esclaves sur son territoire où l’esclavage était prohibé. De ce fait, la question de la race est restée périphérique : elle n’a jamais occupé une place structurante dans la vie sociale et économique, de telle sorte qu’elle n’a pas engendré un travail de codification juridique, ni débouché sur la création de groupes d’intérêts puissants.
L’absence du racialisme pendant la colonisation
Eugen Weber, La Fin des terroirs : la modernisation de la France rurale : 1870-1914, Fayard, 1983.
Rabaut de Saint-Étienne, Réflexions sur la division nouvelle du royaume, 1790.
Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, 1894.
Discours à la Chambre des députés, 28 juillet 1885.
Yerri Urban, Race et nationalité dans le droit colonial français (1865-1955), Université de Bourgogne, thèse de droit public, juin 2009.
La loi du 28 juin 1881, souvent présentée comme étant le « code de l’indigénat », n’a rien d’un code : c’est en réalité un texte très court (trois articles) qui ne fait que transférer la répression des indigènes à l’autorité administrative pour les communes mixtes.
Julien de Lasalle, « Étude sur le régime disciplinaire en Algérie : les répressions militaires, les commissions disciplinaires et l’indigénat », Bulletin de la société de législation comparée, 1889 [en ligne].
Emmanuelle Saada, « Nationalité et citoyenneté en situation coloniale et post-coloniale », Pouvoirs, vol. 160, n°1, 2017, pp.113-124 [en ligne].
Benoît De L’Estoile, Le goût des autres : de l’Exposition coloniale aux Arts premiers, Flammarion, 2007.
Après les traites négrières, le second moment où le racialisme aurait pu s’imposer est la colonisation. Mais là encore, les conditions ne s’y sont pas prêtées. Le premier empire colonial, qui a pris fin en 1763, a été trop superficiel et trop éphémère pour laisser des traces durables. Quant à la seconde colonisation, elle s’est essentiellement déroulée sous la IIIe République, donc au moment où l’égalité à été mise à l’honneur.
La colonisation ne relève pas d’un projet planifié en amont mais plutôt de rivalités entre les puissances européennes. Surtout, elle n’a pas été un bloc : ni homogène dans l’espace, ni stable dans le temps, elle recouvre des réalités différentes et évolutives.
Pour gérer son empire, la République a été tiraillée entre deux logiques : l’assimilationnisme et le différencialisme. L’assimilationnisme reprend les objectifs de la politique menée en métropole à l’égard des provinces – comparée parfois à une colonisation43. « Il n’y a plus diverses nations dans le royaume ; il n’y en a plus qu’une (…) ; il n’y a plus de Bretons, de Provençaux, Languedociens, il n’y a que des Français », disait Rabaut de Saint-Etienne pendant la Révolution pour justifier la création des départements44. C’est la même logique de rassemblement qui est envisagée un siècle plus tard pour les colonies. Dans son ouvrage Principes de colonisation et de législation coloniale45 (1894), Arthur Girault définit par exemple l’assimilation comme « l’union plus intime entre le territoire colonial et le territoire métropolitain » dans le but de créer de nouveaux départements français.
La colonisation répond certes à des objectifs de nature politique et économique, mais elle vise aussi à apporter « l’égalité, la liberté et l’indépendance aux races inférieures », selon les mots de Jules Ferry46. Cette justification morale, qui rappelle l’argument avancé par Sepulveda au xvie siècle pour soutenir la conquête des Indes, a été approuvée par les grandes figures du xixe siècle comme Tocqueville ou Hugo qui ont considéré que la colonisation se justifiait par la lutte contre l’esclavage, lequel est aboli sur tous les territoires conquis par la France.
Le terme de « race » employé par Ferry heurte aujourd’hui, mais il est utilisé dans un sens plus culturel que biologique sinon son emploi serait incohérent avec la volonté de transformer la mentalité des peuples colonisés. Nulle barrière irréductible n’est envisagée ici : il s’agit bien d’apporter la civilisation aux peuples colonisés, non de créer un système ségrégationniste. La volonté d’enseigner « nos ancêtres les Gaulois » aux quatre coins de l’empire, devenu un sujet de raillerie après la décolonisation47, représente tout le contraire d’une conception raciale : en clamant symboliquement qu’il existe une filiation commune, il s’agit de matérialiser un optimisme assimilationniste qui s’est affranchi des généalogies.
Toutefois, la mise en œuvre de cet idéal assimilationniste est complexe. Elle se heurte à divers obstacles : les cultures locales, la diversité des situations, les intérêts économiques, les risques de révolte, les pressions des colons, autant de facteurs qui vont donner lieu à divers aménagements juridiques, critiqués en leur temps au nom des principes républicains48.
En Algérie notamment, le sénatus-consulte de 1865, légué par le Second Empire, prévoyait de laisser les musulmans et les Juifs sous leur statut personnel. Cette différenciation relevait moins d’une logique raciale que d’une préoccupation culturelle : dans l’optique du « royaume arabe » de Napoléon III, il s’agissait de respecter les cultures islamiques et judaïques, conformément aux recommandations des Saint-simoniens, ces théoriciens avant-gardistes du multiculturalisme. Du reste, les musulmans et les Juifs avaient la possibilité de changer de statut. Si la naturalisation a été réclamée collectivement par les Juifs (ce qu’ils ont obtenu en 1870 avec le décret Crémieux), les musulmans ont au contraire préféré conserver leur législation islamique.
Le fameux code de l’indigénat, tant décrié aujourd’hui bien qu’il n’ait jamais existé49, concernait simplement des règles de haute police destinées à gérer les territoires conquis où plusieurs révoltes se sont produites. Conçu comme temporaire, géré initialement par l’armée, ce code a très vite suscité un malaise de la part des pouvoirs publics, qui y ont vu une « monstruosité juridique50 ». Il a donc été progressivement réduit avant d’être abandonné au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Dans l’empire colonial français, si les indigènes étaient des sujets (ils avaient la nationalité française sans posséder les droits civiques), ils n’étaient pas démunis de droits politiques. Le blocage se situait moins du côté de la race que du côté de la culture : peut-on accorder la citoyenneté à des populations qui sont régies par leur statut personnel ? En d’autres termes, peut-on être citoyen français tout en étant soumis à d’autres règles que celles du Code civil ? Dans le cas de l’Algérie, la réponse a été négative : pour être citoyen, il fallait renoncer à la loi coranique. Mais dans d’autres cas, elle a été positive comme au Sénégal ou en Inde51. À Tahiti, le traité d’annexion de 1880 accordait la pleine citoyenneté aux habitants – du moins à ceux qui parlaient français.
Rien n’exprime mieux ces tiraillements républicains que l’Exposition coloniale de 1931. Cet événement, organisé par le maréchal Lyautey, est aujourd’hui considéré comme un « zoo humain », ce qui est un contresens car il s’agissait au contraire de valoriser les populations colonisées pour mieux exalter la grandeur de la France. La confusion découle du fait que, parallèlement à l’Exposition coloniale, une initiative privée a conduit à installer un « village kanak » au Jardin d’Acclimatation du bois de Boulogne. Cette animation, qui présentait les Kanaks comme des cannibales, a été dénoncée en son temps. Lyautey a mis à la retraite le gouverneur de Nouvelle-Calédonie qui avait apporté son aide à cet événement. En réalité, l’Exposition coloniale a mis en scène trois types de récits qui ont finalement parcouru toute l’histoire de la colonisation, et dont aucun n’est de nature racialiste : le primitivisme, l’évolutionnisme et le différentialisme52. Le primitivisme prolonge l’idéal du bon sauvage vivant en harmonie avec la nature ; l’évolutionnisme repose sur la vision optimiste du progrès qui prolonge l’idéal assimilationniste ; et le différentialisme célèbre la diversité des cultures. Ces trois récits témoignent à leur manière d’un authentique respect pour le « goût des autres » dont le musée de l’Homme (1937) ou plus tard le musée du Quai-Branly (2006) constituent la traduction concrète.
Le rejet de la race dans le discours savant
« Si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens » dans Montesquieu, « De l’esclavage des nègres », De l’Esprit des lois, XV-5, 1748.
Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, Gallimard, Folio Classique, 2002 [1776].
L’un des ouvrages les plus favorables à l’esclavage est une réaction à cette idéalisation : il s’agit du livre de Louis-Narcisse Baudry des Lozières, un aristocrate esclavagiste de Saint-Domingue, intitulé Les égaremens du nigrophilisme (Paris, Migneret, 1802). L’auteur part du constat que l’esclavage « est un monstre aux yeux d’une partie de l’Europe », mais il entreprend d’en démontrer le bien-fondé en expliquant que, d’une part les colonies sont devenues indispensables aux Européens, et d’autre part que ces derniers ne sont pas capables de travailler sous ces latitudes pour produire ce dont ils ont besoin. Avec cynisme, il ajoute que la condition d’esclave est un moindre mal par rapport aux conditions de vie en Afrique où, dit-il, les tyrans locaux font passer Robespierre pour un amateur. Il en conclut même que la traite est l’expression d’une compassion humanitaire.
Claude Rétat, « Jules Michelet, l’idéologie du vivant », Romantisme, vol. 130, n°4, 2005, pp. 9-22.
Sylvain Venayre, « Le mythe de l’origine chez les historiens français du xixe siècle », dans Les historiens croient-ils aux mythes ? Éditions de la Sorbonne, 2016.
Son livre Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855) a eu très peu d’écho en France, où il s’est vendu à quelques dizaines d’exemplaires.
Tocqueville écrit ainsi à Gobineau le 14 janvier 1857 : « Le christianisme a évidemment tendu à faire de tous les hommes des frères et des égaux (…). Soyez sûr, dis-je, que dans le monde, le gros des chrétiens ne peut pas éprouver la moindre sympathie pour vos doctrines », dans « Correspondance entre Alexis de Tocqueville et Arthur de Gobineau », Revue des Deux mondes, tome 40, 1907 [en ligne].
Jean-Marc Bernardini, Le darwinisme social en France (1859-1918) : fascination et rejet d’une idéologie. CNRS Éditions, 1997 [en ligne].
Daniel J. Kevles (Daniel J.), Au nom de l’eugénisme : génétique et politique dans le monde anglo-saxon, PUF, 1995.
Carole Reynaud-Paligot, L’école aux colonies. Entre mission civilisatrice et racialisation 1816-1940, Champ Vallon, La chose publique, 2020.
Jean-Claude Wartelle, « La Société d’Anthropologie de Paris de 1859 à 1920 », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, vol. 10, n°1, 2004, pp.125-171.
Jean-Marie Guyau, Éducation et Hérédité : étude sociologique, Paris, Félix Alcan, 1889.
Laurent Cordonier, La nature du social : l’apport ignoré des sciences cognitives, PUF, 2018 ; Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines, La Découverte, 2023.
À Moscou, l’obélisque des Romanov, détournée par les bolchéviques pour rendre hommage aux penseurs socialistes, comporte de nombreux auteurs français.
L’une des meilleures preuves de l’échec du racialisme réside dans l’attitude des élites savantes. De fait, la tradition intellectuelle française a rarement fait de la race un facteur explicatif. Lorsque Montesquieu réfléchit aux prédispositions des peuples vis-à-vis de la liberté, dans le but de comprendre pourquoi se forme un « génie de liberté » ou au contraire un « esprit de servitude », il s’en remet au rôle du climat et use de l’ironie pour dénoncer les esclavagistes qui refusent de considérer les « nègres » comme des hommes à part entière53.
La thèse de Montesquieu sur le climat a été âprement discutée. Approuvée par Rousseau, contestée par Voltaire pour son côté réducteur, elle a donné lieu à de longs débats jusqu’au xxe siècle mais un point est sûr : elle n’a jamais été remplacée par une explication de type racialiste.
Pourtant, une théorie de la race aurait pu trouver sa place au siècle des Lumières. Avec la critique du christianisme et l’idéalisation de la science, un terreau existait. La découverte de peuplades morphologiquement très typées aurait pu mener le discours savant vers la thèse polygéniste par réaction à la vision adamique de l’unité de l’espèce humaine, ce qui va du reste se produire un siècle plus tard avec Paul Broca et la Société d’anthropologie de Paris.
Mais les affrontements politiques et religieux ont fermé la porte à cette option. Loin d’être méprisés, les peuples primitifs ont en effet fourni un solide argument aux partisans du contrat social pour dénoncer l’absolutisme et le christianisme. Le Tahitien de Diderot54 est arrivé à pic : il a permis de créer un imaginaire positif sur l’état de nature et de fonder empiriquement la thèse selon laquelle d’autres formes d’organisation sociale sont possibles.
En somme, l’idéalisation de l’Autre fut proportionnelle à la critique de la société monarchiste et chrétienne : si les peuplades primitives ont été valorisées, c’est pour mieux dénoncer les vices de la société d’Ancien Régime55. Les réflexions sur le contrat social ont fait office de bouclier : la figure du primitif, supposée incarner l’humanité dans son état originel d’innocence et de pureté, a fourni la preuve vivante que les institutions ne sont que des conventions sociales, ce qui a laissé peu de place à une vision dépréciative des peuples sauvages.
Par la suite, une large partie de la pensée française a ignoré la race. Les grandes théories explicatives de l’histoire se sont bien gardées d’y faire référence. La théorie germaniste des origines de la France a beau avoir été relancée au xixe siècle par Augustin Thierry, qui a proposé de décrypter la Révolution française comme une revanche de la race conquise (les Gaulois) sur la race conquérante (les Francs), elle a été rejetée par les contemporains comme Jules Michelet56 et, plus tard, par Fustel de Coulanges. Par anti-germanisme après la défaite de 1870, ce dernier ne pouvait pas concevoir que la nation française fût redevable à l’égard des Francs, donc des Allemands57.
Les théories raciales sont restées périphériques dans la vie intellectuelle. On serait bien en peine de citer un authentique théoricien de la race, mis à part Arthur de Gobineau. Mais ce dernier est resté marginal58. Signe de son échec : sa thèse sur la décadence par métissage racial a été rejetée par son ami et mentor Alexis de Tocqueville, lui aussi aristocrate, qui renvoie Gobineau dans ses cordes au nom du message chrétien de l’égalité entre les hommes59.
Ce n’est pas un hasard si c’est en France qu’a émergé la théorie de l’hérédité des caractères acquis, conçue par Lamarck peu après la Révolution française. En fidèle lecteur de Rousseau, Lamarck avance une théorie de l’évolution qui s’appuie sur une conception très souple du vivant, faisant la part belle aux mutations des organismes sous l’influence de l’environnement. Le néo-lamarckisme va durablement imprégner les élites françaises au point d’empêcher l’émergence du darwinisme social, lequel repose sur une conception peu malléable des êtres vivants.
Le darwinisme social, au même titre que le racialisme, n’est jamais parvenu à pénétrer les élites et les intellectuels français, sans doute aussi à cause d’une profonde réticence pour les idées libérales dans un pays qui sacralise le rôle de l’État60. De là provient l’échec des politiques eugénistes, alors que celles-ci ont su prospérer dans les pays anglo-saxons et scandinaves où elles ont été activement mises en œuvre61. Même le régime de Vichy s’en est tenu à une approche classiquement nataliste (allocations familiales, accouchement sous X) malgré les efforts d’Alexis Carrel, l’un des rares promoteurs de l’eugénisme en France, dont le seul succès est d’avoir instauré les modestes certificats de nuptialité. À aucun moment, les gouvernements français n’ont mis en œuvre des politiques de stérilisation forcée.
Certes, une anthropologie physique s’est constituée au xixe siècle, caractérisée par l’étude des races humaines dans le contexte de la colonisation en Afrique, mais son importance ne doit pas être exagérée. La Société d’anthropologie de Paris, créée en 1860 par Paul Broca, libre-penseur et brillant scientifique, a certes entrepris de démontrer la diversité des aptitudes raciales et sexuelles à l’aide des mensurations crâniennes, mais cette école a été dénuée de toute influence politique, notamment dans les colonies, même si le facteur racial a pu être avancé pour expliquer les difficultés rencontrées par la République dans ses ambitions éducatives62.
La science racialiste a rapidement été marginalisée. Son apogée se situe dans les années 1880-1890, jusqu’au moment où les sciences sociales ont pris leur essor et se sont institutionnalisées. Son seul disciple est Vacher de Lapouge, rare partisan assumé de l’eugénisme en France et militant socialiste engagé63. Même Gustave Le Bon ne retient de Broca que sa craniométrie des femmes, préférant privilégier une interprétation culturelle pour expliquer les divergences entre les civilisations.
À la fin du xixe siècle, la sociologie française va complètement rejeter la race et, plus généralement, la biologie et l’hérédité. Emile Durkheim l’affirme sans ambages : il faut expliquer le social par le social. Pour démontrer la pertinence de cette science du social dont il se fait le défenseur, il prend soin de réfuter la race parmi les causes du suicide. Avant lui, un personnage comme Jean-Marie Guyau, fils d’Augustine Tuillerie (pseudonyme de G. Bruno, l’auteur du Tour de la France par deux enfants) et beau-fils d’Alfred Fouillée, s’est attaché à relativiser les théories de l’hérédité64. Des auteurs comme Marcel Mauss ou Arnold Van Gennep, convaincus de l’unité fondamentale du genre humain, se détournent de l’anthropologie raciale et développent une ethnologie strictement sociale.
Depuis, les sciences sociales ont toujours fait prévaloir les facteurs sociaux sur les origines ethniques ou raciales, ainsi d’ailleurs que sur l’ensemble des critères biologiques, quitte parfois à tomber dans un excès inverse en négligeant totalement la nature, comme l’ont récemment souligné Laurent Cordonier ou Bernard Lahire65.
Cette prévalence du social est confirmée par un indice : alors que les intellectuels français ont été très nombreux à abonder dans l’idéologie communiste66, ils n’ont en rien contribué à l’idéologie nationale-socialiste. Le seul auteur qui aurait pu avoir de l’influence est Gobineau, mais celui-ci estimait que la décadence des races sous l’effet du métissage était trop avancée pour rendre possible un retour à l’état de pureté originelle. Pire : comme il ne hiérarchisait pas clairement les races, et qu’il avait même tendance à louer les Juifs – qu’il classait dans la race blanche – il a été jugé infréquentable par les nazis. En France, aucun intellectuel n’a prôné l’extermination des populations africaines, comme a pu le faire en Allemagne le pasteur Paul Rohrbach, contribuant ainsi à justifier le premier génocide du xxe siècle avec le massacre des Hereros en Namibie.
Aux sources politiques de l’antiracisme
Maurice Barrès, Les diverses familles spirituelles de la France, Emile-Paul Frères Editeurs, 1917. Même Vichy préservera les anciens combattants juifs en leur faisant une place à part dans le statut d’octobre 1940 (voir l’article 3).
Charles Maurras, « Le Nationalisme français et le Nationalisme allemand », avril 1937 [en ligne].
Jacques Bainville, Histoire de France, 1924.
Paul Yonnet, Voyage au centre du malaise français. L’antiracisme et le roman national, Gallimard, 1993.
Antoine Math, « À la croisée d’enjeux nationaux et internationaux : la protection sociale des personnes étrangères ressortissantes d’un pays non-membre de l’Union européenne », Informations sociales, vol. 203-204, n°2-3, 2021, pp.158-166 [en ligne].
Une loi de 2008 est cependant venue corriger cette étrangeté aux effets potentiellement dévastateurs en rappelant que la discrimination en fonction de la nationalité est légitime pour l’accès à la fonction publique.
« Sans distinction de … race », Mots. Les langages du politique, n°33, décembre 1992. Cette proposition a été relancée en 2018, sans plus de succès malgré un vote favorable de l’Assemblée nationale. Voir, « L’Assemblée supprime de la Constitution le mot ‘race’ et interdit la ‘distinction de sexe’ », Le Monde, 12 juillet 2018 [en ligne].
La mise en place de la IIIe République a porté un coup supplémentaire au racialisme : non seulement les théories raciales se sont trouvées incompatibles avec l’égalité civique, mais de surcroît la race et l’hérédité ont été rejetées en raison de leur lien avec la monarchie d’Ancien Régime.
La mouvance royaliste elle-même n’a guère repris le thème de la race, pas plus que le camp nationaliste : la germanophobie issue de la défaite de 1870 et de la guerre de 1914-1918 l’en a empêché. Le revirement de Maurice Barrès sur l’antisémitisme est révélateur : la guerre n’est pas encore terminée que celui-ci célèbre l’engagement des « diverses familles spirituelles » dans la défense de la patrie, incluant les Juifs67. Même Xavier Vallat, futur commissaire aux questions juives sous Vichy, n’est pas indifférent à la fraternité des armes : après avoir déclaré à la Chambre en juin 1936, à propos de Léon Blum, que « pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un Juif », il prend la peine de rejeter l’accusation d’antisémitisme en ajoutant : « je n’entends pas oublier l’amitié qui me lie à mes frères d’armes israélites ».
La fraternité des tranchées a laissé des traces profondes. La haine des Allemands aussi. Pour Charles Maurras, la germanophobie fait office de vaccin contre le racialisme. Rejetant Gobineau68, il rattache le racisme et l’antisémitisme aux lubies allemandes. « Nous sommes des nationalistes. Nous ne sommes pas des nationalistes allemands. Nous n’avons aucune doctrine commune avec eux. Toutes les falsifications, tous les abus de textes peuvent être tentés : on ne fera pas de nous des racistes ou des gobinistes. Nous ne croyons pas aux nigauderies du racisme ». De son côté, l’historien Jacques Bainville, républicain devenu royaliste au service de l’Action française, déclare peu après la guerre de 1914 que « le peuple français est un composé. C’est mieux qu’une race. C’est une nation69 ».
La guerre de 1940 achève de discréditer la race. Le discrédit est aussi bien politique que scientifique. L’antiracisme devient un « roc civilisationnel70 » : érigé en norme internationale, il est conforté par les organisations gouvernementales et non gouvernementales. C’est dans le cadre d’une campagne organisée par l’UNESCO que Claude Lévi-Strauss présente sa conférence « Race et histoire » en 1952.
En France, le rejet de la race après la guerre doit beaucoup à la Shoah mais elle doit aussi beaucoup à la question coloniale. En effet, la guerre a fragilisé la légitimité des puissances européennes. Des droits doivent être concédés aux colonies. La Constitution de 1946 affirme que « le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».
La création de l’Union française précise que « la France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion ».
D’autres facteurs vont jouer contre la race. La mise en place de la sécurité sociale obligatoire en 1945, en redéfinissant les droits individuels à partir du travail et de la production, associe plus étroitement les étrangers à la communauté nationale. Un mouvement s’enclenche en faveur d’un alignement du droit des étrangers sur celui des nationaux, alignement qui, déjà ancien, ne va cesser de s’approfondir.
L’anti-américanisme ajoute une autre couche. De la même façon que la germanophobie a déconsidéré l’antisémitisme, l’anti-américanisme, si présent dans la France d’après 1945, déconsidère le racisme qui est vu comme l’attitude d’un pays fruste, incapable de dépasser les différences physiques et de tourner le dos à son passé esclavagiste. Ce sentiment de supériorité se vérifie dans un reportage de la télévision française d’avril 1964 où quatre personnalités afro-américaines sont présentées : les chanteuses Nancy Holloway et Hazel Scoot, le photographe Emil Cadoo et l’écrivain William Gardner Smith. Tous les quatre ont choisi de vivre en France en raison, d’après leurs propres déclarations, de l’absence de racisme71. Le ton du reportage est à la fierté nationale : on s’enorgueillit que la France ne soit pas aussi raciste que les États‑Unis. Un éloge de l’assimilation clôt le reportage : sur fond d’images de Noirs en costume-cravate, le commentateur se flatte de constater que les Américains ont été « conquis par la baguette de pain et le paquet de Gauloises ».
Avec la chute du bloc soviétique en 1989-1991, une ère de paix semble s’ouvrir. La figure de l’ennemi disparaît. Le dépassement des frontières, déjà largement amorcé par la construction européenne et le GATT, paraît à portée de main. Tout invite à l’optimisme : le traité de Maastricht adopté en 1992, Internet lancé en 1993, l’OMC mise en place en 1994. Un monde pacifié, régi par les droits humains universels, devient l’horizon des nouvelles générations.
La nationalité cesse d’être un critère de distinction légitime. Le « privilège du national » achève de s’effacer lorsqu’il s’agit d’accéder aux droits sociaux72. La « préférence nationale », qui allait jusque-là de soi, devient synonyme d’exclusion et se voit associée au racisme. La xénophobie elle-même se confond avec le racisme. Tout traitement différencié entre nationaux et étrangers devient suspect. La fonction publique s’ouvre aux étrangers européens (1991) et le nouveau Code pénal (1994) range la nationalité parmi les critères de discrimination prohibés73. Les étrangers européens peuvent voter aux élections locales et européennes.
Le mot « race » lui-même, déjà peu légitime, se voit encore plus récusé : son emploi nécessite de fortes précautions de langage. Une première polémique éclate en 1992 : a-t-il encore sa place dans les textes juridiques, notamment dans la Constitution74 ? Parce qu’il est accusé de créer le racisme, le mot est invité à disparaitre de la Constitution où il est pourtant utilisé comme un verrou contre le racisme.

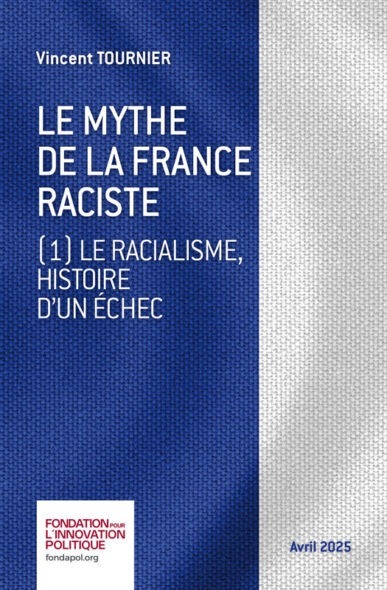










Aucun commentaire.