Les apports du christianisme à l'unité de l'Europe
Face aux identités nationales, l’identité européenne paraît bien fragile. Force est de constater que le christianisme n’est pas un ferment suffisant pour surmonter les divisions nationales.Introduction
Un espace spirituellement unifié ?
Une théologie de la personne
Une théologie de la paix
Jérusalem, Athènes et Rome
Un paysage européen né du christianisme
La connaissance transmise par l’université
Conclusion
Résumé
L’Europe navigue entre unité et diversité, et c’est cette dialectique qui a présidé à sa formalisation institutionnelle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais d’où vient cette aspiration à l’unité ?
Pour répondre à cette question, il est essentiel de rappeler les apports essentiels du christianisme dans la modélisation de la culture européenne. La philosophie chrétienne a historiquement produit les composants essentiels du projet européen d’unification politique etculturelle du continent à travers deux concepts clés : la personne – et les droits fondamentaux centrés autour de celle-ci – et la paix. L’organisation des territoires et le développement des connaissances, avec la création des universités, puisent également leurs racinesdans le christianisme.
C’est bien cette diversité d’apports, mélangés et mutuellement nourris, qui a sensiblement marqué le fonctionnement de nos sociétés les plus contemporaines.
Cependant, une certaine unité culturelle forgée par le christianisme ne signifie pas qu’une identité européenne émerge réellement. Face aux identités nationales, l’identité européenne paraît bien fragile. Force est de constater que le christianisme n’est pas un ferment suffisant pour surmonter les divisions nationales.
Jean-Dominique Durand,
Historien, spécialiste d’histoire religieuse et notamment du christianisme, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Jean Moulin-Lyon III. Il est adjoint au maire de Lyon et ancien conseiller culturel de l’Ambassade de France auprès du Saint-Siège.
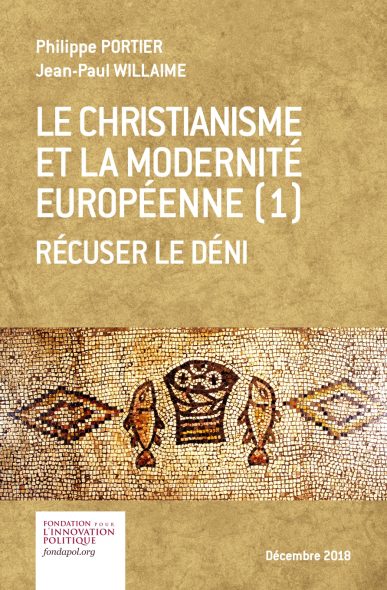
Le christianisme et la modernité européenne (1) récuser le déni
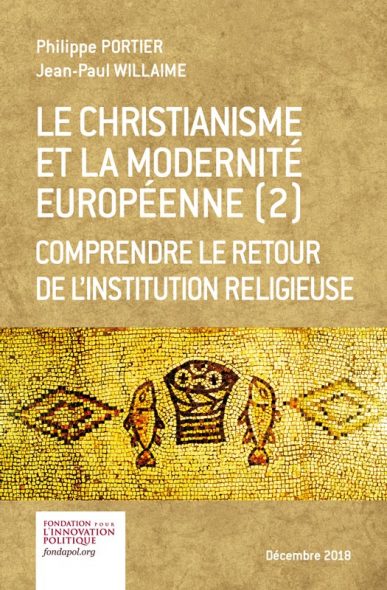
Le christianisme et la modernité européenne (2) comprendre le retour de l'institution religieuse
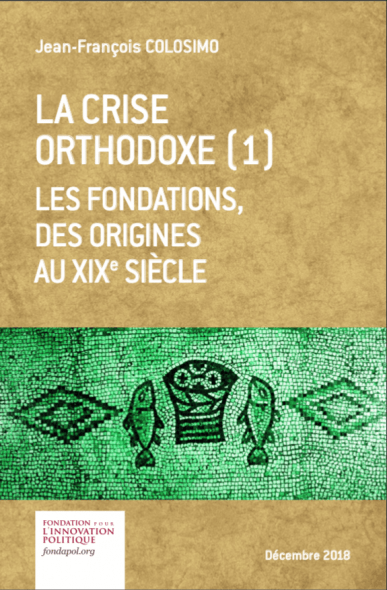
La crise orthodoxe (1) Les fondations, des origines au XIXème siècle
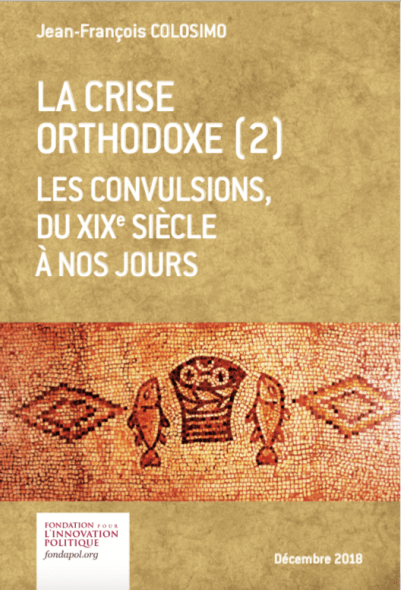
La crise orthodoxe (2) les convulsions, du XIXème siècle à nos jours
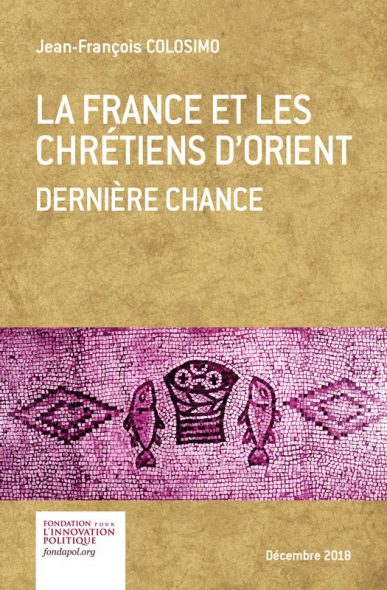
La France et les chrétiens d'Orient dernière chance
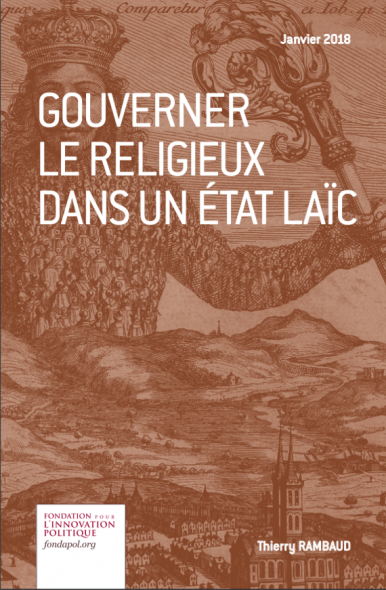
Gouverner le religieux dans un État laïc

La religion dans les affaires : la finance islamique

La religion dans les affaires : la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise)
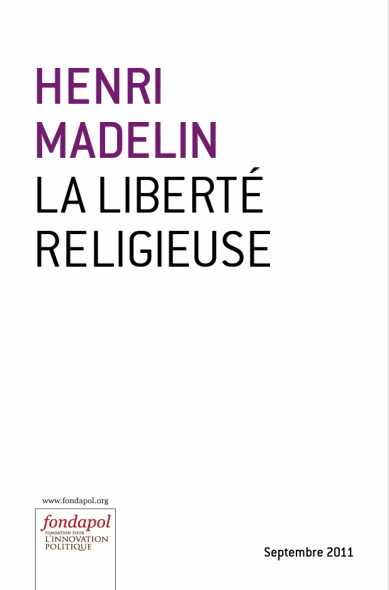
La liberté religieuse

Où va la politique de l’Église catholique ? D’une querelle du libéralisme à l’autre

Portrait des musulmans d’Europe : unité dans la diversité

Portrait des musulmans de France : une communauté plurielle
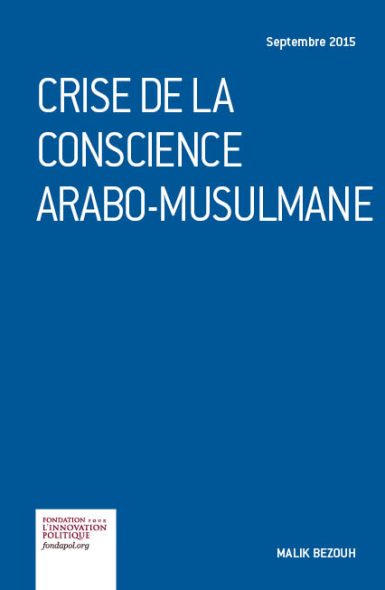
Crise de la conscience arabo-musulmane
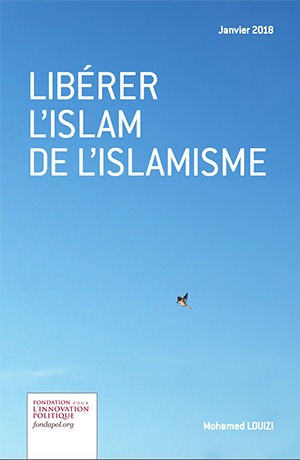
Libérer l'islam de l'islamisme
Introduction
La bibliographie sur ces trois personnalités est considérable et il n’y pas lieu de la reproduire ici, mais un ouvrage, de style plutôt apologétique, présente cependant l’avantage d’offrir un portrait croisé : Giuseppe Audisio et Alberto Chiara, Schuman, Adenauer, De Fondateurs de l’Europe unie selon le projet de Jean Monnet, Salvator, 2004.
Voir Jacques Gadille, « Conscience internationale et conscience sociale dans les milieux catholiques d’expression françaisedans l’entre-deux-guerres », Relations internationales, n° 27, automne 1981, 361-374.
Sur la démocratie chrétienne, voir Jean-Dominique Durand, L’Europe de la démocratie chrétienne, Complexe, 1995 ; Gérard Bossuat, Les Fondateurs de l’Europe, Belin, 2000 ; Philippe Chenaux, De la chrétienté à l’Europe. Les catholiques et l’idée européenne au XXe siècle,CLD, 2007 (en particulier le chapitre V, « Robert Schuman, Konrad Adenauer et Alcide De Gasperi »).
Voir Jean-Dominique Durand, « Giovanni Paolo II e l’Europa Al di là della secolarizzazione », dans Elio Guerriero et Marco Impagliazzo (dir.), Storia della Chiesa. I cattolici e le Chiese cristiane durante il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005),San Paolo Edizioni, 2006, p. 39-69.
Karol Wojtyła, « Una frontiera per l’Europa: dove? », Vita e Pensiero, n° 4-6, juillet-décembre 1978, 160-168
« Discours du pape Jean-Paul II lors de la visiste au Parlement européen », 11 octobre 1988
L’action développée par des hommes politiques d’inspiration chrétienne en faveur de la construction d’une Europe unie est bien connue. Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi et Robert Schuman représentaient peut-être « trois tonsures sous la même calotte », selon le président de la République française Vincent Auriol, mais ils exprimaient avant tout trois volontés politiques de construire ensemble une Europe radicalement nouvelle. Cette Europe, ils la voulaient fondée sur la réconciliation et la définition d’un destin commun sur la base de délégations de souveraineté. Mais, d’une certaine manière, Vincent Auriol voyait juste : leur engagement européiste, fruit d’une expérience commune des guerres et de la frontière, était fondé sur leur foi1. Ils faisaient partie de ces chrétiens qui, sous l’impulsion du magistère pontifical, de Benoît XV, Pie XI et Pie XII, avaient retenu que le message évangélique portait en lui des conséquences sur le plan des relations entre les peuples2.
Il ne s’agit pas ici de retracer le rôle de chrétiens, responsables politiques, philosophes, artistes, historiens, dans la construction européenne à l’époque contemporaine, notamment après 19453, mais d’en mesurer le substrat. Car si l’engagement européiste des chrétiens, qui deviendra militantisme pour une Europe unie, est bien sûr lié à des contingences politiques et économiques – la Seconde Guerre mondiale, les exigences de la reconstruction, le refus des risques d’une nouvelle guerre, le poids de l’Union soviétique et des États-Unis – il s’appuie sur tout un passé qui paraît intégré dans les modes de pensée comme une évidence : l’histoire chrétienne de l’Europe conduirait à une unité intrinsèque que les aléas de l’histoire et les intérêts contradictoires des États ont mise à mal. On le perçoit fort bien dans la vision globale, unificatrice que le pape Jean-Paul II avait de l’Europe, qu’il invitait à respirer avec ses« deux poumons4 ». Archevêque de Cracovie, le cardinal Karol Wojtyła publia durant l’été 1978 un article dans lequel celui qui devait devenir pape quelques semaines plus tard s’opposait à l’idée d’une Europe limitée à sa partie occidentale5. Il insistait sur l’unité intrinsèque du continent née d’un patrimoine chrétien partagé. Plus tard, en 1988, Jean-Paul II parlera de son rêve de voir l’Europe « un jour se déployer aux dimensions que lui ont données la géographie et plus encore l’histoire6 ».
Un espace spirituellement unifié ?
Une traduction de son « traité destiné à établir la paix dans toute la chrétienté » (1464) figure dans le livre de Jean- PierreFaye, L’Europe Les philosophes et l’Europe, Gallimard, 1992, p. 51-70.
Federico Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Laterza, 1961, p. 204.
Ibid., p. 195.
René Rémond, Religion et société en Europe. La sécularisation aux XIXe et XXe siècles, 1789-1998, Seuil, 1998, p. 31.
Cité dans Denis de Rougemont, Vingt-huit siècles d’Europe. La conscience européenne à travers les textes. D’Hésiode à nos jours [1961],Christian de Bartillat, 1990, p. 208-213.
Ibid., p. 172-174.
Thoma S Eliot, Notes towards the Definition of Culture. Appendice: The unity of European Culture, Faber & Faber, 1948, p. 123. Pour uneréflexion sur les approches de l’Europe par les intellectuels, voir Jean-Luc Chabot, Aux origines intellectuelles de l’Union européenne. L’idée d’Europe unie de 1919 à 1939, PUG, 2005 ; Yves Hersant et Fabienne Durand-Bogaert (dir.), Europes. De l’Antiquité au XXe siècle.Anthologie critique et commentée, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2000.
Voir Franco Cardini, Le radici cristiane, Il Cerchio, 2002 ; Gérard-François Dumont (dir.), Les Racines de l’identité européenne,Economica, 1999.
Voir Esther Benbassa, La Souffrance comme identité, Fayard, 2007.
Pour une vision globale de l’histoire de l’Europe, voir Jean-Baptiste Duroselle, L’Europe. Histoire de ses peuples, Perrin, 1990.
Emmanuel Todd, L’Invention de l’Europe, Seuil, 1990, p.17.
Denis de Rougemont, « Originalité de la culture européenne comparée aux autres cultures » [1960], Schweizer Monatshefte, tome 40 (avril 1960-mars 1961), 510, en allemand
Voir Andrea Riccardi, Vivre ensemble, Desclée de Brouwer, 2007 ; Grace Davie et Danièle Hervieu-Léger (dir.), Identités religieuses en Europe, La Découverte, 1996.
Mt XXII, 21 ; Mc XII, 17 ; Lc XX, 25 (trad. Émile Osty).
Jn XVIII, 36 (trad. Émile Osty).
Voir René Rémond, « La laïcité », in René Rémond (dir.), Les Grandes Inventions du christianisme, Bayard Éditions, 1999, 97-116.
Le mot « Europe » aurait été utilisé par le pape Nicolas V en 1453, après la chute de Constantinople, pour exprimer la nécessaire union des forces chrétiennes face à l’expansion de l’islam et au danger représenté par l’Empire ottoman. « Europe » signifiait alors Chrétienté. Lorsque le roi de Bohême Georges de Poděbrady proposa, en 1464, un projet de fédération européenne, « une communauté », il s’agissait de résister aux Turcs et d’identifier l’Europe et le monde chrétien face à l’islam en expansion7.
« Dans la formation du concept d’Europe et du sentiment européen, écrivait l’historien italien Federico Chabod, qui était par ailleurs un militant laïc, les facteurs culturels et moraux ont eu, dans la période décisive de sa formation, une prééminence absolue, et même exclusive8. » Il précisait : « Nous sommes chrétiens et nous ne pouvons pas ne pas l’être […]. Nous ne pouvons pas ne pas l’être même si nous ne pratiquons pas, parce que le christianisme a modelé pour toujours nos manières de sentir et de penser ; c’est au verbe chrétien, sans nul doute l’événement majeur de l’histoire universelle, que tient la profonde différence entre nous et les Anciens, entre notre mode de sentir et celui d’un contemporain de Périclès ou d’Auguste. Ni les libres penseurs ni les anticléricaux ne peuvent échapper à ce destin commun9. »
De son côté, René Rémond observait que l’Europe a la particularité d’être l’unique continent entièrement christianisé, et il soulignait que pour beaucoup de peuples européens (pour les Hongrois et les Polonais, par exemple), la conversion au catholicisme a coïncidé avec la naissance même de la nation, liant ainsi indissolublement identité nationale et identité religieuse : « Cette commune appartenance chrétienne est une composante de l’identité européenne. Elle crée une différence originelle avec les autres continents, qui s’atténuera avec le mouvement missionnaire par lequel l’Europe apportera sa foi aux autres mondes10. » Il est aisé de multiplier les citations de grands auteurs allant dans le même sens pour définir l’unité fondamentale de l’Europe, de Goethe, pour qui « la langue maternelle de l’Europe est le christianisme11 », à Kant, qui voyait dans l’Évangile «la source d’où notre civilisation a jailli12», jusqu’à l’Américain Thomas S. Eliot qui insistait sur l’unité culturelle de l’Europe et notait : « Un citoyen européen peut ne pas croire que le christianisme est vrai et pourtant ce qu’il dit et fait provient de la culture chrétienne dont il est l’héritier13. »
Pourtant, du point de vue religieux, l’Europe est historiquement marquée par le pluralisme, ce qui n’exclut pas la puissance de l’empreinte du christianisme et la vitalité des racines chrétiennes constamment rappelées par Jean-Paul II et par Benoît XVI dans le contexte du débat, au début des années 2000, concernant le préambule du traité constitutionnel de l’Union européenne14.
On peut distinguer une mémoire juive, ancienne, puisque l’on observe une présence juive à Rome dès le Ier siècle avant notre ère, mémoire notamment faite de douleurs15, de l’expulsion des Juifs d’Espagne jusqu’à la Shoah. Celle-ci est d’autant plus importante que c’est, entre autres, du génocide des Juifs qu’est née la conscience de la nécessité de construire l’Europe autrement. Il faut tenir compte aussi des mémoires des schismes, particulièrement de la rupture entre Latins et Grecs de 1054, avec un double anathème lancé par Rome et Constantinople. La chrétienté latine s’est déchirée au XVIe siècle avec la Réforme protestante, elle-même pleine de nuances et de divisions internes. S’y ajoutent les mémoires des persécutions, des guerres entre religions, encore actives il y a peu en Irlande, par exemple, ou des guerres entre confessions chrétiennes. La mémoire du génocide des Arméniens dans l’Empire ottoman interroge elle aussi la conscience européenne.
Non moins vivaces sont les préjugés et les divisions entre peuples, ethnies et groupes linguistiques : l’Europe présente une pluralité culturelle difficile à composer16. Emmanuel Todd parle à ce propos de « fragmentation anthropologique » de l’Europe17. Denis de Rougemont notait que « cet état de polémique permanente portant sur les principes fondamentaux de toute culture ou civilisation n’a pas produit seulement de l’anarchie et des guerres. Il a contraint les élites, et par elles la partie agissante des masses européennes, à développer ce que je voudrais appeler les trois vertus cardinales de l’Europe : le sens de la vérité objective, le sens de la responsabilité personnelle, et le sens de la liberté18 ».
La période actuelle paraît paradoxalement marquée par une nouvelle rigidité de ces frontières de l’esprit. On brandit ici et là un « devoir de mémoire » qui peut se révéler très dangereux lorsque la passion l’emporte sur l’historicisation de la pensée, comme on peut le constater dans les Balkans. À l’Est, l’exemple de la Russie orthodoxe et de ses relations toujours complexes avec le catholicisme et l’Occident invite à parcourir à nouveaux frais l’histoire des grands courants intellectuels russes, du slavophilisme et de l’occidentalisme. À l’intérieur même de l’Union européenne, l’heure est à la diversification des cultures et au repli identitaire alors qu’elle est plus que jamais terre du pluralisme religieux. Elle vit de cepoint de vue une véritable révolution culturelle, avec l’émergence rapide d’une société multiculturelle et multireligieuse, liée aux migrations de masse19. En même temps, elle voit émerger en son sein de nouvelles peurs, de nouveaux replis sur soi, voire des néo nationalismes, qui tendent à exacerber l’idée de frontière et à exalter ou à manipuler un christianisme qui serait l’unique fondateur de l’Europe. Or celle-ci constitue l’espace dans le monde le plus dense de rencontres entre les peuples et les traditions culturelles. Là est l’âme de l’Europe, dans la trame d’unité fournie par le judéo-christianisme, enrichie par d’autres apports tels que l’islam, présent avec l’installation des Omeyyades en Espagne au début du VIIIe siècle, mais aussi en Sicile et dans les Balkans.
L’Europe se trouve plongée dans la question des rapports entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, autrement dit entre religion et politique. Si ces relations furent souvent tumultueuses, si la France a opté pour une séparation inscrite dans la loi de 1905 et une laïcité rigoureuse, si chaque État européen a construit ses propres solutions par rapport aux religions, l’ensemble de l’Europe est marquée fondamentalement par la parole du Christ qui invitait à rendre « à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu20 », tout en affirmant que son « Royaume n’[était] pas de ce monde21 ». Invitant à distinguer deux ordres de réalité, le Christ récusait de ce fait toute forme de pouvoir théocratique et posait les bases de l’autonomie du politique par rapport au religieux, et inversement. Pourtant, comme l’écrit René Rémond, « les deux pouvoirs ne se sont pas toujours inspirés de cette sagesse22 ». C’est paradoxalement sous d’autres influences, celle notamment de la philosophie des Lumières, que la liberté de conscience, en particulier la liberté de ne professer aucune religion, a pu s’imposer. La question des relations entre Églises et États est l’une de celles où les réponses ont été données dans un ordre dispersé, avec des péripéties parfois violentes. Mais, au fil des siècles, dans un premier temps contre les confessions chrétiennes, s’est imposée la règle de la double liberté de conscience et de culte.
Une théologie de la personne
« Message du pape Paul VI au Conseil de l’Europe », 26 janvier 1977
« Audience du pape Jean-Paul II aux participants à la Conférence des présidents des parlements de l’Union européenne », 23 septembre 2000
Voir Guy Aurenche, La Dynamique des droits de l’homme, Desclée de Brouwer, 1998.
Voir Emmanuel Mounier, Qu’est-ce que le personnalisme ?, Seuil, 1947 ; Le Personnalisme, PUF, 1950 ; Michel Meslin, « La personne », in René Rémond (dir.), cit., p. 47-69.
« Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Journal officiels des Communautés européennes, 18 décembre 2000, C 364/8 et 364/9
« Est-ce trop dire que l’Europe […] garde une responsabilité particulière pour témoigner, dans l’intérêt de tous, de valeurs essentielles comme la liberté, la justice, la dignité personnelle, la solidarité, l’amour universel ?24 », questionnait Paul VI en 1977. Jean-Paul II, lui, déclarait aux présidents en 2000 : «L’Union européenne ne devra pas oublier qu’elle est le berceau des idées de personne et de liberté, et que ces idées lui sont venues de sa longue imprégnation par le christianisme. […] Puisse l’Union européenne connaître comme un nouveau sursaut d’humanité ! Qu’elle sache dégager le consensus nécessaire pour inscrire parmi ses plus hauts idéaux la protection de la vie, le respect de l’autre, le service mutuel et une fraternité sans exclusion25. » L’Europe s’identifie ainsi à l’humanisme, qui se caractérise par le caractère central de la personne et des droits de l’homme. De là naît le principe moderne de démocratie dans laquelle la personne est respectée pour elle-même et participe à l’œuvre commune. Le christianisme a élaboré la notion de « personne humaine », pour exprimer la foi en Dieu un et trine (trois personnes en une seule nature), en Jésus homme et Dieu (une personne en deux natures), et en la vocation «personnelle » de tout homme, fils de Dieu. Il insiste sur la dignité de la personne parce qu’elle est éclairée par la foi trinitaire et christologique, parce qu’elle est à l’image de Dieu et trouve sa fin dans la vision de Dieu. Elle est dotée de liberté et de raison. Son modèle est le Christ, image parfaite du Père, qui aaccepté librement son sacrifice pour racheter les péchés. La personne est incarnée. En elle, sa part transcendante – l’esprit – est liée à sa part matérielle – le corps –, avec sa place dans la société, dans l’histoire. D’où sa vocation et sa responsabilité, de rendre présentes les valeurs dont elle tire sa dignité.
La notion de personne existe néanmoins dans d’autres traditions de la pensée occidentale, depuis Socrate, dans les philosophies du sujet, de la conscience intellectuelle et morale, de la liberté de l’individu et des droits de l’homme. Elle impose les droits humains26. Elle a trouvé son expression dans la philosophie personnaliste, dont le terme fut élaboré au XXe siècle sous l’influence de Charles Renouvier et, surtout, d’Emmanuel Mounier27. La notion de « personne » permet d’insister sur la dynamique relationnelle, en particulier sociale, contre l’individualisme issu du rationalisme des Lumières, contre les spiritualismes qui ignorent la matière, contre les collectivismes qui uniformisent. L’idée de « personne » appelle à la communion au sein de communautés diverses à des niveaux différents, des plus petites aux plus vastes. Il n’est pas surprenant que les premières expressions de l’unité de l’Europe aient pris le nom de « communautés » : Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), Communauté économique européenne (CEE), mais aussi Communauté européenne de défense (CED). Elles traduisaient l’inspiration personnaliste des « pères de l’Europe ».
La personne est centrale dans la construction européenne. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée en décembre 2000 le dit clairement dans son préambule : « [L’Union] place la personne au cœur de son action », tandis que l’article 1 affirme : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée28. »
Une théologie de la paix
Is II, 4 (trad. Émile Osty).
Mt V, 9 (trad. Émile Osty).
Jn XIV, 27 (trad. Émile Osty).
René Coste, Théologie de la paix, Éditions du Cerf, 1997.
Voir Joseph Joblin, L’Église et la guerre, Desclée de Brouwer, 1988 ; Guillaume Bacot, La Doctrine de la guerre juste, Economica, 1989 ;Daniel Moulinet, L’Église, la guerre et la paix, Éditions du Cerf, 2016.
Yves de La Brière, « La guerre et la doctrine catholique », 2e partie, Études, 51e année, tome 141, octobre-décembre 1914, 195
« Ad beatissimi apostolorum principis. Lettre encyclique de Sa Saintenté le Pape Benoît XV », 1ernovembre 1914
Karl Barth, « Lettre aux protestants de France », Esprit, n° 91, avril 1940, 75
« Discours du pape Pie XII au deuxième Congrès international de l’Union européenne des fédéralistes», 11 novembre 1948
Luigi Sturzo, La comunità internazionale e il diritto di guerra [1928], Edizioni di storia e letteratura, 2003.
« La déclaration Schuman du 9 mai 1950 », europa.eu
Avec la personne, le christianisme a élaboré une longue réflexion sur la paix. Cette affirmation peut surprendre dans la mesure où la longue histoire de l’Europe est fréquemment éloignée de tout respect de la personne humaine, où les chrétiens ont souvent alimenté les conflits, où les figures des évêques guerriers, et même des papes, ne sont pas rares. L’Europe christianisée est profondément morcelée du fait des schismes, des guerres de religion, des conflits de puissances, les télescopages de mémoires sont fréquents et difficiles à contrôler. La religion a souvent été instrumentalisée par les souverains et les États. La Première Guerre mondiale en témoigne. Ainsi, de 1701 à 1945, les soldats prussiens puis allemands portèrent sur le fermoir de leurs ceinturons, l’inscription « Gott mit uns » (« Dieu avec nous »). Mais les Églises n’en ont pas moins nourri, avec leurs théologiens, un enseignement sur la guerre et la paix qui a pu conduire à la construction d’une paix nouvelle après 1945, suite à deux guerres mondiales effroyables.
L’Ancien Testament est plein de la fureur de batailles, mais l’idéal reste la paix : « Ils forgeront leurs glaives en socs et leurs lances en serpes. On ne lèvera pas le glaive nation contre nation et on n’apprendra plus la guerre29. » Le message évangélique récuse nettement la guerre et exalte la paix : « Heureux ceux qui font œuvre de paix, parce qu’ils seront appelés fils de Dieu30 », et il s’agit de vivre intensément la paix du Christ : « Je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne31. » Sans aucun doute, la paix se trouve au centre de l’enseignement du christianisme.
Pourtant, la guerre n’est pas explicitement exclue. Elle est acceptée chez les Pères de l’Église, mais elle est vue comme une épreuve. Pour saint Augustin, elle est une réalité humaine, fruit du péché originel. Mais le chrétien ne doit ni l’aimer ni l’exalter. Il ne doit pas provoquer la guerre mais, s’il doit la faire, il doit s’y conduire conformément aux principes évangéliques, notamment le plus puissant d’entre eux, l’amour du prochain. Augustin introduit ainsi la notion de « guerre juste », c’est-à-dire celle que l’on mène contre son gré, dans le but de rétablir la paix qui a été violée et à condition qu’elle ait été décidée par l’autorité légitime, ce qui doit permettre d’éviter les guerres privées. Il se situe ainsi au début d’un long processus de réflexion catholique sur la guerre, qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec un théologien comme René Coste32 ou les réflexions du pape François sur le pacifisme.
À la fin du Xe siècle, plusieurs conciles ont défini concrètement la « paix de Dieu » à travers la formulation d’interdits au sein de la guerre, comme attaquer des catégories de population par nature désarmées – clercs, paysans, marchands –, ce qui tendait à définir des populations civiles qui devaient échapper aux violences. Au début du XIe siècle, la «trêve de Dieu», introduisit une limitation de la guerre dans le temps : du jeudi au dimanche (temps de la Passion) ou pendant certains temps liturgiques (Avent, Noël, Carême, Pentecôte).
La réflexion théorique fut prolongée par saint Thomas d’Aquin dans la Somme théologique, où il récupéra les catégories d’Augustin en définissant trois conditions pour qu’une guerre soit juste : l’autorité du Prince sur l’ordre de qui la guerre doit se faire ; une cause juste : ceux qui sont attaqués méritent de l’être en raison de quelque faute ; une intention droite chez ceux qui font la guerre, c’est-à-dire la recherche du bien pour éviter le mal, et la nécessité de mesurer les conséquences de l’action33.
Par la suite, au XVIe siècle, le dominicain Francisco de Vitoria posa les bases d’un droit des gens universel (jus gentium) fondé sur la raison naturelle et non sur la force, sans considération de race ou de religion. Vitoria établit pour tous les hommes le droit de circuler et d’échanger, reconnaît les droits des Indiens vaincus en Amérique et élabore une forme de droit universel : le jus ad bellum (aux principes précédents, on ajoute l’idée d’une réponse militaire proportionnée) et le jus in bello (respect des populations civiles, des prisonniers, notamment). Peu après, au tournant du XVIIe siècle, avec Grotius, cette conception est sécularisée et fournit les racines du droit international. Après la Révolution française et les guerres de l’Empire, dans un contexte de revendications nationalitaires puis de montée des nationalismes, la théologie de la guerre est à nouveau approfondie au milieu du XIXe siècle avec le jésuite italien Luigi Taparelli d’Azeglio. Cependant, cette doctrine fut ébranlée par l’apparition de la guerre totale au XXe siècle et avec l’émergence d’armes de destruction massive. En octobre 1914, le jésuite Yves de La Brière écrit : « La théologie catholique reconnaît qu’il y a des guerres justes, légitimes, nécessaires. Mais les conditions mêmes qu’elle exige pour admettre la licéité morale d’une offensive guerrière inculquent manifestement aux princes et aux peuples chrétiens le grave devoir de faire, en conscience, tout leur possible et jusqu’au bout du possible, pour dirimer leurs litiges autrement que par une solution à la fois aussi terrible et aussi aléatoire34. »
Aussi importante que méconnue, la lettre encyclique Ad beatissimi apostolorum principis de Benoît XV, publiée en novembre 1914, soulignait l’enjeu majeur que représentait pour les chrétiens la guerre qui avait éclaté quelques mois auparavant, car le conflit niait les apports de l’Évangile à l’humanité35. Cette guerre opposait des nations chrétiennes et s’annonçait comme un effroyable massacre. La dimension fraternelle par-delà les nations portée par le christianisme était tenue en échec, alors que catholiques et protestants adhéraient en masse aux unions sacrées et à l’effort de guerre général. L’esprit nationaliste était plus fort que l’esprit évangélique.
La Seconde Guerre mondiale a amené un double questionnement. Tout d’abord, cette guerre était-elle nécessaire ? Cette question a notamment été abordée par le théologien protestant Karl Barth, qui écrit : « Devant Dieu et devant les hommes, on ne saurait prendre la responsabilité de ne pas mettre fin à la menace hitlérienne. Et la guerre est le seul moyen d’y parvenir36. » Et, ensuite, que faire face à Auschwitz ? Une guerre nécessaire, donc juste ? Mais ce fut une guerre totale, qui mobilisa des moyens de destruction dont la puissance était démultipliée par rapport au conflit précédent. Comme jamais auparavant, les populations civiles furent des cibles privilégiées et les accords internationaux (la convention de Genève, par exemple) ne furent guère respectés par les belligérants. Le conflit s’acheva sur les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. L’arme nucléaire changeait radicalement la donne. Le monde était désormais dominé par un nouveau type d’arsenal : l’armement ABC (atomique, biologique, chimique).
La paix s’imposait à l’Europe, certes comme fruit d’un enseignement théologique et pontifical, mais aussi comme une leçon tirée des conflits. En 1948, le pape Pie XII put s’appuyer sur les horreurs vécues aux cours des conflits précédents pour appeler à une construction européenne rapide : « Il n’y a pas de temps à perdre. Et si l’on tient à ce que cette union atteigne son but, si l’on veut qu’elle serve utilement la cause de la liberté et de la concorde européenne, la cause de la paix économique et politique intercontinentale, il est grand temps qu’elle se fasse. Certains se demandent même s’il n’est pas déjà trop tard37. » Les responsables politiques reçurent cet héritage qu’ils surent faire fructifier pour construire entre les États un lien institutionnel si fort qu’il ne puisse pas être défait, contrairement à un traité classique. C’est ce que comprirent notamment Luigi Sturzo38 en 1928 et Robert Schuman dans sa déclaration en 195039.
Jérusalem, Athènes et Rome
Voir Paul Valéry, « Note (ou l’Européen) », extrait d’une conférence prononcée à l’université de Zurich en novembre 1922,in Variété, repris dans Œuvres I, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1957, 1000 à 1014.
Voir Jean-Dominique Durand, « Giorgio La Pira, politico e cristiano », in Vittorio Possenti (dir.), Nostalgia dell’altro. La spiritualità diGiorgio La Pira, Marietti, 2005, 229-239.
Discours du pape Benoît XVI devant le Bundestag, 22 septembre 2011. À propos des influences juive, grecque et romaine sur l’Europe, voir Rémi Brague, Europe, la voie romaine, Critérion,
Voir Amos Elon, Jérusalem, capitale de la mémoire, Perrin, 1991.
Voir Danielle Jouanna, L’Europe est née en Grèce, L’Harmattan, 2009.
Ac XVII, 23 (trad. Émile Osty).
Voir Étienne Gilson, Christianisme et Philosophie, Vrin, 1936.
Voir Adalbert-Gautier Hamman, Pour lire les Pères de l’Église, nouvelle édition revue et augmentée par Guillaume Bady,Éditions du Cerf, 2007 ; Dominique Gonnet et Michel Stavrou (dir.), Les Pères de l’Église aux sources de l’Europe, Éditions du Cerf, 2014.
Biondo Biondi, Il diritto romano cristiano, 3 , Giuffrè, 1953-1954. Voir aussi Michael Stollels, « La promesse du droit », in Étienne François et Thomas Serrier (dir.), Europa. Notre histoire, L’héritage européen depuis Homère, Les Arènes, 2017, p. 367-381.
Pierre Legendre, L’Autre Bible de l’Occident : le Monument romano-canonique. Étude sur l’architecture dogmatique des sociétés, Fayard, 2009.
Voir Maurice Sachot, Quand le christianisme a changé le monde, Odile Jacob, 2007.
Dante, La Divine Comédie. Le Purgatoire, XXXII, 102, Jacqueline Risset, Garnier-Flammarion, éd. bilingue, 1992, p. 297.
Voir Andrea Giardina et André Vauchez, Il mito di Da Carlo Magno a Mussolini, Laterza, 2000.
Voir Bernard Delpal, « San Benedetto, un patrono per l’Europa », in Alfredo Canavero et Jean-Dominique Durand (dir.), Il fattore religioso nell’integrazione europea, Edizioni Unicopli, 1999, 55-68.
« Lettera apostolica Egregiae virtutis del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II con la quale i santi Cirillo e Metodio vengonoproclamati compatroni d’Europa » (en italien), 31 décembre 1980
« Jean-Paul Lettre apostolique en forme de « motu proprio » pour la proclamation de sainte Brigitte de Suède sainte Catherine de Sienne et sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix co-patronnes de l’Europe », 1er octobre 1999
Voir Jean-Dominique Durand, « L’usage du temps et de l’espace par Jean-Paul II », in Bartolo Gariglio, Marta Margotti etPier Giorgio Zunino, (dir.), Le due società. Scritti in onore di Francesco Traniello, Il Mulino, 2009, 415-433.
Voir Andrea Riccardi, Ils sont morts pour leur La persécution des chrétiens au XXe siècle, Plon-Mame, 1999.
Étienne François, « Les trois rayons : Jérusalem, Athènes et Rome », in Étienne François et Thomas Serrier (dir.), op cit., p. 382-385.
Pour Paul Valéry, il y a Europe là où les influences de Rome sur l’administration, de la Grèce sur la pensée, du christianisme sur la vie intérieure se font sentir toutes les trois40. Giorgio La Pira identifiait de son côté les trois pierres sur lesquelles l’Europe se construisait : juridique (Rome), métaphysique (Athènes), prophétique (Jérusalem)41. Pour Benoît XVI, « la culture de l’Europe est née de la rencontre entre Jérusalem, Athènes et Rome – de la rencontre entre la foi au dieu d’Israël, la raison philosophique des Grecs et la pensée juridique de Rome42 ».
À partir de Jérusalem, ville centrale de la vie du Christ, où il est monté au Temple, où il a enseigné, où il a été arrêté, où se sont déroulées la Passion et la Crucifixion, où il a été enseveli et où a eu lieu la Résurrection, le christianisme s’est répandu dans tout l’Empire romain43. C’est de Jérusalem que l’Europe tient son histoire sainte chrétienne, mais la ville du Christ est également la ville sainte des Juifs qui ont tant apporté à la civilisation européenne avec la diaspora et après la destruction du Temple en 70 de notre ère. Les regards des croyants européens convergent vers Jérusalem : les synagogues s’inspirent du Temple et les chœurs des églises sont orientés vers l’est, c’est-à-dire vers la ville sainte par excellence. Vers elle convergent les pèlerins. De nombreuses églises et sanctuaires sont fiers de conserver des reliques prélevées là où le Christ a vécu et a été crucifié, à l’instar de la Sainte-Chapelle, à Paris, pensée et construite entre 1241 et 1248 comme un reliquaire pour abriter la Couronne d’épines et un morceau de la Vraie Croix.
La Grèce a inventé le mythe d’Europe avec une jeune princesse enlevée par Zeus44. Avec Athènes, le christianisme a rencontré la pensée, Socrate, Platon, Aristote. Saint Paul arrivant à Athènes, annonce : «J’ai même trouvé chez vous un autel portant cette inscription : À un Dieu inconnu. Eh bien ! Ce que vous adorez sans le connaître, c’est ce que je viens, moi, vous annoncer45. » Il entame alors une confrontation entre le christianisme et le paganisme, et il ouvre la voie à un dialogue puissant entre la philosophie antique et le monothéisme chrétien46. La plupart des Pères de l’Église, qui ont posé les fondements de la doctrine chrétienne étaient grecs, d’Ignace d’Antioche à Clément d’Alexandrie ou à Jean Chrysostome. Aristote a été introduit dans la pensée chrétienne par Thomas d’Aquin, mais en passant par les penseurs musulmans Avicenne et Averroès. À travers sa Politique, l’Europe a forgé sa conception du bien public, en s’appuyant aussi sur Cicéron, très présent chez les Pères latins47.
Rome apporte la rigueur et le droit, comme l’a montré le grand juriste italien Biondo Biondi dans son œuvre monumentale sur le droit romain chrétien48. L’Europe est la terre du droit, cela la distingue des autres continents. Selon Pierre Legendre, l’interpénétration du droit hérité de Rome et du droit de l’Église, le droit canon forgé par le décret de Gratien au milieu du XIIe siècle, s’est faite d’une manière complémentaire49. En se christianisant, le monde antique a donné à l’Europe le concept grec de cité,fondé sur l’agora athénienne, et l’idée romaine de république, de res publica, qui caractérisent la culture européenne50.
Rome, « cette Rome dont le Christ est romain51 » (Dante), là d’où le pape prononce la bénédiction Urbi et Orbi, Rome est devenue la capitale de la catholicité, but du pèlerinage aux tombeaux des apôtres Pierre et Paul, à ceux des premiers chrétiens (catacombes) et auprès du pape52. Tout semble résumé par ce chant de pèlerins, O Roma nobilis, qui remonte au VIIIe siècle :
« Rome, ô noble cité, souveraine du monde
Toi, la plus excellente entre toutes les villes
Rouge du sang vermeil de tes martyrs
Blanche par les lis immaculés des vierges
Nous te disons : salut pour tes merveilles
Et nous te bénissons, salut dans tous les siècles.
Pierre, toi le premier, le porte-clefs des cieux
Exauce chaque jour nos vœux et nos prières
Lorsque tu siégeras pour juger Israël
Laisse-toi fléchir et juge avec clémence
À nous qui te prions maintenant ici-bas
Apporte le secours de ta miséricorde.
Ô Paul accueille-nous, malgré tous nos péchés
Toi, dont l’habileté a triomphé des sages
Devenu l’intendant de la maison royale
Sers-nous les aliments de la grâce divine
Pour que cette sagesse par qui tu fus comblé
Elle-même nous comble par tes enseignements. »
Du fait de la primauté du pape et de la centralisation de l’Église, accentuée aux XIXe et XXe siècles, Rome est devenue la ville de l’universalité de l’Église, celle où réside le successeur de Pierre. C’est la ville où le monde se retrouve, avec des pèlerins, des étudiants, des séminaristes, venus de partout, où se sont installées les maisons généralices de la plupart des congrégations religieuses. De cette histoire romaine, de cette romanisation de l’Église, témoignent les Archives du Vatican (Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum) ainsi que la Bibliothèque vaticane, qui contiennent la mémoire de l’Europe tout entière. De ce point de vue également, le christianisme a contribué à unifier l’Europe en s’emparant de la langue des Romains, le latin, pour en faire la langue liturgique au détriment du grec, et celle des élites.
Les papes veulent considérer l’Europe dans son ensemble, de l’Atlantique à l’Oural, en la plaçant sous la protection de saints proclamés copatrons de l’ensemble de l’espace européen. En 1964, Paul VI avait proclamé saint Benoît « patron principal de l’Europe entière53 ». En 1980, la proclamation des saints Cyrille et Méthode par le pape Jean-Paul II comme copatrons de l’Europe a souligné les deux traditions chrétiennes de l’Europe, lui permettant de respirer de ses « deux poumons » occidental et oriental54. Peu avant l’entrée dans le IIIe millénaire, Jean-Paul II proclama aussi trois saintes, Brigitte de Suède, Catherine de Sienne et Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), copatronnes de l’Europe, et il déclara à cette occasion : « Le motif qui m’a fait me tourner spécifiquement vers elles repose dans leurs vies elles-mêmes. Leur sainteté s’est en effet exprimée dans des circonstances historiques et dans un contexte «géographique » qui les rendent particulièrement significatives pour le continent européen. Sainte Brigitte renvoie à l’extrême nord de l’Europe, où le continent se regroupe dans une quasi-unité avec le reste du monde […]. Catherine de Sienne est aussi connue pour le rôle qu’elle joua en un temps où le Successeur de Pierre résidait à Avignon […]. Thérèse-Bénédicte de la Croix […], non seulement passa sa vie dans divers pays d’Europe, mais par toute sa vie d’intellectuelle, de mystique, de martyre, jeta comme un pont entre ses racines juives et l’adhésion au Christ. Elle est devenue ainsi l’expression d’un pèlerinage humain, culturel et religieux qui incarne le noyau insondable de la tragédie et des espoirs du continent européen55 ». Avec un sens profond du geste symbolique, ces choix sont venus souligner l’unité spirituelle de l’Europe, du point de vue géographique, en unissant le Nord à l’Orient et à l’Occident56. Ils expriment aussi la préoccupation de surmonter les divisions, d’établir un pont entre la culture chrétienne et la culture juive qui, toutes les deux, nourrissent l’Europe, tout en intégrant le grand martyrologe du XXe siècle qui unit les Églises dans l’œcuménisme de la souffrance57. Étienne François note ainsi que «Jérusalem, Athènes et Rome sont par excellence les villes qui ont donné sens à l’Europe et sans lesquelles il est impossible de la comprendre58 ».
Un paysage européen né du christianisme
René Rémond, cit., p. 31.
« Au monde de la Discours du pape Benoît XVI », Collège des Bernardins, Paris, 12 septembre 2008
Voir Philippe Boutry, « Le clocher », dans Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire. III.2. Les Traditions, Gallimard, 1992, p. 56-89.
Voir Alain Corbin, Les Cloches de la Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes du XIXesiècle, Albin Michel, 1994.
Voir Jean Chélini, Les Chemins de Histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nos jours, Hachette, 1995.
Voir Alphonse Dupront, Du sacré. Croisades et pèlerinages. Images et langages, Gallimard, 1987 ; (dir.), Saint- Jacques-de-Compostelle. Puissance du pèlerinage, Brepols, 1985.
« Atto europeistico a Santiago de Discorso di Giovanni Paolo II » (en italien), 9 novembre 1982.
Javier Gómez-Montero, « Saint-Jacques. Le sens du chemin », in Étienne François et Thomas Serrier (dir.), cit., p. 681-684.
Pour René Rémond, « le christianisme a imprimé sa marque sur le continent. L’Europe s’est couverte d’un grand manteau blanc d’églises. Partout des monastères se sont fondés dont les religieux ont contribué à défricher la terre. L’espace a été quadrillé, des humbles croix érigées aux carrefours des chemins jusqu’aux cathédrales et aux basiliques les plus altières. Le christianisme a imposé son empreinte dans le temps aussi avec son calendrier liturgique59 ».
Paul VI disait que l’Europe est née de la Croix, du Livre et de la charrue, triptyque qui rappelle l’œuvre des monastères, en particulier bénédictins, sur les plans spirituel, culturel et économique : l’Oraet Labora du monachisme médiéval, c’est-à-dire la conjonction de la contemplation et de l’action sociale. À son tour, Benoît XVI a abordé cette thématique en 2008, dans un discours fameux prononcé dans le réfectoire gothique du couvent des Bernardins, à Paris, haut lieu du monachisme cistercien que le cardinal Jean-Marie Lustiger avait voulu établir comme lieu de rencontre et de dialogue avec les divers courants intellectuels et artistiques. Benoît XVI s’inspira à cette occasion de saint Benoît pour souligner l’importance du monachisme. Selon le souverain pontife, celui-ci a sauvé la culture antique par le livre, la bibliothèque et l’école, par la connaissance et la formation de la raison, à travers la musique et la belle liturgie, mais aussi l’architecture harmonieuse – dont témoigne le lieu où il prononçait son discours –, avec la lecture et la parole – lire et enseigner –, par le travail – le fameux Ora et Labora60. Le monachisme a réussi à reconstruire une culture européenne sur les ruines du monde antique, une culture de la parole, en même temps qu’une culture du travail, inscrite dans une tradition héritée du judaïsme.
Cette culture commune a été une culture de la construction et de l’image destinée à proclamer un Dieu créateur et à faire connaître la vie de Son Fils sauveur. L’Europe s’est couverte de monastères, d’églises, de collégiales, de cathédrales, de prieurés, de chapelles, de sanctuaires, de beffrois et de clochers, de fresques, de statues, de vitraux, d’œuvres d’art. Les architectes, les maçons, les artistes de toutes spécialités, sans oublier les musiciens, se sont mobilisés pour exalter Dieu, ad majorem Dei gloriam (« pour une plus grande gloire de Dieu »). Les styles ont pu évoluer selon les époques, les lieux, des imposantes cathédrales gothiques, chefs-d’œuvre d’architecture, aux pompeuses églises baroques, des styles se sont superposés ou succédés au gré des exigences spirituelles, voire politiques, ou des traditions locales. Il y a, plutôt qu’une uniformité, une variété infinie de styles. Mais il n’y a pas un village en Europe sans une église et son clocher61.
Les territoires se sont structurés autour des paroisses et des réseaux des ordres religieux, surtout bénédictins, cisterciens, franciscains, dominicains. La toponymie des villes et des campagnes s’est christianisée, les lieux adoptant des noms de saints ou faisant référence à la vie religieuse. Le temps s’est organisé en fonction de la religion chrétienne, qu’il s’agisse du calendrier de l’année structurée par la liturgie (Avent, Noël, Pâques, Pentecôte…) et les fêtes mariales, du rythme de la semaine ponctuée par l’instauration du dimanche comme jour du Seigneur, et donc jour de repos. Si de nos jours de nombreuses fêtes se sont sécularisées, leurs rythmes restent la marque chrétienne de l’Europe. Le temps et les territoires restent profondément marqués par ces traces toujours présentes dans l’Europe sécularisée. Si les cloches n’appellent plus toujours à la messe et n’annoncent plus les grands événements de la communauté62, elles égrènent encore les heures qui passent et donnent avec les clochers, les campaniles ou les beffrois qui les abritent une identité commune, du Portugal à la Russie, de l’Irlande à la Pologne, de la Norvège à l’Italie. Lorsqu’elles ont été détruites du fait d’une catastrophe naturelle, d’une guerre ou d’une révolution, les autorités civiles et religieuses se sont toujours empressées de les rétablir, non pour réaffirmer un pouvoir religieux mais pour rendre à la ville ou au village son histoire, son appartenance à un territoire plus vaste, celui de l’Europe. Au XXe siècle, les deux exemples de Reims et de Dresde, deux villes aux cathédrales mythiques détruites durant deux guerres successives, témoignent ainsi de l’attachement indéfectible des populations à ces monuments. Ceux-ci sont des signes, visibles de loin, tout comme la cathédrale de Chartres exaltée par Charles Péguy, témoins d’une culture européenne commune. Si aujourd’hui l’attachement d’une population à son clocher est moins enraciné au sein d’une société multiculturelle et individualiste, il est néanmoins difficile d’imaginer une Europe qui en serait dépourvue.
L’Europe fut unifiée également par ses routes, dont beaucoup ont été établies pour relier des grands centres de pèlerinage63. La pratique de prendre la route à pied pour rejoindre des lieux de prière se répandit dès le IVe siècle : Rome, Tours (saint Martin), Saint-Jacques-de-Compostelle, le Mont-Saint-Michel ou Le Puy s’affirmèrent vite comme les lieux les plus prestigieux et ils n’ont jamais cessé d’être fréquentés. Certains, comme aussi les grands sanctuaires mariaux de Fátima, de Lourdes ou de Częstochowa, ont structuré les cheminements européens. Les chemins de Compostelle (la via Francigena) sont restés vivants au cours des siècles. Ils se sont adaptés aux évolutions des moyens de transport, aux frontières imposées par les États nationaux, et à celles des mentalités. Ils associent à présent dévotion et découvertes touristiques. Les chemins de Saint- Jacques, définis dès le milieu du XIIe siècle dans le Liber sancti Jacobi, sorte de guide du pèlerin, sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. L’historien Alphonse Dupront en a montré la dimension sacrale jusqu’à l’époque contemporaine64, le fidèle venant prendre des forces dans un lieu sacré, qui peut aussi n’avoir qu’une dimension locale ou régionale. Il n’est pas étonnant qu’en 1982 le pape Jean-Paul II ait choisi Saint-Jacques-de-Compostelle pour lancer un appel à l’Europe afin qu’elle re découvre ses racines chrétiennes, en en faisant « l’un des points forts qui favorisèrent la compréhension mutuelle de peuples européens si différents comme les Latins, les Germains, les Celtes, les Anglo-Saxons et les Slaves », rappelant la formule de Goethe selon qui « la conscience de l’Europe est née du pèlerinage65 ».Ces chemins sont de véritables lieux de mémoire européens où le sacré se mêle au profane, ce qui fait dire au chercheur Javier Gómez-Montero : « Le chemin de Compostelle se pose en archétype de l’Europe, une sorte de subconscient des territoires, là où se constitue le socle commun des nations avec leurs langues, traditions et valeurs et où se forgent l’identité et la mémoire européennes66. »
La connaissance transmise par l’université
Chateaubriand, Génie du christianisme ou Beautés de la religion chrétienne, in Essai sur les révolutions – Génie du christianisme, IVe partie, livre VI, V, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1978, p. 1045-1046. Voir aussi Jean-Paul Clément, Chateaubriand, Flammarion, 1998.
Voir Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Seuil, 1948.
Voir Léo Moulin, « Une création spécifique du christianisme médiéval », in Michael Konrad et Matteo Negro (dir.), Les Universités catholiques en Europe. Études et perspectives, Éditions universitaires, 1990, p. 16-22.
Voir Edgardo Giovannini, « Quelques réflexions sur trois sujets voisins : l’université, l’université catholique, l’université de Fribourg », in Michael Konrad et Matteo Negro (dir.), cit., p. 64-73.
Christophe Charle et Jacques Verger, Histoire des universités, PUF, 1994, 17-18.
Jerzy Kłoczowski, «La promotion des Églises périphériques de l’Europe du Centre-Est et du Nord», in Jean-Marie Mayeur, Charles Pietri, André Vauchez et Marc Venard (dir.), Histoire du 6. Un temps d’épreuves (1274- 1449), Desclée/Fayard, 1990,p. 804-805.
Bruno Neveu, Les Facultés de théologie catholique de l’Université de France (1808-1885), Klincksieck, 1998, 18.
Jacques Verger, L’Essor des universités au XIIIesiècle, Éditions du Cerf, 1997, 52-53. Voir aussi Hastings Rashdall, TheUniversities of Europe in the Middle Ages, Oxford University Press, 1re éd., 1895.
Voir Angelo Vincenzo Zani, « Identità delle istituzioni ecclesiastiche : cultura e nuova evangelizzazione », in Angelo Vincenzo Zani et Michele Pellerey (dir.), Le istituzioni accademiche ecclesiastiche. Cultura della qualità e nuova evangelizzazione, Lateran UniversityPress, 2012, 9-31.
Léo Moulin, art cit.
Bruno Neveu, cit., p. 41.
John Henry Newman, L’Idée d’université, Desclée de Brouwer, 1968, 29-30.
Voir Pierre Gauthier, « Newman, Jacques Maritain et l’éducation », dans Claude Lepelley et Paul Veyriras (dir.), Newman etl’histoire, PUL, 1992, 235-244 ; Jacques Maritain, Éducation at the Crossroads, dans Pour une philosophie de l’éducation, Fayard, 1959, p.860-861.
Chateaubriand, dans Génie du christianisme (1802), publié au sortir de la Révolution française pour illustrer « les beautés de la religion chrétienne », observait que « toutes les universités de l’Europe ont été établies, ou par des princes religieux, ou par des évêques, ou par des prêtres, et toutes ont été dirigées par des ordres chrétiens ». Après avoir énuméré les plus importantes universités européennes, il ajoutait : « Tous ces foyers des lumières attestent les immenses travaux du christianisme67. » Pour le grand écrivain, il n’y avait pas de doute : il existe un lien fort entre l’Église et l’institution universitaire.
Si Chateaubriand avait parfois un rapport un peu approximatif avec l’histoire, avec laquelle il ne craignait pas de s’arranger (ainsi faisait-il remonter les origines de l’Université de Paris à Charlemagne), cette proposition, en revanche, est parfaitement confirmée par les historiens, unanimes à reconnaître que les universités furent à l’origine des fondations ecclésiastiques, qu’il en est peu pour lesquelles on ne trouve pas dans l’acte de naissance un document pontifical ou l’intervention d’un représentant du Saint-Siège.
L’Antiquité gréco-romaine, qui a tant légué à notre temps dans les domaines de la pensée et de la technique, n’a pas connu l’université68. Celle-ci est née et a prospéré sur le terreau fertile de la chrétienté des XIIe et XIIIe siècles. Elle est un produit de l’humanisme chrétien européen69 : si en 1602 on comptait 106 universités en Europe, il n’y en avait nulle part ailleurs dans le monde, si ce n’est en Amérique latine où les Espagnols avaient transposé le modèle européen, d’abord à Mexico, en 1553, puis à Lima, en 1555. Le XIIIe siècle fut le siècle des grandes cathédrales gothiques, mais aussi celui de ces « cathédrales de l’esprit » qu’étaient les universités70. Entre 1214 et 1230, à partir de Bologne, Paris, Oxford et Montpellier, elles se sont répandues dans toute l’Europe et en ont modifié profondément et durablement le paysage culturel et intellectuel. À la fin du siècle, pas moins d’une douzaine d’universités fonctionnaient71 et, en général, elles avaient reçu des statuts de la part de l’autorité pontificale, en Angleterre et en Europe méridionale : Cambridge, Padoue, Naples, Toulouse, Coimbra, Séville,Salamanque… Ce mouvement se poursuivit au siècle suivant, notamment en Europe centrale, avec la création d’universités à Prague (1347), Cracovie (1364), Pécs (1367), Buda (1389), Vienne (1365)72, et dans les pays germaniques, à Erfurt (1379), Heidelberg (1385) et Cologne (1388). Le mouvement était lancé.
Le terme « université » n’était cependant pas d’origine ecclésiastique mais désignait, dans le droit romain, une communauté autonome, un collège, un corps constitué pour un objectif donné. Au Moyen Âge, il s’appliquait à divers corps de métiers, l’Universitas mercatorum, par exemple. Le mot fut donné aux nouvelles communautés réunissant maîtres et étudiants. Le terme universitas fut ainsi employé dans ce sens par le pape Innocent III dans une décrétale de 1208 à propos de Paris73. Ce pape avait compris que le système ancien des écoles cathédrales ne suffisait plus et que la papauté se devait de favoriser de nouvelles institutions d’enseignement. Il s’agissait également de les contrôler, d’autant mieux que maîtres et étudiants des écoles les plus importantes cherchaient à se soustraire aux autorités locales, qu’elles fussent ecclésiastiques ou non. C’était donc pour la papauté un moyen de renforcer son autorité et, dans ce dessein, elle fut soutenue par le développement des ordres mendiants, notamment les Frères prêcheurs et les Franciscains, dévoués au service de Rome74. Les universités, dans leur volonté d’autonomie par rapport aux pouvoirs locaux, devinrent des organismes d’Église, soumis au siège de Pierre ou à l’évêque du lieu, en tant que mandataire du pape.
L’universitas scholarium comme à Bologne, le magistrorum comme à Paris, ou encore l’universitas studiurom, s’affirmaient comme un organisme autonome, autogéré75. Vers le milieu du XIIIe siècle, le terme prit son sens actuel, c’est-à-dire l’universalité des connaissances, l’enseignement de tous les savoirs, théologie, droit, médecine, arts, au sein du studium generalis. L’Église entendait ainsi former une élite capable de servir Dieu et la cité, de bons chrétiens mais aussi de bons citoyens soucieux du bien commun, dotés d’une solide structure intellectuelle. En effet, si la théologie restait « la reine des sciences », si le droit et la médecine trouvaient pleinement leur place, les arts libéraux, au nombre de sept, restaient fons et origo, c’est-à-dire le fondement et l’origine des autres sciences76; ils étaient regroupés sous les termes de trivium (grammaire, rhétorique, dialectique) et de quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie, musique). Ces disciplines fondaient le sens profond de l’université selon l’Église. Elles entendaient unir la foi et la raison.
Les arts libéraux fondaient la liberté de l’homme en lui donnant la capacité de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le beau du laid, en fondant son aptitude à l’autonomie intellectuelle. La diversité des opinions théologiques était admise, les traditions de chaque université étaient respectées, dès lors que l’unité du dogme n’était pas menacée.
L’autorité de la papauté tendit à s’estomper à l’époque moderne qui vit s’accentuer l’intervention des pouvoirs publics, au point que l’on assista à un double processus d’étatisation et de laïcisation qui devint, selon Bruno Neveu, « une mainmise complète au cours du XVIIIe siècle77 ». Elle fut parachevée au XIXe siècle à la suite de la Révolution française, avec les progrès de la sécularisation comme avec l’affirmation des États-nations qui entendaient contrôler l’éducation.
L’enseignement universitaire, porté à l’origine par le christianisme puis passé sous le contrôle des États, a tendu à rapprocher les cultures de l’Europe. La Magna Charta Universitatum, publiée par les universités européennes à l’occasion du IXe centenaire de l’université de Bologne, le rappelle : l’université, issue du christianisme, est un lieu de culture et de formation, où se construit le savoir grâce à la recherche, un lieu de dialogue où se forge un humanisme intégral, un lieu d’identification de l’Europe.
Dans ses discours célèbres prononcés en 1852 à l’occasion de la fondation de l’université de Dublin, John Henry Newman définit une certaine idée de l’université : « On me demande quelle est la fin de l’enseignement universitaire et ce savoir libéral ou philosophique qu’il doit, selon moi, dispenser ? Voici ma réponse : ce que j’ai dit jusqu’ici doit suffire à montrer que cette fin est tangible, réaliste et satisfaisante, même si elle ne peut se dissocier de ce même savoir. Le savoir, en effet, peut être à lui-même sa fin. L’esprit humain est ainsi constitué, en effet, que n’importe quelle connaissance, est à elle-même sa récompense. Si cela vaut pour toute connaissance, cela vaut donc également pour cette philosophie particulière qui consiste, d’après moi, dans une vision compréhensive de la vérité, envisagée dans toutes ses ramifications ; dans la vision des rapports qui existent entre science et science, de leur interaction, de leurs valeurs respectives78. » Newman rappelait volontiers que « Cicéron situe au premier rang la recherche du savoir pour lui-même ». C’est tout le sens du savoir libéral, au sens des arts libéraux des universités médiévales, c’est-à- dire de la culture générale. Sa mission est de former l’esprit, de lui donner sa cohérence, de l’unifier en quelque sorte. C’est ce qu’il appelait la philosophie. Jacques Maritain parlait de sagesse79. Du reste, la Sapienza est le nom donné à l’université de Rome, fondée en 1303 par Boniface VIII, qui fut longtemps l’université du pape jusqu’à ce qu’elle devienne université d’État après que Rome fut devenue capitale de l’Italie en 1870.
L’université, pensée par l’Église, a été l’un des éléments caractéristiques de la civilisation européenne et un facteur décisif de son développement. L’identité européenne s’est forgée en grande partie à travers l’irrigation intellectuelle opérée par les universités, d’Uppsala à Catane, d’Oxford à Cracovie, de Lisbonne, Salamanque et Alcalá de Henares à Leipzig. L’espace de l’université est l’espace de l’Europe toute entière, un espace qui reste encore à faire fructifier. Sur ce plan également, les universités et leurs membres, professeurs et étudiants, ont une responsabilité et une mission à assumer afin de faire vivre l’intuition des initiateurs du premier mouvement de création des universités au XIIIe siècle.
Conclusion
Les apports du christianisme à l’unité de l’Europe sont puissants. Ils sont facilement identifiables. Les pères chrétiens de l’Europe ont pu s’appuyer sur les théologiens, les philosophes, les écrivains, les artistes, voire les économistes, pour montrer l’absurdité des conflits qui ne pouvaient être que des guerres civiles, tant ce qui unit l’emporte sur ce qui pourrait séparer. Il y a bien une civilisation européenne fondée sur le christianisme. Celui-ci a su intégrer des apports exogènes, venus des civilisations grecques et romaines, et du judaïsme avec lequel le lien à travers l’Ancien Testament est très fort. Le christianisme s’est enrichi de ces apports, y compris de son rapport à l’islam. Tout cela ne s’est pas fait sans heurts. Longtemps, la relation au judaïsme a été fondée sur la théologie du peuple déicide, entraînant des persécutions toujours renouvelées. Il a fallu près de deux mille ans pour qu’un pape se rende dans une synagogue, à Rome, le 13 avril 1986, et pour qu’il reconnaisse la validité actuelle de l’alliance de Dieu avec le peuple d’Israël, le 17 novembre 1980. Jean-Paul II salua alors, dans la synagogue de Mayence, les représentants de la communauté juive, comme «le peuple de l’Alliance établie avec Moïse qui n’a jamais été révoquée 80». Il ne faut pas oublier que le crime de la Shoah a été pensé et mis en œuvre dans des territoires marqués par le christianisme.
C’est dire combien l’histoire est ambivalente. Les deux derniers siècles se caractérisent par un rétrécissement de l’influence des Églises sur les plans politique, intellectuel, religieux et sur celui des mœurs, sous l’effet de la montée de la puissance d’États nationaux et d’une aspiration grandissante à la liberté de conscience.
Le rôle des philosophes des Lumières a été déterminant. Ils ont ouvert la voie à d’autres manières de concevoir la société. Là encore, la résistance des Églises a été tenace.
Ce n’est qu’avec le concile Vatican II que la liberté religieuse a été reconnue et il a fallu attendre le message-radio de Noël 1944 de Pie XII, pour que la démocratie soit définie comme le régime politique qui peut le mieux promouvoir les valeurs portées par l’Évangile 81. Or ces évolutions étaient contenues dans les Écritures, mais les messages de paix, de tolérance, d’ouverture ont été longtemps brouillés par les conflits, les guerres, les refus de toute forme d’altérité. Et, cependant, les évolutions portées ou accentuées par les Lumières ne pouvaient pas être pensées en dehors du message chrétien.
C’est pourquoi le débat sur les racines chrétiennes de l’Europe pour savoir s’il faut les intégrer ou non à la Constitution de l’Union européenne est vite devenu un débat biaisé par des objectifs politiques plus ou moins avoués, qui ont encombré la discussion. Il est un fait que l’Europe s’est nourrie du christianisme, qui a assuré au continent une unité. Le problème est que le christianisme n’est pas uniforme, mais qu’il est lui-même divers. Il est fait de mémoires différentes, voire conflictuelles, liées aux influences subies, aux événements et aux hommes, aux lieux et aux langues, tout cela étant inextricablement imbriqué. Dans l’un de ses ouvrages, Paul Veyne s’interrogeait sur le fait de savoir si l’Europe avait des racines chrétiennes et s’il existait même des racines dans l’histoire82. En tout cas, un grand arbre comme l’arbre européen, a forcément des racines nombreuses, qui s’entremêlent. Edgar Morin utilise les expressions «bouillon de culture » et «tourbillon culturel» pour qualifier l’Europe83. Ce qui compte, c’est le patrimoine commun qui, malgré ou en raison de sa diversité, peut porter à une unité et contribuer à la paix dans un continent si longtemps déchiré. Une certaine unité culturelle forgée par le christianisme ne signifie pas qu’une identité européenne émerge réellement. Face aux identités nationales, l’identité européenne paraît bien fragile. Force est de constater que le christianisme n’est pas un ferment suffisant pour surmonter les divisions nationales.

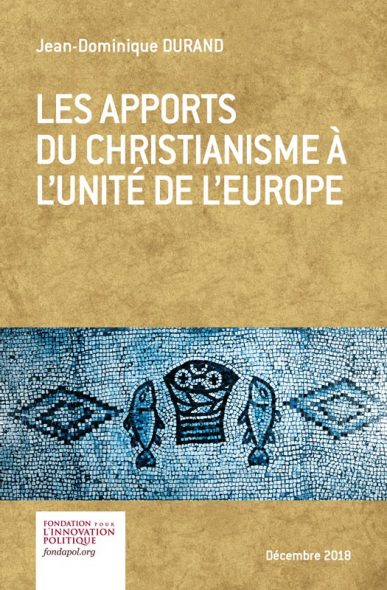











Aucun commentaire.