Les géants du numérique (2) : un frein à l'innovation ?
Introduction
Une « financiarisation » symptomatique d’un environnement trop peu concurrentiel
Des symptômes à la cause
Pouvoir de marché et pratiques anticoncurrentielles
Les géants technologiques sont-ils des monopoles naturels ?
De la nécessité d’une politique antitrust forte et d’un nouveau cadres réglementaire en faveur de la concurrence
Adapter la législation antitrust aux réalités du monde numérique
Renforcer la mise en application du droit de la concurrence
Au-delà du contrôle antitrust, de nouvelles régulations à concevoir ?
Conclusion génerale et recommandations
Adapter le droit antitrust européen aux réalités du monde numérique
Repenser l’application et l’interprétation du droit antitrust
Aller au-delà de l’antitrust
Annexes
Bibliographie
Résumé
Les pratiques anticoncurrentielles des Big Tech montrent que ces entreprises n’hésitent plus à s’appuyer sur leurs positions dominantes pour évincer leurs concurrents, bloquer l’entrée de jeunes firmes innovantes et asseoir ainsi leur hégémonie aux dépens du reste de la société.
Un cercle vicieux manifeste s’engage : leurs immenses réserves financières étudiées dans la première partie de cette note croissent à proportion de ces entraves concurrentielles en même temps qu’elles les facilitent.
Derrière cet inquiétant tableau se révèle en creux l’incapacité chronique des autorités antitrust à agir dans un secteur où les modèles économiques défient leurs grilles d’analyse habituelles. Afin de recréer les conditions d’un environnement propice à l’innovation, un durcissement et une adaptation de la politique de concurrence sont nécessaires. Cette transformation doit s’accompagner d’un renforcement des moyens et des compétences des autorités administratives, trop souvent dépassées par des pratiques anticoncurrentielles dont la technicité et la complexité ne font que croître.
Enfin, des politiques proactives comme des mesures d’interopérabilité et d’ouverture des droits de propriété industrielle compléteraient utilement la démarche souvent réactive de l’antitrust.
Trouver le juste équilibre entre rémunération des innovateurs d’hier et soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrêmement délicat. Mais il est clair que le laxisme des autorités antitrust et la passivité des régulateurs mettent en péril l’entrée sur le marché de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent d’agir, afin de ne pas laisser les anciens champions empêcher l’émergence des champions de demain.
La première partie de cette note est publiée simultanément et s’intitule Les Géants du numérique : Magnats de la finance.
Une version anglaise de cette étude est également disponible sur le site de la Fondation pour l’innovation politique.
Paul-Adrien Hyppolite,
Haut fonctionnaire du corps des Mines.
Haut fonctionnaire, normalien et ingénieur du corps des Mines.
Antoine Michon,
Haut fonctionnaire, polytechnicien et ingénieur du corps des Mines.
Introduction
Depuis deux décennies, le formidable succès commercial des géants américains des nouvelles technologies s’est traduit par une accumulation colossale de liquidités dans leurs bilans. Tandis que les firmes d’autres industries ont plutôt tendance à investir leurs profits dans leur appareil productif ou à les distribuer à leurs actionnaires, les Big Tech font le choix de conserver une part significative de ceux-ci sous forme de trésorerie. Dans la première partie de cette étude, nous avons tenté de montrer que ces liquidités sont par la suite investies très précautionneusement, la plupart du temps dans des titres de dette obligataire publique ou privée sans risque. À contre-pied de leur posture d’innovateurs de premier plan, les géants technologiques se révèlent donc être des investisseurs excessivement prudents. Nous nous sommes attachés à illustrer les conséquences néfastes d’une situation qui prive l’économie de capital productif et avons étudié différents remèdes pour lutter contre ce phénomène. En donnant davantage aux actionnaires l’opportunité d’influencer l’allocation du capital, en recourant à la régulation financière pour surveiller l’emploi des trésoreries ou encore en taxant davantage les profits ou le chiffre d’affaires, on pourrait potentiellement ralentir la dynamique d’accumulation de liquidités.
Toutefois, avant de réguler les trésoreries des géants technologiques, il semble nécessaire de s’intéresser à ce que nous pensons être la racine du problème : la source des profits qui les alimentent. S’il semble évident que ces derniers provenaient initialement d’innovations disruptives, à l’instar de l’iPhone en 2007 ou du réseau social Facebook en 2004, l’écosystème actuel soulève plus de questions. De plus en plus d’observateurs s’alarment du fait qu’un nombre réduit d’entreprises des nouvelles technologies se partagent la mainmise sur l’innovation technologique et captent une part croissante de la valeur ajoutée. En tant que consommateurs, nous constatons par ailleurs un ralentissement des innovations majeures, alors même que, dix ans après son lancement en 2007, l’iPhone coûte plus du double de son prix initial et que Facebook est régulièrement critiquée pour le peu d’attention portée aux données de ses utilisateurs. Dans ce contexte, on peut se demander si la thésaurisation des Big Tech n’est pas le fruit d’une réduction de l’intensité concurrentielle dans le secteur des nouvelles technologies, autrement dit la conséquence de défaillances structurelles dommageables pour le consommateur.
Afin d’y répondre, nous essaierons de montrer que l’industrie des nouvelles technologies est aujourd’hui le théâtre d’abus de position dominante de la part de ses acteurs les plus établis, intéressés au maintien de leur hégémonie au détriment de l’innovation technologique. Forts de ce constat, nous étudierons ensuite les adaptations nécessaires du droit antitrust et de son application, afin de prendre en compte les spécificités du monde numérique. Enfin, nous soulignerons l’importance de régulations proactives – complémentaires de la politique antitrust – pour œuvrer au développement d’un écosystème concurrentiel sain dans les nouvelles technologies.
Une « financiarisation » symptomatique d’un environnement trop peu concurrentiel
Des symptômes à la cause
Pour les ratios cours de Bourse/bénéfices (P/E ratio), voir chapitre I.3.c et graphique 21 dans la première partie de cette note.
On retrouve aujourd’hui dans le secteur des nouvelles technologies tous les symptômes d’une diminution significative de l’intensité concurrentielle : une persistance de profits colossaux (couplée à l’anticipation de profits futurs similaires), une tendance à la concentration du marché et, enfin, un essoufflement de l’activité entrepreneuriale.
a. Persistance de profits colossaux
Comme nous avons pu déjà le signaler, au cours de ces vingt dernières années les profits des géants technologiques américains ont été sans commune mesure avec ceux d’autres industries. Les valorisations actuelles des Big Tech signalent par ailleurs que les marchés anticipent un maintien – si ce n’est une augmentation – de ces profits dans les années à venir1. Une telle longévité de ces niveaux de rentabilité pourrait bien traduire une diminution de l’intensité concurrentielle sur le marché des nouvelles technologies. Il est, en effet, très rare qu’une entreprise évoluant dans un environnement concurrentiel soit en mesure de maintenir de tels résultats sur le long terme en raison de la pression à la baisse qu’exercent, en principe, ses concurrents et les nouveaux entrants.
b. Tendance à la concentration
Un deuxième symptôme de diminution de l’intensité concurrentielle réside dans la tendance marquée de consolidation qui prévaut depuis une décennie dans le secteur des nouvelles technologies. On constate en effet que la remarquable réussite des géants technologiques au cours des vingt dernières années s’est accompagnée de multiples acquisitions d’entreprises plus ou moins jeunes, opérant généralement sur des marchés adjacents. L’analyse des données extraites de la plateforme spécialisée Mergermarket met en évidence une importante activité d’achats de firmes de la part des Big Tech, qui s’est intensifiée à partir de la fin des années 2010 (voir graphique 1).
Graphique 1 : Acquisitions et prises de participation par type d’acquéreur – Top 10 Tech US (en nombre de transactions)
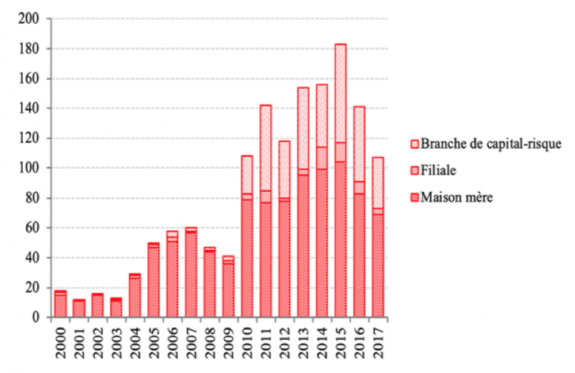
© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018
En moyenne, ils réalisent chacun plus de dix acquisitions par an depuis le début de la décennie.
Pour plus d’informations, se référer aux annexes A et B disponibles exclusivement sur la version numérique de la présente étude, sur notre site fondapol.org
Voir notamment le travail de Autor et al. (2017).
Acquisitions
Comme on le constate sur les courbes du graphique 2 , les géants technologiques participent tous sans exception à la dynamique de consolidation du secteur, également documentée par une littérature académique fleurissante2. En étudiant plus en détail ces transactions, on constate que les géants technologiques acquièrent très souvent de jeunes sociétés opérant sur des marchés similaires ou adjacents aux leurs3. Ce modèle a notamment été initié par Google avec les acquisitions de YouTube (2006) et Android (2007), suivi par Amazon avec Zappos (2009), Quidsi (2010) et Souq (2017), puis Facebook avec Instagram (2012) ou encore To Be Honest (2017). Cette consolidation s’opère également à un stade de développement plus avancé des firmes cibles. On pense par exemple au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014, de Tandberg par Cisco en 2009, de Skype et LinkedIn par Microsoft en 2011 et 2016, ou encore de Beats par Apple en 2014.
La courbe des montants investis dans ces rachats montre que le phénomène a pris de l’ampleur au cours des dernières années (voir graphique 3). Aussi bien pour les « petites » acquisitions stratégiques que pour les acquisitions de firmes plus matures, le constat est le même : l’industrie des nouvelles technologies semble être en proie à une consolidation4 horizontale de plus en plus forte.
Graphique 2 : Acquisitions de maisons mères et de filiales (en nombre de transactions)
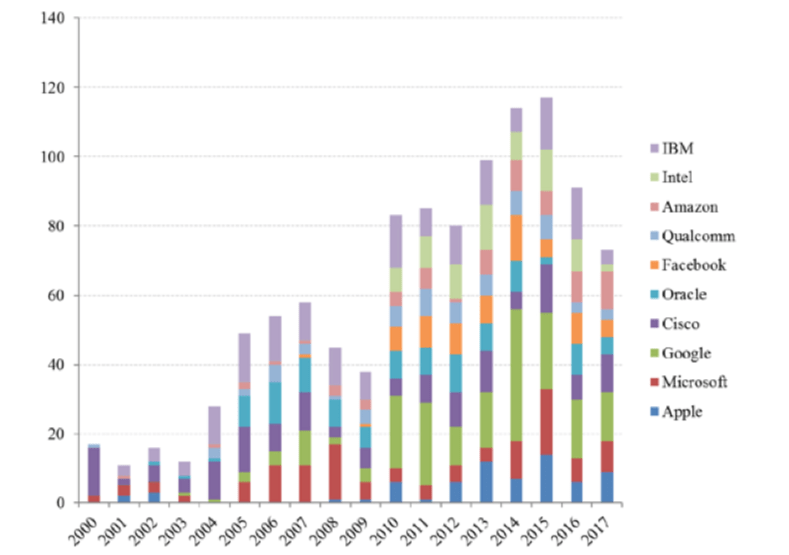
Copyright :
© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018
Graphique 3 : Acquisitions de maisons mères et de filiales (en milliards de dollars)
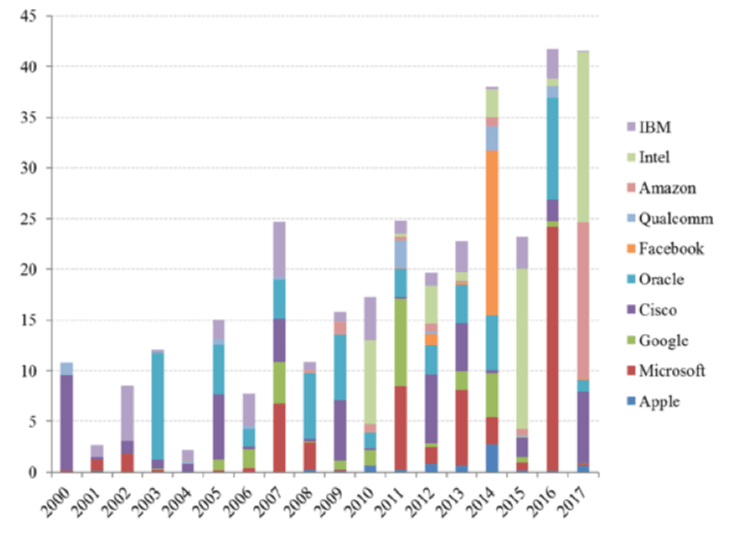
Copyright :
© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018
Parallèlement à ces opérations réalisées dans leurs marchés respectifs, les géants de la Silicon Valley accordent une importance toute particulière aux technologies prometteuses dans des segments radicalement nouveaux, susceptibles de mettre un jour en péril leur domination, en bouleversant leurs marchés et en créant de nouveaux verticaux à forte valeur ajoutée. L’acquisition d’Oculus par Facebook en 2014 constitue à cet égard un exemple intéressant : après avoir remarquablement bien réussi la transition de l’Internet sur ordinateur vers l’Internet sur smartphone, le réseau social a choisi de se positionner très tôt dans le marché de la réalité virtuelle afin de ne pas passer à côté d’un nouveau virage potentiel. L’achat de DeepMind par Google en 2014 suit la même logique : la firme de Mountain View a souhaité acquérir au plus vite des talents et des technologies liées à l’intelligence artificielle, car cette dernière pourrait prochainement bouleverser la manière dont nous faisons nos recherches en ligne.
En somme, l’analyse des acquisitions réalisées par les Big Tech au cours des vingt dernières années laisse entrevoir un schéma tactique récurrent. Les géants des nouvelles technologies acquièrent les jeunes entreprises qui les défient sur leurs marchés respectifs afin de s’approprier leur clientèle, leurs technologies et leurs équipes. Parallèlement à ces achats de consolidation horizontale, les Big Tech rachètent les entreprises très innovantes dans les segments naissants des nouvelles technologies, s’assurant par-là un accès aux nouveaux verticaux prometteurs du secteur.
Investissement capital-risque
À ces prises de contrôle s’ajoutent également des prises de participation réalisées le plus souvent via leurs véhicules internes de capital-risque5. Comme l’illustre le graphique 4, elles sont très fréquentes et ont connu une forte accélération au début de la dernière décennie. Nous pensons que cette dynamique s’inscrit dans la veille exercée par les Big Tech sur les innovations technologiques. Soucieux de ne pas répéter les erreurs de leurs aînés6, ils s’assurent par ces investissements un accès privilégié à l’innovation. Ils peuvent ainsi surveiller de près et au plus tôt l’émergence de toute technologie prometteuse.
Graphique 4 : Prises de participation par les branches de capital-risque (en nombre de transactions)
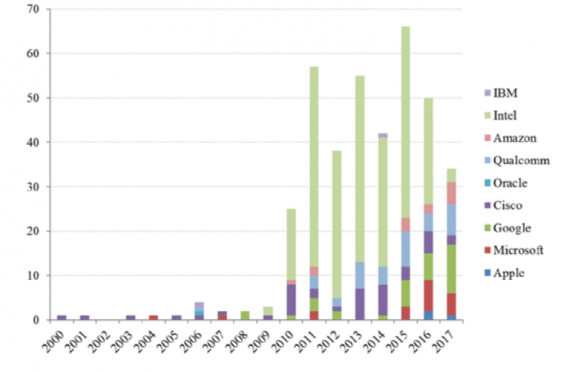
© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018
Ces prises de participations complètent les efforts colossaux de R&D effectués en interne. Les géants technologiques présentent, en effet, des ratios d’investissement en R&D cinq à six fois supérieurs à ceux d’industries traditionnelles (voir graphique 5). La stratégie poursuivie est la même que celle guidant les investissements externes : tandis qu’ils allouent une partie de leur R&D à leur cœur de métier, les Big Tech maintiennent en parallèle des départements de recherche concentrés sur des verticaux totalement nouveaux. Citons comme exemple le laboratoire Google X qui a notamment travaillé sur la voiture autonome (Waymo) et la réalité augmentée (Google Glass), ou encore le défunt projet Aquila de Facebook développant un drone à énergie solaire.
Graphique 5 : Comparaison des dépenses de R&D (en % du chiffre d’affaires)
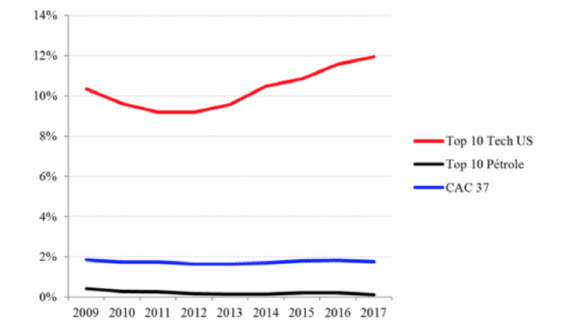
© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018
Les investissements en capital-risque participent donc à la forte consolidation du secteur des nouvelles technologies, déjà constatée avec les nombreuses acquisitions des Big Tech. Mais, au-delà de la concentration des entreprises elles- mêmes, on remarque une concentration massive de la capacité d’innovation. Cette dernière est centralisée dans les mains d’un très faible nombre d’acteurs qui, par leurs dépenses de R&D, leurs prises de participation en capital-risque et leurs acquisitions de sociétés concurrentes ou en passe de l’être, s’assurent la mainmise sur les technologies et les marchés de demain.
Après la persistance des profits colossaux des géants technologiques, cette forte concentration constitue une deuxième piste sérieuse de diminution de l’intensité concurrentielle dans le secteur. Notons qu’il existe un cercle vicieux manifeste entre ces deux dynamiques : la concentration de l’innovation permet le maintien de profits anormalement élevés, et ces derniers alimentent les trésoreries qui garantissent aux géants technologiques la possibilité de racheter tout concurrent émergent ou toute technologie prometteuse.
Voir notamment Ben Casselman, « Corporate America Hasn’t Been Disrupted », 8 août 2014 (fivethirtyeight.com/features/corporate-america-hasnt-been-disrupted/), et James Surowiecki, « Why Startups Are Struggling », technologyreview.com, 15 juin 2016.
Lire, par exemple, John Haltiwanger, Ian Hathaway et Javier Miranda, « Declining Business Dynamism in the US High-Technology Sector », Ewing Marion Kauffman Foundation, février 2014 , ou Ryan A. Decker, John Haltiwanger, Ron S. Jarmin et Javier Miranda, « The Secular Decline in Business Dynamism in the U.S. », working paper, juin 2014.
Voir Amir Teig, « Waze Employees Clinch Most Lucrative Exit in Israeli History », haaretz.com, 13 juin 2013.
« We will not be selling the company unless some insane whatsapp like thing happened. We are building a forever biz, not a flip », (cité par Josh Constine, in « Facebook buys Vidpresso’s team and tech to make video interactive », techcrunch.com, 13 août 2018.
Par exemple, Jon Evans, « After the end of the startup era », techcrunch.com, 22 octobre 2017.
c. Essoufflement de la dynamique entrepreneuriale
Vu d’une France qui se rêve en « start-up nation » et lorgne jalousement sur la Silicon Valley, l’idée d’un ralentissement de la dynamique entrepreneuriale américaine dans les nouvelles technologies peut paraître étonnante. Pourtant, c’est bien ce que déplorent de nombreux observateurs7 et ce que documente parallèlement une littérature académique grandissante8. Nous y voyons là un troisième signal d’une diminution de l’intensité concurrentielle dans le secteur des nouvelles technologies.
Au-delà de la diminution objective du taux d’entrée de jeunes firmes innovantes et des chances de « passage à l’échelle », de moins en moins d’entrepreneurs semblent motivés par la perspective de réussites exceptionnelles ou habités par ce que les Américains nomment volontiers le moonshot thinking. Alors que de nombreux entrepreneurs avaient autrefois l’ambition de créer le « Microsoft du XXIe siècle », une proportion grandissante d’entre eux semblent, en effet, avoir pour premier objectif un rachat lucratif par l’un des géants technologiques. Il faut dire que les exemples ne manquent pas. Lorsque Google a mis la main sur Waze, en 2013, ce sont 120 millions de dollars qui ont été distribués aux 100 employés de la start-up israélienne. La presse n’a pas manqué de mettre en avant la fortune de ces jeunes développeurs9. Citons également le cas récent de l’acquisition de Vidpresso par Facebook. Alors que la start-up spécialisée dans les vidéos interactives insistait auprès de ses employés sur l’importance de son indépendance il n’y a même pas deux ans10, l’opportunité d’un rachat lucratif par le géant de Menlo Park a finalement eu raison de leur ambition de départ. Dès lors, la perspective de l’émergence d’un nouveau géant technologique venant bousculer l’ordre établi des Big Tech paraît fort lointaine : après les vagues successives des entreprises de l’ordinateur (Apple, Microsoft, IBM, Intel, Qualcomm, etc.), de l’Internet (Google, Amazon, Facebook, AirBnb) et du smartphone (Uber, Instagram, WhatsApp, Snapchat), c’est une mer peu agitée qui semble se dessiner devant nous. En outre, comme l’ont très justement noté certains observateurs11, les technologies qui sont aujourd’hui considérées comme les plus prometteuses pour la prochaine décennie ne se prêtent pas vraiment à l’émergence de nouveaux géants technologiques. Toutes présentent, en effet, d’importantes barrières à l’entrée : dépenses de R&D colossales pour la voiture autonome et la réalité virtuelle ou augmentée, besoin de données massives pour l’intelligence artificielle, faibles marges difficiles à soutenir pour de jeunes entreprises pour les drones et l’Internet des objets.
Pouvoir de marché et pratiques anticoncurrentielles
Pour plus de détails, voir l’annexe C, disponible exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site fondapol.org.
Après avoir constaté que l’industrie des nouvelles technologies présentait des signes d’une diminution de son intensité concurrentielle, il reste à établir ce que laissent présager ces indices concordants, à savoir que les géants technologiques américains ont acquis des positions de domination et qu’ils s’en servent à présent pour entraver la concurrence.
a. Des parts de marché colossales
Position dominante et nouvelles technologies
Nous considérons qu’une firme est en situation de position dominante si elle possède un « pouvoir de marché », autrement dit si elle est en mesure de fixer ses prix au lieu de se les voir imposer par les conditions générales du marché. En règle générale, les parts de marché constituent un bon indicateur d’un tel pouvoir. Malheureusement, la notion de part de marché est parfois difficile à définir dans le secteur des nouvelles technologies, notamment lorsque les services aux utilisateurs sont gratuits et les recettes réalisées sur des propositions de valeur connexes ou auprès de tiers. Ainsi, faire une recherche sur le moteur Google ou bien créer un profil sur les réseaux sociaux de Facebook ne coûte rien à l’utilisateur (financièrement parlant) car ces entreprises se rémunèrent auprès d’annonceurs qui utilisent leurs supports pour afficher de la publicité en ligne. Comment définir conceptuellement la notion de marché en l’absence de transaction financière et de variation de prix ? Peut-on parler d’un marché des recherches Internet, des réseaux sociaux ou encore des données d’utilisateurs ? Plus compliqué encore : existe-t-il un marché de l’« attention en ligne », mesurant la part du temps passé sur chaque service par l’utilisateur ? Malgré les difficultés conceptuelles que soulèvent ces questions, une approche pragmatique semble aujourd’hui s’imposer.
Parts de marchés des Big Tech
La décision de la Commission européenne sur le cas Google Shopping a, par exemple, considéré l’existence d’un marché des recherches sur Internet pour conclure que Google abusait de sa position dominante sur ce dernier. Dans le même esprit, l’Allemagne a amendé sa loi antitrust en 2017 afin d’inclure dans l’examen des positions dominantes l’analyse de l’éventuel usage lié de différents services et le transfert de coûts et profits entre ceux-ci (nous examinerons cet aspect un peu plus loin).
Nous prenons également le parti d’une approche pragmatique de la notion de marché en dépassant la seule analyse en fonction du chiffre d’affaires12. Les parts de marché évoquées varient d’une source à l’autre en raison de la difficulté de leur évaluation. Toutefois, une appréciation globale en ressort incontestablement : les Big Tech ont des positions ultradominantes sur un certain nombre de technologies et d’activités liées. Parmi les nombreux exemples, on peut citer la suprématie de Google sur la recherche en ligne en Europe (90% de part de marché), celle de Microsoft sur les systèmes d’exploitation pour ordinateur dans le monde (80% de part de marché) ou encore celle d’Amazon sur le livre numérique aux États-Unis (83% de part de marché). À titre indicatif, la Commission européenne considère qu’une part de marché supérieure à 40% constitue un indicateur de position dominante, tandis qu’aux États-Unis le Department of Justice (DoJ) suspecte un pouvoir de monopole à partir de 50% de part de marché. Plus encore que la valeur absolue de ces statistiques, il convient de considérer leur dynamique : Google et Facebook captureraient ainsi, à eux deux, de l’ordre de 90% de la croissance du marché de la publicité en ligne aux États-Unis13.
Une autre différence importante réside dans la présence en droit de la concurrence européen d’un mécanisme destiné à lutter contre les aides d’État anticoncurrentielles au sein du marché intérieur de l’Union européenne. Ce mécanisme a notamment permis à la Commission européenne de condamner Apple à rembourser 13 milliards d’euros à l’Irlande en Dans le cadre de cette étude, nous n’approfondirons pas ce dernier volet propre aux distorsions de concurrence au sein même de l’Union européenne. Pour un exposé plus complet des spécificités du droit antitrust en Europe et aux États-Unis, voir l’annexe D, disponible exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site.
Pour une liste complète de ces affaires, voir les annexes E, F et G, disponibles exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site.
Ibid.
Stacy Mitchell, « Amazon Doesn’t Just Want to Dominate the Market—It Wants to Become the Market », The Nation, 15 février 2018.
Timothy B. Lee, « Yelp’s CEO makes the case against Google’s search monopoly », vox.com, 3 juillet 2017.
Les données américaines proviennent du Center for Responsive Politics, un organisme à but non lucratif basé à Washington (DC) dont l’activité consiste à suivre l’utilisation de l’argent en politique via une base de données en libre accès sur Internet (opensecrets.org). Les dépenses de lobbying qui y sont référencées proviennent toutes du Senate Office of Public Records. Les données européennes, quant à elles, sont extraites du site eu qui s’appuie sur les archives du registre de transparence de l’Union européenne (EU Transparency Register). Les données ne remontent malheureusement pas plus loin que 2012.
b. Des pratiques anticoncurrentielles manifestes
Cette situation de domination présente un risque majeur : celui que les Big Tech fassent usage de leur suprématie pour entraver la concurrence sur leurs marchés. Nous entrons en conséquence dans le domaine de la régulation antitrust, pan du droit censé garantir le maintien d’une bonne dynamique concurrentielle dans l’économie de marché.
Des abus de position dominante avérés
Force est de constater que les Big Tech ont déjà connu plus d’une passe d’armes avec les autorités concurrentielles européennes et américaines. Avant d’étudier ces conflits judiciaires, arrêtons-nous un instant sur les différences entre les droits antitrust européen et américain. En Europe comme aux États-Unis, le droit antitrust regroupe les droits des États membres (ou États de l’Union) et le droit communautaire (ou fédéral). De part et d’autre de l’Atlantique, ce droit s’appuie sur deux piliers principaux.
Le premier pilier, en amont, s’appuie sur le fait que les autorités compétentes exercent un contrôle sur les concentrations (comme les fusions-acquisitions ou les co-entreprises). Le droit leur confère le pouvoir d’interdire, ou d’autoriser sous conditions, des concentrations susceptibles de menacer l’équilibre concurrentiel d’un marché. Dans le domaine qui nous intéresse, la Commission européenne a par exemple, en 2011, dans le cadre du rachat de McAfee, imposé à Intel de s’engager à maintenir, après la fusion, un libre accès aux spécifications de sécurité de ses puces. L’objectif était d’éviter que McAfee bénéficie d’informations inaccessibles à ses concurrents, ce qui aurait directement biaisé la concurrence sur le marché de la sécurité informatique. En 2010, lors du rachat de Tandberg, la Commission européenne a demandé à Cisco de vendre son protocole « TIP » afin de limiter l’emprise du groupe ainsi fusionné sur les technologies de vidéoconférence.
Le second pilier, en aval, constitue l’antitrust à proprement parler : il s’agit de la lutte contre les ententes, les cartels et autres abus de position dominante. Dans ce cadre, les autorités peuvent infliger des amendes afin de punir d’éventuelles infractions et rendre dissuasive la transgression des règles antitrust. Elles peuvent également ordonner toute action nécessaire au rétablissement d’une saine concurrence sur un marché. Souvenons-nous, par exemple, des décisions de démantèlement de la société pétrolière nord-américaine Standard Oil en 1914 ou de scission de Microsoft en 2000 (annulée en appel en 2001).
En Europe, au niveau communautaire, l’examen des concentrations et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles s’opèrent via des décisions administratives, tandis qu’aux États-Unis, les autorités – Federal Trade Commission (FTC) ou Department of Justice (DoJ) – ou les particuliers font respecter le droit antitrust devant les tribunaux civils ou pénaux14.
Nous avons examiné l’ensemble des affaires antitrust ayant impliqué les géants technologiques au niveau communautaire européen ou fédéral américain15. En Europe, on constate ainsi une intensification importante des décisions administratives pénalisant les Big Tech pour pratiques anticoncurrentielles depuis 2014, date de la prise de fonction de Margrethe Vestager, l’actuelle commissaire européenne à la concurrence. Les actions contre Google se sont multipliées et font régulièrement la une de l’actualité. L’entreprise de Moutain View s’est d’abord vu infliger une amende de 2,42 milliards d’euros en 2017 pour avoir favorisé son propre comparateur de shopping en ligne sur son moteur de recherche Google Search, au détriment de services concurrents relégués plus bas dans les résultats affichés. Puis, en 2018, la Commission européenne a infligé à Google une amende de 4,34 milliards d’euros pour des pratiques anticoncurrentielles relatives à ses licences du système d’exploitation pour mobile Android. L’entreprise obligeait les constructeurs de smartphones à préinstaller des applications Google afin de bénéficier d’une licence du magasin d’applications Google Play. Loin des projecteurs et de l’attention du public, les pratiques anticoncurrentielles des géants technologiques dans les matériels de pointe ont également été épinglées par la Commission européenne : cette année, Qualcomm a été pénalisée à hauteur de 997 millions d’euros pour des pratiques d’achat d’exclusivité pour ses modems auprès des constructeurs mobile. Intel est toujours sous le coup d’une amende de 1,06 milliard d’euros de 2009 pour des pratiques similaires dans le marché des micro-processeurs pour ordinateurs. Notons que, dans la majorité des cas, les entreprises sanctionnées font appel de ces décisions administratives.
Aux États-Unis, la situation est différente. La fin du siècle dernier a été marquée par une affaire antitrust tonitruante, dans laquelle le DoJ accusait Microsoft d’abuser de sa position dominante dans les systèmes d’exploitation pour ordinateur afin d’asseoir son hégémonie dans le marché des navigateurs Web (en préinstallant Internet Explorer sur Windows), au détriment de ses concurrents comme Opera ou Netscape. Le 7 juin 2000, la cour fédérale du district de Columbia ordonna la scission de Microsoft en deux entités : l’une en charge des systèmes d’exploitation, l’autre du développement et de la vente des autres briques logicielles. L’annulation en appel de ce jugement et l’accord à l’amiable trouvé par la suite entre Microsoft et le DoJ sont toujours considérés par de nombreux observateurs comme le symbole de l’abandon par les pouvoirs publics de la lutte antitrust contre les géants technologiques. Deux décennies plus tard, il semble en effet que très peu ait été fait outre-Atlantique par les agences fédérales sur les dossiers dont elles se sont emparées16. Les actions notables de mise en application de lois antitrust émanent plutôt de plaintes privées. Citons à cet égard la class action contre Microsoft en Californie en 2001 pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation, qui a vu le géant de Redmond s’acquitter de 1,1 milliard de dollars de dommages, ou encore l’attaque en justice d’AMD à l’encontre d’Intel, en 2005, pour achat d’exclusivité, qui a obligé Intel à accepter un accord à l’amiable incluant le versement de 1,25 milliard de dollars en guise de dédommagement.
On observe par ailleurs un fait singulier : certaines des pratiques anticoncurrentielles ayant eu des impacts significatifs de part et d’autre de l’Atlantique n’ont été poursuivies que d’un côté. Prenons l’exemple du marché des livres numériques. Donnant suite à une plainte d’Amazon pour pratiques anticoncurrentielles, la FTC a poursuivi Apple en 2012, en lui reprochant une entente avec cinq maisons d’édition visant à maintenir des prix artificiellement élevés sur le marché des livres numériques. Après une première condamnation et quatre années de rebondissements judiciaires, Apple a finalement été débouté par la Cour suprême en 2016 et s’est acquitté d’une amende de 450 millions de dollars. Pendant ce temps, en Europe, la Commission européenne a entamé en 2015 une enquête visant Amazon et ses accords avec les éditeurs, qui empêcheraient l’émergence d’une plateforme de livres numériques concurrente. La Commission européenne et Amazon ont finalement conclu un accord, rendu juridiquement contraignant en 2017. Ironie du sort, aucune enquête publique à l’endroit d’Apple sur ce sujet n’a été menée en Europe et, symétriquement, Amazon n’a fait l’objet d’aucune investigation aux États-Unis. De fait, d’autres atteintes à la libre concurrence ont pu passer sous les radars des autorités.
Des soupçons additionnels d’abus de position dominante
À ces cas de pratiques anticoncurrentielles avérées s’ajoutent donc de nombreuses suspicions relayées soit par des enquêtes en cours de la part des autorités compétentes, soit par des observations n’ayant pas – ou toujours pas – engendré l’ouverture d’enquêtes publiques.
La Commission européenne a annoncé en 2016 avoir décidé d’entamer une enquête approfondie sur le service AdSense de Google. Elle suspecte la firme de Mountain View d’avoir favorisé les publicités de sa propre régie publicitaire sur les sites tiers dont elle gère les barres de recherche. Dans une autre enquête ouverte en 2015, la Commission européenne soupçonne Qualcomm de pratiquer des prix prédateurs pour évincer sa concurrence. Enfin, en septembre 2018, Margrethe Vestager a annoncé étudier les pratiques de collecte de données d’Amazon, même si aucune enquête n’a encore officiellement été entamée.
D’autres suspicions de pratiques anticoncurrentielles des géants technologiques américains font régulièrement surface et restent la plupart du temps sans suite. Mentionnons tout d’abord celles qui émanent d’entreprises en concurrence directe ou ayant refusé leurs offres d’achat. Le cas d’Amazon sur le marché du commerce de détail en ligne est illustratif. Au moment de l’acquisition du site de vente de chaussures en ligne Zappos, en 2009, la firme de Seattle aurait sciemment cassé les prix sur ses propres ventes de chaussures, allant jusqu’à s’infliger des dizaines de millions de dollars de pertes dans le seul but de forcer Zappos, incapable de survivre bien longtemps dans cette bataille à armes inégales, à accepter son offre d’achat. L’acquisition de Quidsi (diapers. com) en 2010 ferait suite à des manœuvres similaires sur le prix des couches en ligne17. Citons également l’exemple de Yelp qui est entré en Bourse à New York (Nasdaq) en 2012 après avoir refusé, en 2009, une offre d’achat de Google à hauteur d’un demi-milliard de dollars. Son PDG, Jeremy Stoppelman, affirme sans relâche que Google a par la suite sciemment diminué la visibilité des avis critiques émanant de Yelp sur son moteur de recherche, dans le but de favoriser son propre service d’avis en ligne18. L’entreprise a pu survivre grâce à la réputation qu’elle avait déjà acquise aux États-Unis, beaucoup d’utilisateurs allant directement sur l’application mobile ou le site Web sans passer par le moteur de recherche de Google. Mais les actions de Google auraient significativement ralenti son développement dans ses nouveaux marchés, en Europe notamment.
Le cas de la messagerie instantanée Snapchat est également intéressant. Après avoir refusé une offre d’achat de Facebook à 3 milliards de dollars en 2013, la jeune société a fait son entrée à la Bourse de New York (NYSE) quatre ans plus tard, pour une valorisation de 33 milliards de dollars. Mais, fort de son effet de réseau, Facebook n’a eu qu’à copier les innovations de Snapchat (« stories » et filtres vidéo) et les mettre en place sur Instagram pour entraver sévèrement son rival, dont la capitalisation boursière a depuis été divisée par deux.
Plus généralement, l’économie de plateforme, au sein de laquelle les géants technologiques occupent une place tout à fait centrale, alimente fortement les suspicions de pratiques anticoncurrentielles. La position d’Amazon à la fois comme vendeur de détail et plateforme de revente pour commerçants tiers (Marketplace) fait débat. Par ce positionnement privilégié, Amazon a accès à de précieuses données d’achats, de prix et de stock, à partir desquelles il est possible d’extrapoler les préférences des consommateurs et les pratiques d’autres commerçants. Dès lors, comment garantir qu’Amazon n’utilisera pas sa position dominante sur la plateforme pour s’approprier des parts de marché dans le commerce en ligne, au détriment de ses concurrents et, à terme, du consommateur ?
De même, Facebook a ouvert son écosystème via différentes interfaces permettant à des tiers d’utiliser des fonctionnalités de la plateforme. C’est le cas par exemple de Graph API, qui ouvre à des développeurs l’accès aux informations du réseau social, ou encore de Facebook Connect, fonctionnalité mise en place en 2018 pour permettre à ses utilisateurs de se connecter sur d’autres sites via leur compte Facebook. Avec un tel contrôle sur l’activité de tiers, comment s’assurer que Facebook ne pratique pas d’actions discriminantes vis-à-vis d’éventuels concurrents ?
a. Des dépenses de lobbying en forte croissance
Dans ce contexte de relations à forts enjeux entre géants technologiques et autorités antitrust, on constate, de part et d’autre de l’Atlantique, une très nette augmentation des dépenses de lobbying engagées par les premiers (voir graphiques 6 et 7)19. Notons que ces efforts ne sont pas uniquement destinés à influencer les décisions propres à la concurrence, et il est clair que bien d’autres sujets, tels le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe, ont pu occuper les lobbyistes des Big Tech.
On remarque toutefois que l’effort de lobbying des géants technologiques est majoritairement déployé aux États-Unis, les frais engagés auprès des institutions européennes étant nettement inférieurs. Cela pourrait s’expliquer par le fait que leurs enjeux économiques sont plus importants aux États-Unis qu’en Europe. Une autre explication pourrait être que la sphère de compétence des autorités européennes est moindre que celle des autorités américaines, compte tenu des prérogatives retenues par les États membres en Europe. Enfin, cet écart pourrait s’expliquer par une plus grande permissivité des autorités américaines à l’égard des Big Tech, sur fond d’intérêt stratégique américain.
Graphique 6 : Dépenses de lobbying auprès des institutions américaines (en millions de dollars)
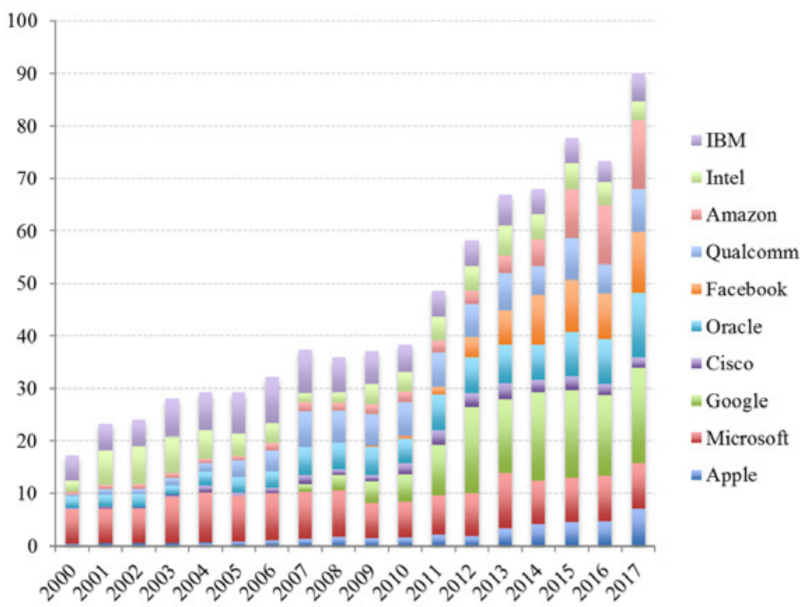
Copyright :
© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018
Graphique 7 : Dépenses de lobbying auprès des institutions européennes (en millions de dollars)
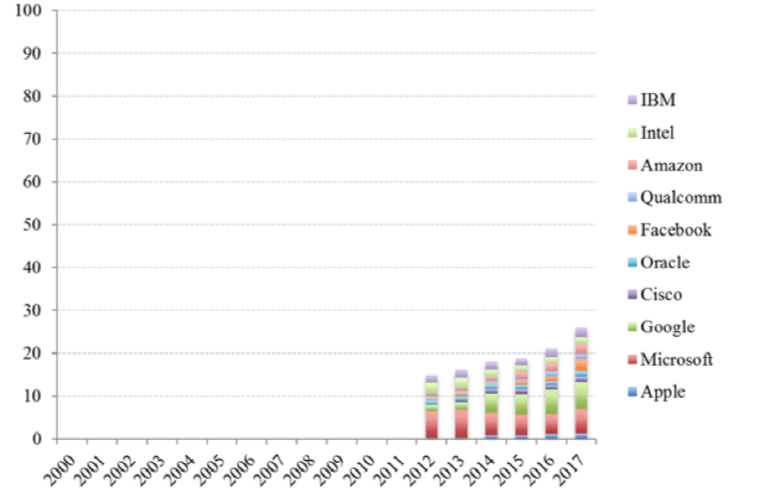
Copyright :
© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018
Quoi qu’il en soit, les géants technologiques ont manifestement fait le choix de ne pas réitérer l’erreur de Microsoft, qui n’avait pas ou peu de présence à Washington au début des années 1990 lorsque ses déboires avec les autorités antitrust ont commencé. Notons, enfin, que le pouvoir d’influence des géants technologiques sur la sphère politique dépasse leur capacité de lobbying, puisque leur accès direct auprès de la majorité des citoyens leur confère des moyens de pressions considérables. En 2012, au moment des discussions sur les projets de loi Stop Online Piracy Act et Protect IP Act au Congrès, Google avait ainsi affiché une banderole noire sur son moteur de recherche dénonçant la supposée « censure » qu’on s’apprêtait à lui imposer.
Les géants technologiques sont-ils des monopoles naturels ?
À ce stade, nous avons mis en évidence une diminution de l’intensité concurrentielle dans l’industrie des nouvelles technologies et constaté que les Big Tech ont tendance à se servir de leurs positions dominantes pour maintenir leur hégémonie, au détriment d’entreprises établies et de nouveaux entrants. Dès lors, comment faut-il les réguler ? Les géants des nouvelles technologies sont-ils des monopoles naturels ? Si oui, alors l’arsenal classique de la politique antitrust (contrôle des fusions-acquisitions, des abus de position dominante et des ententes) n’est pas adapté, et des régulations propres aux entreprises de services publics, à l’instar des réseaux électriques, ferroviaires ou de télécommunications, s’imposent.
a. Les monopoles naturels
Pour rappel, le monopole naturel se définit par une situation économique dans laquelle toute la demande du marché peut être satisfaite par une seule et même entreprise à un prix inférieur et à une qualité supérieure à ce que fourniraient plusieurs entreprises en situation de concurrence. On peut étudier les conditions nécessaires à l’existence d’un monopole naturel sous deux angles : tout d’abord, du côté de l’offre, l’industrie doit présenter des coûts fixes importants ou des économies d’échelle propres au système de production ; ensuite, du côté de la demande, l’utilisateur doit bénéficier d’effets de réseaux ou bien être indifférent à la présence d’un ou plusieurs acteurs. À certains égards, il semble que les Big Tech possèdent bien des caractéristiques de monopoles naturels, de sorte qu’il existe indéniablement une tendance à la concentration dans les nouvelles technologies.
Du point de vue de l’offre, l’économie digitale a tendance à reposer sur des rendements d’échelle croissants. Les coûts fixes de création d’algorithmes, de développement d’un produit ou d’une plateforme s’accompagnent généralement de coûts variables quasi nuls. Le coût marginal d’un utilisateur supplémentaire pour Facebook ou Google, d’une nouvelle licence Windows pour Microsoft ou encore d’un nouvel abonné sur iTunes pour Apple est proche de zéro. Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’utilisateurs permet une amélioration de l’efficacité de l’appareil productif, car elle accroît la quantité de données récoltées et améliore ainsi les statistiques et l’analyse du comportement de ces mêmes utilisateurs. En conséquence, les nouvelles technologies, en particulier l’économie de plateforme, sont propices à l’apparition de rendements marginaux croissants.
Du point de vue de la demande, la présence d’effets de réseau joue indéniablement en faveur d’une concentration du secteur. Les effets directs sont omniprésents. À l’échelle individuelle, l’utilité dérivée de la création d’un compte Facebook ou Instagram ou du téléchargement de l’application WhatsApp croît avec la proportion de son cercle d’amis l’utilisant pour communiquer. Mais des effets indirects concourent également à ce même phénomène. La plateforme de l’application Waze (Google) gagne en pertinence chaque fois qu’un nouvel utilisateur la rejoint, car la qualité du guidage et des informations sur la route s’en retrouve améliorée. Le système de recommandation d’Amazon s’affine également avec chaque nouveau client dont les recherches et les achats viennent enrichir les algorithmes en données. La diversité et la qualité de l’offre des magasins d’applications App Store (Apple) et Play Store (Google) augmentent avec le nombre d’utilisateurs car leur popularité auprès des développeurs d’applications s’en retrouve renforcée.
20. David Wismer, « Google’s Larry Page: “Competition Is One Click Away” (And Other Quotes Of The Week) », forbes. com, 14 octobre 2012
Pour l’Europe, données de la Commission européenne. Pour les États-Unis, données eMarketer.
Tinder domine le marché américain avec 26% des parts, suivi de PlentyOfFish avec 19%, OkCupid avec 10%, puis eHarmony, Match et Grindr, avec respectivement 9, 7, et 6% (données Statistica, avril 2016).
Comme on l’a vu, Facebook pourrait, grâce à la seule puissance de son réseau, venir à bout de Snapchat après avoir simplement copié et mis en place les mêmes solutions (« stories » et filtres) sur la plateforme Instagram.
b. Tendance à la déconcentration
Néanmoins, nous pensons que cette dynamique de concentration « naturelle » présente des limites, en raison de l’existence de forces contraires, autrement dit de déconcentration, aussi bien du côté de l’offre que de la demande.
Du côté de l’offre, les géants de la Silicon Valley évoluent dans un environnement intrinsèquement dynamique où la possibilité d’une innovation de rupture (non incrémentale) reste omniprésente. Il s’agit d’ailleurs d’un des principaux arguments défensifs des Big Tech lorsque sont évoquées leurs positions dominantes. Larry Page, le PDG d’Alphabet (maison mère de Google), le répète ainsi à l’envi : « Sur Internet, la concurrence est accessible en un clic20. » En outre, l’expérience montre que malgré les économies d’échelle et les effets de réseau, la plupart des marchés multifaces ou de plateformes ne suivent pas nécessairement une dynamique d’extrême concentration aboutissant à la survie d’un unique acteur. Il existe suffisamment de marchés où des plateformes coexistent depuis longtemps pour considérer que l’économie-plateforme n’est pas celle du monopole naturel. À cet égard, l’exemple des agences de voyages en ligne est parlant. Le marché américain s’organise autour d’un duopole formé de Booking Holdings (Booking.com, Kayak.com, Priceline. com), environ 45% de part de marché, et Expedia (Expedia.com, Hotels. com, Trivago.fr), environ 30% de part de marché. Il s’agit d’une industrie extrêmement concurrentielle, dans laquelle ces deux acteurs coexistent et se font concurrence depuis des années. L’exemple du commerce de détail en ligne en est un autre. Même s’il est indéniable qu’Amazon a acquis une position dominante sur le marché (en particulier aux États-Unis), d’autres plateformes de distribution parviennent toujours à concurrencer la firme de Jeff Bezos sur certains verticaux. Mentionnons par exemple Zalando, en Europe, qui perce dans le domaine du prêt-à-porter sur un modèle similaire à celui d’Amazon, et a réalisé une introduction en Bourse en 2014 pour une valorisation de 5,3 milliards d’euros.
Du côté de la demande, il existe également une dynamique favorisant la déconcentration des acteurs. La taille du marché des géants technologiques de l’économie de plateforme correspond globalement à la population connectée (de l’ordre de 90% en Europe et 85% aux États-Unis21). Le marché est de fait profondément divers, la pluralité des origines culturelles, démographiques et sociales des utilisateurs se traduisant nécessairement par des préférences différentes. A fortiori, cela favorise l’émergence d’entreprises s’adaptant aux inclinations d’une fraction plus ou moins spécifique de la population. Le marché des applications et plateformes de rencontre en ligne le montre bien. Son important degré de fragmentation22 reflète les attentes d’utilisateurs à la recherche de différentes modalités de rencontre, fréquentations, pratiques sexuelles, etc. Dans l’objectif de maximiser ses chances de rencontrer un certain type de partenaire, un utilisateur donné n’aura pas forcément intérêt à rejoindre la plateforme qui regroupe le plus d’utilisateurs s’il existe une alternative dont l’affluence est certes moindre mais davantage susceptible de répondre à ses attentes. Cette remarque peut être extrapolée aux relations sociales en général : de même qu’il existe plusieurs façons d’envisager les rencontres, il existe de multiples façons d’interagir socialement, d’où la nécessaire diversité des réseaux sociaux. Avant son rachat, Instagram existait et prospérait indépendamment de Facebook. Twitter propose toujours une offre de services différente de celle de Facebook, et nombreux sont ceux qui possèdent des comptes sur les deux plateformes. Et si Snapchat est aujourd’hui sur la pente descendante, c’est probablement parce que le laxisme des autorités antitrust en matière de contrôle des fusions-acquisitions a permis à Facebook de se construire une position ultradominante sur le marché23. Notons, enfin, les difficultés qu’ont certains réseaux sociaux occidentaux à percer sur les marchés asiatiques. Si les barrières réglementaires expliquent en partie ces difficultés (notamment en Chine), on ne saurait négliger l’importance des différences culturelles.
c. Régulations inadaptées
Par ailleurs, la régulation traditionnelle des monopoles naturels semble particulièrement inadaptée à l’économie numérique. Celle-ci se déploie le plus souvent en deux temps. Tout d’abord, le régulateur sépare la partie de l’activité en situation de monopole naturel – généralement l’infrastructure en amont de la chaîne de valeur (les réseaux électriques, par exemple) – de la partie en aval de service (la distribution d’électricité de détail, par exemple) qui peut, elle, être soumise à la concurrence. Ensuite, la partie monopolistique est régulée par des politiques fixant les prix ou les marges de l’opérateur. Mais, contrairement au cas d’industries opérant avec des technologies relativement stables (électricité, rail, etc.), le secteur des nouvelles technologies ne se prête pas à une séparation des parties « infrastructure » et « services », car la frontière entre les deux évolue en permanence et se trouve brouillée par des profits et coûts croisés. Devrait-on par exemple considérer que le service gratuit de messagerie Gmail fait partie de l’« infrastructure » Google, dans la mesure où il est financé par la publicité et les abonnements professionnels ? Pourrait-on séparer la plateforme Amazon de vente pour commerçants tiers (Marketplace) et le vendeur de détail Amazon, sans complètement détruire le modèle d’affaires de la firme ? Notons aussi qu’il est, par définition, impossible d’anticiper la probabilité de succès de telle ou telle innovation, ce qui place de facto le régulateur dans une bien mauvaise position pour définir une régulation par les prix ou les marges dans le secteur des nouvelles technologies.
En résumé, il existe indéniablement une tendance à la concentration dans l’économie numérique qui favorise l’émergence de géants technologiques. Mais dans la mesure où il existe aussi de puissantes forces de déconcentration du côté de l’offre et de la demande, nous pensons que les Big Tech ne doivent pas être caractérisées comme des monopoles naturels. Dès lors, il paraît essentiel d’avoir une politique antitrust attentive aux développements des marchés technologiques, surveillant et sanctionnant si besoin les abus de positions dominantes et les fusions-acquisitions nuisibles au bon fonctionnement de la dynamique concurrentielle.
De la nécessité d’une politique antitrust forte et d’un nouveau cadres réglementaire en faveur de la concurrence
À partir d’un certain nombre de faits avérés ou supposés, nous avons mis en évidence le recours répété, voire systématique, à diverses pratiques anticoncurrentielles de la part d’un petit nombre de géants technologiques. Dans une industrie qui n’a pas vocation à héberger des monopoles naturels, ceci est le constat d’une politique de concurrence défaillante. De toute évidence, les quelques actions antitrust menées ces dernières années aux États-Unis et en Europe à l’encontre des Big Tech n’ont pas atteint leurs objectifs.
Nous allons maintenant tenter de proposer des pistes pour y remédier. L’idée directrice de notre propos est la suivante : renforcer les moyens de contrôle en amont des décisions et intensifier en aval l’effet dissuasif des sanctions, tout en adaptant les analyses concurrentielles au fonctionnement de l’industrie du numérique. La transformation que nous préconisons concerne aussi bien les autorités législatives, en charge d’écrire la loi, que les autorités administratives, en charge de l’appliquer.
Adapter la législation antitrust aux réalités du monde numérique
Depuis le 9 mars 2017, la Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB, « loi contre les restrictions de concurrence »), dans sa section 18-3a, mentionne que « dans le cas de marché multiface ou de réseaux, l’étude d’une éventuelle position dominante doit prendre en compte les effets de réseaux directs et indirects ; l’utilisation parallèle des différents services et la transmission éventuelle des coûts pour l’usager de l’un à l’autre ; les économies d’échelle liées aux effets de réseau ; l’accès aux données pertinentes pour la concurrence ; et, enfin, la pression concurrentielle du segment sur l’innovation ».
« Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence », Journal officiel de l’Union, 9 décembre 1997.
a. Renforcer le contrôle
L’avènement de l’économie numérique doit nous amener à revoir en profondeur les modalités d’évaluation des positions dominantes et des fusions- acquisitions. En effet, nous avons vu qu’il est fréquent que les services proposés aux consommateurs soient gratuits ou s’échangent à des prix sans rapport avec les coûts réels engendrés car les modèles d’affaires des géants technologiques prennent en compte la perspective de gains indirects liés à l’utilisation de produits connexes ou bien de revenus engendrés par l’affichage publicitaire (selon l’adage désormais célèbre : « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit »). En conséquence, l’évaluation par l’autorité administrative d’une position dominante ou d’une concentration doit tenir compte de ces réalités. Cela signifie en pratique la possibilité de conduire des études ad hoc prenant en compte la structure multiface des marchés, les effets de réseaux, l’interdépendance des services proposés au consommateur ou encore la nature et la quantité des données récoltées. Un moteur de recherche opère typiquement sur un marché triface, comprenant des utilisateurs qui effectuent des recherches, des fournisseurs de contenu dont les produits apparaissent dans les résultats et des annonceurs qui paient pour que leurs publicités s’affichent également à l’écran. En outre, l’autorité administrative doit pouvoir intégrer dans ses analyses d’autres dimensions que les prix, pour tenir notamment compte de la qualité du service (ou produit) fourni. Ainsi, une entreprise qui exigerait davantage de données personnelles pour la fourniture d’un même service devrait être perçue comme diminuant la qualité de celui-ci.
À cet égard, l’Allemagne a fait en 2017 un choix qui nous semble tout à fait pertinent : modifier sa loi antitrust pour mentionner spécifiquement ces subtilités24. Aujourd’hui, les principes régissant la définition des marchés et segments de marché par la Commission européenne sont développés dans un texte qui n’a pas valeur de loi25. Afin d’écarter toute incertitude et donner à la Commission européenne des pouvoirs de contrôle adéquats, nous proposons, sur le modèle allemand, d’inscrire les principes d’évaluation des positions dominantes dans la loi en mentionnant expressément une liste de critères pertinents pour l’analyse des marchés numériques (effets de réseau, accès aux données, etc.).
Pour plus de détails, voir les annexes F et G, disponibles exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site.
Correspondant à 3 millions d’euros d’astreintes journalières pendant le temps de l’infraction (c’est-à-dire jusqu’à fin 2007).
b. Abus de position dominante
L’impact limité des sanctions administratives
En parallèle du renforcement des capacités de contrôle, il semble nécessaire de muscler le pouvoir de sanction des autorités en matière d’abus de position dominante. En effet, plusieurs exemples historiques mettent à mal la crédibilité de l’effet dissuasif des sanctions de la Commission européenne.
Citons tout d’abord les exemples relatifs à Microsoft, en commençant par le cas concernant l’interopérabilité de Windows26. Constatant une pratique anticoncurrentielle caractérisée notamment par la non-diffusion de la documentation technique nécessaire à l’interopérabilité des systèmes d’exploitation des ordinateurs Windows et des serveurs, la Commission européenne a condamné Microsoft à une amende de 497 millions d’euros en 2004. Elle a en outre imposé à la firme de Redmond de rendre publiques toutes les spécifications techniques nécessaires au rétablissement d’une juste concurrence sur le marché des serveurs et logiciels pour serveurs. En 2006, la Commission européenne a observé que son injonction de 2004 n’avait pas été respectée et a décidé d’infliger une seconde amende à Microsoft à hauteur de 281 millions d’euros. Mais l’entreprise tarde à se mettre en conformité et écope en 2008 d’une troisième amende à hauteur de 899 millions d’euros27. Finalement, si Microsoft a dû s’acquitter de plus de 1,5 milliard d’euros d’amende au total, les conditions d’une saine concurrence sur le segment de marché concerné n’ont été rétablies que sept années après l’ouverture de l’enquête administrative. On retrouve ce même schéma dans le cas de 2008 relatif à la vente liée de Windows et d’Internet Explorer. L’enquête avait rapidement abouti, et la Commission européenne s’était accordée avec Microsoft dès 2009 sur le fait de garantir aux utilisateurs de Windows la possibilité de choisir leur navigateur Internet. En 2012, toutefois, la Commission européenne a rouvert le dossier sur la base de suspicions de non-conformité et, en 2013, a infligé à Microsoft 561 millions d’euros d’amende pour non-respect des conditions imposées entre 2009 et 2012.
Dans ces deux cas de figure, on voit que l’effet dissuasif des amendes et des astreintes de la Commission européenne n’a pas permis un prompt rétablissement des bonnes conditions de concurrence– la situation anticoncurrentielle ayant perduré pendant plusieurs années alors même que la Commission européenne l’avait constatée. Ceci est particulièrement dommageable dans l’industrie des nouvelles technologies, qui se démarque par des cycles d’innovation extrêmement courts. En poussant l’observation à l’extrême, il semblerait que le caractère non dissuasif de ces amendes ou astreintes permette aux géants technologiques d’« acheter » le droit de poursuivre leurs pratiques anticoncurrentielles.
On peut également mesurer la crédibilité toute relative des sanctions de la Commission européenne à l’aune des variations du cours de Bourse de Google suivant les annonces des amendes record infligées ces deux dernières années (respectivement 2,42 et 4,34 milliards d’euros en 2017 et 2018). En théorie, celles-ci auraient dû impacter négativement l’action de l’entreprise, d’une part, via la réduction de la taille de son bilan en proportion des amendes infligées et, d’autre part, via l’ajustement à la baisse des anticipations de ses profits futurs. En pratique, entre le moment où la Commission européenne a annoncé le 6 juin dernier être sur le point d’infliger une amende record à Google et l’annonce effective de celle-ci le 18 juillet dernier, le cours de l’action Google a grimpé de 0,04%, et chuté de seulement de 0,46 et 0,06% les 6 juin et 18 juillet. Rapportées à la capitalisation boursière de l’entreprise, ces baisses cumulées ne représentent même pas une perte de valeur équivalente au montant de l’amende effectivement infligée (4,34 milliards d’euros). On peut certes imaginer que les marchés avaient déjà anticipé cette sanction avant l’annonce du 6 juin ou qu’ils considèrent que la décision de la Commission européenne sera annulée en procédure d’appel, mais tout porte à considérer que l’effet dissuasif de la sanction anticoncurrentielle est nettement moins opérant que prévu.
Redonner crédibilité à l’autorité administrative
En somme, la crédibilité de la puissance publique est en jeu. Doit-on alors augmenter le plafond des amendes ou bien introduire des amendes « planchers » ? À l’heure actuelle, la législation européenne permet à la Commission de prononcer des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée, ce qui semble lui laisser suffisamment de marge de manœuvre. Par ailleurs, il paraît important de laisser à l’autorité administrative la possibilité de juger, au cas par cas, de la gravité de l’infraction et du montant de l’amende qui en découle. C’est pourquoi nous préférons écarter l’idée d’amendes « planchers ». Nous proposons en revanche deux pistes de réflexion.
La première a trait au montant des astreintes. Ces dernières sont pour l’instant limitées à 5% du chiffre d’affaires mondial journalier de l’entreprise en infraction. Étant donné l’importance d’un rétablissement immédiat d’une concurrence juste favorisant l’innovation dans l’industrie des nouvelles technologies, nous pensons qu’aligner le plafond de cette astreinte quotidienne sur celui de l’amende (soit 10% du chiffre d’affaires mondial journalier) fait sens.
La seconde piste de réflexion que nous proposons, plus polémique, concerne une possible criminalisation des sanctions antitrust. Les dirigeants de sociétés pourraient alors être tenus pour pénalement responsables de violations du droit de la concurrence. Cette seconde piste se heurte bien entendu à de nombreuses barrières, à commencer par l’absence de droit pénal européen. On pourrait toutefois envisager une réflexion au niveau communautaire sur la question d’une harmonisation du volet pénal des droits antitrust nationaux, couplée à un mécanisme de renvoi automatique des dossiers d’enquêtes administratives auprès des juridictions nationales compétentes.
a. Concentrations
Si l’Europe semble progressivement prendre toute la mesure de l’importance d’un contrôle renforcé des abus de position dominante des Big Tech, elle paraît nettement moins avancée sur le plan de l’examen des concentrations dans le secteur des nouvelles technologies.
Pour plus d’informations, se référer aux annexes A et B, disponibles exclusivement sur la version numérique de la présente note et en accès libre sur notre site fondapol.org.
Revoir les seuils de notification de concentration
On constate ainsi que la majeure partie des acquisitions stratégiques réalisées par les Big Tech ne sont même pas étudiées par la Commission européenne28. La raison ? Ces concentrations ne font pas l’objet d’une notification à l’autorité européenne car elles ne satisfont pas aux critères de seuils de notification. Le graphique 8 montre par ailleurs que la part des concentrations notifiées à la Commission européenne a tendanciellement diminué depuis le début des années 2000.
Graphique 8 : Concentrations recensées vs concentrations notifiées à la Commission européenne (en nombre de transactions)
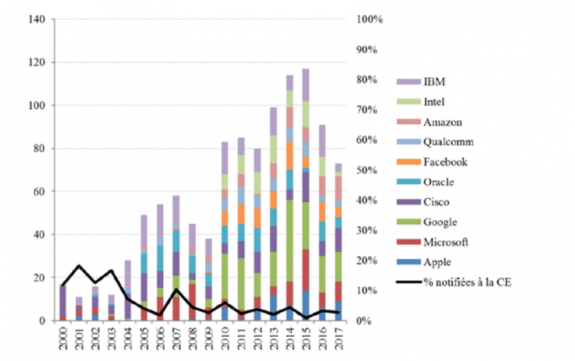
© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018
Notons que l’Allemagne a pris le parti d’introduire des seuils liés au montant de la transaction pour la même raison en 2014.
Nous présentons dans le tableau 1 un comparatif succinct des règles de notification des concentrations au niveau fédéral américain et communautaire européen. Une différence majeure s’en dégage : les critères européens reposent sur le chiffre d’affaires des entités, tandis que les seuils américains se basent sur la valeur des transactions. Dès lors, rien de surprenant à ce que l’acquisition d’Instagram par Facebook en avril 2012 n’ait pas été notifiée à la Commission européenne en dépit de son importance stratégique : le réseau social ne générait tout simplement pas encore de revenus à l’époque. Pour cette même raison, l’acquisition de Waze par Google est une autre concentration horizontale majeure (la start-up israélienne étant un concurrent direct et sérieux du navigateur proposé par Google Maps) qui n’a pas pu être examinée par la Commission européenne.
On comprend ainsi les limites de seuils basés exclusivement sur le chiffre d’affaires. Dans l’univers des nouvelles technologies, les perspectives de croissance d’entreprises prometteuses se caractérisent souvent bien plus par leur nombre d’utilisateurs ou par la quantité de données dont elles disposent que par les revenus de leurs ventes. La valeur d’une opération de fusion- acquisition intégrant toute l’information disponible et reflétant les analyses prospectives des investisseurs, on peut légitimement la considérer, de l’extérieur, comme la meilleure anticipation possible des perspectives de croissance de l’entité ciblée. Nous suggérons donc de réviser le droit européen afin de prendre en compte, sur le modèle américain, la valeur des transactions dans les seuils de notification29.
Tableau 1 : Comparatif des conditions de notification des concentrations (États-Unis vs Union européenne)

Copyright :
© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018
Rachat qui soulevait pourtant des questions importantes en matière de concurrence dans le domaine de l’écoute musicale en ligne. La Commission européenne l’autorisa inconditionnellement le 6 septembre 2018, après six mois d’enquête.
31. Ben Thompson, « Why Facebook Shouldn’t Be Allowed to Buy tbh », stratechery.com, 23 octobre 2017.
Donner un pouvoir d’autosaisine à la Commission européenne
Les cas ne requérant pas de notification auprès des autorités européennes peuvent être, selon les droits nationaux des États membres, notifiés à et revus par des autorités nationales. La Commission européenne ne peut se saisir d’une concentration ne satisfaisant pas aux seuils européens : le dossier doit lui être renvoyé par des autorités nationales ou bien être notifié par l’entreprise elle- même (alors que rien ne l’y oblige juridiquement). Notons ainsi, par exemple, que la Commission européenne n’aurait pas pu enquêter sur le rachat de Shazam par Apple si l’affaire ne lui avait pas été transmise par sept autorités nationales30.
Politiquement, il paraît très délicat de proposer que la Commission européenne puisse, comme c’est le cas pour l’antitrust, s’autosaisir de n’importe quel dossier de concentration, a fortiori si son intervention venait « dessaisir » automatiquement les autorités nationales concernées. De nombreux États verraient probablement d’un mauvais œil une telle immixtion de Bruxelles dans des affaires qu’ils pourraient considérer, à juste titre dans certains cas, comme relevant du périmètre national. A minima, nous pensons que la Commission européenne devrait pouvoir étudier toute concentration ne faisant pas l’objet d’un examen par une autorité nationale. Cela revient à donner à la Direction générale de la concurrence le pouvoir discrétionnaire d’enquêter sur n’importe quelle transaction qui n’atteindrait pas les seuils mentionnés précédemment, sous réserve qu’une autorité nationale compétente ne se soit préalablement pas emparée du cas. Grâce à ce pouvoir, la Commission européenne pourrait enquêter sur certaines opérations, en apparence modestes, voire insignifiantes, de par le chiffre d’affaires de la cible ou la valeur de la transaction mais qui peuvent en réalité s’avérer hautement stratégiques pour les acquéreurs si elles viennent renforcer ou contribuer à constituer des positions dominantes. Pour prendre un exemple récent, mentionnons le rachat par Facebook du réseau social américain To Be Honest (TBH) pour une somme avoisinant probablement 80 millions de dollars31. Après seulement trois mois d’existence, TBH comptabilisait plusieurs millions d’utilisateurs actifs mais ne réalisait encore aucun revenu. Constatant la croissance fulgurante du réseau, plusieurs observateurs y voyaient déjà un potentiel nouveau Snapchat. Moins d’un an après son rachat, Facebook a annoncé mettre fin au développement de TBH. On peut se demander a posteriori si cette acquisition n’a pas été réalisée dans le seul objectif de prévenir l’émergence d’un potentiel concurrent et si, de fait, le régulateur n’aurait pas dû la bloquer en amont.
Il existe toutefois une exemption de notification pour les prises de participations minoritaires à vocation d’investissement représentant moins de 10% des droits de vote.
Jon Russell, « Toshiba chip business set for $18B sale to Bain-led group backed by Apple », techcrunch.com, 28 septembre 2017.
Contrôler les prises de participations
Il faut d’autre part noter que le droit européen ne prévoit la notification d’une opération qu’en cas de concentration, autrement dit uniquement si celle-ci implique un changement de contrôle. Il s’agit là d’une autre différence majeure avec le droit antitrust américain, qui ne prend pas en compte le degré de contrôle acquis dans l’entreprise cible dans les seuils de notification32. Certaines prises de participation minoritaire peuvent pourtant soulever des questions de concurrence. En 2017, Apple a ainsi acheté au sein d’un consortium une partie des activités de cartes mémoires de Toshiba, qui s’avère être le deuxième fournisseur mondial des producteurs d’ordinateurs et de smartphones33. Les actionnaires minoritaires peuvent bien entendu influencer les orientations stratégiques des firmes et bénéficient par ailleurs d’un accès privilégié à l’information les concernant. En conséquence, nous proposons d’adapter la législation européenne afin de prendre en compte les prises de participations minoritaires, à l’instar du droit américain. Cela signifierait concrètement que l’impératif de notification s’étendrait aux transactions sans prise de contrôle. Afin de ne pas inonder l’autorité administrative d’informations présentant un intérêt limité, il semble pertinent de définir, comme aux États-Unis, un seuil d’acquisition de droits de vote en deçà duquel la notification ne serait pas obligatoire.
Renforcer la mise en application du droit de la concurrence
« In terms of whether Instagram may have the potential to compete with Facebook’s photo sharing app for advertising revenue, one third party told the OFT that it does not consider that Instagram provides significant marketing opportunities » (cité in John Constine, « Why The OFT And FTC Let Facebook Buy Instagram: FB Camera Is Tiny, IG Makes N° Money, And Google », techcrunch.com, 23 août 2012.
Notons que cette concentration n’exigeait pas une notification à la Commission européenne (car se situant en dessous des seuils limites). L’entreprise de Menlo Park a préféré la notifier d’elle-même pour ne pas avoir à subir un processus d’examen avec trois autorités nationales différentes.
Voir Jorge Valero, « Google contraint d’ouvrir son comparateur d’achat en ligne à la concurrence », euractiv. com, 28 septembre 2017.
Ibid.
Si l’adaptation de la législation antitrust aux défis du numérique est un préalable, elle ne saurait combler qu’une partie des lacunes du système anticoncurrentiel. Il convient, en effet, de s’intéresser également à la manière dont le droit est interprété et appliqué.
a. Combattre les asymétries entre régulateur et régulé
La bonne mise en application du droit anticoncurrentiel nécessite des analyses approfondies et complexes, impliquant souvent des études techniques poussées liées aux industries concernées. La rapidité du changement technologique propre à l’industrie des nouvelles technologies vient donc considérablement compliquer le travail des autorités de concurrence.
Compétences
La révolution numérique et son usage intensif de technologies informatiques nouvelles, de données de masses ou encore de protocoles d’échanges novateurs mettent en difficulté l’expertise des autorités antitrust, plus habituées à gérer des problématiques juridiques ou administratives que techniques. Trois exemples viennent illustrer cela.
Dans les conclusions de son enquête avalisant l’acquisition d’Instagram par Facebook en 2012, l’Office of Fair Trading (OFT), l’autorité britannique de concurrence, a pris soin de préciser qu’Instagram, en tant que simple application d’édition de photographies, présentait très peu de fonctionnalités et de propriétés propres aux réseaux sociaux, et s’avérait de fait peu susceptible de pouvoir un jour concurrencer Facebook34. Le niveau de mauvaise information et l’ampleur de l’incompréhension du fonctionnement des réseaux sociaux qui transparaissent dans ces propos laissent penser que l’autorité administrative a manqué des compétences nécessaires pour mener à bien son étude.
Autre exemple, au cours de l’examen de l’acquisition de WhatsApp en 201435, Facebook a assuré aux fonctionnaires de la Commission européenne qu’il était techniquement impossible d’appairer automatiquement les comptes des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp. Le décalage manifeste entre l’information communiquée à l’autorité et la réalité technique bien connue des ingénieurs de la firme n’est apparu que deux ans plus tard, lorsque Facebook a commencé à intégrer les deux plateformes et à lier les comptes des utilisateurs grâce à un algorithme reposant simplement sur les numéros de téléphone. La Commission européenne a réagi en 2017 en infligeant une amende de 110 millions d’euros à la firme de Menlo Park pour transmission d’informations erronées pendant l’enquête. Si cette amende paraît dérisoire au regard de l’enjeu, l’exemple révèle avant tout l’absence d’autonomie de l’autorité administrative sur le plan technique.
Enfin, dans la même veine, la Commission européenne a dû s’offrir les services de deux sociétés d’audit afin de surveiller, pendant les cinq prochaines années, la mise en application par Google de sa décision concernant Google Shopping36. La commissaire à la concurrence Margrethe Vestager l’a reconnu elle-même : « Il est très important de nous entourer des bonnes personnes pour nous aider à cette surveillance37. »
Autrement dit, les autorités antitrust font face à un problème de compétences dans les dossiers concernant les nouvelles technologies. Pour remédier à cela, nous proposons que la Commission européenne se dote d’une « Task Force Tech » composée d’ingénieurs spécialisés et de professionnels du secteur. Les services de la Commission européenne pourraient s’appuyer sur cette équipe pour étayer leurs enquêtes. Par ailleurs, cette même équipe pourrait pallier une autre faiblesse des autorités antitrust ayant trait à l’insuffisante proactivité du contrôle. Du fait de la complexité et de l’instantanéité des transactions à l’ère du numérique, les abus de position dominante peuvent être subtils, momentanés, et donc très difficiles à repérer. Comme l’illustrent les exemples des techniques de prédation supposément utilisées par Amazon pour faciliter le rachat de concurrents (Zappos, Quidsi) ou des méthodes discriminantes qu’auraient pu employer Google dans l’affichage de ses résultats (Yelp), l’identification des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des nouvelles technologies, notamment de l’Internet, nécessite des capacités de surveillance en temps réel et une grande réactivité. Dans bien des cas, la capacité de détection des abus semble donc devoir reposer sur des techniques de web scraping ou des algorithmes de suivi et l’analyse qui s’ensuit sur de puissants outils de traitement et de visualisation des données. Une Task Force Tech pourrait aider la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne sur ces questions.
Pour plus d’informations, voir l’annexe E, disponible exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site.
Moyens
Au-delà de la question de la compétence technique de l’autorité administrative se pose celle de ses moyens. Une analyse rapide des dernières enquêtes de la Commission européenne ayant abouti à une sanction administrative38 montre une durée moyenne de plusieurs années entre l’ouverture de l’enquête et la décision administrative. Une part de ce temps est incompressible car il correspond à des contraintes légales. Avant de rendre juridiquement contraignant un accord trouvé avec une entreprise suspectée de pratiques anticoncurrentielles, la Commission européenne doit par exemple publier le projet d’accord et donner au moins un mois aux tierces parties intéressées pour faire part d’éventuelles observations. Cependant, ces durées légales n’expliquent qu’une faible part du temps de latence entre l’ouverture d’une enquête et sa conclusion. L’essentiel est dû au temps de l’enquête elle-même. Le secteur des nouvelles technologies se distinguant par des cycles d’innovation très courts, une situation anticoncurrentielle est d’autant plus dommageable qu’elle bloque potentiellement l’émergence de nombreuses innovations. De fait, la longueur des délais d’enquête est particulièrement problématique. C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il conviendrait de renforcer les équipes travaillant sur ces dossiers. Compte tenu des coûts pour l’économie des abus de position dominante, il s’agit sans nul doute d’un investissement rentable pour le contribuable.
Ajoutons à cela que les sanctions administratives prononcées à l’encontre des Big Tech font quasi systématiquement l’objet d’une procédure d’appel. Ces recours devant le Tribunal de l’Union européenne voire devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) prennent plusieurs années et continuent d’occuper les équipes de la Direction générale de la concurrence. Ainsi, par exemple, le cas d’Intel, condamnée par la Commission européenne à une amende de 1,06 milliard d’euros en 2009, n’est toujours pas clos. Le tribunal a d’abord confirmé la sanction de la Commission européenne en 2014, avant que la CJUE décide d’annuler le jugement et de renvoyer le dossier devant le même tribunal. Nous y voyons là une raison supplémentaire d’augmenter les ressources de l’autorité administrative afin d’accélérer ses processus de décision.
Signalons toutefois qu’une remise en cause de ce paradigme semble progressivement se dessiner, notamment grâce aux travaux et initiatives de think tank ou centres de recherche libéraux (Stigler Center, Open Markets Institute, The New Center) et d’intellectuels comme Luigi Zingales ou Guy Rolnik.
Voir Robert Bork, The Antitrust Paradox, The Free Press, 2e éd., 1993.
Montant exact non dévoilé mais estimé au-delà de 500 millions de dollars. Voir Catherine Shu, « Google Acquires Artificial Intelligence Startup DeepMind for More Than $500M », techcrunch.com, 27 janvier 2014.
Voir Sam Shead, « Google Trusts DeepMind AI To Manage Data Centre Cooling », forbes.com, 18 août 2018.
Pour un récapitulatif des décisions de la Commission européenne sur les concentrations, voir l’annexe F, disponible exclusivement sur la version numérique de la présente étude et en accès libre sur notre site fondapol. org. Cette sélection contient toutes les autorisations conditionnelles prononcées par la Commission européenne sur les transactions impliquant les géants technologiques. Il convient de noter que la situation aux États-Unis est similaire : des concentrations importantes ne font pas même l’objet d’une enquête formelle de la FTC ou du DoJ (exemple : l’acquisition de YouTube par Google en 2006).
En l’occurrence, la plupart des pratiques anticoncurrentielles précédaient le rachat par Google. Il n’empêche que l’ajout d’une conditionnalité à l’approbation de la fusion aurait semblé légitime.
b. Placer l’innovation au cœur de la politique antitrust
Parallèlement à l’augmentation des moyens de contrôle et de sanction des autorités, un travail conceptuel d’adaptation des analyses antitrust aux réalités du monde numérique doit également être mené. Nous touchons là au contenu des enquêtes à proprement parler.
La question du pouvoir de contrôle et de sanction est, en effet, loin d’épuiser le sujet : une autorité dotée d’armes légales mais ne les utilisant pas à bon escient ne serait pas opérante. Nous pensons que l’action antitrust contemporaine est guidée par une interprétation trop prudente de la régulation, ne prenant pas suffisamment en compte l’importance de l’innovation ou du « potentiel d’innovation ». Aux États-Unis notamment, l’influence de la réinterprétation des lois antitrust par les juristes et économistes de l’école de Chicago (Robert Bork, Richard Posner, Georges Stigler ou Harold Demsetz, entre autres) est encore très prégnante39. Robert Bork, par exemple, entend démontrer que l’esprit originel des lois ainsi que l’analyse économique nous invitent à nous intéresser uniquement à la maximisation du bien-être du consommateur, sans prise en compte de celui des concurrents40. Dès lors, certaines pratiques prétendument exclusives, tels les accords verticaux ou la discrimination par les prix, ne doivent pas être interdites s’il n’est pas avéré qu’elles pénalisent directement le consommateur.
De fait, les études d’impact des concentrations ou des positions dominantes ont toujours excessivement tendance à se focaliser sur le consommateur, ce qui a tendance à étouffer dans l’œuf toute perspective d’intervention dans un marché numérique où les services aux utilisateurs sont souvent gratuits. A minima, nous pensons que le bien-être du consommateur doit être envisagé de façon prospective, c’est-à-dire en dynamique et sur le long terme. Les analyses purement statiques peuvent être aveuglantes, a fortiori dans une industrie aussi dynamique que les nouvelles technologies. L’offre d’achat de toute entreprise intègre une vue sur le futur que le régulateur doit apprendre à faire sienne. L’acquisition éminemment stratégique de DeepMind par Google en 2014 en est un bon exemple : l’entreprise de soixante-quinze employés, ultra-innovante et à la pointe de la recherche en intelligence artificielle, ne présentait certainement pas une situation financière justifiant un rachat pour plus de 500 millions de dollars41. L’offre de Google tablait sur une forte croissance de la jeune pousse et d’importants profits à venir, qui se sont d’ailleurs déjà matérialisés grâce à l’utilisation par le géant de Mountain View des techniques de la startup britannique pour optimiser le refroidissement de ses data centers42.
Par ailleurs, cette logique d’interprétation prospective des lois antitrust invite l’autorité administrative à considérer les marchés adjacents plutôt comme des verticaux que des marchés parallèles. D’une part, cela éviterait qu’une position dominante puisse se propager aisément d’un marché à l’autre (à l’instar de Google depuis le marché du moteur de recherche vers celui des avis critiques en ligne de magasins et restaurants). D’autre part, cela permettrait à des concurrents éventuels des Big Tech de se développer sur des marchés adjacents, étape indispensable avant de pouvoir se confronter aux géants technologiques sur leurs segments principaux. Si, par exemple, Google peut aujourd’hui concurrencer le duopole Apple-Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour ordinateur via Chrome OS, c’est grâce à sa position privilégiée sur le marché adjacent des navigateurs Internet (avec son logiciel Chrome).
Enfin, l’analyse prospective encourage le régulateur à s’intéresser au potentiel d’innovation, notamment dans le cadre des enquêtes sur les concentrations. Si une transaction est susceptible de freiner substantiellement l’innovation à moyen ou long terme, il pourrait être légitime de la bloquer, quand bien même elle ne causerait pas de tort au consommateur à court terme. Concrètement, cela s’apparenterait par exemple à interdire une opération de fusion-acquisition entre deux firmes de taille inégale – typiquement un géant technologique et une jeune entreprise prometteuse – qui « pourraient » devenir directement concurrentes dans un avenir proche. Pensons à l’achat d’Instagram par Facebook en 2012. À l’époque, les autorités antitrust n’ont pas envisagé qu’Instagram puisse devenir un réseau social majeur et n’ont donc pas considéré la transaction comme potentiellement néfaste à la concurrence sur le marché des réseaux sociaux. Six ans plus tard, l’erreur d’appréciation apparaît manifeste.
Bien entendu, le régulateur est a priori particulièrement mal placé pour anticiper l’avenir sur le marché des nouvelles technologies. Cela rend donc éminemment difficile et périlleuse l’évaluation du potentiel d’innovation de telle ou telle entreprise. Sans même se risquer à bloquer des transactions, la Commission européenne gagnerait à s’appuyer sur son pouvoir d’autorisation conditionnelle. Les clauses de conditionnalité peuvent, en effet, constituer un puissant garde-fou en cas de suspicion d’une diminution potentielle de l’intensité concurrentielle à terme. Vu le très faible nombre d’acquisitions des Big Tech ayant été sujettes à de telles clauses ces dernières années43, la Commission européenne semble faire un usage trop limité de ce pouvoir. Illustrons notre propos avec l’exemple du rachat de Motorola Mobility par Google en février 2012. Deux mois après avoir autorisé la fusion, la Commission européenne a ouvert deux enquêtes formelles pour violation du droit antitrust par Motorola Mobility. L’entreprise se serait servie de ses brevets pour limiter la concurrence sur le marché des smartphones. Deux ans plus tard, la Commission européenne conclut son enquête et annonce que Motorola Mobility (dorénavant Google) a bien enfreint le droit de la concurrence européen. On peut se demander pourquoi la Commission européenne n’a pas ajouté dès février 2012, au moment de l’autorisation de la fusion, une clause de conditionnalité sur l’usage des brevets acquis par Google afin de prévenir d’éventuels abus ou de pouvoir prononcer une sanction rapide et sévère en cas d’infraction44.
Pour plus d’informations, voir les annexes E et G, disponibles exclusivement sur la version numérique de la présente note et en accès libre sur notre site.
c. Renforcer la collaboration avec les États-Unis
Malgré toutes les perspectives d’amélioration que nous avons soulevées jusqu’à présent, l’Europe semble aujourd’hui en avance sur les États-Unis dans le processus d’adaptation de l’antitrust aux réalités du monde numérique, notamment via le contrôle et la sanction qu’elle exerce sur les abus de position dominante depuis la prise de fonction de Margrethe Vestager. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer les principales condamnations des Big Tech pour pratiques anticoncurrentielles de part et d’autre de l’Atlantique45. Les sanctions record contre Google en Europe sont sans équivalent aux États-Unis. Mais l’Europe seule ne peut pas tout. Même si le Vieux Continent concentre de nombreux utilisateurs, les acquisitions des Big Tech concernent en majorité des entreprises non européennes. Notons qu’autorités antitrust européennes et américaines ont parfois collaboré par le passé. Le DoJ et la Commission européenne ont par exemple conjointement traité le cas de la fusion de Cisco et Tandberg, à fort enjeu concurrentiel. Mais cette collaboration est aujourd’hui mise à mal par une forme de défiance réciproque. Tandis que les Européens sont tentés de soupçonner le laxisme conscient des autorités américaines dans le cadre de la course à la domination technologique qui se joue entre leurs champions et les entreprises chinoises, certains observateurs américains voient volontiers dans les actions de la Commission européenne une tentative de sanctionner délibérément les géants américains dans un secteur où les firmes européennes ont pris un retard considérable. Alors que les autorités antitrust des deux zones économiques poursuivent un même objectif de maximisation du bien-être de la société, cette situation d’incompréhension paralyse partiellement l’action publique, au seul avantage des entreprises commettant des actes répréhensibles. Afin de remédier à cela, nous pensons que l’Europe devrait jouer un rôle moteur dans ce nécessaire rapprochement via le Réseau international de la concurrence (RIC).
Au-delà du contrôle antitrust, de nouvelles régulations à concevoir ?
Voir Nicolas Certes, « Margrethe Vestager menace de démanteler Google », lemondeinformatique.fr, 10 avril 2018.
Selon une expression de Jason Furman, président de l’US Council of Economic Advisers, dans une note de 2016 qui a fait date (« Beyond Antitrust: The Role of Competition Policy in Promoting Inclusive Growth », Searle Center Conference on Antitrust Economics and Competition Policy, 16 septembre 2016.
Voir « Amazon Grabs 55 Percent of Consumers’ First Product Search, Set to Dominate 2016 Holiday Shopping », prnewswire.com, 27 septembre 2016.
Lire, à ce sujet, Luigi Zingales et Guy Rolnik, « A Way to Own Your Social-Media Data ».
Voir Jen Cordwainer, « How to Transfer Twitter Followers to Instagram », itstillworks.com, s.d.
Nous avons souligné les lacunes du droit de la concurrence appliqué aux nouvelles technologies et proposé des mesures pour y remédier tant du point de vue de la loi que de son application. Nous sommes néanmoins convaincus que le problème de la domination des Big Tech exige une réponse politique globale, dont l’antitrust n’est qu’une facette. Des mesures complémentaires d’interopérabilité et d’ouverture des droits de propriété paraissent en effet indispensables pour recréer les conditions du développement d’une bonne dynamique concurrentielle sur le marché des nouvelles technologies.
a. De bonnes raisons pour dépasser l’antitrust
L’efficacité de l’antitrust en question
Nous avons jusqu’à présent négligé les risques d’une politique antitrust excessivement volontariste, notamment l’incertitude juridique ou de la limitation de la liberté d’entreprendre. En matière de fusions-acquisitions, une application trop zélée du droit peut potentiellement dissuader certaines entreprises de réaliser des fusions-acquisitions qui auraient eu un impact socio- économique positif.
En ce qui concerne les abus de position dominante, l’efficacité des sanctions est controversée. Pour certains, elles permettent la libération des forces de création et d’innovation, tandis que, pour d’autres, l’autorité arrive toujours trop tard, engage des procédures longues, incertaines et coûteuses, avec une asymétrie d’information considérable et le risque de ralentir l’innovation. À cet égard, l’histoire fournit des exemples intéressants. Pensons à l’emblématique procès que le DoJ intenta contre IBM en 1969 pour violation du Sherman Act dans le cadre d’un monopole présumé sur le marché des ordinateurs à circuits intégrés. Un millier de témoins furent entendus, des millions de pages de documents transmises et étudiées, et le gouvernement finit, treize ans plus tard, par abandonner le cas. Un tel gâchis de ressources ne peut pas laisser indifférent. Quelque trente ans plus tard, en 1998, Microsoft fit l’objet d’un procès tout aussi retentissant pour la vente liée du système d’exploitation Windows et du navigateur Internet Explorer, à l’issue duquel le DoJ obtint un accord minimaliste. Reprenant volontiers ces exemples, les critiques des sanctions antitrust dépeignent une machine juridico-administrative mal adaptée pour faire face au rythme du changement dans les nouvelles technologies. À l’inverse, leurs opposants répondent que les poursuites, quoique totalement ou partiellement infructueuses, ont néanmoins contraint IBM et Microsoft à se concentrer sur leurs marchés respectifs (ordinateurs à circuits intégrés et logiciels), permettant l’émergence de nouveaux champions comme Microsoft (dans le cas d’IBM) et Google (dans le cas de Microsoft) sur les segments prometteurs de l’informatique.
Des géants d’ores et déjà too big to be challenged ?
Quoi qu’il en soit, une politique antitrust se limitant à du contrôle – même strict et avec un pouvoir de sanction renforcé – peut-elle être efficace contre des géants technologiques qui ont atteint de tels niveaux de domination sur leurs marchés ? Autrement dit, les Big Tech ne sont-elles pas déjà parvenues à un stade de développement qui les met purement et simplement hors d’atteinte des initiatives des autorités antitrust ? Si tel est le constat, il faut s’interroger sur les régulations qu’il faut concevoir.
Nous avons certes montré que l’économie de plateforme n’est pas celle du monopole naturel, mais on peut se demander si la longue période de passivité des autorités antitrust que nous venons de traverser n’a pas laissé se constituer des monopoles indétrônables. Prenons l’exemple de Google. Son pouvoir de marché sur les moteurs de recherche est aujourd’hui si fort que l’émergence d’un concurrent sérieux semble relever plus du fantasme que du possible. Dès lors, une scission de certaines sociétés en plusieurs entités ne serait-elle pas la solution ?
En pratique, le droit européen comme le droit américain donnent ce pouvoir aux autorités administratives. Par le passé, la solution du démantèlement a déjà été utilisée en dernier recours pour rétablir la concurrence sur des marchés particulièrement défaillants. Le cas d’école est celui de la société Standard Oil, au début du XXe siècle, qui jouissait d’une position ultradominante sur l’exploitation pétrolière grâce au contrôle de 90% de la production des raffineries américaines. En 1911, le gouvernement fédéral prit la décision de briser ce monopole des Rockefeller en créant trente sociétés de plus petite taille. Un autre exemple éclairant est celui de AT&T. Dans les années 1970, l’entreprise exerçait un quasi-monopole sur deux marchés, celui des services téléphoniques et celui des équipements téléphoniques (via Western Electric). En 1974, le gouvernement fédéral assigna le conglomérat en justice, demandant la cession de Western Electric pour limiter l’intégration verticale des deux monopoles. En 1982, la firme trouva un accord avec le DoJ stipulant la cession de ses sociétés d’exploitation téléphonique locales et donc, de facto, la fin de son monopole sur les services téléphoniques.
On peut concevoir le démantèlement d’une Big Tech selon une ligne verticale ou selon une ligne horizontale. Dans le premier cas, il s’agit de mettre fin à certaines intégrations verticales, ce qui reviendrait par exemple à séparer une partie type « infrastructure » d’une autre, type « services ». Comme évoqué plus haut à propos des monopoles naturels, nous doutons de la possibilité de « détricoter » ainsi des modèles d’affaires qui s’entrecroisent. Interdire à Google d’intégrer verticalement son moteur de recherche avec d’autres services l’empêcherait potentiellement d’améliorer son moteur de recherche, au détriment de tous les utilisateurs. À notre connaissance, aucune analyse étayée n’est parvenue à démontrer l’existence de bénéfices suffisants pour justifier le recours à un démantèlement vertical. Notons toutefois que la commissaire Margrethe Vestager a déjà exprimé la possibilité de démanteler, si nécessaire, l’activité européenne de Google46.
Dans le second cas, la scission concerne une séparation horizontale des activités, sur les modèles de Standard Oil ou AT&T. Intéressons-nous, par exemple, au groupe Facebook, qui possède une position hégémonique sur le marché des réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et des messageries instantanées (Messenger, WhatsApp). Si les réseaux Facebook et Instagram n’appartenaient pas au même groupe, on peut aisément imaginer la concurrence féroce qu’ils se livreraient aujourd’hui et l’amélioration de la qualité de leurs services respectifs qui en résulterait. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui font le rapprochement entre la faible pression concurrentielle à laquelle la firme est soumise et la pertinence décroissante du contenu affiché sur Facebook ou la relative indifférence du réseau social au scandale Cambridge Analytica. Même si nous déplorons cette situation, nous pensons là encore qu’une étude approfondie des conséquences d’un éventuel démantèlement s’impose, étant donné l’impact économique et la portée symbolique d’une telle décision dans une économie de marché où prévaut la liberté d’entreprendre.
Force est de constater que la politique de contrôle et de sanction a des limites et qu’il est donc nécessaire d’aller « au-delà de l’antitrust47 ». Pour compléter son approche généralement réactive, il nous paraît important de réfléchir à des mesures proactives, susceptibles d’encourager l’innovation et le développement économique.
Un nouveau paradigme sur la propriété et la portabilité des données
L’une des principales barrières à l’entrée dans le secteur des nouvelles technologies, en particulier dans l’économie de plateforme, est celle de l’obtention des données. Comment faire concurrence aux algorithmes de Facebook qui se renforcent en permanence grâce aux milliards d’actions effectuées quotidiennement sur la plateforme ? Comment mieux prévoir qu’Amazon le comportement de l’acheteur moyen en ligne, alors que plus de la moitié des recherches concernant des biens de consommation courante débutent sur son site 48 ? Avec le développement des capacités de calcul de masse et des algorithmes d’apprentissage statistique ou d’intelligence artificielle, il est évident que l’avantage comparatif des firmes possédant le plus de données va devenir de plus en plus critique. Dès lors, nous considérons qu’une législation propre à limiter l’accumulation durable de données dans les mains d’un faible nombre d’acteurs est un prérequis au maintien de la concurrence dans l’économie numérique.
Une première piste consiste à donner davantage de contrôle aux utilisateurs et aux fournisseurs de contenu sur les données numériques récoltées par les plateformes. À la lumière du Règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté en 2016, c’est le choix qui a été fait en Europe. Le règlement renforce, d’une part, considérablement le pouvoir de l’utilisateur dans l’usage de ses données et, d’autre part, rend plus dissuasives les sanctions auxquelles s’exposent les contrevenants. Il introduit également le concept clé de « portabilité des données », qui regroupe trois droits : celui de recevoir ses données personnelles partagées avec une firme, celui de transmettre ces dernières à une autre firme et celui de demander directement leur transmission entre firmes. Ce transfert partiel de la propriété des données vers le citoyen européen est susceptible de stimuler la concurrence dans le secteur numérique. À cet égard, une comparaison avec le secteur des télécommunications est éclairante. Dans la plupart des pays développés, les autorités ont donné au client d’un opérateur téléphonique la propriété de son numéro de portable. En diminuant le coût de transfert d’un opérateur à un autre, cela a grandement accentué le pouvoir de négociation du consommateur et de fait accru la concurrence entre opérateurs de téléphonie mobile. L’esprit du RGPD est le même : redonner au client d’un responsable de traitement de données le droit de changer de fournisseur, le tout avec un minimum de frictions.
On pourrait aller encore plus loin et imaginer un transfert complet de propriété vers le citoyen et l’émergence d’un marché des données sur lequel celles-ci s’échangeraient. Les utilisateurs auraient de fait la possibilité de vendre leurs données à des entreprises, qui pourraient ensuite également les revendre entre elles. Cette idée suscite néanmoins de nombreuses interrogations. S’il semble pertinent de donner à chaque citoyen un droit d’accès aux informations le concernant, l’entreprise qui a fait l’effort de récupérer ces données, de les traiter et de les stocker doit aussi pouvoir en tirer profit. Or un transfert complet de propriété au profit des utilisateurs rendrait vraisemblablement caduque le modèle d’affaires de nombreuses entreprises. Le sujet est donc délicat et il convient de trouver une limite acceptable entre la définition du droit fondamental des citoyens et la juste rémunération des acteurs du numérique. Sans vouloir aller aussi loin, on pourrait imaginer octroyer à chaque utilisateur la propriété de certaines de ses données, notamment celle de son graphe social sur les réseaux sociaux (c’est-à-dire l’ensemble de ses contacts et de ses liens)49. L’utilisateur pourrait alors passer d’un réseau social à un autre sans avoir à reconstruire tout son cercle de connaissances ou de relations. Remarquons que la plateforme Instagram a historiquement grandi comme cela. Initialement, le réseau social permettait d’importer le graphe de son compte Twitter50. Plus tard, Facebook a pu accélérer considérablement sa croissance en important simplement les données du graphe Facebook des utilisateurs. Un tel transfert de propriété paraît d’autant plus pertinent dans le cas des réseaux sociaux que les effets de réseau sont puissants et les coûts de transfert entre plateformes par conséquent élevés.
Le RGPD constitue donc une avancée significative. En examinant de plus près l’encadrement de la portabilité des données, on constate toutefois que le règlement impose leur transmission dans un « format structuré, couramment utilisé et lisible par machine », sous réserve que cela soit « techniquement possible ». On comprend alors toute la limite du dispositif : l’absence fréquente de standards d’interopérabilité dans l’industrie des nouvelles technologiques complique de fait l’application de cette exigence, au risque de la rendre purement et simplement inopérante.
Cela peut sembler ironique dans la mesure où le système Android est distribué en open source. Toutefois, le magasin d’applications de Google (Play Store) ne l’est pas. Le géant américain utilise sa position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour mobiles afin d’obtenir des conditions favorables de préinstallation de ses applications.
52. Saluons le fait que les géants technologiques semblent s’engager dans cette voie, avec la création récente du « Data Transfer Project » initié par Facebook, Google, Twitter et Microsoft qui vise le développement d’une plateforme « open source » de portabilité des données. Il est toutefois important de s’assurer qu’un tel projet prenneencomptelesintérêtsd’acteursémergents.Source:« Facebook,Googleandmoreunitetoletyoutransfer data between apps », 20 juillet 2018, TechCrunch
b. Renforcer l’interopérabilité des plateformes
L’amende de 4,34 milliards d’euros infligée à Google par la Commission européenne en 2018, sanctionnant l’installation quasiment obligatoire des Google Apps sur les smartphones fonctionnant avec le système d’exploitation Android, signale le début d’une remise en cause de la logique d’enfermement des Big Tech dans des écosystèmes propriétaires ou fermés51. Cette problématique n’est pourtant pas nouvelle. Le cas Microsoft du début des années 2000 concernait déjà l’interopérabilité entre Windows et les systèmes d’exploitation de serveurs d’entreprises tierces. Ces deux exemples montrent les deux facettes du sujet de l’interopérabilité : la première, purement technique (un système est-il ouvert ? Est-il techniquement possible et facile d’y connecter des services tiers ?) ; la seconde, juridique et commerciale (quels sont les accords de licence, les limitations ou les coûts d’une telle connexion ?). Alors que le second point concerne typiquement la politique de concurrence, le premier nécessite un travail en amont. L’autorité administrative peut toujours imposer a posteriori la publication des spécifications techniques d’une interface, mais elle arrive la plupart du temps trop tard dans la mesure où le mal est déjà fait. Nous pensons qu’une régulation proactive est plus adaptée. Le sujet est cependant délicat, car il ne s’agit pas de limiter l’innovation technologique en la maintenant dans des carcans fixés par un régulateur par essence en permanence en retard sur l’innovation.
Nous croyons qu’un système hybride s’impose. Dans un tel système, le législateur aurait la charge de définir le cadre théorique de l’interopérabilité dont le principe général serait garanti par la loi. Le régulateur pourrait typiquement exiger que tout utilisateur puisse transférer son graphe social d’un réseau social à un autre52, ses playlists d’un service d’écoute de musique en ligne à un autre, ou encore son historique d’achats d’une plateforme de vente en ligne à une autre. Il se garderait néanmoins de définir les détails techniques de la mise en application de ces connexions de potabilité. À la place, les industriels se réuniraient régulièrement pour décider entre eux des standards leur permettant de se mettre en règle. Pour rebondir sur les exemples précédents, des commissions ou groupes de travail réunissant les entreprises opérant dans chaque branche (réseaux sociaux, services d’écoute de musique en ligne, sites de commerce en ligne…) seraient mis en place. Imaginez que Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Play Music ou encore Deezer soient obligées de s’accorder pour maintenir les dispositifs techniques nécessaires au transfert immédiat des playlists de leurs utilisateurs. La concurrence et l’innovation dans ce secteur n’en seraient que renforcées. Les firmes bénéficieraient a priori d’un poids dans la discussion et la prise de décision indépendant de leur taille, avec un seuil minimal à fixer pour éviter des effets pervers. Toute entreprise d’une certaine taille devrait se conformer aux standards d’interface, et des entreprises plus petites auraient la liberté de faire ou non partie du dispositif. La loi donnerait enfin à l’autorité administrative le pouvoir de décider des modalités du dispositif, notamment des branches qui auraient à s’y soumettre.
Prenons un exemple en dehors du secteur des nouvelles technologies. Le schéma que nous proposons est à certains égards similaire au service d’aide à la mobilité bancaire instauré par la loi Macron de 2015. Depuis son entrée en vigueur, les banques sont dans l’obligation de proposer le service suivant : annoncer le changement de banque d’un client à tous les organismes effectuant des prélèvements ou des virements automatiques sur son compte. En facilitant le passage du client d’une banque à une autre, cette mesure devrait encourager la concurrence et l’innovation dans le secteur de la banque de détail. Plus généralement, le monde bancaire offre une autre comparaison intéressante. Le système Sepa, qui permet notamment les virements interbancaires en Europe, est né du Conseil européen des paiements (European Payments Council, ECP), entité qui réunit les acteurs du marché européen du paiement au sein de différents groupes de travail (virements, débits directs, cartes et monnaie fiduciaire). La société coopérative Swift, fondée en 1973 pour moderniser les flux papiers dans les échanges bancaires, est quant à elle entre les mains de deux mille institutions financières qui se sont accordées sur des standards pour faciliter leurs échanges. Swift et Sepa illustrent un phénomène de standardisation des échanges qui s’est réalisé naturellement dans le monde bancaire car celui-ci était fragmenté à l’échelle supranationale. La plupart des banques évoluaient dans leur marché domestique et avaient donc intérêt à trouver des protocoles d’interface pour mieux échanger avec leurs concurrents ou voisins. Cette fragmentation n’existe pas dans les nouvelles technologies, car l’industrie est dominée par des géants en position hégémonique qui n’ont que très peu intérêt à ouvrir leurs systèmes, ou alors de manière biaisée (à l’instar d’Android pour Google). C’est pourquoi nous proposons de forcer par la loi les acteurs de cette industrie à créer des initiatives semblables de standardisation, en veillant à ce que les concurrents des Big Tech aient une place à la table des négociations. Ajoutons que le régulateur reste omniprésent dans la définition des interfaces de l’industrie bancaire, comme en témoigne l’arrivée des virements instantanés en Europe en 2018 grâce au système Target Instant Payment Settlement (TIPS) mis en place par la Banque centrale européenne. Même si nous reconnaissons pleinement l’intérêt des initiatives de standardisation provenant de l’autorité administrative, nous pensons que celles-ci courent le risque de circonscrire l’innovation dans le secteur des nouvelles technologies. C’est pourquoi nous souhaitons, à la différence du secteur bancaire, décentraliser au maximum le processus de définition des interfaces et protocoles au niveau des industriels. Bien entendu, la mise en place du dispositif que nous suggérons aurait un coût pour l’économie car les entreprises technologiques devraient y consacrer des ressources. Les commissions ou groupes de travail mis en place devraient également financer des experts neutres en charge de l’analyse et de l’arbitrage d’éventuels contentieux. Nous pensons néanmoins que ce système pourrait apporter une réponse satisfaisante à l’absence criante de standardisation dans les nouvelles technologies, absence dommageable pour le consommateur à court terme, car rendant difficile le changement de plateforme, et à long terme, car mettant à mal la concurrence et l’innovation.
c. L’ouverture des brevets
Enfin, nous souhaitons remonter encore d’un niveau la chaîne de valeur et considérer les politiques de rémunération de l’innovation, à savoir le système des brevets et des licences. Nous avons souligné depuis le début de notre propos l’importance considérable de l’innovation dans le maintien d’une concurrence saine dans le secteur des nouvelles technologies. Cela invite naturellement à s’intéresser au cadre qui la régit. En particulier, plusieurs considérations nous poussent à repenser la propriété industrielle, afin de l’adapter aux réalités du secteur des nouvelles technologies.
Avant tout, un constat s’impose : la guerre des brevets fait aujourd’hui rage entre les Big Tech et, plus largement, au sein de l’industrie des nouvelles technologies. Apple, Microsoft, Intel, Google, IBM et Qualcomm se sont chacune vu octroyer des droits sur plus de deux mille brevets en 2017. Comme l’illustre le graphique 9, la tendance est manifestement à l’augmentation du nombre de brevets déposés annuellement.
Graphique 9 : Brevets déposés par les maisons mères aux États-Unis (en nombre par année)
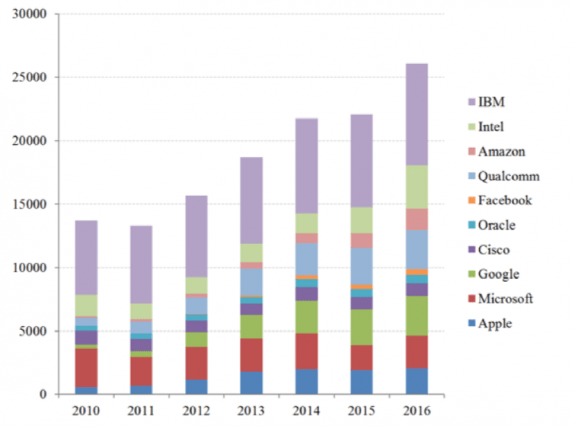
© Fondation pour l’innovation politique, novembre 2018
Source : U.S. Patent and Trademark Office.
Voir Charles Duhigg et Steve Lohr, « The Patent, Used as a Sword », www.nytimes.com, 7 octobre 2012.
Cour suprême des États-Unis, « Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC, et al. », 24 avril 2018.
L’inflation des brevets utilisés pour se protéger contre les attaques ou pour servir d’arme juridique est manifeste. Des armées d’avocats accompagnent maintenant les ingénieurs au sein des départements de recherche pour tenter de breveter toute idée potentiellement innovante, dans une dynamique aussi bien défensive qu’offensive. À ce titre, citons une statistique : entre 2010 et 2012, quelque 20 milliards de dollars ont été dépensés aux États-Unis dans des batailles judiciaires liées à des brevets sur le seul marché du smartphone53. Un arrêt très attendu de la Cour suprême américaine est venu récemment confirmer la légalité des procédures accélérées de remise en cause de la validité de brevets54. Dans l’ensemble, les Big Tech l’ont accueilli avec soulagement car elles se trouvent fréquemment confrontées à de petites entreprises spécialisées dans le dépôt de brevets douteux uniquement destinés à enclencher des poursuites juridiques (les fameux patent trolls). Les géants technologiques ne sont toutefois pas en reste et plusieurs sanctions récentes ou enquêtes en cours impliquant des brevets dans des cas d’abus de position dominante sont là pour en témoigner. En 2012, Google a été ainsi épinglé par les autorités de part et d’autre de l’Atlantique pour ses pratiques anticoncurrentielles sur les brevets de télécommunications de sa branche Motorola Mobility. Similairement, Qualcomm est sous le coup d’une enquête antitrust aux États-Unis pour ses pratiques dites de no license, no chips. L’entreprise est suspectée d’abuser de sa position dominante pour obtenir des accords de licence avantageux.
Ces premières observations invitent à poser la question suivante : le système des brevets, censé encourager les investissements dans la recherche, ne tend-il pas plutôt à transformer des rentes d’innovation en rentes de situation dans le secteur des nouvelles technologies, où la puissance des effets de réseau garantit déjà un succès considérable à celui qui perce en premier le marché grâce à une technologie nouvelle ? Si le droit de la propriété industrielle ne remplit pas convenablement ses fonctions dans ce secteur, quelles pistes considérer pour y remédier ?
Notons que les États-Unis ont considérablement augmenté la difficulté d’obtention des brevets de logiciel depuis un arrêt de 2016 de la Cour suprême jugeant inéligible l’implémentation informatique d’une idée abstraite (« Alice Corp. v. CLS Bank International »). Depuis, de nombreux brevets de logiciel ont tout simplement été refusés aux États-Unis. En Europe, même si un logiciel n’est pas « en tant que tel brevetable » selon la Convention sur le brevet européen (organisme indépendant de l’UE), les industriels peuvent toutefois déposer un brevet pour une « invention mise en œuvre par ordinateur ». Dans les faits, de nombreux brevets logiciels sont accordés par les pays de l’UE, avec toutefois une grande variabilité de la jurisprudence sur la brevetabilité des logiciels entre États membres. Il s’agit d’un sujet polémique depuis l’échec du vote d’une directive sur la brevetabilité des logiciels dans l’UE en 2005.
Libéraliser les brevets
Le cas historique de AT&T, déjà évoqué précédemment au sujet du démantèlement du monopole des télécommunications en 1982, n’était pas la première passe d’armes du système Bell avec les autorités antitrust américaines. La firme, fondée par Alexander G. Bell en 1877 (un an après le dépôt de son brevet pour l’invention du téléphone), avait déjà fait l’objet d’une procédure pour pratiques anticoncurrentielles dans les années 1950. En 1956, le gouvernement fédéral décida de limiter la part de marché de l’entreprise aux États-Unis à 85% – la laissant, de fait, opérer en situation de monopole –, en échange notamment de l’ouverture de près de huit mille de ses brevets (soit 1% de tous les brevets américains en vigueur à l’époque). Les résultats des travaux de recherche des laboratoires Bell dans des domaines aussi divers que les transistors, les lasers, la téléphonie cellulaire ou encore les câbles sous-marins devinrent du jour au lendemain accessibles à toutes les entreprises américaines. Des travaux de recherche ont montré que cette libéralisation soudaine avait encouragé le développement de nombreuses industries aux États-Unis. Certains y voient même un des éléments déterminants de l’émergence de la Silicon Valley dans les années 197055. Ces brevets ont, en effet, accéléré les inventions d’Intel dans les microprocesseurs, les progrès de Motorola dans les communications ou encore ceux de Texas Instruments dans les circuits intégrés.
L’exemple historique de AT&T plaide clairement pour une libéralisation d’un système qui rémunère trop les détenteurs de brevets et détourne les budgets R&D vers les frais d’avocats. Le sujet est éminemment sensible car l’équilibre entre, d’un côté les impératifs de juste rémunération de l’innovation et, de l’autre, le rétablissement de la concurrence est subtil. Nous avons fait ici le choix de mentionner deux pistes de réflexion.
Nous suggérons de raccourcir substantiellement les durées de validité des brevets dans le domaine des nouvelles technologies, en particulier dans celui des logiciels. Il est, en effet, surprenant que ces brevets bénéficient des mêmes durées légales de validité – de l’ordre d’une vingtaine d’années – que les brevets traditionnels56.
Parallèlement, nous proposons d’orienter l’industrie des nouvelles technologies vers les brevets à licence largement accessible, sur le modèle des « brevets essentiels à une norme ». Ce type de brevet regroupe les droits de licence protégeant les technologies normalisées, comme par exemple le Wi-Fi ou le Bluetooth. En retour de l’obtention d’un brevet de ce type (ou en retour de l’obtention du statut de norme pour une technologie préalablement brevetée), les entreprises titulaires sont obligées d’octroyer des licences « à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires » à toute entreprise souhaitant utiliser la norme. Nous pensons que cette dynamique est très intéressante car elle confère une arme juridique à l’entité acheteuse de la licence pour lutter contre un éventuel abus, tout en rémunérant le détenteur du brevet pour son innovation. Dans les faits, les géants technologiques ont acquis une telle primauté dans leurs marchés respectifs que les technologies qu’ils développent et utilisent deviennent rapidement des normes, même si elles n’en ont souvent ni le nom ni le statut juridique. Dès lors, une adaptation du droit des brevets dans les nouvelles technologies afin de permettre à un large éventail d’industriels d’acheter des licences à des conditions raisonnables semble pertinente. En pratique, il conviendrait d’identifier certains brevets clés (par exemple, ceux déposés par Apple avant la parution de l’iPhone) et de les placer dans un dispositif de licence largement accessible. Bien entendu, de nombreuses questions se posent alors, notamment quant à la signification de l’expression « des conditions équitables ». Les brevets essentiels à une norme soulèvent le même type de débats depuis plusieurs années : les déboires de Qualcomm avec les autorités antitrust portent essentiellement sur les conditions de licence qu’elle accorde sur ses brevets essentiels aux normes de télécommunications mobiles. Nous proposons qu’une telle réflexion soit menée au niveau européen dans le cadre de la mise en place de la Juridiction unifiée du brevet.
Conclusion génerale et recommandations
Au cours des deux dernières décennies, d’importantes innovations technologiques ont permis à quelques entreprises américaines de s’installer en tête du classement des plus grosses capitalisations boursières mondiales. En étudiant l’allocation du capital de ces géants, nous avons pu constater leur tendance à accumuler dans leurs trésoreries une part très significative de leurs profits. Avec le recul qui s’impose, ce phénomène de thésaurisation paraît sans commune mesure avec les standards d’autres industries, nettement plus habituées à réinvestir leurs liquidités dans leur appareil productif ou à les distribuer à leurs actionnaires.
L’étude des placements financiers des Big Tech a ensuite permis de mettre en lumière la gestion ultraconservatrice des sommes thésaurisées, avec des portefeuilles d’actifs majoritairement composés de créances obligataires sans risque. Bien loin de leur image d’innovateurs de premier plan, les géants du numérique allouent et gèrent ainsi leur capital avec une surprenante aversion au risque. Nous tenons cette situation pour économiquement sous-optimale car elle éloigne de l’économie productive de précieux capitaux qui pourraient financer l’innovation technologique et, par là même, contribuer à la croissance de la productivité.
Forts de ce constat, nous avons envisagé plusieurs remèdes à cette situation. Dans la mesure où les actionnaires des Big Tech (essentiellement de grands gestionnaires d’actifs américains) adoptent aujourd’hui une attitude bien trop passive à l’égard de leurs dirigeants, une recrudescence de l’activisme actionnarial pourrait favoriser une distribution plus systématique de leurs liquidités. Nous avons ensuite étudié des options relatives à la régulation financière dans la perspective d’inciter les géants technologiques à diminuer leur encours de trésorerie. Enfin, nous avons mentionné des pistes en matière de fiscalité susceptibles de limiter les profits futurs et donc le potentiel de thésaurisation des Big Tech.
Quoique intéressantes, ces solutions ne nous paraissent en mesure de venir à bout du problème, car la financiarisation de l’actif des Big Tech n’est en réalité que la conséquence d’un problème plus profond : la diminution de l’intensité concurrentielle sur le marché des nouvelles technologies. Plusieurs observations viennent corroborer cette intuition : la persistance de profits exceptionnellement élevés sur le long terme, la concentration croissante de l’activité et de l’innovation dans les mains d’un petit nombre d’entreprises et l’essoufflement de la dynamique entrepreneuriale.
Si les géants du numérique sont parvenus à acquérir des parts de marché considérables en se montrant extrêmement innovants par le passé, ils ont depuis érigé diverses barrières à l’entrée qui les protègent de la concurrence et leur permettent de conserver sans trop d’effort leurs positions dominantes. Leurs multiples passes d’armes (passées ou en cours) avec les autorités antitrust mettent en lumière des pratiques anticoncurrentielles manifestes, auxquelles il faut ajouter de nombreuses suspicions d’abus de position dominante n’ayant pas – ou toujours pas – fait l’objet d’enquêtes officielles. La préservation de leur hégémonie passe en réalité par une mainmise sur l’innovation technologique et leurs trésoreries jouent d’ailleurs là un rôle crucial : tout ce qu’ils ne développent pas eux-mêmes en interne peut être racheté moyennant l’utilisation d’une part tout à fait marginale de leurs immenses réserves de liquidités.
Le tableau que nous dressons est donc celui d’une industrie dans laquelle l’intensité concurrentielle n’est plus satisfaisante du fait d’actions délibérées d’un petit nombre de parties prenantes, au détriment de l’innovation, de la liberté d’entreprendre et donc, in fine, du consommateur. Les dérives actuelles pourraient cependant être en partie corrigées par la politique antitrust en renforçant son champ d’application, en l’adaptant aux réalités du monde numérique et en donnant aux autorités administratives les moyens de faire appliquer la loi.
Nous considérons néanmoins que le rétablissement d’un juste degré de concurrence sur le marché des nouvelles technologiques devrait également reposer sur la conception et la mise en place d’un certain nombre de réglementations nouvelles, à commencer par la facilitation de l’échange des données entre services (inconcevable sans une interopérabilité accrue entre les différents acteurs de l’économie de plateforme) et la libéralisation d’un système des brevets manifestement inadapté à l’économie numérique.
Trouver le juste équilibre entre rémunération des innovateurs d’hier et soutien aux innovateurs de demain est bien entendu un exercice extrêmement délicat. Nous considérons toutefois que le déséquilibre qui prévaut aujourd’hui en faveur des premiers justifie l’adoption des recommandations qui suivent :
Adapter le droit antitrust européen aux réalités du monde numérique
a) Renforcer la capacité de contrôle
• Inscrire dans la loi européenne, sur le modèle allemand, l’obligation de prendre en considération, dans le cadre des enquêtes sur les abus de position dominante et les concentrations, les éléments suivants : marchés multifaces, transferts de coûts entre services, effets de réseau directs et indirects, économies d’échelle et accès à des données à forte valeur ajoutée.
• Modifier la définition des seuils légaux caractérisant la dimension communautaire d’une concentration, de façon à ne plus prendre en compte le chiffre d’affaires des entités concernées mais plutôt la valeur de la transaction (deal value).
• Étendre le contrôle des concentrations aux prises de participation minoritaires, au-delà d’un seuil d’acquisition de droits de vote à déterminer.
• Octroyer à la Commission européenne un droit d’autosaisine sur les concentrations qui ne lui sont pas notifiées, conditionnel à l’absence d’ouverture d’une enquête par l’autorité nationale compétente.
b) Muscler le pouvoir de sanction
• Relever le plafond des astreintes quotidiennes de 5 à 10% du chiffre d’affaires journalier en cas de non-respect par une entreprise d’une décision administrative relevant du droit de la concurrence.
• Étudier la possibilité d’une criminalisation des violations du droit de la concurrence européen.
Repenser l’application et l’interprétation du droit antitrust
a) Lutter contre les asymétries entre régulateur et régulé
• Renforcer les moyens de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, en prônant une vraie politique communautaire sur ce sujet stratégique.
• Créer une « Task Force Tech » au sein de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, chargée d’apporter un soutien technique aux enquêtes et d’automatiser en partie le processus d’identification des pratiques anticoncurrentielles.
b) Placer l’innovation au cœur de l’interprétation de la régulation antitrust
• Favoriser les analyses prospectives dans l’examen des concentrations, prenant en compte la dimension stratégique de l’innovation dans les nouvelles technologies comme moteur de la concurrence de demain.
• Normaliser le recours à la conditionnalité dans les autorisations de concentration, afin de préserver l’intensité concurrentielle des marchés numériques.
c) Renforcer la collaboration avec les autorités américaines
• Instaurer un groupe de travail entre la Commission européenne, la FTC et le DoJ pour œuvrer à l’harmonisation des méthodes d’analyse concurrentielle.
Aller au-delà de l’antitrust
a) Rééquilibrer le droit de la propriété des données en faveur de l’utilisateur
• S’assurer de la bonne application du dispositif RGPD relatif au transfert de données personnelles entre responsables de traitement.
• Étudier la possibilité d’inscrire dans la loi la portabilité du « graphe social » de tout utilisateur d’un réseau social à un autre.
b) Renforcer l’interopérabilité des entreprises de l’économie de plateformes
• Imposer par la loi l’interopérabilité et la portabilité entre fournisseurs de services dans des segments clés de l’économie de plateforme : commerce en ligne, écoute musicale, réseaux sociaux, etc.
• Mettre en place, par segments, des groupes de travail rassemblant les industriels afin de définir les standards régissant cette interopérabilité.
c) Adapter le système des brevets
• Raccourcir la durée de validité des brevets ayant trait aux nouvelles technologies, en particulier dans le domaine du logiciel.
• Étudier la possibilité de généraliser le modèle des « brevets essentiels à une norme » dans le domaine des nouvelles technologies, afin d’obliger les détenteurs de brevets à accorder des contrats de licence justes et non discriminants.
Annexes
A.Principales acquisitions
Sélection de vingt acquisitions majeures réalisées par les Big Tech pour un montant de plus de 2 milliards de dollars depuis 2000.

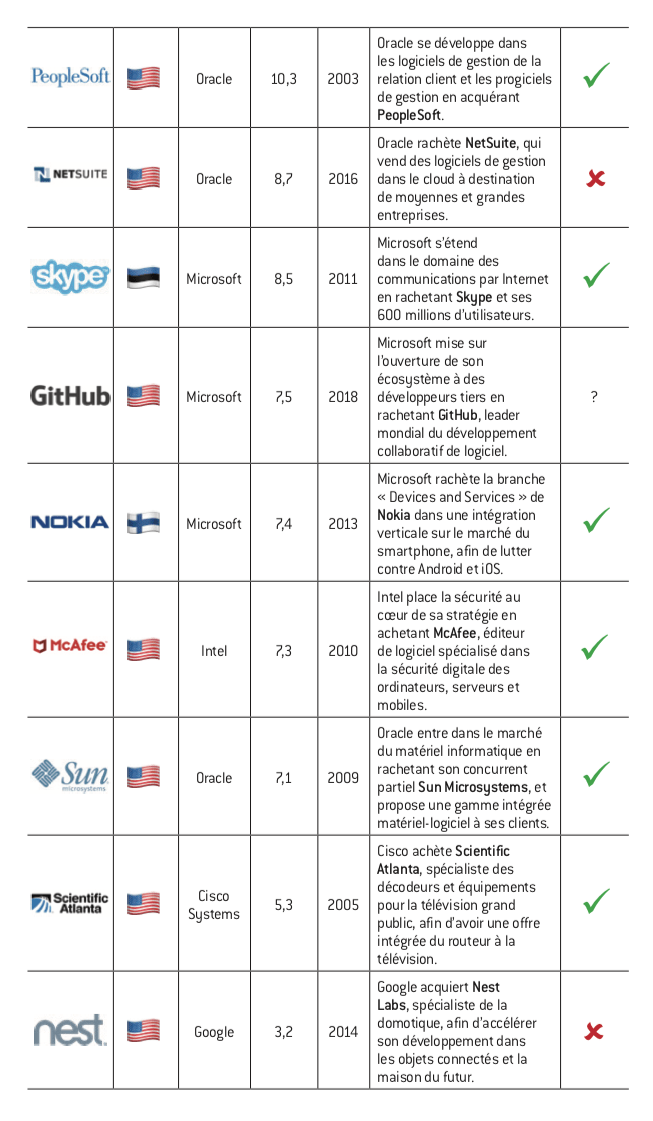
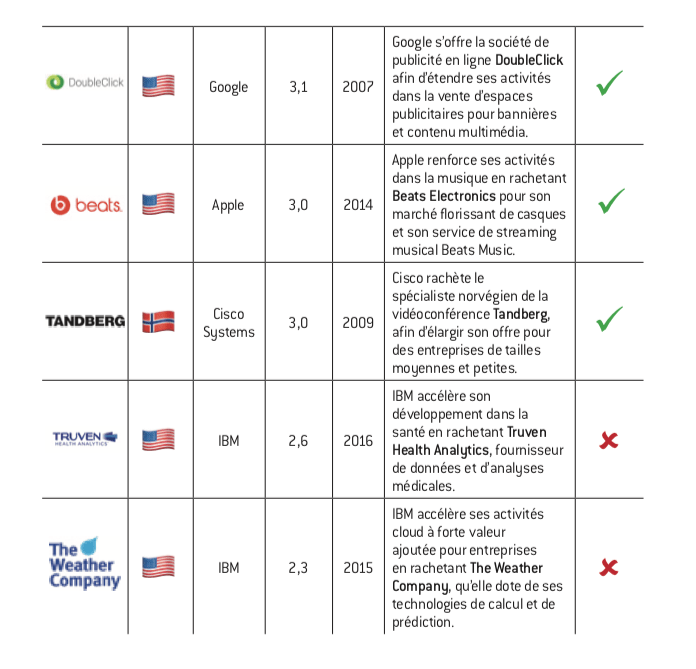
Acquisitions d’un montant supérieur à 2 milliards de dollars depuis 2000 non représentées : ArrowPoint Communications (Cisco Systems), BEA Systems (Oracle), NDS Group (Cisco Systems), aQuantive (Microsoft), PwC Consulting (IBM), AppDynamics (Cisco Systems), MICROS Systems (Oracle), Cognos (IBM), Siebel Systems (Oracle), ASML Holding (Intel), Hyperion Solutions (Oracle), Atheros (Qualcomm), Mojang AB (Microsoft), WebEx Communications (Cisco Systems), CSR (Qualcomm), Sourcefire (Cisco Systems), Rational Software (IBM).
B. Acquisitions stratégiques
Sélection de vingt acquisitions majeures réalisées par les Big Tech pour un montant de moins de 2 milliards de dollars depuis 2000.
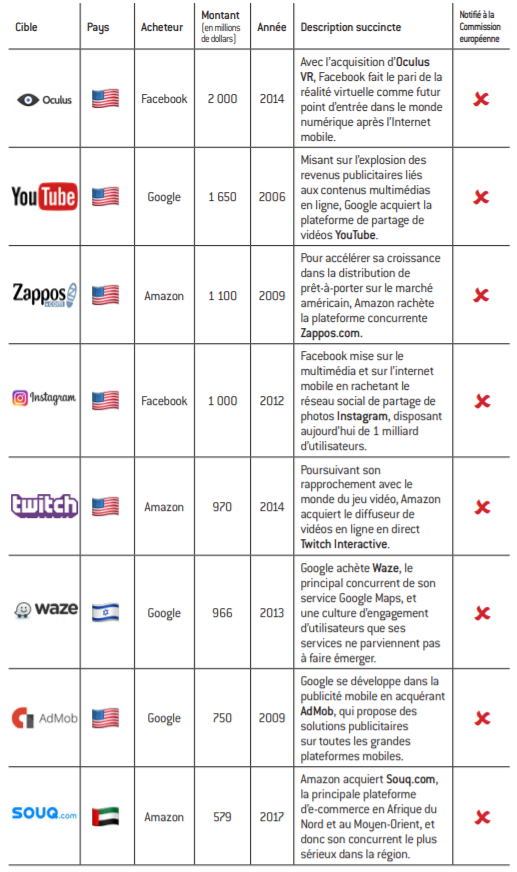
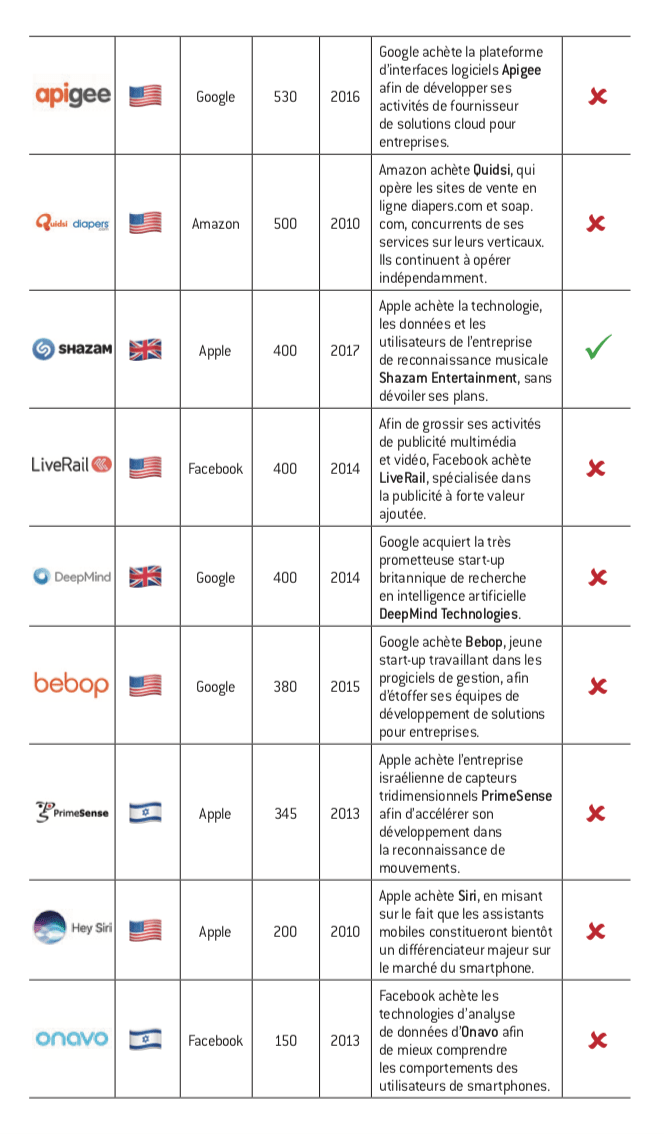
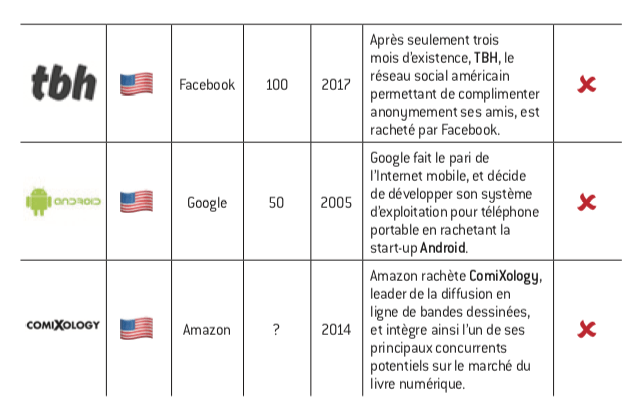
C. Parts de marché des Big Tech
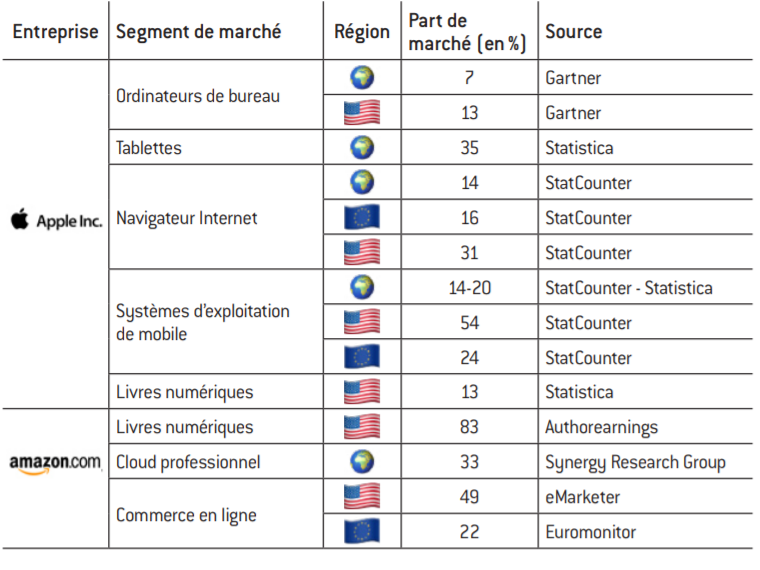
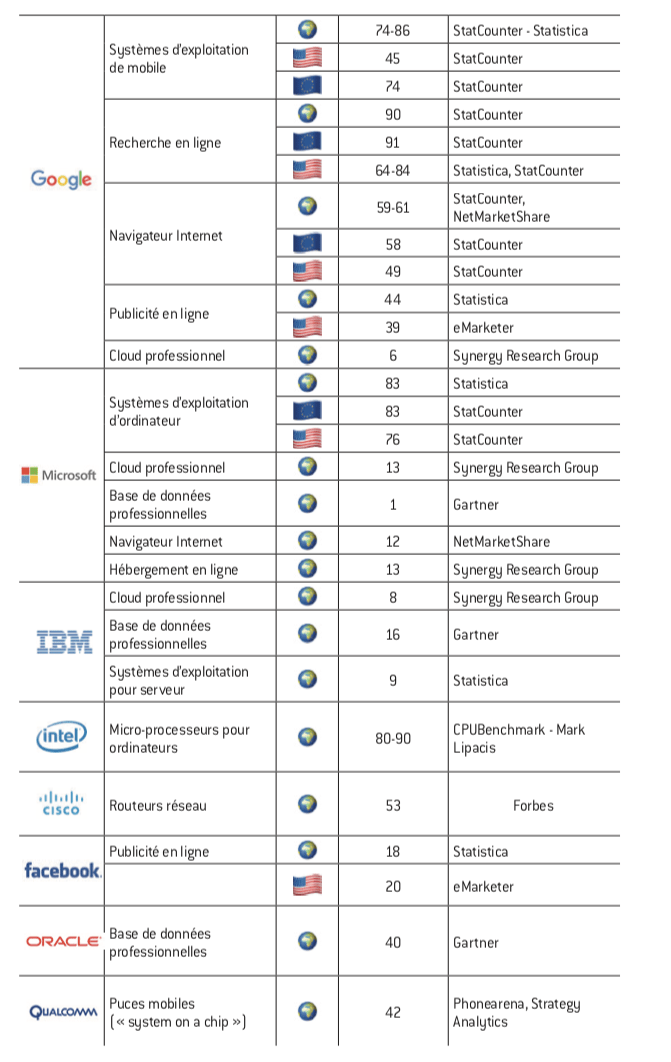
D. La législation antitrust aux États-Unis et dans l’Union européenne
1. États-Unis
La législation antitrust américaine repose sur un ensemble de lois fédérales et de lois des États. Les cas de pratiques anticoncurrentielles violant les lois antitrust peuvent être attaqués en justice par la Federal Trade Commission (FTC), le Department of Justice (DoJ) ou toute entité privée ayant subi des dommages suffisants.
Les quatre principaux textes régissant la législation antitrust américaine sont :
– le Sherman Act de 1890, qui définit notamment les pratiques anticoncurrentiellesd’entente et de cartel ainsi que celles de monopole et d’abus de positiondominante. Le DoJ a la responsabilité fédérale de l’application du Sherman Act ;
– le Federal Trade Commission Act de 1914, qui crée la FTC, cette dernière ayant la responsabilité fédérale de son application ;
– le Clayton Antitrust Act de 1914, qui met en place l’examen des fusions-acquisitions, et dont la FTC et le DoJ partagent la responsabilité de mise en application ;
– le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, qui amende et modernise les dispositions d’examen des fusions-acquisitions du Clayton Antitrust Act.
Divers amendements de ces lois ont été votés, notamment au cours des dernières décennies, afin de clarifier et moderniser les procédures.
La FTC et la division antitrust du DoJ partagent la compétence de l’examen des fusions-acquisitions ainsi que celle de l’application globale des lois antitrust fédérales. Les critères d’examen d’une concentration par une agence fédérale sont basés sur la taille de la transaction et, éventuellement, sur le chiffre d’affaires des entités concernées. Au cas par cas, les deux agences s’accordent sur la responsabilité d’un examen ou d’une éventuelle enquête. La FTC et le DoJ se sont progressivement spécialisés dans certains segments, notamment l’industrie pharmaceutique ou les nouvelles technologies pour la première, la finance, le transport aérien ou les télécommunications pour le second.
Le DoJ et la FTC se partagent également la responsabilité, au cas par cas, de poursuivre les abus de position dominante, d’ententes ou de cartels qui enfreignent les lois antitrust. Il convient de noter que seul le DoJ a la possibilité de poursuivre les enfreintes au pénal grâce au Sherman Act. Les entités privées peuvent également demander l’application des lois antitrust si elles démontrent qu’elles ont subi des dommages suffisants imputables à une pratique anticoncurrentielle. En pratique, on constate de nombreuses class actions intentées au motif de violation du droit antitrust.
2. Europe
La législation antitrust européenne repose sur des textes communautaires, ainsi que sur les lois des États membres.
Les cas de pratiques anticoncurrentielles violant les lois antitrust européennes sont évalués par le Réseau européen de la concurrence (REC), composé des autorités nationales de la concurrence des États membres ainsi que de la Commission européenne. Ces entités peuvent prononcer des sanctions administratives en cas d’infraction au droit concurrentiel, et des sanctions pénales peuvent également être engagées au niveau national selon le droit du (ou des) État(s) membre(s) concerné(s).
Les principaux textes régissant le droit de la concurrence au niveau européen sont :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (revu en 2007 avec le traité de Lisbonne), en particulier son article 101, qui interdit les ententes et les cartels ; son article 102, qui prohibe les abus de positions dominantes ; et son article 107, qui bannit les aides d’État contraires à la bonne concurrence du marché intérieur ;
– le règlement antitrust de 2003, qui fixe les règles d’application du traité précédent sur l’antitrust dans l’Union européenne ;
– le Règlement CE sur les concentrations de 2004, qui encadre l’examen et l’autorisation des concentrations en Europe.
Ajoutons que, depuis quelques années, l’Europe souhaite pousser les entités privées (consommateurs, concurrents) ayant subi des dommages provoqués par des pratiques anticoncurrentielles à demander réparation en justice au niveau d’une juridiction civile nationale. Afin d’harmoniser les droits nationaux, l’Europe a adopté en 2014 une directive sur les actions civiles en dommages consécutives à des pratiques anticoncurrentielles (directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne).
Concentrations
Le Règlement CE sur les concentrations détaille les critères d’évaluation permettant d’attribuer à une concentration une dimension communautaire. Si ces critères sont remplis, la Commission européenne est responsable de son évaluation et la régulation communautaire s’applique. Un mécanisme de renvoi entre la Commission européenne et les autorités des États membres existe afin de simplifier la procédure et de garantir un guichet unique aux entreprises. Ce principe permet:
– à la Commission européenne de renvoyer tout ou partie d’un cas qui lui était attribué par sa dimension communautaire à une autorité nationale, sous certaines conditions ;
– à une autorité nationale de renvoyer à la Commission européenne un cas qui n’est pas de dimension communautaire (au sens des critères de seuils), mais qui a trait au commerce entre États membres et menace d’affecter significativement la concurrence. La Commission européenne peut informer un État qu’elle considère qu’un cas doit lui être renvoyé, mais ne peut s’autosaisir.
Les traités européens permettent à la Commission européenne d’autoriser une concentration sans condition, d’autoriser une concentration conditionnellement au respect de certains engagements (maintien de licence de brevets à des entreprises tierces par exemple) ou à la réalisation de certaines actions (vente d’une partie de l’activité par exemple), ou d’interdire une concentration.
Antitrust
Les cas d’abus de position dominante, d’entente et de cartel sont ouverts après une plainte d’une entité privée, une autosaisie des autorités de la concurrence du REC, une information reçue via un lanceur d’alerte ou une demande de mesure de clémence reçue de la part d’un des membres d’un cartel. La Commission européenne traite ces cas en collaboration étroite avec les autorités nationales des États membres. Ces dernières doivent informer la Commission européenne de toute action qu’elles mènent en application du droit communautaire. Quand la Commission européenne décide de se saisir d’un cas, cela dessaisit automatiquement les autorités nationales de leur prérogative d’application du droit communautaire.
S’il y a violation constatée du droit concurrentiel, la Commission européenne peut prononcer une amende administrative. Le droit communautaire limite ces amendes à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. Afin de parvenir au montant de l’amende infligée, la Commission européenne a publié en 2006 des « Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées » :
–montant de base de l’amende : ce calcul commence par la détermination du montant des ventes concernées par la pratique anticoncurrentielle. La Commission européenne applique ensuite à ce montant un coefficient multiplicatif pouvant aller jusqu’à 30% (déterminé en fonction de la gravité de l’infraction), et multiplie le tout par la durée de l’infraction. En sus, la Commission européenne peut ajouter à ce dernier montant une somme représentant 15 à 25% de la valeur des ventes annuelles précédemment calculée, indépendamment de la durée de l’infraction. Ce dernier ajout constitue une dissuasion supplémentaire, en particulier afin d’éviter les ententes horizontales et les cartels ;
–ajustement du montant de base pour circonstances aggravantes ou atténuantes : une fois le montant de base de l’amende calculée, la Commission européenne peut l’augmenter si elle constate des circonstances aggravantes (infraction répétée, refus de coopération, rôle de meneur dans l’infraction) ou le diminuer en cas de circonstances atténuantes (infraction commise par négligence, forte coopération avec la Commission européenne dans l’enquête, comportement anticoncurrentiel autorisé ou favorisé par les autorités publiques nationales). Quoi qu’il en soit, les lignes directrices insistent sur la nécessaire dimension dissuasive de l’amende, et donc sur l’importance de dépasser le montant des gains illicites dus à l’infraction – dans la limite du seuil légal de 10% du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée.
Afin d’obtenir les éléments nécessaires à son enquête en amont ou bien de faire appliquer une éventuelle décision administrative en aval, la Commission européenne peut infliger une astreinte quotidienne allant jusqu’à 5% du chiffre d’affaires mondial journalier de l’entreprise concernée.
Aides d’État
En plus des volets classiques de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, l’Union européenne s’est dotée d’un mécanisme pour éviter le « dumping » entre États de l’Union. Les aides attribuées par les politiques budgétaires nationales aux entreprises sont donc très précisément encadrées, la Commission européenne ne tolérant celles-ci que dans un cadre précis définit dans les textes (aides au développement économique de zones à faible activité, aides au bon déroulement d’un projet d’intérêt commun à l’Union européenne, aides liées à la préservation du patrimoine culturel, etc.). Il faut noter que les aides d’État illégales du point de vue du droit communautaire peuvent prendre plusieurs formes : subventions directes, crédits d’impôts, etc. La Commission européenne a ainsi respectivement demandé au Luxembourg et à l’Irlande de récupérer 250 millions d’euros auprès d’Amazon et 13 milliards d’euros auprès d’Apple pour aides d’État illicites (la Commission européenne a d’ailleurs assigné l’Irlande en justice en 2017 pour ne pas avoir fait le nécessaire pour recouvrer ce montant).
E. Principaux cas d’abus de position dominante des Big Tech en Europe depuis 2000
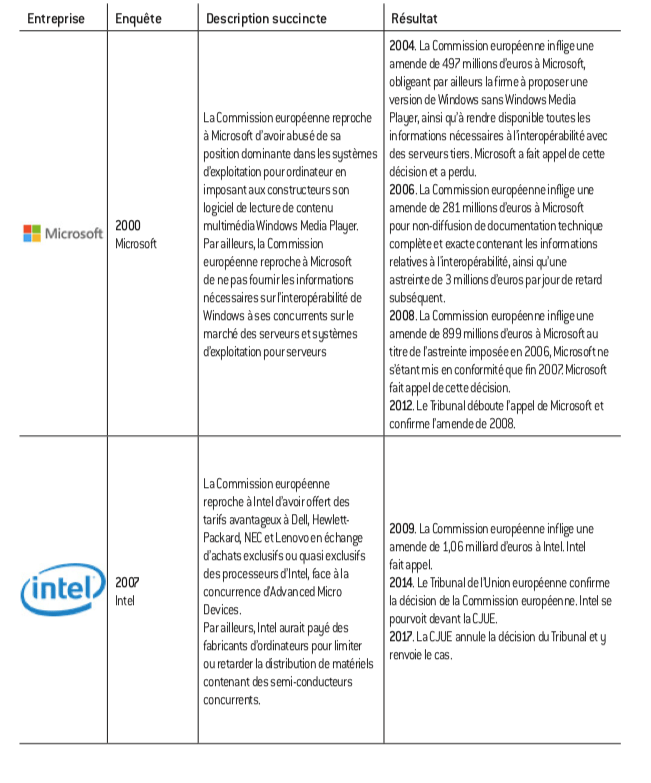
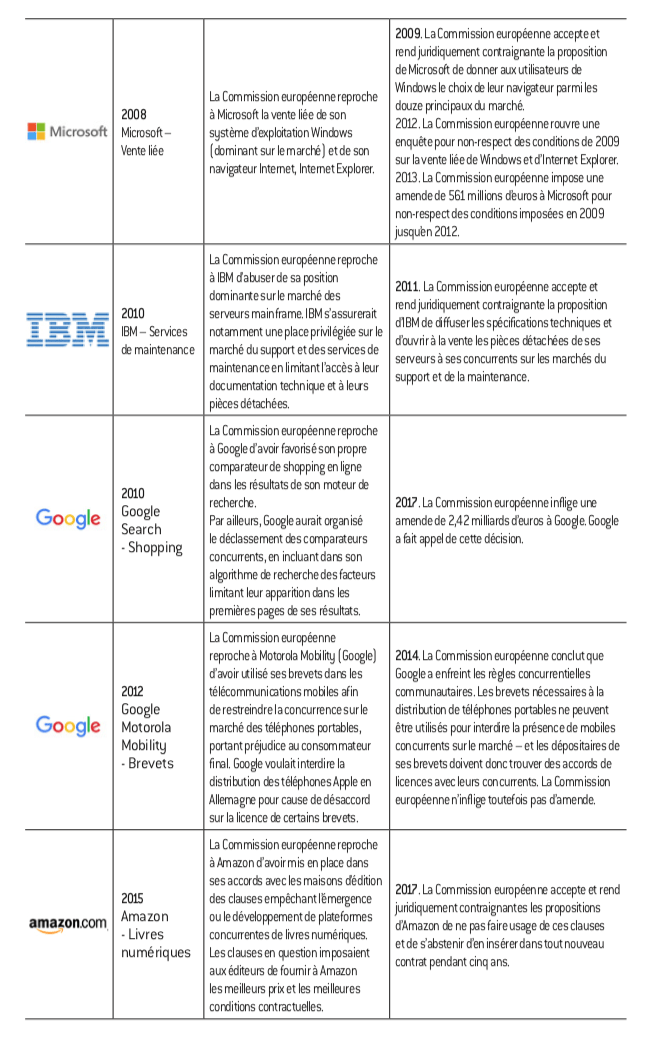
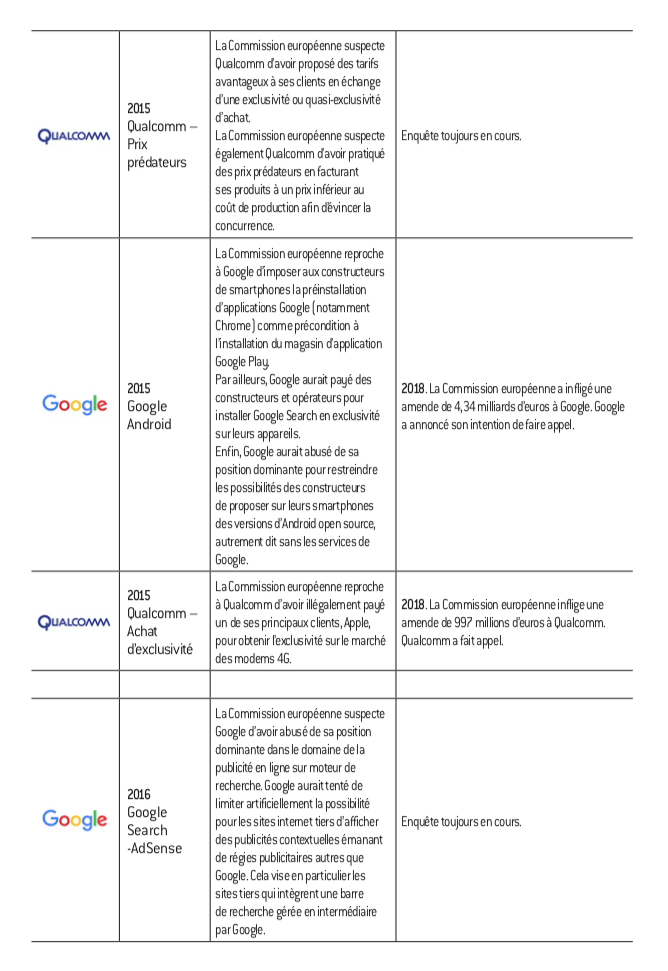
F. Principales concentrations des Big Tech depuis 2000
Sélection de concentrations ayant donné lieu à une autorisation conditionnelle de la part de la Commission européenne ou présentant un intérêt particulier au vu de leur enjeu stratégique.
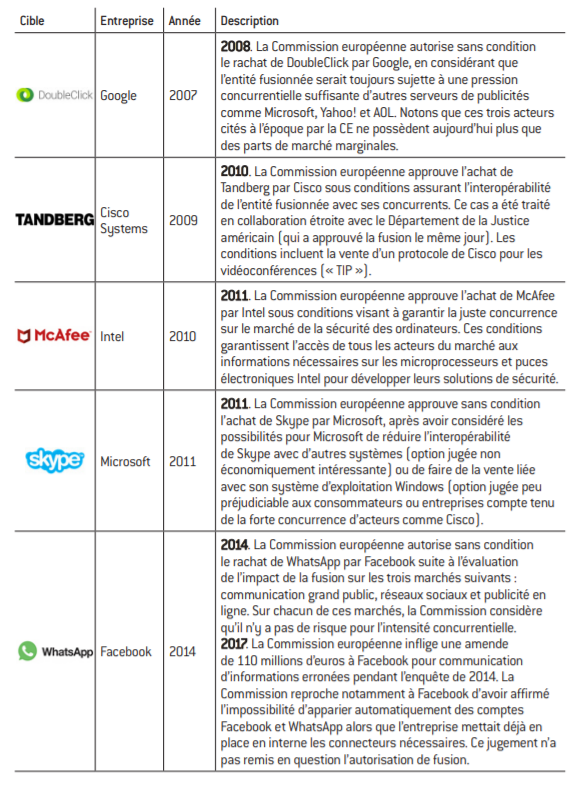
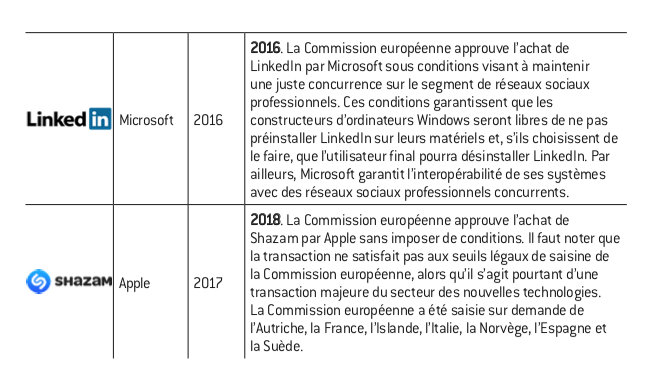
G. Principaux cas antitrust des Big Tech aux États-Unis depuis 2000
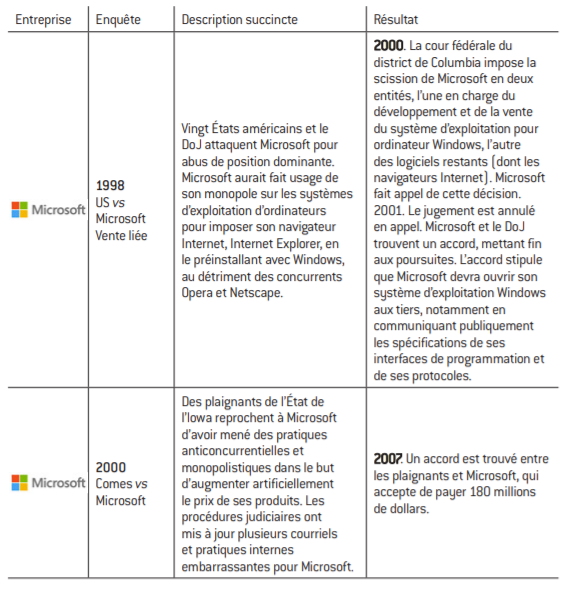
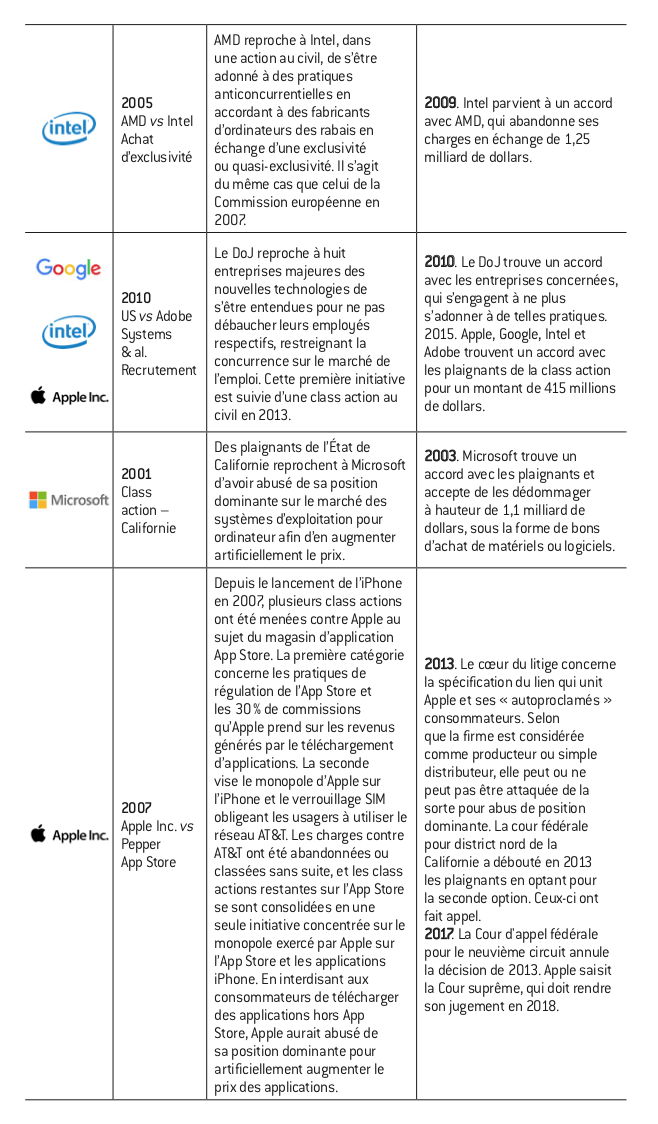
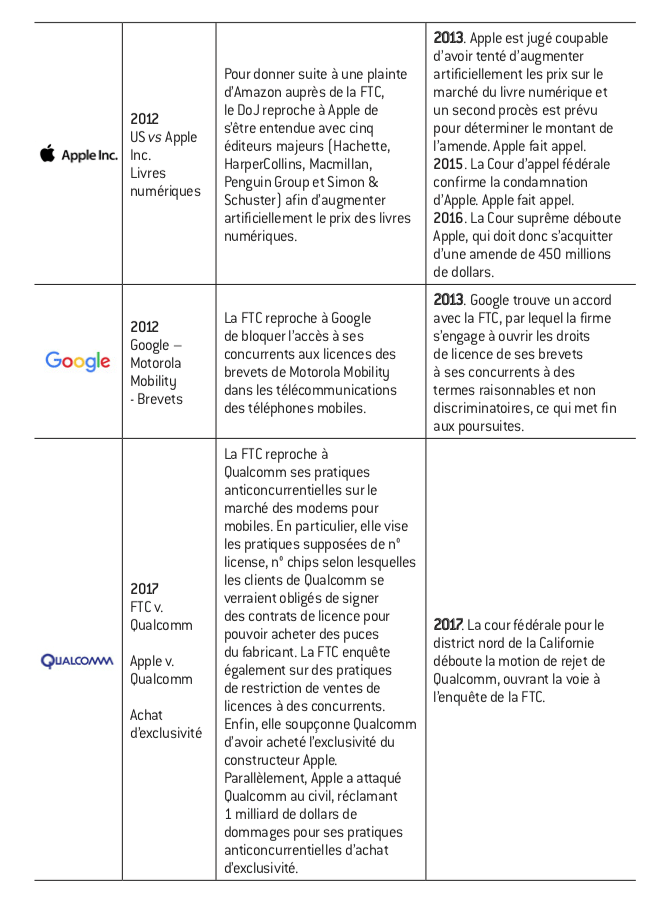
Bibliographie
AUTOR (David), DORN (David), KATZ (Lawrence F.), PATTERSON (Christina) et VAN REENEN (John) (2017), « The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms », NBER Working Paper n° 23396, mai 2017
AZAR (José), SCHMALZ (Martin C.) et TECU (Isabel), « Anticompetitive Effects of Common Ownership », The Journal of Finance, vol. 73, n° 4, août 2018, p. 1513-1565
BAKER (Jonathan B.), « Can Antitrust Keep Up? Competition Policy in High- Tech Markets », brookings.edu, 1er décembre 2001
BOLDRIN (Michele) et LEVINE (David K.), « The Case Against Patents », Working Paper 2012-035A, Federal Reserve Bank of St. Louis, septembre 2012
BORK (Robert H.), The Antitrust Paradox, The Free Press, 2e éd., 1993 COWEN (Tyler), « Yesterday’s Antitrust Laws Can’t Solve Today’s Problems »,bloomberg.com, 5 octobre 2016
COWEN (Tyler) et ZINGALES (Luigi), « Are Google and Facebook Monopolies? », review.chicagobooth.edu, 22 janvier 2018
CRANDALL (Robert W.), « If It Ain’t Broke, Don’t Break It Up », brookings. edu, 14 juin 2000
DECKER (Ryan A.), HALTIWANGER (John), JARMIN (Ron S.) et MIRANDA (Javier), « Declining Dynamism, Allocative Efficiency, and the Productivity Slowdown », American Economic Review, vol. 107, n° 5, mai 2017, p. 322-326
— « Declining Business Dynamism: What We Know and the Way Forward », American Economic Review, vol. 106, n° 5, mai 2016, p. 203-207
— « The Secular Decline in Business Dynamism in the U.S. », working paper, juin 2014
DUHIGG (Charles) et LOHR (Steve), « The Patent, Used as a Sword », The New York Times, 8 octobre 2012
FURMAN (Jason), « Beyond Antitrust: The Role of Competition Policy in Promoting Inclusive Growth », Searle Center Conference on Antitrust Economics and Competition Policy, 16 septembre 2016
HENDRICKSON (Clara) et GALSTON (William A.), « Big technology firms challenge traditional assumptions about antitrust enforcement », brookings.edu, 6 décembre 2017
GUZMAN (Jorge) et STERN (Scott), « The State of American Entrepreneurship: New Estimates of the Quantity and Quality of Entrepreneurship for 15 US States, 1988-2014 », NBER Working Paper n° 22095, mars 2016
HALTIWANGER (John), HATHAWAY (Ian) et MIRANDA (Javier), « Declining Business Dynamism in the US High-Technology Sector », Ewing Marion Kauffman Foundation, février 2014
HATHAWAY (Ian) et LITAN (Robert E.), « What’s Driving the Decline in the Firm Formation Rate? A Partial Explanation », brookings.edu, 20 novembre 2014
KHAN (Lina M.), « What Makes Tech Platforms So Powerful? », promarket. org, 5 avril 2018
— « Amazon’s Antitrust Paradox », The Yale Law Journal, vol. 126, n° 3, janvier 2017, p. 710-805
MITCHELL (Stacy), « Amazon Doesn’t Just Want to Dominate the Market—It Wants to Become the Market », thenation.com, 15 février 2018
ROLNIK (Guy) et ZINGALES (Luigi), « A Way to Own Your Social-Media Data », nytimes.com, 30 juin 2017
SALOP (Steven C.) et SHAPIRO (Carl), « Jean Tirole’s Nobel Prize in Economics: The Rigorous Foundations of Post-Chicago Antitrust Economics », Antitrust, vol. 29, n° 2, printemps 2015, p. 78-81
SHAMBAUGH (Jay), NUNN (Ryan), BREITWIESER (Audrey) et LIU (Patrick), « The state of competition and dynamism: Facts about concentration, start-ups, and related policies », brookings.edu, 13 juin 2018
SHAPIRO (Carl), « Antitrust in a Time of Populism », abstract, University of California, Berkeley, 24 octobre 2017
SUROWIECKI (James), « Why Startups Are Struggling », MIT Technology Review, 15 juin 2016
STONE (Brad), The Everything Store. Jeff Bezos and the Age of Amazon, Little, Brown and Company, 2013
THOMPSON (Ben), « Why Facebook Shouldn’t Be Allowed to Buy tbh », stratechery.com, 23 octobre 2017
— « Facebook and the Cost of Monopolies », stratechery.com, 19 avril 2017
— « Manifestos and Monopolies », stratechery.com, 21 février 2017
— « Antitrust and Aggregation », stratechery.com, 26 avril 2016
TIROLE (Jean), «A Nobel-winning economist’s guide to taming tech monopolies », interview par Allison Schrager, qz.com, 27 juin 2018
— Économie du bien commun, PUF, 2016
— « Prize Lecture », nobelprize.org, 8 décembre 2014
WATZINGER (Martin), FACKLER (Thomas A.), NAGLER (Markus) et SCHNITZER (Monika), « How Antitrust Enforcement Can Spur Innovation: Bell Labs and the 1956 Consent Decree », CEPR Discussion Paper, 9 janvier 2017




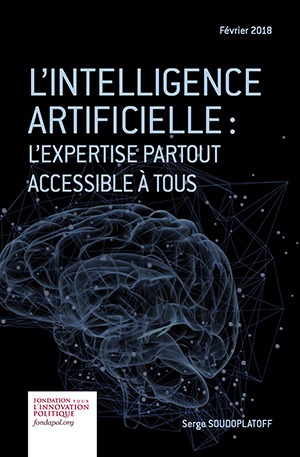
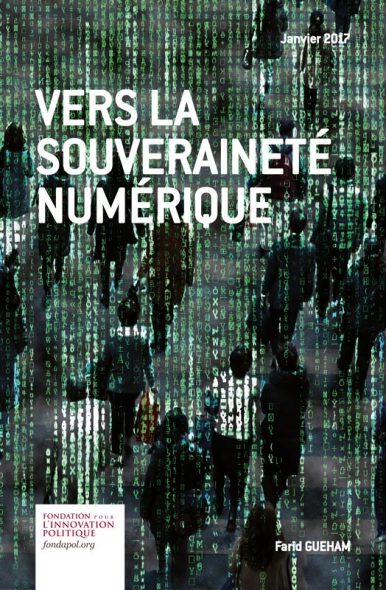
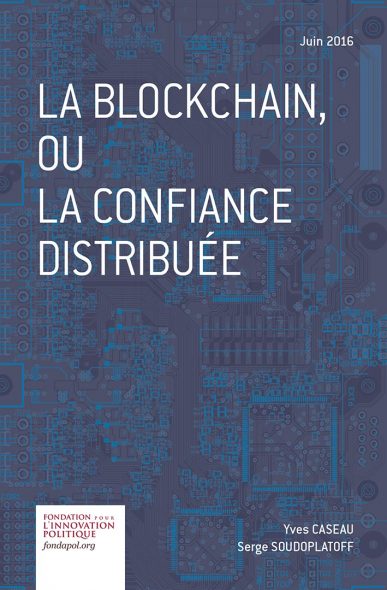
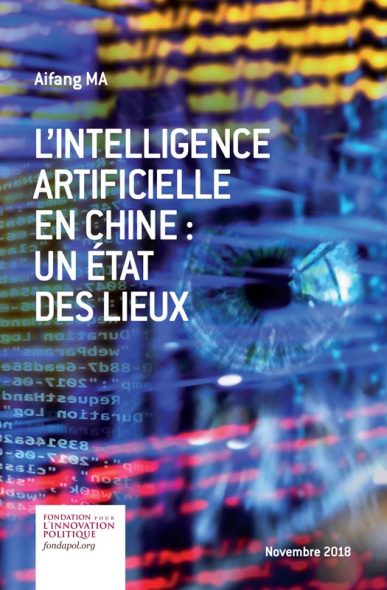











Aucun commentaire.