Les mots de la fin de vie : ne pas occulter les termes du débat
Introduction : le contexte
Le poids des locuteurs
Des éléments de langage revisités
La fin de vie comme cheminement dans une temporalité
La mort provoquée : extension du champ lexical de l’euthanasie et du suicide assisté
La langue comme pacte fondateur de la communauté
Des concepts à double sens ?
Conclusion
Résumé
« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Cette formule de Camus, bien souvent citée, nous rappelle l’importance des mots. Si la question de la mort programmée occupe depuis quelques mois une place médiatique importante, elle s’inscrit dans de subreptices glissements sémantiques qui génèrent de graves confusions. La fin de la vie est nécessairement redoutée. L’euphémisation du vocabulaire voudrait laisser croire que la suppression des mots efface la crudité des actes et la méconnaissance du sens exact des termes altère fondamentalement le débat.
Le militantisme pro-euthanasie commence par la transformation délibérée du lexique. Qu’il s’agisse de la lénifiante expression d’« aide à mourir » pour signifier la mort provoquée ou du mésusage du vocable « euthanasie », employé pour évoquer un arrêt de traitement, les mots peuvent être trompeurs. Leur restituer leur signification exacte est un préalable indispensable à tout débat juste sur ce sujet d’une immense complexité.
Pascale Favre,
Médecin, titulaire d’un DEA en droit et économie de la santé et doctorante en philosophie. Elle a co-écrit avec Jean-Marie Gomas l’ouvrage Fin de vie : peut-on choisir sa mort ?, Artège, 2022.
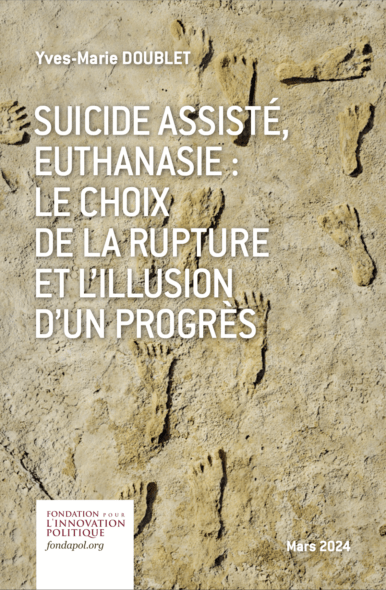
Suicide assisté, euthanasie : le choix de la rupture et l'illusion d'un progrès

Prestataires de santé à domicile : les entreprises au service du virage ambulatoire

L’hospitalité : une éthique du soin

L'humanisme et l'humanité en islam

La fraternité

Où va la politique de l’Église catholique ? D’une querelle du libéralisme à l’autre
Introduction : le contexte
La fin de vie reste un sujet que l’on aborde avec réticence. Pourtant, s’il est volontiers évité par ceux qui n’y sont pas directement confrontés, il nous concerne tous à un moment ou à un autre. Une relative méconnaissance de sa réalité clinique ainsi que de nombreux préjugés en donnent une vision souvent inexacte, plombée par des représentations exclusivement négatives. Notre société permissive et individualiste, valorisant avant tout la performance, repousse ce qui dérange le fantasme d’immortalité. La progression majeure de la conception économico-technicienne du soin dans le monde hospitalier n’est plus à démontrer. Mais la volonté de maîtrise qui s’empare aujourd’hui de la mort elle-même – en allant jusqu’à proposer son administration anticipée – touche un domaine jusque-là relativement protégé. La subtilité est de laisser croire que la demande vient de la personne elle-même, alors que les influences multiples, qui s’inscrivent d’abord dans le fond et dans la forme du discours, sont à l’œuvre. Le vocabulaire qui s’y réfère n’est pas neutre et modifie notablement l’appréhension des choses.
La puissance du langage touche chacun d’entre nous sans même que nous en ayons conscience. Porteur de visions avant tout culturelles mais aussi plus personnelles, intimement liées à notre histoire, chaque mot résonne de façon particulière dans notre imaginaire. Trace d’une mémoire inconsciente, il a aussi valeur d’échange témoignant de sa fonction sociale.
Le langage affectant la manière dont on perçoit les choses, il est essentiel d’observer l’utilisation qui en est faite pour aborder un sujet aussi sensible que celui de la fin de vie. L’actualité de cette question met en évidence une mise en scène très élaborée du discours ainsi qu’une transformation imperceptible du vocabulaire employé.
Le poids des locuteurs
La question qui a été posée à la convention citoyenne était : « Le cadre d’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? ». Faut-il rappeler que toute loi est générale et donc par essence non destinée à répondre à chaque situation singulière ?
Damien Le Guay, « Vote sur la fin de vie : ‘‘ pourquoi tout était écrit d’avance’’ », Le Figaro, 21 février 2023 ; Henri De Soos, « Les faux ‘‘débats équilibrés’’ de la Convention citoyenne sur la fin de vie », AFP, 24 février 2023 ; Paul Sugy et Agnès Leclair, « Malaise et soupçons d’instrumentalisation à la Convention citoyenne sur la fin de vie », Le Figaro, 3 mars 2023.
Georges Bernanos, Les Grands Cimetières sous la lune, 1938
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835.
Chiffre qui a valu récemment un rappel des « bonnes pratiques » aux médecins : « La Commission rappelle par ailleurs que l’âge avancé et les problèmes liés au vieillissement ne constituent pas une maladie grave et incurable et ne justifient pas l’AMM. » (cité par Davide Gentile et Daniel Boily, Radio Canada, 5 août 2023).
En préambule, nous ne pouvons ignorer le contexte global de la prise de parole, caractérisé aujourd’hui par une absence totale de hiérarchisation en fonction du locuteur. Il est frappant de constater par exemple la mise en balance, sans correctif aucun, de la parole d’un médecin qui évoque sa pratique solitaire et illégale de l’euthanasie et d’un autre qui, dans la transdisciplinarité quotidienne de son exercice respectueux des règles, représente plusieurs milliers de soignants ; ou encore de personnes qui martèlent leurs propres convictions, forgées sur leur seul vécu, face à d’autres qui, à travers des années d’expérience professionnelle dans le domaine, ont multiplié les rencontres singulières. Fréquemment aussi, le message d’une personnalité connue, jouissant d’une popularité sur un terrain tout autre que celui de la médecine, résonne avec une force plus grande que celle d’un soignant anonyme mais expérimenté : le poids des mots doit plus à la notoriété qu’à la compétence du locuteur.
Bien peu se sont interrogés sur le poids accordé aux conclusions d’une convention citoyenne appelée à se prononcer en trois mois sur une question extrêmement complexe, aux enjeux majeurs, de surcroît basée sur une formulation biaisée1 et organisée dans des conditions dont l’impartialité a été ouvertement remise en cause2.
Plus grave encore est l’écho donné à la demande de mort provoquée d’un patient atteint d’une maladie particulière – comme la maladie de Charcot, devenue un totem pour les tenants de l’euthanasie – susceptible d’être entendue comme une généralisation, en occultant les milliers d’autres porteurs de la même pathologie qui souhaitent pour eux-mêmes un tout autre chemin. Le focus hyperbolique centré sur un individu tend à estomper le reste du tableau. Cet « effet loupe » impacte vivement une population occidentale aux affects aussi perméables que désengagés. « L’homme de ce temps a le cœur dur et la tripe sensible3 ».
Chacune de ces disproportions témoigne d’un égalitarisme déjà auguré par Tocqueville4, qui désintègre la notion même d’égalité, développant un principe démagogique d’équivalence qui fausse la prise en compte de la réalité.
Sur un plan plus intime, la relation entre soignant et malade vit elle aussi sous influence, devant impérativement trouver un équilibre entre deux excès potentiels. Asymétrique, elle a longtemps imposé un paternalisme infantilisant qui participe des réactions actuelles visant à inverser la domination, en transformant le praticien en prestataire de service.
Paradoxalement, le courant pro-euthanasie omet d’envisager la part de puissance feutrée qui appartient alors au médecin. Selon que celui-ci est favorable ou non à la mort provoquée, il abordera la relation avec des approches dissemblables. Laisser entendre au patient qu’il sera accompagné jusqu’au bout, en valorisant l’imprévisible du temps à venir ou lui proposer d’emblée de répondre positivement à sa demande de mort, induisent chez ce dernier des comportements radicalement autres. La posture du soignant s’avère déterminante en ce temps d’immense fragilité. Les chiffres sont éloquents : dans les États d’Australie qui autorisent l’euthanasie, la loi interdit aux soignants d’initier une discussion sur la mort provoquée, dont l’initiative revient donc exclusivement au patient. À l’opposé, au Québec, le patient se voit proposer, dès l’annonce de la maladie grave, l’euthanasie comme une des alternatives envisageables : cet État montre le taux de progression du nombre d’euthanasies le plus impressionnant au monde, avec plus de 7 % des décès par euthanasie six ans après l’instauration de la loi5.
En revenant à la dimension collective, l’impact d’une loi sur la mort provoquée est aussi très inégal si celle-ci fait l’objet d’une restriction absolue de communication ou s’il est permis d’en parler publiquement.
Plusieurs autres types de transformation affectent la diffusion de l’information, à travers la modification du lexique lui-même, les glissements sémantiques qui altèrent le sens même des mots utilisés ou encore l’interprétation orientée qui leur est délibérément attribuée.
Des éléments de langage revisités
Mots et images sont indissociables. Penser la mort dans une abstraction est une illusion, une impossibilité, une éviction de la réalité de la finitude. Vouloir la réduire à la seule maîtrise d’un geste technique ne peut pour autant effacer ses autres dimensions. La mort est avant tout une histoire singulière, toujours unique, assez généralement génératrice de peurs et par conséquent volontiers mise à distance. Chacun de nous en a une figuration liée à son propre vécu, mais aussi largement façonnée par les messages véhiculés dans la société.
La fin de vie comme cheminement dans une temporalité
Même si le législateur la fait miroiter comme exigible dans l’article L1110-5-1 de la loi Claeys-Leonetti de 2016 : « à la demande du malade d’éviter toute souffrance » : les mots du législateur ne sont pas ceux du médecin.
Intervention de Véronique Miniac lors de la Journée régionale de la coordination bretonne de soins palliatifs, 20 octobre 2023, sur le thème « Les fondamentaux des Soins Palliatifs ; Gardons le cap, nos valeurs comme boussole ».
Définition de la HAS.
Éric Fiat, Petit traité de dignité, Larousse, 2012
Ibid.
Agata Zielinski, « Pour une éthique de la relation : la dimension relationnelle de l’autonomie et de la vulnérabilité », CNSA (caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), 1ères rencontres scientifiques sur l’autonomie, 2009.
Dans une perspective d’ensemble, toute description peut revêtir une coloration fort opposée selon la manière dont elle est rapportée : exposer « le temps du mourir », et plus spécifiquement l’agonie, comme inéluctablement un moment de souffrance intolérable, est une image aussi effrayante qu’inexacte. Si cette période de la vie est une étape redoutée et légitimement inquiétante, elle reste toujours ouverte à un inconnu. Nombre de patients – au moins deux sur trois, toutes causes de mort confondues – mangent et communiquent jusqu’aux derniers jours de leur vie. L’essentiel reste toujours la qualité de leur prise en charge. Cela étant, l’absence totale de souffrance, souvent mentionnée comme exigence pour justifier une mort provoquée, est une notion irréaliste6. La souffrance spirituelle, existentielle est inhérente à la vie et la phase de la fin de la vie n’en est pas exempte. Elle peut même apparaître majorée en ce temps qui n’est plus envahi par les trépidantes activités qui la remplissent habituellement. La souffrance née d’insatisfactions, d’aspirations inassouvies peut se densifier, s’acutiser dans la conscience de cette attente qui ne sera jamais comblée. Le calme imposé par l’alitement, le silence d’un espace clos loin de la vie sociale, laissent soudain émerger ou réémerger des angoisses plus ou moins anciennes, qui peuvent se déployer et/ou trouver des apaisements bienvenus7. Par ailleurs, la peur de la mort est universellement partagée, par ceux qui croient au ciel comme par ceux qui n’y croient pas, générant une souffrance parfois intense, bien en amont même d’une imminence annoncée. De fait, ce temps qui est encore un temps de vie se vit dans la même tonalité que le reste du parcours ; il n’y a pas de mort standard, chaque mort est unique et toujours exceptionnelle.
Tout autre est la douleur, qui doit impérativement être soulagée et peut l’être à l’heure actuelle avec les moyens thérapeutiques à la disposition du corps médical, à condition que l’offre de soins soit accessible et que le patient bénéficie d’une prise en charge par une équipe compétente. Il importe donc de ne pas confondre douleur et souffrance. Très schématiquement, la douleur est « physique » ; elle se définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes8. La souffrance a une épaisseur « morale », elle se déploie dans une dimension plus globale. Si les deux interagissent mutuellement, elles font intervenir des mécanismes psychiques et des traitements qui leur sont propres. La douleur est assez régulièrement soulagée grâce aux techniques et traitements à visée antalgique, au besoin puissants, dont la médecine dispose à l’heure actuelle. La souffrance, plus subjective, implique l’être dans sa totalité et peut se montrer rebelle à l’apaisement.
Ajoutons que l’iconographie fréquemment associée aux discours sur cette phase particulière de la fin de vie dans les médias est judicieusement choisie pour renforcer le rejet.
Dans un focus plus précis, la multiplication des modifications lexicales destinées à influencer notre manière de concevoir la fin de vie n’est pas sans effet. Et très clairement les mots peuvent acquérir un pouvoir considérable, altérant en profondeur la compréhension de la situation, comme des enjeux.
Cette pression sur le vocabulaire se manifeste de multiples manières, à travers des mots occultés, des mots obscurs, des mots équivoques, des mots trompeurs, des mots-couverture, des mots détournés, des mots imposés, des mots oubliés…
Tandis que l’expression « mourir dans la dignité » est employée comme synonyme de mort administrée, la simple évocation de la « fin de vie » tend à se polariser sur ce seul aspect. En filigrane on laisse ici sous-entendre que les autres morts – c’est-à-dire la quasi-totalité d’entre elles – seraient indignes. Indéniablement, le rapt effectué sur le mot même de « dignité » par l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) en a perverti la compréhension commune ; la perte de dignité s’attache aujourd’hui à décrire le ressenti de la dégradation physique. Or la dignité ne se mesure pas à cette aune. Pour le dire très simplement, la dignité n’est pas liée à l’état du corps ; il n’existe pas de dignitomètre9. Inaliénable, elle est « intrinsèque à l’humanité »10. Notre responsabilité commune est de permettre aux personnes devenues plus vulnérables de ne pas se sentir indignes en raison d’une dépendance accentuée. Si cette usurpation du terme de dignité par l’association qui se l’est approprié est néanmoins remise en question par ses propres membres, son emploi en ce sens réducteur et galvaudé demeure omniprésent. Il serait plus juste de parler ici d’« estime de soi »11.
L’accompagnement lui-même est présenté dans un continuum de soins susceptible d’aller jusqu’à la provocation de la mort. Il y a là un dévoiement majeur de la notion même de soin dans un glissement affirmé. Il est essentiel de revenir à un ancrage dans le réel et de s’appuyer sur les définitions de base.
L’accompagnement de la vie – puisque c’est de cela dont il s’agit – est l’essence même de la médecine palliative, dont l’objectif est la prise en charge des patients atteints d’une pathologie incurable pour leur assurer le meilleur confort possible jusqu’au terme de leur vie. Quel que soit le chemin des derniers moments de la vie, même s’il y a une décision d’arrêt de traitement, les soins ne sont jamais interrompus. Soins qui par nature sont totalement incompatibles avec l’administration de la mort ; parce que donner du soin, c’est se soucier de, apporter de l’attention à la personne jusqu’à son dernier souffle.
La mort provoquée : extension du champ lexical de l’euthanasie et du suicide assisté
Il s’agit essentiellement des cancérologues, des réanimateurs, des gériatres et des palliatologues.
Affaire Pretty c. Royaume-Uni, arrêt de la CEDH du 29 avril 2002 rappelant l’article 2 : « le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement […] ».
Dans le même arrêt Pretty, l’interdiction du suicide assisté pourrait constituer une ingérence dans le « droit au respect de la vie privée » défendu par l’article 8, §2 de la Convention, ce qui a permis aux juristes d’en donner des interprétations fort divergentes.
John Donne, « Meditation XVII », in Devotions upon Emergent Occasions, 1624.
Bruno Dallaporta et Faroudja Hocini, Tuer les gens, tuer la terre, Compagnons éditions, à paraître en mars 2024.
Vladimir Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 3. La volonté de vouloir, 1957, éditions Seuil, coll. « Points Essais », 1980, p. 20.
Axel Kahn, L’ultime liberté ? Plon, coll. « Tribune libre », p.26.
Gènéthique, « Canada : 1 200 euthanasies en plus, 149 millions de dollars de frais de santé en moins », source Global News, Katie Dangerfield, 20 octobre 2020.
Loi du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti.
Comité consultatif national d’éthique, Avis n°121, « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir », juin 2013, p. 42.
Phénomène de contagion décrit par le sociologue américain David Philips en 1982, nommé ainsi en référence au héros de Goethe (dont le suicide fut suivi d’une vague de morts similaires chez les hommes jeunes après la parution du roman). Plusieurs études ont confirmé l’effet incitatif de la médiatisation sur les personnes fragiles.
Les données de l’UNPS (source Observatoire national du suicide, 4ème rapport, juin 2020) indiquent environ 9.000 suicides par an, c’est-à-dire 25 morts par jour et 685 tentatives de suicide, ce qui correspond à plus de 200.000 tentatives chaque année.
Mais l’innovation linguistique la plus spectaculaire est sans conteste la mise en service de la formule « aide active à mourir », déclinaison de l’« aide médicale à mourir » inventée par les Québécois lors de la préparation de leur loi dépénalisant l’euthanasie en 2016. La formule « aide active à mourir », que l’on peut entendre parce qu’« aidante », probablement réconfortante dans sa sonorité, s’est installée dans le langage courant avec une énergie étonnante. La crudité du geste euthanasique s’estompe derrière une aide, et on ne saurait la refuser. Une proposition accueillante, améliorée encore par l’adjonction d’une qualification « médicale ».
La proposition d’aide peut aller plus loin encore : le Québec, qui a dépénalisé l’euthanasie en 2016, propose des groupes interdisciplinaires de soutien (GIS) pour lever les réticences des soignants à la pratique de l’aide à mourir en quelques séances. Il importe de mettre en parallèle le manque criant de formation des soignants à la culture palliative dans notre pays. Redonner à l’aide la place qui lui convient est une priorité.
Plus choquant est l’accaparement de l’expression et sa consécration par un Comité consultatif national d’éthique (CCNE) à distance de sa vocation éthique, qui, dans son avis 139, a ainsi offert aux pro-euthanasie une sorte de présent : l’expression a inscrit officiellement sa marque et, en dépit de son ambiguïté potentiellement dangereuse, devient difficilement contournable12. Usage d’autant plus surprenant qu’il n’est nullement justifié au sein de cet avis, alors que jamais l’expression n’avait été utilisée dans notre pays. L’aide « médicale » est devenue « active », questionnant la possibilité d’une aide passive. Depuis lors, sa propagation est fulgurante, il serait plus juste d’ailleurs de parler de dissémination puisqu’elle s’infiltre en profondeur dans les moindres espaces, entravant toute velléité d’extraction. L’effet propagande a fonctionné pleinement : nombreux sont ceux qui s’en sont emparés, s’y accrochant comme à une bouée de sauvetage, trouvant là la possibilité d’éviter tout mot évocateur d’une réalité que l’on ne veut pas voir.
Cette progression rampante, souterraine autant qu’exponentielle, s’est répandue comme une traînée de poudre jusqu’au sein même du milieu médical, contrastant avec l’opposition majoritaire chez les soignants à toute idée de mort provoquée. La dissociation des représentations joue pleinement, la déconnexion avec le réel s’accomplissant dans l’usage de l’expression réduite à un acronyme (AAM), comme un nouveau mot, une nouvelle chose, une nébuleuse irreprésentable, bien éloignée du geste létal qu’elle cache. Cet accueil positif lié à l’aspect réconfortant de l’expression résonne avec le fonctionnement contemporain de la société où nombre d’individus attendent d’un État maternant qu’il s’occupe de tout, que leur vie soit lissée, sans aspérité aucune.
La volonté d’amalgamer euthanasie et suicide assisté sous un même vocable ambitionne de neutraliser leurs différences pourtant essentielles. Tout d’abord, l’euthanasie impose de transgresser un interdit fondateur de notre civilisation, l’interdit de tuer. Interdit qui concerne tout particulièrement le monde soignant même si, au sein même de ce domaine, les médecins confrontés à la mort13 sont très minoritaires. En outre, ceux-ci interviennent dans des conjonctures hétérogènes selon leur spécialité. Si les palliatologues proposent un accompagnement dans une durée – celle-ci pouvant être plus ou moins longue, selon le moment de la prise en charge – les réanimateurs font face à des tableaux cliniques qui s’inscrivent dans l’urgence. Dans tous les cas, l’activité des praticiens vise à soulager au mieux le patient, quelquefois au prix du raccourcissement de sa vie. Il ne s’agit pas pour autant de provoquer sa mort. Ici intervient le phénomène dit du « double effet », c’est-à-dire que l’obtention du soulagement du patient peut nécessiter l’emploi de doses thérapeutiques plus importantes, dès lors susceptibles d’accélérer la survenue du décès. Dans ces cas, le patient, proche de sa fin de vie ou jusque-là maintenu en vie de manière artificielle, meurt à son rythme. En raison de la proximité du décès, ces actes peuvent être faussement étiquetés « euthanasie ». Rappelons que l’euthanasie est définie par l’intention délibérée de provoquer une mort immédiate. L’inverse, un arrêt de traitement ou la mise en place d’une sédation profonde constituent des actes de bonne pratique clinique, l’intention du praticien étant ici de continuer à assurer le meilleur confort du malade. Il serait d’ailleurs contraire à la loi de poursuivre des traitements devenus inutiles.
Parfois encore ce sont les injections d’antalgiques qui sont accusées d’être des euthanasies déguisées. Si certaines expériences rapportent une quasi-contemporanéité de l’administration du traitement et du décès, cette proximité ne doit pas pour autant être mal interprétée : utilisée dans une intention antalgique, la morphine ne tue pas. Dans un degré interventionniste supplémentaire, il est question d’adoucir délibérément le vocabulaire pour renforcer l’acceptabilité des actes. La mission de rédaction d’un lexique pour « donner du sens aux mots » confiée à Monsieur Orsenna a cependant disparu fort discrètement de l’actualité médiatique.
Le propos serait d’effacer simplement certains mots et de les remplacer par des euphémismes séducteurs. L’expression de « mort choisie » pour nommer les actes de mort provoquée a ainsi été proposée, l’euthanasie s’éclipsant derrière une « mort choisie passive » et le suicide assisté, quant à lui, disparaissant derrière une « mort choisie active ». L’incongruité de ces néologismes était telle qu’ils ont bien vite disparu du nouveau paysage linguistique. L’objectif des pro-euthanasie est d’utiliser tous les moyens pour faire de l’euthanasie une chose simple, douce, souhaitable. Gommer le mot constitue la première étape. L’avant-projet de loi dévoilé par la presse en décembre 2023 y réussit magistralement, introduisant une euthanasie sans jamais en prononcer le nom. Une euthanasie fantôme en quelque sorte et pourtant bien réelle puisqu’il y est écrit que « si la personne est en incapacité physique de s’auto-administrer la substance létale, un tiers peut la lui administrer ». C’est donc bien d’euthanasie qu’il s’agit pourtant.
L’idée d’une « mort choisie » donne l’illusion d’un choix souhaitable, nonobstant le fait que toute mort est et restera une épreuve. Certes, quelques personnalités fortes, dans un contexte sociétal marqué par un individualisme manifeste, vantent les mérites d’une « liberté » de choix. De fait, il ne s’agit pas de « choisir sa mort » puisque celle-ci est naturellement le terme de toute vie humaine, mais éventuellement sa modalité et sa temporalité. Cette « liberté » est ici appréhendée au sens étroit du mot, au cœur du modèle consumériste de la société, qui se traduit par la croyance en une extension presque illimitée des choix possibles auxquels chacun aurait droit. D’aucuns parlent d’une génération « j’ai le droit » mais il semble que ce phénomène se soit étendu plus largement.
Notons que l’affirmation d’un « droit à l’euthanasie » se heurte à une réalité sensiblement différente, tout au moins dans le texte des lois existantes : la loi belge ouvre au « droit à une demande d’euthanasie », ce qui est distinct d’un « droit à l’euthanasie ». La formule subit cependant une interprétation élargie et est généralement comprise comme un « droit à ». Pourtant le droit à mourir n’est pas reconnu non plus par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui défend un droit à vivre14, même si elle évoque aussi un « droit au respect de la vie privée15 ».
Plus précisément, la liberté comme autodétermination – se référant à l’autonomie, « autonomos », au sens de décider par soi-même pour soi-même – est sommée de régir toutes les décisions importantes de la vie. Revendiquée aujourd’hui pour justifier une demande de mort, elle présuppose une forme d’indépendance absolue qui en réalité est chimérique. Nous sommes par nature des êtres interdépendants ; de surcroît modelés par notre histoire personnelle, notre culture, nos liens. Aucun d’entre nous ne peut se prétendre libre de toute influence et d’interférences extérieures, moins encore la personne soumise aux aléas de sa maladie. Pour reprendre la très belle formule de John Donne, « aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est un fragment du continent, une partie de l’ensemble16 ». Évoquer la mort à l’aune de la seule individualité élude ses inévitables implications sociétales. Chacun de nos actes a indéniablement une portée qui dépasse largement la sphère personnelle17. Cette appréhension d’une autonomie qui serait toute-puissante occulte aussi la majoration de la vulnérabilité dans la traversée de la maladie grave et l’attente d’un renforcement de l’attention qui en découle souvent.
Surtout, « la liberté » de demander la mort ne répond pas au critère intrinsèque premier de la liberté, qui est le choix ouvert entre plusieurs possibles – « l’homme libre peut toujours faire autrement : autrement à l’infini », écrit Jankélévitch18 – ; elle apparaît plutôt comme une contrainte, une demande extrême posée en désespoir de cause, devant l’impossibilité d’imaginer une autre solution. En amont de la demande, se décèle souvent une « euthanasie sociale » de la personne malade, celle-ci se vivant comme un poids vis-à-vis de la société. « À l’évidence, l’ultime liberté se situe presque toujours au-delà de la liberté, c’est-à-dire s’exerce lorsque l’on a cessé d’être libre19 », analyse Axel Kahn dans un ouvrage qu’il lui consacre.
Mais la question essentielle est celle du message que la société adresserait aux plus vulnérables en évoquant l’idée d’une « mort choisie ». Il faut n’avoir jamais côtoyé un malade en phase dépressive pour oser le terme. Les médecins savent que toutes les pathologies graves constituent une épreuve violente qui n’est jamais dénuée d’effets psychiques. Parler de « choix » dans une telle configuration est pour le moins une indélicatesse à l’égard des personnes concernées. Comme c’est bien trop souvent le cas, le discours là encore est tenu par des biens portants, qui ne sont pas en situation mais dans une inquiétude projective. Même pour ceux qui ont vu des proches mourir dans des conditions difficiles et inacceptables, il ne s’agit pas d’un vécu à la première personne. Ceux qui traversent personnellement l’expérience sont dans une tout autre disposition. Le choix qu’ils expriment est prioritairement celui d’une prise en charge adaptée de leurs symptômes.
En outre, dire que la mort peut s’appréhender comme un choix désirable revient à en faire un objet de consommation. Le lexique de la mort entre ouvertement dans le registre économique. Un mot généralement effacé dans le domaine qui nous intéresse. Au moins la question de la mort anticipée sort-elle de l’hypocrisie latente, puisque, dès lors, est reconnue la portée majeure de son impact financier sur les orientations politiques. Malgré son soutien appuyé à la cause pro-euthanasie, la MGEN ne s’étend pas sur cette logique comptable. Cependant certains pays ont déjà chiffré les économies réalisées sur le budget de la santé permises par la pratique de l’euthanasie. Le Canada prévoyait ainsi une économie d’environ 149 millions de dollars en 202120. Le voile pudique qui couvre cet angle d’analyse dans notre pays mérite sans doute d’être levé.
Au-delà du danger que constituerait l’abrogation volontaire du mot euthanasie, le vrai problème est celui d’une compréhension souvent erronée de sa signification. Les personnes qui affirment « vouloir choisir leur mort » en se disant favorables à l’euthanasie précisent généralement qu’elles ne veulent pas souffrir, qu’elles ne veulent pas vivre dans l’indignité, qu’elles ne veulent pas « être prolongées »… Or toutes ces situations sont déjà régies par les lois françaises actuellement en vigueur sans jamais qu’il ne soit question d’euthanasie. Tout d’abord, le soulagement de la douleur fait partie des obligations déontologiques du soignant et il est incontestable que les produits comme les techniques antalgiques ont connu d’immenses améliorations ces dernières années.
La dignité quant à elle ne peut en aucun cas être corrélée à un état de santé, ce qui reviendrait à considérer comme indignes la maladie grave, le handicap voire le vieillissement. Pourtant nos représentations nous font craindre la dégradation physique en l’habillant parfois d’une indignité supposée ; plus encore la peur de la mort – toute légitime qu’elle soit – conduit à redouter le chemin qui y mène au point de souhaiter y mettre un terme au plus vite… pour éviter l’affaiblissement qui le marque. La valorisation de la jeunesse et de la performance de notre société s’accorde mal avec les altérations du corps et de l’esprit et voudrait bien les faire disparaître derrière une indignité qui n’existe pas.
Enfin, « prolonger » un patient est illégal : il s’agit d’obstination déraisonnable – autrement dénommée acharnement thérapeutique – légalement prohibée depuis 200521. Lorsque les traitements sont devenus inutiles ou excessifs au regard de la clinique, leur arrêt s’impose. Toujours accompagnée d’une analgésie et au besoin d’une sédation, elle est prise en concertation avec le patient (s’il est en état d’exprimer sa volonté) et/ ou dans le cadre d’une procédure collégiale. Le patient lui-même peut demander un arrêt des traitements, qu’il s’agisse d’une chimiothérapie ou d’un traitement de suppléance vitale. Ici encore, une confusion a été entretenue par l’emploi de termes inexacts, tendant à assimiler l’arrêt des traitements à une euthanasie. Très clairement un arrêt des traitements, trop longtemps abusivement qualifié d’« euthanasie passive », n’est pas une euthanasie. Il n’y a pas ici intention de provoquer la mort, seulement de la laisser advenir tout en assurant le confort maximal du patient. Le cas le plus classique est celui de l’arrêt de la dialyse. Celle-ci intervient lorsque les inconvénients du maintien artificiel de la vie deviennent trop lourds. Décision difficile mais nécessaire, elle fait toujours l’objet d’une concertation entre le patient – son entourage étant informé sauf indication contraire de sa part – et l’équipe soignante. Pour autant les soins ne sont pas interrompus et le patient est accompagné jusqu’au bout avec une prise en charge adaptée. L’euthanasie, elle, est un acte très explicite : c’est l’acte délibéré d’un tiers qui provoque la mort d’un malade ; dit plus simplement, c’est l’injection d’un produit mortel à effet immédiat : une piqûre et la mort. Un arrêt des traitements est un acte de bonne pratique.
L’expression « suicide assisté » a le mérite d’être une terminologie comprise par tous et d’ailleurs formellement retenue par tous les pays qui l’ont dépénalisé. Entérinée et consensuelle malgré sa construction erronée (« suicide » renvoyant à la seule personne concernée), elle est assez claire dans son adéquation à l’acte qu’elle exprime. Dans un avis plus ancien, le CCNE avait envisagé une distinction entre « suicide assisté » et « assistance au suicide » : l’expression « assistance au suicide » consistant à donner les moyens de se suicider, tandis que la notion de « suicide assisté » correspond au cas où la personne qui souhaite mettre fin à son existence n’est pas apte à le faire en raison de son état physique22. Cette subtilité n’a jamais été reconnue et les deux expressions sont indifféremment utilisées dans le même sens de l’existence d’une intervention extérieure.
L’assistance suppose la participation d’un tiers. Cette implication se fait à un degré variable : il peut s’agir de la prescription du produit létal, de sa préparation voire d’une présence au moment du geste. Mais celui-ci doit impérativement être réalisé par le patient lui-même. À défaut, il s’agit d’une euthanasie.
Il est évidemment délicat – c’est un euphémisme – de parler de « mort choisie » pour évoquer le suicide assisté. Chaque année dans notre pays, 9.000 personnes se suicident, seules. Comment expliquer aux familles endeuillées l’action « choisie » de leur proche ainsi décédé, effaçant d’un trait de plume toute la souffrance inhérente au geste ? Au cœur des désordres transgénérationnels, la « mort choisie » du grand-père ne serait-elle pas perçue comme une invitation à faire de même par ses petits-enfants traversant une période troublée ? L’effet Werther, ou suicide mimétique23, pourrait lui aussi être encouragé ; tout particulièrement à l’heure des réseaux dits sociaux, ses effets pourraient être ravageurs. D’un autre côté, les missions de prévention du suicide – que ce soit dans leur dimension médicale ou sociale – ne peuvent qu’être mises en plus grande difficulté encore dès lors que le suicide serait masqué derrière une notion « d’aide à mourir » voire de « mort choisie ». La prévention est bien un vocable oublié du discours ambiant sur la mort provoquée. Rappelons que la France reste le pays d’Europe où l’on déplore le plus grand nombre de suicides24.
L’utilisation du vocabulaire à des fins manipulatoires n’est pas nouvelle. Si l’exercice sophistique n’est pas une exclusivité contemporaine, les glissements sémantiques se révèlent néanmoins particulièrement vertigineux à l’heure actuelle. Aucune euphémisation linguistique ne saurait cependant effacer la réalité des actes. Effectivement, le mot euthanasie évoque l’implacable fait d’administrer la mort, mais ceci est exactement l’acte auquel il correspond. Le maquiller sous une appellation trompeuse « d’aide active à mourir » – accessoirement affublée d’un épithète (« active ») ou d’un autre (« médicale »).
Plus invraisemblable est l’introduction, dans l’avant-projet de loi élaboré sous la férule de Madame Firmin le Bodo, de la notion de « secourisme à l’envers ». La formule a déjà suscité bien des réactions légitimement outrées. Mais elle doit nous interpeller sérieusement sur l’absence de limite à l’égarement lorsque seul le but à atteindre compte, la fin semblant justifier tous les moyens. Ici l’absolue détermination à valider la mort programmée pour tous anéantit purement et simplement tout réalisme. L’idée avancée est de poster derrière la porte de la chambre du patient qui aurait décidé d’absorber un produit létal, un médecin prêt à intervenir pour l’achever s’il ne mourait pas assez vite. Un « secours mortel » donc, l’oxymore reflétant directement l’inimaginable aberration du geste demandé à un soignant.
Avec plus de subtilité mais allant plus loin encore sur le fond, certains intervenants au débat associent soins palliatifs et « AAM », valorisant les premiers pour accroître la confusion et favoriser l’acceptation par incrustation de gestes mortels qui ne disent pas leur nom. L’enrobage est fort bien vu, à la fois diplomatique et populaire, niant l’antagonisme absolu entre ces deux chemins radicalement opposés.
La langue comme pacte fondateur de la communauté
Chaque langue a une histoire ; elle est vivante et évolue au fil du temps, au rythme de la société. La nôtre appartient au patrimoine culturel de tous les Français et nul – quelle que soit sa fonction – ne saurait s’arroger le droit de la modifier volontairement pour convenance personnelle ou par dogmatisme.
La récente inauguration d’une cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts témoigne de la considération qui doit lui être accordée. Elle nous incite à nous pencher sur la célèbre ordonnance signée en 1539 par François Ier dans ce château de l’Aisne. Alors que longtemps, celle-ci a été réputée avoir fait du français la langue officielle de l’État, de nombreux historiens en donnent une nouvelle interprétation. Certes l’objectif du roi était de permettre à tous une réelle intelligibilité des décisions de justice. Mais le texte mentionnait plus précisément le respect de la pluralité des langues de France (« en langage maternel françoys »). Aussi ne s’agissait-il pas d’un instrument d’unification linguistique de la France, qui aurait été ainsi imposée au peuple par voie surplombante, mais bien d’une reconnaissance de son appartenance populaire autant que de la nécessité de sa compréhension par tous.
Plus encore, langage et pensée sont indissolublement liés. Les mots modèlent nos représentations et par conséquent notre réflexion, notre vision du monde, nos projections, jusqu’au sens de notre vie. Et la puissance insidieuse permise par la révision du vocabulaire n’est plus à démontrer.
Dans une temporalité proche et dans la pesanteur du contexte historique de la première moitié du xxe siècle, Orwell et Klemperer, chacun à sa manière, nous ont interpellés sur cette question. C’est à Orwell, dans son roman d’anticipation 198425, que nous devons le terme de « novlangue ». Satyre décrivant un monde fictif, elle reflète pourtant bien des traits d’une réalité alors déjà présente. Viktor Klemperer de son côté analyse concrètement les innovations lexicales progressivement mises en œuvre en Allemagne dès le début des années trente. Tous les deux montrent l’implication directe des transformations linguistiques et l’usage qui en est fait par les gouvernants, qu’il s’agisse de propagande pour leurs intérêts ou de dévalorisation de ceux qui sont la cible du pouvoir. L’efficacité est impressionnante.
Mais cette appropriation du glossaire et sa métamorphose délibérée comporte un risque majeur de glissement. Les leçons de l’Histoire ne peuvent nous laisser oublier « la mort gracieuse » promise par Hitler aux personnes handicapées, dans son redoutable programme T4, la mort étant présentée comme un soulagement.
La tentative de greffe d’un vocabulaire nouveau à laquelle nous assistons actuellement est indigne d’une démocratie. La garantie d’un fonctionnement juste et mesuré des institutions, protecteur du collectif, incombe à l’État.
L’usage de beaux mots, dans ce domaine lourdement empreint d’affectivité, ne saurait transformer la réalité de la fin de vie, même si chacun peut le souhaiter.
On ne peut laisser croire que l’euthanasie est un « soin » alors qu’elle est un acte provoquant une mort immédiate ; qu’elle est une « mort douce » alors qu’elle est presque instantanée et que bien peu d’entre nous sommes assez forts pour assister à la mort en direct de notre proche ; ou encore qu’elle est équivalente au suicide assisté, tous deux réunis dans l’expression « aide à mourir » alors que les deux actes sont tout à fait distincts et que les pays qui permettent le suicide assisté considèrent toujours l’euthanasie comme un meurtre.
Le recours à l’étymologie, euthanatos, la « bonne mort », pour conforter une interprétation lénifiante de l’acte euthanasique, se heurte à un anachronisme patent. La « bonne mort » de l’Antiquité a une signification alors bien différente26, sans lien avec son administration directe. Par ailleurs, l’antalgie, histoire récente à l’échelle de notre humanité a fondamentalement transformé la prise en charge de la douleur. Les progrès récents de la thérapeutique permettent à ce jour de soulager l’immense majorité des patients, ce qui devrait favoriser le maintien d’une « bonne vie » jusqu’à la lisière de la mort.
Des concepts à double sens ?
Jean-Marie Gomas et Pascale Favre, Fin de vie : peut-on choisir sa mort ?, Artège, 2022.
Eu égard au nombre de morts : en 2022, il y a eu 670.000 morts en France.
Corine Pelluchon, Ethique de la considération, Seuil, 2018.
Jacques Ricot, « La vie humaine et la médecine », Esprit, août-septembre 2001.
Éric Fiat, « Maintenant, en quoi l’évolution de notre société rebat les cartes des soins palliatifs ? », 23e journée de la coordination bretonne des soins palliatifs, Saint Brieuc, 2023.
Isabelle Marin et Sara Piazza, Euthanasie, un progrès social ? éd. Feed Back, 2023.
Pascale Favre, « Fin de vie : le clair-obscur des mots et des concepts », Le Figaro, 13 janvier 2023.
Voir ministère de l’Intérieur.
Jacques Ricot, Penser la fin de vie, Presses de lEHESP, 2017, pp. 246-256, qui cite en contre-exemple d’une juste compassion, la fable de La Fontaine « L’Ours et l’amateur des jardins » ainsi que le roman de Zweig, La Pitié dangereuse.
Le discours de présentation du texte à l’Assemblée nationale de Simone Veil est très clair en ce sens.
Chiffres publiés par le ministère de la Santé.
Loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement.
Comme médecin, j’ai bien souvent entendu des confidences de femmes se souvenant encore bien des années après, non sans une profonde émotion, d’une date de naissance qui aurait dû être mais qui n’a jamais eu lieu.
Dans leur détermination à justifier l’euthanasie, certains militants appuient leur démarche rhétorique sur des concepts néanmoins interprétés de manière fort discutable27. Les philosophes de tous temps sont régulièrement conviés à offrir leur soutien. Nous avons déjà évoqué la « dignité », aujourd’hui largement supplantée dans le discours par une « liberté » envisagée comme nous l’avons vu dans un sens appauvri.
L’argument d’une prétendue égalité qui devrait permettre le recours à l’euthanasie à ceux qui le demandent pose question quand près de la moitié des patients n’ont pas accès à la prise en charge palliative alors que leur état le requiert. Pour plus de 150 000 patients chaque année – c’est à dire 400 personnes par jour – cette aide à vivre le temps qui reste est inaccessible.
Revendiquer l’humanisme – souvent associé à la fraternité – pour justifier l’administration de la mort au prétexte qu’elle serait demandée semble aussi aller à l’encontre du sens profond de cette philosophie centrée sur l’humain et les valeurs de solidarité. L’expérience soignante permet d’affirmer, non sans humilité, que la réponse attendue par le patient est souvent bien plus nuancée. Certes les demandes persistantes de mort existent, et un chemin doit être trouvé. Celles-ci, qui restent très marginales28, doivent être traitées de manière personnalisée, sans impacter l’ensemble de la population. L’humanisme nous enseigne encore et toujours le primat de la relation.
– Peut-on vraiment parler de progrès lorsqu’il s’agit de « donner la mort » à une personne vulnérable sans que, trop souvent encore, lui soit offerte la possibilité d’être soulagée convenablement ? L’idée de considérer comme un progrès l’euthanasie d’un patient pour mettre fin à ses souffrances relève d’une bien piètre considération 29 de la personne. Comme le dit Jacques Ricot, « l’euthanasie ne complète pas l’accompagnement, elle le supprime. Elle ne succède pas aux soins palliatifs, elle les interrompt. Elle ne soulage pas le patient, elle l’élimine30 ». Le progrès est ici abâtardi en un progressisme31 oublieux de la condition humaine, qui voudrait pouvoir lisser tout le parcours de vie et s’affranchir de toute contrainte.
La notion de progrès se réfère usuellement aux domaines scientifique ou social, lesquels ne sont pas forcément corrélés au progrès humain. C’est au nom du progrès que l’homme du xxe siècle a multiplié les infractions à l’égard de la nature et perdu tout contrôle sur les effets de son action même. « L’homme mène un combat contre la nature ; s’il le gagne, il est perdu » écrivait Hubert Reeves.
Plus spécialement, le progrès social signifie une amélioration des conditions de vie de chaque personne 32 et plus particulièrement dans le domaine de la santé, les préoccupations actuelles des Français sont d’abord de trouver un médecin traitant ou un accueil en service hospitalier. Si les progrès des techniques et le gain d’efficacité des produits antalgiques depuis ces vingt dernières années sont considérables – ce qui pose d’ailleurs la question de leur limite et du risque d’acharnement thérapeutique – la qualité humaine du suivi est régulièrement mutilée par les exigences administratives et les contraintes économiques.
Un authentique progrès consisterait à organiser la diffusion de la connaissance des lois existantes pour rendre effective leur application sur l’ensemble du territoire et à multiplier les formations à la prise en charge de cette période si particulière de la fin de vie. En effet, nombre de demandes de mort sont imputables à un acharnement thérapeutique, pourtant interdit depuis 2005, ou à une déficience du soulagement. La sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, encadrée par la loi de 2016, reste encore à ce jour mal connue et donc insuffisamment mise en œuvre.
Certains ont même soutenu que l’euthanasie était une question de laïcité, ce qui ne manque pas d’interroger sur la compréhension du mot. La volonté d’attribuer le refus de la mort provoquée aux seules religions, ce qui se révèle d’ailleurs inexact, peut conduire à des contresens surprenants. Dès lors qu’elle se fait laïcisme, la laïcité perd son essence même33. « La laïcité n’est pas une opinion parmi d’autres mais la liberté d’en avoir une34 ».
Enfin, et sans exhaustivité, évoquons un dernier élément fréquemment convoqué pour défendre l’exigence d’une mort provoquée : la compassion, avec une appréhension erronée du mot. La compassion, c’est être touché par l’autre et le soutenir. La proposition de supprimer le malade pour faire disparaître sa souffrance, « par compassion », s’avère être une réaction purement émotionnelle et pour le moins disproportionnée, faisant l’impasse sur la réflexion éthique. Un « bon usage de la compassion »35 doit amener à trouver une juste distance, en soulageant le patient au mieux de ses souffrances, tout en étant conscient que ce passage n’est pas exempt de questions existentielles potentiellement douloureuses.
Avant de clore cette réflexion, il nous semble important de contester un amalgame délibérément entretenu par certains, entre la loi ayant autorisé l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et une loi qui permettrait l’euthanasie. L’invocation de cet argument peut d’ailleurs surprendre car, au-delà du fait qu’on ne peut mettre en parallèle ces deux domaines, l’extension progressive du recours à l’IVG prouve si besoin était que l’encadrement initial, réservé à des circonstances exceptionnelles36, n’a pas permis de garantir le maintien des limites souhaitées par le législateur. En dépit du développement de la contraception, de la facilitation de son accès, de l’amélioration de l’information, le nombre d’IVG s’accroît continument, avec près de 235.000 actes en 202237. La gravité de l’acte est souvent négligée. La légèreté de ton employée il y a quelques mois par certains députés dans le cadre de la loi autorisant un allongement des délais de recours à l’avortement38 contraste avec la narration intime du vécu de nombreuses femmes39. Là encore la question de savoir « d’où l’on parle » est primordiale.
Quant à l’objectif même de la loi, Simone Veil défendit avec beaucoup de courage en 1975 le principe d’une loi de santé publique destinée à protéger la vie des femmes, leur permettant d’éviter les avortements clandestins qui chaque année conduisaient à la mort plusieurs dizaines d’entre elles.
Conclusion
Loi 99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.
Alexis Gales, Ballast 2015/1 n°2 pp.88-97.
Ibid.
Roland Gori, La preuve par la parole, Paris, Dunod 1996.
Les sondages évoqués sont à relativiser, la question fréquemment posée étant de choisir entre des souffrances insupportables et l’euthanasie.
La question de la fin de vie a pris une place grandissante dans les médias depuis ces dernières années, sans commune mesure avec les priorités actuelles des Français. La puissance d’un militantisme pro-euthanasie place son combat sur le terrain de la nécessité.
Certes, le « mal mourir » est une réalité incontestable et inacceptable. Une réflexion sur ce sujet est donc urgente et essentielle pour parvenir à des réponses satisfaisantes. Au fond, et c’est une donnée bien connue, celles-ci dépendent avant tout d’une volonté politique : la loi permettant l’accès aux soins palliatifs pour tous ceux dont l’état le requiert date de 199940 et ses objectifs affichés sont loin d’être complètement traduits dans la pratique. La question financière est d’ailleurs plus pressante que jamais devant l’horizon d’un accroissement inédit du nombre de personnes vieillissantes à très court terme.
La valorisation actuelle des soins palliatifs dans le discours, dans un consensus remarquable, n’est qu’un écran pour faciliter l’acceptation de la mort provoquée présentée dans le même temps.
Proposer l’administration de la mort comme une solution permettant de répondre à la carence de la prise en charge (par insuffisance notable de la culture palliative, pénurie de soignants, manque de formation et indigence des budgets alloués) est une mauvaise solution apportée à un vrai problème. Surtout, tenter de favoriser l’approbation de cette « solution » par le plus grand nombre en modifiant la présentation de la situation à l’aide d’un nouveau vocabulaire, est profondément inconvenant.
Qu’il s’agisse de « l’élimination des mots indésirables » ou de « l’invention de mots nouveaux41 », la métamorphose du langage s’attaque à la pensée elle-même. Le langage traduit une certaine vision du monde, fonctionnant comme un prisme d’entrée vers la réalité42. Le recours à un langage écran, comme neutralisation pour empêcher l’image de ce qui se passe réellement, constitue une véritable manipulation. La perversion vient du glissement d’une forme incarnée du langage à la seule volonté de communication.
Touchant à la racine même de la construction de la réflexion, il en altère tout le cheminement. « L’extrême dépendance de l’humain aux faits de parole et de langage43 » explique le succès d’une véritable fabrique du consentement. L’apparente adhésion d’une majorité de nos concitoyens à une ouverture à l’euthanasie44 doit nous questionner. S’agit-il tout simplement d’une méconnaissance du sens des mots, avec en particulier cet amalgame si répandu entre décision d’un arrêt des traitements et euthanasie ?
S’agit-il d’une réduction de la conception de l’homme à sa dimension biologique effaçant le mystère, contrastant avec la multiplication contemporaine des cheminements ésotériques empruntés par nos concitoyens (dans une amplification inverse à la pratique religieuse) ?
S’agit-il d’un narcissisme engendré par les injonctions de la société refusant toute dégradation physique, éclipsant les personnes qui ont appris à vivre au quotidien avec un handicap ou une maladie chronique plus ou moins invalidante ? S’agit-il d’une méconnaissance des droits qui existent à l’heure actuelle pour chaque personne malade dans notre pays, droit d’interrompre ou de refuser un traitement, droit de bénéficier d’une sédation proportionnée ou profonde selon la symptomatologie ?
S’agit-il de la cicatrice d’une expérience personnelle douloureuse, vécue parfois il y a de très nombreuses années, imputable à une prise en charge médicale déficiente ? S’agit-il enfin de la naïveté de croire en une illusoire promesse de douceur qui ferait disparaître la mort elle-même, douceur des mots qui viendraient effacer la réalité de la mort ?
Aucun lissage lexical n’évitera d’interroger notre choix de civilisation. Il est essentiel que la langue reste enracinée dans le concret pour préserver notre capacité à nous représenter ce dont il s’agit. Certains mots sont durs à entendre, leur abrasion n’effacera pas la réalité de leur signification.



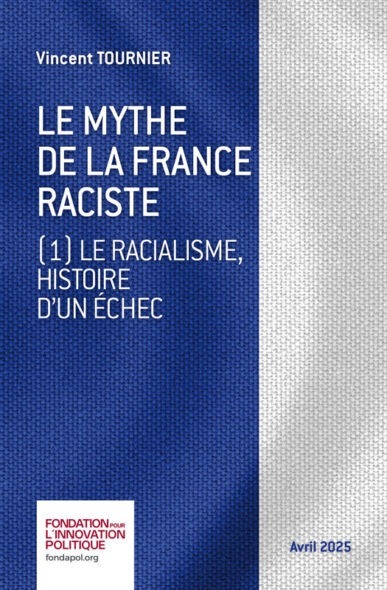









Aucun commentaire.