Crise de la conscience arabo-musulmane
Lorsque la conscience européenne était en crise …
Le monde arabo-musulmano, ce nouvel « homme malade » de l’Occident
Du réformisme à … l’islamisme
Les remèdes à la crise de la conscience arabe-musulmane
Charles de Gaulle, Mémoires de guerre. L’Appel, 1940-1942 [1954], in Mémoires, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 2000, p. 145.
Résumé
Assassinats de masse, enlèvements, guerres, terrorisme et exactions en tout genre semblent être le lot quotidien du Moyen-Orient depuis que cette partie du monde est confrontée à un fléau redoutable. Son nom : l’État islamique en Irak et au Levant. Défrayant chaque jour la chronique, les membres de cette organisation massacrent, sans considération d’âge ou de sexe, tous ceux qui refusent d’embrasser leur interprétation particulière de l’islam. Les minorités religieuses, de rite chrétien, yézidis ou chiites, l’ont appris à leurs dépens. Pour certains observateurs avisés, cette mouvance est le fruit de la politique américaine marquée au coin du bellicisme en Irak. Pour d’autres, ce sont des pétromonarchies du Golfe, cyniques à souhait, qui ont armé puis financé ce groupe afin qu’il déstabilise tel ou tel voisin.
Quant aux fatalistes, ils estiment que l’État islamique en Irak et au Levant n’est, après tout, qu’une nouvelle vicissitude frappant un monde arabe se mourant de consomption depuis des temps immémoriaux. Leur emboîtant le pas, certains considèrent même qu’il faut taire nos scrupules et soutenir les dictatures arabes en lutte contre ces extrémistes religieux car, aussi liberticides soient-ils, ces régimes, dont certains seraient « laïques », nous protégeraient du spectre islamiste…
Et si, en réalité, l’islamisme, dans ce qu’il a de plus radical, n’était pas cette maladie, tant crainte en Occident, mais le symptôme d’un mal plus profond que nous n’aurions pas diagnostiqué, par simplisme, par aveuglement ou tout simplement par ignorance ? C’est de ce mal dont nous allons parler à présent. Un mal que nous avons nommé crise de la conscience arabo- musulmane.
« Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples »
Charles de Gaulle *.
Malik Bezouh,
Physicien de formation, spécialiste de l’islam de France, de ses représentations sociales dans la société française et des processus historiques à l’origine de l’émergence de l’islamisme.
Lorsque la conscience européenne était en crise …
L’évêque Jacques-bénigne bossuet (1627-1704), littérateur, théologien, précepteur du fils de louis XiV, fut une figure incontournable de l’ancien régime. mieux, il l’incarna. de son vivant, il a vu son Église assiégée de toutes parts par des athées, des déistes, des panthéistes et des libertins. les protestants ne furent pas en reste. Par leurs écrits et l’influence qu’ils exercèrent sur les esprits, spinoza, Fontenelle, malebranche et bayle – pour ne citer qu’eux – participèrent à cette entreprise de remise en cause des dogmes catholiques, au grand
dam de bossuet qui, comme de nombreux dévots de l’époque, s’est retrouvé bien démuni pour contrer ces audacieux penseurs qui furent des acteurs majeurs de cette « crise de la conscience européenne ».
Pierre bayle estimait qu’il était illusoire et vain d’essayer de tenir la bride haute à la conscience. aussi appela- t-il les princes et les rois à ne plus punir l’hérétique et l’athée. autre conséquence des « droits de la conscience errante » : l’égale valeur des religions, car toutes les errances de la conscience se valent, dans la mesure, bien évidemment, où celles-ci ne nuisent pas à autrui.
Cité par hubert bost, Pierre Bayle, Fayard, 2006, p. 499.
Cité par Jacqueline lalouette, La République anticléricale, xixe- xxe siècles, seuil, 2002, p. 9.
Cité par Georges minois, Bossuet. entre Dieu et le Soleil, Perrin, 2003, p. 397.
En 1935, l’historien Paul Hazard publiait un ouvrage qui allait faire date : La Crise de la conscience européenne, 1680-1715. Livre majeur dans le champ de l’histoire des idées, il apporta un éclairage sur la manière dont l’Europe, à la faveur de cette fameuse « crise », passa d’une époque marquée par la tradition, l’ordre et la religion à une époque rejetant les dogmes, prônant le «doute méthodique» et appelant à plus de tolérance. Paul Hazard, qui situe cette époque charnière entre 1680 et 1715, illustrait son propos par ces quelques mots révélant l’étendue de la transformation opérée dans toutes les strates de la société française : « La majorité des Français pensait comme Bossuet1 ; tout d’un coup, les Français pensent comme Voltaire : c’est une révolution. » Bref, en moins d’un siècle, la France, comme le reste de l’Europe, est passée d’une ère théocentrique à une ère ouvrant la voie à l’anthropocentrisme.
Pierre Bayle, intellectuel avant l’heure, né en 1647 en Ariège, joua un rôle important, pour ne pas dire fondamental, dans cette évolution sociologique. Philosophe de grande renommée, cet érudit, fils de pasteur, fit scandale en soutenant que la morale et l’athéisme ne sont pas antinomiques. Indignées, les Églises, catholique et protestante, condamnèrent l’impudent. Pur produit de l’humanisme chrétien dans ce qu’il a de plus libéral, Pierre Bayle, qui n’est pas l’ennemi des cultes, tant s’en faut, fut aussi un instigateur des Lumières, de la laïcité et un défenseur opiniâtre des « droits de la conscience errante2 ». Au reste, il ne cessa de militer, au périple de sa liberté maintes fois menacée, en faveur d’une « République des Lettres » permettant une confrontation apaisée des idées contradictoires. Apôtre de la tolérance, il vitupéra contre le fanatisme religieux et les excès du cléricalisme qui affligèrent les protestants du royaume français. Personnage hors du commun, se définissant comme un « philosophe chrétien3 », Bayle a profondément marqué son époque. D’ailleurs, son Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ : «Contrains-les d’entrer», sera considéré comme l’un des écrits les plus importants de cette période charnière pour l’avenir de la pensée européenne. En effet, outre le fait de donner au mot « tolérance » toutes ses lettres de noblesse, cette œuvre contribua au changement de paradigme dont nous avons parlé précédemment. Changement de paradigme qui se caractérisa par l’émergence de nouvelles sacralités : la liberté, l’individualisme, la nation – supplantant la monarchie – et une sécularisation rampante secondée par un anticléricalisme virulent. Au surplus, ne dit-on pas que son Dictionnaire historique et critique, publié en 1697 et interdit en France, a été l’« arsenal des Lumières » ? Critiqué pour son soutien au « tolérantisme » et pour sa trop grande souplesse doctrinale, Bayle s’est aliéné la bienveillance d’une fraction du camp réformé qui lui reprocha d’ouvrir la voie à l’« antitrinitarisme » et au rationalisme. Rongé par la maladie, usé par tous ses combats au service de la tolérance et de la liberté religieuse, ce géant des Lumières, injustement débarqué du train de l’Histoire et de la postérité, s’est éteint à Rotterdam le 28 décembre 1706.
Marchant dans les pas de ce personnage emblématique de la « crise de la conscience européenne », Voltaire, Rousseau, d’Alembert, Diderot, d’Holbach, La Mettrie, Helvétius, etc., à des degrés divers et variés, apporteront leur écot à ce processus complexe qui a propulsé la France – et l’Europe – dans une nouvelle ère : celle de l’anthropocentrisme, où l’homme deviendra la mesure de toute chose, contrairement à l’ère théocentrique durant laquelle c’est la religion qui fixait ses limites et définissait la finalité de son existence ici-bas. Les oppositions de ce que l’on appellera, à tort, les antiphilosophes, n’y feront rien. Parmi eux, citons Élie Fréron, l’irréductible adversaire de Voltaire, et l’abbé Nicolas Bergier, illustre théologien considéré comme l’un des plus grands apologistes catholiques du siècle des Lumières. Tous deux, secondés par les détracteurs du « philosophisme », tenteront vaille que vaille d’endiguer le courant matérialiste au nom d’un « traditionalisme ouvert » conciliant valeurs chrétiennes et progrès. Ils échoueront, après d’âpres combats d’idées, de guerres de plumes mémorables, de controverses et de polémiques traitant de la place de Dieu dans la société. Les vainqueurs, imprégnés de philosophie voltairienne, transmettront à leurs héritiers, les anticléricaux de la IIIe République, cette même volonté d’en découdre avec les tenants du cléricalisme, vestiges humains d’un monde ancien que la philosophie matérialiste et positiviste a engloutis en partie. Vouant aux gémonies ces alliés indéfectibles et opiniâtres de l’Église catholique, Léon Gambetta, en janvier 1876, affirmera : « Ce qui est redoutable, c’est le parti clérical ; voilà l’ennemi4 ! » Face aux coups de boutoirs assénés par les anticléricaux, dont certains élèveront un monument à l’intolérance et au dogmatisme, le parti clérical ne sera pas en mesure d’empêcher l’inévitable : le vote, le 9 décembre 1905, de la loi consacrant la séparation des Églises et de l’État. À la lecture de cette mesure législative, lourde de conséquences, heureuses pour certains, désastreuses pour d’autres, l’on ne peut s’empêcher d’avoir une pensée émue pour Bossuet. En effet, deux siècles plus tôt, celui-ci pressentait qu’un mal profond, puissant, indicible, n’allait pas tarder à se répandre dans toute la société et, par là même, mettre à mal ses fondements traditionnels. Pour lui, l’Église serait la première atteinte : « Je vois une nuée noire et épaisse qui s’élève dans le ciel de l’Église, qu’on aura bien de la peine à dissiper5. » Gardien du temple de l’orthodoxie religieuse, l’évêque de Meaux prononça ces mots en 1699 ; en pleine crise de la conscience européenne. Il ne se doutait pas un instant que celle-ci accoucherait d’une société qui un jour prendrait congé de Dieu…
Si, aujourd’hui, des historiens émettent quelques réserves concernant l’analyse de Paul Hazard à qui il est reproché d’avoir quelque peu négligé les aspects sociaux, économiques et politiques, il n’en demeure pas moins que son étude a contribué, indubitablement, à mieux comprendre une évolution sociétale majeure expliquant, en partie, les représentations actuelles, qui sous-tendent la perception du monde dans nos sociétés occidentales.
Le monde arabo-musulmano, ce nouvel « homme malade » de l’Occident
L’existence et l’unicité de dieu, la croyance en un jour du Jugement dernier, la croyance dans les missions prophétiques d’abraham, de moïse, de Jésus, etc., sont autant d’exemples d’éléments constitutifs de ce dogme musulman.
C’est-à-dire le « modèle » du prophète muhammad.
D’autres versets abordent le thème du « foulard », avec une terminologie différente, à l’image du verset 58 de la sourate 59 (al-Ahzâb).
Littéralement, le mot hijâb, en arabe, signifie « séparation » ou « rideau de séparation ». dans le cadre de la religion musulmane, la grande majorité des exégètes considère que le port du hijâb est une obligation.
Michel abitbol, « Juifs et arabes. mille ans de cohabitation, cent ans d’affrontement », L’Histoire, no 243, mai 2000, p. 40.
Tareq oubrou a été promu chevalier de la légion d’honneur le 1er janvier 2013. la cérémonie de remise a été présidé par m. alain Juppé, maire de bordeaux.
Tareq oubrou, Intégration, laïcité, violences. Un imam en colère, bayard, 2012, p. 93.
Amin maalouf, Les Croisades vues par les Arabes, La barbarie franque en Terre sainte, J’ai lu, 2007.
Littéralement, mu’tazilite signifie « celui qui se met à l’écart du groupe ». la pensée des sectateurs de ce courant musulman a de nombreuses similitudes avec celle du mathématicien-philosophe allemand leibniz (1646-1716). il n’est pas exclu, du moins certains le pensent – c’est le cas du penseur mohamed Charfi – que si la théologie des mu’tazilites l’avait emportée, celle-ci aurait pu semer les germes d’un certain humanisme islamique dont on verrait aujourd’hui les effets positifs.
Mohamed Charfi, Islam et Liberté. Le malentendu historique, albin michel, 1999, p. 134.
La première étant le Coran, la seconde la Sunna.
Cité par mohamed Charfi, op. cit., p. 134.
Présenter les mu’tazilites comme des théologiens « éclairés », apôtres de la tolérance, relève de la cari- cature grossière. Ceux-ci, tout comme les théologiens classiques, n’étaient pas en reste lorsqu’il s’agissait de lancer des anathèmes sur leurs adversaires, voire de les excommunier.
Mohamed Charfi, op. cit., p. 134.
Pierre-andré Taguieff, Le Protocole des sages de Sion. Faux et usages d’un faux, Fayard, 2004.
Voir Éric Geoffroy, L’islam sera spirituel ou ne sera plus, Seuil, 2009, p. 100.
Qu’en est-il de l’Orient ? Et, plus précisément, du monde arabo-musulman ? A-t-il existé un processus équivalent, né en son sein, grâce auquel il aurait accédé à une modernité propre ? Cette question complexe appelle une réponse nuancée. En effet, si crise de la conscience arabo-musulmane il y a eu, celle-ci n’enclencha pas un processus accouchant, plus tard, d’une modernité musulmane endogène. De plus, la structure de cette crise est d’une nature bien différente de celle dont nous venons d’esquisser un tableau. Mais avant de nous enquérir de ce sujet, il importe de donner quelques définitions ayant trait à la religion musulmane.
Le corpus idéologique de l’islam s’articule autour de trois blocs distincts : le dogme6 constitué d’un ensemble de principes immuables tirés des deux sources canoniques, le Coran et la Sunna7, le fiqh représentant les règles juridiques élaborées par les théologiens musulmans – ces règles, issues de l’interprétation des sources canoniques précitées, codifient les pratiques cultuelles et, plus généralement, la vie des musulmans dans les affaires de mariage, d’héritage, etc. – et, enfin, al-ihsân, qui n’est autre que la dimension spirituelle de la religion musulmane la vivifiant. Il faut également dire un mot sur l’ijtihâd : esprit de réforme, l’ijtihâd, telle une bouée d’oxygène théologique, permet d’adapter les règles juridiques – tirées du fiqh – aux réalités et enjeux nouveaux des sociétés majoritairement musulmanes. On peut citer comme exemple l’injonction faite aux femmes musulmanes de se couvrir les cheveux à l’aide d’un voile. Cette disposition n’est pas en soi un principe religieux, c’est-à-dire un point de dogme, mais une jurisprudence découlant de l’interprétation d’un verset coranique. Notons, au passage, que sur les 6.216 versets que renferme le Coran, un seul est consacré explicitement au port du foulard8. Qui plus est, ce verset n’est pas univoque. Des théologiens orthodoxes, et non des moindres, considèrent que son interprétation est sujette à caution. En outre, le port du voile n’est pas à proprement parler un acte cultuel. Il relèverait plutôt de l’éthique musulmane qui impose, aux musulmans et aux musulmanes, le respect du principe de modération en toute chose, y compris dans la façon de se vêtir. Ajoutons qu’il n’existe aucun hadîth ordonnant aux musulmanes de dissimuler leur chevelure à l’aide d’un foulard – en arabe, hijâb9. Enfin, il y a peu, dans un contexte marqué par les « printemps arabes », un théologien égyptien, le cheikh Mustafa Muhammad Rached, de la célèbre et prestigieuse université Al-Azhar, a suscité une vive émotion en soutenant une thèse doctorale dans laquelle il remettait explicitement en cause le caractère obligatoire du port du voile islamique. Nombre d’exégètes, traditionalistes mais aussi réformistes, ont protesté contre l’outrecuidance de ce religieux. Mais pourquoi ce regain de conservatisme alors même que c’est un homme de Dieu, théologien de surcroît – et donc légitimement disposé à émettre des jurisprudences islamiques, appelées fatwa –, qui est à l’origine de cet avis religieux ? Est-ce un rejet délibéré de toute tentative de réforme religieuse, que l’esprit de l’ijtihâd ne réprouve pourtant pas ? À moins que cette controverse cache en réalité une peur profonde, lancinante, celle d’une occidentalisation rampante de la société arabo-musulmane ? Vue de notre France sécularisée et voltairienne jusqu’au bout des ongles, une telle crispation, que l’opinion publique a tôt fait de considérer comme un soubresaut intégriste, étonne et génère si ce n’est de l’inquiétude, du moins des interrogations quant au devenir du monde arabe incapable d’embrasser la modernité. Mais de quelle modernité parlons-nous ? Là est la question.
Cet événement et cette dernière interrogation amènent, tout naturellement, à aborder la crise de la conscience arabo-musulmane dont nous venons de voir, à l’instant même, une illustration. Avant cela, un mot sur la structure de cette crise. Contrairement à la « crise de la conscience européenne » qui s’est déclenchée à une époque bien déterminée – la fin du XVIIe siècle –, la crise de la conscience arabo-musulmane s’est déroulée en trois temps et perdure encore de nos jours. Tentons maintenant d’en comprendre les éléments clés. Pour ce faire, nous allons nous évertuer à décrire ses différentes phases. Entre les VIIIe et XIIe siècles, le monde arabo-musulman, porté par une économie en pleine croissance, a connu un essor culturel sans précédent. Le développement, à l’ombre des mosquées, de diverses disciplines, parmi lesquelles les mathématiques, la mécanique, l’astronomie, l’optique, la chimie, la médecine, la philosophie, mais aussi les arts, la calligraphie, l’architecture et l’urbanisme, témoigne de cette prodigieuse vitalité civilisationnelle. Signalons, et c’est important de le rappeler, que les Juifs, qui vivaient au sein des populations arabo-musulmanes, contribuèrent de façon significative au rayonnement de ce que Michel Abitbol, professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem, nomme la « civilisation judéo-arabe ».
En effet, « de Bagdad à Tolède et du Caire à Tibériade10 » va s’étendre « une resplendissante civilisation judéo-arabe » que de grands penseurs juifs, tels que l’Égyptien Gaon (882-942) et l’illustre Maïmonide (1135-1204) – natif de Cordoue – ou encore Moïse Ibn Ezra (v. 1058-v. 1138) – originaire de Grenade – ensemenceront de leurs savoirs. Hélas, trois fois hélas, le conflit actuel du Moyen-Orient a éclipsé de nos mémoires ce joyau de civilisation humaine.
Mais revenons à la crise de la conscience arabo-musulmane et, plus particulièrement, à sa première phase. On peut considérer que celle-ci débuta lorsque l’ijtihâd cessa d’irriguer la pensée musulmane ; période que l’on peut situer entre le XIIe et le XIIIe siècle. La conséquence immédiate en fut le taqlîd, c’est-à-dire l’apparition d’un conservatisme stérile et rigide empêchant, quand il ne l’interdisait pas, toute lecture intelligente des textes religieux. Les effets du taqlîd, dont l’esprit se caractérise essentiellement par le mimétisme intellectuel, seront désastreux pour la pensée arabo-musulmane tant dans le domaine du profane que du sacré. Rappelons que c’est grâce à cette fermentation des idées religieuses, permises par l’ijtihâd, qu’après le VIIIe siècle des juristes arabo-musulmans, héritiers du grand théologien Abû Hanîfa (700-767) – de la région de Koufa, en Irak –, décrétèrent qu’il était permis à une musulmane de découvrir sa chevelure ! Point de vue que l’imam Tareq Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux11, a fait sien, en partie, en affirmant, aujourd’hui, que le hijâb « ne fait pas partie des obligations religieuses12 ». Le vent de désapprobation qui a soufflé aussitôt sur le malheureux théologien bordelais en dit long sur la prégnance du taqlidisme dans la société arabo-musulmane contemporaine. Mais d’où vient-il ? Comment expliquer la brusque fin de l’esprit de réforme qui féconda le monde arabo-musulman jusqu’au XIIe siècle ? Les causes de ce dessèchement de la pensée arabo-musulmane sont multiples. Tentons de les appréhender. Tout d’abord, il y eut le contrecoup des croisades, mouvement de dilatation de l’Europe chrétienne en Orient, initié par le pape Urbain II en 1095, à Clermont. La première croisade entraîna, on le sait, la chute de Jérusalem, au grand désarroi des Arabes. Pour ces derniers, cette perte fut un cataclysme13. Plus à l’ouest, les régions arabo-berbéro-judéo-musulmanes ne furent pas épargnées par les troubles, à l’image de l’Ifriqiya, territoire englobant la Tunisie et l’Est algérien, gagné par l’instabilité, et d’une partie du Maroc, fragilisée par des luttes intestines. Même constat dans l’Espagne musulmane où les Almohades, dynastie berbère originaire du Haut Atlas marocain, ne parviendront pas à maintenir la cohésion du royaume. Ces divisions, telles des prémices préparant la Reconquista de l’Espagne musulmane, annoncèrent le crépuscule de la civilisation judéo-arabe dans la péninsule Ibérique. À ces déconvenues militaires et politiques, lourdes de conséquences pour le monde arabo-musulman, il convient d’ajouter la terrible destruction de Bagdad – cœur culturel du monde arabo-musulman – et la dévastation de sa grande bibliothèque, en 1258, par les hordes mongoles. Un drame sans précédent pour les musulmans. Outre le fait de signer la fin de la dynastie abbasside, cette catastrophe causa la mort de nombreux penseurs renommés. Menacé de toutes parts, le monde arabo-musulman va alors se recroqueviller théologiquement. C’en sera fait de l’esprit de réforme et de réflexion. Les exégètes traditionalistes, les ashâb al-hadîth, développant une lecture littéraliste des textes sacrés, vont alors peu à peu gagner du terrain au détriment des « rationalistes », les mu’tazilites14. Théologiens hardis, ces derniers firent « de la raison le critère même de la loi religieuse15 » au point de la considérer comme la troisième source canonique16 à partir de laquelle il est tout à fait fondé de s’appuyer pour élaborer de nouvelles règles juridiques. Tel était l’avis du célèbre philosophe arabo-andalou, Averroès, insistant, au xIIe siècle, sur la primauté de la raison sur la Révélation : « Nous affirmons catégoriquement que partout où il y a une contradiction entre la spéculation rationnelle et le sens apparent d’un énoncé du Texte révélé, celui-ci doit être interprété17. » Nuançons quelque peu notre propos en relevant que les mu’tazilites, sur le plan doctrinaire, pouvaient faire preuve, eux aussi, d’une féroce intransigeance18. Il n’en demeure pas moins que, pour les raisons citées plus haut, ils vont s’effacer et laisser place aux tenants du conservatisme rigoriste et stérile. Averroès, tentant désespérément de marier « sagesse et loi religieuse », en fera les frais et tombera en disgrâce. En cause, ses écrits jugés un rien hétérodoxes. Des imams renommés et influents, parmi lesquels l’imam Ibn al-Salâh (xIIIe siècle) et les successeurs de l’imam al-Juwaynî al-Haramayn (XIe siècle) contribueront fortement à ce mouvement général d’appauvrissement, voire d’atrophie, de la pensée musulmane en décrétant que, dorénavant, il convient de se conformer aux avis religieux élaborés lors des siècles précédents par les anciennes écoles juridiques:hanafite(VIIIe siècle),malikite (VIIIe siècle), hanbalite (IXe siècle) et chafiite (IXe siècle). Depuis, ce sont ces écoles qui sont à la source du code musulman dans les pays sunnites. La plupart du temps, leur promoteur, des glossateurs, se contenteront de commenter les commentaires des anciens théologiens traditionalistes, comme le souligna très justement, avec une pointe d’ironie, l’éminent juriste tunisien, Mohamed Charfi, aujourd’hui décédé, qui déplorait la disparition du courant mu’tazilite en ces termes : « Avec l’écrasement des mu’tazilites, c’est l’esprit d’imitation qui l’emport[a] sur l’esprit de réflexion19.»
Là réside la première crise de la conscience arabo-musulmane. Elle est fondamentale et explique, pour une large part, l’absence de courants réformistes durables qui auraient pu sortir le monde musulman de sa langueur intellectuelle alors même, qu’en Occident, l’esprit de Renaissance prenait son envol à l’orée du XVe siècle. Et ce n’est pas le califat ottoman qui inversera cette tendance. Devenus les nouveaux représentants de l’islam sunnite, les Ottomans persévéreront dans cette voie de la fermeture théologique, c’est-à- dire du taqlîd, avec toutes ses funestes conséquences : absence de réflexion profonde relative à la réformation de la pensée islamique, conformisme intellectuel, mimétisme religieux, extinction de l’esprit d’émulation, étendard de la recherche scientifique en berne, etc.
La deuxième crise de la conscience arabo-musulmane est concomitante de l’agonie du califat ottoman. Vermoulu, fatigué, celui-ci n’a pas pris la mesure des évolutions techniques et scientifiques qui ont jalonné l’histoire de l’Occident entre les XVIIe et XXe siècles. Incapable de se réformer, en dépit de quelques vaines tentatives, il ploya sous le poids de ses insuffisances, au grand bonheur des puissances européennes qui ne tardèrent pas à le dépecer. La disparition du califat, cadre politique naturel dans lequel la Umma, c’est- à-dire l’ensemble de la communauté musulmane, était supposée évoluer, a profondément désorienté une fraction de la population musulmane. Celle-ci cultivera le souvenir nostalgique de ce symbole d’unité mais aussi de puissance, de grandeur, que l’Occident, avide de ses terres riches en hydrocarbures – nous sommes, en ce début de XXe siècle à l’ère de la mécanisation, faut-il le rappeler –, aurait détruit. Cette deuxième crise, crise califale, est donc la crise de l’unité arabo-musulmane.
Toutes proportions gardées, et avec la prudence qui s’impose lorsque l’on essaie de raisonner par analogie, la fin du califat ottoman peut s’apparenter, dans une certaine mesure, à la disparition ou, plus exactement, à l’éclatement de la papauté. Si un tel événement s’était produit en 1922 – fin officielle du califat ottoman –, il aurait eu, à n’en point douter, de lourdes répercussions, et ce dans toute l’Europe. Toutefois, ses effets auraient été contenus par le processus de sécularisation engagé en Occident depuis le siècle des Lumières, l’affermissement des États-nations durant toute la Renaissance et l’émergence, à la faveur du gallicanisme triomphant, d’Églises nationales, peu ou prou indépendantes de Rome. Dans l’Orient arabo-musulman, l’éclatement du califat, telle une explosion, a produit divers fragments géographiques, les futurs États arabes, dont les contours, informes, instables, seront dessinés par les puissances anglaise et française, un rien cyniques et intéressées, puis entérinés par les accords Sykes-Picot de 1916.
Cette crise de l’unité perdue – traumatisme que l’on aurait tort de sous-estimer et dont l’Europe précoloniale est, à tort ou à raison, tenue responsable – ne sera pas résorbée par l’avènement de ces États-nations arabes. Et pour cause ! Repaissant d’illusions les masses arabes, le panarabisme postcolonial, professé par des régimes autoritaires, policiers et souvent corrompus, viendra se briser, telle une vague, sur un rocher fait d’échecs politiques, sociaux, culturels mais aussi militaires. À ce propos, on pense, bien évidemment, à Israël gagnant insolemment ses guerres les unes après les autres au grand désespoir de la multitude arabe dont une partie, mâchant son humiliation, épanchera ses frustrations dans un exutoire qui tombera à point nommé pour les gouvernants arabes ravis de voir la colère populaire ainsi détournée : l’antisionisme radical, voire l’antisémitisme… Certains de ces régimes, en particulier d’obédience socialiste, en joueront plus que de raison, dans l’espoir de masquer leurs nombreuses défaillances. Ce faisant, ils donneront une seconde vie au vieil antisémitisme européen du XIXe siècle, agonisant, en diffusant des livres que l’Occident, après la découverte de l’horreur nazie, avait définitivement bannis de ses bibliothèques. L’un d’eux fera florès. Il s’agit du Protocole des sages de Sion20, un faux grossier égrenant, de façon éhontée, tous les préjugés antisémites éculés, en leur faisant la part belle. Ces régimes arabes-là – syrien, algérien, égyptien, libyen, irakien, etc. –, outre le fait de trahir leur peuple en les privant du droit élémentaire de choisir librement leur représentant, ont je ne dis pas insulté mais flétrit la mémoire de la civilisation judéo-arabe.
La troisième et dernière crise de la conscience arabo-musulmane est la plus complexe, la plus aiguë. Diffuse, profonde, elle est une conséquence lointaine de la première crise de la conscience arabo-musulmane, celle du taqlîd. Quant à sa caractérisation, on peut affirmer qu’elle est, à bien des égards, la crise de la modernité. Car cette modernité, fille d’un Occident, jadis chrétien, hier colonisateur, aujourd’hui sécularisé, n’est pas née à l’ombre des palmiers ou des mosquées d’Alep, de Bagdad, de Tunis ou de Fès. C’est une importation. Sans mode d’emploi, sans référence ni mémoire arabo-musulmane. Aucune trace d’un Pierre Bayle, d’un Rousseau, d’un d’Holbach, d’un Diderot, d’un Fréron, d’un Condorcet, d’un Marx ou d’un Freud arabo-musulman qui en aurait esquissé, même d’une plume hésitante, les contours. Rien, du moins en apparence. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement. Aussi, le monde arabo-musulman, cordialement invité à endosser l’uniforme de la modernité qu’il peine à porter, faute de modèle adapté à ses mesures particulières, se trouve dans une sorte de répulsion-attraction vis-à-vis de cette modernité exogène qu’il doit subir. S’en approcher de trop près, c’est prendre le risque de se brûler, tout du moins de se perdre d’un point de vue identitaire ; s’en éloigner, c’est une fuite en avant vers un traditionalisme dépassé, sans issue, faisant fi de toute réalité.
Ce sont ces trois crises de la conscience arabo-musulmane – crise théologique, crise de l’unité et crise de la modernité – qui alimentent, en partie, l’extrémisme musulman contemporain. Extrémisme qu’une approche «juridiste» de l’islam développée au détriment de sa dimension spirituelle ou soufie a amplifié21. En partie seulement, disions-nous, car la radicalité de ceux que l’on désigne sous le vocable d’islamistes est aussi une conséquence du despotisme des élites dirigeantes arabes parvenues au pouvoir après les indépendances.
Du réformisme à … l’islamisme
En réalité, de nombreux « Pierre bayle » sont apparus en terre d’islam. ils n’ont hélas pu se maintenir. le conservatisme religieux, secondé par l’oppression politique, a eu raison d’eux. Citons par exemple mahmûd muhammad Taha, un soudanais exécuté en 1985 pour ses positions politiques et religieuses jugées « héré- tiques », ou nasr hamid abû zayd (1943-2010), un Égyptien forcé de s’exiler à cause de son livre Critique du discours religieux, qui déchaîna les foudres des gardiens du temple de l’orthodoxie religieuse.
Le terme « takfirisme » a pour racine le mot KFR (kâfir avec les voyelles), qui signifie, littéralement, « celui qui cache ou dissimule la vérité », consciemment ou pas. Par extension, c’est celui qui fait acte de rébellion envers son Créateur bienfaisant, dieu. Pris dans le sens commun, un kâfir est celui qui nie l’existence de dieu. un takfiriste est donc un anti-kâfir extrême.
Une étude conduite par le Centre international pour l’étude de la radicalisation (iCsr), en collaboration avec BBC World, a établi que plus de 80% des victimes de ce que l’on appelle communément le djihadisme mondial sont musulmanes.
Cité par le cheikh al-’utaybî, Le Takfirisme, al-hadîth Éditions, 2012, p. 16.
Que ce soit en Algérie, avec Boumédiène, en Égypte, avec Nasser, en Irak, avec Saddam Hussein, en Tunisie, avec Ben Ali, en Libye, avec Kadhafi, au Maroc, avec Hassan II, ou en Syrie, avec Hafez el-Assad, pour ne citer que ces exemples, les élites arabes dirigeantes importèrent, de façon autoritaire, des Constitutions calquées, à des nuances près, sur des modèles occidentaux marxisant ou libéraux, en prenant soin de jeter aux orties les libertés individuelles et politiques. Pour se maintenir au pouvoir, elles useront sans vergogne de la terreur. Dès lors, des pans entiers de la population arabe, dans leur for intérieur, eurent le sentiment, amer, que si la colonisation effective avait bien cessé, il n’en était rien de la colonisation idéologique. Cela alimentera leurs ressentiments et cristallisera le rejet de ces régimes perçus comme des succursales de l’URSS ou de l’Occident libéral. Aussi faut-il voir l’islamisme de l’ère postcoloniale, porté par les successeurs du fondateur de la confrérie des Frères musulmans fondée en 1922 par Hassan al-Bannâ, comme une réaction aux politiques jugées trop éloignées des références islamiques ancestrales. Quant à l’islamisme lui-même – en particulier celui professé par la confrérie des Frères musulmans –, il n’est que le prolongement lointain et conservateur du courant réformiste musulman, celui-là même qui tenta de relancer la machine de l’ijtihâd, seule capable de revivifier un monde arabo-musulman dépérissant depuis le XIIIe siècle. Impulsé au XVIIIe siècle par un précurseur, Muhammad al-Shawkânî, yéménite chiite dénonçant à cor et à cri les effets tragiques du taqlîd et l’immobilisme politique contraire au principe de la consultation, al-shûrâ, et au XIXe siècle par les illustres penseurs Jamâl al-dîn al-Afghânî, Muhammad Abduh et Rachid Ridâ, ou encore, au XXe siècle, par Malek Bennabi, ce courant, vecteur d’un renouveau musulman né dans un contexte marqué par la domination coloniale, essaiera de résoudre la première crise de la conscience arabo-musulmane : celle de la fermeture théologique, et ce afin de libérer la pensée réformiste emmurée dans le taqlîd. Par ricochet, cela aurait pu solutionner l’autre crise de la conscience arabo-musulmane, celle de la modernité. Mais, dans un contexte colonial, pareille entreprise fut délicate à réaliser. Au milieu d’un XXe siècle décolonisant, leurs successeurs, imprégnés de la pensée de ces réformistes mais positionnés sur un terrain nettement plus politique et conservateur, souhaiteront s’affirmer à leur tour. Ces gens-là, que l’on nommera plus tard en Occident « islamistes », se heurteront à la violence des régimes arabes qui réprimeront, souvent de façon impitoyable, leur tentative d’organiser au sein des sociétés arabes un début d’opposition politique. Hassan al-Bannâ, à la fois soufi et conservateur, fut la figure emblématique de ce courant-là. Notons, toutefois, que son organisation, celle des Frères musulmans, ne peut en aucun cas être considérée comme héritière du courant rationaliste- islamique, le mu’tazilisme, tant s’en faut ! Ni même comme réformiste, bien que certains de ses leaders s’en réclament. Leur attachement sans bornes à l’orthodoxie religieuse, attachement respectable en soi, place de fait cette mouvance dans le grand courant historique du conservatisme musulman, celui-là même qui, naguère, hostile au mu’tazilisme, le combattit et le vainquit.
Il en ressort que le réformisme musulman, balbutiant au XVIIIe siècle, raffermi au XIXe siècle, et son prolongement à caractère politique, l’islamisme du milieu du XXe siècle, un rien conservateur, tous deux apparus dans des contextes radicalement différents, l’un colonial, l’autre postcolonial, peuvent être vus comme des réponses imparfaites à la crise protéiforme de la conscience du monde arabo-musulman. Ces crises ont été effroyablement aggravées, durant tout le XXe siècle, par l’absence de débat à l’intérieur de ces sociétés-là. Les pouvoirs en place, en confisquant la parole citoyenne, en étouffant toute tentative de discussion démocratique, en écrasant systématiquement les oppositions, par la violence, la torture et le crime politique, n’ont pas permis l’émergence durable de Pierre Bayle musulmans22 et, par voie de conséquence, l’éclosion de courants islamico- rationalistes d’inspiration néo-mu’tazilite – délestés de leur intransigeance religieuse – rompant avec le conservatisme religieux. Pis encore : la politique ultrarépressive de ces régimes a favorisé l’apparition, dans les années 1970, du takfirisme23, courant musulman extrémiste, inquisiteur et porteur d’une violence exacerbée, qu’un pluralisme démocratique arabe aurait pu absorber puis dissoudre dans la confrontation des idées si on avait laissé à ce pluralisme la possibilité de s’exprimer. Car la culture démocratique ne se décrète pas, mais elle s’apprend, se renforce, se cultive, pour devenir, au gré des alternances politiques, cette sève ardente et civilisatrice qui infuse dans toute la société l’acceptation de l’altérité qu’elle soit politique, philosophique ou religieuse. Mais de tout cela, hélas !, le monde-arabo-musulman en a été privé. Les régimes arabes, foncièrement antidémocratiques, ont, de ce point de vue-là, une très lourde responsabilité. Les chancelleries occidentales sont loin d’être exemptes de tout reproche. En soutenant, parfois ouvertement, ces modes de gouvernance marqués au coin du despotisme, elles ont contribué, sans le vouloir, à faire resurgir, des tréfonds de l’histoire arabo-musulmane, ce mouvement éminemment fanatique, le takfirisme, qui ne connaît que le rapport de force brutal. Par essence sectaire, ce courant rompt radicalement avec la longue tradition du réformisme islamique du fait même de sa nature extrémiste, agressive et déviante. À ce propos, les exégètes musulmans, de quelques sensibilités qu’ils fussent, ont de tout temps condamné sans ambages cette idéologie mortifère. Sans nous perdre dans des considérations par trop complexes, relevons que l’excommunication – suivie de la mise à mort du musulman24 jugé trop libéral – est au cœur de la pensée takfiriste. Apparue dès les premiers siècles de l’islam, elle fut considérée comme la première grande hérésie islamique. Piétinant allègrement les principes de la religion musulmane, ses émirs hérésiarques excitèrent l’odieux fanatisme de leurs affidés afin qu’ils anathémisent et assassinent ceux et celles qui n’embrassaient pas leurs querelles. L’un des plus grands théologiens de l’école hanbalite, l’inflexible Ibn Taymiyya (1263-1328), vitupéra contre les tenants de cette secte à tout le moins dangereuse : « Les hérétiques kharijites, rafidites, qadarites, jahmites et anthropomorphistes ont une conviction égarée qu’ils pensent juste. De plus, ils considèrent que leurs opposants sont des mécréants25. »
Là encore, ce serait pécher sinon par ignorance, ou du moins par simplisme, que de mettre sur un même pied d’égalité réformistes musulmans d’antan, islamistes de la première génération et takfiristes d’aujourd’hui. Cela reviendrait à renvoyer dos à dos l’illustre penseur Jamâl al-dîn al-Afghânî, débattant savamment avec le philosophe Ernest Renan, et Oussama Ben Laden, ci-devant chef d’un groupe criminel et terroriste ! Notons, enfin, que le GIA algérien, al-Qaida, les talibans et les sectes islamistes subsahariennes dérivent, peu ou prou, de ce courant takfiriste. En ce qui concerne l’État islamique en Irak et au Levant, organisation d’obédience takfiriste elle aussi, son irruption spectaculaire sur la scène moyen-orientale doit beaucoup aux désastreuses interventions américaines en Irak et à la gouvernance catastrophique du premier ministre irakien, aujourd’hui déchu, Nouri al-Maliki, qui consacra la dramatique confessionnalisation du pays. Cette organisation funeste trouve aussi ses ressorts dans le jeu trouble des puissances régionales la soutenant un jour pour mieux la défaire le lendemain, et ce au gré d’intérêts géopolitiques complexes, intriqués et fluctuants. Au surplus, l’effondrement du bloc soviétique favorisant l’émergence d’un monde unipolaire, aux coudées franches, sous domination américaine, menant des guerres « préventives » dans un Moyen-Orient instable, peut être considéré comme un autre facteur d’incubation takfiriste. Quant à son succès auprès d’une frange minoritaire de la jeunesse musulmane européenne, cela mériterait une réflexion particulière qui ne sera pas entamée ici. Notons tout de même que l’État islamique en Irak apporte une réponse – ô combien démente ! – aux trois aspects de la crise de la conscience arabo-musulmane.
En effet, à la crise théologique et à la crise de la modernité, il offre à ses partisans une lecture takfiriste de l’islam, lecture grossière et dévoyée des textes sacrés permettant de transformer l’autre, l’infidèle fantasmé, en un exutoire dans lequel pourra s’épancher tout le mal-être de ces âmes à la dérive, en quête de Dieu sait quel idéal. Quant à la crise de l’unité perdue, Daech propose, ni plus ni moins, la restauration du califat islamique au cœur même du berceau de la civilisation arabo-musulmane : Bagdad, la Rome musulmane, qui fait palpiter le cœur de millions de musulmans à travers le monde. Relevons ici que ni l’horrible guerre civile algérienne, ni le conflit bosniaque, mettant pourtant aux prises des chrétiens orthodoxes serbes et des musulmans sunnites bosniaques, ni même ce qui s’est passé en Tchétchénie, durant les décennies précédentes, ne suscita un tel engouement chez la jeunesse musulmane européenne en perte de repères. Cela pose de nombreuses interrogations auxquelles nous répondrons en disant que les candidats français au djihad, issus de l’immigration maghrébine, sont à l’interface de deux crises : celle de la conscience arabo-musulmane, bien entendu, et celle de la France, en proie à des difficultés de tout ordre – sociales, économiques, morales, identitaires… – et assumant, non sans difficulté, son arabo-islamité, élément constitutif de sa nouvelle identité.
Les remèdes à la crise de la conscience arabe-musulmane
La conscience du monde arabo-musulman est donc en crise. Crise de la fermeture théologique, de l’unité et de la modernité. L’islamisme conservateur du début du XXe siècle, s’inspirant des courants réformistes qui émergèrent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, doit être considéré comme une tentative de traitement de cette triple crise en usant d’outils élaborés à partir d’un référentiel purement musulman. Confronté à des régimes arabes ne souffrant aucune opposition politique, l’islamisme en sera réduit à la clandestinité. Et c’est à l’ombre de ces régimes arabo-musulmans, érigeant le despotisme et la terreur policière en principes de gouvernance, que des excroissances cancéreuses de l’islamisme se sont développées dans la seconde moitié du xxe siècle. Elles donneront naissance au takfirisme contemporain, dont al-Qaida et l’État islamique en Irak et au Levant sont de sinistres représentants.
Il n’existe cependant aucune fatalité. Car le takfirisme, quoi qu’en disent les théoriciens du choc des civilisations, est un courant plus que marginal dans le monde arabo-musulman. Quant à la crise protéiforme de la conscience arabo-musulmane qui alimente en partie ce courant-là, elle ne peut être résorbée que par une et une seule façon : l’avènement d’une démocratie musulmane renouant avec l’ijtihâd, avec la pensée islamico-rationaliste et le principe de consultation : al-shûrâ. Cette démocratie ijtihadiste, consultative et rationaliste, jetant les bases de la démocratie musulmane, reconnaîtra à tout un chacun, comme le signifiait Pierre Bayle, le droit à une « conscience errante ». Cela impliquera, entre autres, le droit à l’athéisme, à l’apostasie, et la fin de la criminalisation civile de l’homosexualité, chantier resté bien trop longtemps en souffrance. Car Dieu, par principe juste, ne saurait punir, dans Son infinie miséricorde, la pulsion homosexuelle alors même qu’Il l’a insufflée dans celui qui en est porteur. Ce type de débat et bien d’autres encore pourraient tout à fait prendre place dans un cadre islamico- rationaliste, c’est-à-dire néo-mu’tazilite. En revanche, ils ne pourront en aucune façon se tenir dans des régimes arabes despotiques contribuant, chaque jour que Dieu fait, au délitement de la conscience arabo-musulmane et, par ricochet, au développement anarchique de métastases takfiristes. N’est-il pas venu le temps, pour les démocraties occidentales, de cesser de soutenir, pour des intérêts à courte vue, ces régimes malades dont le maintien favorise, à terme, l’apparition du cancer takfiriste ? À quand une diplomatie durable encourageant les forces vives et citoyennes seules capable de traiter, de l’intérieur, cette crise profonde et protéiforme de la conscience arabo- musulmane ? Gageons qu’avec le maintien de telles politiques étrangères, le takfirisme, proliférant sous les tapis dorés des dictatures arabes, a de beaux jours devant lui. Quant aux bombardements occidentaux, ici et là, en Irak ou ailleurs, s’ils sont indispensables pour freiner l’avancée des « islamopathes » de l’État islamique et pour protéger des minorités religieuses en danger de mort, ils ne peuvent en aucun cas constituer une solution viable et durable à long terme. Qui peut raisonnablement penser que l’on peut traiter la crise profonde et complexe de la conscience arabo- musulmane de cette façon-là ? C’est poursuivre une chimère que de le croire. Seule la démocratie musulmane, ijtihadiste, consultative, favorisant débats, controverses et autres polémiques, peut en venir à bout en accouchant de penseurs musulmans de la stature de Pierre Bayle, prêchant sans craindre la fureur du despotisme politique ou l’hydre du conservatisme religieux. Se déployant dans des sociétés arabes, enfin débarrassées de leur tyran, ces derniers, d’obédience néo-mu’tazilite ou soufie, réfléchiront, avec leurs frères agnostiques, athées, et religieux, à l’élaboration d’une laïcité musulmane qui passe, non pas par une séparation, mais par un éloignement de l’État et de la religion. Quant à la distance séparant lesdites institutions, ce sont les citoyennes et les citoyens arabes qui la définiront, après, n’en doutons pas, d’interminables et houleux débats. Telle doit être l’issue de la crise de la conscience arabo-musulmane : une laïcité arabo-musulmane endogène, s’appuyant sur les travaux des grands « rationalistes » musulmans de l’âge d’or de la civilisation judéo-arabe et des maîtres de l’islam soufi tentant sans relâche de libérer l’islam de sa gangue « juridiste » pour en faire jaillir sa substance première : la spiritualité 26. Privé de son moteur, l’islamisme radical et belliqueux – le takfirisme étant la pire de ses facettes –, tel un marais que l’on aurait cessé d’irriguer, s’asséchera et mourra de sa belle mort.

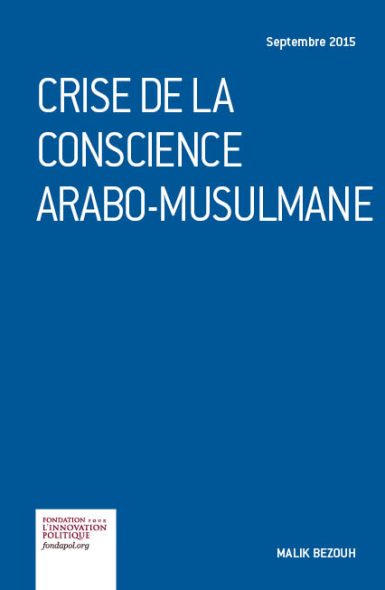
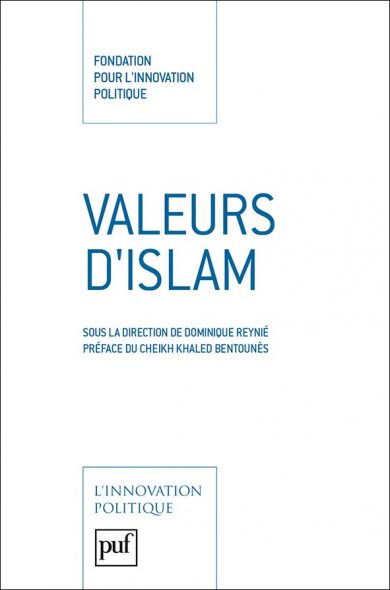
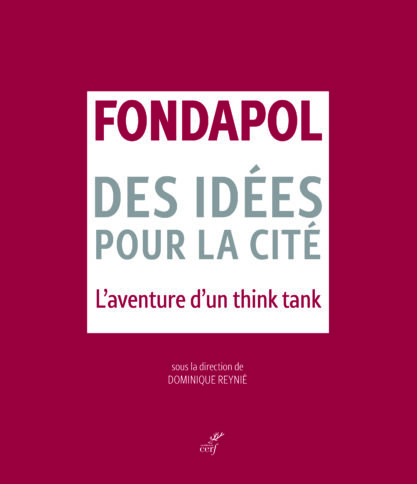



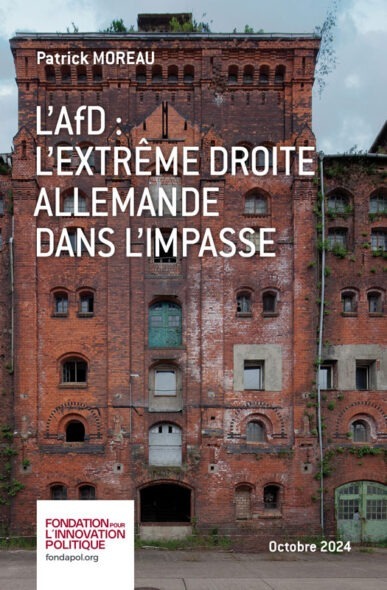






Aucun commentaire.