Introduction
L’histoire d’une scission
La succession du Prophète et les fondations de l’islam
Le drame de Karbalâ’ et la formation du chiisme
L’émergence du sunnisme
Un livre, un prophète, deux islams
Corpus scripturaires sunnite et chiite
Les dogmes
Les pratiques cultuelles et les fondements du droit
Les divisions internes du chiisme et du sunnisme
Les divisions du chiisme
Les divisions du sunnisme
Désignations et justifications de la guerre
Du rapprochement (taqrîb) à l’anathémisation (takfîr)
Les spectres de la « chiitisation » et de l’« arc chiite »
Résumé
Il est devenu urgent de comprendre la scission interne à l’islam, son origine et sa nature. Cette séparation remonte aux fondations de l’islam : la succession contestée du Prophète et les guerres civiles successives ont déterminé l’émergence d’une majorité, plus tard appelée sunnite, et de minorités chiites. Un différend qui ne se réduit pas à des questions de pouvoir et de personnes mais porte sur l’interprétation même de la Révélation. Sunnites et chiites partagent le même livre et le même prophète, mais leur foi en eux est profondément différente. Ils partagent aussi les cinq grands rituels de l’islam, mais leurs pratiques diffèrent également, tout comme leur droit religieux. Sunnisme et chiisme ne sont pas non plus deux blocs monolithiques opposés mais comprennent chacun une diversité interne. Si les écoles juridiques sunnites restent proches, les courants chiites sont des confessions différentes.
| Les traductions des versets du Coran proposées dans ce texte sont extraites de l’édition : Le Coran, trad. Denise Masson, Gallimard, 1967, rééd.1980. |
Le chiisme majoritaire, vénérant une lignée de douze imams, est la religion officielle de l’Iran depuis le XVIIe siècle mais ne saurait être pris pour un islam iranien opposé à un islam sunnite arabe. Il a connu une évolution complexe, d’une spiritualité apolitique à une politisation encore discutée en son sein. Voués à coexister depuis le début de leur histoire, chiites et sunnites ont développé les uns envers les autres bien des discours de guerre et de paix avant que l’extrémisme sunnite anti-chiite ne gagne récemment une audience considérable et meurtrière. La perspective d’une « paix obligée » n’en est pas moins réaliste, soutenue par les ressources d’un islam spirituel partagé depuis toujours, souvent sous le nom de soufisme, par des chiites et des sunnites, comme par celles de l’intelligence politique.
| Le conseil scientifique de cette note a été assuré par Éric Geoffroy, islamologue à l’Université de Strasbourg. |
Mathieu Terrier,
Professeur de philosophie, docteur en sciences religieuses et chercheur associé au Laboratoire d’études sur les monothéismes.
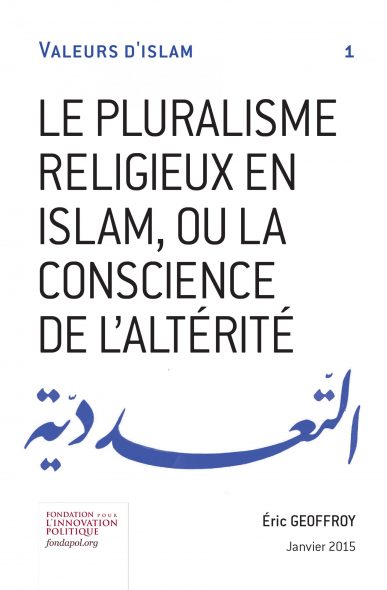
Le pluralisme religieux en islam, ou la conscience de l'altérité
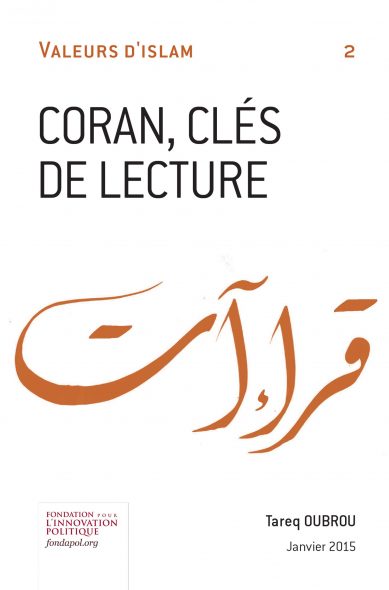
Coran, clés de lecture
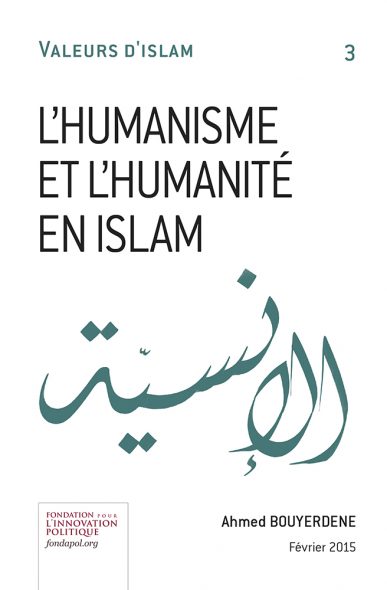
L'humanisme et l'humanité en islam
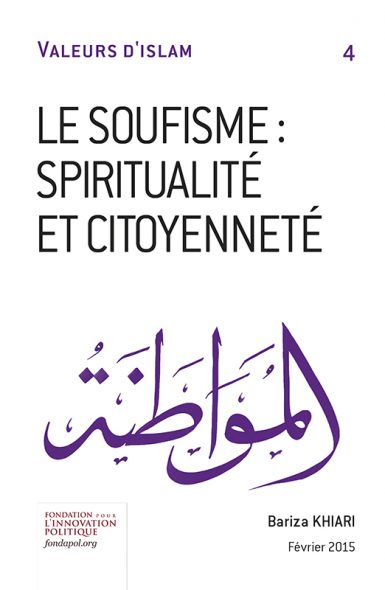
Le soufisme : spiritualité et citoyenneté

Islam et contrat social
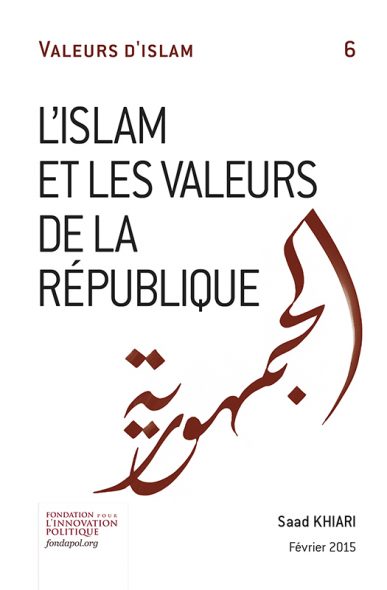
L'islam et les valeurs de la République
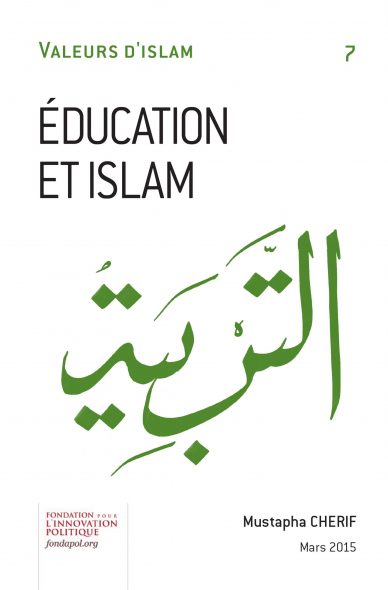
Éducation et islam
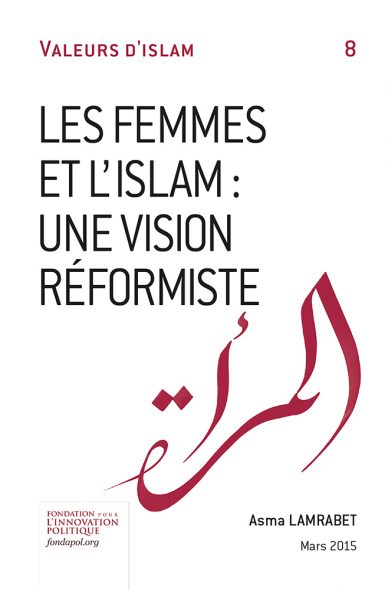
Les femmes et l'islam : une vision réformiste
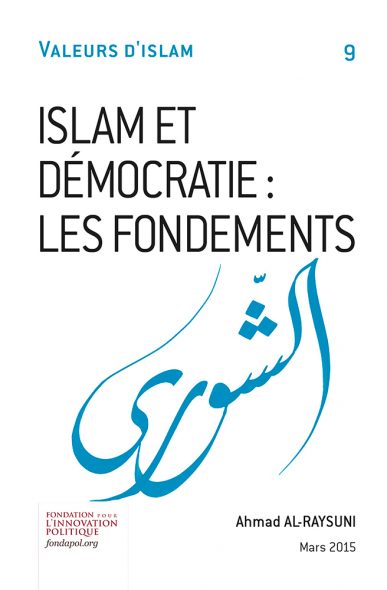
Islam et démocratie : les fondements
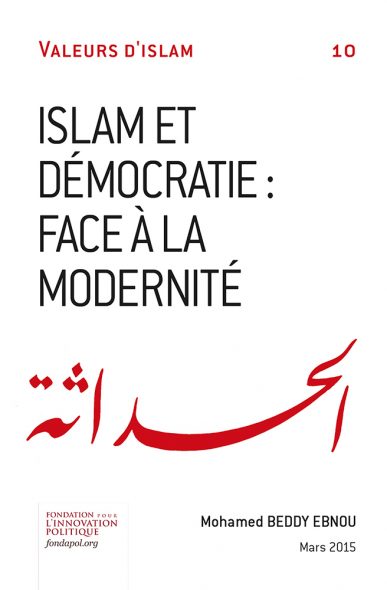
Islam et démocratie : face à la modernité
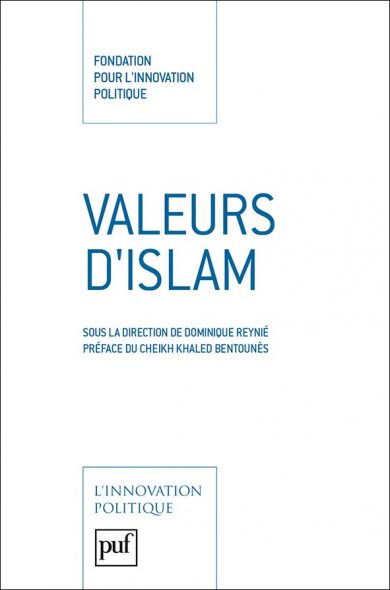
Valeurs d'islam
Introduction
Chiffres approximatifs en l’absence de statistiques fiables dans beaucoup de Les chiites duodécimains comptent entre 150 et 180 millions de fidèles, les ismaéliens entre 15 et 20 millions, et les zaydites près de 5 millions.
Après avoir longtemps perçu l’islam comme un tout monolithique, l’opinion occidentale tend aujourd’hui à le voir comme contradictoire, déchiré par la « guerre fratricide » des chiites et des sunnites. Ce nouveau schéma tend autant à conforter le préjugé d’un islam foncièrement violent qu’à occulter les autres lignes de partage traversant les mondes musulmans, qu’elles soient sociales ou politiques. Il est donc plus que jamais nécessaire d’éclairer ce qui sépare mais aussi ce qui rapproche les deux grands courants de l’islam que sont le chiisme et le sunnisme. Leur affrontement est-il inévitable ? La paix entre eux est-elle impossible ?
C’est avec la révolution islamique iranienne de 1979 que l’islam chiite est apparu sur la scène politique internationale : considéré jusque-là comme une secte hérétique à l’influence négligeable, le chiisme devint soudain le nom de l’islam le plus fanatique. Deux décennies plus tard, l’organisation Al-Qaïda s’imposait par le terrorisme comme le principal ennemi de l’Occident au nom de l’islam, cette fois sunnite et wahhabite, radicalement hostile au chiisme. Le conflit entre sunnites et chiites s’est exacerbé en 2003, après l’invasion de l’Irak par l’OTAN. Il s’est imposé comme une dimension de l’actuelle guerre en Syrie sans avoir été à l’origine de la contestation du régime. Il a motivé l’émergence fulgurante de l’autoproclamé « État islamique en Irak et en Syrie » (al-dawlat al-islâmiyya fî al-‘Irâq wa al-Shâm, abrégé en arabe Da’ish), avatar d’Al-Qaïda. Il a pris récemment un nouveau tour militaire au Yémen, avec l’engagement sans précédent de l’Arabie saoudite wahhabite contre les houthis zaydites – d’une branche du chiisme – soutenus par l’Iran. Ce conflit est toujours latent en Arabie saoudite, où vit une minorité chiite marginalisée (10%) à l’est du pays, et plus encore au Bahreïn, où la majorité chiite (70%) est marginalisée et réprimée par la dynastie sunnite au pouvoir avec l’appui saoudien et dans l’indifférence de l’Occident.
Comprendre la scission interne à l’islam est donc devenu une urgence. Ce pourrait être chose faite depuis longtemps si l’islamologie occidentale n’avait pas eu tendance à identifier l’islam dans son ensemble au courant majoritaire sunnite. Or l’influence des courants minoritaires dans l’histoire culturelle de l’islam est bien plus forte que leur poids démographique respectif, et même en s’en tenant aux données quantitatives, le vécu et les croyances de plus de 200 millions de chiites, entre 15 et 20% des musulmans du monde, ne peuvent être insignifiants1. Il importe donc de ne pas confondre l’islam et le sunnisme, ni le sunnisme et le wahhabisme, mais de comprendre le lien constitutif du sunnisme avec le chiisme, tout comme il importe de ne pas confondre le chiisme et le khomeynisme, l’idéologie du fondateur de la République islamique d’Iran, mais aussi de comprendre la diversité interne du chiisme et son lien constitutif avec le sunnisme. Aussi présenterons-nous les racines historiques de la scission, les différences dogmatiques entre sunnisme et chiisme, puis leurs divisions internes, afin d’aborder la question de la guerre ou de la paix entre les deux branches de l’islam.
L’histoire d’une scission
La succession du Prophète et les fondations de l’islam
Mohammad Ali Amir-Moezzi, Le Coran silencieux et le Coran parlant, CNRS Éditions, 2011.
Hichem Djaït, La Grande Discorde, Gallimard, 1989, 57-61.
Mohammad Ali Amir-Moezzi, cit., p. 27-61.
Lucia Veccia Vaglieri, « Ghadîr Khumm », in Encyclopédie de l’Islam 2, II, Brill, 1015-1017.
La césure du sunnisme et du chiisme remonte à la période des fondations de l’islam, à des événements sur lesquels les récits des sunnites et des chiites divergent radicalement. Sur cette période, l’islamologie s’est longtemps confinée à l’étude de la seule tradition majoritaire sunnite, l’histoire écrite par les vainqueurs. Ce n’est que depuis peu que la recherche a pris en considération les sources chiites anciennes, notamment grâce aux travaux de Mohammad Ali Amir-Moezzi2.
Le conflit entre protochiites et protosunnites, comme on peut appeler les deux groupes politico-religieux dont l’évolution allait faire le chiisme et le sunnisme d’aujourd’hui, naît avec la succession du prophète Muhammad à la tête de la communauté des croyants. D’après les sources sunnites, généralement reprises par les historiens modernes, le Prophète ne laissa aucune instruction à ce sujet. Après sa mort, en 632, la désignation d’Abû Bakr comme calife ou « successeur de l’Envoyé de Dieu » (khalîfa rasûl Allâh) se serait faite par élection entre les anciens compagnons mecquois du Prophète et leurs auxiliaires médinois, sans opposition majeure3. Le premier calife s’illustra en réprimant le mouvement d’apostasie d’une partie des musulmans. À sa mort, en 634, ‘Umar Ibn al-Khattâb, compagnon du Prophète et artisan de l’élection d’Abû Bakr, prit le titre de calife et initia les grandes conquêtes musulmanes (futûhât) qui allaient constituer en une vingtaine d’années un véritable empire. Après son assassinat, en 644, ‘Uthmân Ibn ‘Affân fut désigné comme calife et poursuivit l’œuvre de son prédécesseur avant d’être lui aussi assassiné à l’issue d’un soulèvement, en 656. ‘Alî Ibn Abî Tâlib, cousin et gendre du Prophète pressenti dès son vivant pour lui succéder, accéda alors au califat pour un règne marqué par le combat contre des rébellions internes qui se solda par son assassinat en 661. Les sunnites voient dans ces quatre hommes les dignes successeurs du Prophète et les vénèrent sous le titre de « califes bien guidés » (al-khulafâ’ al-râshidûn).
La mémoire chiite de l’histoire est toute différente. Loin d’être une construction tardive, elle est consignée dès le VIIIe siècle dans des livres qui furent interdits par les autorités sunnites, dissimulés par les savants chiites et ignorés par l’islamologie occidentale4. À la mort du Prophète, des musulmans soutenaient le droit exclusif de ‘Alî à sa succession, d’où leur désignation comme ses « partisans » ou « chiites » (shî‘a). Pour eux, ‘Alî était d’abord le premier homme à avoir cru au message du Prophète alors qu’il n’était qu’un enfant ; le Prophète lui avait donné sa fille Fâtima en mariage et il avait donné au Prophète deux petits-fils, Hasan et Husayn, qui étaient sa seule descendance mâle ; enfin, Muhammad l’avait désigné comme maître des croyants après lui au retour de son « pèlerinage d’adieu » à La Mecque, en 6315. Les chiites n’ont jamais reconnu la légitimité des trois premiers califes et leur version de la succession du Prophète contredit le récit d’une transition consensuelle. Elle fait état d’un véritable complot de ‘Umar et d’Abû Bakr pour évincer ‘Alî, mais aussi de violences mortelles commises contre la fille du Prophète Fâtima pour obtenir l’allégeance de ‘Alî à Abû Bakr. Le divorce mémoriel touche ici à son comble : pour les chiites, les premiers « califes bien guidés » des sunnites sont les auteurs de crimes majeurs contre la volonté divine, tandis que la fille du Prophète est la première martyre de la vraie foi.
La personne de ‘Alî semble avoir toujours suscité autant d’hostilité que de vénération, comme le révèle la brève période de son califat. La bataille de Siffîn (657), qui vit s’opposer ses armées et celles de Mu‘âwiya, gouverneur rebelle de Syrie, fut la plus sanglante des débuts de l’islam. ‘Alî fut contraint d’accepter un arbitrage qui déboucha sur un apparent statu quo et un échec politique pour lui. Une faction de ses partisans se retourna contre lui, que l’on appela les khâridjites (littéralement « ceux qui sortent »), et l’un d’eux finit par l’assassiner. Mu‘âwiya se proclama calife avec succès, obtenant même l’allégeance de Hasan, fils aîné de ‘Alî et deuxième imâm (« guide ») des protochiites. Pour les sunnites, ‘Alî reste le quatrième « calife bien guidé » et les Omeyyades ont laissé le souvenir d’un pouvoir corrompu sans être illégitime ; pour les chiites le règne de ‘Alî fut le seul pouvoir absolument juste que connut l’islam et la dynastie des Omeyyades représente son usurpation par les ennemis des amis de Dieu.
Le drame de Karbalâ’ et la formation du chiisme
Après la mort de Hasan et celle de Mu‘âwiya en 680, Husayn, le troisième imâm des chiites, refusa de prêter allégeance à Yazîd, fils de Mu‘âwiya. Sur la route de Kûfa, où il espérait peut-être prendre la tête d’un soulèvement, lui, sa famille et ses compagnons – une centaine de personnes, probablement – furent encerclés par l’armée omeyyade dans la plaine de Karbalâ’ et tués sans pitié. Ce massacre eut comme première conséquence l’émergence du chiisme comme mouvement politico-religieux dépassant les frontières claniques. Il est à l’origine d’une martyrologie particulière au chiisme, s’exprimant chaque année depuis le drame de Karbalâ’ dans l’impressionnant rituel de commémoration de ‘Âshûrâ.
Le chiisme s’est rapidement divisé et nous ne suivrons pour l’instant que le courant devenu majoritaire, appelé imâmite ou duodécimain, aux douze imâms. Après la mort de Husayn, son fils réchappé du massacre perpétua la lignée des imâms, désormais héréditaire. Ces imâms successifs se désistèrent de toute prétention politique pour se vouer à l’enseignement spirituel, fondant la théologie chiite. Ainsi le sixième imâm, Ja’far al-Sâdiq (m. 765), reconnu par les sunnites comme un grand savant de son temps, conserva le plus strict quiétisme quand la révolution abbâsside mobilisa les aspirations chiites pour renverser les Omeyyades. Les derniers imâms suivants vécurent et enseignèrent sous la persécution. Après la disparition du onzième, en 874, la thèse prévalut que son fils unique s’était caché pour échapper aux ennemis. Le douzième imâm aurait continué de communiquer à ses fidèles par le biais de représentants jusqu’en 941, date à laquelle il annonça qu’il entrait désormais en occultation complète et ne se manifesterait plus qu’à la fin des temps « pour remplir le monde de justice et d’équité comme il l’était d’injustice et d’oppression ». C’est le dogme, proprement axial en chiisme duodécimain, de l’occultation (ghayba) et du retour (zuhûr) du douzième imâm.
L’émergence du sunnisme
Claude Gilliot, « La représentation arabo-musulmane des premières fractures religieuses et politiques (Ier-IVe/VIIe-Xe siècles) et la théologie », in Thierry Bianquis, Pierre Guichard et Mathieu Tillier (dir.), Les Débuts du monde VIIe-Xe siècle, PUF, 2012, p. 137-159 (voir notamment p. 156).
Josef van Ess, Prémices de la théologie musulmane, Albin Michel, 2002, 114.
Gautier A. Juynboll, « Sunna », in Encyclopédie de l’Islam 2, IX, Brill, p. 913-917.
Le sunnisme peut être considéré comme le dernier venu des groupes politico- religieux de l’islam6. Les partisans des trois premiers califes défendaient surtout, à l’encontre des vues légitimistes et réformistes chiites, un certain pragmatisme politique et un attachement aux valeurs traditionnelles. L’expression ahl al-sunna wa al-jamâ‘a, « les gens de la tradition et de la communauté », aurait d’abord été choisie par les partisans de Mu‘âwiya contre ‘Alî à la bataille de Siffîn, mais les sunnites donnèrent ensuite raison à ‘Alî dans le conflit. Comme le précise Josef van Ess, l’une des premières définitions techniques des ahl al-sunna à la fin du VIIIe siècle était « ceux qui rejettent toute insurrection et font la prière derrière le représentant du calife, qu’il soit juste ou injuste7 ». Mais c’est à l’époque abbâsside et dans le cadre d’une querelle théologique que se constitua le « parti de la tradition », tenant d’un strict respect des prescriptions du Prophète conservées dans les hadîth, opposé au rationalisme des mu‘tazilites. Après la brève et violente domination de ceux-ci, les positions des traditionalistes triomphèrent au milieu du IXe siècle et le parti majoritaire s’appropria l’expression d’ahl al-sunna wa l-jamâ‘a8. Tout comme l’appellation de « chiites » renvoie au « parti de ‘Alî », toujours minoritaire, celle de « sunnites » est donc liée à la formation d’un courant majoritaire au sein de l’islam. Alors que les chiites ont été désignés comme « ceux qui refusent » (al-râfidûn), les sunnites se définissent comme ceux qui comptent, avec le Coran et la Sunna du Prophète, le consensus de la communauté (ijmâ‘) comme fondement de la loi religieuse.
Un livre, un prophète, deux islams
Corpus scripturaires sunnite et chiite
Régis Blachère, Introduction au Coran, Maisonneuve & Larose, 1959 ; Alfred-Louis de Prémare, Aux origines du Questions d’hier, approches d’aujourd’hui, Téraèdre, 2004.
Mohammad Ali Amir-Moezzi, op.cit.
Le plus important des recueils canoniques est le Kitâb al-Kâfî d’al-Kulaynî (m. 940). Parmi les livres attribués aux imâms, citons le Nahj al-balâgha, ensemble de prônes et de maximes attribué à l’imâm ‘Alî, très apprécié aussi en milieu Sur les sources chiites anciennes, voir Mohammad Ali Amir-Moezzi, Le Guide divin dans le shî‘isme originel. Aux sources de l’ésotérisme en islam, Verdier, 1992, p. 48-58.
Sunnites et chiites fondent également leur théologie et leur jurisprudence sur le Coran et le Hadîth. Mais leur relation au Coran et leur définition même du Hadîth sont profondément différentes.
On sait qu’à la mort de Muhammad, le Coran n’existait pas à l’état de livre, mais que les différents fragments de la Révélation avaient été retenus par cœur par les compagnons du Prophète. Les sunnites attribuent au calife ‘Uthmân l’initiative d’avoir désigné une commission pour rassembler ces fragments et constituer une version unique du Coran, aboutissant à la vulgate que nous connaissons, divisée en cent quatorze sourates qui ne suivent pas l’ordre chronologique de la Révélation9. Pour comprendre le Livre, les sunnites constituèrent différentes « sciences coraniques » : la grammaire, l’exégèse, les « circonstances de la révélation » (asbâb al-nuzûl) et, surtout, la science du Hadîth, l’ensemble des dires attribués au Prophète. En matière d’exégèse, les théologiens sunnites s’attachèrent surtout à une lecture littéraliste du Coran, laissant à Dieu seul l’interprétation des versets équivoques, tandis que les philosophes comme Ibn Rushd/Averroès (m. 1198) et les mystiques comme Ibn ‘Arabî (m. 1240) en développèrent une lecture allégorique ou ésotérique. La seconde source scripturaire des sunnites est donc l’ensemble des actes et des dits du Prophète rassemblés sous le nom de Hadîth. Sous les premiers califes, ces traditions ne circulaient qu’à l’oral. Le besoin d’établir un code juridique et moral précis, joint à la vénération du Prophète comme modèle d’imitation, persuada de les collecter à l’écrit. On s’aperçut vite de l’incertitude de nombreux témoignages ainsi que des inventions manifestes forgées dans le but de soutenir des intérêts politiques. Les savants examinèrent les chaînes de transmetteurs pour déterminer la valeur des traditions. Quelques grands recueils de hadîth tenus pour « sains » (sahîh) devinrent canoniques, comme ceux de Bukhârî (m. 870) et de Muslim (m. 875). Malgré la rigueur dont firent preuve les savants sunnites du Hadîth, celui-ci ne peut être tenu pour une source historique probante sur les débuts de l’islam, surtout avec l’existence d’un Hadîth chiite différent. C’est pourquoi il s’avère impossible d’écrire une biographie scientifique du Prophète et d’arbitrer scientifiquement le litige historique entre sunnites et chiites.
Les positions des chiites ont beaucoup évolué vis-à-vis du Coran « officiel10 ». Les sources chiites les plus anciennes rapportent que ‘Alî, après l’élection d’Abû Bakr, avait rassemblé tout le Coran dans un livre qu’il fut empêché de produire devant la communauté. Ce Coran « originel », trois fois plus volumineux que l’actuel, aurait été conservé par les imâms et occulté avec le douzième. La vulgate imposée par les ennemis des imâms contiendrait de nombreuses omissions – des mentions de ‘Alî et de la sainte famille du Prophète, mais aussi des adversaires de Muhammad – et peut-être même des ajouts. Sous la persécution, l’immense majorité des chiites ont fini par abandonner la thèse de la falsification du Coran pour développer une conception ésotérique du Livre. Mais ils tiennent toujours celui-ci pour « muet » sans une herméneutique qui en dévoile le sens caché ou intérieur, laquelle ne peut être l’œuvre que de l’imâm. L’idée que le texte coranique possède une signification littérale exotérique et une signification spirituelle ésotérique est partagée par le chiisme, la mystique soufie et la philosophie ; elle semble être née dans le chiisme, puisque le plus ancien commentaire ésotérique du Coran est attribué à l’imâm Ja’far al-Sâdiq. L’exégèse chiite du Coran se distingue en mettant la sainteté de l’imâm et la fonction de l’imâmat au centre du message divin.
Comme les sunnites, les chiites tiennent le Hadîth pour l’autorité scripturaire après le Coran. Mais ne reconnaissant que les dires du Prophète transmis par les imâms et considérant toutes les paroles de ceux-ci comme également sacrées, ils ont constitué un corpus de hadîth tout autre que celui des sunnites. La mise à l’écrit de ces hadîth commença dès le VIIIe siècle, sous la conduite même des imâms, leur position minoritaire faisant de la conservation de leur enseignement une question de survie pour la communauté. Les recueils de hadîth imâmites, contenant des milliers de pages, forment une immense exégèse spirituelle du Coran et de la vie du Prophète, où les données juridiques sont relativement réduites. Outre quatre recueils canoniques, plusieurs ouvrages attribués aux imâms eux-mêmes sont vénérés par les chiites presque à l’égal du Coran11.
Les dogmes
Ibid., p. 155-173.
Henry Corbin, En Islam I, Gallimard, 1971, p. 219-284.
Mohammad Ali Amir-Moezzi, « Dissimulation tactique (taqiyya) et scellement de la prophétie (khatm al- nubuwwa) », Journal asiatique, 302, no 2, 2014, p. 411-438.
Souâd Ayada, L’Islam des théophanies. Une religion à l’épreuve de l’art, CNRS Éditions, 2010, 65-190.
Christiane Gruber, « Between logos (kalima) and light (nûr) : representations of the prophet Muhammad in islamic paintings », An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, vol. XXVI, octobre 2009, p. 229-262.
La différence originelle du chiisme et du sunnisme ne se réduit pas à un conflit pour le pouvoir politique. Les divergences doctrinales sont considérables et pourraient remonter à l’époque même du Prophète, dans les différentes perceptions et interprétations de ses paroles et de ses actes par ses compagnons. C’est d’abord sur la question de l’imâmat, la « guidance » de la communauté après le Prophète, que la doctrine chiite se distingue, tant au sujet des personnes légitimes pour l’exercer que de son fondement et de son étendue. Pour les sunnites, cette direction n’est pas spirituelle mais uniquement politique, nul n’étant infaillible en matière religieuse après le Prophète ; aussi le chef est-il désigné ou légitimé par le consensus de la communauté. Les sunnites emploient le terme de « calife » pour désigner le détenteur du pouvoir politique et celui d’« imâm » pour qualifier un dirigeant religieux, puis un desservant de mosquée, sans sacralité particulière. Les chiites ont une tout autre conception de l’autorité. Ils tiennent d’abord que chaque prophète législateur de l’histoire était accompagné d’un imâm voué à perpétuer la religion après lui. Ils soutiennent que la direction de la communauté musulmane après Muhammad ne pouvait revenir qu’à un homme impeccable choisi par Dieu et désigné par son Prophète, et que cet homme était ‘Alî. Ils ne reconnaissent pas un mais quatorze « impeccables » : le Prophète, ‘Alî, Fâtima et onze mâles de leur descendance. Ils considèrent l’autorité de l’imâm comme étant en droit spirituelle et temporelle, religieuse et politique. Mais après la défaite de Karbalâ’, les imâms chiites développèrent une conception apolitique de l’imâmat comme autorité purement spirituelle, fondée sur une science infuse et distincte du califat temporel12.
La notion de walâya, désignant la sainteté des imâms et leur élection divine, constitue le dogme spécifique du chiisme. Entendue comme l’amour des croyants dû aux imâms, la walâya est pour les chiites l’un des « piliers de l’islam », en plus des cinq partagés avec les sunnites : la profession de foi, les cinq prières quotidiennes, le jeûne du ramadan, l’aumône et le pèlerinage à La Mecque. Cette notion de walâya comme intimité avec Dieu et autorité spirituelle sur les hommes se retrouve dans la mystique sunnite du soufisme. Les soufis attribuent la walâya à de nombreux maîtres spirituels n’ayant pas de lien généalogique avec ‘Alî et le Prophète ; ils conçoivent la sainteté non comme une pré-élection héréditaire mais comme une adoption par Dieu obtenue par la voie initiatique et l’effort personnel. Cette proximité entre chiisme et soufisme est à l’origine d’une rivalité toujours vive autour de l’autorité spirituelle et de sa légitimation, ce pourquoi les soufis ont subi des persécutions sur l’une de leurs terres d’origine, l’Iran, depuis que le chiisme y est devenu religion d’État au début du XVIe siècle.
Une autre différence doctrinale majeure entre chiisme et sunnisme concerne le statut du prophète Muhammad et de son message. Le Coran disant de lui qu’il est « le sceau des prophètes » (33, 40), les théologiens sunnites professent qu’il était le dernier des prophètes et que la révélation coranique constitue la fin de l’histoire de la prophétie. Les chiites ne nient pas que Muhammad soit le dernier prophète législateur, mais soutiennent qu’au cycle de la prophétie législatrice succède le cycle de l’imâmat qui en est le dévoilement ésotérique13. Des hadîth des imâms affirment que le dernier d’entre eux, à son retour, restaurera toutes les Écritures antérieures falsifiées, nommément la Torah, les Psaumes, l’Évangile et le Coran. Plus encore, ils attribuent aux imâms des puissances au moins égales à celles des prophètes. La continuité de la prophétie dans l’imâmat est l’une des positions chiites les plus vilipendées par les hérésiographes, juristes et prédicateurs sunnites. À l’heure où la sacralité du Prophète est devenue un repère identitaire particulièrement sensible des musulmans dans le monde, c’est une doctrine que les chiites tendent à dissimuler14.
Liée aux précédentes, une autre différence fondamentale touche à la relation de Dieu aux hommes. La théologie sunnite tient Dieu pour absolument transcendant, sans commune mesure avec sa création. Le chiisme, tout en situant l’Essence divine au-delà des limites de la connaissance, conçoit l’imâm comme une manifestation humaine de Dieu, sans qu’il s’agisse d’une incarnation au sens chrétien, et la véritable foi comme passant par l’amour et la connaissance des imâms. Le soufisme, notamment celui d’Ibn ‘Arabî, est encore proche du chiisme quand il pense « l’homme parfait » (al-insân al-kâmil) comme une manifestation de Dieu en l’homme. Échappant à la dichotomie du sunnisme et du chiisme, une autre distinction apparaît là entre un islam abstrait, d’une part, refusant toute manifestation de la transcendance dans l’homme et sur terre, et un islam théophanique, de l’autre15. Celui-ci est partagé entre chiisme et sunnisme, et les wahhabites, fanatiquement attachés au monothéisme abstrait et à la dogmatisation de la figure du Prophète, ne s’y trompent pas qui n’ont de cesse d’accuser ensemble chiisme et soufisme d’« associationnisme » (shirk). Soulignons, enfin, une attitude différente relativement à l’image. Si en islam sunnite l’iconoclasme s’est généralement imposé, les chiites, eux, n’ont cessé de représenter leurs « quatorze impeccables », y compris le prophète Muhammad16.
Une dernière différence des doctrines sunnite et chiite concerne l’appréhension de la fin des temps. La tradition sunnite annonce la venue finale d’un homme nommé al-Mahdî, à l’identité inconnue, combattant « l’Imposteur » (al-dajjâl) et préparant le retour de Jésus-Christ. Traditionnellement, l’attente du Mahdî n’est pas au centre de la foi sunnite, mais on relève une nette recrudescence du messianisme en milieu sunnite, notamment wahhabite, depuis quelques décennies. Les chiites, eux, ont toujours identifié le Mahdî à leur douzième imâm, dont Jésus-Christ sera l’auxiliaire lors du jihâd final contre les forces de l’Imposteur. Depuis la grande occultation de l’imâm, l’attente de son retour comme Sauveur eschatologique est au cœur de la foi chiite. Un messianisme aussi vivace chez les tenants d’un chiisme politique, cherchant à préparer le retour de l’imâm, que chez les tenants d’un chiisme apolitique, se bornant à l’attendre avec patience.
Soulignons, enfin, que les termes d’« orthodoxie » et d’« hérésie » n’ont jamais qu’un sens relatif en islam, qui ne connaît pas de magistère doctrinal analogue à l’Église catholique. Des thèses aujourd’hui tenues pour « orthodoxes » par les savants sunnites comme par des islamologues semblent ainsi avoir été formulées à l’encontre de doctrines plus anciennes, souvent chiites, tenues a posteriori pour « hétérodoxes ». Or les chiites sont tout aussi convaincus de représenter la véritable « orthodoxie ». Et si le sunnisme s’est construit en réaction contre le chiisme, l’inverse est également vrai : de l’imâmisme originel au chiisme actuel, l’évolution fut profonde et déterminée par la confrontation avec la majorité sunnite. Par pragmatisme ou par conviction, les doctrinaires chiites duodécimains ont progressivement adopté nombre de dogmes sunnites, comme l’intégrité du Coran, le sceau de la prophétie et la supériorité du Prophète sur l’Imâm, jusqu’à rejeter comme « extrémistes » les positions du chiisme originel, toujours conservées sous le manteau de nombreux mollahs. En dépit de ce rapprochement historique, la différence doctrinale entre sunnisme et chiisme reste bien plus profonde qu’entre catholicisme et protestantisme. Ces deux théologies diffèrent au point que l’on pourrait parler de deux religions différentes si elles ne s’étaient pas définies l’une par l’autre et ne se référaient pas toujours, in fine, à la même Révélation.
Les pratiques cultuelles et les fondements du droit
Yann Richard, L’Islam chi’ite ? Croyances et idéologies, Fayard, 1991, 189-212.
Par-delà les différends historiques et théologiques, sunnites et chiites partagent les grands rituels appelés « piliers de l’islam ». Mais, là encore, des différences sont notables. Les chiites attestent, dans leur profession de foi, la walâya de ‘Alî en plus de l’unicité de Dieu et de la prophétie de Muhammad. Dans la prière, lors de la prosternation (sujûd), ils posent leur front sur un cachet de terre de Karbalâ’. Au pèlerinage de La Mecque, ils tiennent pour une obligation l’exécration rituelle des premiers califes, ce qui génère bien des tensions avec les wahhabites, actuels « gardiens des lieux saints ». Là où les deux courants sont présents, chiites et sunnites ont généralement des mosquées séparées.
Les chiites considèrent comme une obligation religieuse et une source de bénédiction la visite rituelle (ziyâra) aux lieux de repos des imâms et de leurs familiers, notamment à Najaf et Karbalâ’, en Irak, ou à Mashhad, en Iran. Les pratiques dévotionnelles autour des tombes et les demandes d’intercession (tawassul) adressées aux saints sont caractéristiques du chiisme. Elles se retrouvent aussi dans le soufisme, avec de nombreux mausolées de saints au Maghreb, en Égypte ou en Iran. Expression de la croyance en la walâya, le culte des saints est un autre point commun du chiisme et du soufisme sunnite, vilipendé par les sunnites radicaux comme une hérésie contraire à la tradition du Prophète. Ainsi les wahhabites saoudiens ont-ils détruit, dans le cimetière al-Baqî’ de Médine, tous les mausolées de personnages vénérés par les chiites, dont ceux de Fâtima et de plusieurs imâms. L’opposition, une fois encore, n’est pas là entre sunnisme et chiisme, mais entre un courant sunnite minoritaire intégriste, tenant d’un monothéisme abstrait, et un islam spirituel et populaire, sunnite ou chiite, cultivant un rapport vivant à la sainteté.
Dans le domaine du droit musulman, la différence principale entre sunnisme et chiisme concerne la place donnée à l’« effort personnel d’interprétation de la loi » (ijtihâd). Le droit religieux sunnite est fixé dans ses grandes lignes depuis la constitution des quatre grandes écoles juridiques au IXe siècle, bien que de grands savants comme Ibn ‘Arabî (m. 1240), Ibn Taymiyya (m. 1328) ou Muhammad ‘Abduh (m.1905) aient revendiqué l’ijtihâd à travers les siècles pour produire de nouveaux avis juridiques. Dans le chiisme réformé après la période des imâms historiques, l’effort personnel d’interprétation du savant reconnu par ses pairs, appelé mujtahid, ne cesse de faire évoluer le droit, y compris politique. Selon la doctrine du chiisme clérical, récusée par certains savants chiites, tout croyant doit suivre, dans ses affaires religieuses et sociales, la direction religieuse d’un mujtahid de haut rang tenu pour « modèle d’imitation » (marja‘ al-taqlîd), qu’il est libre de choisir.
Le clergé chiite se distingue donc de l’Église catholique, à laquelle il est parfois comparé, en ce qu’il y coexiste plusieurs autorités souveraines dont le mode d’émergence dépend largement des croyants eux-mêmes. Parmi les particularités du droit chiite, jugée scandaleuse par d’aucuns, la possibilité de contracter un mariage dit « de plaisir » (mut’a) engageant l’homme et protégeant la femme pour une durée déterminée17. En Iran, le droit chiite est devenu beaucoup plus favorable aux femmes grâce aux efforts de l’avocate Shirin Ebadî : une femme mariée est aujourd’hui en mesure de faire valoir son droit au travail, mais aussi au divorce et à la garde des enfants.
Les divisions internes du chiisme et du sunnisme
La grande coupure du sunnisme et du chiisme, à l’origine d’une immense littérature polémique, masque des divisions internes à chaque courant. Leur prise en compte est nécessaire au dépassement d’une vision dichotomique et simplificatrice de l’islam.
Les divisions du chiisme
Farhad Daftary, A History of Shi‘i Islam, B.Tauris, 2013, p. 145-174.
Ibid., p. 105-144.
Ibid, p. 175-190 ; Meir. M. Bar-Asher, « Le rapport de la religion nuṣayrite-‘alawite au shî‘isme imâmite », in Mohammad Ali Amir-Moezzi, Meir M. Bar-Asher et Simon Hopkins (dir.), Le Shî‘isme imâmite quarante ans après. Hommage à Etan Kohlberg, Turnhout, 2009, p. 73-93.
Mohammad Ali Amir-Moezzi et Christian Jambet, Qu’est-ce que le shî’isme ?, Fayard, 2004, 181-283.
Né autour de la personne de ‘Alî Ibn Abî Tâlib, le chiisme commença à se diviser après la mort tragique du troisième imâm Husayn. Alors que les imâms du courant protoduodécimain, issus en ligne directe de Husayn, s’en tenaient à un strict quiétisme, d’autres descendants de ‘Alî prétendant à l’imâmat étaient enclins au soulèvement politique.
Les zaydites se séparèrent de la lignée de Husayn après la mort du quatrième imâm Zayn al-‘Âbidîn. Récusant le quiétisme et le dogme de l’impeccabilité, ils tiennent pour imâm légitime tout descendant de ‘Alî capable de mener l’insurrection et de prendre le pouvoir. Leur théorie juridique (fiqh) est plus proche du sunnisme que du chiisme imâmite18. Ils n’existent plus aujourd’hui qu’au Yémen où ils composent la moitié de la population.
L’ismaélisme se sépara du tronc commun imâmite lors de la succession du sixième imâm Ja‘far. Cette branche du chiisme ne connaît pas le dogme de l’occultation, mais professe un imâmat héréditaire continu. Ramifié en courants rivaux, il a joué un rôle politique et culturel considérable au Maghreb et en Égypte avec la dynastie des Fatimides (909-1171) et en Iran septentrional avec les nizarites de l’État d’Alamut (1090-1257), connus en Europe médiévale par la légende noire des « Assassins19 ». Après avoir été la branche la plus politisée du chiisme, l’ismaélisme a renoncé à toute action violente et s’est profondément modernisé. Son quarante-neuvième imâm est aujourd’hui le quatrième Agha Khan (né en 1957), à la tête d’une immense fortune, de nombreuses fondations et d’un important institut scientifique à Londres.
Les nusayrites, qui prirent tardivement le nom d’alaouites, remontent à un disciple dissident des derniers imâms. Leur doctrine conserve des croyances du chiisme le plus ancien, aujourd’hui tenues pour « hétérodoxes » en milieu duodécimain20. Implantés en Syrie, ils cultivent une religiosité discrète et une discipline du secret sur leurs croyances. Leur puissance au sein de l’État syrien depuis 1970 ne doit rien au facteur religieux, mais à leur promotion au sein de l’armée et du parti panarabe à tendance laïque Baath.
Les imâmites duodécimains, enfin, furent le dernier des nombreux groupes chiites à émerger. Ils ne devinrent majoritaires au sein du chiisme qu’après l’échec politique de l’ismaélisme au Moyen Âge. D’une certaine façon, le chiisme duodécimain suivit une évolution inverse de l’ismaélisme : d’une position apolitique à l’époque des imâms historiques (VIIe-Xe siècles) à une politisation marquée à partir de l’ère safavide en Iran (XVIe-XVIIe siècles), culminant au XXe siècle dans la doctrine de la « souveraineté du juriste-théologien » (wilâyat al-faqîh) de l’ayatollah Khomeyni. Mais cette politisation a toujours suscité une forte opposition interne : pour nombre de savants imâmites jusqu’à nos jours, toute direction politico-religieuse de la communauté demeure impossible, illégitime, en l’absence de l’imâm impeccable. Les études sur l’imâmisme ont souvent souligné le fait que les savants chiites, après l’occultation, ont altéré la doctrine initiale des imâms pour en faire une religion juridique et politique21. Mais il faut reconnaître que, sans une telle réforme, la communauté chiite aurait eu peine à survivre et nous ne saurions peut-être rien de ses doctrines originelles.
Le chiisme duodécimain est fréquemment associé à un « islam iranien », que ce soit pour des motifs spirituels ou géopolitiques. C’est une erreur de perspective quand il ne s’agit pas d’une vue idéologique. Car tout le chiisme a son origine en Arabie et en Irak, et les imâms sont tous de lignée arabe, bien qu’une légende fasse d’une princesse sassanide l’épouse de l’imâm Husayn et l’aïeule des imâms suivants. Quand, au début du XVIe siècle, les shâhs safavides firent du chiisme duodécimain la religion officielle de l’Iran, ils appelèrent des savants des grands foyers chiites arabes d’Irak et du Jabal Amil, le Sud-Liban actuel, pour former un clergé et appliquer une politique d’uniformisation religieuse. Aussi certains nationalistes iraniens contemporains dénoncent-ils la « chiitisation » de l’Iran comme un nouvel épisode de l’arabisation forcée de leur nation ; certains vont jusqu’à répudier l’islam pour cultiver la nostalgie de la Perse achéménide et de la religion zoroastrienne, oubliant que ses prêtres n’étaient pas moins intolérants que les mollahs chiites. Quant au sunnisme, il n’est pas plus spécifiquement arabe que le chiisme n’est iranien, et son élaboration doit d’ailleurs beaucoup à des Iraniens. La séparation du sunnisme et du chiisme ne recouvre donc pas une opposition, largement imaginaire, entre cultures arabe et perse. Les deux grandes branches de l’islam partagent un même universalisme, une conception du lien de la foi comme transcendant les frontières ethniques et culturelles, ce qui est aussi à l’origine de leur rivalité.
Les divisions du sunnisme
John Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford University Press, 1973 ; Éric Geoffroy, « L’apparition des voies : les khirqa primitives », in A. Popovic et G. Veinstein (dir.), Les Voies d’Allâh. Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, Fayard, 1996, p. 44-54, voir notamment p. 45.
Voir la quatrième partie « Les ordres dans les espaces » du livre Alexandre Popovic et Gilles Veinstein (dir.), cit., p. 259-447..
D’un point de vue doctrinal et rituel, le sunnisme est beaucoup plus homogène que le chiisme. Les quatre écoles qui le partagent depuis les VIIIe-IXe siècles ne sont pas théologiques mais juridiques ; leurs différences portent sur les sources du droit religieux, couvrant les pratiques cultuelles comme les affaires sociales. Le chafiisme, se réclamant d’al-Shafi‘î (m. 820 au Caire), donne la préséance au Hadîth prophétique ; le hanéfisme, d’Abû Hanîfa (m. 767), admet l’autorité du raisonnement par analogie après le Coran et le Hadîth ; le malékisme, de Mâlik Ibn Anas (m. 795), est plus ouvert à l’adoption de normes locales ; le hanbalisme, d’Ibn Hanbal (m. 855), l’école la plus rigoriste, s’attache à la lettre du Coran et refuse l’autorité de la raison. Ces quatre écoles se partagent sans heurt le monde sunnite selon des frontières géographiques et culturelles.
Le sunnisme comprend aussi, depuis ses origines, une dimension mystique portant le nom de soufisme (tasawwuf). D’abord individuel et ascétique, elle se structura matériellement dans des « voies initiatiques » (tarîqa, pluriel turuq) à partir de la période seldjoukide (XIe-XIIIe siècles), jouant un rôle social et politique majeur dans la défense du sunnisme contre les mouvements chiites et l’islamisation de certaines populations22. Cela fait du soufisme un courant pluriel de par la multiplicité de ses confréries et son adaptation aux cultures du monde musulman, du Maghreb aux Balkans et du Caucase à l’Inde23. Si la plupart des confréries soufies sont sunnites, certaines sont chiites et presque toutes font remonter leur chaîne initiatique (silsila) à ‘Alî Ibn Abî Tâlib. Entre soufisme et chiisme, les frontières doctrinales et sociales ont toujours été poreuses. Ainsi la mystique et la philosophie chiites, très vivaces jusqu’à nos jours, sont-elles fortement influencées par le soufisme d’Ibn ‘Arabî.
Le salafisme, du mot salaf désignant les musulmans des premières générations, est un mouvement sunnite prônant le retour à l’islam pur des origines, issu du réformisme de la fin du XIXe siècle. Apparu pour sa part au XVIIIe siècle, le wahhabisme est une forme politique de cet intégrisme, devenue la doctrine officielle du royaume d’Arabie saoudite. Ces courants, modernes malgré eux, s’inspirent particulièrement du néo-hanbalite Ibn Taymiyya, qui condamnait les chiites comme impies (kuffâr) en raison de leurs thèses sur le Coran et les compagnons du Prophète, et dénonçait aussi certaines pratiques soufies. Le wahhabisme reprit et durcit encore ces positions. Encore minoritaire dans le monde sunnite, il développe un prosélytisme de plus en plus efficace dans le monde entier, bénéficiant des deux grands moyens de la puissance saoudienne : les revenus pétroliers et la mainmise sur les lieux saints de La Mecque et de Médine. S’il se distingue du djihadisme révolutionnaire par sa stratégie « quiétiste » de prédication, le projet de société, fondé sur une interprétation étroite et sélective du Coran et de la Sunna, est foncièrement le même. Le wahhabisme a fait du chiisme son ennemi juré à l’intérieur de l’islam et se montre aussi hostile à l’égard du soufisme, comme l’ont illustré les événements récents au Mali.
Désignations et justifications de la guerre
Éric Geoffroy, Le pluralisme religieux en islam, ou la conscience de l’altérité, Valeurs d’islam 1, Fondation pour l’innovation politique, janvier 2015, 25-26.
Alfred Morabia, Le Ğihâd dans l’Islam médiéval, Albin Michel, 1993, 298-308.
Hichem Djaït, op.cit.
Meir Litvak, « “More harmful than the Jews”: ani-Shi’I polemics in modern radical Sunni discourse », in A. Amir-Moezzi, M.M. Bar-Asher et S. Hopkins (dir.), op. cit., p. 293-314.
Etan Kohlberg, “The Development of the Imâmî Shî‘î Doctrine of Jihâd”, in Etan Kohlberg, Belief and Law in Imâmî Shî‘îsm, Variorum, 1991, 69 et 81-82.
La notion de jihâd en islam, loin de se réduire à un combat militaire, a d’abord un sens spirituel24 que l’on rencontre autant dans le soufisme que dans le chiisme. Mais au vu de l’histoire et des enjeux actuels, c’est le jihâd au sens du combat armé « sur la voie de Dieu » (fî sabîl Allâh) qui nous retiendra ici. Sunnites et chiites l’ont pensé et pratiqué de manière très différente, ce qui tient d’abord à leur situation. Pour les sunnites majoritaires, l’adversaire désigné pour le jihâd fut généralement une puissance non musulmane. Les chiites représentent l’autre de l’intérieur, contre lequel un combat coercitif peut être légitime, voire obligatoire, pour défendre l’intégrité de la religion. Ce combat, ils l’ont généralement appelé harb ou « guerre », sans connotation sacrale, plutôt que jihâd25. Pour les chiites minoritaires, en revanche, la puissance sunnite a été l’adversaire de toutes les confrontations, l’antagoniste par excellence, et contre elle le combat, réel ou fantasmé, a toujours été appelé jihâd. Ainsi les violences politiques du début de l’islam sont-elles qualifiées de « discorde » (fitna) dans les sources sunnites, généralement suivies par les historiens critiques modernes26. Mais d’après les sources chiites anciennes, ‘Alî et ses partisans considéraient pour leur part la bataille de Siffîn comme un jihâd, une « guerre sainte » opposant les vrais croyants aux « hypocrites » dénoncés par le Coran ; une « guerre sainte » que les chiites savent avoir perdue sur le terrain de l’histoire.
Dans le droit musulman, le jihâd peut être dirigé contre les polythéistes, les apostats, les « gens du Livre » (ahl al-kitâb) et les « hommes de la rébellion » (ahl al-baghy). C’est en désignant les chiites par ce dernier terme que les juristes sunnites ont pu appeler au jihâd contre eux, s’appuyant sur le verset :
« Si deux groupes de croyants se combattent, rétablissez la paix entre eux. Si l’un des deux se rebelle encore contre l’autre, luttez contre celui qui se rebelle, jusqu’à ce qu’il s’incline devant l’Ordre de Dieu… » (49, 9). La guerre à outrance ne se justifiait qu’à l’époque du Prophète à l’encontre des mécréants qui lui étaient hostiles (kuffâr), mais le souverain est fondé à conduire un jihâd coercitif contre des musulmans dissidents pour maintenir l’unité de la communauté. Cette théorie fut appliquée par l’ayyoubide Saladin au XIIe siècle, qui fit de la répression des chiites le préalable au jihâd défensif contre les croisades. Sous la domination mongole, assez favorable aux chiites, Ibn Taymiyya qualifia les différents groupes chiites de kuffâr contre lesquels le jihâd était légitime. À sa suite, Muhammad b. Abd al-Wahhab (m. 1792), à l’origine du mot wahhabite, désigna les chiites comme « le plus grand mal de la religion, pire que celui des juifs et des chrétiens », ce que ses partisans s’empressèrent de traduire en acte en massacrant plusieurs milliers de chiites à Karbalâ’, en 1801 déjà27.
Les chiites considèrent originellement que seul l’imâm impeccable peut conduire le combat sacré et que le seul combat sacré est pour la cause de l’imâm. Mais après le martyre de Husayn, leurs imâms ont renoncé à toute action politique et renvoyé le jihâd à la venue finale du Sauveur, identifié par la suite au douzième imâm occulté. Les hadîth chiites sont nombreux qui décrivent le combat eschatologique du Mahdî et de son armée, terrassant les ennemis de Dieu qui ne sont autres que les protosunnites et « remplissant le monde de justice comme il l’était d’injustice ». Théoriquement, l’application de l’obligation du jihâd est donc suspendue jusqu’à la fin des temps, mais les docteurs de la loi chiites s’avisèrent qu’une telle suspension des prérogatives de l’imâm était en pratique intenable. Ils établirent qu’en période d’occultation, le jihâd défensif pouvait être proclamé par un mandataire de l’imâm. L’Iran safavide (XVIe-XVIIe siècles), État chiite revendiqué, put ainsi légitimer religieusement la guerre quasi permanente contre l’Empire ottoman voisin, champion du sunnisme. À partir du XIXe siècle, les plus grands mujtahids chiites s’attribuèrent la prérogative de la déclaration du jihâd. Ce fut un succès idéologique mais le plus souvent un échec militaire, depuis les guerres perso-russes au XIXe siècle jusqu’à la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, soldée par un arbitrage que l’ayatollah Khomeyni accepta à contrecœur28.
Du rapprochement (taqrîb) à l’anathémisation (takfîr)
Rainer Brunner, « Interesting Times : Egypt and Shi’ism at the Beginning of the Twenty-First Century », in Ofra Bengio et Meir Litvak (dir.), The Sunna and Shi’a in Division and Ecumenism in the Muslim Middle East, Tel-Aviv, 2011, p. 223-241.
Meir Litvak, art.cit.
Mentionnons, de l’actuel président Hasan Rûhânî, Moqaddeme-i bar târix-e emâmân-e shî’e (« Introduction à l’histoire des imâms chiites »), Téhéran, 2012, p. 203-213.
Les affrontements actuels l’ont fait oublier, mais le XXe siècle vit une entreprise de rapprochement officiel entre les représentants des deux grands courants de l’islam. D’éminents clercs chiites comme l’Irakien Kâshif al-Ghitâ’ (m. 1954) s’employèrent à réfuter les accusations des hérésiographes sunnites en reniant explicitement de nombreuses thèses du chiisme originel. Ces efforts aboutirent en 1959 à une fatwa du doyen de l’université al-Azhar du Caire reconnaissant la doctrine juridique chiite duodécimaine ou ja‘farite (du nom du sixième imâm) comme la cinquième école juridique de l’islam après les quatre écoles sunnites mentionnées plus haut29. Aujourd’hui encore, les muftis d’al-Azhar intègrent le rite ja‘farite avec les quatre rites sunnites dans leurs procédures juridiques. Un autre rapprochement, idéologique celui-là, s’opéra entre le sunnisme politique des Frères musulmans et le chiisme politique de l’ayatollah Khomeyni. Avec des emprunts et des retours : Khomeyni s’inspira de l’idéologue des Frères musulmans Saïd Qotb pour théoriser le « gouvernement islamique », et Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste sunnite de Tunisie Ennahdha et membre important de l’organisation internationale des Frères musulmans, vanta l’exemple du mouvement révolutionnaire de Khomeyni.
Mais la révolution islamique de 1979 en Iran et le rayonnement de l’ayatollah Khomeyni ont eu aussi pour effet d’exacerber la crainte des oulémas sunnites devant une possible expansion du chiisme et de réveiller l’antichiisme viscéral des wahhabites. Après la chute de Saddam Hussein en 2003 et le transfert du pouvoir de la minorité sunnite à la majorité chiite en Irak, le chef d’Al-Qaïda en Irak, al-Zarkawî, déclarait la guerre à mort à tous les chiites du monde. Sans aller toujours jusque-là, les prédicateurs salafistes et wahhabites ne cessent d’accuser les chiites de vénérer un autre Coran, de rabaisser le Prophète et de pratiquer la dissimulation (taqiyya) ; certains vont jusqu’à prononcer contre eux l’anathème valant excommunication, le takfîr, justifiant le jihâd à outrance. Ces discours bénéficient d’une formidable diffusion sur Internet, vers un public souvent dépourvu de culture religieuse30. Car il est bien certain que nulle autorité en islam n’est en mesure de prononcer une excommunication et que de telles déclarations n’ont aucune validité, comme l’a rappelé le cheikh d’al-Azhar Ahmed al-Tayyeb en 2010. Mais l’efficacité mortelle du takfîr antichiite en Irak, en Syrie ou au Pakistan, démontre tragiquement que le droit religieux (fiqh) a perdu de son autorité contre la puissance de la prédication.
En Iran chiite, le rapprochement doctrinal avec le sunnisme « orthodoxe » des quatre écoles juridiques, excluant le wahhabisme, est toujours d’actualité dans les fondations et écoles religieuses de Qom. Après des années d’exaltation du martyre et de la guerre sainte, fondée sur la mémoire du combat de l’imâm Husayn, les autorités religieuses et politiques avancent de plus en plus le thème de la « paix obligée » (al-sulh al-mafrûd), en référence au choix douloureux du deuxième imâm Hasan de renoncer au combat pour sauvegarder sa vie, celle de ses fidèles et l’avenir de la communauté31.
Les spectres de la « chiitisation » et de l’« arc chiite »
En ayant à l’esprit les divisions internes du chiisme et l’idéologie antichiite des wahhabites, on peut mieux comprendre la nature et les enjeux des alliances actuelles. Si l’Iran chiite duodécimain soutient le régime syrien tenu par des alaouites et les rebelles zaydites au Yémen, c’est bien sûr pour avoir une zone d’influence dans le monde arabe et contrer la puissance saoudienne qui, de son côté, ne cesse d’œuvrer à l’isolement diplomatique de l’Iran. Mais on ne peut pas sérieusement croire à un projet de « chiitisation » du monde musulman, pas plus qu’au spectre d’un « arc chiite », expressions forgées par des chefs d’État sunnites nourrissant la rhétorique des prédicateurs wahhabites. Les différences dogmatiques et juridiques entre les courants du chiisme rendent ces expressions dénuées de sens et les clercs chiites imâmites d’Iran ou d’Irak sont trop pragmatiques pour forger de telles chimères. Que le président syrien Bachar el-Assad en appelle à la solidarité chiite pour sauver son régime est un fait, mais entre le projet de société baathiste et la « gouvernance islamique » de l’Iran, il n’y a pas grand-chose en commun, sinon, il faut le reconnaître, un certain respect du pluralisme religieux. Le Hezbollah libanais, lui, adhère à la wilâyat al-faqîh de l’ayatollah Khomeyni et de son successeur Khamenei, mais ne peut être considéré comme un simple instrument de l’Iran. Ses objectifs politiques sont au Liban, où il est un parti légal, et c’est pourquoi il intervient en Syrie. Car avec la montée en puissance de l’extrémisme sunnite antichiite, les chiites du Sud-Liban se trouveraient directement menacés si la Syrie chutait aux mains de wahhabites.
La scission de l’islam entre chiisme et sunnisme n’est donc pas une vue de l’esprit mais une réalité structurelle et dynamique. Elle doit être abordée en tenant compte aussi d’une autre ligne de partage qui la traverse, entre un islam juridico-politique, volontiers intolérant et coercitif, et un islam spirituel, quiétiste, voire apolitique. L’islam politique sunnite et son répondant chiite tendent aussi bien à se rapprocher qu’à s’affronter ; l’islam spirituel sunnite et son répondant chiite tendent aussi bien à se disputer qu’à se confondre. Le paradoxe de la division interne de l’islam est que les différences doctrinales fondamentales se résorbent dans des pratiques cultuelles semblables. Tant que la mémoire historique et les débats théologiques ne sont pas instrumentalisés à des fins politiques, ces différences n’empêchent pas sunnites et chiites de vivre, de travailler et de croire ensemble. À l’heure où les discours de haine, les armes et les combattants circulent à travers le monde à la vitesse des capitaux, il serait cependant naïf de croire que la spiritualité et la convivialité (ta‘ayyush), deux valeurs au cœur de l’islam, l’emporteront seules. Dans le monde sunnite, il est sans doute urgent que s’allument de véritables contre- feux politiques et intellectuels au wahhabisme et aux courants encore plus extrêmes qui ne cessent de gagner du terrain dans les rues et les esprits. Dans le monde chiite, et d’abord en Iran, la tâche des réformateurs modérés est de tourner la page du messianisme politique incarné dans un passé récent par le président Mahmud Ahmadinejâd. De chaque côté, ces efforts existent déjà et doivent être soutenus par les sphères politiques et intellectuelles du monde non musulman. Car de cette « paix obligée » entre les deux courants de l’islam dépend aujourd’hui la paix dans le monde.

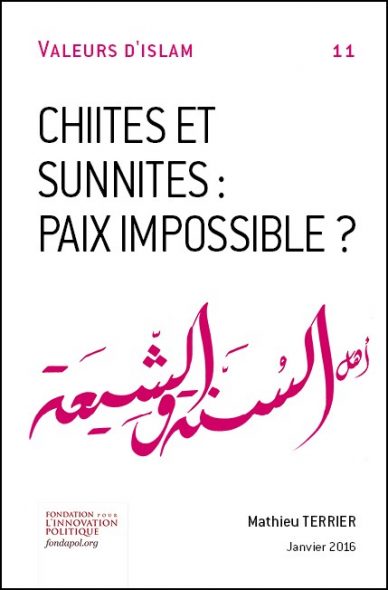
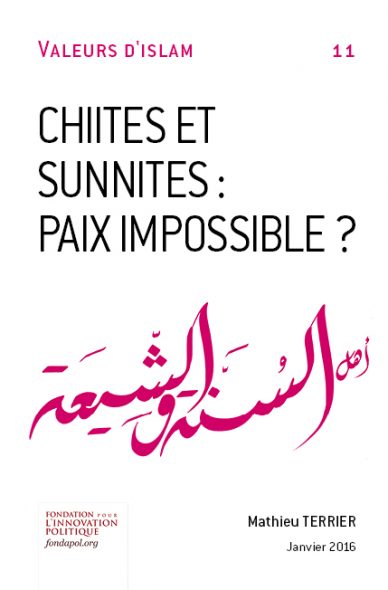











Aucun commentaire.