Du paradoxe au paradigme
Du dogmatisme et de la confusion sémantique au principe de discernement
Vers une pensée audacieuse : le paradoxe devenu paradigme
Ajustements sémantiques de la morale, de l’éthique et de la déontologie
La réprobation morale
De la morale au moralisme : essence religieuse de la morale et primauté de la raison
La logique du « devoir être » : saturation de la critique et effets pervers
Ethique
Immanence de l’éthique : s’ajuster au « site »
Une éthique de l’esthétique : les pactes émotionnels
L’écosophie : la sagesse attachée à la maison commune
Déontologies
Élan vital et « situationnisme » des déontologies
Une puissance des choses qui exige une adaptation à la différence
Devoir être, pouvoir être, vouloir être
Citation
« C’est un refus de penser, et souvent hérité, qui gouverne ce peuple d’ombres »
Alain, Souvenirs concernant Jules Lagneau, Paris, Gallimard, 1925, p. 144.
Michel Maffesoli,
Institut universitaire de France, professeur à la Sorbonne (Paris 5), administrateur du CNRS, directeur du Centre d'Étude sur l'Actuel et le Quotidien (CEAQ)
Du paradoxe au paradigme
Du dogmatisme et de la confusion sémantique au principe de discernement
« Il faut détruire Carthage ».
Thomas d’Aquin, Summa Theologica, I-II, 49, art.3, A, « Principium importans ordinem ad actum ».
Michel Maffesoli, Le Temps des tribus, le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse (1988), 4ème édition, Paris, La Table Ronde, 2000.
Saint Augustin, La Cité de Dieu, III, 30.
Il y a un rapport entre l’art de comprendre et celui de rendre compré- hensible les choses de la vie. Ces choses sont ce qu’elles sont. Et il est bien naïf de croire que c’est nous qui les créons. Naïf ou prétentieux, c’est selon. En tout cas, voilà ce qui est à l’origine de l’embrouillamini : confusion des mots, confusion de sentiments, propre au climat mental de l’époque. Certes, il ne faut jamais se lasser de le répéter, le vivre ensemble est tributaire de la manière dont nous l’exprimons. D’où la nécessité d’opérer ce constant travail de sape consistant à désobstruer la pensée de nos habituels conformismes et autres mots dogmatiques, afin de revenir au sens originaire des paroles fondatrices.
Nécessaire, mais pas aisé, tant de multiples dogmatiseurs tiennent le haut du pavé. Il convient, en effet, de savoir se libérer de l’opinion dominante, ce que d’antique mémoire on nomme doxa, pour penser, le plus justement possible, ce qui est. Voilà qui n’est pas aisé, tant ce que Durkheim nommait le « conformisme logique » est la pensée naturelle de toute vie en société. Arrêtons à cet égard de parler de pensée unique, car la pensée n’est pas au rendez-vous. Il serait plus juste de nommer « plat unique » ce qui tend à susciter lassitude, voire indigestion.
Caton l’Ancien, à temps et à contretemps, ponctuait ses discours du fameux « Delenda Carthago est1 ». Signifiant par là une impérieuse exi- gence pour la survie de Rome. Peut-être est-ce une telle exigence qu’il faut repérer : en la matière, montrer l’inanité du discours moraliste, si l’on veut saisir avec justesse et lucidité le vivre ensemble contemporain. Et cela, il faut le répéter, tant le babil moraliste se retrouve dans tous ces discours politiques, ces articles journalistiques, voire ces livres universi- taires, tous pétris de bons sentiments. Tous obnubilés par une logique du « devoir être », qui n’est pas la meilleure manière pour apprécier ce qui est.
En fait, pour reprendre une image de Nietzsche, cette sécrétion de « moraline » traduit, tout simplement, le déphasage des élites sociales face à la vraie vie. Ou encore le fait que celle-ci, au nom d’un principe de réalité (politique, économique, social) bien rachitique, se soit abstraite d’un réel autrement plus complexe et plus riche. Réel où les passions, les émotions communes jouent un rôle indéniable. Réel où le ludique, le festif et l’onirique ne peuvent plus être cantonnés derrière le mur de la vie privée, ou être limités au fameux « 1% culturel », mais contaminent, le développement technologique aidant, l’ensemble de la vie sociale.
Disons le tout net, c’est un tel déphasage qui permet de comprendre cette étonnante inversion des valeurs, où, sous couvert d’une « biblio- thèque rose », le « cogito ergo sum » cartésien devient un déliquescent « odi ergo sum », je hais donc je suis. Haine traduisant dans les histoires humaines qu’une circulation des élites est en cours. En effet, quand la société officieuse n’est plus représentée par la société officielle, celle-ci tend à s’aigrir, et à exprimer ses mauvaises humeurs. N’est-ce point cela la définition, toute simple, des vieillards cacochymes, qui au déclin de leur vie, sont impuissants à percevoir la virilité inépuisable de la vie en son perpétuel recommencement ?
Ainsi, pour ceux qui, au-delà ou en deçà de la posture catastrophiste qu’il est bienséant d’afficher, veulent être attentifs au vitalisme des mœurs actuelles, il convient de saisir la forme intérieure les façonnant. En effet, malgré l’aspect erratique du phénomène, il y a un principe assurant la cohérence profonde et obstinée. Principe qu’il convient de repérer, principe régulant l’action et délimitant l’imaginaire caractéri- sant l’« être ensemble ». C’est ce que saint Thomas d’Aquin nommait habitus2. Principe régulateur faisant que le clerc du quartier latin portait tel habit induisant ses habitudes de vie. Alors que le juriste de la Cité, ayant un autre habit, pouvait avoir d’autres manières d’être. C’est pour saisir l’habitus de ce que j’ai nommé en son temps « les tribus post- modernes3 » qu’il faut faire des distinctions entre des termes que l’on emploie fréquemment les uns pour les autres : morale, éthique, déonto- logie. Et pour cela penser, résolument, à contre-courant. S’opposer aux généreux poncifs tenant lieu d’analyses. Dépasser l’exhortation grati- fiante, essentiellement, pour celui qui la profère. De tout temps, il y eut des livres protreptiques, livres d’incitation à la vertu. Ils ont, certes, leur utilité. Mais l’on sait que l’inflation est contre-performante. Ou pour le dire plus familièrement : « cause toujours, tu m’intéresses ».
En bref, les niagaras d’eau tiède déversés par les livres d’édification, saturés de bons sentiments, ne font que favoriser, a contrario, l’indif- férence, voire, par réaction, l’immoralisme. Ce qui, on en conviendra, ne peut qu’inquiéter. C’est pour cela qu’au-delà des facilités et autres pensées convenues, il faut, sans pusillanimité, mettre en œuvre une luci- dité ouvrant la voie à la sagacité. Sagesse humaine, on pourrait presque dire humaniste, sachant de longue tradition, que l’humain, justement, est pétri d’humus. Ce qui incite à avoir l’humilité d’accepter le clair-obscur de toute existence. Voilà bien le fondement de ce qui fut, d’antique mémoire, le caractère essentiel, tout à la fois de la pensée savante et de la connaissance ordinaire : le discernement. En son étymologie latine, dis- cretio. C’est-à-dire ce sens de la mesure préférant une justesse concrète à l’abstraite justice. Discrétion du « point trop n’en faut », de ce délicat « rien de trop » réfutant les fanatismes et autres intolérances à l’origine des diverses inquisitions et tribunaux « populaires » familiers à tous les totalitarismes. En ce sens le discernement est bien le fondement de cette virtù, telle que Machiavel en parle et qui, loin d’une vertu quelque peu rancie, assure sur la longue durée tenue et solidité à ce qui est le principe essentiel de toute société : le vivre ensemble.
Il s’agit là d’une banalité de base que l’on ne se lassera jamais de répéter. Les préjugés – fussent-ils issus des meilleures intentions – confor- tent les évidences intellectuelles, ne permettant pas de voir ce qui est, tout simplement, évident. Les jugements a priori sont cause et effet des mimétismes sociaux, de cette pulsion animale servant de fondement à ce que Gabriel Tarde nommait, justement, les « lois de l’imitation ». Il n’y a rien là que de très naturel. L’instinct grégaire étant, on le sait, un constant moteur de notre espèce animale. Et de tout temps, il fallait avoir « l’odeur de la meute » pour participer à la vie commune.
Voilà qui est donc compréhensible. Ce qui l’est moins, c’est quand ceux qui ont pour fonction d’être des veilleurs, c’est-à-dire d’être atten- tifs aux fourmillements de la vie, aux grouillements culturels, se conten- tent, aveuglés par leurs présupposés, de jouer les pompiers des bonnes mœurs, éteignant, de leur tranquille certitude, les vibrantes effervescences sociétales. Ce faisant, ils favorisent l’asepsie sociale, source d’ennui et de dégoût existentiel. Qui plus est, c’est un tel « conformisme logique », propre à une intelligentsia tout à la fois suffisante et non nécessaire, qui ne permet pas de saisir les tendances de fond en gestation. Ce qui peut faire penser à l’avertissement de saint Augustin à ceux qui ne voyaient pas la survenue d’une barbarie allant submerger l’Empire : « caecus atque improvidus futurorum4 », autrement dit, « aveugle et incapable de prévoir les évènements futurs », voilà bien ce qu’est l’observateur social, qui n’est plus veilleur, qui n’éveille plus, mais qui se contente de ronronner quelques incantations convenues.
Vers une pensée audacieuse : le paradoxe devenu paradigme
Max Weber, Le Savant et le politique, Paris, Plon, 1959, 93. Dans cet ouvrage, ainsi que dans Essais sur la théorie de la science (Plon, 1965), Max Weber montre qu’avant tout jugement de valeur (ce qui « devrait être »), la démarche scientifique doit s’employer à constater « ce qui est ». En un mot, fût-ce d’une manière provisoire, se purger de ses convictions.
Depuis Gide, on sait bien que l’on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Ces derniers, a fortiori, risquent d’être totalement inefficaces pour rendre compte de cette rhétorique sociale constituant la vie de tous les jours. N’est-ce point cela à quoi nous rend attentif Max Weber ? « S’il est une chose que nous n’ignorons plus, c’est qu’une chose peut être sainte non seulement bien qu’elle ne soit pas belle, mais encore parce que et dans la mesure où elle n’est pas belle. […] De même une chose peut être belle, non seulement bien qu’elle ne soit pas bonne, mais précisément en quoi elle n’est pas bonne. Nietzsche nous l’a réappris, mais avant lui Baudelaire l’avait déjà dit dans Les Fleurs du Mal… Enfin, la sagesse populaire nous enseigne qu’une chose peut être vraie bien qu’elle ne soit et alors qu’elle n’est ni belle, ni sainte, ni bonne5. »
On ne saurait mieux dire l’entièreté de la vie sociale, la complexité de la personne humaine, ou, en un mot, l’indivision de l’être. Toutes choses qui, au-delà ou en deçà des attitudes normatives ou judicatives (ayant la propension de juger), devraient être l’essentielle préoccupation du penseur social. Ne serait-ce que pour permettre au politique de juger et d’agir, il faut d’abord, fidèle autant que faire se peut à la neutralité axiologique, photographier la complexité du réel. Avant quelque repré- sentation que ce soit, présenter le monde, tel qu’il est.
En effet, il faut accepter avec lucidité et humilité que l’impératif de la connaissance ne se trouve pas dans un « monde vrai » au-delà de ce monde-ci, qu’il n’y a pas à attendre une consolation dans une vie au-delà de celle-ci, qu’il n’est pas souhaitable de vitupérer ce qui est en fonction d’un hypothétique « devoir être ». En bref, ne plus chercher la vérité des choses à partir d’une attitude surplombante, celle issue de la « loi du père », marque de l’Occident judéo-chrétien, mais bien se contenter d’une vérité énigmatique, issue d’un dévoilement de ce qui est, dévoile- ment à jamais inachevé. Voilà qui est plus en congruence avec l’horizon- talité de la « loi des frères » dont les divers moyens de communication interactifs, l’Internet en particulier, sont les vecteurs privilégiés.
C’est une telle posture intellectuelle, mettant l’accent sur le question- nement, sur la problématique (en tant qu’ensemble de problèmes) plus que sur des solutions toutes faites, propres aux certitudes dogmatiques, qu’il faut adopter. C’est cette attitude, en phase avec l’inquiétude exis- tentielle qui, au-delà des faciles mais sécurisantes convictions, permet de sentir battre l’impulsion de la vie, et de repérer les lignes de force de la socialité contemporaine, où le « polythéisme des valeurs », le polycul- turalisme et les identifications multiples semblent prédominer. C’est cet « éclatement » de l’individu en personne plurielle, cette fragmentation des institutions homogènes en tribus hétérogènes, d’une République une et indivisible en une mosaïque plus ou moins cohérente de communautés, qui doit nous inciter à un chemin de pensée audacieux. Celui pouvant permettre de comprendre – ce qui est la caractéristique essentielle de la postmodernité – en quoi les paradoxes sont devenus des paradigmes.
On ne peut s’interroger avec pertinence sur l’évolution des mœurs que si l’on sait s’arracher à « ce qui va de soi », c’est-à-dire aux cer- titudes lénifiantes de l’opinion commune. Opinion qui, la plupart du temps, ne traduit en rien les profonds courants affectant, en profondeur, le vivre ensemble. En ce sens, ainsi que je viens de l’indiquer, il ne faut pas donner des solutions faciles, mais savoir poser, le mieux possible, les problèmes. Être, pour reprendre l’expression de Nietzsche, un « scrupu- leux de l’esprit », capable de faire les distinctions s’imposant entre des termes que l’imbécillité ambiante tend à confondre.
Ajustements sémantiques de la morale, de l’éthique et de la déontologie
Pour l’instant, et dans l’attente d’une analyse plus fouillée, rappelons que la morale s’élaborant dans la foulée de l’universalisme de la philosophie des Lumières, à partir du XVIIIe siècle, se veut générale, applicable en tous lieux, et en tous temps. C’est cet universalisme qui est un fondement même de tous nos livres d’édification, d’exhortation, d’incitation dont il a été question.
L’éthique, quant à elle, que l’on confond fréquemment avec la morale, est, au plus près de son étymologie, tributaire d’un « site » donné. Elle est liée à un lieu et à la communauté qui y vit. Ce « territoire » peut être réel ou symbolique (virtuel). Les « sites » communautaires sur Internet en témoignent. L’éthique est particulière. Elle peut être parfois immorale en ce qu’elle sert de ciment à un groupe donné, elle peut contrevenir aux lois établies et à la bienséance admise. À l’opposé d’une morale une, les éthiques sont, structurellement, plurielles. Ce qui va poser le problème de leur ajustement. L’harmonie n’étant plus a priori, mais a posteriori.
Si l’on s’en tient à son étymologie, c’est-à-dire ce qui est ponctuel, ce qui renvoie aux situations, la déontologie met en jeu les instincts de survie. C’est l’expression même du glissement du contrat rationnel et pensé sur la longue durée, vers le pacte à forte charge émotionnelle et à durée limitée. Il y a quelque chose de sauvage, de primitif dans le « situationnisme » déontologique. C’est la prise en compte des humeurs et des affects qui est en jeu. On est loin, comme on le verra, de l’habituelle signification la rattachant aux règles et devoirs régissant une profession. La déontologie consiste à agir, sans considération du bien et du mal, comme on « doit le faire », comme il convient de le faire en fonction de la situation présente6.
C’est quand il y a confusion des mots que les choses et les sentiments tendent, également, à s’obscurcir. D’où la nécessité de sortir du « piège sémantique » utilisant un mot pour un autre. Pour le dire d’une manière plus familière, il faut cesser de « prendre des vessies pour des lanternes ». Quand un mot n’est plus en phase avec ce qui est vécu, il devient dog- matique : ainsi la fameuse langue de bois des bureaucraties staliniennes. Il perd, en son sens scientifique, de sa pertinence. Du coup, il devient impertinent. Et quand un mot est saturé, la chose qu’il désigne perd également de la consistance, elle n’a plus de force attractive. Écoutons encore la sagesse populaire : « ça ne parle plus ».
D’où la nécessité, au-delà des sermons incantatoires, d’ajuster nos mots aux choses telles qu’elles sont. Le comte de Lautréamont, puis Guy Debord avaient bellement formulé cela : « Les mœurs s’améliorent, le sens des mots y participe7. » C’est une telle exigence qu’il convient de faire nôtre, sous peine de conforter ces discours creux, s’employant à condamner l’amoralité ambiante, se contentant de vitupérer ou d’anathémiser les phénomènes dangereux, jetant l’opprobre sur les pratiques honteuses des jeunes générations, en bref , voir les choses sociales par le « petit bout de la lorgnette », autre manière de fonctionner par dénégations !
On le sait, de longue date, « l’oiseau de Minerve ne prend son vol que la nuit » (Hegel). Il est, en effet, fréquent de ne pas voir ce qui est, depuis longtemps déjà, arrivé. C’est sur un tel décalage que repose la disparition de la « compétence narrative » qui est la spécificité des élites modernes dont se moquent les discussions du Café du Commerce et divers Guignols de l’info. En effet, c’est quand les mots ne sont plus pertinents qu’il est impossible de saisir la force intérieure animant une culture donnée, et donc les formes extérieures dans lesquelles celle-ci se manifeste.
D’où la superficialité de la plupart des analyses journalistiques, poli- tiques et universitaires contemporaines. Le marché de l’opinion publiée réclame sans cesse des scoops, qui ne sont, la plupart du temps, que des « marronniers » et autres pensées convenues n’intéressant qu’une minorité. La recherche de ces nouveautés (tout comme il existait des « magasins de nouveautés » dans les endroits les plus reculés) traduit en fait un indécrottable provincialisme d’esprit, incapable de voir que l’anomique d’aujourd’hui est le canonique de demain.
En effet, l’impertinence des mots usés, la confusion sémantique se contentent de seriner quelques formules creuses sur un supposé « prin- cipe de réalité » qui, en reprenant les termes de la démarche phénomé- nologique, renvoie à la vision étriquée de « l’étant » et en oublie le réel subsistant de « l’être ». Voilà le fondement du moralisme : passer à côté des caractéristiques essentielles de l’existence humaine. Réduire celle-ci à ce que l’on peut appeler « l’auto-anthropos », l’homme limité à lui- même. Alors qu’il n’est compréhensible qu’en situation : avec l’autre, avec le monde. Est-ce exagéré de dire que c’est cette limitation de l’homme à l’homme qui a conduit à cette paranoïa propre à la « dévastation du monde » (Heidegger), les saccages écologiques en témoignant, et à la dévastation des esprits, la grégaire solitude en étant l’expression achevée ? En fait, nous quittons une époque où l’homme se pensait « maître et possesseur de lui comme de l’univers » (Descartes). Époque où il croyait faire l’histoire. L’universalisme, la morale et le contrat social sont les maîtres mots d’une telle sensibilité. Mais voilà que, plus subrepticement (les vraies révolutions, on le sait, « avancent à pas de colombe »), un tel optimisme se sature et tend à laisser la place à l’émergence d’un destin auquel il convient de s’ajuster.
Voilà de quoi l’éthique est le nom : s’accommoder d’un « site », s’ac- commoder à ce site. D’où l’émergence des pactes traduisant l’aspect émotionnel que revêt le lien civique. Pactes émotionnels dont la forme paroxystique est le « situationnisme déontologique », celui de l’oppor- tunité, de la bonne « occase », où l’intensité du moment partagé avec d’autres, la durée de l’instant remplacent le projet moral, lointain et permanent (économique, politique, symbolique) propre à la modernité. Voilà, en effet, ce sur quoi il convient d’insister. La morale repose sur une logique de projection. Elle est d’ailleurs d’essence religieuse (des religions sémitiques), renvoyant le bien au-delà de cette vie-ci, au-dessus d’elle. La morale est donc censée gérer une période préliminaire, intermédiaire. Elle gouverne, d’une manière normative et judicative, la transition vers la vraie vie, celle d’un paradis céleste (judéo-christianisme) ou terrestre (les utopies socialistes). Elle met en place l’injonction du « devoir être » et favorise la conscience individuelle et son expression philosophique : le rationalisme.
Son essence est, qu’on le sache ou non, l’eschatologie.
L’éthique, en revanche, s’attache tout simplement au « pouvoir être » fondé sur l’expérience de la communauté. Elle prend fond sur la sédimen- tation plurigénérationnelle, celle de la tradition. Elle est cause et effet d’une philosophie de l’existence, faisant fi des idées préconçues et s’appuyant sur l’empirique et le concret. Quant au « situationnisme déontologique », il est quelque peu l’antinomique héritier d’un bon sens s’accordant, au coup par coup, à ce qui se présente, à ce qui se donne à vivre et à penser. L’ajustement qu’il met en jeu, ajustement aux autres et au monde, est essentiellement introjectif. L’immanentisme, la jouissance de ce monde-ci en est la principale manifestation. On peut comprendre que ceux-là mêmes faisant partie de ce que Victor Hugo nommait le « clergé littéraire » aient quelque difficulté à admettre une telle sensibilité hédoniste.
Le moi moral, celui de l’individu autonome, capable d’élaborer « sa propre loi » (auto nomos), pièce essentielle du contrat social, est centri- fuge. C’est son moi qu’il projette sur le monde. Voire, tel Dieu créant le monde en le nommant, c’est à partir de sa conscience qu’il crée ce qui est. Le moi éthique ou déontologique en revanche est centripète. D’une manière hétéronome, c’est l’autre qui lui dicte la loi. L’autre de la tribu, l’autre de la nature, l’autre de la déité, c’est cet autre qui fait ce qu’il est. Il est littéralement absorbé par le monde et par le groupe. Ou, ce qui revient au même, il absorbe le monde et l’autre du groupe. Du paga- nisme de la deep ecology au fait de « s’éclater » dans les « afoulements » festifs, c’est une même logique qui est à l’œuvre : celle de la fusion, voire de la confusion. Il ne sert à rien de stigmatiser cela. Il vaut mieux le penser, ne fût-ce que, comme toujours en pareil cas, pour éviter le pire.
Peut-être est-ce ainsi qu’un rêve collectif évite de devenir cauchemar.
La réprobation morale
De la morale au moralisme : essence religieuse de la morale et primauté de la raison
Je l’ai déjà indiqué, il n’est pas inutile de se détacher des pensées conve- nues si l’on veut saisir ce que Durkheim nommait les « caractères essen- tiels » d’une époque, d’une situation ou, tout simplement, d’une idéologie sociale. Le caractère, qu’est-ce, sinon la marque spécifique, l’empreinte profonde propre à un individu ou à une culture donnée ? Il n’est jamais inutile d’aller à la racine des choses. Il est des moments où cette radi- calité permet de rester éveillé, en un temps d’assoupissement généralisé. Elle est gage de lucidité quand tend à prévaloir le correctness dont on commence, à peine, à mesurer les dégâts. Quelles sont les sources d’une morale dont il est de bon ton de célébrer les bienfaits, et du moralisme qui, quoique l’on en ait dit, en est l’inéluctable conséquence ?
Tout d’abord, comme principe fondateur, l’invention de l’individu. Je dis bien « invention », en ce que de la communauté originaire et matricielle, on fait « venir au jour » (in venire) une entité séparée, un monde « indivisible », devenant une substance autosuffisante. C’est le principium individuationis que la notoire inculture savante s’emploie à négliger, voire à dénier, mais qui n’en reste pas moins l’irréfragable fondation de la culture occidentale ou moderne, ce qui revient au même. Mais allons encore plus en profondeur. Un tel individualisme, que l’on peut qualifier d’épistémologique, est lui-même solidement souché sur ce que l’on peut, à juste titre, considérer comme une exception cultu- relle : le monothéisme de la tradition sémitique. Pour ce dernier, grâce à diverses révélations ou alliances, formalisées par quelques prophètes, et en fonction de lois fondamentales à respecter, le salut individuel est possible. C’est cela « l’exception » dont j’ai parlé. Ces religions reposent sur une conception dite sotériologique : croyance en un au-delà, origine de nombreux mythes, fantasmes et autres rêveries, tout un chacun aura droit à une éternité de béatitude que rien (péché, mal, dysfonction, imperfection, etc.) ne pourra entraver.
Les voies pour accéder à un tel paradis sont, certes, variables. Les querelles théologiques et nombreuses guerres de religion en témoignent. Mais le dénominateur commun est bien le respect d’une loi dont l’indi- vidu est comptable et qui lui assurera, d’une manière inéluctable, le salut éternel. Mais pour cela, il faut qu’il prenne conscience de ses devoirs, il faut surtout, qu’au-delà des instincts et autres pulsions animales, cet individu privilégie ce qui le différencie, justement, des autres créatures : la conscience en ses multiples modalités cognitives.
C’est en effet une spécificité du monothéisme que de mettre l’accent sur la raison. Ce problème a, ici, sa légitimité. En effet, une des racines du « devoir être » moral est bien cette progressive rationalisation du sacré. À partir de saint Augustin, dont on peut dire sans trop d’anachronisme qu’il est le fondateur de la modernité, le monothéisme est fondé en raison : « la raison humaine conduit à l’unité », dit-il. Par là l’aspect fascinant et inquié- tant du sacré est canalisé, épuré de ses reliquats idolâtriques également.
Les grands systèmes théologiques du XIIIe siècle poursuivent cette lente domestication que la Réforme protestante va parfaire. L’analyse de Max Weber sur la « rationalisation généralisée de l’existence », fon- dement du fameux « désenchantement du monde » (Entzauberung der Welt), est un moment important de l’évolution de l’idéologie moderne qui, de la théodicée des « lumières radicales » à la « Déesse Raison », va aboutir au rationalisme sans Dieu qui finit par s’imposer tout au long du XIXe siècle. On peut voir là ce que certains appelèrent la « marche royale du Progrès » qui, de Descartes à Durkheim, assura les bases de l’éducation morale d’individus dont l’ultima ratio (dernier argument) est de susciter, de conforter et de parfaire le « libre arbitre ». Libre arbitre secrétant, tout au long des siècles, une farouche volonté de perfection. Un activisme forcené cherchant, à tout prix, un monde meilleur. Ce peut être l’ascèse des athlètes de la foi, ou l’abnégation de la « valeur tra- vail », proposée par Karl Marx, que les héros du réalisme soviétique symbolisèrent si bien. Dans tous les cas, le « travail sur soi » ou le travail sur le monde devaient permettre de dépasser l’aliénation d’un monde corrompu. Le moralisme sémite (songeons ici à cette judicieuse formule de Joseph de Maistre : « Le mahométisme est une secte chrétienne. ») est d’essence apocalyptique. Il postule une rupture fondamentale entre un présent imparfait, voire abject, et un futur radieux. Ce monde-ci étant en constante dégénérescence : mundus jam senescit, il est dominé par le mal, que seuls l’action et le travail dont il a été question pourront dépasser.
Qu’elle l’exacerbe dans ses formes paroxystiques (ainsi les fanatismes religieux ou les racornissements racistes) ou qu’elle la dilue dans la contemporaine idéologie du correctness, la morale naît et se conforte dans une ambiance millénariste. Millénarisme diffus, utopiste ou catas- trophiste, ayant une constante fascination pour le désordre auquel, consciemment (révolution) ou inconsciemment (religion), on aspire, puisque c’est ainsi que l’on atteindra la parousie (achèvement du temps) ou la société parfaite promise par les théories d’émancipation qui fleu- rirent au XIXe siècle et dont on a pu, à juste titre, noter le caractère religieux. Peut-être est-ce cela qui donne cet air grognon à ces chevaliers à la triste figure que sont les moralistes de tous poils. Protagonistes qu’ils sont d’une « utopie du désastre8 » qu’ils tentent, en vain, de masquer sous des aspects avenants, mais dont le moteur essentiel est celui de la condamnation de ce « monde de misère9», la stigmatisation du simple bonheur d’être ; peut-être même de l’être tout court.
Je veux dire par là que pour reprendre une idée récurrente dans l’œuvre du psychologue des profondeurs, Carl Gustav Jung, et dans celle de l’an- thropologue Gilbert Durand, la tradition occidentale est, structurellement,
« schizophrène ». Elle coupe, dissèque, distingue. Tout comme Dieu, in illo tempore (en ce temps là), sépara la lumière des ténèbres, elle s’est employée à séparer, radicalement, le bien du mal. Dichotomisation du monde, qui, par après, se déclina à l’infini : nature/culture, corps/esprit, matérialisme/spiritualisme et autres coupures aussi radicales qu’abstraites. Cette attitude « analytique » suscita, certes, le développement scientifique et technologique, mais son « effet pervers » conduisit, également, à la « dévastation du monde » dont on n’a pas fini de subir les conséquences.
Ce qui est certain, c’est que c’est une telle schizophrénie qui est cause et effet de la thématique de la rédemption propre à une philosophie de l’histoire finalisée. Histoire du salut individuel, puis histoire du salut de l’humanité, le tout ponctué d’apocalypses religieuses et/ou politiques, voilà le socle irréfragable d’une telle tradition, dont le tropisme primor- dial se cristallise dans la logique du « devoir être ».
La logique du « devoir être » : saturation de la critique et effets pervers
John Henry Newman, Apologia pro vita sua, Genève, Éditions Ad Solem, 2008, 430.
Existe-t-il une différence essentielle entre Les Confessions de saint Augustin, Du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau et le Manifeste du parti communiste de Karl Marx ? Pas vraiment. Car à côté de multiples autres ouvrages d’édification, précédant les multiples livres de « déve- loppement personnel » dont le New Age contemporain s’est fait le spé- cialiste, ils soulignent la nécessité de l’émancipation vis-à-vis d’un donné naturel en fonction de ce qui pourrait être, de ce que l’on aimerait qui soit. On est bien au cœur de ce besoin paranoïaque de changer le monde. Injonction propre à l’activisme prométhéen qui servit de soubassement théorique au développement scientifique et au triomphe planétaire de la technique, spécificité du moralisme anglo-saxon. Parti de la Réforme protestante, ce dernier, en effet, l’emporta sur le scepticisme méditerra- néen pour lequel la claire rationalité et le paganisme mêlés conduisaient à s’abandonner à l’instant, à trouver naturel le naturel, à accepter l’inévi- table. Ce qui était bien résumé dans l’adage stoïcien : « ce sur quoi je ne peux rien, me devient indifférent ». Ce que Nietzsche cristallisa en son « amor fati », amour du destin. Mais comme toutes choses humaines, la force interne conquérante de ce prométhéisme devint, progressivement, rhétoriques de bons sentiments, homélies sirupeuses, propres à tous les livres d’édification, écrits par ceux que Max Weber appelait, en se moquant quelque peu, kathederpropheten.
D’où ce curieux pendant, propre au moralisme en général, au poli- tiquement, théoriquement et socialement correct en particulier, pour les idées généreuses qui, d’une manière hypocrite, stigmatisent avec une grande efficacité. Comme le dit avec justesse la sagesse populaire, qui en connaît un bout sur le sujet, « l’enfer est pavé de bonnes inten- tions ». Tant il est vrai que par un curieux effet pervers, celui des voies détournées (per via), ceux qui proclament le bien et imposent le bon, ne font que projeter leurs propres valeurs qu’ils érigent en absolu. La bien- pensance et l’universalisme vont, en général, mano con la mano (main dans la main).
D’où l’aspect normatif, judicatif qui, toujours, prévaut, dans la pos- ture morale. La critique, sous son aspect trivial ou intellectuellement sophistiqué, y est constamment à l’œuvre. Critique qui, ne l’oublions pas, était, à l’origine, l’instrument grâce auquel le juge soupesait les diverses parties en présence et, ainsi, évaluait leurs valeurs spécifiques. Le trébuchet du magistrat est encore à l’œuvre dans beaucoup de têtes. Tant il est vrai que c’est souvent, a priori, en fonction de représentations assez abstraites, voire d’idéologies éthérées, ou d’utopies fort généreuses, mais non moins désincarnées, que se sont perpétrées les pires pratiques inquisitoriales qui, comme on le sait, sont édictées pour le plus grand bien de celui qui les subit.
Mais comme pour les diverses inquisitions et nombreux tribunaux populaires ou de salut public, c’est l’angoisse diffuse qui est à l’origine de la posture judicative. Ou encore la peur à l’égard d’une vie se présentant souvent d’une manière effervescente. De tout temps les dames patron- nesses, archétypes du correctness, ont masqué sous un moralisme mes- quin une réelle haine de l’existence. Des esprits aigus, tels Max Scheler ou Friedrich Nietzsche, ont souligné le caractère aigri du ressentiment moral. Certes, il s’agit là de figures paroxystiques, mais la caricature est toujours instructive. En chargeant le trait, elle exprime en majeur, sans fard ni faux-fuyant, ce qui est vécu en mineur, dans la vie de tous les jours. En la matière, la peur vis-à-vis de ce qui est, mesurée à l’aune de ce qui devrait être.
En bref, la morale est une sorte de constante réprobation de ce qui se présente en fonction de ce que l’on se représente. N’est-ce pas ainsi que l’on peut définir, d’après Goethe, celui qui, avec constance, est en désaccord avec le monde dans lequel il se trouve : « der Geist der immer verneint », l’esprit qui toujours dit non ? Réprobation d’origine judéo- chrétienne, reportant la jouissance dans un monde meilleur, un « arrière monde » aux contours bien indéfinis, mais dont l’indéfinition même génère le besoin de la loi, aboutissant à l’abus des lois que l’on sait et dont la vie économique, sociale et politique fait les frais.
Écoutons ici John Newman, qui avec ingénuité, vend la mèche, lorsqu’il note que « la première doctrine que doit soutenir un maître infaillible est une protestation solennelle contre l’état du genre humain10 ». Ce cardinal dit crûment, mais avec justesse, dans la représentation philoso- phique qui est la sienne, ce que font tous les petits « maîtres infaillibles » qui semblent assez assurés de leurs croyances pour pouvoir vitupérer, solennellement, contre l’état du monde et le genre humain en particulier. Mais il convient également de reconnaître que si la caricature est instructive, elle souligne, dans son excès même, sa fragilité. En effet, nombre de proclamations morales sont, avant tout, des incantations. Et ce, en son sens le plus abstrait : ce que l’on chante, rituellement, pour essayer de s’en convaincre ; ou encore des formules magiques pronon- cées liturgiquement, afin d’obtenir des effets surnaturels. Ce sont bien ses racines profondes qui rendent la morale quelque peu désuète. Et le fait que l’opinion publiée « en rajoute », n’ôte rien à l’affaire. Le moralisme ambiant souligne, au contraire, que l’on est en train d’assister à la saturation de la logique du « devoir être » ayant marqué la modernité. Un autre liant du lien civique est en gestation. Il est important de savoir en dessiner les contours.
Ethique
Immanence de l’éthique : s’ajuster au « site »
Ne peut-on pas admettre, faisant en cela fond sur une sagesse immé- moriale, qu’au-delà du linéarisme historique, le devenir humain soit tributaire d’un cycle constant, ce qu’Anaximandre nommait genesis kai phthora, genèse et déclin ? En bref, qu’après le cycle de l’universalisme moral, revienne celui du particularisme éthique ? Hypothèse que le retour des phénomènes ethniques, des exacerbations tribales, des mul- tiples revendications localistes, toutes choses dont l’actualité n’est pas avare, semblent corroborer.
À l’encontre du millénarisme moraliste (dont j’ai indiqué que l’aspect incantatoire marquait sa fin), il convient d’être attentif à une ambiance diffuse mettant l’accent sur le détachement. Paradoxe : se détacher du lointain, afin de s’attacher à un lieu partagé avec d’autres. S’accorder, s’ajuster, tant bien que mal à ce monde-ci. Mystère de la proxémie. Le lieu faisant lien, voilà ce qui peut résumer la pertinence et l’aspect pros- pectif de l’éthique.
Il est une figure mystérieuse dont parle Saint Paul dans la « Seconde Épitre aux Thessaloniciens » (Thes. II ; 6), c’est celle du « Katechon » : celui qui retient, celui qui empêche la venue de l’Antéchrist, et donc, après ce dernier, la parousie ou l’achèvement des temps. Le « Katechon » est celui qui maintient en ce monde-ci, il permet d’éviter l’apocalypse ! Voilà qui est paradoxal dans la visée eschatologique, spécifique à la tra- dition chrétienne. C’est ce qui ne manque pas de poser problème aux divers commentateurs des épîtres pauliniennes. Le juriste Carl Schmitt fit de cette figure un usage judicieux dans sa lutte contre la logique du « devoir être » quelque peu abstrait et par trop rationnel11.
Pour ma part, je pense que l’on peut interpréter la figure du « Katechon » comme la métaphore du « oui » à la vie. À l’encontre du « non » de la critique, propre à la morale, dans l’attachement au plaisir d’être, se dit une irréfragable affirmation à la vie telle qu’elle est. Telle qu’elle se présente et non telle qu’elle se représente. L’éthique en son essence et l’éthique telle qu’elle est vécue au jour le jour, sont l’expres- sion d’un pur immanentisme ou, pour le dire autrement, d’un hédonisme diffus, s’employant à s’accorder, à s’ajuster au monde tel qu’il est.
J’ai bien dit l’éthique en son essence, et telle qu’elle est vécue. Ce qui n’est en rien l’utilisation du terme éthique pour parler d’une manière « chic » de la morale. Au travers de l’éthique, s’amorce un pivotement du temps, un temps tournant sur lui-même. L’indice d’un cycle qui s’achève, et l’amorce d’un autre en gestation : ce qui consiste à s’accorder au « site », au site de la vie. On rapporte que Hegel devant les montagnes de Suisse, ne trouva à dire que « c’est ainsi ». Banalité ou amère sagesse, c’est tout cela qu’il faut avoir le courage intellectuel d’appliquer à toutes choses : elles sont ainsi.
Pour le dire en des termes plus soutenus : au-delà ou en deçà de la subjectivité, de la conscience souveraine créatrice du monde (l’homme « maître et possesseur12 » du monde naturel et social), l’éthique traduit l’expérience concrète, cum crescere, ce qui croît avec. En ce sens, l’éthique exprime la substance même du vivre ensemble populaire, ce qui le constitue en son fond, ce qui constitue son fonds. Ce que Hölderlin nommait l’essentielle intimité : innigkeit. À la fois sa réalité intime, et ce qui assure la communauté avec les autres13.
Il ne s’agit plus là de l’« esprit appris » qui, dans la foulée du ratio- nalisme de la philosophie des Lumières, va considérer que tout peut s’apprendre. Que l’on peut éduquer l’individu en particulier, le peuple en général. Que l’on peut les « tirer » vers le bien et le bon. Grande prétention ou courageuse ambition ayant caractérisé toute la modernité et ayant été au fondement même de l’idée du contrat social : « l’être ensemble » est structurellement rationnel, c’est l’esprit humain qui de part en part le construit.
Une éthique de l’esthétique : les pactes émotionnels
René Descartes, « Réponses aux troisièmes objections », in Œuvres et Lettres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1953, p.414.
Le « donné mondain » renvoie à une forme d’acceptation de ce qui est « donné » par ce monde-ci. Le « donné » s’opposant à l’habituelle idéologie de la « construction » propre à la tradition occidentale et moderne, le « mondain » rendant attentif à l’espace où l’on vit, ici et maintenant, sans espoir d’un quelconque « arrière monde ».
Pierre Bourdieu, L’Ontologie politique de Martin Heidegger, Paris, Éditions de Minuit, 1988, 23 et p. 56.
Michel Maffesoli, Le Temps Formes élémentaires de la postmodernité, Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Des paroles et des hommes », 2010.
Jacob Taubes, En Divergent Accord. À propos de Carl Schmitt, Paris, Payot, coll. « Rivages Poches », 2003, p. 87.
Ce que l’éthique est en train de redécouvrir, c’est qu’à côté du « construit », il y a du « donné ». Au fondement du pouvoir rationnel, existe la puissance émotionnelle. Peut-être est-ce cela que la complexe, et parfois mystérieuse, pensée de Descartes – à ne pas confondre avec le cartésianisme vulgarisé – appelle les « idées innées ». Certes, pour lui, il existe des idées que tout un chacun se forge de lui-même (« idées factices »), il en est d’autres qui viennent de l’expérience (« idées adven- tices »), mais certaines, profondément enfouies sont nées (innatae) avec moi. Voilà de quoi relativiser l’esprit construit de la morale : « Lorsque je dis que quelque idée est née avec nous, ou qu’elle est naturellement empreinte en nous, je n’entends pas qu’elle se présente toujours à notre pensée, […] mais seulement que nous avons en nous-mêmes la faculté de la produire14. »
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le retour de l’éthique est, si l’on s’accorde au mot en son sens plénier, une véritable « innovation », à savoir ce qui invente la vie, en faisant venir au jour (in venire) ce qui est là, enraciné d’antique mémoire ; ce qui permet de penser l’actuel à partir du substantiel. Ce qui, au-delà des évènements propres à la politique ou à la morale, met l’accent sur un avènement n’étant que l’illustration de l’immémorial. Alors que l’évènement exprime une histoire, collective, que l’on peut toujours maîtriser, l’avènement renvoie à un destin auquel il convient de s’accommoder.
Alors que la morale est une course éperdue vers l’au-delà (céleste ou terrestre), celui de la « Cité de Dieu » ou de la société parfaite, l’éthique est un lent retour vers un en deçà, vers l’origine, vers « l’archaïque » caractérisant ce qui est premier, fondamental. Le socle primitif de tout être ensemble. L’éthique exprime l’expérience primordiale du « donné mondain15 ». À l’encontre du jugement, elle privilégie l’intuition. Elle complète la raison par le sensible. Ou plutôt, elle « sensibilise » la raison. C’est tout cela qui peut permettre de comprendre la crainte habituelle de l’intelligentsia « éclairée » vis-à-vis de ce que fut la philosophie de la vie, celle qui de Nietzsche à Bergson mit l’accent sur l’empathie, l’in- tuition, la prévalence des affects et diverses manifestations des passions communes, crainte quelque peu déphasée, quand on voit dans la vie quotidienne, les multiples manifestations d’un émotionnel de plus en plus envahissant. Plutôt que de le dénigrer systématiquement, peut-être vaut-il mieux en voir l’efficacité, la pertinence et l’aspect prospectif.
Il ne sert à rien, d’une manière péremptoire et quelque peu arrogante, de condamner ces « liens naturels, irrationnels, éthiques16» (la juxta- position de ces termes est on ne peut plus éclairante !). Mais bien de voir qu’à l’opposé d’un lien social purement mécanique, rationnel et moral, à certains moments, peut-être par simple compensation, on voit revenir une « reliance17 » beaucoup plus organique, mettant en jeu pas simplement un « morceau » du corps individuel et social (le cerveau, le cognitif), mais l’entièreté de ce même corps. Entièreté où à côté du rationnel, s’exprime aussi l’émotionnel : les affects, les humeurs, en un mot la complexité de l’humain.
L’éthique ainsi comprise est loin d’une morale transcendante, toute en attente d’un monde à venir et reposant sur une valeur unique, mono- théiste. Bien au contraire, axée sur le présent, elle est tout à la fois imma- nente et polythéiste. C’est cela qui peut faire parler d’un immoralisme éthique que l’on peut voir à l’œuvre dans nombre de pratiques juvéniles et, plus généralement, dans ce que l’on peut, métaphysiquement, appeler les « tribus postmodernes ». En celles-ci, ce qui prévaut, c’est le fait de vivre, ensemble, des expériences collectives, de « vibrer ensemble ». C’est ce que les sociologues appellent l’empathie ou la syntonie. Expressions tradui- sant, au-delà de l’enfermement dans la conscience individuelle, la pulsion animale de « s’éclater », c’est-à-dire de participer magiquement, mystique- ment à ce que Durkheim appelait les « effervescences communautaires ». On peut, en ce sens, parler d’une éthique de l’esthétique, c’est-à-dire au plus près de l’étymologie de ces termes, d’un lien, d’un ciment à partir des émotions ou des passions partagées, tant il est vrai que l’empathie ou la syntonie se retrouvent dans la multiplicité des phénomènes festifs, des occasions ludiques et autres fantaisies collectives dont l’actualité donne des exemples à foison. Éthique et esthétique ! Certains esprits grincheux n’ont pas manqué de vitupérer contre l’émergence d’un homo festivus. Et ce en oubliant qu’une telle conjonction fut à l’origine de grandes cultures. Le Quattrocento italien et la Renaissance française en portent témoignage. Notons, tout simplement, que si l’homo sapiens fut au fondement du progressisme occidental, l’homo ludens met l’accent sur une conception plus complexe de l’humanité, celle de la « progressivité » impliquant l’ap- port du passé et de la tradition. En bref, des formes archaïques, c’est-à-dire originelles, de tout vivre ensemble. C’est ainsi que l’on peut comprendre cet indéniable hédonisme populaire, s’exprimant, au mieux, dans une éthique pleine de bon sens : la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. Ce qui traduit, tout à la fois, une clairvoyance de bon aloi, mais également, plus profondément, le fait que le peuple est artiste : créateur de sa vie « en participant » à cette création, celle de la vie en général.
Voilà ce qui peut chagriner les grincheux dont il a été question. La République n’est pas une et indivisible, c’est-à-dire reposant sur une valeur unique façonnée par l’esprit de sérieux. La Res publica est une mosaïque plurielle, où de multiples valeurs, dont celle du plaisir d’être, peuvent occuper une place de choix. C’est ainsi qu’à l’opposé de l’utilitarisme qui prévalut durant toute la modernité, et dont la morale fut l’expression achevée, la « chose publique » retrouve, au travers de l’éthique, l’impor- tance de l’inutile : le prix des choses sans prix. Importance du frivole, du superflu, nécessité du luxe, exprimant, pour l’aristocratie populaire, le désir du non fonctionnel. Le bénévolat, les nouvelles formes de solidarité ou de générosité en sont les expressions achevées.
L’éthique, en son immoralisme, est l’expression d’une société ouverte, polyculturelle, relativiste. Société dans laquelle le choc des valeurs est gage d’une harmonie conflictuelle. C’est-à-dire non pas une harmonie a priori, purement intellectuelle et quelque peu abstraite, celle du contrat social, mais une harmonie a posteriori, c’est-à-dire concrète et intégrant l’entièreté des spécificités humaines, harmonie issue du pacte émotionnel. Pour reprendre une remarque de cet esprit aigu qu’est Jacob Taubes : « Le monde n’est pas aménagé pour que quelques intellectuels jouent à quelques jeux verbaux, il l’est pour que les gens y vivent18. »
L’écosophie : la sagesse attachée à la maison commune
Aristote, Éthique à Nicomaque, II, I, 17-18.
Hans-Georg Gadamer, Vérité et Méthode, Paris, Seuil, 1996, 298. Cf. aussi Années d’apprentissage philo- sophique. Une rétrospective, Paris, Criterion, 1992, p. 275.
Alain, Souvenirs concernant Jules Lagneau, Paris, Gallimard, 1925, p.130.
Vivre en ce monde-ci, c’est s’ajuster à lui et non pas le contraindre avec la brutalité coutumière au progressisme occidental. Pour para- phraser Aristote, la « vertu éthique » dérive de l’habitude (ethos), d’où elle tire son nom19. C’est-à-dire d’une attitude faite de prudence par rap- port à un lieu que l’on partage avec d’autres. C’est cela l’écosophie : la collective sagesse à l’égard de la maison commune que l’on a à ménager et non à dévaster à merci. Sagesse n’étant pas forcément conscientisée, mais qui, en fonction d’un savoir incorporé – on pourrait dire intériorisé –, « sait » limiter son attitude prédatrice. Et ce, parce qu’en fonction d’un instinct animal, la sagesse écosophique, autre manière de nommer l’éthique, comprend qu’en étant trop prédateur, c’est soi-même qu’à terme on risque d’éliminer. Ce qui induit que ce n’est pas en fonction d’un but à atteindre que se détermine l’éthique, mais qu’elle le fait, à partir de l’origine, de la source primordiale. Voilà bien la spécificité du « rythme de la vie » propre à l’éthique : il y a un point de départ qui donne naissance à l’existence.
Formulons cela en termes plus philosophiques. C’est le terminus ad quem, c’est-à-dire ce vers quoi l’on tend, qui est le moteur du moralisme occidental, lequel est fondé sur un rationalisme qui se « finalise » : qui a un but. Le terme « sens » en sa polysémie est instructif. Il désigne tout à la fois la signification et le sens des choses de la vie. C’est une telle finalité qui est à l’origine de la performativité de l’Occident. C’est cela aussi qui en souligne la crise.
À l’encontre de cela, l’éthique pourrait se caractériser par un terminus a quo, d’où l’on vient. Par le « site » à partir duquel l’espèce humaine, et les « tribus » qui la constituent se situent, ce qui veut dire que l’éthos consiste à accepter, sans illusion, les choses telles qu’elles sont. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est reconnaître le caractère naturel des choses naturelles. Ne pas avoir la prétention de maîtriser et dominer le monde, mais, au contraire, l’humilité, qui ne manque pas de grandeur, de s’ajuster à lui. D’en être le gardien attentif et bienveillant.
Puis-je, ici, solliciter le philosophe Hans-Georg Gadamer ? « En vérité, ce n’est pas l’histoire qui nous appartient, mais nous qui lui appartenons. Bien avant que nous accédions à la compréhension de nous-mêmes par la réflexion sur le passé, nous nous comprenons de manière spontanée dans la famille, la société et l’État où nous vivons. La prise de conscience de l’individu par lui-même n’est qu’une lumière tremblante dans le cercle fermé du courant de la vie. C’est pourquoi, les préjugés de l’individu, bien plus que ses jugements constituent la réalité historique de son être20. »
Cette familiarité au monde environnant, cette spontanéité par rapport au « site » dans lequel on se trouve, les préjugés tribaux qui font ce que nous sommes, voilà bien les fondements de l’éthique. Voilà aussi qui doit nous ramener à plus d’humilité. Celle des racines. Mais à un enracinement qui peut être dynamique. C’est un tel attachement à un lieu, attachement qu’il convient de comprendre en son sens le plus strict, qui est au fondement même de l’union du sens commun et de la droite raison. Union qui, sur la longue durée et au-delà des morales particu- lières (« Vérité en deçà des Pyrénées, fausseté au-delà… »), sert de fon- dement à la sagesse populaire. À la véritable intelligence (intelligere, lier) unissant ce qui est épars.
Cette fonction de « reliance » de l’éthique, enracinée, donc dyna- mique, peut permettre de comprendre qu’au-delà des pouvoirs éphé- mères, que ceux-ci soient économiques, politiques, sociaux ou symbo- liques, existe une puissance de base qui, elle, perdure dans le temps, et ce parce qu’elle est souchée sur le temps immémorial de la tradition. La puissance éthique sait, de ce « savoir incorporé » dont il a été question, que le pouvoir moral est provisoire : et illud transit , cela aussi passera.
Une certaine sociologie a su discerner, en des termes fort simples, que l’institué ne peut perdurer que s’il est enté sur l’instituant, hanté par lui. C’est en ce sens que la théologie catholique a toujours souligné que l’église hiérarchique institutionnelle, visible, n’avait de légitimité qu’en référence au « corps mystique » propre à la communauté de la grâce. Communauté tout à la fois immatérielle, mais non moins réelle et consti- tuant, en son sens sculptural, l’âme, c’est-à-dire le noyau central de l’ar- chitectonique ecclésiale. De la même manière, l’idéalisme allemand, en son moment effervescent, verra les jeunes Hegel, Schelling et Hölderlin opposer l’église visible à l’Église invisible, celle-ci assurant le soubassement, irréfragable, de celle-là.
Références allusives n’ayant pour seule ambition que de rendre attentif à la communauté de destin que l’éthique conforte. Elle incarne en un lieu donné, elle permet la fidélité à « l’immense existence », cause et effet de ce monde-ci. L’éthique (ethos) en tant que prise au sérieux du « site » où l’on vit, intègre le vivre ensemble dans le long et complexe passé où les formes archaïques, les strates de l’inconscient collectif assurent, sur la longue durée, la pérennité de l’espèce. Ainsi que le rappelle le philosophe Alain : « L’analyse platonicienne, si on la suivait selon l’esprit païen et sans préjugé théologique […] montrait les rapports éternels, impliqués dans le texte de l’expérience21. »
Il y a en effet quelque chose de païen dans l’éthique, en ce qu’elle implique à partir de l’expérience commune dans ce monde-ci. Nouvelle et éternelle sagesse, celle de l’écosophie dont on (re)commence à appré- cier la pertinence et l’aspect prospectif.
Déontologies
Élan vital et « situationnisme » des déontologies
La morale est donc, dans son essence, ce vers quoi l’on tend : le sens de la vie en tant que finalité, le but lointain. L’éthique, quant à elle, est tributaire de ce d’où l’on vient. D’où l’importance du « site ». Voilà pour l’éthos, mettant l’accent sur la signification de la vie, ici et maintenant. La déontologie accentuerait l’entre-deux. Être là, et comment se comporter en conséquence.
On est loin, bien entendu, du sens habituel et quelque peu abâtardi, accordé à ce terme. Il désigne, au contraire, le fait de vouloir ce qui est. Conception tragique s’il en est, reconnaissant que l’on ne maîtrise pas l’environnement naturel et social, mais que, autant que faire se peut, on s’ajuste aux forces primordiales, instinctives du vivre ensemble. La déontologie, peut-être vaudrait-il mieux dire les déontologies, sont l’expression d’un élan vital dont l’évanescence est la caractéristique essentielle. Il n’y a pas de bien ou de mal substantiels (cela la morale le gère), mais des successions d’instants uniques, impliquant une suite de décisions ayant l’intensité et la précarité de l’éclair.
C’est en ce sens que les déontologies sont tragiques. Mais non moins exaltantes ou authentiques, en ce que d’une manière stoïcienne, elles incitent tout un chacun à faire son métier d’homme et à « laisser le reste aux dieux » , manière courtoise de se moquer de ce qui n’est pas de notre ressort. Tragiques, car elles soulignent la facticité de l’existence. Mais, en même temps, le factuel accentue la grandeur de la situation, des situations concrètes, ce qui induit une réelle créativité. Le « faire de sa vie une œuvre d’art », pour le dire au travers d’un lieu commun nietzschéen, tend subrepticement à se répandre et se retrouve, d’une manière diffuse, dans nombre de pratiques juvéniles.
Tout cela souligne le refus de la sécurité de croire, et le désir de comprendre et de vivre l’ordre du monde. Un ordre où la nécessité a sa part. Nécessité acceptée sans illusion, sans miséricorde, sans espoir de délivrance : la vie sera ce qu’elle peut être. Voilà bien l’orbe des ontologies : œuvre de tout un instant, d’une éternité se contractant en un moment et pour cela œuvre de tout instinct, ce qui pour vivre, s’accorde à ce qui est. Déontologie comme « situationnisme », ou comme « surréalisme ».
L’un et l’autre s’attachant, dans tous les sens du terme, à la survie. D’où l’intensité, qui est certainement la tonalité de l’époque. Intensité des relations : l’affect, l’émotionnel plus que le rationnel. Intensité de l’instant dont pâtit le politique ou, d’une manière plus générale, toutes les pratiques sociales reposant sur le projet. L’intensité c’est, avant tout, une énergie qui est tendue dans (in tendere), la nature partenaire, la tribu « affectuelle22 », le proche auquel on participe. En ce sens, d’une manière diffuse, pour l’imaginaire du moment, l’existence n’est point une substance, elle est tout en devenir. Mais un devenir n’étant tel qu’en fonction de la nécessité. Nécessité que la morale s’employait à nier, à dénier, à dépasser, alors que les déontologies s’astreignent à l’accepter et à composer avec elle.
Qu’est-ce que cela induit ? En termes savants, c’est le « savoir pratique » que l’on retrouve chez Aristote. Mais c’est également, dans la facticité (Heidegger), c’est-à-dire le vécu de l’expérience quotidienne, le « système D », ce que Lévi-Strauss nomme le « bricolage », ce que l’on ne manque pas de retrouver dans de nombreuses langues : jeitinhio brésilien, combinazione italienne, et autres biais par lesquels et grâce auxquels on s’ajuste à ce qui est. Peut-être est-ce cela qui, au-delà du ressentiment moral, fait que la déontologie est la vertu des forts, de ceux qui n’ont pas besoin des consolations illusoires, de ceux qui ne voient dans les doctrines vertueuses que d’insanes piperies à usage des esprits faibles.
Ainsi, alors que la morale, par le biais de l’institué (les multiples institutions sociales), bride le laisser-aller de l’instinct, celui des forces primordiales du vouloir vivre, les déontologies favorisent le laisser-être, propre à la richesse et à la complexité de l’immense existence. Elles reconnaissent qu’il est vain de chercher un sens (finalité) aux choses et à la vie. Elles refusent la tranquille certitude rationaliste postulant que rien ne peut être hasardeux ou contingent. Toutes choses trouvant leur origine dans la croyance en ce monothéisme où Dieu est, tout à la fois causa sui, sa propre cause, et cause de tout. En prenant le contrepied de ces assurances sans risque, les déontologies sont proches de la position de Spinoza, reconnaissant qu’il « suit de là que toutes les choses particu- lières sont contingentes et corruptibles23 ».
Il s’agit là d’idées fort simples – on pourrait dire de bon sens –, et pourtant bien difficiles à admettre. Tant il est vrai que les évidences intellectuelles empêchent, bien souvent, de voir ce qui est évident. Mais au risque de lasser, il faut répéter ces banalités de base. D’autant que, le correctness étant à la mode, les bons sentiments s’infiltrent partout, et tiennent, la plupart du temps, lieu d’analyse. Après la langue de bois politique, c’est la morale qui emprunte les mêmes chemins de traverse en se complaisant en quelques formules convenues, répétées, d’une manière lancinante, d’un air entendu, mais dont on peut être sûr qu’elles ne prêtent pas à conséquence, tant le peuple les tient pour quantité négligeable.
Voilà pourquoi il convient de rabaisser la pensée au rang d’un jeu de rhétorique. La pensée lucide est dénuée d’a priori, avance toujours par corrections, par reprises. Elle n’est jamais établie une fois pour toutes, car elle sait que tout est en devenir, surtout la question de l’être. Elle se refuse aux injonctions pressantes, à ce qui semble urgent. Elle sait user de la nonchalance de Socrate, ou du sourire de Platon. Attitude de sagesse pressentant que la vérité ne réside point dans la certitude issue d’une conscience souveraine, mais bien dans le dévoilement progressif de ce qui est. Ce que l’expérience grecque nommait aletheia, montrer ce qui est. De montrer à « monstrer », il n’y a qu’un pas.
C’est ainsi qu’il convient de décrire un monde qui, en son clair-obscur, est au-delà ou en deçà des représentations tout à la fois abstraites et tranquillisantes. Il est des moments où pour saisir la figure du destin en ses aspects les plus anodins, inapparents, voire frivoles, il faut savoir user des métaphores qui sont plus pertinentes que des énoncés apodictiques. On l’a compris, la sensibilité déontologique est rétive à ceux-ci, alors qu’elle est en parfaite congruence avec celles-là. Ce qui ne manque pas de susciter la méfiance d’une intelligentsia préférant la médiocrité bien- pensante à la roborative lucidité.
Une puissance des choses qui exige une adaptation à la différence
Alain, Souvenirs concernant Jules Lagneau, Paris, Gallimard, 1925, p.30 et p. 173.
Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Paris, Éditions de Minuit, 1992, p.57.
John Henry Apologia pro vita sua, Genève, Éditions Ad Solem, 2008, p. 227. Cf. aussi Michel Maffesoli, L’ombre de Dionysos, contribution à une sociologie de l’orgie (1982), CNRS Éditions, 2010.
Michel Maffesoli, L’Ombre de Dionysos, contribution à une sociologie de l’orgie (1982), CNRS Éditions, 2010.
Martin Heidegger, Approche de Hölderlin, Paris, Gallimard, 1962, p.72.
Mais présenter ou « monstrer » ne sont pas synonymes de passivité. Il en est de même pour la déontologie, qui désigne une autre forme d’action mettant l’accent sur la puissance des choses, sur le dynamisme de leur nature. En effet, la reconnaissance, détachée et un peu ironique de la puissance intrinsèque des choses, n’a pas, n’a plus la prétention « don- quichottesque » de modifier de fond en comble ce qui est. Tout au plus de corriger, ici ou là, ce qu’il est nécessaire de faire. Dès lors que l’on s’accorde sur la facticité de l’existence, on se contente d’en limiter les méfaits. Là est la différence essentielle entre la prétention morale et l’hu- milité des déontologies.
Pour celles-ci il convient d’agir non pas en fonction de principes abs- traits et généraux, mais concrètement et en fonction du moment. C’est ainsi que l’on peut comprendre le propos d’Alain : « À changer les lois, nous ne trouvons point de prise ; au lieu que la circonstance singulière est appui pour l’homme au contraire, et instrument d’action24. »
Là encore contre l’urgence abstraite et l’indignation désincarnée, le détachement nonchalant d’un Socrate sachant par son sourire ironique correspondre au vécu de la vie, en ce qu’elle a de singulier et de général, semble plus judicieux. Est-ce anachronique de parler à cet égard d’un « universel concret » ?
Voilà bien l’enjeu du « situationnisme » déontologique : rappeler qu’à l’opposé de ce qui est le fondement des diverses injonctions morales, l’être, en ses modalités individuelles ou collectives, ne se réduit pas à la conscience. L’être, en son entièreté, est instincts, affects, sens. De plus, il pense moins (ego cogito) qu’il n’est pensé par la chaîne ininterrompue des générations passées. On a traduit par « Genèse » le terme hébreu Todelot, signifiant « les engendrements ». Ce pluriel prête à réflexion en ce qu’il met l’accent sur la secrète puissance du temps des généra- tions qui, sur la longue durée, accumulent les situations de l’expérience humaine.
Non pas une expérience individuelle dont tout un chacun est respon- sable et redevable, mais l’expérience commune s’enracinant profondé- ment et servant de terreau à la singularité et aux situations factuelles. Les déontologies, d’une manière paradoxale, sans être assurées par une conscience souveraine et tout en étant soumises au vent du large, aux aléas de l’existence quotidienne, tirent leur sûreté des engendrements successifs faisant que l’on se réalise non pas à partir de soi-même, mais grâce à l’autre antérieur. Pour le dire un peu plus trivialement, on
« s’éclate » dans l’autre. Situation banale dans les tribus pré et postmo- dernes, où l’on est pensé et agi par l’autre, où l’on n’existe que par et sous le regard de l’autre. En des termes plus académiques, l’historien Erwin Panofsky décrivant l’action de l’abbé Suger, se situant dans une lignée dont il est tributaire, parle de « ce besoin de se grandir par métem- psychose25 ».
Belle expression pouvant nous chagriner quelque peu, ou rabattre notre caquet rationaliste, mais n’en soulignant pas moins, pour reprendre une formule du sens commun, que s’il n’y a qu’une vérité absolue, c’est qu’il n’y a pas de vérité absolue ! Les déontologies, autre manière de dire la déambulation existentielle, sachant s’accommoder de cette amère pensée. D’autant qu’elle tend à se diffuser. Elle est au fondement du relativisme ambiant. Et les divers fanatismes, en leur aspect sanglant, ne font que confirmer a contrario que la tolérance est à l’ordre du jour.
Amère pensée rappelant que si « l’homme a toujours aussi bien pensé » (Lévi-Strauss), c’est toujours en reconnaissant la diversité des points de vue, des manières d’être, des « us et coutumes » assurément pluriels. La mosaïque étant l’expérience achevée d’une cohérence struc- turelle à partir de la multiplicité. Il faut de tout pour faire un monde, rappelle la sagesse populaire. Et concrètement, dans la vie de tous les jours, au-delà de l’a priori intellectuel, tout un chacun s’accorde à la différence et s’accommode d’elle. Telle peut être la leçon des déontolo- gies : au-delà de ce qui est dit, d’une manière dogmatique, dans le vécu empirique la différence enrichit. Voilà bien, selon l’adage latin « quod semper, quod ubique, quod ab omnibus », le fondement concret, de ce qui est vécu « toujours, partout, par tous ».
En bref, une loi abstraite, celle d’un contrat social élaboré dans la foulée du rationalisme propre à la philosophie des Lumières – aussi généreuse soit-elle –, ne doit pas oublier que les hommes sont sinon tota- lement dominés par les passions, du moins tributaires d’elles. Réalité qu’il est vain d’oublier sous peine de tomber dans un artificialisme qui, à terme, fragilise le lien civique. Les déontologies, en revanche, rendent compte d’un tel état de fait sur lequel peut se fonder ce qui est de droit. C’est en ayant ce rapport, de bon sens, entre le de facto et le de jure que Durkheim put énoncer, justement, que la loi suit, toujours, les mœurs. Voilà bien ce que l’on appelait l’humanisme intégral propre à la sensibilité déontologique : faire d’une faiblesse une force. Reconnaître qu’une humanité pleine et entière s’érige à partir de la fécondité de l’humus. Pour reprendre la belle expression de Montaigne, la grandeur de « l’hommerie » consiste à profiter des aléas, autre manière de dire la radicale incertitude de notre condition, pour aboutir à un « plus-être » authentique. C’est en déniant cela que « l’homme se pipe » : il est dupe de lui-même, et il dupe les autres.
Les pratiques quotidiennes, aussi fausses puissent-elles paraître, aussi fausses soient-elles, sont progressivement intégrées, canalisées, banali- sées. Je l’ai déjà dit, il faut le répéter : l’anomique d’aujourd’hui est le canonique de demain ! C’est ce que reconnaît ce fin observateur de l’âme humaine, John Henry Newman, en montrant comment « les croyances et coutumes populaires » sont, à la longue, « sanctionnées par Rome ». Les « erreurs dominantes » devenant dès lors « vérités acceptées par tous26 ». J’ai pour ma part montré, en parlant d’une « sociologie de l’orgie27 », c’est-à-dire d’une reconnaissance des passions communes, comment sur la longue durée le génie du christianisme avait consisté dans la récupération des croyances communes : nombre de divinités locales étant devenues des saints respectables vénérés par tous !
Il y a, dans une telle mise en perspective déontologique une expérience cruciale, experimentum crucis unissant tous les aspects apparemment disparates de l’expérience humaine, tant individuelle que collective. Dans la durée du « situationnisme » déontologique, c’est comme un court-circuit du passé, du présent et de l’avenir qui se vit au jour le jour. J’ai parlé pour exprimer cela d’un enracinement dynamique où, dans la chaîne ininterrompue du temps, le futur n’est plus, comme dans la morale, un absolu conditionnant l’existence individuelle, mais celle-ci ne faisant sens qu’en référence à ce (ceux) qui est (sont) passé(s), ce qui assure une plénitude d’être : l’éternité vécue au présent, voire dans l’instant.
C’est en prenant au sérieux un tel état de choses, dont la postmoder- nité est le paradigme achevé, qu’à la place des mots creux, une parole pleine peut naître. C’est en reconnaissant ce va-et-vient entre le « fait » et le « droit » que dans l’organicité réelle du vivre ensemble, et dans la complémentarité des fonctions on acceptera que le poète nomme le sacré, le penseur dise l’être et le politique s’occupe de l’étant. Complémentarité accentuant le fait que « comme l’avenir lui-même repose et s’attarde dans son initialité, le ressentiment de ce qui vient est en même temps une pensée du futur et une mémoire de l’antérieur28 ».
Devoir être, pouvoir être, vouloir être
Dans la panoplie d’instruments proposés à notre espèce animale pour fonder et légitimer le vivre ensemble, il existe, suivant les époques, des moyens d’action fort différenciés. Il n’est pas question d’établir entre eux une hiérarchie précise ou de porter un jugement sur ce qu’ils repré- sentent. Il suffit de repérer le moyen ou mode opératoire qui est le plus pertinent à un moment donné.
C’est ainsi que la morale, en son principe, repose sur une logique du « devoir être ». En privilégiant les valeurs abstraites, éternelles, appli- cables en tous lieux et en tous temps, elle est censée apprendre, d’une manière universelle, ce qui est juste. C’est au nom de cette justice intemporelle, et quelque peu désincarnée, qu’elle a été établie, dans le cadre des législations nationales. La prévalence du contrat ayant contaminé également le droit international.
L’éthique, quant à elle, se contente de la justesse. À partir d’un enracinement dans un « site » donné, site réel et virtuel (le quartier ou Internet), elle s’emploie à favoriser le « pouvoir être ». Elle est particulière, locale et particulièrement repérable dans la multiplicité des « afoulements » postmodernes (musicaux, religieux, sportifs) où le ludique et le festif occupent une place de choix. Elle est cause et effet des vibrations communes, des passions et émotions collectives. Toutes choses renvoyant à ce que l’on a pu nommer une « éthique de l’esthétique ».
Quant aux déontologies, elles mettent l’accent sur l’importance des situations vécues au jour le jour. Toutes ces choses anodines, familières, situations propres à la vie quotidienne que les esprits sérieux relèguent dans la rubrique de l’inessentiel. Or la sagesse populaire sait bien, de savoir incorporé, que c’est dans le « banal » que gît la perdurance d’un groupe, et de l’espèce en son entier, le terreau quotidien étant ce à partir de quoi croît la vie sociétale. On est là dans la rubrique du « vouloir être » qui, à certains moments, s’exprime comme une impérieuse exigence.
« Devoir être », « pouvoir être », « vouloir être », telles sont bien les modalités du lien civique. Il faut savoir trouver celle qui est en congruence avec le temps, trouver les mots permettant de remédier aux maux du moment. Faute de quoi notre aimable animalité risque de finir en pure bestialité. Dans le theatrum mundi (théâtre du monde), il ne faut pas se tromper de rôle, mais bien faire œuvre de discernement pour repérer, en fonction des formes laissées par la tradition, ce qui est véritablement prospectif. N’est-ce pas ainsi qu’il convient d’entendre l’avertissement de Léon Bloy : « Le prophète est celui qui se souvient de l’avenir. » ?

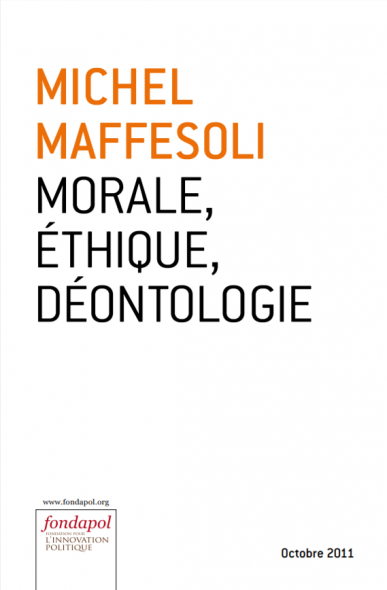

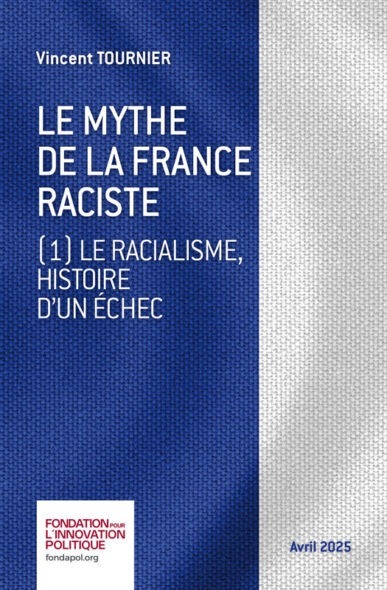









Aucun commentaire.