Portrait des musulmans de France : une communauté plurielle
Du concept au réel
L’islam en France : une Histoire tumultueuse
Une population, des communautés ?
Les contours de la communauté musulmane
L’électorat musulman, miroir aux alouettes
Français et musulmans, une identité à inventer
Trajectoire et identité
Musulmans de France, une exception française
Ethnicisation de l’islam
Présence consulaire
Individualité vs communauté
Rupture générationnelle
Des courants forts en interne
La question du leadership
Structurer une communauté Fantasmée
Vingt ans d’«islam de France»
Conclusion
Résumé
Depuis plus de vingt ans, l’islam en France se retrouve régulièrement au centre du débat public. Si l’idée qu’il existe une communauté musulmane est largement répandue dans l’opinion, la réalité est plus complexe. Concept clé en islam, la oumma, au sens de communauté de foi, se reflète-t-elle sur le terrain ? Cette note tente d’apporter des éléments d’analyse pour mieux définir la communauté musulmane.
Régulièrement objets de polémique, les Français musulmans constituent pourtant une population hétéroclite. Qu’il s’agisse des courants, des trajectoires de vie ou même des liens avec les pays d’origine, l’islam en France est loin d’être un cadre uniforme et immuable.
À y regarder de plus près, on perçoit à quel point l’idée d’une communauté relève du fantasme, terreau fertile aux raccourcis. Cette perception erronée des musulmans renvoie aussi à l’histoire entre l’Occident chrétien et l’Orient musulman, où les croisades ont marqué le début d’une relation tumultueuse. Un effort de compréhension est indispensable tant les musulmans de France sont à l’image d’une religion où cohabitent plusieurs courants de pensées. À l’heure où les crispations atteignent leur paroxysme, éclairer cette question reste un préalable pour combattre tous les obscurantismes et favoriser des relations plus harmonieuses au sein de notre communauté nationale.
Nadia Henni-Moulaï,
Journaliste, fondatrice de MeltingBook, entrepreneure et auteure.
Du concept au réel
L’islam de France cristallise souvent l’attention de l’opinion publique à travers les médias et les politiques. Une réalité qui s’explique, en surface, par le contexte international. Les attentats du 11-Septembre commandités par al-Qaida et aujourd’hui les atrocités commises directement ou indirectement par l’État islamique en France, notamment, les 7, 8 et 9 janvier 2015 puis le 13 novembre 2015, se répercutent sur la perception de l’islam de France, et donc des musulmans français résidant dans l’Hexagone. Ainsi, depuis 2001, l’islam et ses représentants occupent de manière croissante les titres des médias et les discours politiques. Durant ces dernières années, il a été difficile d’échapper aux polémiques concernant la population musulmane en France, initiée par la classe politique et reprise par la presse ou inversement.
Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la mise en place du ministère de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement a débouché sur un débat identitaire confus. Un tel débat ne doit évidemment pas être tabou mais à condition de pouvoir conduire à des perspectives constructives. Or ce débat a été parasité par celles et ceux qui ont voulu accréditer l’idée d’une incompatibilité entre islam et nation française. Déjà, en 2009, l’affaire du Quick halal, un exemple parmi d’autres, avait remis en cause, selon certains, les fondements de la République et de la laïcité. La chaîne de fast-food, très au fait du marché que représentent les musulmans, proposait des hamburgers halal dans huit de ses restaurants. René Vandierendonck, maire socialiste de Roubaix, l’une des villes pilotes retenues pour l’expérience, avait alors saisi la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde)1 pour dénoncer une pratique «discriminatoire». L’affaire avait gagné en intensité lorsque plusieurs personnalités politiques, dont Marine Le Pen, avaient critiqué le choix stratégique de Quick. Une fois de plus, la majorité silencieuse des Français musulmans qui aspiraient à l’indifférence se retrouvait sur le devant de la scène politico-médiatique sans vraiment contrôler son image. Prières de rue, nounous voilées, voile à l’université, jupes longues… l’islam n’a jamais été aussi médiatisé.
Au cours des cinq dernières années, les polémiques se sont succédé au rythme d’un agenda médiatique ne permettant pas de traiter l’information avec acuité et profondeur. Or le temps est une variable déterminante en matière d’information. D’autant que bon nombre de Français non musulmans s’interrogent sur la visibilité de l’islam en France, voire la redoutent, et se trouvent confrontés à des questions auxquelles ils ne semblent pas trouver de réponses nuancées, capables d’éclairer le sujet, de traduire cette réalité de l’islam de France dans toute sa pluralité.
Une défaillance qui pose question et même qui inquiète. Rappelons que les politiques gèrent les affaires de la cité, alors que la presse doit en principe relayer l’information et aussi apporter des clés de décryptage pour comprendre les enjeux. Et parmi ces derniers, la nécessité de savoir de quoi l’on parle lorsque l’on aborde le sujet de l’islam en France est un point crucial. Les mots sont importants. Les concepts aussi. D’où la nécessité de les manier avec exactitude. Dans L’Islam dans les médias, l’intellectuel palestinien et professeur de littérature à l’université Columbia de New York Edward W. Said revient sur le rapport des médias occidentaux à l’islam. Il pointe la responsabilité «des spécialistes, universitaires ou journalistes : tenant un discours déconnecté des réalités propres à la communauté dont ils parlent, de la simple notion de bon sens et de la responsabilité intellectuelle qu’ils portent, ils défendent à tout prix un intérêt particulier, ou transforment […] le savoir en instrument de pouvoir ». Le tout produisant, selon lui, «non pas à une compréhension des sociétés et cultures […], notamment l’islam, mais à un escamotage en bonne et due forme2». Pessimiste, Edward W. Said craint «que de nouvelles fictions ne soient inventées et que des modes de désinformation inédites ne soient introduits3».
Parmi les concepts imprécis largement employés par la sphère médiatique et politique, la plus courante est l’expression «communauté musulmane». Régulièrement cités dans l’actualité, les musulmans de France appartiendraient à une seule et même communauté de valeurs, à un bloc monolithique qui se penserait et agirait comme une seule personne. Si le terme «communauté» fluctue en fonction de la réalité ciblée, il renvoie pourtant à des acceptions plus ou moins différentes. Dans le cas de la communauté musulmane, sa définition relève davantage du concept auquel elle réfère, c’est-à-dire un groupe de personnes qui partagent quelque chose de commun.
Si les Français musulmans sont associés de fait à la communauté musulmane, la réalité paraît plus complexe. La communauté porte par définition des valeurs communes à l’ensemble de ses représentants. Dans le cas de l’islam, si leur énumération n’est pas exhaustive, ces valeurs se résument à la paix, au respect, à la solidarité et à l’harmonie sociale dont les membres de cette dite communauté sont censés témoigner à travers leur pratique. Ces valeurs font écho aux valeurs républicaines.
La définition même de «communauté» renvoie à une réalité conceptuelle. Au sens philosophique, elle renvoie à une représentation abstraite d’une réalité, en l’occurrence celle de la population musulmane. Si les Français musulmans incarnent cette abstraction dans l’inconscient collectif, impossible pour autant de cerner les spécificités de cette communauté. Face à cette abstraction, à partir de quand alors appartient-on à la communauté musulmane ? Suffit-il de se dire musulman pour s’identifier et être assimilé à la communauté musulmane ? À l’inverse, suffit-il de rejeter son islamité pour en sortir ? Des questions qui permettent de pointer la difficulté de délimiter la notion de communauté en général. Dans le cas de l’islam de France, ces interrogations prennent une dimension particulière tant les enjeux sont décisifs. Les musulmans de France forment une communauté mouvante, traversée par une myriade de réalités religieuses, sociales, économiques et même politiques.
L’islam en France : une Histoire tumultueuse
Mohammed Arkoun (dir.), Histoire de l’islam et des musulmans en France, albin michel, Paris, 2006
Jacques Le Goff, « Préface », in mohammed arkoun (dir.), op. cit., p. 15.
Ibid., p. 16
Michel Renard, « Les débuts de la présence musulmane en France et son encadrement », in mohammed arkoun (dir.), op. cit., p. 712
Ibid.
Ibid., p. 713
Patrick Simon et Vincent tiberj, « Sécularisation ou regain religieux : la religiosité des immigrés et de leurs descendants », Documents de travail, no 196, ined, juillet 2013, p. 6
Alain Boyer, « Les débuts de la présence musulmane en France et son encadrement », in mohammed arkoun (dir.), cit., p. 768.
La communauté musulmane existe bien dans la mesure où elle a, depuis le début du XXe siècle, pris une place croissante dans l’espace mais aussi dans le roman national français. D’abord main-d’œuvre saisonnière, les musulmans des colonies ont témoigné lors des deux conflits mondiaux de leur détermination à défendre les valeurs occidentales. Mais ce qui frappe chez cette population musulmane, c’est l’absence de structuration. Arrivés dès le début du XXe siècle, les premiers migrants issus des colonies sont aussi les symboles de croyances jugées jusqu’ici incompatibles avec la Chrétienté et l’Occident en général.
Si la présence de l’islam en France est, pour une bonne partie de l’opinion, un fait nouveau, la réalité est tout autre sur la frise chronologique de la France. Dirigée par Mohammed Arkoun et préfacée par Jacques Le Goff, la foisonnante Histoire de l’islam et des musulmans en France du Moyen Âge à nos jours4 permet d’apporter de précieux éclairages. Au début du VIIIe siècle, des peuples convertis à l’islam, venus de l’Afrique du Nord occidentale, conquièrent la majeure partie de la péninsule Ibérique. Une colonne s’avance jusqu’à Poitiers, où elle est vaincue par le chef franc Charles Martel. Un événement historique et symbolique puisque cette bataille de 732 résonne encore de nos jours comme l’un des symboles de «la victoire du christianisme et de la civilisation occidentale sur la barbarie musulmane».
Cette opposition entre deux systèmes de valeurs pose les bases d’une relation tumultueuse. Comme l’ont montré de nombreux travaux universitaires, la figure du musulman a cristallisé un rejet de la Chrétienté qu’incarne l’Église. Au-delà de Poitiers, et même si les philosophes arabes – comme Avicenne puis Averroès, commentateurs de la pensée aristotélicienne – jouissent d’une reconnaissance au Moyen Âge, l’imaginaire en vogue ternit les rapports entre l’islam et l’Occident. Les musulmans seront longtemps nommés «Sarrasins», terme ethnique remplacé par «mahométistes» à la fin du Moyen Âge puis «mahométans» au XVIe siècle, et il faudra attendre le XXe siècle pour voir apparaître les termes «islam» et «musulman» en France.
Pour autant, la culture musulmane va franchir les frontières à travers une image négative du prophète Muhammad, vu également comme l’éternel rival d’un Occident chrétien en quête d’affirmation de son identité. Comme le souligne Jacques Le Goff, «l’islam face à la chrétienté avait été l’Autre. Or, l’identité naît souvent de l’opposition à un Autre5». C’est ce qui explique peut- être le rapport conflictuel avec l’islam. Pendant les siècles suivants, et encore souvent dans l’opinion actuelle, la relation entre islam et Occident se résume, à quelques exceptions près, aux croisades et à la construction d’un ennemi contre lequel il faut se protéger des ambitions belliqueuses. Le bouleversement intervient à la fin du XIXe siècle.
D’après Arkoun et Le Goff, «la colonisation de l’Algérie à partir de 1830, de la Tunisie et du Maroc sous forme de protectorats, puis de la Syrie et du Liban entre les deux guerres mondiales, comme celle de l’Afrique noire qui compte de nombreux musulmans et de la Tunisie, marque un revirement dans les relations entre la France et l’islam6». La colonisation a introduit un déséquilibre, si l’on peut dire, plaçant l’un des protagonistes, à savoir les musulmans des colonies rattachés à l’islam méditerranéen, en posture de domination. Ainsi, l’ordonnance royale du 24 février 1834, qui officialise l’annexion de l’Algérie à la France suite à la capitulation du dey d’Alger en 1830, ouvre la voie à une nouvelle ère. Si les «indigènes» musulmans ou juifs sont considérés comme français, ils ne bénéficient ni des droits civiques, ni des droits politiques. Le vieil ennemi venu du monde musulman, autrefois repoussé à Poitiers, devient alors sujet placé sous la souveraineté directe et immédiate de la France. La promulgation du décret Crémieux, le 24 octobre 1870, crée une rupture dans l’égalité statutaire entre musulmans et juifs d’Algérie. Ces derniers obtiennent alors la nationalité française, une étape décisive dans le processus d’assimilation de cette communauté. Une étape également dans la construction d’un système discriminant et inégalitaire à l’égard des musulmans du département français.
Dès le début, la présence de l’islam en France est biaisée. En effet, le statut de sujet appliqué aux indigènes mais aussi la violence de la colonisation, le système inégalitaire soumis aux soldats des colonies lors des deux guerres mondiales, puis, plus tard, la condition des «travailleurs d’Afrique du nord» ne permettent pas l’éclosion d’une relation apaisée à la France. Surtout, ces raisons ne favorisent pas le sentiment d’appartenance à la nation, même pour des résidents. Depuis un siècle, les musulmans ont eu du mal à se voir comme acteurs de la société française. Le mythe du retour en est un exemple. La France sera tour à tour la puissance coloniale, le front, la terre promise économique, mais jamais la terre voulue.
Pour autant, «il ne faudrait pas négliger les élans de gratitude ni les courants indigénophiles ou islamophiles du début du XXe siècle qui ont contribué à susciter un intérêt réel pour l’islam et pour les musulmans7», écrit Michel Renard. La construction de la mosquée de Paris, inaugurée en 1926, ou de l’Hôpital franco-musulman Avicenne, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ne «répondaient donc pas aux besoins d’une population nombreuse8», laissant supposer une communauté en phase d’organisation. Non, il s’agit, pour les autorités françaises, de rendre hommage aux soldats des colonies tombés en 1914-1918. Au-delà de l’image dévalorisante dont va souffrir l’Autre, l’indigène, la colonisation et ensuite la décolonisation sonnent le point de départ de nombreuses vagues d’immigration. Les musulmans commencent à fouler le sol français, prenant part d’une autre manière à l’histoire de France. Mais c’est véritablement au XXe siècle que débute la présence musulmane dans l’Hexagone.
En dehors de la Première Guerre mondiale, dès le début du XXe siècle, quelques milliers d’émigrés – 5.000, selon l’enquête du Gouvernement général d’Algérie –, des Algériens, des Kabyles en majorité ainsi que quelques étudiants nord- africains, viennent en métropole pour des emplois saisonniers. En décembre 1904, une loi facilite les formalités de circulation entre la France et l’Algérie9. On est alors loin des 4,3 millions de musulmans en France évoqués par l’Institut national démographique (Ined)10, chiffre sur lequel nous reviendrons.
En 1926, les travailleurs algériens composent la communauté d’immigrés la plus significative. Ce sont les prémices de la communauté musulmane de France. Au total, la Première Guerre mondiale voit la mobilisation de 280.000 soldats d’Afrique du Nord, auxquels s’ajoutent 200.000 combattants d’Afrique subsaharienne. Lors de la Seconde Guerre mondiale, selon l’historien Jacques Frémeaux, les colonies d’Afrique du Nord fournissent 200.000 à 250.000 hommes entre 1943 et 1945. Entre colonisation et efforts de guerre, la présence de l’islam en France change progressivement de nature.
Après 1945, l’installation en métropole des musulmans issus des colonies devient effective. À partir de 1950, la France métropolitaine, en pleine phase de reconstruction mais aussi de croissance économique, relance à nouveau l’accueil des travailleurs immigrés. L’État signe notamment des accords avec le Maroc et la Tunisie pour accélérer la venue de cette main-d’œuvre peu qualifiée, bon marché et discrète. Les grandes entreprises, dont celles de l’automobile, recrutent directement dans les villages marocains et tunisiens. Ce sont les fameux «ouvriers spécialisés (OS)». Ces travailleurs, conscients de trouver en métropole un emploi et une rémunération inenvisageable en Afrique, s’impliquent dans leurs tâches, dans la perspective d’un retour au pays. La France mène jusqu’en 1974 la campagne d’immigration la plus importante de son histoire.
Au gré des soubresauts historiques liés notamment à la guerre d’Algérie, les musulmans présents en France, d’ailleurs appelés «travailleurs d’Afrique du Nord», s’acclimatent à la métropole. Si les Maghrébins figurent parmi les premiers immigrés, ils seront plus tard rejoints par les musulmans des ex-colonies d’Afrique subsaharienne, des Comores ou encore de Turquie. Comme le souligne Alain Boyer, «la religion ne semble pas être alors la préoccupation première des travailleurs nord-africains pour qui l’existence se résume au travail en métropole dans l’espoir d’un avenir meilleur, souvent projeté dans leur pays d’origine11».
À partir de 1974 et jusqu’en 1982, l’introduction du regroupement familial modifie la nature de la présence musulmane en France. On passe d’une immigration temporaire économique à une immigration définitive. L’implantation des chaînons manquants, femmes et enfants de ces «travailleurs d’Afrique du Nord», entre autres, va ancrer durablement l’islam dans la France sécularisée. Et, avec elle, l’éclosion des premiers besoins en termes de pratiques religieuses. Cet élément marque une étape inédite. La pratique religieuse s’effectue alors à travers les consulats des pays concernés. La France laissant carte blanche à ces réseaux institutionnels pour organiser le culte dans le cadre du respect de la laïcité, le fameux islam consulaire encore en vigueur. Les années 1980 voient un virage s’opérer. Les premières générations de Français issus de l’immigration entrent dans l’espace de visibilité, carte d’identité en main. Là où leurs parents ont joué la carte de la discrétion, les enfants vont lentement décliner les mots «liberté» et «droit» dans la construction de leur parcours identitaire, scolaire, puis plus tard politique ou même entrepreneurial. Si cette émergence des jeunes issus de l’immigration se fait au forceps, le processus a abouti de nos jours à une visibilité de ces minorités dans l’espace public, propulsées ces dernières années par Internet. Aujourd’hui, le Web constitue pour ces populations un terrain d’expression inédit, tout comme ont pu l’être, par exemple, les cultures urbaines trente ans plus tôt.
Depuis les années 1980, l’islam apparaît ainsi comme un vecteur d’appartenance communautaire. Contrairement à l’islam importé des parents, qui le vivent comme un lien intime avec le pays d’origine, les jeunes de l’immigration construisent une nouvelle forme de pratique religieuse. Transmise dans les familles, avec plus ou moins de ferveur, la pratique des anciens ne résulte pas forcément d’un enseignement.
En discutant avec un panel de jeunes musulmans nés en France à la fin des années 1970, on comprend que la transmission religieuse repose davantage sur le rite que sur un apprentissage académique de la science islamique. Ce n’est qu’au fil des années 1980-1990 que la donne change, lorsque ces générations de Français musulmans scolarisés développent un sens critique et qu’ils accèdent à l’enseignement coranique au sens de science disciplinaire. À l’inverse de leurs parents, ces jeunes de l’immigration intellectualisent les textes pour en extirper une pratique plus approfondie que celles de leurs aïeux. Qu’elle soit littéraliste ou non, cette posture introduit une nouveauté dans l’approche religieuse et spirituelle. Les parents, qui s’efforcent de trouver un fonctionnement religieux harmonieux entre rite et spiritualité pour coller à cet impératif de discrétion inconscient et émanant certainement de la posture indigène de l’immigré, se font alors «supplanter» par ces jeunes générations, pour qui le rite va parfois prendre le dessus sur la dimension spirituelle de l’islam.
Symptomatique, et contrairement aux idées reçues, la question du voile qui émerge en 1989 ne fait pas l’unanimité chez les anciens, soucieux d’éviter le regard de l’autre, celui qui n’est pas musulman. Un réflexe propre à ces générations pour qui la colonisation a été une expérience de vie, teintée d’humiliations, mais surtout de rapport dominant-dominé. S’ils perpétuent cette tradition de la discrétion, ces nouveaux Français refusent – et la tendance va aller crescendo au fil des années – de se plier à cette forme d’injonction tacite. Ainsi, l’exemple du foulard est un marqueur, traditionnellement attaché à la culture d’origine des parents. Aujourd’hui, il témoigne aussi de la façon dont ces jeunes Français ont juxtaposé la culture d’origine des parents et celle qu’ils ont construit/expérimenté en tant que Français. Ces jeunes de l’immigration, d’obédience musulmane, jouissent, à l’inverse de leurs parents, d’un accès à tous les savoirs, y compris au savoir religieux. Ce retour au rite et à une plus grande visibilité de leur croyance est l’expression même de leur liberté. Liberté de lire et de vivre comme ils l’entendent leur condition de Français issus de l’immigration. Et c’est parce qu’ils se sentent Français qu’ils s’octroient le droit de fabriquer leur récit personnel comme bon leur semble. L’opinion assiste à la fabrication d’une nouvelle identité, française et musulmane. Une séquence qui dure aujourd’hui et qui se fait dans la douleur tant l’introduction d’une religion – l’islam –, jusqu’ici vue comme exogène à la République, bouleverse le récit national.
Ainsi les musulmans en France n’ont pas écrit leur roman personnel. Jusque dans les années 1990, ils n’ont pas structuré cette communauté malgré une présence historique ancienne. De fait, leur arrivée en France s’apparente implicitement – le terme est fort – à un «accident» de l’Histoire. C’est autour du mythe du retour que les anciens musulmans ont bâti leur rapport à la France. Mais, avec les générations de Français musulmans nés dans les années 1970, l’équation n’est plus la même. Le mythe du retour s’est évaporé, ouvrant la voie à de nouvelles aspirations collectives : donner à l’islam de France une place visible dans le roman national mais surtout être capable d’écrire son récit, celui d’une communauté plurielle en phase avec les valeurs républicaines.
Une population, des communautés ?
Jérôme Fourquet, « 66% des Français considèrent que les musulmans vivent paisiblement en France et que seuls des islamistes radicaux représentent une menace », atlantico.fr, 10 janvier 2015
Raphaël Liogier Le Mythe de l’islamisation. Essai sur une obsession collective, Seuil, 2012, 115.
Ibid, p.118
Jérôme Fourquet, « attentats de Paris : le nombre de Français qui considèrent que l’islam est une menace en baisse de 4 points par rapport à juillet », atlantico.fr, 30 novembre 2015
Patrick Simon et Vincent tiberj, art. cit
Ibid., p. 8-10.
Ibid., p. 6
Raphaël Liogier, op. cit
Au lendemain des attaques meurtrières contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes, un sondage paru sur le site Atlantico12 pointait les inquiétudes des Français face à la communauté musulmane. Pour 40% d’entre eux, elle représentait «une menace pour l’identité de notre pays». L’étude montre par ailleurs que 66% des Français considèrent «qu’il ne faut pas faire d’amalgame, les musulmans vivent paisiblement en France et seuls les islamistes radicaux représentent une menace». Ces deux données illustrent bien les écarts de pensée, voire les tiraillements qui animent l’opinion publique, représentée en l’occurrence par les 1.002 sondés de l’enquête, quand il s’agit d’exprimer un avis sur l’islam et les musulmans.
Ces chiffres traduisent une réalité intéressante. La deuxième religion de France envisagée comme «communauté» engendre le rejet. L’idée d’un groupe religieux structuré nourrit dans l’opinion publique un fantasme négatif comme l’a montré le sociologue Raphaël Liogier : «le Musulman métaphysique qui aboutit à une vision mystique de la conspiration dans laquelle le musulman de chair et d’os s’est littéralement volatilisé au profit d’un principe métaphyique13». Et Raphaël Liogier d’ajouter, que le musulman est vu comme «dépourvu de spécificités régionales, sociales, économiques et finalement personnelles, le Musulman, en un sens, n’a pas d’âme individuelle, il n’est qu’un collectif conquérant14», assimilé à l’ennemi de l’intérieur.
À l’inverse, la prise en compte des aspérités entre musulmans paisibles et radicaux extrémistes introduit la nuance dans le jugement, empreint d’altérité. La prévalence des individualités permet de coller à la réalité de la population musulmane, d’y apposer des parcours de vie, des visages. Le musulman dans son individualité devient le voisin d’à côté, celui que l’on croise dans son hall de résidence, à la sortie des écoles ou au supermarché.
D’où la nécessite de dépasser le concept englobant de «communauté musulmane». D’abord, parce qu’il renvoie à un fantasme. Ensuite, parce qu’envisager ce groupe de croyants dans une uniformité imaginée empêche d’introduire de la nuance, préalable à toute analyse constructive. D’ailleurs, au lendemain du carnage du 13 novembre 2015 perpétré au nom de Daesh, l’image des musulmans s’est quelque peu modifiée. Un sondage Ifop publié sur Atlantico indiquait que 67% des Français faisaient la distinction entre les musulmans «vivant paisiblement en France et les radicaux15». Au-delà du caractère discutable du terme «radicaux», ces attentats poussent, contre toute attente, les non-musulmans à voir la complexité de ladite «communauté musulmane». Il aura fallu attendre ce drame pour voir la presse s’emparer de l’hétérogénéité de la réalité musulmane. Le 25 novembre, un article du Monde, titrait : «Pourquoi il ne faut pas confondre le salafisme et le takfirisme». Le journaliste William Audureau prenait appui sur une déclaration du Premier ministre Manuel Valls, datée du 18 novembre, qui liait le salafisme à l’islamisme radical sans aborder la pratique du takfirisme, idéologie prônant la violence. Au-delà de la méconnaissance, la déclaration du Premier ministre entretenait le flou.
En juillet 2013, l’Ined a publié un document de travail réalisé par deux chercheurs à partir de l’enquête «Trajectoires et origines (TeO)». Ce document concernait notamment la communauté musulmane et interrogeait le rapport des Français de l’immigration à la religion dans une France sécularisée16. La lecture de l’étude permet de mieux comprendre en quoi le concept de «communauté», au sens où il se réfère à un groupe de personnes réunies autour de mêmes croyances et pratiques, est discutable pour ce qui est des musulmans. Parmi les chiffres avancés, on apprend que le nombre de musulmans oscillerait entre 3,98 et 4,3 millions17. Les auteurs tablent sur une hypothèse moyenne à 4,1 millions de personnes. Des chiffres plutôt éloignés des 7 millions parfois brandis à la fois dans les médias mais aussi par certains Français musulmans.
Si l’islam représente la première religion des immigrés en France, sa pratique ne correspond pas vraiment à l’idée que s’en fait l’opinion publique. L’étude de l’Ined est claire et illustre bien en quoi la représentation des musulmans est imprécise et biaisée. Si 49% des musulmans manifestent une forte religiosité, c’est-à-dire qu’ils considèrent que la religion occupe une place importante, 47% d’entre eux sont plutôt des musulmans dits «modérés». L’adjectif renvoie, dans la typologie proposée par les auteurs, «aux personnes ayant déclaré accorder un peu ou assez d’importance à la religion18». Mais l’expression «musulman modéré» pose problème chez les principaux concernés. Selon eux, elle introduit l’idée qu’une pratique intense est nécessairement radicale. Or l’islam offre un équilibre parfait entre le rite et la pensée, surtout s’il repose sur une connaissance érudite, rigoureuse et débarrassée de toute considération politique. L’islam, tel que pratiqué par la majorité silencieuse, suit la voie du juste milieu. Adjoindre systématiquement l’adjectif «modéré» au terme musulman serait une preuve du postulat négatif que l’opinion publique associerait aux pratiquants. On leur demanderait de prouver une pratique raisonnable. C’est ce que Raphaël Liogier explique en substance : parler de modération, c’est un peu comme parler d’une drogue : l’islam, c’est bien, mais à petite dose19.
Dernière catégorie qui émerge dans l’enquête : les musulmans dits «détachés». Ils représentent 4% des membres de cette communauté. Ils regroupent les individus se définissant comme musulmans mais pour lesquels la religion «n’a pas du tout d’importance pour eux». Ce sont les musulmans «culturels», selon l’étude TeO. Cette frange de la population musulmane renvoie aux immigrés ou à leurs descendants nés en France. Pour eux, l’islam relève davantage d’un héritage familial et historique. Il s’agit moins d’asseoir une croyance que de maintenir une forme de lien affectif avec son cercle intime. Cette catégorie ne pratique pas, mais reste attachée à la célébration des fêtes ou au respect du régime alimentaire sans porc. «Détachés», «modérés» ou «à forte religiosité», ces termes et cette approche permettent de poser une typologie et des chiffres sur une communauté musulmane française aux contours mouvants.
Les contours de la communauté musulmane
L’enquête TeO, réalisé entre 2008 et 2009, permet de mieux cerner la religiosité chez les musulmans de France, qu’ils soient immigrés ou descendants. Si l’on s’appuie sur les trois groupes définis – détachés, modérés ou très religieux –, les différences sont incontestables. Pour autant, ces tendances intracommunautaires suffisent-elles à remettre en cause l’existence d’une communauté ? Si cette appartenance devait reposer sur l’existence d’un lien même ténu avec l’islam – être né dans une famille musulmane, entretenir un rapport lointain ou même avoir un faciès renvoyant, à tort, à cette religion… –, alors il existerait bien une communauté musulmane, hétérogène mais réelle. Or rien n’est moins sûr.
L’électorat musulman, miroir aux alouettes
Secrétariat général du Comité interministériel des Villes, agir pour les habitants des quartiers populaires. La politique de la ville, mode d’emploi, 2013, p. 2
Ces dernières années, la question de l’électorat musulman a émergé dans le débat public. Lors des dernières élections présidentielles, la gauche et la droite ont tenté de s’attribuer les faveurs de ce vivier d’électeurs. En 2007, lors du duel entre les deux candidats à l’Élysée, Nicolas Sarkozy (UMP) et Ségolène Royal (PS), la question du vote des quartiers avait été analysée sous le prisme de la banlieue. À l’élection présidentielle de 2012, l’angle d’analyse a changé, puisque la presse et les politiques eux-mêmes parlaient moins du vote des cités (croisant la composante sociale avec la question religieuse, sans vraiment l’assumer) que du vote dit «musulman». Au-delà du vocable, ce glissement illustre bien la façon dont la question religieuse a peu à peu pris le dessus sur celle des quartiers populaires et de ses urgences sociales.
D’où l’intérêt grandissant des politiques, affiché ou non, pour l’«électorat musulman» qui serait, dans l’imaginaire collectif, accolé aux habitants de banlieue. Si l’on se base sur l’ancienne géographie prioritaire en vigueur jusqu’en décembre 2014, date à laquelle de nombreux quartiers sont sortis de ce périmètre au profit de zones rurales – innovation introduite par la politique d’«égalité des territoires» voulue par François Hollande –, les zones urbaines sensibles (ZUS) comptent 8,1 millions d’habitants, sur un total de 63,2 millions de Français20. Un réservoir de voix incontestable. Un résident sur deux dans les quartiers populaires est immigré ou descendant d’immigrés. On peut donc supposer que la communauté musulmane de France constitue un levier d’électeurs significatif pour les candidats. Sous cet angle, il y aurait donc un électorat musulman directement issu de cette même communauté. Quand on sait que 1 habitant sur 3 en ZUS est pauvre, que le taux de chômage y est 2,5 fois plus élevé qu’en dehors de ces zones, rien d’étonnant à ce que le vote des Français issus de l’immigration se positionne plutôt à gauche. De nombreux chercheurs l’ont montré, les catégories populaires votent traditionnellement à gauche. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les partis de gauche avaient capté le vote ouvrier. Les populations françaises issues de l’immigration ouvrière n’ont pas remis en cause ce positionnement politique presque «naturel», inscrit dans la lignée des combats sociaux incarnés par leurs aïeux issus des colonies et installés en France avant et après les vagues de décolonisation. Ainsi, quand on les interroge, on voit que bon nombre de Français issus de l’immigration ont grandi dans une vision schématique de la politique dans laquelle la gauche a toujours tiré son épingle du jeu. «La gauche nous aime bien [nous Français de l’immigration, faut-il comprendre] et la droite pas vraiment» est une phrase récurrente dans la plupart des familles d’immigrés, qui résume bien la manière dont des générations ont intégré l’analyse politique en assimilant la ligne de démarcation droite-gauche. Non par le prisme social, au sens de la réalité qu’ils vivaient, mais bien par le prisme identitaire. Les enfants des couches populaires de banlieue, nés à la fin des années 1970 et au début des années 1980, ont été marqués par la gauche dès le plus jeune âge, au moment où François Mitterrand accédait à la présidence de la République. Au moment même, également, où naissait la politique de la ville. Une concomitance calendaire qui a inscrit très certainement et inconsciemment la gauche, surtout le Parti socialiste, au cœur de l’ADN des quartiers et vice versa. Un électorat que la gauche, par transitivité, a pensé s’attribuer : les quartiers votent à gauche, les musulmans vivent principalement en banlieue, donc l’électorat musulman vote à gauche. Un syllogisme qui a fonctionné.
Français et musulmans, une identité à inventer
Les années 1980 ont constitué un tournant et le début d’un lent processus d’émancipation politique des musulmans de France. Au cours de l’été 1983, de violents affrontements opposent des policiers et des jeunes de la cité des Minguettes, à Vénissieux, près de Lyon. La situation dégénère sur fond de drames : cinq Maghrébins sont victimes de meurtres racistes selon les autorités, vingt et un selon les associations et organisations syndicales. Le père Christian Delorme et le pasteur Jean Costil, de la Cimade, avancent alors aux jeunes des Minguettes l’idée d’une marche, s’inspirant notamment de la Marche pour les droits civiques aux États-Unis. Parti de la cité phocéenne le 15 octobre 1983, le cortège, modeste, traverse les villes de France en direction de Paris, attirant curiosité et sympathie. À Paris, le 3 décembre, ce qui a été rebaptisé «Marche des beurs» se fond dans un défilé réunissant quelque 100.000 personnes. Reçue par François Mitterrand, président de la République, une délégation obtient, entre autres, la promesse d’un projet de loi contre les crimes racistes. Un texte en faveur du droit de vote des étrangers aux élections locales est aussi envisagé, mais la mesure reste toujours en suspens. Le climat est à l’époque tendu. D’autant que le Front national (FN), à l’occasion d’une élection municipale partielle à Dreux, connaît son premier coup d’éclat : la liste FN fusionne au second tour avec la liste RPR, remportant l’élection face à la gauche. 1983, ce sont aussi les grèves de Talbot à Poissy. Face aux mutations profondes que connaît l’industrie automobile, la restructuration des usines est inéluctable. À cela s’ajoutent le durcissement des rapports sociaux et les grilles d’évaluation jugées arbitraires sur lesquelles repose la promotion interne. Véritable «printemps syndical», les grèves de Talbot, qui avaient été précédées par celles de Renault à Boulogne-Billancourt en 1973 puis par celles de Citröen à Aulnay-sous-Bois, confirment une forme de stigmatisation de la figure de l’immigré. Le Premier ministre Pierre Mauroy déclare alors : «Les principales difficultés qui demeurent sont posées par des travailleurs immigrés dont je ne méconnais pas les problèmes, mais qui, il faut bien le constater, sont agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises21.» La boîte de Pandore est ouverte. Si les protestations syndicales et la Marche pour l’égalité ont du mal à s’ancrer dans le patrimoine des luttes françaises, elles constituent pourtant des actes fondateurs de l’histoire des Français de l’immigration. D’une part, parce que les ouvriers spécialisés (OS) à la lutte dans les usines automobiles entre 1982 et 1984 sont, d’une certaine manière, les parents des jeunes marcheurs de l’automne de 1983, et, d’autre part, parce que la question du racisme et de la mise à la marge de cette frange de la population se manifeste, aujourd’hui, à travers la question de l’islam. Selon Jamel El Hamri, cofondateur de l’Académie française de la pensée islamique (AFPI), la Marche pour l’égalité a vu naître deux courants qui permettent de mieux comprendre la communauté musulmane de France22. Le premier courant est resté sur un message citoyen. Ce sont les marcheurs historiques comme Toumi Djaidja, symbole de la Marche. Un second courant est apparu progressivement du côté de Lyon, avec une spécificité nouvelle pour l’époque. Ces marcheurs commencent à voir la citoyenneté comme le prolongement de la spiritualité. Parmi eux figure Abdelaziz Chaambi, fondateur en 1981 de l’Association de solidarité pour les travailleurs immigrés, partie prenante de l’organisation de la Marche. Aujourd’hui, il est à la tête de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie. Une ligne de démarcation «intra-Marche» qui illustre les prémices d’une fragmentation de ladite «communauté». La plupart des marcheurs viennent de familles immigrées de confession musulmane. Citoyenneté, spiritualité et engagement politique sonnent, ainsi, comme le triptyque d’une lente maturation qui va concerner à des degrés différents les Français de l’immigration. Chacun évoluant à sa manière, avec sa propre trajectoire familiale, scolaire, et professionnelle. Déjà, en 1983, les courants qui émergeaient de la Marche posaient les bases d’une communauté musulmane plurielle, avec un fort ancrage à gauche qui a tendance à s’effriter à présent.
Trajectoire et identité
Antoine Jardin, interview par Nadia Henni-Moulaï, 12 mai 2016
La Nouvelle Pme, adive et opinionway, « étude nationale sur les entrepreneurs dans les quartiers sensibles », 17 novembre 2010
Anne-Sylvaine Chassany, « uber: a route out of the French banlieues », The Financial Times, 3 mars 2016
« Comment ont voté les banlieues populaires ? Les municipalités de banlieue après le séisme du 30 mars », Ville & Banlieue, 2 avril 2014
D’un vote immigré, motivé par les enjeux sociaux et donc plus favorable à la gauche, à un vote communautaire, plus conservateur et plus ancré à droite, il n’y aurait donc qu’un pas. La réponse serait affirmative si la composante musulmane de la population était hétérogène et unifiée. La difficulté, voire l’impossibilité, à saisir les contours d’un électorat musulman le montre bien. Les Français musulmans ne votent pas comme un seul homme. En 2012, lors de l’élection présidentielle, les citoyens musulmans ont certes plébiscité le candidat de gauche, François Hollande, mais l’idée était plutôt d’en finir avec un sentiment de stigmatisation des musulmans jugé prégnant au cours de la présidence de Nicolas Sarkozy. «Cette inclination vers la gauche est d’ordre historique, pas naturelle. Si le vote de droite a progressé, c’est surtout dans les contextes où le Front national ne présente pas de candidats, comme lors des élections municipales de 2014», analyse Antoine Jardin, chercheur en sciences politiques23.
Mais la vivacité entrepreneuriale des quartiers pousse également les créateurs d’entreprise vers la droite. Selon une étude publiée en 2010, 50% des entrepreneurs dans les ZUS ont moins de 40 ans24. Le goût de l’entrepreneuriat et du libéralisme est une vague de fond qui traverse les milieux issus de l’immigration. Récemment, un article du Financial Times intitulé «Uber: a route out of the French Banlieues25» revenait même sur le parcours de certains habitants de banlieue, confrontés au chômage, qui trouvent dans la start-up californienne une issue professionnelle.
L’analyse du dernier scrutin municipal de mars 2014 effectuée par Ville & Banlieue26, une association pilotée par des élus issus des villes populaires, le montre bien. Si l’on met de côté l’abstention, dont des pics ont été atteints dans certaines villes de banlieues – plus de 60%, par exemple, d’abstentionnistes à Clichy-sous-Bois –, la droite (UDI-UMP) a obtenu plus de 27% d’alternance à son profit au sein des élus membres de l’association Ville & Banlieue réussissant à déloger la gauche de bastions traditionnels comme à Athis-Mons (Essonne). Ville & Banlieue s’est fait le réceptacle de ce changement. Avant les élections municipales, l’association penchait plutôt à gauche dans un rapport de 1 à 10. Après le 23 mars 2014, le rapport est passé de 1 à 3. Les Français de l’immigration ne restent donc plus cantonnés aux partis de gauche. L’idée d’une communauté d’intérêts autour de valeurs sociales, économiques et religieuses vole donc en éclat. Ces conclusions le montrent bien : la banlieue, où une importante partie de ses habitants est musulmane, s’ouvre au vote à droite.
Musulmans de France, une exception française
La question de l’électorat musulman illustre bien la part de fantasme liée à la communauté musulmane. Le vote confessionnel est volatil par nature. Car, aujourd’hui, si les médias et les politiques s’accordent à parler d’une communauté musulmane homogène, la réalité est tout autre. La remise en question de l’existence d’un électorat musulman en est un premier signe.
Ethnicisation de l’islam
Cité par Nadia Henni-moulaï, in « Communauté musulmane de France, la part du fantasme », middleeasteye. net, 16 janvier 2015
Ibid
Ibid
Ibid
Mosquées algériennes, marocaines ou turques font notamment partie du vocabulaire tacitement admis par les fidèles. Si la tendance évolue avec le temps, il n’est pas rare que les fidèles se rendent dans un lieu de culte en fonction de leurs accointances culturelles avec le responsable de la mosquée ou de l’imam. On sait, par exemple, qu’une frange de ces religieux est directement envoyée par les ministères des Affaires religieuses des pays d’émigration. Selon Omero Marongiu-Pierra, spécialiste de l’islam en France et membre du laboratoire CISMOC de l’université de Louvain, en Belgique, «les imams turcs seraient entre 100 et 200, une centaine pour l’Algérie et plusieurs dizaines pour le Maroc27». Par rapport aux 2 500 mosquées et salles de prières de France, la proportion est plutôt faible. Surtout, les imams venus de l’étranger marquent une ligne de fracture parmi les musulmans de France. Sur le terrain, certains élus locaux d’obédience musulmane déplorent cet état de fait. «L’islam de France est entre les mains de personnes qui ne maîtrisent pas toujours le contexte socioculturel français28», constate un conseiller municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui dénonce par ailleurs « la tutelle consulaire sur le culte musulman29». Hanane Karimi, doctorante en sociologie et initiatrice du mouvement féministe «Les Femmes dans la mosquée», dénonce les procédures patriarcales mais aussi l’impossibilité pour les jeunes de se reconnaître dans la gestion des anciens. Structurer une communauté suppose de s’engager en faveur de l’organisation du culte. Comme le souligne encore le même conseiller municipal en prise avec le terrain et qui connaît bien ce sujet : «S’ils ne s’engagent pas pour gérer ce culte, rien ne se passera. Gérer une mosquée, c’est une forme d’engagement à part entière tout comme se faire élire dans une association de parents d’élève !30»
Plus visible encore est la structure ethnique de l’islam en France. La communauté musulmane en France est organisée par nationalités. Marocaines, algériennes, turques et plus globalement subsahariennes, pour ne citer qu’elles, représentent les principales origines qui régissent la présence des musulmans en France. Si les fidèles ne prêtent pas forcément attention à cette «appartenance» ethnique, leur inclination vers un lieu de culte repose sur un réflexe identitaire, endogène à l’islam et symptôme d’une communauté musulmane qui n’en a que le nom. L’influence étrangère qui s’exerce sur la mosquée à travers l’imam en charge du prêche participe à la structuration cultuelle des musulmans. Un élément supplémentaire qui permet de penser concrètement cet islam ethnique français.
Présence consulaire
Propos recueillis par Nadia Henni-moulaï lors d’une interview le 13 janvier 2015
Sur le terrain, cette répartition ethnique se traduit par un maillage des lieux de culte en fonction du pays concerné. Ainsi, par exemple, à Argenteuil, dans le Val-d’Oise, deux importantes mosquées ont été construites ces dernières années. La première, la mosquée Assalam, également appelée mosquée Dassault, est connue des fidèles comme étant un prolongement du Maroc en France. Son responsable, Mohamed El Aissaoui, d’origine marocaine, est également, président du centre socioculturel Assalam. Bâtie sur les friches d’un ancien entrepôt Dassault, elle devrait être agrandie courant 2016 grâce à l’appui financier des fidèles, selon Mohamed El Aissaoui. Des imams diligentés par le Maroc y officient. La seconde, la mosquée Al-Ihsan, ou mosquée Renault, en référence à l’ancien garage de la marque automobile sur lequel est installé l’édifice, est gérée par Abdelkader Achebouche, un Algérien né en 1931. Arrivé en France en août 1965, il cumule les emplois avant de fonder, en 1974, deux agences de voyages, qu’il gère jusqu’en 1995. Pragmatique, il installe une cabane dans le jardin du pavillon d’un ami à Asnières (Hauts- de-Seine), puis, le 28 juin 2010, il inaugure la mosquée Al-Ihsan en présence de François Fillon, alors Premier ministre. Cette mosquée s’étend sur 3.000 mètres carrés emploie des imams nommés par l’Algérie.
Avec 28.000 musulmans pour quinze lieux de culte, de tailles différentes, la ville d’Argenteuil illustre bien la fragmentation de l’islam en France. Outre les Maghrébins, les Turcs représentent également une portion significative de l’islam argenteuillais. Dans cette ville, ils disposent d’un important centre religieux.
Dans les mosquées dites «turques», le Diyanet, direction des affaires religieuses d’Ankara, organise la formation et l’envoi des imams turcs en France. Du côté de l’Algérie et du Maroc, le système de nomination des imams, autrefois organisé autour des amicales, a évolué. «Les deux pays du Maghreb ont redéployé leurs stratégies pour encadrer les lieux de culte de manière officieuse31», explique Omero Marongiu-Perria. Ce découpage cultuel de l’islam est une émanation des vagues d’immigration issues du Maghreb, d’Afrique subsaharienne ou encore d’Asie Mineure. Regroupés en communautés de travailleurs, les musulmans de France se sont avant tout organisés en groupes socio-ethniques.
Conservant un fort lien avec le pays d’origine, l’islam en France a posé les bases de ce que les experts nomment l’islam consulaire, c’est-à-dire un islam organisé depuis les pays d’origine des premières générations d’immigrés. Celles des pères dont la présence dans les associations religieuses reste prégnante et qui marque, aussi, une ligne de fracture interne aux musulmans de France. Culturellement, on peut parler de fossé. Ainsi, après les attaques de janvier 2015, un Français musulman basé en Anjou, chirurgien de profession, s’agaçait de cet islam consulaire totalement en décalage avec les événements dramatiques : «Comment voulez-vous qu’un imam arrivé du Maroc, il y a trois mois, qui ne connaît rien à la culture française, à la cuisine française et à Charlie Hebdo puisse se saisir de cet instant d’exception ?32», lançait-il. Des mots qui font écho à la fragmentation de cette dite communauté musulmane davantage semblable à un puzzle.
Individualité vs communauté
La question des trajectoires sociales est également prégnante dans cette population musulmane. Depuis les années 1980, l’accès à l’enseignement supérieur s’est démocratisé. Dans les quartiers populaires, espaces qui concentrent une grande part de musulmans, ils ont été de plus en plus nombreux à décrocher le bac, sésame pour l’enseignement supérieur. D’ailleurs, dans la dernière enquête PISA (Programme international pour le programme du suivi des acquis des élèves) menée par l’OCDE en 2012, l’analyse des inégalités subies par les enfants de l’immigration montre des résultats significatifs. On apprend ainsi que les enfants de la première génération obtenaient des résultats inférieurs de 83 points à ceux des autres élèves, contre 60 points pour ceux de la seconde génération. Des résultats bien sûr défavorables, mais qui indiquent, en contrepoint, une évolution positive du rapport aux études. Au-delà du diplôme, cette avancée a profondément modifié les trajectoires individuelles dans ces populations. À l’échelle d’une cité, les parcours de vie ont forcément joué sur la façon de pratiquer sa religiosité. L’accès aux savoirs universitaires a ainsi pu influer sur la maîtrise des enseignements religieux mais aussi sur la pratique.
Une ligne de démarcation qui se retrouve dans la communauté musulmane. Dans une mosquée au moment de la prière, si la oumma permet de gommer toutes les aspérités sociales, culturelles ou ethniques, dans la réalité du quotidien, les Français musulmans sont comme l’ensemble de leurs concitoyens : différents et pluriels.
Rupture générationnelle
Propos recueillis par Nadia Henni-moulaï lors d’une interview le 13 janvier 2015.
Propos recueillis par Nadia Henni-moulaï lors d’une interview le 13 janvier 2015
Cité par Nadia moulaï, in « Saint-Gratien : les fidèles refuseraient un lieu de culte », saphirnews.com, 21 janvier 2009
À d’autres niveaux, on peut évoquer une rupture générationnelle. Sur le terrain, les chibanis à la tête des associations religieuses n’ont pas su ou pu passer le relais aux jeunes générations. Comme le souligne Omero Marongiu-Perria, «on est à quarante ans de structuration d’islam en France et il est toujours aux mains des primo-arrivants33». Le sociologue va même plus loin puisqu’il pointe «l’absence d’approche française de ce culte34». La question d’un islam en France passe certainement par l’appropriation de ce monothéisme par les jeunes Français. Un passage de relais des primo-arrivants vers les générations suivantes semble nécessaire pour bien ancrer l’islam en France et dépasser le conflit culturel mais aussi générationnel parfois perceptible dans la relation avec les institutions. Sur le terrain, cette rupture se décline à travers la gestion des relations entre musulmans et pouvoirs publics. Alors que les anciens, les parents immigrés, ont toujours privilégié des discussions informelles avec les élus, les jeunes générations de Français musulmans n’hésitent plus à aller sur le terrain juridique pour faire valoir leurs droits.
En 2005, l’Association franco-maghrébine de Saint Gratien (AFMSG), dans le Val-d’Oise, créée dans les années 1980, est en passe d’acquérir un pavillon à l’orée de la cité : «174.000 euros au total sont collectés grâce aux fidèles35», confie Ladli Lambarek, alors président de l’association. Mais la mairie avance le projet d’un relogement social et préempte alors le lieu. Le dialogue entre l’édile et les chibanis de l’association est pourtant maintenu. C’est l’entente cordiale, mais en 2010, le conflit éclate au grand jour. Le 29 août 2010, une prière collective est organisée sur le terrain de sports des Raguenets, quartier populaire de la commune. À la manière d’un happening, 200 personnes interpellent l’édile sur le droit au culte qu’ils jugent bafoué. Menée par un groupe de jeunes Français musulmans, l’action déclenche simultanément l’ire de la mairie dénonçant «l’action d’extrémistes musulmans» mais aussi celle des musulmans «historiques» représentés par Ladli Lambarek. Ce dernier a dû faire face à la naissance, en 2010, de l’Association des musulmans de Saint-Gratien, à l’initiative de la prière en plein air. Pointée du doigt pour son immobilisme et son incapacité à créer un rapport de force avec l’édile, l’association des chibanis se résout après plusieurs mois à se rallier à la structure créée par les jeunes Gratiennois. Une situation source de nombreuses critiques chez les musulmans du quartier qui dénoncent une «forme d’irrespect à l’endroit des anciens». L’Association des musulmans de Saint-Gratien saisit le tribunal administratif pour dénoncer le refus de la mairie de leur mettre une salle à disposition au titre de la liberté de réunion et de culte. Le 16 août, le Conseil d’État confirme une décision du tribunal administratif en faveur de l’association. Depuis, la relation conflictuelle entre les parties persiste dans un dialogue de sourds.
Au-delà du conflit entre les autorités publiques et les musulmans de la ville, l’événement traduit bien le conflit générationnel naissant entre les premières générations d’immigrés musulmans qui, dès les années 1960, ont organisé à leur manière cet islam français et les jeunes Français issus de ces mêmes vagues d’immigration en provenance du Maghreb, d’Afrique subsaharienne ou d’Asie Mineure. Ces jeunes citoyens, pleinement français, investissent le terrain du droit, une différence de poids par rapport à leurs aînés. Une approche différente de celle des anciens dotés d’une carte de résident mais surtout ayant assimilé cette forme de devoir de discrétion, résidus probables du statut de l’immigré. Cette jouissance de la nationalité française propre aux jeunes musulmans de l’immigration marque une divergence très nette au sein de la communauté musulmane. Alors que les associations culturelles historiques s’évertuent à préserver des relations de compromis avec les pouvoirs publics, celles dirigées, en quelque sorte, par leurs progénitures recourent sans détour à l’arsenal juridique. Elles ont la connaissance et la pleine conscience d’être dans un État de droit.
Des courants forts en interne
Cité par Nadia Henni-moulaï, in « Communauté musulmane de France… », art. cit
Ibid.
À ne pas confondre avec les salafs (« pieux devanciers »). il s’agit des trois premières générations de musulmans : les compagnons du Prophète, puis les deux suivantes auxquels se référaient les musulmans aspirant à l’unité, à l’humanisme, à l’éducation spirituelle, au respect de l’autre. Cette précision est ainsi, comme l’explique éric Geoffroy dans la réédition de son livre L’islam sera spirituel ou ne sera plus (Seuil, à paraître) : « Les salafistes actuels incarnent en fait la totale inversion du vécu des salaf dont ils se réclament, et certains parlent à leur égard de “hold-up„ de la civilisation islamique : ils promeuvent la pensée unique, l’uniformité dans la tête et dans l’habit, alors que l’islam classique s’est caractérisé par un pluralisme, une éthique de la divergence, un foisonnement d’écoles et de courants de pensée que les contemporains – musulmans ou non – peinent à imaginer. Le savant muhammad Said Ramadan al-Bûtî (m. 2013) a vite retourné leur maigre slogan en montrant que le nom qu’ils se sont arrogés, salafiyya, était bien, lui, la “mauvaise innovation” (bid’a) qu’ils accusent tout le monde de perpétrer. »
Mythe d’un électorat musulman, ancrage ethnique, trajectoires individuelles et rupture générationnelle représentent les réalités de la population musulmane de France. À cette typologie s’ajoute la problématique des courants religieux à l’intérieur même de la oumma, communauté de foi islamique et qui, en définitive, constitue un indice de structuration très caractéristique. D’après Hanan Ben Rhouma, rédactrice en chef de Saphir News, un média dédié au fait musulman en France, «croire et faire croire que la communauté musulmane serait composée de membres pratiquant et vivant leur islam de la même manière est une grave erreur36». Et la journaliste de renchérir : «Il n’existe pas de communauté musulmane à proprement parler. Elle se distingue par sa diversité religieuse, idéologique, ethnique, politique et sociale37.»
Sur le terrain, l’éclatement de la communauté musulmane est particulièrement visible. En France, les Frères musulmans, incarnés par l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), des conservateurs comparables aux démocrates chrétiens, constituent l’acteur le plus structuré. Le Tabligh, venu d’Inde, est ultraconservateur mais pacifiste. Très présent dans les quartiers, il prône une pratique stricte, sans pour autant verser dans le prosélytisme. Dans les années 1990-2000, les experts lui reconnaissaient un rôle dans la baisse de la délinquance en ramenant les jeunes vers la mosquée. Les salafistes, les yeux tournés vers l’Arabie saoudite, défendent un islam jugé ultraconservateur et littéraliste38. Enfin il existe d’autres courants à travers des organisations telles que la Fédération nationale des musulmans de France (FNMF), la Mosquée de Paris, FAIAACA, les Turcs… Un éclectisme que le Conseil français du culte musulman (CFCM) a bien du mal à fédérer. En cause, le discrédit dont il souffre et reproche qu’on lui fait d’être à la fois absent sur le terrain, source de son illégitimité, et d’être trop proche de la sphère politique
La question du leadership
Discussion avec l’auteur lors d’une réunion privée de terrain le 18 février 2015, qui n’a pas fait l’objet d’un article spécifique.
Sur le terrain, les responsables d’associations cultuelles citent peu souvent le CFCM. Les attaques menées en France en 2015 ont mis en lumière la faiblesse de représentation de cette institution. Mohamed M., responsable d’une mosquée en région parisienne a dû gérer la crise à son niveau : «Le jour des attentats, j’ai tenté de mettre en place une réunion de crise avec les responsables cultuels de mon secteur», expliquait-il lors d’une réunion privée en février 201539. Cette initiative personnelle ne résulte pas d’une stratégie de crise plus globale logiquement dévolue à un organe comme le CFCM. Dans ce contexte, il est donc difficile pour les musulmans de trouver un consensus à travers une instance unique, et la création du CFCM en 2003 en témoigne. L’instance, dont Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, avait été le fer de lance, n’a jamais vraiment trouvé grâce auprès des Français musulmans. La représentativité de l’islam en France est un projet compliqué à mettre en œuvre tant la communauté musulmane de France est hétérogène et encore affiliée au pays d’origine, Algérie, Maroc ou encore Turquie.
Structurer une communauté Fantasmée
Vingt ans d’«islam de France»
Les musulmans dans leur diversité ne veulent pas être les pions d’une instance créée de toutes pièces par l’État. D’autant plus qu’ils ont conscience de représenter un curseur électoral pour l’ensemble de la classe politique. La création du CFCM en est une caractéristique. Il y a plus de vingt ans, le projet d’une institution représentative de l’islam de France (et non en France, qui prendrait en compte toutes la pluralité des réalités musulmanes françaises) était évoqué. C’est en 1990 que Pierre Joxe, ministre de l’Intérieur de François Mitterrand, créa le Conseil de réflexion sur l’islam de France (Corif). Une démarche innovante mais qui souffrait de son mode de désignation des membres, basé sur la nomination et la cooptation. En 1993, Charles Pasqua, alors ministre de l’Intérieur d’Édouard Balladur, tenta à son tour d’organiser la communauté musulmane. Il créa un Conseil représentatif des musulmans de France. La Mosquée de Paris, affiliée à l’Algérie, est à la tête de cette nouvelle instance, mais ce n’est pas du goût de toutes les organisations musulmanes. Après ce nouvel échec, le projet est réactivé en en 1999 par Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Jospin. Il initie une concertation auprès des musulmans de France, espérant poser les bases d’une organisation. S’appuyant sur des délégués élus à la proportionnelle en région, l’initiative aboutira en 2003 au fameux CFCM sous l’impulsion du ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy. Un lent processus, passé successivement par la gauche et la droite mais qui reste, malgré tout, encore en chantier. Si tous les acteurs s’accordent sur l’impérieuse nécessité de trouver un interlocuteur institutionnel pour les musulmans de France, reste à savoir si l’État est vraiment dans son rôle quand il prévoit de participer à l’organisation du culte musulman.
Conclusion
Émile Poulat, Scruter la loi de La République française et la Religion, Fayard, 2010.
en octobre 1989, le collège Gabriel-Havez, à Creil (oise), situé en zone d’éducation prioritaire (ZeP), a exclu, au nom du principe de neutralité et de laïcité scolaire, trois élèves qui refusaient d’enlever leur Si le principal du collège, après avoir négocié avec les familles, avait obtenu que le foulard soit retiré pendant les cours, l’affaire pris néanmoins une ampleur nationale.
Le concept même de «communauté musulmane» sonne avant tout comme un raccourci intellectuel. Il est caractéristique d’une facilité de langage, propice au fantasme, celui des Français musulmans agent du communautarisme. Or comment parler de «communautarisme» en l’absence de communauté homogène, définie et structurée. L’effervescence médiatique et politique autour de l’Islam en France pose la question de l’«autodétermination» de cette population. Dans une société sécularisée, quelle marge de manœuvre disposent les musulmans de France pour écrire leur récit de manière autonome ? Dans un État de droit comme la France, la question est bien sûr rhétorique. Les musulmans, fort de cet atout qu’est la loi de séparation des Églises et l’État de 1905, jouissent d’un cadre bienveillant pour vivre leur foi et leur culte en toute quiétude. Et c’est parce que le texte est une référence pour l’ensemble des cultes qu’il leur offre la liberté de tracer leur sillon dans l’espace républicain en toute indépendance. Cette loi ne permet pas aux autorités de s’ingérer dans les affaires cultuelles des communautés religieuses. Communauté musulmane importante en Europe, les musulmans de France constituent un véritable laboratoire de prospectives. C’est ce qui explique aussi leur difficulté pour trouver leur place dans une République méfiante, qu’on le veuille ou non, à l’égard de l’objet religieux. Dans un ouvrage référence paru récemment, l’historien Émile Poulat, sommité de la laïcité, pointait la relégation du fait religieux dans la sphère privée, empêchant toute discussion apaisée et constructive sur le sujet40. Or, et nous le voyons bien aujourd’hui, contrecarrer les discours de haine suppose d’être outillé pour les déconstruire.
C’est aussi pour cela que la communauté musulmane doit se saisir de la loi de 1905 pour bâtir sa présence et sa visibilité. Depuis plus de vingt ans, la question de l’islam a surgi dans le débat public. L’affaire de Creil impliquant des collégiennes voilées en 198941 a été le point de départ d’une longue série de polémiques politiques et médiatiques. Si le fantasme d’une communauté musulmane permet de conforter l’opinion publique dans la peur de l’islamisation de la France, il ne reflète en rien la réalité. Les musulmans de France sont davantage réunis par le rite que par les idées. Mais si ce fantasme persiste, c’est aussi la responsabilité de ses fidèles. On touche là le cœur du sujet. Les musulmans sont-ils en mesure de reprendre la main sur leur image ? De prime abord, la réponse est négative. Mais, comme on le soulignait plus haut, un processus est en cours chez les Français musulmans. Le mythe du retour au pays, entretenu par leurs parents, s’est transformé en un ancrage fort revendiqué par leurs enfants à partir des années 1980. De plus, à la question de l’identité musulmane s’est adjointe, assez récemment, celle de la citoyenneté française. Replacée à l’échelle de l’histoire de France, la communauté musulmane est en pleine structuration. Alors si elle prend conscience que son image lui appartient, dans toute sa pluralité, nul doute qu’elle saura inscrire son destin dans le roman national français.

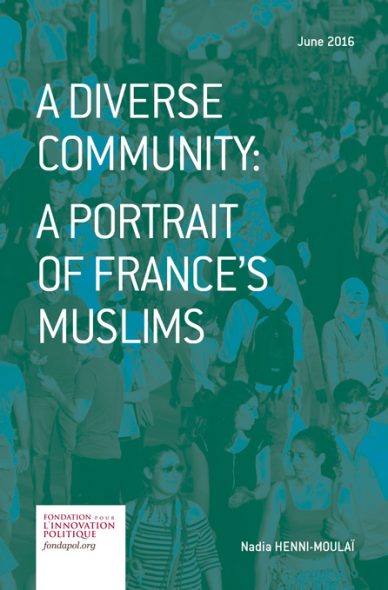

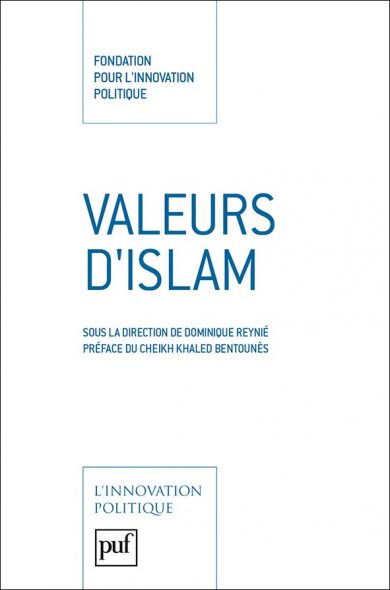











Aucun commentaire.