Que peut-on demander à la politique monétaire ?
Introduction
Le rôle de la monnaie
Premier aspect de la création monétaire : l’augmentation de la quantité de monnaie et l’effet d’encaisses réelles
Deuxième aspect de la création monétaire : la distribution de crédits d’origine monétaire
Approches théoriques de la politique monétaire
Les erreurs de l’approche keynésienne
La courbe de Phillips et les monétaristes
La théorie « autrichienne » des cycles
La politique monétaire facteur d’illusions
Les objectifs de la politique monétaire
La règle monétaire
Le « monétarisme de marché »
Fed et BCE
Création monétaire et taux de change
Illustrations pratiques
Propositions
Introduction
La monnaie fascine et l’on pourrait presque dire que les débats la concernant sont éternels. Ils sont en tout cas omniprésents à notre époque, et l’attention des financiers, aussi bien que du grand public et des hommes politiques, est continuellement focalisée, par exemple, sur ce qu’on appelle «la crise de l’euro», sur la politique monétaire américaine et le «quantitative easing», ou celle de la Banque centrale européenne (BCE) et sa politique à l’égard de la dette souveraine. Nombreux, en particulier, sont ceux qui réclament une politique monétaire active pour atténuer les cycles économiques ou pour aider à la reprise économique après une crise. Il est donc essentiel d’analyser, de manière rigoureuse, le rôle de la monnaie, le fonctionnement des systèmes monétaires et les prescriptions de politique monétaire. C’est ce que nous nous efforcerons de faire dans la présente étude.
Quelle démarche poursuivre à cet effet ? La tentation, dans ce domaine, consiste à multiplier les exemples, à accumuler des faits et à essayer d’en tirer des enseignements. Or, les faits ne parlent pas par eux-mêmes, et c’est particulièrement vrai dans le domaine monétaire puisqu’il est difficile, si ce n’est impossible, d’isoler le rôle de la monnaie dans l’évolution de l’activité économique à partir de la simple observation des faits, dans la mesure où le fonctionnement d’une économie résulte d’une multitude de facteurs dont l’influence respective ne peut pas être décelée immédiatement. La seule méthode valable consiste à effectuer un raisonnement théorique, quitte à rechercher ensuite s’il apporte un éclairage valide pour l’interprétation des phénomènes économiques. C’est cette démarche que nous allons entreprendre. Nous nous efforcerons de la rendre aussi claire que possible, même si, nécessairement, une telle démarche demande un certain effort conceptuel. Mais devant l’importance des problèmes en cause, et l’urgence d’une bonne compréhension, nous pensons que cet effort devrait être accepté et même désiré par tous ceux qui portent un intérêt particulier aux questions monétaires, qu’ils soient des personnalités politiques, des journalistes ou des citoyens éclairés.
Le rôle de la monnaie
Il est peut-être utile, en ce point, de rappeler que la notion d’optimum – qui est de nature subjective – ne peut avoir de sens qu’au niveau La quantité optimale de monnaie est donc celle qui correspond à l’ensemble des quantités optimales pour tous les individus. Elle ne peut pas être définie par un observateur extérieur, elle ne peut qu’être révélée par le comportement des agents économiques.
La valeur réelle d’une encaisse monétaire est égale à sa valeur nominale (exprimée en monnaie) divisée par un indice des prix, c’est-à-dire un indice du prix en monnaie d’un certain «panier de biens». La mesure du pou- voir d’achat de la monnaie et de son évolution dans le temps ne peut évidemment pas être parfaite puisque dif- férents individus sont intéressés par différents «paniers de biens». Les statisticiens construisent un indice de prix à partir de l’hypothèse que l’on peut définir un «panier de biens moyen» résultant de l’observation du comportement d’achat des agents économiques. Mais il est évident qu’il ne s’agit là que d’une approximation.
Il est clair que la monnaie rend des services aux agents économiques, et on ne peut valablement étudier le rôle qu’elle joue dans une société sans tenir compte de ces services. Or, une grande partie des raisonnements habituels sur la monnaie et la politique monétaire repose sur une sorte de mécanique globale consistant à établir des relations a priori entre des variables macro- économiques arbitrairement construites. Mais ces raisonnements oublient de s’interroger sur les comportements monétaires des individus qui constituent pourtant les déterminants uniques des variables monétaires. C’est cette approche réaliste – car reposant sur le comportement rationnel des individus – que nous adoptons ici. Les raisonnements qui suivent relèvent de la stricte logique de l’action humaine et, en tant que tels, ils nous semblent difficiles à contester. Les approches que nous critiquons reposent, pour leur part, bien souvent sur des hypothèses dénuées de liens avec le comportement humain réel, et elles nous semblent donc bien souvent arbitraires.
La monnaie peut être définie comme un pouvoir d’achat généralisé, c’est- à-dire qu’elle est échangeable (ou à peu près) contre n’importe quoi, à n’importe quel moment et auprès de n’importe qui. Détenir de la monnaie, c’est faciliter les transactions et faire face aux incertitudes de la vie. Tels sont les services rendus par la monnaie. Mais une monnaie donnée à un moment donné rend plus ou moins bien ces services, et il est donc essentiel de se demander comment assurer à la monnaie la meilleure qualité possible.
La monnaie rend donc des services essentiels, et elle est, bien évidemment, détenue pour cette raison. Mais détenir de la monnaie, c’est renoncer à se procurer d’autres biens qui apporteraient d’autres satisfactions (dont certaines pourraient d’ailleurs être proches de celles que procure la monnaie, comme cela est le cas pour la détention d’actifs financiers qui apportent, par exemple, des services de sécurité par rapport aux incertitudes du futur). C’est pourquoi personne ne souhaite rationnellement détenir une quantité illimitée de monnaie. Plus précisément, chaque individu souhaite détenir, en moyenne, une certaine quantité d’encaisses monétaires – ni plus, ni moins – qui constitue le montant optimum pour lui1, compte tenu de son revenu et de son patrimoine, des autres opportunités de placement et de son appréciation des risques futurs ou de la variabilité de ses recettes et dépenses futures. Mais il faut garder à l’esprit que les individus désirent, non pas une certaine quantité d’encaisses nominales, mais une certaine quantité d’encaisses réelles, c’est-à-dire qu’ils sont sensibles au pouvoir d’achat réel représenté par les encaisses monétaires qu’ils détiennent2. En d’autres termes, il ne revient pas au même pour un individu de détenir 1000 € si le panier de marchandises qu’il désire obtenir dans le futur vaut 500 € ou 2000 €.
Supposons donc qu’à un moment du temps tous les individus détiennent le montant d’encaisses réelles qu’ils désirent, et supposons qu’une expansion monétaire est décidée. Cette expansion présente en fait deux aspects qu’il est essentiel de distinguer soigneusement.
Premier aspect de la création monétaire : l’augmentation de la quantité de monnaie et l’effet d’encaisses réelles
Nous verrons ultérieurement qu’il existe un cas dans lequel la déflation peut avoir des conséquences néga- tives
D’autant plus qu’il y a un phénomène de « fuite devant la monnaie » en cas d’inflation, comme on le constate particulièrement dans les cas d’hyper-inflation où les détenteurs de monnaie finissent par ne plus utiliser la monnaie, et lui trouvent des substituts réels.
Étant donné que tous les agents économiques possédaient initialement la quantité de monnaie optimale pour eux, ils détiennent trop de monnaie du fait de la nouvelle création monétaire, compte tenu des prix existants. Ils vont donc vendre la monnaie en excédent contre des biens actuels ou futurs (c’est-à-dire des actifs financiers). La théorie des prix, conforme à l’expérience courante, implique de toute évidence que les prix monétaires des biens vont augmenter, puisqu’il y a une offre excédentaire de monnaie par rapport aux biens. Mais on peut aussi dire – ce qui est plus important – que le prix de la monnaie en termes de biens, c’est-à-dire son pouvoir d’achat, diminue. On peut alors tirer de cette proposition absolument incontestable, deux observations importantes :
- La monnaie étant un pouvoir d’achat en attente, elle est d’autant plus utile que ce pouvoir d’achat se maintient Or, la création monétaire se traduisant par une perte de pouvoir d’achat, elle constitue une atteinte à la qualité même de la monnaie. C’est pourquoi on peut dire que l’inflation – c’est-à-dire l’augmentation des prix monétaires des biens – est nécessairement mauvaise. De ce point de vue, il est donc tout aussi absurde de désirer une politique monétaire inflationniste qu’il le serait de désirer des roues carrées. Certes, on dira peut-être que l’inflation peut avoir, par ailleurs, des avantages qui peuvent compenser totalement, ou partiellement, la perte de valeur de la monnaie. Nous verrons, en fait, qu’il n’en est rien.
- Ce qui intéresse les agents économiques, c’est évidemment la valeur réelle de leurs encaisses, c’est-à-dire leur pouvoir d’achat. Or, on voit que les agents économiques obtiennent toujours le niveau d’encaisses réelles qu’ils souhaitent en vendant ou en achetant des encaisses monétaires, ce qui en fait varier le Par simple application de la théorie des prix, on sait que le taux d’inflation (ou de déflation) est fonction de l’écart entre le taux de croissance réel et le taux de croissance monétaire. Ainsi, si les autorités monétaires créent trop de monnaie (par rapport à la croissance réelle), il y a inflation, c’est-à- dire que la valeur réelle des encaisses monétaires diminue. En revanche, si le taux de croissance de la masse monétaire est plus faible que le taux de croissance réelle, il y a déflation. Contrairement à ce qui est souvent proclamé, la déflation est souhaitable. Elle signifie, en effet, que le pouvoir d’achat de la monnaie augmente dans le temps, c’est-à-dire qu’elle rend plus de services3.
On appelle effet d’encaisses réelles ce processus par lequel les individus obtiennent le niveau désiré d’encaisses par le simple jeu des offres et demandes de monnaie contre des biens sur les marchés, sans intervention d’une quelconque autorité monétaire. Cet effet constitue le cœur de la théorie monétaire et il est regrettable qu’il soit généralement totalement ignoré de la plupart de ceux qui s’intéressent à la monnaie et à la politique monétaire. Or, il a une implication tout à fait remarquable. En effet, comme nous l’avons déjà dit, ce qui intéresse les agents économiques, c’est de détenir une certaine quantité d’encaisses réelles et non d’encaisses nominales. Or, la politique monétaire consiste à créer des encaisses nominales, et plus le système monétaire crée de la monnaie (encaisses nominales), moins les agents économiques disposent d’encaisses réelles4. On peut donc dire que le meilleur moyen de créer des encaisses (réelles) c’est de ne pas créer d’encaisses (nominales).
Ainsi, à ne considérer que l’aspect monétaire du problème, il est évident que la création monétaire ne peut pas stimuler une économie, bien au contraire. En effet, en détériorant la qualité de la monnaie – et en incitant éventuellement les individus à effectuer une «fuite devant la monnaie» – elle rend l’activité économique moins efficace. Il n’est donc pas étonnant que l’on ait souvent constaté une relation inverse entre l’inflation et la croissance économique.
Deuxième aspect de la création monétaire : la distribution de crédits d’origine monétaire
À notre époque, la création monétaire s’accompagne nécessairement d’une distribution de crédits. Elle constitue un simple jeu d’écritures dans les bilans des banques : une banque accroît ses actifs du montant des crédits accordés et elle accroît ses engagements d’un même montant, correspondant à l’accroissement des dépôts. Or, tous les agents économiques ne sont pas emprunteurs et ceux qui empruntent obtiennent leurs crédits à des dates différentes. Ceux qui sont les premiers à emprunter obtiennent un gain de pouvoir d’achat par rapport aux autres car ils peuvent dépenser la monnaie ainsi obtenue avant que les prix augmentent. Ce gain diminue avec le temps, parallèlement à l’augmentation des prix. Par ailleurs, dans la mesure où la création monétaire implique une diminution des taux d’intérêt, certains sont également bénéficiaires de ce point de vue. C’est dire que la création monétaire a des effets de répartition dont on ne peut évidemment pas trouver la justification, car ils sont arbitraires. Nous verrons ultérieurement un aspect important de cette question.
Or, ceux qui parlent de la nécessité d’une politique monétaire plus expansionniste, n’en précisent généralement pas la raison : est-ce qu’ils souhaitent une augmentation de la masse monétaire pour elle-même, mais on voit mal en quoi elle pourrait stimuler l’activité économique, c’est-à-dire avoir des effets autres qu’inflationnistes. Ou bien, lorsqu’ils se déclarent en faveur d’une politique monétaire expansionniste, pensent-ils plutôt à la contrepartie de la croissance monétaire, à savoir la distribution de crédits ? Il serait indispensable que les défenseurs d’une politique monétaire active précisent toujours les relations causales auxquelles ils croient. Or, l’aspect purement monétaire de l’expansion monétaire, à savoir l’augmentation des prix des biens, n’est pas désirable par lui-même. Mais que peut-on penser de l’expansion des crédits ? Nous avons vu qu’elle correspondait à un effet de répartition peu mesurable et arbitraire. Mais ne peut-on pas considérer qu’elle a un rôle de stimulant de l’activité économique ? C’est sans doute ce que pensent implicitement ceux qui défendent l’expansion monétaire. Pourtant, assez curieusement, ils ne le précisent jamais et ils considèrent a priori qu’une expansion monétaire stimule «l’économie nationale», ce concept abstrait, détaché de toute hypothèse logique concernant le comportement humain. Nous aurons à discuter ultérieurement cet aspect important de la question.
En définitive, une expansion monétaire a donc trois importantes conséquences :
- Une augmentation des prix
- Des effets de répartition : ceux qui bénéficient les premiers de l’expansion monétaire détiennent un avantage par rapport aux autres, puisqu’ils vont pouvoir dépenser les nouvelles encaisses ainsi obtenues par endettement avant que les tous les prix aient augmenté ; les autres agents économiques sont évidemment perdants.
- La création d’incertitudes puisque personne ne peut prévoir avec précision le taux d’inflation et, surtout, les déformations dans la structure des prix (ce qui dépend de la structure des crédits et de la structure des dépenses faites par les bénéficiaires des crédits d’origine monétaire).
Il est tout de même étonnant qu’on puisse être favorable à une politique d’expansion monétaire alors que celle-ci est nécessairement la cause d’effets de répartition arbitraires et d’une augmentation des risques économiques !
On dira peut-être que nous sommes partis d’une hypothèse un peu extrême consistant à supposer que tous les individus possèdent initialement le montant d’encaisses qu’ils considèrent comme optimal. Ceci constitue, certes, une hypothèse simplificatrice, utile au raisonnement. Mais qu’en est-il si l’on suppose que les individus ne possèdent pas initialement le montant optimum d’encaisses ? Normalement, ils vont essayer de s’en rapprocher en achetant ou en vendant des encaisses, ce qui se traduira par des variations du prix relatif entre les encaisses, d’une part, et les biens et actifs financiers d’autre part. C’est l’effet d’encaisses réelles qui va permettre cet ajustement. Mais il serait vain de demander à la politique monétaire d’aider les individus à trouver leur niveau optimal d’encaisses. En effet, un observateur extérieur ignore nécessairement quel est le montant global d’encaisses considéré comme excessif ou comme insuffisant, et il ignore quels sont les agents économiques qui auraient besoin d’obtenir plus d’encaisses ou, au contraire, d’en céder. Seul le marché, c’est-à-dire le comportement libre de ceux qui sont concernés, permet de révéler ces besoins.
Approches théoriques de la politique monétaire
En considérant, comme cela est légitime, le rôle de la monnaie, nous avons vu que la politique monétaire expansionniste ne pouvait avoir que des effets négatifs (destruction de la valeur de la monnaie,effets de répartition arbitraires, création d’incertitudes). Mais, compte tenu de la croyance si largement répandue dans les bienfaits de l’expansion monétaire, il est également légitime de se poser la question suivante : l’usage de la politique monétaire peut-il avoir des effets macro-économiques bénéfiques qui viendraient compenser, ou même au-delà, les effets nocifs que nous avons rencontrés jusqu’à présent ? Pour répondre à cette question, il semble indispensable de passer en revue les approches théoriques les plus importantes. Il est fréquent d’invoquer, et d’opposer, l’approche keynésienne et l’approche monétariste dont nous allons rappeler les caractéristiques principales. Malheureusement, on oublie presque toujours une troisième approche qui est pourtant, selon nous, la seule capable d’expliquer des phénomènes comme ceux que nous venons de connaître lors de la crise financière et économique récente.
Les erreurs de l’approche keynésienne
La théorie keynésienne considère que, dans certaines circonstances «normales», la politique monétaire peut avoir un effet positif sur l’activité économique. En effet, pour les raisons indiquées ci-dessus, une expansion monétaire implique une baisse du taux d’intérêt, ce qui stimulerait l’investissement. Dans une perspective keynésienne, cette augmentation de l’investissement est désirable, non pas parce qu’elle permettrait d’accroître la capacité productive, et donc ultérieurement la production, mais tout simplement parce qu’elle est censée accroître la demande globale, et donc la production. Nous aurons par la suite l’occasion de discuter cette proposition, mais restons pour le moment dans le cadre de la théorie keynésienne. Celle-ci se focalise, non pas sur cette situation «normale», mais sur une situation particulière qui est censée expliquer un équilibre de sous-emploi pour lequel, au demeurant, la politique monétaire perd sa capacité à stimuler l’investissement et la demande globale.
Sous le prétexte de développer une théorie macroéconomique générale, et plus particulièrement pour expliquer le chômage, Keynes a choisi un ensemble d’hypothèses très spécifiques qui, en les combinant, sont censées expliquer le chômage, et donc aider à la définition des politiques économiques à mettre en œuvre pour retrouver le plein-emploi. Le point de départ de la démonstration consiste à supposer que, pour une raison inexpliquée, il y a soudain une chute de l’investissement et donc un excès d’épargne. Une telle situation n’a pas de cause endogène, c’est-à-dire qu’elle ne résulte pas du fonctionnement normal du système économique ou même d’un choc extérieur, elle est tout simplement le résultat des «esprits animaux» des entrepreneurs qui deviennent tout d’un coup sceptiques à l’égard des développements économiques futurs, et préfèrent ne pas investir. Pour les économistes classiques, dans un tel cas, le taux d’intérêt devrait diminuer, ce qui ouvrirait de nouvelles opportunités d’investissement et réduirait l’épargne, de telle sorte qu’il y aurait un retour à l’équilibre sur le marché des fonds prêtables. Mais, afin de poursuivre son propre but intellectuel, Keynes se doit d’inventer quelques mécanismes susceptibles d’empêcher que ce processus d’ajustement puisse se produire. Il y arrive en faisant deux hypothèses ad hoc, à savoir l’existence d’une trappe à liquidités, et l’inélasticité de l’investissement au taux d’intérêt.
Il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la présente étude, d’insister sur ces deux hypothèses. Mais il est tout de même remarquable que ces deux hypothèses – qui sont le cœur de la théorie keynésienne puisqu’elles permettent de définir un équilibre de sous-emploi – soient totalement arbitraires et contraires aux fondements mêmes de toute analyse économique sérieuse. En effet, l’une et l’autre supposent implicitement que les agents économiques ne sont pas rationnels, soit parce que les investisseurs ne seraient pas sensibles aux signaux de taux d’intérêt, soit parce que les individus conserveraient des encaisses inutiles au lieu de les utiliser. On peut donc s’interroger sur ce paradoxe extraordinaire par lequel l’une des théories économiques les plus célèbres, la théorie keynésienne, est en fait l’une des théories les plus arbitraires et les moins réalistes. Elle doit probablement sa célébrité au fait qu’elle apporte aux gouvernements un alibi incomparable pour pratiquer des déficits budgétaires : grâce à Keynes, ils peuvent toujours prétendre agir ainsi pour permettre la «relance économique». Mais il serait temps d’oublier la théorie keynésienne et de refuser d’appeler «politique de relance» une politique de déficit budgétaire. De manière plus générale, il est erroné de penser que l’activité économique puisse être stimulée par une augmentation de la demande globale obtenue soit par la politique budgétaire, soit par la politique monétaire (soit par les deux, comme tant de pays ont malheureusement essayé de le faire récemment pour sortir d’une crise qui n’avait strictement rien de keynésien).
La courbe de Phillips et les monétaristes
”The Role of Monetary Policy”, The American Economic Review, 58, No. 1, March 1968, pp. 1-17.
La courbe de Phillips a été très à la mode pendant plusieurs décennies, à partir des années soixante, et on peut la considérer comme une sorte de complément à la théorie keynésienne. Comme on le sait, une version de cette courbe implique qu’il existe une relation inverse entre taux d’inflation et taux de chômage, de telle sorte qu’on pourrait diminuer le chômage en pratiquant une politique monétaire inflationniste. Ainsi, alors que la théorie keynésienne avait légitimé l’usage de la politique budgétaire dans le cas supposé d’équilibre de sous-emploi, la courbe de Phillips a donné une légitimité supplémentaire à la politique monétaire, déjà considérée comme efficace dans la théorie keynésienne, dans le cas d’une situation «normale». Or, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que cette courbe n’a pas été élaborée à partir d’une analyse économique rigoureuse, mais seulement à partir de régularités statistiques apparentes, et c’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’elle soit finalement apparue comme trompeuse.
Milton Friedman, dans un célèbre article5, a démontré de manière convaincante, que la courbe de Phillips ne pouvait exister qu’à court terme, alors qu’il existait au contraire une relation diamétralement opposée à long terme, le taux de chômage étant d’autant plus élevé que le taux d’inflation est plus grand (ce qui s’explique probablement par le fait que l’inflation trouble le bon fonctionnement de l’économie, ainsi que nous l’avons souligné). Milton Friedman a fait cette démonstration au moyen d’une analyse théorique, mais il a aussi montré que les faits correspondaient exactement à ce que sa théorie permettait de prévoir.
Si la courbe de Phillips semble exister à court terme, c’est parce que la politique monétaire est créatrice d’illusions : si le taux d’inflation augmente, les salariés n’en sont pas immédiatement conscients, et ils ne demandent donc pas une augmentation de leurs salaires nominaux en compensation. Ainsi, il y a une diminution de leurs salaires réels, donc du coût du travail, ce qui incite les employeurs à accroître l’emploi. Mais les illusions se dissipent évidemment peu à peu et les salariés, devenant de plus en plus conscients de l’inflation, demandent des hausses de salaires nominaux. Pour pouvoir maintenir un niveau d’emploi artificiellement élevé, il est alors nécessaire que les autorités monétaires décident une politique monétaire en accélération constante de manière à créer continuellement de nouvelles illusions, c’est-à- dire en trompant les citoyens. On peut ainsi aboutir à des taux d’inflation très élevés et destructeurs du fonctionnement normal d’une économie. Nous trouvons ici une illustration du fait que la politique économique consiste bien souvent à envoyer des signaux erronés aux marchés, détruisant ainsi les fondements mêmes des calculs économiques.
Milton Friedman et les monétaristes ont certainement eu raison de montrer que la politique monétaire expansionniste, bien qu’elle puisse donner l’impression à court terme de stimuler l’activité économique et l’emploi, ne peut pas avoir d’effet positif à long terme, mais produit simplement une inflation coûteuse. C’est pourquoi ils défendent l’idée d’une «règle monétaire», c’est-à-dire une politique monétaire consistant en ce que les autorités monétaires annoncent à l’avance un taux d’expansion monétaire crédible, et si possible faible, et qu’elles s’y tiennent, quelles que soient les circonstances. En désaccord avec beaucoup d’économistes, en particulier ceux qui se rattachent à la tradition keynésienne, ils considèrent que la politique monétaire doit avoir un seul objectif : empêcher une inflation à taux élevé.
Grâce à la «règle monétaire», les autorités monétaires donnent une information fiable aux marchés et elles évitent l’instabilité inhérente à une politique monétaire discrétionnaire qui se traduit essentiellement par des situations de «stop and go». Les principes monétaristes ont, heureusement, inspiré les politiques monétaires de nombreux pays – comme cela est le cas dans l’eurozone – pendant plusieurs décennies, et on doit leur donner crédit pour avoir ainsi limité les aventures inflationnistes nuisibles qui avaient si souvent existé auparavant et qui existent encore dans nombre de pays. Cependant l’approche des monétaristes, comme celle des keynésiens, reste une approche globale, les uns ou les autres s’intéressant, par exemple, à la demande globale, au taux de chômage national, à la quantité de monnaie, etc. Certes, les analyses et les prescriptions des keynésiens et des monétaristes diffèrent profondément, mais elles ont tout de même en commun cette caractéristique. Par contraste, c’est le grand mérite des économistes de ce qu’on appelle «l’école autrichienne» – qui s’est développée en particulier à partir des travaux de pionniers de Ludwig von Mises et de Friedrich Hayek – d’avoir souligné l’importance des structures de production et des structures de prix, c’est-à-dire d’avoir poussé leurs analyses bien au-delà de la considération des variables macroéconomiques.
La théorie « autrichienne » des cycles
La théorie «autrichienne» du cycle considère que l’origine des fluctuations cycliques est de nature monétaire et que le taux d’intérêt y joue un rôle crucial6. Le taux d’intérêt doit être considéré comme le prix du temps, c’est-à-dire le prix qui détermine les choix entre le présent et le futur. Le taux d’intérêt d’équilibre est celui qui permet la compatibilité entre l’offre d’épargne prêtée par les consommateurs et la demande d’épargne empruntée par les investisseurs. Si, par exemple, les consommateurs décident de consommer moins, et donc d’épargner plus, la plus grande abondance d’épargne va faire baisser le taux d’intérêt, ce qui va inciter les investisseurs à emprunter davantage et rétablir l’équilibre entre offre et demande d’épargne prêtable. Mais un autre processus peut se produire : en effet, la création monétaire a nécessairement pour contrepartie une distribution de crédits et une baisse du taux d’intérêt. Or, la distribution de crédit artificielle d’origine monétaire fait croire qu’il y a plus d’épargne disponible dans l’économie qu’il n’y en a en réalité (d’autant plus que la baisse des taux d’intérêt réduit l’incitation à épargner). La baisse du taux d’intérêt incite les investisseurs à emprunter pour investir davantage. Des facteurs de production sont alors déplacés de la production de biens de consommation vers la production de biens d’investissement. Mais ce partage entre consommation et investissement ne correspond plus au partage désiré par les consommateurs entre consommation et épargne. On produit trop de biens de production et pas assez de biens de consommation : ce déséquilibre ne peut pas durer. Les producteurs de biens de production (y compris de biens immobiliers) font face un jour à des méventes et la crise apparaît. Et si l’on met fin, comme cela est souhaitable, à la politique monétaire expansionniste, la remontée des taux d’intérêt rend encore plus évidentes les erreurs du passé. Il faut revenir à des structures de production plus conformes aux besoins réels des agents économiques. Tel est d’ailleurs le rôle de la crise. Elle implique l’arrêt, ou même la destruction, des activités qui ont été artificiellement développées auparavant, et le retour vers des structures productives et des structures de prix plus conformes aux souhaits des individus. Bien entendu, ce processus d’ajustement est particulièrement coûteux pour certains producteurs et salariés, mais il doit nécessairement être entrepris un jour ou l’autre : on ne peut malheureusement pas revenir sur le passé et éviter les erreurs. Il faut en accepter les conséquences. Si un gouvernement, nourri de préceptes keynésiens, pratique de prétendues politiques de relance d’ordre budgétaire ou monétaire, il empêche ou retarde les ajustements nécessaires. Mais il risque fort, par ailleurs, d’introduire de nouvelles distorsions dans le système économique. Tel est le cas de la politique budgétaire, la structure des dépenses publiques n’étant pas la même que la structure des dépenses privées. Tel est aussi le cas de la politique monétaire expansionniste puisque, nous l’avons vu, celle-ci a des effets réels de distorsion des structures de prix et des structures de production. Elle fait même courir le risque d’un nouveau cycle d’origine monétaire.
Dans un cas comme celui de la France de notre époque, il faut en fait distinguer deux types de problèmes. En effet, la crise économique et financière mondiale d’origine monétaire commencée en 2007-2008, s’est greffée sur une situation de long terme caractérisée par une faible croissance et un fort taux de chômage. Cette situation s’explique, de notre point de vue, par les excès de prélèvements obligatoires et de réglementations7.
Or, nous venons de voir que la politique monétaire expansionniste était incapable de faciliter la sortie de crise. Mais elle est évidemment incapable également de faciliter la sortie de la stagnation de long terme. Pour résoudre un problème, il faut en connaître les causes. Or, si une crise a eu pour origine un excès de création monétaire, il est évident qu’on ne trouvera pas un remède efficace en ayant recours à nouveau à une expansion monétaire. Si la stagnation de long terme est due aux excès de prélèvements obligatoires et de règlementations, on ne résoudra pas ces problèmes en faisant de l’expansion monétaire. Certes, on peut créer des illusions de court terme, comme l’a bien montré la critique de la courbe de Phillips, mais on ne peut pas (et on ne doit pas) tromper tout le monde tout le temps. Malheureusement, il existe un grand risque parce que les gouvernements sont toujours à l’affût de résultats à court terme. En effet, leur horizon est nécessairement court – c’est celui des prochaines élections – et ils ont besoin de faire croire aux électeurs qu’ils résolvent leurs problèmes. Ceci se traduit par une grande instabilité dans les décisions de politique économique, ce qui provoque une grande instabilité des variables économiques.
La politique monétaire facteur d’illusions
Nous verrons plus précisément d’importants exemples d’illusions d’origine monétaire dans les pages qui suivent.
Il implique en particulier que la banque centrale et les banques bénéficient d’un profit supplémentaire du fait que les individus sont obligés de reconstituer, au moins partiellement, la valeur réelle de leurs encaisses monétaires en achetant de la monnaie
Comme nous l’avons vu précédemment, la politique monétaire expansionniste détruit l’information des agents économiques et brouille les signaux de prix, c’est-à-dire les instruments essentiels du fonctionnement d’une économie de marché. Elle créé des illusions et, en ce sens, elle est malhonnête (par exemple, en faisant croire aux gens que leur pouvoir d’achat est augmenté, alors que celui-ci va être amputé par l’inflation8). Elle est arbitraire et aveugle puisqu’elle modifie la répartition des revenus d’une manière difficile à connaître. Elle est anti-démocratique puisqu’elle ne respecte pas le Droit des personnes. Il est donc étonnant qu’un nombre considérable d’hommes politiques, d’universitaires ou de journalistes puissent cautionner de telles pratiques.
nsi que nous l’avons vu, Milton Friedman s’est focalisé sur l’erreur d’information apportée par la politique monétaire en ce qui concerne l’appréciation des salaires réels. Les économistes « autrichiens » se sont, pour leur part, davantage focalisés sur les erreurs d’information concernant le taux d’intérêt ou, plus précisément, les choix entre consommation présente et consommation future. Mais ces deux types d’approche ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La politique monétaire conduit à des erreurs d’appréciation aussi bien en ce qui concerne les salaires réels que le taux d’intérêt. Ainsi, la critique «friedmanienne» des illusions du court terme dans la critique de la courbe de Phillips est parfaitement compatible avec la critique autrichienne des illusions dans le taux d’intérêt (le taux d’intérêt est le prix du temps ; il est très nuisible d’en manipuler la valeur).
La courbe de Phillips existe certes, mais seulement à court terme, et elle est donc à l’origine de décisions regrettables. En effet, on peut être tenté de la faire jouer à court terme en créant de la monnaie et en raisonnant ainsi : s’il y a crise économique, la création monétaire va permettre de diminuer le chômage en imposant provisoirement une baisse des salaires réels qu’on aurait, sinon, du mal à obtenir et en profitant du fait que les salariés n’en sont pas immédiatement conscients. Mais ce faisant, on créé de nouvelles distorsions, par exemple entre les activités à fort contenu de main-d’œuvre et les autres. On accroît donc les distorsions dans les structures productives et, comme on n’a pas résolu les autres distorsions (par exemple, en maintenant artificiellement un taux d’intérêt trop bas), on retarde le retour à l’équilibre. Quand on arrêtera les illusions, on risquera d’enregistrer des salaires réels trop élevés (on avait augmenté les salaires nominaux en anticipant une poursuite de l’inflation, qui ne se produit plus).
L’inflation est, par ailleurs, à l’origine d’un autre type d’illusions. Une inflation non anticipée – et qui n’avait donc pas pu se refléter antérieurement dans les taux d’intérêt – diminue la valeur réelle des dettes, et c’est pourquoi les États qui ont une dette publique importante sont tentés de faire de l’inflation. La perte de pouvoir d’achat due à l’inflation est le moyen par lequel des ressources réelles sont transférées des individus vers l’État. C’est en ce sens que l’on parle, à juste titre, de l’impôt d’inflation9. Il est apprécié des gouvernants car il est moins visible qu’un impôt proprement dit (et il n’est pas voté par le Parlement…). L’inflation est donc, de ce point de vue également, un moyen de créer des illusions et de tromper l’opinion. Le coût en est élevé, puisque, en-dehors même du transfert obligatoire subi par les créanciers, et ainsi réalisé au profit d’un État endetté, il diminue la valeur réelle de toutes les encaisses détenues par les individus, comme nous l’avons vu. Or, il faut bien voir qu’une telle «solution» au problème d’endettement – par la spoliation des détenteurs d’encaisses et des créanciers de l’État – n’est possible que parce que les États disposent du monopole de la création monétaire, ce qui empêche les citoyens de choisir une monnaie non-inflationniste.
Dans toute discipline humaine on considère que l’exigence de rigueur intellectuelle – gage de réussite pratique – implique de connaître les causes d’un problème pour définir les meilleurs moyens de le résoudre. Malheureusement, cette exigence disparaît bien souvent lorsqu’on s’intéresse à des problèmes économiques. Ainsi, lorsqu’on constate une faible croissance et/ou un fort chômage, on préconise une politique monétaire expansionniste et/ou une politique budgétaire expansionniste sans s’interroger sur les causes de la faible croissance et du chômage ! Or, imaginons que cette situation économique soit due aux excès de fiscalité et de réglementations qui détruisent les incitations à entreprendre, travailler, épargner ou investir, comme cela est très probablement le cas en France. On ne voit vraiment pas en quoi l’expansion monétaire peut modifier ce système d’incitations. Elle peut tout au plus, dans certains cas, créer des illusions de court terme. Mais, en se focalisant sur la politique monétaire, on détourne l’attention des vrais problèmes. On ne résout évidemment pas ces problèmes, notamment les excès de fiscalité et de règlementations. Or, comme les illusions se dissipent nécessairement, il en résulte une instabilité accrue. Au total, on fait vivre un pays dans le mensonge, l’instabilité et l’injustice.
Nous le verrons ultérieurement, le caractère illusoire des solutions monétaires pour résoudre des problèmes réels se retrouve, par exemple, avec les politiques de variations de taux de change (dévaluations ou réévaluations). Toutes les manipulations monétaires utilisées sous prétexte de résoudre des problèmes réels (par exemple faible croissance et chômage élevé) sont incapables de résoudre effectivement ces problèmes, et ne peuvent que créer des illusions, elles-mêmes à l’origine d’incertitudes et de distorsions. On devrait, de ce point de vue, utiliser une règle simple :
Il convient d’utiliser des instruments monétaires pour résoudre des problèmes d’ordre monétaire et des instruments réels pour résoudre des problèmes réels.
Ainsi, pour réduire le taux d’inflation, il faut nécessairement pratiquer une politique monétaire moins expansionniste ; pour supprimer l’éventuelle surévaluation d’une monnaie, il faut soit dévaluer, soit – ce qui est mieux – réduire de manière drastique la création monétaire ; pour diminuer le chômage, il faut pratiquer des diminutions d’impôts et supprimer des règlementations hostiles à la flexibilité des marchés du travail ; pour augmenter la croissance, il faut libérer les énergies productives des êtres humains en supprimant les obstacles fiscaux, règlementaires et institutionnels qui détruisent les incitations productives, etc.
En définitive, la politique monétaire est facilement capable de créer des illusions de court terme néfastes ; elle n’est pas capable de stimuler l’activité économique et l’emploi.
Les objectifs de la politique monétaire
La règle monétaire
Nous avons déjà rappelé que ce sont essentiellement Milton Friedman et les monétaristes qui ont préconisé une politique d’objectifs. Milton Friedman préconisait de fixer un objectif de croissance à long terme de la quantité de monnaie et de s’y tenir quelles que soient les circonstances. Mais on a également souvent préconisé ou utilisé un objectif de taux d’inflation. Tel est le cas de la BCE pour laquelle l’objectif à atteindre est un taux d’inflation maximum de 2%. La politique d’objectif est certainement supérieure à la politique monétaire discrétionnaire. En effet, cette dernière a été traditionnellement considérée comme un instrument permettant d’exercer une influence conjoncturelle stabilisatrice, mais elle est, en pratique, plutôt déstabilisatrice. En effet, elle constitue bien souvent une politique de «stop and go» pour deux raisons :
- Tout d’abord parce que l’information est souvent de mauvaise qualité et obtenue avec retard. Ainsi, il faut du temps pour évaluer la situation monétaire et économique, pour que des décisions de politique monétaire soient prises et pour que celles-ci aient des effets. Par ailleurs, les critères d’action peuvent être multiples (inflation, croissance, chômage, etc.) et on ne sait pas avec précision si un problème est d’ordre conjoncturel ou structurel.
- En deuxième lieu, les gouvernements ont tendance à utiliser la politique monétaire pour atteindre des objectifs de court terme, quel qu’en soit le coût à plus long terme. C’est d’ailleurs en grande partie pour cette raison que les courbes de Phillips existent à court terme.
Milton Friedman a eu une influence importante sur les politiques monétaires, et il ne paraît pas excessif de dire que, grâce à lui et grâce à des politiques plus ou moins précises d’objectif monétaire, on a enregistré une diminution des taux d’inflation dans un très grand nombre de pays depuis trois ou quatre décennies. Mais il n’en reste pas moins que l’un des messages importants de Milton Friedman – à savoir la nécessité de renoncer à une politique monétaire variable et l’utilité d’une stabilité à long terme du taux de croissance monétaire – a été oublié, comme en témoigne l’incroyable instabilité des politiques monétaires au début du XXIe siècle, ce qui a été l’une des causes majeures de la crise économique.
La BCE, pour sa part, s’est vu assigner initialement un seul objectif : maintenir la stabilité de la monnaie. Mais ses dirigeants ont interprété cette clause et on a admis généralement qu’elle a un objectif consistant à ne pas dépasser 2% d’inflation. On peut s’interroger sur la justification de cet objectif chiffré. En effet, un taux d’inflation de 2% par an n’est pas négligeable puisqu’il signifie une perte de pouvoir d’achat de la monnaie (en termes de marchandises) de 2%. Mais alors que, semble-t-il, le taux de 2% était considéré comme un taux maximum à ne pas dépasser, une autre interprétation s’est peu à peu imposée de manière subreptice, et on pense dorénavant que la BCE doit agir de manière à atteindre un taux d’inflation de 2%, considéré comme un taux optimum en-dessous duquel il y aurait un «risque de déflation». Or, il existe aussi une autre raison de considérer ce taux de 2% comme excessif. En effet, au début d’une expansion monétaire, ce sont d’abord et surtout les prix des actifs qui augmentent, ainsi que les prix des matières premières, des biens d’équipement ou de l’immobilier (apparition de «bulles»), tandis que les prix des biens de consommation – qui servent généralement à mesurer le taux d’inflation – augmentent tardivement. C’est ainsi qu’ils n’avaient pas augmenté significativement avant les crises monétaires de 1929-1930 ou de 2007-2008. En se focalisant sur le taux d’inflation (des biens de consommation), on a donc une information de mauvaise qualité et trop tardive. De ce point de vue, l’objectif de quantité de monnaie préconisé par Milton Friedman est préférable. En outre, il conviendrait d’ajouter qu’il serait même préférable d’avoir une croissance nulle de la masse monétaire plutôt que, par exemple, un objectif de croissance à 2 ou 3%, pour les raisons que nous avons vues précédemment : comme nous le savons, il est préférable de ne pas créer d’encaisses monétaires nominales, le besoin de monnaie des individus étant satisfait par l’effet d’encaisses réelles.
Le « monétarisme de marché »
Cette expression est étrange : il est en effet inimaginable que le monétarisme de Milton Friedman ne soit pas concerné par le fonctionnement des marchés (ou soit même hostile aux marchés !). Précisément, son objectif consistait à donner une information fiable aux marchés.
On peut se reporter à ce sujet à la note de la Fondation pour l’innovation politique par Nicolas Goetzmann, Une autre politique monétaire pour résoudre la crise, publiée en décembre 2012.
En fait, ce que l’on observe directement, c’est le PIB nominal et on en déduit la valeur du PIB réel en divisant le PIB nominal par l’indice des Comme un indice des prix ne peut pas être « parfait », il est certain que l’évaluation du PIB réel est sujette à débat. Mais ce n’est pas parce qu’on peut mesurer plus facilement le PIB nominal que le PIB réel, que l’on doit le prendre pour objectif de la politique monétaire.
Compte tenu de ce problème majeur d’incohérence et du cadre nécessairement limité du présent texte, il ne nous semble pas nécessaire de discuter en détail un certain nombre d’aspects particuliers et secondaires qui apparaissent dans certaines publications relatives au «monétarisme de marché».
Par exemple, Lars Christensen, Market Monetarism, research paper, septembre 2011, consultable sur le site Internet marketmonetarist.com. La vitesse de circulation de la monnaie mesure le rapport entre la valeur des transactions au cours d’une période – par exemple un an – et le montant de la masse monétaire. Elle est donc égale à l’inverse du montant moyen d’encaisses par unité de transaction.
Ainsi, Scott Sumner écrit : «Si la politique budgétaire risque de conduire à une demande insuffisante en Grande-Bretagne, il en résulte ipso facto que la Grande-Bretagne a besoin d’une inflation plus forte et non pas moins forte» ( cit., p.15). Ainsi, pour lui, la politique budgétaire et la politique monétaire sont des substituts l’une de l’autre et elles déterminent la demande globale !
Malheureusement, dans le désarroi qui a suivi la crise récente – parce qu’on se refusait à adopter la seule analyse susceptible d’expliquer cette crise et de trouver les moyens d’en sortir – certains économistes ont essayé d’inventer des propositions nouvelles.
Tel est le cas de ce qu’on appelle parfois le «monétarisme de marché»10. C’est aux États-Unis que cette approche a pris naissance, en particulier à la suite des écrits de Scott Sumner, mais aussi, assez curieusement, par l’intermédiaire d’un certain nombre de blogs souvent animés par de jeunes économistes11. Cette approche consiste à substituer à l’objectif monétariste traditionnel – quantité de monnaie ou inflation – un objectif de PIB nominal. La politique monétaire devrait, selon cette approche, être déterminée en fonction des écarts existants entre l’évolution constatée du PIB nominal et l’objectif décidé a priori.
Or, le PIB nominal est égal au produit du PIB réel par l’indice des prix, soit PIB nominal = P x PIB réel (où P représente l’indice des prix)12. Il est légitime de souhaiter un certain niveau – ou un certain taux de croissance – du PIB réel et un certain taux de croissance (aussi faible que possible) du niveau des prix, car cela concerne directement le bien-être des individus. Mais on ne voit pas ce qui peut justifier le choix du PIB nominal comme variable- objectif. En effet, il ne revient absolument pas au même d’avoir, par exemple, pour une croissance au taux de 5 % du PIB nominal, un taux d’inflation de 5% et une croissance réelle nulle, ou d’avoir un taux d’inflation nul et une croissance réelle de 5%. Tout le monde sera évidemment d’accord pour préférer la deuxième hypothèse à la première.
Prenons un autre exemple. Supposons que, à la suite d’un excès de prélèvements obligatoires et de réglementations – qui portent atteinte aux capacités d’ajustement des marchés – un pays enregistre une croissance négative au taux de -2%. Si, par ailleurs, du fait d’une croissance monétaire au taux de 3 % on enregistre une inflation de 5%, le taux de croissance du PIB nominal sera de 3%. Si l’objectif de PIB nominal est égal à 5%, les autorités monétaires décideront d’augmenter le taux de croissance de la masse monétaire de manière à atteindre l’objectif fixé (arbitrairement). Si, par exemple, la croissance monétaire est de 5%, on atteindra bien l’objectif de croissance du PIB nominal, soit 5%. Or, la croissance réelle restera à -2% puisqu’elle s’explique par le niveau des prélèvements obligatoires et les excès de règlementations, de telle sorte que la politique monétaire expansionniste n’a évidemment aucun impact sur ces facteurs. En voulant atteindre un objectif de croissance nominale du PIB égal à 5%, on obtient pour seul résultat une augmentation du taux d’inflation (qui passe dans notre exemple à 7%). En poursuivant cet objectif de PIB nominal, on ne peut guère enregistrer que des effets négatifs. Ceci signifie à nouveau que, dans ce domaine comme dans n’importe quel autre domaine, on ne peut résoudre un problème sans en connaître précisément les causes. Si la faible croissance est due à des facteurs non-monétaires, on ne pourra pas la modifier en utilisant des manipulations monétaires.
L’objectif de PIB nominal est donc dépourvu de signification. Il ne repose d’ailleurs sur aucune base théorique et constitue un simple acte de foi. Il semble traduire l’hypothèse implicite et arbitraire selon laquelle la politique monétaire expansionniste stimule la croissance (on se garde bien d’expliquer comment), de telle sorte qu’en se donnant un objectif de PIB nominal on doit bien pouvoir obtenir un peu de croissance réelle.
En fait, la seule chose qui compte c’est précisément de décomposer la croissance nominale entre ses deux composantes, la croissance réelle et la croissance des prix, et par ailleurs de chercher à minimiser l’inflation et à maximiser la croissance réelle. Autrement dit, l’objectif de croissance nominale cache un double objectif. Mais il est bien connu qu’il est impossible d’atteindre deux objectifs de politique économique avec un seul instrument (la croissance monétaire). Ceci constitue même un principe de base évident de la théorie de la politique économique. Il est tout à fait incohérent d’un point de vue purement logique de se donner pour objectif une variable qui est la somme de deux autre variables, et que l’on souhaite pour l’une d’elles (la croissance réelle) d’être aussi forte que possible, et pour l’autre (l’inflation) aussi faible que possible13!
Si la quantité de monnaie déterminait uniquement la croissance réelle – ce que nous récusons évidemment – pourquoi ne pas adopter tout simplement un objectif de croissance réelle ? Mais si on pense qu’elle détermine la croissance réelle et l’inflation, il faut bien admettre que la croissance est déterminée également par des facteurs réels (fiscalité, institutions, règlementations et lois, progrès technique, etc.). Quel sens cela peut-il alors avoir d’utiliser un double objectif pour la politique monétaire sans tenir compte des autres facteurs, si ce n’est en faisant l’hypothèse contestable que ces autres facteurs sont invariables (par exemple la politique fiscale) ?
Les défenseurs du monétarisme de marché adressent à la «règle friedmanienne» le reproche qu’elle suppose une stabilité de ce qu’on appelle la «vitesse de circulation de la monnaie»14. Mais qu’est-ce qui fait varier la vitesse de circulation de la monnaie ? Ce sont essentiellement le taux d’intérêt – dans la mesure où il détermine les substitutions possibles entre encaisses monétaires et créances – et les anticipations inflationnistes. Ainsi, une augmentation des anticipations inflationnistes conduit à diminuer le montant des encaisses désirées, puisqu’il est prévu que la monnaie va perdre une plus grande partie de son pouvoir d’achat. Mais c’est dire que c’est précisément la variabilité de la politique monétaire qui, en induisant des variations du taux d’intérêt et des anticipations inflationnistes, provoque une instabilité de la vitesse de circulation de la monnaie, et c’est bien pourquoi il est dangereux de vouloir mener une politique monétaire active : on n’en connaît pas parfaitement les conséquences. C’est aussi un reproche que l’on peut adresser au monétarisme de marché, puisqu’il préconise une politique monétaire variable (en fonction de la variabilité du PIB nominal).
Par ailleurs, dans la mesure où l’on ne sait absolument pas comment la croissance nominale va se répartir entre croissance réelle et inflation, la fixation du taux de croissance désiré du PIB nominal est totalement arbitraire. Faut-il décider 3%, 5%, 7%, ou plus ? Personne ne peut le savoir.
Certes, on dira peut-être qu’il existe une relation forte entre la croissance monétaire et la croissance du PIB nominal et que, par conséquent, l’objectif de PIB nominal n’est pas aussi éloigné qu’on pourrait le penser de la règle monétaire à la Friedman. Il existe pourtant une différence considérable entre les deux préconisations. En effet, la règle «friedmanienne» implique une constance de la politique monétaire, quelles que soient les circonstances. Le «monétarisme de marché» implique au contraire, pour sa part, une variabilité de la politique monétaire en fonction de la variabilité du PIB nominal (qui dépend de la croissance réelle et de la croissance des prix dans des proportions inconnues). C’est pourquoi le «monétarisme de marché» ne peut pas être apparenté au monétarisme traditionnel. En fait, dans la mesure où il suppose implicitement une relation positive entre la politique monétaire expansionniste et la croissance réelle, il conviendrait plutôt de l’appeler un « keynésianisme de marché » ; ou bien, tout simplement, du «néo-keynésianisme» (puisqu’il ne s’interroge guère sur les processus de marché). Il encourt alors toutes les critiques que l’on peut adresser au keynésianisme.
Le «monétarisme de marché» constitue un ensemble extrêmement touffu et hétéroclite qui le rend quelque peu insaisissable. Ses défenseurs multiplient les cas d’école et les exemples historiques, et affirment de manière un peu péremptoire que tel ou tel phénomène ne se serait pas produit si on avait poursuivi un objectif de PIB nominal. Preons, par exemple, l’hypothèse évoquée par Scott Sumner15, celle où il y a un «choc de productivité». S’il y a une augmentation plus forte que prévue de la productivité, l’augmentation des prix est faible et la poursuite d’un objectif d’inflation conduit à une politique monétaire trop expansionniste. Symétriquement, une plus faible croissance de la productivité se traduit par une inflation plus forte qui incite les autorités monétaires à réduire la croissance monétaire, ce qui «casse la croissance». Mais Scott Sumner n’explicite pas les raisons pour lesquelles le ralentissement de la croissance monétaire aurait cette conséquence sur la production réelle. Par ailleurs, répétons-le encore, il est plus que contestable de faire des prescriptions de politique économique sans préciser les causes du problème que l’on veut résoudre. Si l’objectif le plus généralement poursuivi est celui de la «stabilité macro-économique», c’est-à-dire celui qui consiste à éviter une évolution cyclique, il convient de s’interroger sur les causes possibles de l’instabilité. D’un point de vue très général, les variations imprévues qui peuvent se produire dans un secteur d’activité particulier ne peuvent pas avoir une influence suffisante pour expliquer l’instabilité des variables macro-économiques. Il faut un choc de grande ampleur qui peut être de nature réelle ou monétaire. Un choc réel ne peut pas provenir du fonctionnement normal des économies, compte tenu de l’extrême diversité des économies modernes, contrairement à ce qui pouvait se passer dans des économies moins développées, essentiellement fondées sur l’agriculture, et où, par exemple, les fluctuations climatiques pouvaient avoir d’importantes conséquences réelles. C’est pourquoi, contrairement à l’exemple de Scott Sumner ci-dessus, on doit récuser l’existence d’un «choc de productivité», c’est-à-dire une variation forte de la productivité dans tous les secteurs d’activité (et dans tous les pays…). Un choc réel ne peut provenir que d’un changement brutal d’une politique économique, par exemple une augmentation forte et imprévue de la pression fiscale. Mais il est clair que la politique monétaire est incapable de compenser les conséquences négatives de ce choc. C’est pourquoi l’hypothèse la plus vraisemblable est celle où un choc de nature monétaire est à l’origine de l’instabilité économique, comme nous l’avons expliqué ci-dessus. Ceci implique que la meilleure politique est celle qui consiste à maintenir une croissance stable et faible de la quantité de monnaie, quelles que soient les circonstances. De ce point de vue, d’ailleurs, nous serions plutôt d’accord avec les défenseurs du monétarisme de marché pour critiquer l’objectif d’inflation. Mais il nous paraît très préférable de lui substituer un objectif de stabilité de la quantité de monnaie plutôt que l’objectif ambigu du PIB nominal.
Il est tout à fait clair, dans les différents textes des défenseurs du «monétarisme de marché», que l’effet attendu d’une expansion monétaire est une augmentation de demande, dont on pense a priori qu’elle devrait bien se traduire, au moins en partie, par une augmentation de la production réelle. Mais ces auteurs se gardent bien de préciser s’ils attendent une augmentation de la demande nominale ou de la demande réelle, et ils n’expliquent pas comment cette prétendue augmentation de demande se décompose entre un effet-prix et un effet-quantité. De toute façon, il est également parfaitement clair que, de ce point de vue, ces auteurs sont typiquement et fondamentalement keynésiens16. Or, il est assez étonnant que les keynésiens préconisent une augmentation de la demande globale pour stimuler l’activité économique et l’emploi, sans se préoccuper de savoir pourquoi il y a du chômage et/ou une faible croissance. En fait, l’idée selon laquelle on peut augmenter la demande globale repose sur une totale illusion. Ainsi, si l’État augmente les dépenses publiques – ce qui est censé accroître la demande globale – il doit, pour financer cette augmentation, soit augmenter les impôts – ce qui diminue d’autant la demande globale – soit emprunter – ce qui diminue également la demande globale en détournant le financement disponible de l’investissement privé vers la dépense publique. Au demeurant, il n’y a jamais d’insuffisance de demande globale. En effet, il existe toujours, pour les producteurs d’un pays, une demande presque illimitée, celle du reste du monde. Et la seule question que l’on peut donc se poser est la suivante : comment peut-il se faire que ces producteurs ne répondent pas à cette demande extérieure et pourquoi répondraient-ils alors à l’accroissement de demande exprimée par l’État ? S’ils n’y répondent pas, c’est parce qu’ils ne désirent pas y répondre, c’est-à-dire que leurs conditions de production sont telles qu’ils ne pourraient pas obtenir un profit quelconque en vendant leurs produits aux prix des marchés mondiaux. C’est bien dire que le problème en cause n’est pas un problème relevant de la mécanique des quantités globales, mais un problème de prix et d’incitations à produire. La véritable révolution intellectuelle qu’il convient de faire – et donc la véritable révolution de la politique économique – n’est pas celle qui consiste à substituer un objectif de PIB nominal à l’objectif d’inflation pour la politique monétaire, c’est celle qui consiste à abandonner définitivement la «mécanique des quantités globales» d’inspiration keynésienne pour s’interroger sur le système d’incitations des agents économiques et sur l’environnement institutionnel, fiscal et règlementaire qui le détermine.
Ce n’est pas parce que certaines autorités monétaires – mal conseillées – portent de l’intérêt à l’objectif de PIB nominal qu’il faut faire de même. On utilise ici l’argument d’autorité aussi bien par effet d’imitation de certains pays, que par respect a priori (et non justifié) des positions de certains économistes. Mais ce n’est pas parce qu’ils sont plus ou moins connus qu’ils ont raison. N’est respectable que la position qui consiste à raisonner par soi- même au lieu de se contenter d’imiter les autres (et leurs erreurs).
Fed et BCE
Comme on le sait, la banque centrale américaine, la Fed, est officiellement chargée de poursuivre deux objectifs, la stabilité des prix et un niveau satisfaisant de l’activité économique, tandis que la BCE a pour seul objectif la stabilité des prix. Mais nombreuses sont les voix qui s’élèvent pour réclamer une modification de la «Constitution monétaire» de la BCE de manière à ce qu’elle puisse, elle aussi, poursuivre les deux objectifs assignés à la Fed. Si jamais il en était ainsi, il existerait un grand risque d’instabilité économique, comme l’expérience de la Fed le montre d’ailleurs bien et comme l’illustre, notamment, la récente crise monétaire et financière. Pour stimuler l’activité économique, la banque centrale décide une politique monétaire expansionniste (qui créé des distorsions dans les structures productives et les structures de prix). Des «bulles» se forment et l’inflation n’apparaît pas immédiatement. Mais lorsque l’expansion des «bulles» devient trop forte et que l’inflation se manifeste, on se met à adopter un objectif de lutte contre l’inflation et on réduit la création monétaire. C’est alors le moment de la crise financière et économique. Pour essayer d’en sortir, la banque centrale adopte à nouveau l’objectif de croissance réelle, et elle se lance une fois de plus dans une politique monétaire expansionniste. Dans la mesure où il est évidemment impossible de poursuivre à la fois les deux objectifs au moyen de la politique monétaire, la banque centrale les prend en considération de manière successive, ce qui est à l’origine d’une formidable instabilité. On peut même dire qu’à notre époque la source majeure de l’instabilité économique provient de la politique monétaire et que la poursuite d’objectifs multiples y contribue.
On peut alors penser que le «monétarisme de marché» prend son origine dans le souci de synthétiser les deux objectifs en question, et de les prendre en considération simultanément et non successivement. Mais ce faisant on brouille totalement le jeu monétaire en poursuivant un objectif dénué de toute signification.
Création monétaire et taux de change
Il existe une relation biunivoque entre inflation et taux de change. En effet, le taux de change est le prix d’une monnaie en termes d’une autre et, pour apprécier son rôle, il convient une fois de plus d’utiliser la théorie des prix. On en tire aisément la proposition fondamentale selon laquelle une variation de taux de change reflète l’écart de taux d’inflation entre pays. En effet, le prix d’un panier de biens en termes réels est le même dans le monde entier (hypothèse d’arbitrage) et la variation du prix nominal de ce panier dans un pays est forcément compensée (non pas immédiatement, mais à court ou moyen terme) par une variation du taux de change par rapport à une autre monnaie et/ou de l’inflation concernant cette monnaie.
S’il existe donc une relation de compatibilité entre variation de taux de change et écarts de taux d’inflation, la causalité ne joue pas toujours dans le même sens. Il est, de ce point de vue, essentiel de distinguer les changes fixes et les changes flexibles. En régime de taux de change flexibles, les politiques monétaires sont indépendantes et les variations du taux de change sur le marché reflètent les écarts de taux d’inflation, et donc les différences de politiques monétaires entre les zones monétaires concernées. En régime de taux de change fixes, la croissance monétaire est endogène, c’est-à-dire que les politiques monétaires sont interdépendantes : si un pays veut faire une politique monétaire différente de celles des autres pays avec lesquels il se trouve en régime de changes fixes, des processus d’ajustement rendront les politiques monétaires compatibles. En termes succincts, des flux de monnaie iront des pays ou zones où la monnaie est relativement abondante vers les autres pays ou zones. Si les autorités monétaires d’un pays en régime de changes fixes souhaitent faire une politique monétaire indépendante, elles n’ont pas d’autre solution que de dévaluer ou réévaluer leur monnaie, c’est- à-dire qu’elles renoncent (au moins momentanément) à la décision annoncée précédemment d’échanger sans limites, à un prix fixe, leur propre monnaie contre les autres monnaies de leur zone de changes fixes. Elles annoncent alors un nouvel objectif de taux de change si elles veulent rester en changes fixes, ou elles acceptent que le taux de change soit désormais déterminé sur le marché des changes (adoption de changes flexibles).
Une précision de terminologie est nécessaire en ce point, compte tenu des approximations de langage fréquemment rencontrées dans ce domaine. Il convient de désigner par le terme «dépréciation» (ou «appréciation»), la variation d’un taux de change sur le marché en régime de changes flexibles. On appellera «dévaluation» (ou «réévaluation») la décision prise par les autorités monétaires d’un pays de modifier le taux de change en régime de changes fixes. Ainsi, les autorités monétaires de la zone euro n’ont pas pris l’engagement d’échanger à taux fixe l’euro contre une autre monnaie, de telle sorte que l’euro est soumis à un régime de changes flexibles. Dans ces conditions, demander une dévaluation de l’euro, comme cela se fait souvent, constitue un grave contresens.
Du fait de la relation biunivoque entre variation de taux de change et taux d’inflation, on retrouve à propos du taux de change exactement le même système de création d’illusions que dans les raisonnements précédents (où l’on raisonnait implicitement en économie fermée). Ainsi, on préconise souvent une dévaluation pour relancer une économie. À titre d’exemple, on prétend fréquemment que la Grèce pourrait faciliter la solution de ses problèmes en sortant de la zone euro car elle pourrait ainsi dévaluer sa monnaie. L’interprétation qu’on donne à ce processus est de type keynésien : cela permettrait d’encourager les exportations et de réduire les importations, d’où il résulterait une augmentation de la demande globale. Mais cela va se traduire essentiellement par une augmentation de la masse monétaire et une augmentation des prix intérieurs.
En fait, une dévaluation aurait essentiellement deux conséquences :
- Une diminution des salaires réels, c’est-à-dire que l’on retrouve exactement l’idée de la courbe de Phillips : on créé une illusion à court terme. Celle-ci s’obtiendrait en changes flexibles en faisant une politique monétaire expansionniste et donc de l’inflation, ce qui conduirait à une dépréciation de la monnaie ; elle s’obtient en changes fixes en dévaluant, ce qui provoque de l’inflation (et il en résulte une augmentation de la quantité de monnaie).
- La diminution de la charge réelle des débiteurs, en particulier du Trésor public ; mais ici encore on joue sur les illusions de court terme : on a promis un certain taux d’intérêt nominal dans un contexte de faible inflation et on trompe les créditeurs en les remboursant en monnaie représentant un moindre pouvoir d’achat. C’est immoral et c’est du court terme. Qui aurait le courage de dire : « pour aider à résoudre l’endettement excessif que nous avons pratiqué, nous allons spolier les épargnants nationaux et étrangers qui nous ont fait confiance» ? Ne pourrait-on pas cesser de présenter comme une mesure efficace de politique économique une mesure qui consiste purement et simplement à spolier les autres ? Imaginons un individu qui s’est trop endetté et qui ne rembourse pas toutes ses dettes : on le considèrera à juste titre comme un voleur. Pourquoi le standard de moralité n’est-il pas le même lorsqu’il s’agit de la gestion des États, eux qui sont censés exister en particulier pour protéger les droits légitimes des individus ?
C’est dire également qu’il est faux de prétendre que l’appartenance à l’eurozone prive un pays d’un instrument de politique économique ; cela le prive de la possibilité de créer certaines illusions. Or, il est facile pour les autorités de se défausser de leurs responsabilités en accusant la politique monétaire de l’eurozone ou même le taux de change. À titre d’exemple, on entend souvent dire que «l’euro est trop fort». Mais il est trop fort par rapport à quoi ? Ceux qui font de telles affirmations en sauraient-ils plus sur la valeur d’équilibre de l’euro que les millions de décisions de millions de personnes qui déterminent le cours de l’euro ? C’est à la fois la manifestation d’une incroyable arrogance et d’une incroyable illusion, celle qui consiste à croire que la croissance dépend des exportations et que celles-ci dépendent du taux de change. De leur conviction que l’euro est trop fort, certains tirent même la conclusion qu’il faudrait une dévaluation de l’euro, ce qui est tout à fait extraordinaire car l’euro est en régime de changes flottants par rapport aux autres monnaies et la dévaluation n’a donc pas de sens. C’est seulement lorsqu’on est en régime de changes fixes qu’une dévaluation peut être décidée, ce qui n’est évidemment pas le cas, mais ce que semblent ignorer même des acteurs de la politique économique. Ainsi, récemment, un ministre français, citant une étude de la direction du Trésor, pour la loi de finances 2014, a déclaré : «Si l’euro était dévalué de 10% (…) nous gagnerions 150.000 emplois supplémentaires», comme si une dévaluation pouvait exister en régime de changes flottants ! Et l’idée selon laquelle une dévaluation de 10% permettrait de créer 150.000 emplois donne l’impression que des études scientifiques ont été faites pour cela. Mais c’est une tromperie intellectuelle de faire croire qu’on a cette connaissance. Ceci rappelle les prétendues prévisions que l’on faisait avant l’introduction de l’euro d’après lesquelles la création de l’euro devait permettre de gagner un point de croissance en Europe et devait garantir la stabilité ! On a vu ce qu’il en était. Bien sûr, on peut toujours construire un modèle à partir d’hypothèses arbitraires qui permettent d’aboutir au résultat désiré, mais cela n’est pas sérieux.
Certes, on dira sans doute qu’en réalité, en parlant de dévaluation, les uns et les autres pensent plutôt à une dépréciation sur le marché des changes. Mais comment pourrait-on obtenir ce résultat ? Il faudrait soit que la BCE augmente le taux de croissance de la masse monétaire, soit qu’elle fasse baisser encore davantage les taux d’intérêt afin de provoquer des sorties de capitaux qui feraient déprécier l’euro, ce qui signifie en réalité, également, une augmentation de la création monétaire. La volonté de déprécier l’euro revient donc à préconiser la sempiternelle politique monétaire expansionniste, avec tous les effets nuisibles qu’on lui connaît, en particulier l’inflation et les distorsions de structures économiques.
Cette dépréciation aboutirait-elle pour autant à une augmentation des exportations, à une variation positive du solde commercial et donc à une plus forte croissance et à une baisse du chômage ? Il n’en est rien. Considérons en effet tout d’abord la première relation de cette séquence, à savoir la relation entre dépréciation et solde commercial. Il est habituel de considérer que les exportations seraient facilitées, et les importations plus chères. Or, ceci signifie en fait que le pouvoir d’achat des individus serait diminué puisque le prix des biens importés (et des biens nationaux concurrents) augmenterait. En fait, la dévaluation n’est qu’un moyen détourné – mais coûteux – de faire baisser les salaires réels. Cependant, l’illusion monétaire est de courte durée. L’effet attendu est, une fois de plus, le résultat de ces illusions (comme pour la courbe de Phillips). Par conséquent, pour obtenir une amélioration purement formelle et de courte durée, on renforce l’instabilité économique, on fait de l’inflation – toujours nuisible – et on détourne l’attention des vrais problèmes. Si, comme on a toutes les raisons de le penser, le chômage est dû à un excès de fiscalité et de réglementations, cette situation n’est évidemment pas modifiée par la dépréciation de la monnaie ; elle est simplement momentanément cachée. Le risque est donc d’obtenir une succession de cycles résultant des réactions de la politique monétaire à la situation économique, sans aucune amélioration durable de la situation, mais une persistance et même une accélération de l’inflation et une instabilité elle aussi croissante.
Illustrations pratiques
Interview de Scott Sumner par Caroline Baum, com, 24 janvier 2013.
On est souvent tenté de rechercher dans des faits réels la confirmation – ou l’infirmation – des thèses qu’on analyse. Et il est même fréquent de se contenter de l’observation des faits pour en déduire des relations de causalité qui ne sont justifiées par aucun raisonnement théorique. Mais trouver dans l’observation de la réalité des preuves, ou même seulement des illustrations de certains raisonnements, est une tâche difficile, si ce n’est illusoire. En effet, pour chaque cas particulier, il existe une multitude de facteurs qui peuvent jouer simultanément et constituer des causes d’une situation observée. Ceci est aussi vrai pour les thèses que je défends que pour celles que je critique. En outre – il faut le reconnaître – chacun est tenté de mettre en avant les exemples qui semblent aller dans le sens de l’approche qu’il défend et de passer sous silence ceux qui lui sont opposés. C’est pourquoi l’approche purement théorique ci-dessus présente un important mérite relatif. Mais essayons tout de même de voir dans quelle mesure certains exemples peuvent illustrer les raisonnements ci-dessus (et non pas en apporter une preuve absolue, pas plus qu’ils ne peuvent le faire pour d’autres approches).
Prenons tout d’abord le cas des États-Unis. Depuis 2008 la Fed a pratiqué une politique de création monétaire massive. Celle-ci s’est traduite par une augmentation du PIB nominal à un taux de 4% environ depuis le début de 2010, proche de l’objectif suggéré à la Fed par l’un des principaux défenseurs du «monétarisme de marché», Scott Sumner, soit 3 à 5%. Conformément à ce qui se passe généralement, l’inflation – mesurée au moyen de l’indice des prix à la consommation – n’a pas été très importante pour le moment (quitte à se déchaîner ultérieurement), mais ce sont surtout les prix des actifs et des matières premières qui ont augmenté considérablement, laissant craindre le développement de nouvelles bulles, et donc la possibilité d’une nouvelle crise dans le futur. Mais cette forte expansion monétaire, pas plus d’ailleurs que l’exceptionnelle politique de déficit budgétaire, n’ont pu véritablement provoquer une relance économique, puisque le taux de croissance réelle est resté faible (il a même été négatif au quatrième trimestre 2012, mais, il est vrai, la croissance semble s’être accélérée à la fin de 2013), tandis que le taux de chômage restait aux environs de 7%, ce qui est un taux élevé pour les États-Unis. Il semble donc clair que la politique keynésienne de (prétendue) augmentation de la demande globale par le déficit public a échoué et que, par ailleurs, il est vain d’attendre des effets réels positifs d’une politique d’expansion monétaire, qui se traduit par une croissance du PIB nominal – mais pas du PIB réel – et surtout par le développement de bulles financières.
On peut d’ailleurs souligner qu’il est ironique de constater que Scott Sumner est obligé de recourir à une hypothèse ad hoc pour expliquer une situation bien embarrassante pour lui et pour la thèse qu’il défend. Il imagine que «la faible croissance nominale et réelle et les taux d’intérêt extrêmement bas sont moins un phénomène temporaire que la norme dans des pays développés avec des populations vieillissantes»17. Il n’apporte pas de preuve ou de raisonnement à l’appui de cette affirmation. Or, si elle était vraie, étant donné qu’il s’agirait d’un phénomène de long terme, on peut se demander pourquoi il ne se serait manifesté par miracle qu’au cours des quelques années récentes. En outre, cela impliquerait évidemment qu’il est vain de préconiser une politique monétaire ciblée sur le PIB nominal puisque, de l’aveu même de Scott Sumner, on ne peut pas espérer une croissance forte du PIB nominal ou réel ! À quoi sert alors la politique monétaire si la croissance nominale et réelle dépend des caractéristiques de la population ?
Un autre cas souvent cité est celui du Japon. En effet, il semble fournir l’exemple d’un pays où la politique monétaire a été restrictive pendant la plus grande partie des décennies 1990 et 2000, ce qui aurait conduit à la déflation et à une faible croissance. Le caractère restrictif de la politique monétaire est indéniable. Par ailleurs, la baisse des taux de croissance du PIB nominal a été à peu près parallèle à la baisse des taux de croissance monétaire, ce que l’on peut considérer comme normal. Mais en réalité, il serait plus correct de parler d’une période de stabilité des prix plutôt que d’une période de déflation. Mais qu’en est-il de la croissance réelle, et observe-t-on un parallélisme entre déflation (ou stabilité des prix) et activité économique ? Le taux de croissance du PIB réel a certes été proche de zéro dans la période 1999-2002, mais proche de 3% dans la période 2003-2007, avant de devenir légèrement négatif, avec la crise économique, en 2008-2009, mais en remontant à 3% en 2009. Or, il est intéressant de noter que la très faible croissance de la période 1999-2002 a suivi une période de très forte croissance monétaire du milieu de 1998 au milieu de 1999. Au cours de la période 2002-2007, la croissance réelle a été modérée, les prix ont été à peu près stables, la croissance de la quantité de monnaie a été faible. Quant au PIB nominal il a varié assez fortement, ce qui en fait un indicateur peu fiable.
Ceux qui prétendent que le Japon a connu deux décennies de stagnation à cause d’une prétendue déflation prennent en fait en considération le taux de variation du PIB nominal, ce qui précisément les induit en erreur. C’est un mauvais indicateur. En fait, les prix des biens sont restés à peu près stables, les prix des actifs ont diminué et le taux de change s’est apprécié à cause d’une inflation moindre au Japon qu’à l’extérieur.
Il n’est pas inutile, par ailleurs, de rappeler que, depuis le début des années 1990, le Japon a connu constamment des déficits budgétaires importants, variant entre 2 et 10% du PIB, de telle sorte qu’il se trouve maintenant avec une dette publique représentant 245% du PIB, un record mondial. Son gouvernement a en effet constamment essayé d’appliquer des recettes d’inspiration keynésienne dans l’espoir de favoriser la relance économique. Cette politique a donc connu un échec total, comme on pouvait logiquement le prévoir. Ainsi, la croissance économique japonaise a été modérée au cours des décennies récentes, surtout si on la compare aux taux très élevés qui étaient enregistrés dans un passé plus lointain. Mais rien ne permet de dire que ceci a été dû à une politique monétaire relativement raisonnable. Il ne faut pas oublier, en effet, que le Japon est un pays où la pression fiscale est extrêmement élevée (avec, par exemple, des taux qui peuvent facilement atteindre 40% pour l’impôt sur les sociétés et pour l’impôt sur le revenu ou des droits de succession élevés). Le Japon est aussi un pays où des règlementations particulièrement contraignantes rendent l’économie peu flexible et constituent une importante barrière à l’entrée des producteurs dans beaucoup d’activités. L’interventionnisme étatique est important dans le secteur financier, où, par exemple, un programme hors budget («Fiscal Investment and Loan Program») absorbe une grande partie de l’épargne placée dans la banque postale et l’utilise pour des activités essentiellement décidées pour des motifs politiques, ce qui ne permet évidemment pas une bonne utilisation des ressources. Tous ces éléments, ainsi que les excès de dépenses publiques et les gaspillages qu’ils entraînent – en détournant les moyens de financement et les ressources du secteur privé vers le secteur public – fournissent une explication du caractère relativement faible de la croissance japonaise beaucoup plus crédible que la prétendue déflation. En fait, le raisonnement logique incite à penser que la politique monétaire n’est pas responsable de cette évolution et que le cas japonais, si souvent invoqué, ne justifie en rien une politique monétaire expansionniste et n’apporte aucune justification au «monétarisme de marché». Il est d’ailleurs caractéristique que la nouvelle politique économique (les «Abenomics») qui a consisté récemment à pratiquer une politique monétaire très expansionniste et un déficit budgétaire important, n’ait pas réussi à relancer la croissance. Autrement dit, la concomitance constatée dans le passé entre une croissance économique modérée et une faible croissance monétaire ne suffit pas pour établir un lien de causalité. C’est bien pourquoi, au lieu de se contenter de l’observation des faits, il convient de recourir à une analyse rigoureuse.
Propositions
Quand on faisait valoir à Friedrich Hayek – qui a ressuscité l’idée de monnaies privées concurrentes – qu’il était irréaliste de préconiser le retour à un tel système, il répondait qu’il y a quelques siècles, on aurait consi- déré comme irréaliste de préconiser la séparation entre l’Église et l’État. Et pourtant cela s’est bien réalisé (au point que personne ne peut concevoir la disparition de cette séparation).
L’une des plus graves erreurs de notre époque vient du fait qu’on attribue à la politique monétaire – et plus généralement à toutes les manipulations monétaires, par exemple les dévaluations – la capacité d’influencer positivement l’activité économique et de permettre la stabilisation macro- économique. On devrait pourtant être alerté par le fait que jamais dans l’Histoire il n’y a eu autant d’inflation et de crises monétaires que depuis que la politique monétaire existe, c’est-à-dire, essentiellement, depuis le début du XXe siècle. Alors que, au cours de la plus grande partie de l’Histoire de l’humanité, les fluctuations économiques ont eu des causes réelles (mauvaises récoltes, guerres, épidémies), les crises modernes sont d’origine monétaire. La prétention des autorités monétaires à prendre en charge la stabilisation économique parait alors d’autant plus dérisoire.
Certes, on dira probablement que la politique monétaire peut apporter les bienfaits qu’on attend d’elle généralement, mais à condition d’améliorer les règles de gestion monétaire. C’est ainsi qu’on a souvent proposé ou décidé de rendre la banque centrale indépendante (c’est le cas de la BCE). On entend par là que les dirigeants de la banque centrale ne dépendent pas du pouvoir politique. Certes, l’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique est souhaitable, car on a eu trop d’exemples dans le passé de gouvernements qui décidaient d’importants déficits budgétaires et qui créaient de la monnaie pour alléger le poids réel de leur endettement. Mais l’indépendance n’est pas suffisante car on peut être indépendant pour faire de bonnes choses ou de mauvaises choses. Tout dépend de la compétence des décideurs, de leurs préjugés éventuels, de l’attention qu’ils portent éventuellement à l’opinion publique et/ou au pouvoir politique. Ainsi, un gouverneur de banque centrale à qui l’on reproche continuellement de ne pas faire une politique monétaire plus expansionniste pour diminuer le chômage peut facilement accepter un changement de politique pour conserver une bonne image dans l’opinion et auprès d’un gouvernement. N’est-il d’ailleurs pas significatif que la grande crise récente ait été provoquée par les politiques monétaires déstabilisatrices d’autorités monétaires indépendantes ? Et quand on voit les dommages considérables que peut provoquer une politique monétaire mal conçue, on peut légitimement se demander s’il est raisonnable de laisser à un homme, ou à un petit groupe d’hommes indépendants, cet extraordinaire pouvoir de nuisance incontrôlé.
Comme nous l’avons vu, la politique monétaire – si elle existe – ne devrait avoir qu’un seul but : permettre à la monnaie d’être aussi bonne que possible, c’est-à-dire de maintenir son pouvoir d’achat autant que possible. Et comme nous l’avons également vu, l’idéal consisterait en fait à ne pas produire d’encaisses monétaires nominales supplémentaires, c’est-à-dire à ne pas faire de politique monétaire. Il est évident qu’un tel changement dans les habitudes de pensée et d’action n’est sans doute pas facile à faire admettre. Mais il doit constituer le point de référence de toute réflexion.
Ceci dit, même si l’on est convaincu de cet objectif, il reste à faire le nécessaire pour qu’il puisse être atteint ou, tout au moins, pour qu’on puisse s’en rapprocher. De ce point de vue, l’indépendance de la banque centrale n’est pas suffisante. Mais il existe bien des moyens de la contrôler pour empêcher que les autorités monétaires abusent de leur liberté d’action. Traditionnellement, l’obligation de maintenir la convertibilité de la monnaie en termes d’un avoir extérieur – par exemple l’or – est censée jouer ce rôle. Mais on a vu aussi dans l’Histoire que les autorités monétaires publiques pouvaient facilement s’affranchir de cette contrainte. Telle est la signification d’une dévaluation. Il en allait tout autrement dans les systèmes monétaires du XVIIIe ou du XIXe siècle au cours desquels les garanties de convertibilité en or n’étaient pas données par une organisation publique, mais par des banques privées. Il s’agissait alors d’un engagement contractuel entre un banquier capitaliste et ses clients, et dans ce monde civilisé de la sphère privée, un contrat se respecte. L’incitation à décider une expansion monétaire excessive est ainsi bridée efficacement. Ceci signifie en tout cas que le plus important ne consiste pas à savoir s’il faut ou non revenir à un étalon-or, mais consiste à définir un contexte institutionnel tel que la garantie de convertibilité soit respectée.
Nous sommes, pour notre part, persuadés que le retour à des systèmes de production monétaire privés reposant sur des garanties de convertibilité serait la méthode la plus efficace pour permettre aux individus de détenir des monnaies de qualité. Mais nous savons aussi qu’il est sans doute prématuré d’envisager un tel retour18. Que peut-on alors imaginer pour le moment ? On peut limiter la tentation de créer de la monnaie, soit par des règles de gestion monétaire obligatoires, soit par la concurrence, puisque celle-ci incite les producteurs à faire mieux que les autres, c’est-à-dire à faire des productions de bonne qualité.
Nous avons déjà eu l’occasion, ci-dessus, d’évoquer les règles monétaires. Celles-ci doivent être définies de manière cohérente et efficace – ce que nous avons essayé de préciser – mais aussi être assorties de sanctions. De ce point de vue, on peut imaginer toutes sortes de solutions : imposer des amendes aux autorités monétaires qui ne respectent pas la règle qu’on leur a imposée, licencier le gouverneur de banque centrale qui n’aurait pas atteint les objectifs fixés ou même – comme cela a été proposé – faire varier son salaire (nominal) en sens inverse du taux d’inflation ou du taux de création monétaire.
Mais il n’est sans doute pas de règle plus contraignante (et donc efficace) que celle qui consiste à subir la concurrence d’autrui. Même sans accepter la concurrence entre des monnaies produites par des émetteurs privés, on peut accroître le degré de concurrence dans les systèmes monétaires existants. Il conviendrait, pour cela, de supprimer le cours forcé, c’est-à-dire de permettre aux citoyens d’un pays (ou aux membres d’une zone monétaire telle que l’eurozone) de détenir et d’utiliser les monnaies qu’ils préfèrent. Ceci impliquerait d’ailleurs la liberté de payer ses impôts dans la monnaie que l’on veut, faute de quoi la monnaie nationale (ou la monnaie de la zone monétaire) conserverait nécessairement une place privilégiée à l’abri de toute concurrence.




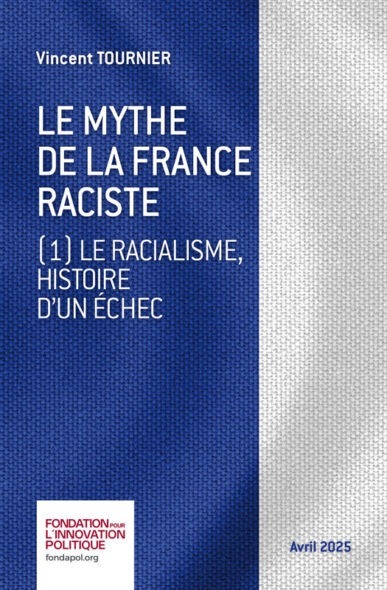









Aucun commentaire.