Ecologie et libéralisme
Ecologie et philosophie
Ecologie et démocratie
Résumé
Comment concilier efficacement les intérêts du libéralisme et les enjeux écologiques auxquels notre société accorde de plus en plus d’importance ?
Dans sa note Ecologie et libéralisme, Corine Pelluchon propose plusieurs pistes de réflexion afin de ne plus percevoir l’écologie et le développement durable comme des valeurs, en opposition avec les préoccupations économiques et politiques de notre époque.
Corine Pelluchon,
Philosophe, maître de conférences à l’université de Poitiers, spécialiste de philosophie politique et d’éthique appliquée (bioéthique, éthique environnementale et éthique animale).
Serge Moscovici, Essai sur l’histoire humaine de la nature (1968), Paris, Flammarion, 1977, 7 (cité par Dominique Bourg et Kerry Whiteside, Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et le politique, Paris, Seuil, 2010, p. 41).
Il existe aujourd’hui parmi les scientifiques un consensus sur la réalité du changement climatique induit par l’homme. Les divergences concernent le rythme et les modalités de ce changement, comme l’explique Naomi Oreskes dans « The scientific consensus on climate How do we know we’re not wrong? », in Joseph DiMento et Pamela Doughman (dir.), Climate Change. What it Means for Us, Our Children, Our Grandchildren, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 73-74.
Ce néologisme, forgé en 2000 par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen et repris par Michel Serres, désigne la nouvelle ère ouverte par la révolution industrielle, où l’action géologique de l’humanité implique que l’on cesse de penser séparément l’histoire de l’humanité et l’histoire Voir Paul Crutzen, Eugene F. Stoermer, « The Anthropocene », The Global Change Newsletter, no 41, 2000, p. 17, et Paul Crutzen, « Geology of man- kind », Nature, vol. 415, no 6867, 3 janvier 2002, p. 23 (cités par Dipesh Chakrabarty, « Le climat de l’histoire : quatre thèses », Revue internationale des idées et des livres, vol. 15, janvier-février 2010, p. 22-31).
Arne Næss, « The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology A Summary », Inquiry, no 16, 1973, p. 95-100 (trad. fr. in Éthique de l’environnement. Nature, valeur, respect, textes traduits par Hicham-Stéphane Hafeissa, Paris, Vrin, 2007, p. 51-60).
« Écologie » dérive de oikos, qui signifie maison, Ce terme a été créé en 1866 par le naturaliste allemand Enst Haeckel. L’écologie désigne la science qui s’intéresse aux rapports des êtres vivants avec leur milieu environnant.
Mt, VII, 12, et Lc, VI, 31.
Aldo Leopold, Almanach pour un comté des sables (1949), fr. A. Gibson, Paris, Flammarion, 2000, p. 255- 284.
Thomas Hobbes, Léviathan (1651), fr. G.Mairet, Paris, Folio, 2000.
Claude Lévi-Strauss, « Réflexions sur la liberté », in Le Regard éloigné, Paris, Plon, 1983, p. 376-377.
Félix Guattari, Les Trois Écologies, Paris, Galilée, 1989.
Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Paris, Grasset, La motivation de l’auteur est liée à la hantise que les normes écologiques aboutissent à un nouveau dogmatisme mettant en péril les fondements du libéralisme politique. Ce danger existe lorsque des individus ou des groupes cherchent à substituer aux visions métaphysiques du monde, qui sont valables sur le plan personnel, un universalisme politique qui s’apparente « aux mirages de la grande politique » que Luc Ferry dénonce à juste titre dans son ouvrage. Cependant, il n’est pas sûr que les auteurs cités dans cet ouvrage tombent dans cet écueil, surtout si l’on fait référence à Arne Næss qui insiste, dans son écosophie, sur les principes invitant chacun à s’interroger sur son style de vie et à réévaluer son rapport à lui-même et à la nature sans tomber dans le paternalisme politique, ni même dans une sorte de perfectionnisme moral (A. Næss, Écologie, communauté et style de vie, tr. fr. Ch. Ruelle, Paris, Éditions MF, coll. «Dehors», 2008). De même, les huit points de la plate-forme écologique sont des normes écologiques qui supposent la prise en considération des impératifs écologiques. Næss suggère que ces normes doivent être discutées. L’éthique de la discussion de Habermas, la théorie des parties prenantes ou encore le pragmatisme peuvent servir à compléter l’approche de Næss qui, du point de vue de la philosophie politique, est moins dangereuse qu’imprécise.
Dominique Bourg et Kerry Whiteside, cit., p. 43-55.
« Aucun changement éthique important ne s’est jamais produit sans un remaniement intime de nos loyautés, de nos affections, de nos centres d’intérêt et de nos convictions intellectuelles. […] Dans nos efforts pour rendre l’écologie facile, nous l’avons rendue dérisoire. » Aldo Leopold, Almanach pour un comté des sables (1949), tr. fr. A. Gibson, Paris, Flammarion, 2000, p. 265.
Lorsque Serge Moscovici disait que le XVIIIe siècle avait été marqué par la « question politique », le XIXe par la « question sociale » et, qu’à notre époque, la « question naturelle » passait au premier plan1, il ne pensait pas seulement à ce qu’on appelle la crise environnementale. Le réchauffement climatique, l’augmentation de la fréquence des cyclones, la fonte des glaces de l’Himalaya et des calottes polaires, l’acidification des mers et les dégâts causés à la chaîne alimentaire, la dégradation des écosystèmes, la disparition chaque jour de nombreuses espèces et, de manière générale, l’érosion des ressources peuvent difficilement être niés2. De même, le caractère anthropogénique de ces phénomènes est reconnu, ce qui ne veut pas dire que l’homme, devenu un agent géologique, capable de déterminer l’état de la planète et même de troubler les conditions dont dépend son existence, ait voulu cette crise environne- mentale ni qu’elle soit causée par le seul capitalisme.
L’inquiétude suscitée par l’empreinte écologique d’une population qui pourrait atteindre neuf milliards d’hommes en 2050 est légitime. Cependant, la spécificité de l’ère anthropocène3 est précisément de nous inviter à penser notre responsabilité individuelle et collective en dépassant les schémas binaires auxquels se raccrochent la plupart du temps les partisans de l’altermondialisme et ceux qui considèrent la décroissance comme la solution à tous nos maux. Les écologistes n’ont pourtant pas tort d’opposer à la bonne conscience de leurs concitoyens la nécessité d’une interrogation radicale sur les styles de vie qui montre, en outre, que l’espace public est saturé d’injonctions contradictoires, comme lorsqu’on encourage la consommation de produits polluants, et qu’au lieu d’être traitée comme un sujet transversal lié à des enjeux universaux et visant le long terme, l’écologie apparaît comme une préoccupation périphérique en rivalité avec les autres intérêts du moment.
Prendre au sérieux la « question naturelle », ce n’est pas seulement se préoccuper de l’environnement en le pensant comme un simple réservoir de ressources. Une telle préoccupation n’est inspirée que par la crainte de voir son mode de vie et ses habitudes de consommation menacés par la crise pétrolière et la pollution. Or, ce qui distingue l’écologie profonde de l’écologie superficielle4 tient au fait que la première implique une interrogation sur la manière dont l’homme habite la terre et partage ses ressources avec les autres terriens5. Cette enquête, qui suppose la remise en question de l’image d’un homme séparé des autres espèces et seul capable de leur conférer une valeur, comporte un volet ontologique et un volet politique étroitement liés. Au lieu de se borner à un règlement strictement juridique et économique de la crise environnementale, une telle approche, qui est conciliable avec les outils que le droit de l’environnement met à notre disposition, passe par un examen des fondements et des présupposés de notre éthique et de notre politique.
Quelles valeurs rendent possible la prise en compte de l’écologie dans notre vie ? On peut se demander si la règle d’or, qui commande de faire pour les autres personnes ce que nous voudrions qu’ils fassent pour nous6, suffit, ou bien s’il ne faut pas parler, comme Aldo Leopold, d’une éthique de la terre7. Cette land ethic signifie-t-elle que les entités non humaines ont la même importance morale que nos frères humains, ou bien les catégories éthiques indispensables à une philosophie de l’écologie exigent-elles des distinctions rigoureuses qui interdisent d’étendre le vocabulaire des droits de l’homme aux autres vivants et aux végétaux, et de confondre les critères permettant d’avoir un statut moral avec ceux qui font que l’on est titulaire de droits ? En outre, la fondation du droit sur l’agent moral individuel qui peut « user de tout ce qui est bon pour sa conservation8» est-elle compatible avec le respect de la biodiversité ou bien faut-il penser que les droits de l’homme reçoivent une limite lorsque nous mettons en péril la survie des autres espèces9 ? On peut même questionner le droit que l’homme s’octroie d’imposer aux animaux d’élevage des conditions de vie non conformes aux normes éthologiques de leur espèce.
Ainsi la justice ne concerne pas exclusivement nos rapports à l’autre homme et aux autres cultures. Nos usages des vivants et de la terre relèvent également de la justice, non seulement parce que ce sont d’autres hommes, présents et à venir, qui subissent les conséquences irréversibles de notre mode de vie et de nos décisions, mais aussi parce que notre manière d’habiter la terre, de l’exploiter et de consommer révèle, par- delà nos déclarations d’intentions et nos contradictions, les idéaux ou principes auxquels nous accordons la priorité.
Cet examen déborde donc le cadre de l’éthique environnementale et de l’éthique animale qui étudient le statut des différentes entités et en déduisent des normes pouvant guider nos usages de la terre et des vivants. En effet, nous ne pensons pas qu’il faille déduire une politique de normes écologiques comme le respect de la biodiversité. L’écologie ne fonde pas une politique, mais, par les nouveaux défis qu’elle soulève, elle conduit à s’interroger sur le type de sujet et d’organisation sociale et politique qui rend possible la prise en compte de la « question naturelle » ou, au contraire, qui la rend dérisoire et la condamne à n’être qu’un vœu pieu. Parce que l’écologie n’est pas un domaine séparé des autres et qu’elle requiert une réflexion à la fois ontologique et politique, elle suppose un certain état de l’organisation sociale. Cette remarque donne raison à Félix Guattari qui soulignait le lien entre les trois écologies ou écosophies, entre l’état de la planète, l’écosophie sociale ou les modalités de l’être en groupe, et l’écosophie mentale qui concerne l’essence de la subjectivité10. Ce lien, rarement appréhendé par les formations et le pouvoir politiques, doit être pensé par la philosophie. Il est le fil directeur de notre approche de l’écologie. Cependant, un pan important de la réflexion concerne plus particulièrement les modifications que la « question naturelle » impose au politique et aux instances délibératives. Il ne s’agit pas seulement de dire à quelles conditions l’écologie, loin d’être un écofascisme11, est compatible avec la démocratie. Tout en rendant compte des tensions existant entre les droits subjectifs et les normes écologiques, entre la liberté de choisir son mode de vie et le respect de l’environnement, entre les traditions culturelles et la préservation de certaines espèces menacées, il importe d’être attentif au fait que l’écologie, comme la bioéthique, suppose un changement de culture politique qui passe par plus de démocratie.
L’écologie est une science difficile, qui se trouve au carrefour de plu- sieurs disciplines – l’économie, la biologie, la géographie, les mathématiques. Elle est concernée par des phénomènes invisibles qui ont une portée globale et s’étendent sur plusieurs siècles. Cela ne signifie pas que la démocratie d’experts soit la panacée. Que les décisions politiques ne puissent peut-être plus être prises sans que l’on mesure leur compatibilité ou leur incompatibilité avec la protection de la biosphère et sans que l’on tienne compte des données internationales relatives au réchauffement climatique ne signifie pas que la science fonde la politique ni que cette dernière découle des recommandations des experts. Une telle interprétation serait un contresens sur le rapport entre sciences, société et pouvoir que cette note a pour objectif de mettre au jour. En effet, les défis que soulève la prise en compte de l’écologie dans la politique obligent à reconfigurer le rapport entre sciences et société, et à redéfinir le rôle des représentants. Quelles instances peuvent introduire le principe du respect de l’environnement au cœur du politique et tempérer les effets d’un système électoral uniquement dédié aux intérêts présents et au court terme ? La démocratie représentative est née dans un contexte social, politique et économique où les représentants servaient à défendre les intérêts des individus, encouragés à s’enrichir, à produire et à consommer, et où le risque majeur demeurait celui de la tyrannie d’un homme ou d’un groupe. Il ne s’agit pas de remettre en question la légitimité du système représentatif, mais de se demander s’il est adapté à une gestion appropriée de la « question naturelle12». L’idée selon laquelle la prise au sérieux de l’écologie, loin d’aboutir au rejet du libéralisme et de l’humanisme, implique de compléter les instances représentatives et d’enrichir la philosophie du sujet est l’horizon des propositions et pistes de réflexion présentées dans cette note.
Ecologie et philosophie
Richard Sylvan Routley, « A-t-on besoin d’une nouvelle éthique ? » (1973), in Éthique de l’environne- ment…, op. cit., p. 39.
Le biocentrisme accorde une égale valeur à tout Il se distingue de l’écocentrisme, qui est une éthique du respect de la nature plus plausible en ce qu’elle privilégie l’espèce plus que l’individu et le rapport des individus à leur milieu et à la « communauté biotique ».
Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
John Baird Callicott, Genèse. La Bible et l’écologie (1991), fr. D. Bellec, Paris, Wildproject, 2009, p. 48-49.
Ibid., p. 26-29, 61-62 et 76-86.
Cette expression est de Leopold qui, pourtant, dénonce l’anthropocentrisme de la tradition judéo-chrétienne, ce qui est excessif si l’on se reporte à la lecture attentive de la Genèse.
John Locke, Second traité du gouvernement civil (1690), trad. fr. J.-F. Spitz, Paris, PUF, 1994 (voir notamment V, 31, 36 et 46).
Kenneth Goodpaster, « De la considérabilité morale » (1978), in Éthique de l’environnement…, op. cit., p. 76.
Cette question des droits différenciés qui pourraient être accordés à certains vivants, notamment aux animaux, qui peuvent être des sujets sans être des personnes, mériterait un examen à L’essentiel ici est simplement de distinguer statut moral et statut juridique et d’indiquer que, si les animaux devaient avoir des droits, ces droits ne seraient en aucun cas à penser sur le modèle des droits de l’homme. En effet, la liberté de culte n’a pas de sens pour les bêtes. Le vocabulaire des droits subjectifs est inapproprié pour eux, comme en témoigne la Déclaration universelle des droits de l’animal, proclamée le 15 octobre 1978 à l’Unesco, qui comporte des contradictions. De plus, et surtout, les droits des animaux doivent être définis à partir de leurs normes propres.
John Stuart Mill, De la liberté (1859), L. Lenglet et D. White, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1990, p. 74.
Holmes Rolston III, « La valeur dans la nature et la nature de la valeur » (1994), in Éthique de l’environne- ment…, op. , p. 156.
C’est-à-dire entre une éthique ne reconnaissant de dignité qu’à l’homme et déterminant la valeur des autres êtres et des choses qu’en fonction de son usage et une éthique du respect de la nature qui est fondée sur la reconnaissance de la valeur intrinsèque des écosystèmes et des autres espèces, et qui privilégie l’individu (biocentrisme) ou son interaction avec son milieu (écocentrisme).
Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, AK, IV, 223, Œuvres philosophiques, III, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1986, p. 470. Cette remarque donne raison à Luc Ferry qui soulignait l’inanité des procès d’animaux intentés au Moyen Âge (voir Le Nouvel Ordre écologique, op. cit., p. 18). Cela ne signifie pas que nous n’ayons envers les bêtes que des devoirs indirects, comme le pensent Kant et Luc Ferry, et comme on le voit avec la loi Grammont de 1860 qui réprimait les mauvais traitements contre les animaux domestiques lorsqu’ils étaient perpétrés en public, en reprenant l’argument selon lequel la violence envers les bêtes comporte son extension à l’homme. Il n’est, en effet, pas insensé de considérer les animaux comme des sujets qui n’ont pas seulement droit à être protégés contre les mauvais traitements, mais qui limitent aussi l’usage que nous faisons d’eux et ont droit à ce que leurs besoins éthologiques soient respectés.
Christophe Dejours, L’Évaluation du travail à l’épreuve du réel. Critique des fondements de l’évaluation, Paris, Inra Éditions, 2003.
« Directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ».
Christophe Dejours, Souffrance en La banalisation de l’injustice sociale (1998), Paris, Seuil, coll. « Point Essais », 2009.
Aldo Leopold, op. cit., p. 282.
Garrett Hardin, « The tragedy of the commons » (1968), Science, no 162, p. 1243-1248.
Stéphane Chauvier, Justice et droits à l’échelle globale, Paris, Vrin/EHESS, 2006, p. 147-179.
Voir la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment l’article 9 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs de son espèce. ». Voir Jean-Pierre Marguénaud, « L’animal dans le nouveau Code pénal », Recueil Dalloz, Sirey, 1995, 25e cahier, p. 187-191.
Christophe Dejours, Souffrance en France, cit., p. 82.
Ce que Hannah Arendt appelle la désolation (loneliness). Voir Les Origines du Le système totalitaire (1951), trad. J.-L Bourget, R. Davreu et P. Lévy, Paris, Seuil, 2002, p. 305-306.
Günther Anders, « Hors limite pour la conscience », in Hiroshima est partout (1995), Paris, Seuil, 2008, p. 312.
Cette éthique est développée dans Corine Pelluchon, L’Autonomie brisée. Bioéthique et philosophie, Paris, PUF, Dans La Raison du sensible. Entretiens autour de la bioéthique, Perpignan, Artège, 2009, nous en rappelons les principaux caractères et la genèse, liée à la réflexion sur les pratiques médicales et l’accompagnement des malades en fin de vie et des personnes souffrant de handicaps sévères. Dans Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, Paris, Cerf, 2011, nous approfondissons cette éthique de la vulnérabilité et en tirons les implications politiques et écologiques.
Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1974), Paris, Le Livre de poche, « Biblio-Essais », 1996, p. 31.
Martin Heidegger, Être et Temps (1927), Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1993, E.Martineau, Authentica 1985.
Emmanuel Levinas, op. cit., p. 180.
L’ipséité, du latin ipse, soi-même, désigne l’identité personnelle, ce que je suis de manière singulière, moi, et non un Cette notion se distingue de celle de mêmeté, qui renvoie au latin idem.
Emmanuel Levinas, op. cit., p. 86-87.
Seul un moi vulnérable peut aimer son prochain. ». Voir Emmanuel Levinas, De Dieu qui vient à l’idée (1982), Paris, Vrin, 2004, p. 14.
Quelle éthique pour l’écologie ?
L’éthique environnementale s’est constituée comme une branche de l’éthique appliquée dans les années 1970, aux États-Unis. Elle est née d’une rupture, orchestrée de manière souvent polémique, avec l’anthropocentrisme, voire avec le « chauvinisme » de l’éthique traditionnelle13. Celle-ci regroupe sous une même étiquette des théories différentes qui ont cependant en commun de borner la morale aux rapports entre les hommes et de faire du sujet humain un empire dans un empire, un être séparé des autres espèces et seul à même de conférer de la valeur à la création. La notion cardinale de cette éthique environnementale, qui pourra, en outre, relever de l’écocentrisme ou du biocentrisme14, est la notion de valeur intrinsèque. Elle signifie que les vivants et les écosystèmes n’ont pas seulement une valeur instrumentale découlant des usages qu’en fait l’homme, mais qu’ils représentent des formes de vie ayant leurs normes spécifiques et une valeur propre qui n’est pas relative au point de vue économique ou au profit que nous retirons de leur exploitation.
Quoi que l’on puisse dire de l’ancrage de cette éthique de la terre dans une tradition célébrant, à la suite de Thoreau, la vie sauvage ou wilderness et trahissant une manière culturellement déterminée de se représenter la nature15, il convient de souligner l’apport de ce qui allait devenir l’écologie profonde. On peut critiquer les raccourcis qui font remonter à la Genèse l’origine de la crise environnementale. Quand on relit les deux récits de la Création, on constate, en effet, l’écart existant entre la position d’un homme jardinier et intendant de Dieu, cultivant la terre dont il n’a que l’usufruit sous le regard du Créateur auquel il rend des comptes, et l’exploitation démesurée des ressources caractéristique de notre époque. Le second récit de la Création, où Dieu insuffle la vie à l’homme, formé de la boue de la terre16, peut même être considéré comme allant plus loin et comme anticipant sur le modèle d’une citoyenneté écologique17, l’homme étant partie prenante, avec les autres espèces, de la Création et membre de la « communauté biotique18».
De même, le gaspillage de la nourriture et la déforestation seraient incompatibles avec le libéralisme de John Locke qui fondait la propriété sur le travail, mais limitait ce droit par une loi naturelle enjoignant de ne pas menacer l’espèce humaine et de ne pas s’approprier les ressources au point d’affamer les autres hommes19. Pourtant, les conséquences en chaîne de l’exploitation des ressources naturelles depuis la révolution industrielle et les évolutions de l’agriculture et de l’élevage intensifs, qui ont nourri toujours plus d’êtres humains mais dont nous savons aujourd’hui qu’ils conduisent à l’empoisonnement des sols et imposent des souffrances intolérables aux animaux, prouvent que notre modèle de développement est problématique. Ce modèle est essoufflé et repose sur une conception du rapport de l’homme à l’autre que lui qui est erronée. Une telle assertion ne donne pas forcément raison aux écologistes profonds ni à ceux qui cherchent dans l’histoire de la philosophie les origines de nos problèmes, comme si la civilisation occidentale était par nature viciée et que Descartes et les Lumières étaient responsables de la crise environnementale. Toutefois, si les philosophies ne sont pas relatives à leur époque, il est vrai que les théories morales et politiques du passé ne permettent pas de résoudre les problèmes écologiques auxquels notre modèle de développement nous confronte et qui menacent d’une certaine façon les valeurs de liberté, de paix et de démocratie que les hommes des Lumières nous ont léguées. Bien plus, il se pourrait que, pour honorer cet héritage à l’ère anthropocène, il faille à la fois tenir compte de la manière dont les écologistes profonds renouvellent l’éthique et contester leurs prémisses, notamment l’idée selon laquelle c’est en partant de la nature que l’on peut procurer à l’écologie la philosophie dont elle a besoin. C’est en partant de l’homme et en proposant une philosophie rénovée du sujet qu’il est possible de tenir la promesse d’un règlement démocratique de la « question naturelle ».
Statut moral, théorie de la valeur et res communis
L’apport majeur des héritiers d’Aldo Leopold réside dans un petit nombre de catégories qui constituent la méta-éthique indispensable à l’écologie. À côté de la notion de valeur intrinsèque, on trouve une définition de la considérabilité morale qui n’est subordonnée ni à la possession de la raison ni identifiée à la sensibilité20. Celle-ci, entendue comme la susceptibilité à la douleur et au plaisir, suffit à conférer un statut moral aux bêtes, mais elle n’est pas la condition sine qua non de la considérabilité morale. Tous les êtres et les entités qui ont un intérêt à préserver et peuvent subir un dommage à la suite d’un traitement ont un statut moral. Il s’agit des animaux qui ressentent de la douleur et du plaisir, et éprouvent du stress, mais aussi des plantes qui peuvent faner et des écosystèmes qui ne sont pas irritables, mais dont l’équilibre subtil dépend de l’interaction entre plusieurs organismes. Ainsi, nous ne pouvons pas interagir n’importe comment avec eux, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’ils aient des droits21. L’intérêt de cette notion de considérabilité morale, qui n’exclut pas que nous établissions une hiérarchie entre les êtres qui n’ont pas à nos yeux la même importance morale, est qu’elle suggère qu’il y a des limites à l’action de l’homme imposées par les entités non humaines. Dans l’éthique et la politique classiques, la seule limite à mon action qui rend légitime l’intervention de l’État22 est l’autre homme, dont je dois préserver la vie et dont la liberté doit être compatible avec la mienne. Avec les notions de valeur intrinsèque et de considérabilité morale, on ne sort pas forcément de l’humanisme, puisque c’est l’homme qui reconnaît ou non la valeur des êtres, même si cette valeur n’est pas forcément relative à son utilité. Comme l’écrit Rolston, l’homme n’est pas toujours la source de la valeur, mais elle a besoin de lui pour « coaguler dans le monde23». Aussi, l’intérêt des concepts mis en place par les théoriciens de l’éthique environnementale est qu’ils conduisent à penser autrement le sujet. Cet aspect n’a pas été perçu par les partisans de l’écologie pro- fonde qui se sont focalisés sur l’opposition entre l’anthropocentrisme et l’écocentrisme ou le biocentrisme24. Pourtant, les limites qu’imposent à notre action les normes propres des animaux qui ne sont pas des personnes parce qu’ils ne sont pas imputables25, mais qui souffrent quand nous les contraignons à vivre dans des conditions contraires à leurs besoins éthologiques, posent un problème qui ne relève pas seulement de la morale ou de la compassion, mais de la justice.
L’élevage en batterie des poules qui ne peuvent étendre leurs ailes et gratter le sol, le confinement des truies gestantes dans des stalles où il leur est impossible de se mouvoir et où leur détresse est telle qu’elles développent des stéréotypies, ne sont pas seulement cruels, mais ils sont illégitimes. Le fait de forcer les bêtes à s’adapter aux conditions de l’élevage industriel afin de produire une quantité maximale d’œufs, de lait, de viande, en un minimum de temps et pour un coût réduit, est injuste. L’homme nie les normes éthologiques des bêtes et les force à s’adapter à des conditions de vie contraires à leurs besoins afin d’atteindre un objectif de rentabilité qui, en outre, n’est pas défini en fonction de la réalité du travail et qui est déterminé d’avance. Le travail est fondé sur le déni du réel et il fait aussi souffrir les hommes26. L’élevage est assimilé à la production en série d’objets manufacturés et les conditions de détention et d’exploitation des bêtes sont définies à partir du bénéfice que l’on peut retirer d’une production massive. On en arrive même à piéger le droit, comme on le voit avec la directive CE 1999/7427 qui prévoit l’agrandissement des cages des poules qui passeront, à partir de 2012, de 550 à 950 centimètres carrés, ce qui équivaut à une augmentation de la surface d’une carte postale ! Or ce déni du réel, cette manière de penser le rendement sans s’appuyer sur le sens d’une activité se retrouvent aussi dans l’organisation du travail des hommes28.
S’agissant de la terre et des écosystèmes, il est possible de tracer une frontière entre une intervention humaine, qui maintient leur équilibre, et une exploitation, qui conduit à l’érosion des sols et ne respecte pas la capacité d’une forêt à se restaurer. L’homme doit connaître les écosystèmes pour les respecter. Nombreux sont les dégâts causés par l’homme qui résultent de son ignorance. L’introduction dans le marais poitevin du ragondin venu d’Amérique du Sud, où sa population reste stable en raison de la présence des alligators, en est un exemple : les terriers de cet animal que l’on destinait au commerce de la fourrure fragilisent les berges et les digues, tandis que la terre, évacuée des galeries et repoussée, gêne le fonctionnement hydraulique du marais. Cette méprise est liée au fait que l’intervention de l’homme a été dictée uniquement par la recherche du profit immédiat et qu’il ne s’est pas demandé si l’introduction de cet animal dans un milieu où il n’a pas de prédateur, à l’exception des humains, était compatible avec les conditions garantissant l’équilibre du marais. C’est en ce sens que cette erreur est aussi une faute et une injustice. Comme l’écrit Leopold, « une chose est juste quand elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique […], injuste quand elle tend à l’inverse29».
Enfin, pour l’air, l’atmosphère, le climat, il est parfaitement censé de demander aux entreprises qui polluent de verser une compensation aux personnes subissant les conséquences de leurs actions et de réparer les dégâts qu’elles ont créés. Ces frontières entre une intervention légitime et une intervention illégitime sont à la fois morales et politiques, dans la mesure où les écosystèmes et le climat cessent d’être des res nullius, des choses qui ne sont à personne et dont tout le monde peut abuser30, et qu’ils deviennent des res communis, des choses communes dont il s’agit de gérer la rareté. Cela n’exclut pas la propriété privée, mais le marché fonctionne comme un marché de biens et de services, ce qui implique de supprimer l’effet économique de la rareté à propos des ressources naturelles tirées du sous-sol en évitant que les États et les entreprises en tirent une rente et en les dédommageant seulement du coût de l’exploitation31. Le droit de l’homme d’exploiter les vivants et la nature rencontre une limite qui pourrait figurer parmi les principes constitutionnels. C’est un principe politique au sens fort du terme. Il n’en est pas ainsi parce que le bien, en morale et en politique, découlerait d’une plate-forme de normes déduites du statut des différentes entités et imposées à la collectivité par les écologistes. Ces impératifs écologiques, comme le respect de la bio-diversité ou la reconnaissance de la valeur intrinsèque des écosystèmes, suscitent l’adhésion de ceux qui sont déjà convaincus par la centralité de l’écologie, mais, dans une démocratie, ils ne peuvent servir a priori de normes universalisables, c’est-à-dire reconnues par tous comme valides. Ces impératifs doivent être soumis à la discussion et à la délibération publique avant de pouvoir informer nos politiques. Cependant, il est une idée qui ne peut être niée par personne et qui souligne la dimension politique des problèmes soulevés par nos usages de la terre et des vivants : cet usage en dit long sur nous, révélant ce que nous sommes, les valeurs auxquelles nous accordons la priorité, la place que nous faisons ou pas aux autres hommes, aux autres cultures, aux autres formes de vie, le pouvoir que nous nous octroyons sur ces dernières et les raisons pour lesquelles nous les exploitons ainsi.
Nous continuons d’honorer les valeurs d’égalité et de justice sociale, nous parlons de développement durable, nous reconnaissons que l’animal est un être sensible32, mais, dans nos pratiques, dans l’élevage industriel, dans la manière dont nous exploitons la terre et dont le travail des hommes tend aujourd’hui à être organisé, nous ne reconnaissons pas de valeur supérieure à la rentabilité. Même la sécurité sanitaire des produits et l’idée d’un juste prix que les agriculteurs recevraient en échange de leur production ne sont rien à côté du diktat de la rentabilité. Celle-ci, comme on l’a suggéré plus haut, n’est même pas évaluée à partir du sens d’une activité. Elle ne s’identifie pas à l’efficacité, mais elle est calculée de manière abstraite et homogène, à partir des chiffres d’une production optimale qui n’est pas adaptée à la réalité du travail.
Ainsi, la crise environnementale n’est que l’expression d’une crise plus générale, ou plutôt d’une organisation sociale et politique elle-même fondée sur le déni du réel et sur une inversion des valeurs que sert « une stratégie de distorsion communicationnelle33» où l’argument économiste permet de justifier des décisions brutales et injustes. Les violences faites aux bêtes, la dévastation des paysages, les crises sanitaires sont un appel lancé au quis du « qui suis-je ? ». Qui sommes-nous pour faire ce que nous faisons et accepter de contester dans nos pratiques ce que nous pensons encore chérir sur le plan des idées et dans la sphère de la vie privée que la plupart des hommes, n’ayant plus le sentiment d’appartenir à un monde commun34, investissent comme une valeur refuge, comme le seul espace où ils pensent exprimer leur subjectivité et où la solidarité semble possible ?
Ces remarques ne servent pas à dresser un tableau pessimiste de notre époque, mais à signifier que cette organisation sociale n’est pas une fatalité. Bien plus, elles invitent à compléter la philosophie du sujet. Celle-ci n’est pas responsable de la crise actuelle, et nous ne dirons jamais assez tout ce que nous lui devons en termes de libertés. Sans elle, nous serions encore sous le joug des tyrans. Cependant, la conception du sujet et le fondement du droit sur lesquels repose le libéralisme politique ne suffisent pas à nous faire concevoir nos devoirs envers les autres vivants et les entités non humaines. La construction d’un concept de responsabilité qui nous préserve de nous transformer en « innocents coupables35» et d’être les complices d’un modèle de développement qui menace aujourd’hui les valeurs de liberté et de justice que les philosophes des Lumières nous ont transmises est précisément l’ambition de l’éthique de la vulnérabilité.
L’éthique de la vulnérabilité
La responsabilité est la catégorie phare de l’éthique de la vulnérabilité qui est, à sa manière, une philosophie du sujet et un humanisme. L’homme, à la différence du pigeon, est capable de pleurer la disparition d’une autre espèce et de la protéger. Plus encore que son pouvoir technique et que sa capacité à détruire la planète, sa responsabilité distingue l’homme des autres vivants. Elle est, en ce sens, un privilège. La spécificité de l’éthique de la vulnérabilité, qui ne se confond ni avec l’éthique du care ni avec les philosophies de la liberté, qu’il s’agisse des pensées que l’on regroupe d’ordinaire sous l’humanisme et qui vont du contractualisme à Kant et à Rawls ou que l’on fasse référence à l’ontologie du souci de Heidegger, est d’articuler trois expériences de l’altérité36.
La première expérience de l’altérité renvoie à l’altération du corps propre et à la fragilité, c’est-à-dire à ce que l’on appelle communément la vulnérabilité, qui est le fait d’être facilement blessé physiquement, psy- chiquement, socialement ou culturellement. Cependant, cette fragilité du vivant susceptible à la douleur, au plaisir, au vieillissement, donc à des phénomènes qui soulignent sa passivité, ainsi que l’incomplétude du psychisme qui manifeste notre besoin des autres et l’importance de la reconnaissance dans le développement de soi et l’identité, n’est qu’un aspect de la vulnérabilité. Celle-ci désigne aussi l’ouverture à l’autre, le fait que je suis concernée par ce qui lui arrive et que ma responsabilité pour lui n’est pas à penser comme une obligation, consécutive à un engagement.
Ma responsabilité est l’expérience d’une altérité en moi au sens où je suis atteinte par l’autre et ne reviens pas seulement à moi-même, ce que Levinas exprime dans Autrement qu’être en parlant d’« une passivité plus passive que toute passivité37». Je ne suis pas seulement préoccupée par ma propre conservation, par ma mort ou par le besoin que j’éprouve de m’affirmer, de conquérir mon authenticité38. Cette responsabilité originaire désigne une manière de nommer le sujet : « Je signifie me voici39. » L’ipséité40 n’est pas définie par la liberté négative ou l’indépendance, ni même par la capacité à faire des choix et à en changer, mais je suis ce à quoi je réponds et la manière dont je réponds.
Bien plus, l’auteur d’Autrement qu’être souligne la solidarité entre ces deux expériences de l’altérité, la fragilité du vivant et la sensibilité liée au corps rendant possible ma responsabilité pour l’autre41. Seul un moi vulnérable peut être responsable42.
Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité (1961), Paris, Le Livre de poche, 1994, p. 215- 218.
Günther Anders, « L’homme sur le pont », in Hiroshima est partout, op. cit., p. 81.
Emmanuel Levinas, De Dieu qui vient à l’idée, op. cit., p. 262.
Ibid.
Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 335 et 406.
Pour reprendre la formule de Bruno Latour, Politiques de la nature, Paris, La Découverte, L’auteur souhaite que l’on «étende la démocratie aux non-humains» (p. 294) et il propose un « Parlement des choses » (p. 299) composé de scientifiques faisant entendre la voix des entités non humaines et proposant leur can- didature à la deuxième chambre qui a le pouvoir d’ordonnancement. Ces propositions supposent une nouvelle définition du politique qui est « la composition progressive d’un monde commun ». Voir aussi p. 61-69 de son ouvrage.
Cet autrui, qui ne saurait être enfermé dans un concept ou un genre et qui défie « mon pouvoir de pouvoir », faisant du meurtre à la fois une interdiction et une impossibilité43, n’est encore pour le philosophe que l’autre homme, seul à avoir un visage. Pourtant, la pensée de Levinas contient la promesse d’une considération de l’animal et même des différentes entités qui va bien au-delà de ce qui existe dans l’éthique classique et dans les théories du contrat social. Il n’a pas tenu explicitement cette promesse, puisque les bêtes ne renvoient, pour lui, qu’à une différence sans altérité et qu’il ne s’est pas intéressé explicitement à l’écologie. Cependant, il ne serait pas possible de construire un concept de responsabilité procurant à l’écologie la philosophie dont elle pourrait avoir besoin si Levinas n’avait déjà modifié le climat de la philosophie.
Le changement radical qu’il opère ne tient pas essentiellement à la réhabilitation de la sensibilité, que l’on trouve également chez Bentham, ni à la place conférée à la compassion. Cette dernière ne doit d’ailleurs pas être confondue avec la responsabilité, dont il faut affirmer la démesure essentielle et la rationalité, les transformations de notre agir dues à la science et à la technique ayant des conséquences invisibles et irréversibles sur des êtres que nous ne connaissons pas et auxquels nous ne pouvons pas nous identifier44. La révolution initiée par Levinas réside dans l’affirmation d’un primat de la responsabilité sur la liberté qui a des conséquences sur l’organisation sociale et politique dont le philosophe n’a pas forcément pris toute la mesure.
Ce n’est pas seulement au phantasme d’un individu indépendant et servant de fondement au contrat social que cette philosophie met fin. Plus radicalement que l’éthique de la sollicitude qui a pointé les insuffisances des théories de la justice et dénoncé leurs présupposés atomistes, voire leurs préjugés sexistes, la pensée de Levinas interroge le droit de notre droit. La substitution à la peur pour ma mort de la crainte pour autrui est une manière de poser la question du droit à être et de se demander si «ma place au soleil n’est pas usurpation de la place d’autrui par moi opprimé ou affamé45». Cette question, qui creuse la bonne conscience, n’équivaut pas à une pensée de la culpabilité, ce qui serait une interprétation psychologique et moralisatrice de Levinas, mais il s’agit de s’inquiéter de « ce que mon exister », c’est-à-dire mon être au monde et mon vouloir vivre, « malgré son innocence intentionnelle et consciente, peut comporter de violence et de meurtre46». Placer la question, sans réponse, du droit à être au cœur de notre droit, c’est modifier radicalement la philosophie du sujet. Nous ne sommes pas obligés de cautionner l’éco-centrisme, mais en rénovant ainsi la philosophie du sujet, une fenêtre est ouverte vers un usage moins égoïste de la terre et une exploitation moins violente des autres, y compris des animaux.
Enfin, la troisième expérience de l’altérité qui constitue l’éthique de la vulnérabilité renvoie à ma non-indifférence pour les institutions de ma communauté politique dans laquelle je ne suis non pas un moi, mais moi. Cette notion de communauté politique est éloignée de la manière dont Levinas pense le politique qui est, pour lui, suspect de ramener l’Autre au Même et de broyer l’individualité sous une totalité. Elle est également distincte de ce qu’il appelle le tiers, qui désigne les autres qui me lancent un appel à la justice. Le rapport de l’individu au politique est un rapport d’appartenance, mais il ne relève pas de la fusion. Il sou- ligne le lien entre les valeurs qui sous-tendent les traditions et les institutions dans lesquelles je suis éduquée et ce à quoi je tiens. Ce lien, que l’expression d’identité narrative chère à Ricœur exprime bien, n’est pas exempt de tensions, les pratiques et les valeurs qui apparaissent comme prioritaires dans une société pouvant heurter profondément mes valeurs et me renvoyer une image de l’humanité qui m’est intolérable. La notion d’attestation développée par l’auteur de Soi-même comme un autre47 traduit cette dimension politique de notre responsabilité qui empêche de penser l’espace public comme le simple lieu de la déréliction.
Ainsi, le sujet de l’éthique de la vulnérabilité ne se définit pas seulement par la conservation et l’édification de soi, mais il s’inquiète du devoir être de son droit et intègre, dans son vouloir vivre, le souci de préserver la santé de la terre, de ne pas imposer aux autres espèces une vie diminuée et de ne pas usurper la place des autres hommes. Ces impératifs sont autant d’appels lancés au quis du « qui suis-je ? ».
Un tel fondement du droit implique une relecture des droits de l’homme et une modification de l’image de l’homme et de la socialité qui est au cœur du contractualisme sous sa forme actuelle. Ce travail en cours de réalisation est une partie du vaste chantier qui consiste à se demander comment le libéralisme peut répondre aux défis posés par les nouvelles techniques médicales et biomédicales et par l’écologie. En aval, la réflexion consiste à se demander quelles institutions peuvent compléter la démocratie représentative. Parce que l’écologie est aussi une éthique du quotidien et des petites choses, et qu’elle implique que nous consentions à changer nos styles de vie, il est impossible de séparer le volet ontologique du volet politique de la réflexion. Cependant, compte tenu de la complexité des problèmes environnementaux et des tensions existant entre des principes également importants, comme le respect des libertés individuelles et la protection de la biodiversité, il importe de séparer ces questions et de se concentrer ici sur quelques propositions visant à faire « entrer l’écologie dans la démocratie48 ».
Ecologie et démocratie
Dominique Bourg et Kerry Whiteside, op. cit., p 24.
Voir aussi les propositions de Bruno Latour, cit., p. 101-102 et 158-159.
Dominique Bourg et Kerry Whiteside, cit., p. 98. Les auteurs suggèrent que les services de l’État en charge des questions gouvernementales soient rattachés au Premier ministre et aux plus hautes instances exécutives.
Bertrand de Jouvenel, Essais sur le mieux-vivre (1968), Gallimard, coll. « Tel », 2002, p. 76.
Benjamin Constant, « De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes » (1819), in Écrits poli- tiques, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1997, p. 589-619.
Cette solution est l’un des écueils du grand livre de Hans Jonas, Le Principe responsabilité (1979), J. Greisch, Paris, Cerf, 1990, p. 271-272 et 279-283 (notamment p. 280).
Dominique Bourg et Kerry Whiteside, op. cit., p. 76-80.
Ibid., p. 75.
Ibid., p. 88.
Ibid., p. 91-94.
Ibid., p. 92.
Ibid., p. 93.
Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001.
Sylviane Agacinski, Le Corps en miettes, Paris, Flammarion, 2009.
Corine Pelluchon, La Raison du sensible, op. , p. 108-113. Voir aussi « La gestation pour autrui : une exception, pas la règle ! », Le Monde, 22 mai 2009.
Corine Pelluchon, L’Autonomie brisée, cit., p. 53-82. Voir aussi « Toutes les vies valent d’être vécues », Le Monde, 29 janvier 2011. Certaines personnes disent vouloir mourir parce qu’autour d’elles, tout leur signifie qu’elles sont de trop. Leur autonomie est ainsi le comble de l’hétéronomie.
Jürgen Habermas, L’Éthique de la discussion et la question de la vérité, P. Savidan, Paris, Grasset, 2003.
Arne Næss, Écologie, communauté et style de vie, cit. p. 108.
Depuis la loi sur l’eau de 1992, les commissions locales de l’eau (CLE) composées pour moitié d’élus, pour un quart de représentants de l’État et pour un quart de toutes les catégories d’usagers (agriculteurs, industriels, consommateurs, ) définissent en France le schéma d’organisation et de gestion de l’eau. Leurs prescriptions s’imposent aux administrations et collectivités publiques.
La démocratie représentative en question
Les problèmes environnementaux « heurtent les prémisses du gouvernement représentatif49 ». Ils impliquent que l’on corrige un peu les fondements philosophiques sur lesquels la démocratie représentative repose et que l’on ajoute des instances délibératives permettant de faire figurer la protection de la biosphère et le respect des autres espèces parmi les obligations de l’État. Il s’agit aussi de prendre en compte les informations scientifiques relatives à l’état de la planète50. Ce système méta-représentatif, qui vise à produire un autre rapport entre valeurs, consciences et institutions, est également associé à des procédures participatives garantissant une évaluation démocratique des choix environnementaux et évitant qu’on en arrive à un gouvernement d’experts.
Ces deux solutions au problème de l’inadéquation entre le système politique actuel et l’écologie supposent aussi un changement de culture politique, c’est-à-dire une autre manière de concevoir le rôle de l’État et de définir la mission des hommes politiques. Un tel changement n’affecte pas seulement les passions politiques et le contenu des programmes électoraux, mais il concerne aussi la manière dont les représentants, les intellectuels et les médias s’adressent aux citoyens. De même, la question de savoir quel est le rôle des scientifiques, des philosophes et des organisations non gouvernementales dans la Cité et même au sein des débats législatifs est déterminante. Avant de développer ces points, qui suggèrent que les difficultés des gouvernements et des organisations internationales à résoudre la crise environnementale sont dues à des habitudes de pensée et d’agir qui trahissent un déficit démocratique, il importe de revenir brièvement sur les raisons qui expliquent les insuffisances du système représentatif actuel.
Nous avons déjà opposé le souci du long terme que requiert une gestion adaptée des problèmes environnementaux à la myopie ou au court terme auquel conduit la course aux élections. Le contraste entre les raccourcis idéologiques, encouragés par les luttes partisanes et par la médiatisation des situations individuelles, et la complexité des arguments scientifiques et philosophiques servant à penser l’écologie suffit également à comprendre pourquoi la « question naturelle » se résume bien souvent à des déclarations d’intentions qui ne sont suivies d’aucun changement réel. Cela ne veut pas dire que les ministres de l’Environnement qui se sont succédé n’aient rien fait ni que le Grenelle de l’environnement ait été vain. Cependant, si la biosphère est le lieu où s’exerce notre liberté et si la politique n’est pas seulement un jeu à deux, mais un jeu à trois, alors l’absence de représentation des entités non humaines est problématique. De même, le fait de confier l’écologie à un ministère51, voire d’en faire un parti qui, en outre, doit se déclarer plus à gauche ou plus à droite, nous condamne à des actions ponctuelles et à des politiques atomistes qui vont à l’encontre du caractère transversal des questions environnementales et de leurs enjeux généraux.
Enfin, la démocratie représentative et le système électoral que nous connaissons sont nés dans un monde où les hommes avaient le sentiment que la terre était une planète géante52 qu’ils pouvaient cultiver sans relâche pour en tirer des ressources inépuisables. Cette idée d’une nature infinie et rebelle que l’homme doit soumettre grâce à la technique a installé le schéma d’une dualité entre la liberté et la nature qui n’a plus le même sens aujourd’hui. Non seulement la biosphère est finie et les réserves naturelles sont limitées mais, de plus, notre pouvoir technologique, notre démographie et nos habitudes de consommation font que nous imposons à la terre des contraintes qui n’ont rien à voir avec ce que faisaient les hommes des siècles précédents.
Nous continuons de raisonner comme si nous étions dans le monde de Hobbes, où l’homme est le prolétaire de la Création et où la guerre et la tyrannie de l’Église sont les menaces contre lesquelles l’État doit nous préserver. Pour les contractualistes, qui sont à l’origine de la démocratie libérale, le rôle de l’État est, en effet, de maintenir l’ordre public, de protéger la nation, de régler les conflits sociaux et de concilier les intérêts concurrents. Quand la menace de la guerre disparaît et que les hommes coulent des jours tranquilles, savourant une liberté définie davantage par la satisfaction de leurs intérêts privés et la jouissance de leurs droits que par l’idéal antique de la citoyenneté53, alors l’État est pensé comme ce qui doit maximiser le bonheur individuel. Cela ne signifie pas que la réduction de notre empreinte écologique passe aujourd’hui par une politique contraignant les citoyens à consommer moins ou prônant le malthusianisme. Il importe cependant de reconnaître que le rôle de l’État change dès lors que le bien commun ne peut être dérivé des seuls intérêts des personnes actuelles et que la nature est reconnue comme étant vulnérable.
Comment faire pour que la démocratie passe d’un système lié au jeu des égoïsmes à un gouvernement encourageant les responsabilités des individus envers une nature finie ? Quels contrepoids apporter à la représentation des intérêts immédiats et à quelles conditions la recherche de règles adaptées aux obligations nouvelles que nous avons vis-à-vis des générations futures et de la planète préserve-t-elle les valeurs du libéralisme politique, c’est-à-dire la tolérance, l’idée d’une égalité morale des individus, la liberté de penser et d’expression, la paix ? Telles sont les questions auxquelles il convient de se confronter si l’on veut que les changements que l’écologie fait subir à la politique signifient plus, et non pas moins, de démocratie. Car le spectre d’un Léviathan imposant ses normes environnementales à une partie du monde et la solution d’une « tyrannie bienveillante54» ou même d’un gouvernement d’experts sont les risques auxquels peut conduire notre manque de créativité sur le plan de la théorie politique.
Des contre-pouvoirs au sein du pouvoir
L’intérêt des propositions de Dominique Bourg et de Kerry Whiteside est de souligner la nécessité d’introduire les organisations non gouverne- mentales environnementales (ONGE) dans les institutions publiques ou gouvernementales55. Il ne s’agit pas seulement de faire en sorte que les politiques auditionnent des scientifiques ou des membres d’associations dédiées à la défense de l’environnement, comme cela est déjà arrivé avant la révision de loi de bioéthique ou lorsqu’il a été question de légiférer à propos des OGM. L’idée est que des ONGE comme la World Fund for Nature, le World Ressource Institute ou la Fondation Nicolas Hulot siègent dans des instances délibératives. Dans le système représentatif actuel, ces organisations ont un poids dans la mesure où elles ont une certaine autorité morale, mais leur influence reste limitée. Elles convainquent les hommes et les partis politiques de tenir compte de certaines questions environnementales, mais tant qu’elles ne prendront pas part aux processus d’élaboration des politiques publiques, elles resteront des outsiders56.
Certes, cette indépendance des ONGE, qui se sont développées dans la société civile, en dehors des partis politiques et des syndicats, est aussi leur force. Elle leur permet de conserver le sens du long terme et de penser au bien commun. Leur dimension internationale les préserve également des contraintes territoriales et de la pression électorale propres à l’organisation politique actuelle. En outre, elles sont en contact avec les populations, ce qui veut dire qu’elles font entendre la voix des citoyens. Cet aspect renforce l’idée selon laquelle leur présence dans les organes délibératifs est un gain démocratique. Cela ne signifie pas que ces ONGE prennent la place des représentants et des élus, mais leur rôle est de rappeler l’importance de la « question naturelle » alors que les politiques, naturellement, sont enclins à représenter surtout les intérêts des hommes actuels. De plus, il faut veiller à ce que la participation des ONGE aux organes du pouvoir ne leur fasse pas perdre les qualités qui font d’elles des alternatives et des contrepoids au présentisme. Pour ce faire, Bourg et Whiteside suggèrent de sélectionner les ONGE à partir de critères disqualifiant les associations créées ad hoc ou par simple opportunisme. Ils souhaitent aussi que des jurys populaires évaluent la compétence des différentes ONGE et que celles qui siègent dans les instances délibératives soient sélectionnées de manière aléatoire et tournante. De telles procédures permettraient de garantir plus de justice, de transparence et de publicité dans le choix des organisations, et elles serviraient à lutter contre la corruption liée à la pression des lobbies ou à l’usure du pouvoir. Ainsi, ces ONGE, loin de s’ériger en maîtres à penser ou d’édicter des normes sur lesquelles fonder la politique, seraient comme des contre-pouvoirs au sein du pouvoir, exerçant une vigilance dans les commissions régulant l’énergie, l’agriculture, le transport, le logement, la recherche et l’éducation. Leur rôle serait de « mettre en lumière, avec preuves et justifications à l’appui, les composantes environnementales des politiques » publiques dans tous les secteurs d’activité. Ces sous- systèmes démocratiques formés par des conseils et instances de veille et de réglementation n’ont de sens que si des considérations d’ordre écologique acquièrent une valeur constitutionnelle57. Ce rôle de gardien d’une Constitution intégrant les nouvelles obligations de l’État incomberait à l’Académie du futur et au Nouveau Sénat que Bourg et Whiteside appellent de leurs vœux58. Il ne s’agit pas, encore une fois, d’instances dictant le beau, le bien, le vrai en politique. L’idée est de se donner les moyens de prendre en compte les données de la science dont on ne peut pas faire l’économie quand on veut faire entrer l’écologie dans la poli- tique et même répondre aux défis soulevés par les techniques actuelles. Les hommes politiques ne peuvent pas tout savoir et les scientifiques ne sont pas des politiques. Comment, pour éviter une crise de légitimité, penser un nouveau rapport sciences/société/pouvoir ? Cette question que la plupart des philosophes et politistes s’intéressant à la bioéthique et à l’écologie se posent n’a rien à voir avec la fondation de la politique sur la science. L’exigence consistant à concilier les anciennes fonctions de l’État avec la préservation de biens environnementaux communs qui conditionnent l’existence de l’humanité confère une place nouvelle aux scientifiques sans les confondre avec des politiques. Tandis qu’une Académie du futur, regroupant des scientifiques et quelques philosophes, également sélectionnés puis nommés par tirage au sort, informerait les autorités publiques des connaissances relatives à l’état de la planète et des ressources, un Nouveau Sénat ferait le lien entre la « science éclairante » et les politiques. Il traduirait et interprèterait « les connaissances internationalement acquises59», élaborerait des grands projets de loi en pensant à réaliser les nouveaux objectifs constitutionnels et pourrait mettre son veto à tout projet contredisant les nouvelles obligations de l’État60. Chargé de veiller aux interactions entre la nation et la biosphère, il constituerait ainsi une sorte de laboratoire législatif « en amont et en aval de l’Assemblée nationale ».
La manière dont nous traitons les bêtes étant l’épreuve de notre justice, ce Nouveau Sénat pourrait aussi s’opposer aux pratiques qui ne respectent pas les normes éthologiques des animaux. De même, l’environnement touche à tous les secteurs d’activité, notamment à l’éducation, qui favorise la prise de conscience par les individus de leur responsabilité dans la vie quotidienne comme dans la dimension politique de leur vie. Si les politiques d’enseignement et de recherche reflétaient cette idée que mes habitudes de consommation et la manière dont je considère ce qui est dans mon assiette attestent de mes valeurs et révèlent mon identité, elles seraient plus fidèles à l’idéal de civilité et même de civilisation qui est l’héritage des Lumières, un héritage dont les discours moralisateurs et autres cours de citoyenneté ne sont que le pâle reflet, voire la caricature. Enfin, loin d’exclure les citoyens des décisions politiques, ces propositions qui visent à changer la démocratie vont de pair avec un renforcement de la participation. Les conférences de citoyens61, quand elles sont organisées de manière rigoureuse et que les participants désignés par hasard ne sont pas simplement invités pour recevoir la bonne parole de grands témoins ou d’experts jouant le rôle de gourous, permettent d’évaluer les projets et de mieux connaître la pensée et la volonté des individus que des sondages qui fournissent des réponses sommaires à des problèmes complexes. Une information et une formation de qualité sont non seulement nécessaires, mais, de plus, elles sont souhaitées par les citoyens qui, au XXIe siècle, apprécient que l’on s’adresse à leur intelligence, comme en témoignent le succès que connaissent les conférences sur les sujets de bioéthique et d’écologie et le discrédit accompagnant ceux qui utilisent des arguments ad hominem et croient encore qu’à l’âge des défis biotechnologiques et écologiques on peut faire l’économie de toute réflexion. Autrement dit, la culture politique, c’est-à-dire les passions politiques et la manière dont on s’adresse aux citoyens, devrait elle aussi évoluer.
Une autre culture politique
Des champs aussi complexes que la bioéthique et l’écologie nous enseignent que les anciens clivages, telle l’opposition entre progressisme et conservatisme, ne permettent pas de mesurer les enjeux liés aux problèmes que nous rencontrons ni de comprendre les conflits qui surgissent quand il s’agit, par exemple, de légiférer sur la gestation pour autrui, l’euthanasie ou les OGM. Des personnes que l’on pensait de gauche se déclarent farouchement hostiles aux mères porteuses62. D’autres pensent qu’on peut encadrer cette pratique, dans la mesure où elle n’implique pas une rémunération et qu’elle répond à des situations exceptionnelles, comme celles des femmes qui, n’ayant plus d’utérus, peuvent concevoir mais non porter un enfant63. Une telle position n’implique pas que l’on soit pour la dépénalisation de l’euthanasie, comme si l’administration du don de la mort par l’État et l’institution médicale équivalait à promouvoir la justice sociale et l’autonomie des personnes64.
Ainsi, il n’existe pas de manuel énonçant les solutions progressistes aux questions dites de bioéthique. Sans doute y a-t-il des positions conservatrices qui conduisent à refuser presque tout, mêlant avortement, contraception, procréations médicales assistées, recherche sur les cellules souches embryonnaires. On peut également rencontrer, à l’autre extrême, des hérauts du progrès qui confondent euthanasie et avortement, et font de la satisfaction des désirs individuels la mesure des lois. Cependant, ces coupures idéologiques résistent mal à l’examen des problèmes spécifiques liés à chaque question de bioéthique. De plus, les véritables arguments servant à cautionner ou à interdire une pratique ne sont pas ceux qui sont avancés lors des confrontations polémiques. Il s’agit, en effet, de conceptions du monde et de la vie, et de positions ontologiques plus profondes qui expliquent qu’une personne est prête ou non à intervenir sur le vivant de telle ou telle façon. Or, au lieu de ne voir que l’écume des choses, de rechercher des solutions toutes prêtes et de s’en tenir aux réactions épidermiques, chacun est invité, par les problèmes que soulèvent les champs de l’éthique appliquée, à prendre la mesure des conceptions substantielles du bien et des valeurs qui orientent ses décisions.
Ce travail d’explicitation des positions ontologiques qui sous-tendent, pour chacun, ses manières d’être et ses choix, et même ses goûts ou ses dégoûts, produit une connaissance de soi qui est en même temps une mise à distance de soi. Cet examen évite d’habiller du beau nom de dignité ses valeurs esthétiques, comme c’est souvent le cas dans les discussions éthiques et politiques, où l’attitude consistant à rationaliser ses impressions et à prononcer des jugements moralisateurs et paternalistes cède rarement la place à l’évaluation de l’impact moral et sociétal des tech- niques. De plus, cette analyse où les intérêts, les visions du monde et les émotions sont soumis à la raison publique permet à chacun d’adopter un « point de vue faillibiliste et critique65». Tout individu peut ainsi faire le tri entre ses opinions et croyances, et comprendre mieux le point de vue des autres, en particulier des personnes ayant des positions ontologiques opposées aux siennes et adoptant un comportement qu’il réprouve.
C’est par l’émotion que nous savons que nous admirons ou rejetons tel ou tel comportement. Elle est, dans les débats politiques, sur des sujets sensibles comme ceux qui touchent à la bioéthique et à l’écologie, ce que la douleur est au corps, à savoir un signal d’alarme qui invite à faire attention à l’organe douloureux et à lui prodiguer des soins. Le fait de parler de ses émotions et de voir ce dont elles sont l’expression permet aussi d’examiner ce qui peut entrer dans l’élaboration de normes universalisables et valables pour la communauté. Ces normes n’existent pas dans le ciel des idées, comme s’il y avait une vérité absolue que nous n’aurions qu’à découvrir et à appliquer. Elles émergent au cours de la discussion comme des normes qui peuvent être reconnues comme valides par tous.
Cette élucidation est particulièrement importante en écologie, parce que les émotions et les réactions esthétiques traduisent une manière de penser la nature et de se penser en elle. Encore une fois, cela ne signifie pas que les émotions aient valeur d’argumentation, mais « les réactions spontanées, qu’elles soient négatives ou positives, font plus qu’exprimer ce qu’une personne aime ou n’aime pas. Les prises de position éthiques sont des réflexions par rapport à de telles réactions : est-ce que j’aime ce que j’aime ?66». Aussi la clarification des différences ontologiques est- elle un pas vers la clarification des différences politiques et de leurs bases éthiques. Ces différences politiques, qui ne sont plus forcément celles auxquelles les anciennes oppositions idéologiques nous ont habitués, sont le système de valeurs d’une personne. Elles expliquent les conflits environnementaux. Les émotions, quand chacun des participants leur fait subir cet examen qui consiste à les traduire afin qu’elles révèlent la position ontologique qui leur est sous-jacente, peuvent donc servir de point de départ à la discussion.
Ces remarques suggèrent que les problèmes environnementaux qui créent des situations de conflits entre des individus ayant des intérêts et des points de vue divergents ne peuvent pas être résolus de manière technocratique par des mesures abstraites venues d’en haut, ni débattues au sein de formations politiques qui cherchent avant tout à définir une ligne de conduite par opposition à celle du camp adverse et usent ou abusent de slogans périmés. Il nous faut aussi nous appuyer sur l’expérience qui découle, par exemple, de la gestion de l’eau67, laquelle réunit, en plus
des élus, les différentes parties prenantes, les usagers, les agriculteurs, les industriels, etc. Cela ne signifie pas que la gouvernance requise par la gestion locale de biens communs suffise à l’échelle nationale, mais l’idée est de rendre possible l’autonomie politique.
La capacité des différentes parties prenantes à faire surgir des normes qui puissent être acceptées par tous et ainsi déterminer le partage d’un bien commun suppose une implication des individus qui va plus loin que l’idéal participatif auquel on réduit parfois les progrès démocratiques. Au lieu de se borner à des échanges interactifs entre les représentants et les électeurs lors de spectacles ou dans les médias, l’autonomie poli- tique des citoyens suppose que ces derniers aient un véritable intérêt pour la Cité et qu’ils acquièrent et développent les vertus de tolérance et d’écoute, et les qualités dialogiques indispensables à l’éthique de la discussion. Elle implique aussi qu’ils aient suffisamment confiance en eux pour s’organiser afin de faire remonter les résultats auxquels les ont amenés leur travail et leur réflexion. Enfin, elle suppose que les gouver- nants ne considèrent pas les citoyens comme des mineurs auxquels il suffit de s’adresser avec habileté et qu’ils ne considèrent pas la décision politique comme si elle était uniquement la marque de la volonté d’un homme mettant son empreinte sur le réel.
Plus que les leçons en communication auxquelles les politiques et les chefs d’entreprise consacrent de nos jours une part importante de leur budget, la connaissance du réel, comme la connaissance des traditions d’un pays, de sa culture et des habitudes et dispositions qui soutiennent ses institutions, est indispensable à celles et à ceux qui veulent faire quelque chose d’utile et de juste pour la collectivité. Le bluff, l’autoritarisme, le paternalisme, l’extrémisme, les simplifications et même l’idéologie sont des postures dépassées et complètement inadaptées aux enjeux d’une civilisation technologique, où chaque jour qui passe nous confronte à nos responsabilités, grandes et petites, envers les autres hommes, les autres cultures, les autres espèces et la planète. L’écologie peut être la chance d’un autre gouvernement des hommes, où l’Europe n’est pas l’ennemie de la nation, où les cultures ne disparaissent pas dans la globalisation, où la France, pays du goût et de la philosophie, célèbre pour son amour de l’universel et aimée pour sa singularité, a sa place dans le monde.

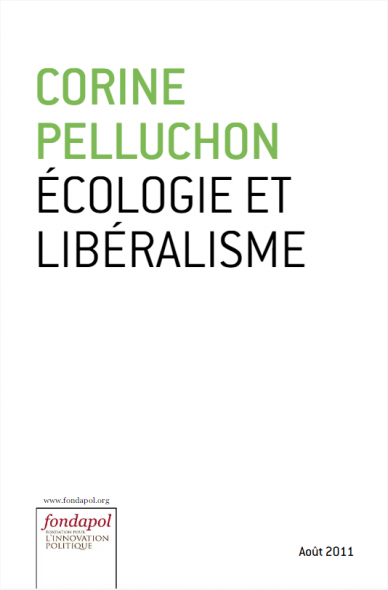











Aucun commentaire.