Prix de l’électricité : entre marché, régulation et subvention
Cette note explore les particularités de l’industrie de l’électricité, de ses évolutions au cours des dernières années, entre « vague du marché » et « vague verte », ainsi que les perspectives actuelles de réformes.Introduction
L’électricité, une « industrie de réseaux » soumise à des contraintes de politique publique
Spécificités techniques du produit
Intervention nécessaire des pouvoirs publics
La « vague du marché », une libéralisation encadrée par une forte régulation
Une ouverture progressive à la concurrence
La concurrence au sens de l’école de Harvard ou de celle de Chicago ?
Les exceptions à la règle de la concurrence
La « vague verte », une option coûteuse qui perturbe le marché
Le mécanisme des prix garantis avec obligation d’achat
Des prix négatifs pour l’électricité
Les réformes en cours
Les incertitudes technologiques et sociétales
Incertitudes économiques
Incertitudes technologiques
Incertitudes institutionnelles
Conclusion
Résumé
En plein débat sur la transition énergétique se pose la question suivante : comment caractériser l’électricité ? À la fois marchandise et service public, l’électricité est un produit vendu à travers un réseau interconnecté à l’échelle européenne, lequel requiert une gestion très particulière. C’est aussi un produit que l’on ne sait pas stocker à grande échelle avec les technologies actuelles, du moins à des coûts acceptables. Cependant, l’électricité n’est pas une marchandise comme une autre, non seulement du fait de ses caractéristiques physiques mais aussi en raison de son caractère stratégique.
Ce produit n’échappe en effet pas totalement aux règles du marché mais sa gestion dépend beaucoup des décisions publiques, aussi bien au niveau des choix de production qu’à celui de l’organisation des réseaux. Cette note explore les particularités de cette industrie de réseaux, ses évolutions au cours des dernières années, entre«vague du marché» et «vague verte», ainsi que les perspectives actuelles de réformes, marquées par l’incertitude.
Jacques Percebois,
Professeur émérite à l’université de Montpellier,directeur du Centre de recherche en économie et droit de l’énergie (Creden).

L’avenir de l’hydroélectricité
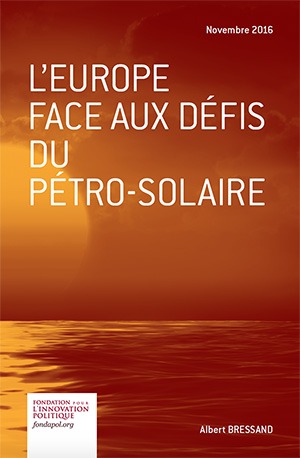
L’Europe face aux défis du pétro-solaire

Le nouveau monde de l'automobile (1) : L'impasse du moteur à explosion

Le nouveau monde de l'automobile (2) : Les promesses de la mobilité électrique

Good COP21, Bad COP21 (1) : le Kant européen et le Machiavel chinois
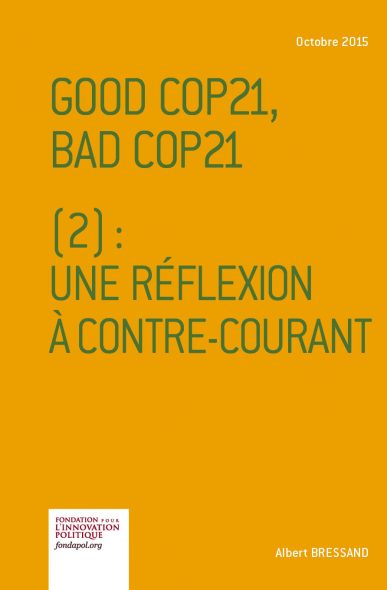
Good COP21, Bad COP21 (2) : une réflexion à contre-courant

Énergie-climat : pour une politique efficace
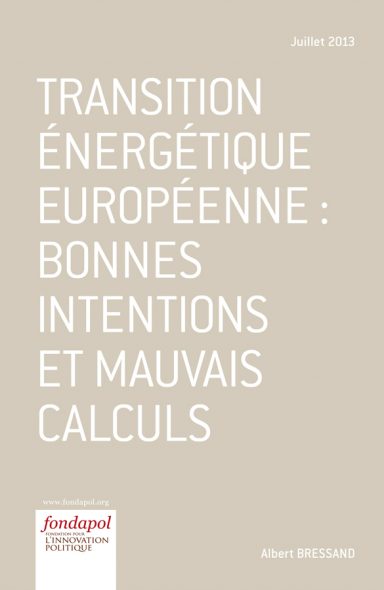
Transition énergétique européenne : bonnes intentions et mauvais calculs
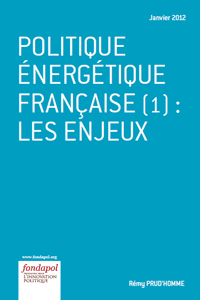
Politique énergétique française (1) : les enjeux

Politique énergétique française (2) : les stratégies
Introduction
L’électricité est à la fois une marchandise et un service public. De plus, il s’agit d’un produit vendu à travers un réseau interconnecté à l’échelle européenne, lequel requiert une gestion très particulière puisque, à tout instant, à la seconde près, la quantité soutirée du réseau doit être strictement égale à la quantité injectée dans le réseau. C’est aussi un produit que l’on ne sait pas stocker à grande échelle avec les technologies actuelles, du moins à des coûts acceptables. Certes, ce produit n’échappe pas totalement aux règles du marché mais sa gestion dépend beaucoup des décisions publiques, tant au niveau des choix de production qu’à celui de l’organisation des réseaux. Nous verrons successivement en quoi cette industrie de réseaux est particulière, comment la «vague du marché» a impacté la gouvernance de cette industrie et comment, dans un second temps, la «vague verte» a compliqué le fonctionnement du marché, avant de mettre en évidence, dans un dernier point, les nombreuses incertitudes, à la fois technologiques, économiques et institutionnelles, qui demeurent aujourd’hui.
L’électricité, une « industrie de réseaux » soumise à des contraintes de politique publique
Du fait de ses spécificités techniques mais aussi parce que c’est un bien stratégique qui a la nature d’un service public à caractère industriel et commercial, l’électricité n’est pas un produit comme les autres.
Spécificités techniques du produit
Voir Christophe Bouneau, Michel Derdevet et Jacques Percebois, Les Réseaux électriques au cœur de la civilisation industrielle, Timée Éditions, 2007.
Cour des Comptes, Les Coûts de la filière électronucléaire, rapport public thématique, janvier 2012.
EPR : réacteur pressurisé européen (Evolutionary Power Reactor).
L’électricité est généralement produite dans des centrales de dimensions variables, localisées sur le territoire en fonction de contraintes physiques (en bord de mer ou le long des fleuves pour le nucléaire ou l’hydraulique, près des mines de charbon ou des gisements d’hydrocarbures pour les centrales thermiques classiques) et elle est ensuite transportée en haute tension dans un réseau de transport (par RTE en France) pour être distribuée en moyenne et basse tension dans un réseau de distribution (Enedis) jusqu’au consommateur final domestique, industriel ou commercial. Mais, pour l’instant, c’est un produit que l’on ne sait ni stocker à grande échelle ni dans des conditions économiques raisonnables, ce qui implique que la quantité de kilowattheures (kWh) injectée en amont au niveau des centrales est égale, aux pertes en ligne près (par « effet Joule »), à la quantité soutirée par les consommateurs. En France, les pertes en ligne sont estimées à 7% environ de la production, ce qui représente une valeur basse par rapport aux autres estimations mondiales. C’est principalement dans le réseau de distribution que ces pertes sont observées. En quasi-totalité, il s’agit de pertes techniques, les pertes non techniques (fraudes) étant très faibles en France. Cette contrainte d’équilibre instantané entre électricité injectée et électricité soutirée a comme conséquence un impact important sur le marché de gros de l’électricité car elle explique la très forte volatilité du prix de l’électricité. Une forte demande, mal anticipée, provoque une envolée du prix, car il faut alors faire appel à une centrale dite « de réserve », dont la maintenance est coûteuse en raison de son faible facteur de charge. Cette volatilité est bien plus élevée que celle du prix du pétrole ou de n’importe quelle autre matière première.
Par ailleurs, l’électricité est un produit qui se transporte assez mal sur longue distance : au XIXe siècle, la «guerre des courants», qui a opposé Edison, favorable au courant continu, et Westinghouse, favorable au courant alternatif, s’est traduite par la victoire du second parce qu’il est plus facile de transporter le courant alternatif à condition de le faire en haute, voire très haute tension (400.000 volts en Europe, par exemple). Via des transformateurs, ce courant est ensuite ramené à des tensions plus basses (220.000 volts, 63.000 volts puis 220 volts au niveau du particulier). Les lois de Kirchhoff (loi des nœuds et loi des mailles) expliquent le cheminement de l’électricité sur un réseau interconnecté et justifient notamment que la fréquence sur le réseau européen ne doit pas s’éloigner de 50 HZ (60 HZ sur les réseaux des États-Unis et du Brésil). Lorsque des millions d’Européens allument la lumière, il faut qu’à l’autre bout de la chaîne le système injecte en temps réel suffisamment d’électricité pour maintenir cette stabilité de la fréquence. Si tel n’est pas le cas, on court le risque d’un effondrement du réseau, comme cela a souvent failli se produire ou s’est d’ailleurs parfois produit. Cela requiert soit de réduire une partie de la demande (effacement contractuel ou délestage), soit d’appeler des centrales maintenues en stand by (réserves primaire, secondaire ou tertiaire). Avec l’électricité, les files d’attente sur le réseau sont impossibles, à la différence de ce qui se passe sur un réseau téléphonique : toute demande doit être satisfaite ou délestée en temps réel, sinon c’est le black out sur le réseau1.
L’électricité est aussi une industrie très capitalistique : la valeur des équipements (centrales et réseaux) représente plusieurs fois le chiffre d’affaires des entreprises d’électricité, et ces équipements ont une durée de vie très longue (plus d’un siècle pour un barrage ou un réseau de transport et de distribution, de quarante à soixante ans pour une centrale nucléaire, de vingt à quarante ans pour une centrale thermique classique). Ainsi, en 2012, la Cour des comptes a estimé le coût « overnight » du parc nucléaire français à 83,2 milliards d’euros 2010 (coût hors intérêts intercalaires estimés à 13 milliards, hors frais de fonctionnement et de démantèlement et, bien sûr, hors coût des réseaux) 2, cela à une date où le chiffre d’affaires d’EDF avoisinait les 72 milliards d’euros. C’est le coût qu’il faudrait supporter si l’on voulait reconstruire dans la nuit le parc nucléaire. Et l’on ne tient pas compte ici de la valeur du réseau. Cela requiert donc d’anticiper les besoins longtemps à l’avance, d’autant que la construction de ces infrastructures et centrales exige des délais non négligeables (plusieurs années pour une centrale nucléaire).
Afin de bénéficier d’économies d’échelle, on a eu tendance à construire des centrales de plus en plus puissantes (l’EPR 3 a une puissance de 1.650 MW, contre 900 pour les 58 réacteurs du parc nucléaire actuellement en fonctionnement et de 400 à 600 MW pour une centrale fonctionnant avec du charbon). Pour tenir compte des économies d’envergure, on a interconnecté les réseaux, ce qui permet de bénéficier de ce que les électriciens nomment le « foisonnement » : le maillage du réseau permet tout à la fois d’optimiser la route que l’électron va prendre pour alimenter le client et, surtout, de bâtir une puissance sensiblement inférieure à la somme des puissances installées chez les utilisateurs. Tous les clients raccordés au réseau n’utilisent pas en même temps la totalité de la puissance qu’ils ont souscrite ; ainsi la puissance totale installée en France, qui est de l’ordre de 130 GW (130.000 MW), est près de quatre fois inférieure à la somme estimée des puissances correspondant aux appareils installés chez les consommateurs français.
Il importe à ce niveau de bien dissocier la puissance, exprimée en kilowatts (kW) ou en mégawatts (MW), et l’énergie, exprimée en kilowattheures (kWh) ou en mégawattheures (MWh). Le service qu’achète un client, c’est le droit de bénéficier à un instant donné d’une puissance en kilowatts qu’il va utiliser pendant une certaine durée en heures ; cette spécificité technique va d’ailleurs justifier la tarification dite « binôme » qui sera traditionnellement retenue, puisqu’on facturera à la fois la puissance et l’énergie.
Intervention nécessaire des pouvoirs publics
Voir Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, Transition(s) électrique(s). Ce que l’Europe et les marchés n’ont pas su vous dire, Odile Jacob, 2017.
Voir Christophe Bouneau, Michel Derdevet et Jacques Percebois, op. cit., ainsi que Jacques Percebois, « La dérégulation de l’industrie électrique en Europe et aux États-Unis : un processus de décomposition-recomposition », Cahiers du Creden, n° 97-04-08, juillet 1997.
Voir Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, op. cit.
L’électricité est un bien qui peut s’échanger sur un marché et possède donc un prix, mais c’est aussi un bien qui revêt la nature d’un service public du fait de son caractère indispensable. Il existe d’ailleurs un « droit à l’électricité », implicite dans la loi de nationalisation de 1946 et explicite dans la loi française votée en 2000. Certains besoins ne peuvent être satisfaits que par l’électricité (éclairage, fonctionnement des appareils électroménagers, informatique, TGV…). Ce caractère stratégique justifie l’intervention des pouvoirs publics, celle de l’État, bien sûr, mais aussi celle des collectivités territoriales. Le « coût de défaillance » du réseau électrique peut être très élevé du fait des dommages que cela engendre pour l’économie dans son ensemble. Ainsi RTE estime que le coût d’un mégawattheure non livré suite à une défaillance non anticipée peut largement dépasser 10.000 euros alors que, sur le marché, ce même mégawattheure se négocie en moyenne (et sauf pics extrêmes), selon les périodes, entre 30 et 150 euros. Certaines grandes pannes ont engendré des baisses importantes d’activité en termes de PIB et donné lieu à des indemnisations conséquentes de la part des opérateurs quand ceux-ci n’ont pas pu invoquer la force majeure4.
Par ailleurs, l’électricité n’est pas seulement un bien de consommation finale pour le particulier qui se chauffe ou utilise un ordinateur, c’est aussi une consommation intermédiaire pour les entreprises industrielles ou le secteur commercial qui utilisent ce vecteur pour faire fonctionner leurs équipements. Le coût du kilowattheure est donc un élément important de la compétitivité des entreprises à l’échelle internationale, et cela est particulièrement vrai pour celles qui utilisent ce que l’on appelle des « électro-intensifs » (aluminium, verre, ciment, pâte à papier, chimie…).
Ce caractère stratégique et le fait que l’électricité est relativement coûteuse à transporter expliquent que la production d’électricité soit, dans tous les pays du monde, à de rares exceptions près, une activité nationale. Ainsi plus de la moitié du pétrole produit dans le monde donne lieu à des échanges sur le marché international, contre 25% pour le gaz naturel (plus coûteux à transporter), 15% pour le charbon (produit pondéreux) et seulement 1,5% pour l’électricité. Les échanges internationaux se limitent d’ailleurs aujourd’hui à des échanges avec les pays limitrophes et la France est dans le « top 3 » des exportateurs mondiaux d’électricité. Un pays peut dépendre à 100% de l’étranger pour son approvisionnement en pétrole ou en gaz naturel, car ce sont des produits qui se stockent. Ce n’est pas possible avec l’électricité : couper l’alimentation électrique du pays reviendrait à le rendre totalement vulnérable. La conséquence en est que la structure du « mix électrique » d’un pays dépend de sa dotation initiale en facteurs de production. Cela a des conséquences lorsque l’on interconnecte les réseaux nationaux, puisque cela peut à la fois justifier les échanges transnationaux afin de bénéficier, par exemple, d’une électricité étrangère meilleur marché, et rendre difficile la convergence des prix nationaux, les coûts de production étant très variables d’un pays à l’autre. Un pays qui dispose d’importants gisements d’hydrocarbures optera pour des centrales thermiques fonctionnant au fioul ou au gaz naturel, tandis qu’un pays dont le sous-sol renferme des gisements importants de charbon ou de lignite aura naturellement tendance à privilégier les centrales au charbon. La France, qui disposait de gisements miniers et de chutes d’eau dans les Alpes et les Pyrénées, a longtemps opté pour des centrales à charbon et de l’hydraulique. L’accès privilégié au pétrole algérien, durant une certaine période de son histoire, et le bas prix du pétrole sur le marché international dans les années 1960 l’ont incitée à privilégier les centrales au fioul à côté de l’hydraulique (suite à la régression du charbon et à la fermeture progressive des mines françaises de charbon à partir de 1960), mais les différents chocs pétroliers l’ont ensuite conduite à opter pour un vaste programme nucléaire, condition sine qua non de son indépendance électrique. Rappelons qu’en 1960 l’hydraulique représentait plus de 50% de la production française d’électricité et qu’en 1974, au moment du premier choc pétrolier, le nucléaire ne représentait que 8% de cette production, contre 72 à 75% aujourd’hui.
À ses débuts, l’électricité était un produit de luxe mais, très vite, les communes ont compris l’intérêt de son développement, notamment au niveau de l’éclairage public jusqu’alors assuré par le gaz, et donc, indirectement, au niveau de la sécurité publique. Elles ont alors développé des réseaux locaux dans le cadre de la concession de service public (ou de la permission de voirie) et, plus exceptionnellement, créé des régies municipales, loi Le Chapelier de 1791 oblige. Mais l’affaiblissement du pouvoir concédant des communes sera la conséquence de la montée du pouvoir réglementaire de l’État. Dès 1928, l’État va fixer un cahier des charges type et les décrets-lois Laval de 1935 vont introduire une certaine uniformisation des tarifs, sans conduire toutefois à la péréquation spatiale sur l’ensemble du territoire. L’État va également favoriser l’interconnexion des réseaux aux échelles régionale et nationale, à la fois dans un souci de sécurité de l’approvisionnement, mais aussi pour garantir l’approvisionnement de Paris grâce à de l’électricité venue des Alpes. Traditionnellement, les centrales électriques sont à dominante thermique au nord de la Loire (présence de mines de charbon) et à dominante hydraulique au sud (du fait des montagnes). Ce processus d’étatisation va connaître son apogée en France, comme dans de nombreux pays européens, après la Seconde Guerre mondiale, avec le vote de la loi d’avril 1946 créant Électricité de France (EDF), qui a alors le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic). Le législateur nationalise l’essentiel des 1.730 entreprises d’électricité qui existaient alors, certaines de grande dimension, d’autres très petites, et ne laisse subsister qu’un petit secteur privé et, bien évidemment, les régies municipales ou sociétés d’économie mixte qui prévalaient avant cette loi, avec interdiction d’ailleurs d’en créer de nouvelles. À noter que les collectivités locales (les communes, puis les agglomérations) sont aujourd’hui encore des autorités concédantes propriétaires des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, Enedis n’étant que le concessionnaire obligé (sauf en cas de régies). Le réseau de transport qui, au départ, appartenait à l’État est aujourd’hui propriété de RTE5.
Cette « entreprise » EDF, qui n’en était pas une au sens juridique à ses débuts puisqu’il n’y avait pas de capital social, a alors le monopole intégral de l’exportation-importation d’électricité en France, le monopole total du transport et un quasi-monopole de la production – il existe quelques producteurs privés – et de la distribution – il existe des entreprises locales de distribution (ELD), essentiellement des régies.
Le monopole public intégré (qui va de la production à la distribution) n’est pas une exception française, car on trouve à peu près la même chose alors au Royaume-Uni ou en Italie, mais il est plus affirmé en France du fait des moindres prérogatives accordées aux collectivités locales (communes ou régions). À cette époque, il faut reconstruire l’économie française, assurer l’électrification rurale du pays (qui ne sera achevée qu’au début des années 1960) et procéder à des investissements massifs dans la production et les réseaux. Ce sera le grand programme hydraulique des années 1950 (les grands barrages dans les Alpes), puis le programme thermique au fioul des années 1960 et enfin l’accélération du programme électronucléaire de 1974 (plan Messmer) qui, en vingt ans, dotera la France des 58 réacteurs de type Westinghouse (filière « francisée ») actuellement en fonctionnement. Le financement de ce programme nucléaire se fera par endettement (largement sur le marché obligataire américain, avec la garantie de l’État) et les coûts seront répercutés dans les tarifs de l’électricité. C’est le consommateur qui paie, hormis les aides que l’État a accordées au niveau de la recherche-développement dans le domaine du nucléaire militaire et civil, et qui seront à la charge du contribuable. Le nucléaire civil a ainsi bénéficié de retombées du nucléaire militaire et le choix de la filière française uranium naturel graphite gaz (UNGG) s’explique en partie par des raisons militaires (production de plutonium comme produit de fission), mais ce n’est pas la seule raison : à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France ne maîtrisait pas l’enrichissement de l’uranium et comme les Américains refusaient de lui livrer de l’uranium « enrichi », il a fallu développer une filière à uranium naturel tout en recherchant de l’uranium sur le sol métropolitain (ce qui permit les découvertes du Limousin). Les choses ont changé dans les années 1960 avec la maîtrise de l’enrichissement et la décision de passer à la filière des réacteurs à eau pressurisée (ou PWR, pour pressurized water reactor), plus sûre et surtout plus rentable sur le plan économique. Ce fut le choix de la filière Westinghouse, technologie dominante alors à l’échelle internationale, qui fut « francisée ».6
Durant cette période, c’est EDF qui proposait à sa tutelle le niveau et la structure des tarifs d’électricité mais ceux-ci étaient arrêtés par l’État. Des considérations politiques et sociales empêcheront EDF d’obtenir toujours gain de cause, l’État rechignant à augmenter le prix du kilowattheure, qui faisait partie de l’indice des prix calculé par l’Insee et avait donc un impact sur le taux d’inflation, préoccupation importante à l’époque. L’État sera toujours préoccupé par le fait que la facture d’électricité est un poste important du budget des ménages. Il faut rappeler qu’en 2018 encore, l’Office national de la précarité énergétique (ONPE) estime à 5,6 millions le nombre de ménages en situation de précarité énergétique en France (un ménage est en situation de précarité énergétique s’il affecte plus de 10% de son budget aux usages énergétiques de son logement, ce qui ne tient pas compte des dépenses d’énergie liées à la mobilité). C’est la raison pour laquelle l’État a instauré des tarifs de première nécessité (TPN), remplacés depuis 2017 par un « chèque énergie » pour ces ménages précaires, même si tous ne se chauffent pas à l’électricité mais beaucoup encore au fioul, au gaz ou au bois.
En s’appuyant sur les travaux du service des études économiques générales dirigé par Marcel Boiteux, EDF parviendra à convaincre le gouvernement qu’il faut, sauf cas sociaux particuliers, pratiquer la « vérité des prix » et opter pour une tarification au coût marginal, ce qui conduira à différencier les prix selon l’heure et la période (tarification dite « horo-saisonnière » prévoyant des tarifs heures pleines, heures creuses et heures de pointe, variables selon la période, été et hiver). Ce choix sera d’ailleurs validé par le rapport Nora de 1967 qui recommande aux entreprises publiques d’aligner autant que faire se peut les tarifs publics sur les coûts, à l’image de la pratique d’EDF. Au fond, le monopole public applique l’optimum tarifaire auquel conduirait par tâtonnements la concurrence pure et parfaite si elle était introduite, alors même qu’il n’est pas soumis à cette époque aux lois du marché.
La « vague du marché », une libéralisation encadrée par une forte régulation
De 1946 jusqu’au milieu des années 1990, l’entreprise publique EDF a, aux yeux des Français, rempli son contrat : assurer l’accès de tous à un service public de l’électricité garantissant à la fois la continuité du service (très peu de défaillances), l’égalité de traitement de tous les « usagers » grâce à une tarification fondée sur les coûts marginaux (chacun paie les conséquences de sa présence sur le réseau), tout cela à un prix sensiblement inférieur à la moyenne européenne. Le choix du nucléaire a certes entraîné une hausse des prix au moment où il a fallu investir massivement (dans les années 1974-1985), mais le consommateur bénéficiait d’une baisse régulière des tarifs puisque le gros de l’endettement était passé et que, du fait de la standardisation des technologies retenues (les 58 réacteurs sont tous du même modèle, avec des paliers croissants), l’entreprise profitait de fortes économies d’échelle. EDF n’était-elle pas la plus grande entreprise électrique du monde occidental par la puissance installée et le nombre de clients ?
Mais à partir de la fin des années 1980 et du début des années 1990, un vent de libéralisme venu du Royaume-Uni et de la côte Est des États-Unis va souffler sur le secteur de l’énergie, ce qui va offrir à la Commission européenne l’opportunité de s’intéresser de près à la politique énergétique de ses différents pays membres, en particulier électrique, sujet qu’elle avait jusqu’alors quelque peu délaissé. Rappelons qu’aux termes des traités, notamment du traité de Rome (1957), la politique énergétique est de la compétence exclusive des États et non de celle de Bruxelles. Le respect de la concurrence est en revanche une prérogative de la Commission, et c’est par ce biais que Bruxelles va interférer avec les politiques énergétiques menées par les États membres, d’autant plus facilement que, depuis l’Acte unique entré en vigueur en 1987, les votes ne se font plus à l’unanimité mais à la majorité qualifiée pour ce qui concerne l’organisation du marché intérieur. On va alors assister à une ouverture à la concurrence progressive dans un secteur qui jusqu’alors était largement dominé par des monopoles locaux ou nationaux, publics ou privés, mais concessionnaires de service public dans ce dernier cas. Cette ouverture à la concurrence sera progressive et va connaître de nombreuses exceptions, qui tiennent au fait que l’électricité n’est pas un produit comme un autre.
Une ouverture progressive à la concurrence
Voir ibid. et Jacques Percebois, cit.
Voir Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, cit.
Voir Paolo Cecchini (dir.), 1992, le défi. Nouvelles données économiques de l’Europe sans frontières, Flammarion, 1988. Ce livre est la synthèse d’une étude de 6 000 pages et traduite en dix-sept langues réalisée à la demande de Jacques Delors pour la Commission européenne
Voir Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, Énergie. Économie et politiques, 2e éd., De Boeck, 2015.
Voir Commission de régulation de l’énergie (CRE), Les Marchés de gros de l’électricité, du gaz et du CO2, 4e trimestre 2017 – données au 31/12/2017.
Plusieurs facteurs vont se conjuguer. C’est d’abord le rappel par la Commission européenne des dispositions de la version originelle de l’article 90 du traité de Rome, qui dispose que « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général […] sont soumises aux règles du présent Traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie7 ». Le traité ne méconnaît pas les missions de service public mais elles ne doivent pas entraver le respect de la concurrence. Seuls les « monopoles naturels », c’est-à-dire les activités qui pour des raisons technico-économiques ne peuvent pas s’accomplir dans le cadre de la concurrence au sens strict, échappent à cette logique8.
Un « monopole naturel » est une activité qui, pour des raisons économiques de « sous-additivité stricte » de la fonction de coût, ne peut être assurée que par un seul opérateur. C’est le cas d’un réseau de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz, ou celui d’un réseau ferré. La duplication du réseau sur un espace donné serait antiéconomique. On ne va pas construire deux réseaux concurrents de distribution d’électricité dans une ville, car la concurrence serait destructrice et que les deux opérateurs auraient intérêt à s’entendre, voire à fusionner. Il peut certes y avoir concurrence pour l’obtention de la concession de distribution suite à une mise aux enchères (au plus offrant), mais, une fois la concession accordée, le contrat donne une garantie au concessionnaire qu’il aura le monopole de la distribution pour une certaine durée (entre dix et cinquante ans, selon les cas), sous réserve bien sûr de respecter les dispositions du cahier des charges annexé au contrat de concession. On parle alors de concurrence pour le marché et non de concurrence par le marché9. C’est d’autant plus indispensable que la construction et l’entretien d’un réseau sont des activités coûteuses : le concessionnaire doit pouvoir récupérer sa mise de fonds tout en réalisant un profit « normal ». La concession de distribution de l’électricité est généralement valable sur l’espace d’une agglomération ; celle du transport de l’électricité peut l’être sur un espace régional (un Land ou plusieurs Länder, comme en Allemagne) ou sur l’ensemble du territoire national (comme en France pour RTE). En France, la loi prévoit qu’Enedis est actuellement le concessionnaire obligé des collectivités locales (sauf lorsqu’il existe des régies), mais la Commission européenne souhaite qu’à terme, à l’échéance des concessions déjà signées, toutes les concessions puissent être mises aux enchères sur l’espace européen.
Les activités de production ou de commercialisation de l’électricité ne sont en revanche pas des activités en situation de monopoles naturels. Il existe certes des économies d’échelle mais rien n’empêche les producteurs et les fournisseurs de se faire concurrence, et c’est d’ailleurs souhaitable pour le consommateur. Pour la Commission européenne, il faut donc ouvrir à la concurrence ce qui peut l’être et maintenir les monopoles pour la gestion des réseaux mais sous réserve de les contrôler afin qu’il n’y ait pas d’abus de position dominante.
En 1988, le rapport Cecchini avait mis en évidence le « coût de la non- Europe10 ». Ce rapport montrait que la faible intégration des économies européennes avait un coût et qu’une intensification des échanges dans tous les domaines, y compris ceux du gaz et de l’électricité, serait favorable au consommateur européen. La baisse du coût d’accès à l’énergie permettrait de gagner quelques points de PIB. À l’époque, du fait des monopoles d’importation et d’exportation, il était juridiquement impossible pour un industriel allemand qui le souhaitait de profiter du kilowattheure français moins cher en achetant son électricité directement à EDF ; il devait passer par son fournisseur allemand local. Les industriels français de la chimie qui avaient commencé à négocier avec les fournisseurs norvégiens de gaz naturel avaient de même été rappelés à l’ordre par les autorités françaises : ils devaient acheter leur gaz à Gaz de France (GDF), qui détenait le monopole d’importation du gaz, même si cela était plus cher. Il y a donc eu des opérations de lobbying de la part des gros consommateurs européens pour inciter à plus de concurrence, comme cela était aussi le cas dans certains États des États-Unis, notamment en Californie et sur la côte Est.
À cela s’ajoute l’observation que certains monopoles étaient critiqués, notamment au Royaume-Uni, du fait d’une moindre compétitivité et de l’existence de rentes qui conduisaient à des prix de vente supérieurs à ceux qui auraient prévalu si une certaine concurrence était introduite. Le contexte a lui aussi changé. Le keynésianisme triomphant a cédé la place à un vent de libéralisme venu en particulier du Royaume-Uni, et les réformes menées par Margaret Thatcher qui, pour mettre fin à la grève des mineurs, n’a pas hésité à démanteler une partie du secteur de l’énergie, ont fait des émules dans le reste de l’Europe.
Mais l’une des raisons majeures en faveur de la libéralisation fut sans doute l’ouverture concurrentielle réussie du secteur des télécommunications et de celui du transport aérien. L’abolition des monopoles a, dans les deux cas, entraîné une diversification des services et une baisse des prix pour le consommateur final. Pourquoi, dès lors, ne pas appliquer la même mesure aux secteurs de l’énergie comme le gaz ou l’électricité ? Mais il existe une différence majeure entre l’industrie des télécommunications et celle de l’électricité : dans le secteur des télécoms, l’ouverture à la concurrence s’est faite dans un contexte de fort progrès technique (l’apparition du téléphone mobile), alors qu’il n’existe pas un tel bouleversement technologique dans le cas de l’électricité. Le réseau par câbles enterrés de France Télécom était un monopole naturel et il le demeure car c’est une infrastructure coûteuse et difficile à dupliquer ; les réseaux sans fil de type hertzien ne le sont pas et chaque opérateur peut construire son propre réseau. Dans ce cas, il n’y a donc quasiment plus de « monopole naturel ». L’important est d’interconnecter les divers réseaux mais cela ressort de l’intérêt de chaque fournisseur. En revanche, l’électricité continue à être véhiculée par câbles et le gaz, lui aussi, a besoin de tuyaux coûteux à construire. De plus, les demandes de services de téléphonie mobile ou de transport aérien (apparition du low cost) ont explosé, ce qui n’est pas le cas de la demande d’électricité qui reste stable (et que l’on souhaite même limiter pour des raisons environnementales), même s’il y a eu l’émergence des turbines gaz-vapeur (TGV) qui, dans le domaine de la production d’électricité, ont permis de produire de l’électricité à faible coût avec des puissances modestes, à la différence des centrales nucléaires dont la dimension croissante permet de bénéficier de fortes économies d’échelle – mais cela est aujourd’hui de plus en plus contesté comme le montrent les difficultés du réacteur pressurisé européen (EPR, pour evolutionary power reactor).
Après bien des tergiversations, diverses directives européennes, transposées dans les droits nationaux, ont imposé aux États membres de procéder à une libéralisation de leur industrie de l’électricité. La première directive (« premier paquet ») a été adoptée le 19 décembre 1996, suite au « compromis de Luxembourg ». Elle impose l’abolition des monopoles d’importation, d’exportation, de production et de fourniture de l’électricité, et prévoit le principe de l’accès des tiers aux réseaux (ATR). Les réseaux peuvent continuer à fonctionner comme des monopoles (y compris publics) mais ils deviennent des « infrastructures essentielles » (essential facilities, terme emprunté au Sherman Act voté en 1890 par le Congrès américain, parfois traduit par « facilités essentielles » en français). L’accès à ces infrastructures est ouvert à tous les producteurs, fournisseurs et clients, et les péages d’accès doivent être fixés par une commission de régulation indépendante – en France, la Commission de régulation de l’énergie – sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les péages sont établis pour plusieurs années (quatre à cinq ans) afin de permettre aux consommateurs d’anticiper leurs coûts et ils sont pour l’essentiel de type cost-plus (les péages suivent les coûts), même si une dose de price-cap (prix plafond) est introduite pour inciter les gestionnaires de réseaux à améliorer leurs performances 11.
Il faut noter que la France n’était pas au départ favorable au système de l’ATR et avait soutenu le principe de l’acheteur unique (AU). Elle défendait l’ouverture à la concurrence au niveau de la production mais voulait réserver au seul gestionnaire du réseau de transport (RTE) le droit d’acheter de l’électricité en mettant en concurrence tous les producteurs. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de transport (GRT) achète alors la quantité contractuelle négociée entre un vendeur et un client, et il la revend à l’acheteur au prix convenu. C’est lui qui se charge de mettre les producteurs en compétition pour acheter au mieux l’électricité nécessaire, d’autant qu’il dispose à chaque instant d’une bonne vision d’ensemble de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Avec l’ATR, ce gestionnaire se contente de s’assurer que les injections d’électricité correspondent bien aux soutirages et il doit simplement acheter un peu d’électricité pour compenser les pertes en ligne. Le 1er juin 1996, le conseil des ministres de l’Énergie de Luxembourg avait d’ailleurs entériné les deux systèmes (ATR et AU), chaque État membre étant libre de choisir son système, mais la France renonça à l’AU en raison des risques économiques que cela pouvait engendrer : un pays qui refuse l’ATR chez lui ne peut pas se prévaloir de l’ATR dans les autres pays et, du coup, cela risquait de limiter la conquête de marchés au-delà des frontières pour EDF.
Les consommateurs vont alors devenir progressivement éligibles, ce qui signifie qu’ils peuvent choisir leur fournisseur – l’opérateur historique, en l’occurrence EDF – ou un entrant – Engie, Direct Énergie, Enel… (actuellement au nombre de vingt-sept en France). Au début, seuls les gros consommateurs bénéficiaient de cette éligibilité, ensuite généralisée en juillet 2007 à tous les consommateurs européens. Le consommateur peut demeurer au tarif réglementé de vente (TRV) fixé par les pouvoirs publics et fourni par l’opérateur historique (EDF ou les ELD), ou opter pour un contrat en offre de marché (OM) soit chez l’opérateur historique, soit chez un concurrent. S’il abandonne le TRV, il ne pouvait plus à l’origine revenir à ce tarif mais cette mesure a ensuite été abolie et la réversibilité est aujourd’hui possible. Il faut noter que les TRV ont été abolis en 2016 pour les professionnels au tarif vert et jaune, et que seuls subsistent les tarifs bleus (consommateurs domestiques et petit secteur tertiaire comme on peut le constater sur le rapport de la CRE qui donne les statistiques sur les tarifs en vigueur)12.
La deuxième directive (« deuxième paquet ») a été adoptée au sommet de Lisbonne les 23 et 24 mars 2000. On décide alors d’accélérer le processus d’ouverture à la concurrence en abaissant le seuil d’éligibilité et, surtout, en imposant une séparation juridique des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture. Ainsi RTE et Électricité Réseau Distribution France (ERDF, aujourd’hui Enedis) deviennent des entreprises indépendantes d’EDF, même si ce sont à l’époque des filiales à 100% de l’opérateur historique.
La troisième directive (« troisième paquet »), connue sous le nom de « paquet énergie-climat », a été adoptée en 2009. Elle prévoit une séparation patrimoniale des réseaux, ce qui implique que l’opérateur historique ne peut plus détenir 100% du capital d’un réseau. Ce sera l’occasion de privatiser certains réseaux en Europe, mais la France refuse ce système et, par exception, bénéficiera du système de l’independent transmission operator (ITO) : l’opérateur historique peut conserver la propriété totale de son réseau de transport et en assurer la gestion, mais à condition de prouver que le gestionnaire de ce réseau est vraiment indépendant. Cela revient à signer une charte dite « de bonne conduite » et à vérifier, chaque année, que le GRT n’opère pas de discriminations entre les demandes d’accès. Il faut noter qu’en 2017 le capital de RTE a été ouvert pour 49,9% à la Caisse des dépôts, de sorte qu’EDF ne détient plus que 50,1% du capital du gestionnaire de transport. La question ne se pose pas pour le gestionnaire du réseau de distribution, puisqu’il est la propriété des collectivités locales. Il est également demandé de bien distinguer les logos des réseaux de ceux d’EDF et d’éviter la confusion des noms, ce qui conduira ERDF à changer de nom en 2016 et à devenir Enedis. D’autres mesures sont prévues par cette troisième directive, en particulier des mesures pour favoriser la pénétration des énergies renouvelables.
La concurrence est donc devenue la règle mais sa portée sera limitée par de nombreuses exceptions, dont certaines tiennent à la nature du produit et d’autres à des choix de politique énergétique. Encore faut-il savoir à quelle école de la concurrence on se rattache.
La concurrence au sens de l’école de Harvard ou de celle de Chicago ?
Voir Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, Énergie…, op. cit.
Pour la conception traditionnelle de la concurrence, c’est-à-dire celle de l’école de Harvard défendue par Chamberlin, Mason ou Bain, la concurrence suppose l’existence de nombreux producteurs et fournisseurs, ce qui implique de limiter autant que faire se peut toute position dominante. On utilise pour cela l’indice de Herfindahl-Hirschman (HHI, pour Herfindahl-Hirschman Index), qui revient à additionner le carré des parts de marché des producteurs présents sur le marché. Ainsi, en cas de monopole, le HHI s’élèvera à 10.000 (100²) ; avec dix fournisseurs détenant chacun 10% du marché, il sera égal à 1.000 (10 x 10²) ; avec 100 fournisseurs détenant chacun 1% du marché, il sera de 100, etc. On estime qu’un HHI inférieur à 2.000 est signe de concurrence et que plus on se rapproche de 10.000, moins cette concurrence existe. En France, le HHI est aujourd’hui encore au-delà de 7.000, contre moins de 2.000 au Royaume-Uni et en Allemagne13. Pour certains, dans quelques pays, il faut donc obliger l’opérateur historique à vendre une partie de ses actifs, ce qui a été le cas en Italie ou aux États-Unis, avec le Public Utility Holding Company Act (PUHCA) de 1935. La France a toujours refusé cette rétrocession de capacités, considérant que les actifs détenus par EDF étant pour l’essentiel des centrales nucléaires, ceux-ci ne pouvaient pas être cédés à d’autres opérateurs. Lorsque EDF a pris (provisoirement) le contrôle de EnBW, en Allemagne, la Commission européenne a demandé en contrepartie une cession d’actifs ; cette cession s’est faite sous la forme de virtual power plants (VPP) : EDF demeure propriétaire et gestionnaire des centrales, mais les kilowattheures produits par les 6.000 MW de puissance en cause (sur les 63.000 MW nucléaires détenus par l’entreprise) sont cédés sur le marché et ne peuvent pas être vendus de gré à gré par EDF. Pour cette conception de la concurrence il faut donc éviter les fusions d’entreprises et proscrire l’intégration verticale des activités. C’est donc bien la position dominante qui est condamnable.
Pour la conception « moderne » de la concurrence, celle défendue par Baumol et l’école de Chicago (Stigler, Posner ou Peltzman), ce qui compte ce n’est pas la position dominante mais l’abus de position dominante. Une entreprise peut fort bien être en position dominante parce qu’elle est plus performante que ses concurrentes, ce qui n’est pas en soi un délit. Ce qui est condamnable, c’est l’abus qui peut prendre trois formes : la prédation (vente à perte pour éviter l’entrée de concurrents dans la branche), la collusion (entente sur les prix ou partage du marché) et la forclusion (qui consiste à empêcher l’accès des concurrents à une infrastructure essentielle, un réseau notamment). Cela justifie donc de rendre les marchés « contestables », ce qui revient à supprimer les « barrières à l’entrée » dans la branche. L’important est que les entrants ne soient pas pénalisés par des barrières juridiques (monopoles d’importation- exportation, par exemple) ou par des barrières plus économiques (péages dissuasifs empêchant l’accès aux réseaux). Il faut donc dissocier les activités de production, transport, distribution et fourniture, empêcher l’intégration verticale des activités de réseaux et des activités concurrentielles, et créer une commission de régulation qui garantira un accès non discriminatoire en fixant les péages et en s’assurant qu’il n’y a pas de congestion artificielle sur les réseaux. Il faudra notamment vérifier que certains opérateurs ne réservent pas des capacités d’accès aux réseaux dans le seul but de bloquer l’entrée. D’où la règle UIOLI (use it or lose it) : une capacité réservée qui n’est pas utilisée doit être remise sur le marché. Le rôle de la commission de régulation, la CRE, qui en France a le statut d’autorité administrative indépendante, est donc primordial. Elle fixe les péages mais vérifie aussi que tout se passe bien en amont des réseaux (sur le marché de gros de l’électricité) et en aval (au niveau des consommateurs). En cas d’infraction, elle peut sanctionner (pénalités) ou saisir l’Autorité de la concurrence et, in fine, le juge. Ces péages sont en général de type « timbre-poste » (il est difficile de suivre l’électron sur le réseau du fait des fameuses lois de Kirchhoff, il n’est donc pas possible de fixer une tarification à la distance) et ils sont calculés essentiellement en fonction de la capacité souscrite en kilowatts (quelquefois aussi, pour la haute tension, en fonction de la capacité injectée) et partiellement en fonction du taux d’utilisation de cette capacité.
L’ouverture à la concurrence a toutefois été difficile à ses débuts, en France tout spécialement, à la fois parce que l’opérateur historique détenait (et détient encore) l’essentiel du marché mais aussi parce que les consommateurs français ne voyaient pas très bien ce qu’ils pouvaient gagner en changeant de fournisseur. Dans les pays où l’opérateur historique était controversé, comme au Royaume-Uni, les consommateurs ont profité de cette opportunité, même si c’étaient souvent les mêmes qui changeaient plusieurs fois. Le « nomadisme des clients » est-il pour autant un critère de bon fonctionnement de la libéralisation ? Rien n’est moins certain. L’important est que le consommateur puisse changer de fournisseur et pas nécessairement qu’il le fasse. En d’autres termes, la « menace crédible » suffit à rendre le fournisseur historique attentif aux attentes des clients et, de plus, la fidélité à son fournisseur n’est pas en soi répréhensible.
Début 2018, environ 15% des clients résidentiels avaient quitté EDF pour des fournisseurs alternatifs (ce qui représente à peu près 14% du volume de térawattheures consommés par le secteur résidentiel), contre 20% des clients non résidentiels (représentant tout de même près de 40% des térawattheures consommés par ce secteur, ce qui n’est pas négligeable). Le processus des départs s’accélère depuis quelques mois pour les particuliers et il est probable que la fin des TRV accentue le phénomène.
Mais bien d’autres raisons expliquent que, dans le secteur de l’électricité, l’ouverture à la concurrence ne soit pas facile à mettre en œuvre. En effet, la Commission européenne et les pouvoirs publics n’ont cessé de promulguer des exceptions à la règle du marché, même si c’est parfois pour de bonnes causes.
Les exceptions à la règle de la concurrence
Loi nº 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, Journal officiel, 8 décembre 2010. Voir aussi Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, Énergie…, op. cit.
Voir Rapport de la commission sur l’organisation du marché de l’électricité présidée Paul Champsaur, ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, avril 2009. ). L’auteur de la présente note était l’un des membres de la commission.
Cour des Comptes, Les Coûts de la filière électronucléaire, op. cit., p. 402, et id., Le Coût de production de l’électricité nucléaire. Actualisation 2014, communication à la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, mai 2014, p. 162
Voir Commission de régulation de l’énergie (CRE), Évaluation du dispositif ARENH entre 2011 et 2017, 18 janvier 2018.
Par nature, l’intégralité de la chaîne électrique ne peut pas être ouverte à la concurrence, comme on l’a rappelé plus haut, puisque les réseaux de transport et de distribution constituent des « monopoles naturels » qui doivent être régulés, qu’ils soient d’ailleurs publics ou privés. Le reste de la chaîne – la production en amont et la fourniture en aval – peut l’être, mais de nombreuses exceptions limitent de fait le rôle du marché.
Un consommateur domestique qui achète son électricité à EDF au tarif réglementé paie 0,17 €/kWh en moyenne en 2018, soit 170 €/MWh (en plus d’un abonnement fonction de la puissance souscrite) ; il s’agit d’une moyenne, car ce prix peut varier selon l’heure et la période (heures pleines, heures creuses d’été et d’hiver…). La structure de ce prix moyen est la suivante : 36% pour le coût à la sortie de la centrale (y compris les frais de commercialisation), 34% pour les taxes (dont la TVA et des taxes destinées à financer des missions de service public sur lesquelles nous reviendrons plus loin) et 30% pour les péages d’accès aux réseaux (10% pour le transport, 20% pour la distribution). En pratique, la concurrence ne peut donc porter que sur 36% du prix TTC, et cette concurrence concerne surtout les coûts de commercialisation, soit moins de 10% du total.
Les entrants peuvent certes construire des centrales à gaz à cycles combinés fournissant un kilowattheure compétitif avec le kilowattheure nucléaire produit par EDF, acheter des kilowattheures à EDF de gré à gré ou via le marché de gros de l’électricité, mais il leur sera difficile de concurrencer l’opérateur historique, sauf à rogner sur leurs marges ou proposer des services annexes valorisants. C’est d’autant plus vrai que le législateur a maintenu des TRV pour les petits consommateurs au tarif bleu. Les concurrents d’EDF ont d’ailleurs déposé une plainte pour obtenir leur suppression, comme le demande depuis longtemps la Commission européenne, mais le Conseil d’État a récemment validé ces TRV pour l’électricité, alors qu’il avait demandé leur suppression pour le gaz quelques mois plus tôt. Rappelons que tous les Français sont connectés au réseau d’électricité (32 millions de clients), ce qui n’est pas le cas du gaz distribué par gazoducs (10,5 millions de clients). C’est l’argument du service public et la protection du petit consommateur qui sont invoqués par l’exposé des motifs de la décision du Conseil d’État. C’est une garantie plus « psychologique » que réelle pour le petit consommateur, puisque certains tarifs proposés en « offre de marché » sont parfois inférieurs au TRV. Certes, les TPN ont disparu et ont été remplacés en 2018 par un « chèque énergie », mais c’est plus pour permettre à ceux qui se chauffent au fioul ou au bois d’en profiter que par souci de redonner un rôle au marché. Avec le TPN, le consommateur avait sans doute le sentiment d’être moins pauvre ; avec le « chèque énergie », il a sans doute celui d’être plus riche puisqu’il peut affecter ce chèque, comme il l’entend ou presque, à l’achat d’énergie, à l’acquisition d’équipements performants ou à des investissements d’isolation. Certains, du coup, craignent un « effet rebond » ou l’affectation de ce chèque à d’autres usages.
Mais c’est sans doute l’instauration du tarif réglementé et transitoire d’ajustement au marché (Tartam) et de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) qui a montré les limites d’une confiance aveugle dans les mécanismes du marché. Il a fallu réguler l’amont de la chaîne électrique pour assurer un minimum de concurrence en aval. Après la transposition de la directive de 1996 dans le droit français, les consommateurs éligibles (des industriels, pour l’essentiel, à l’époque) ont pu dès le 1er janvier 2000 abandonner le tarif réglementé (vert ou jaune) d’EDF et opter pour des prix « en offre de marché » auprès de producteurs ou fournisseurs alternatifs. À l’époque, le marché européen de l’électricité était en surcapacité et le prix du pétrole était bas (environ 20 dollars le baril). Dès lors, le prix du gaz, indexé sur le prix du pétrole, était lui aussi bas et l’électricité produite dans des centrales à gaz par ces fournisseurs alternatifs était relativement compétitive. Pour gagner des parts de marché, les entrants ont d’ailleurs « cassé » les prix. Les industriels qui avaient changé de fournisseur ne pouvaient que se féliciter de leur choix. Mais les choses ont changé à partir de 2004. Le prix du pétrole a commencé à monter, puis s’est s’envolé début 2008 (à plus de 100 dollars le baril) et, avec lui, le prix du gaz. L’électricité produite avec le gaz s’est donc mise à coûter davantage et les industriels qui avaient abandonné le TRV ont demandé à y revenir, ce qui est justement interdit par la directive. Sous la pression, le parlement français a modifié la loi et introduit un nouveau TRV, appelé Tartam, corrélé au TRV ancien, bien qu’à un niveau un peu supérieur. Ce tarif a été mis en place fin 2006 et a été prolongé jusqu’au 30 juin 2010. Cette décision a entraîné la fureur de la Commission européenne qui a engagé une procédure contre la France pour non-transposition des directives et pour aide d’État (EDF étant une entreprise publique, ce tarif, inférieur à l’époque au prix du marché de gros, était assimilable à une subvention).
Comment, dès lors, concilier des objectifs contradictoires : garantir la concurrence, permettre aux alternatifs de pouvoir rivaliser avec EDF alors que l’électricité thermique est plus coûteuse que l’électricité nucléaire, tout en permettant au consommateur français qui a financé ce programme nucléaire dans le passé d’en profiter aujourd’hui ? Si, en France, le prix de l’électricité doit suivre le prix du gaz, donc celui du pétrole, comme cela est le cas dans les autres pays européens, le choix nucléaire n’a plus de justification. Pour sortir de l’impasse, en 2009, le gouvernement français a mis en place une commission, présidée par Paul Champsaur et composée de quatre parlementaires et de quatre experts, avec comme objectif de faire des propositions permettant de mettre fin au Tartam. Ces propositions seront reprises dans la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (loi Nome) votée le 7 décembre 201014.
Comment permettre aux entrants qui ont accès à une électricité plus coûteuse que celle produite par l’opérateur historique de pouvoir faire des offres compétitives ? Deux solutions étaient possibles. La première était de pénaliser EDF en taxant l’entreprise d’un montant correspondant à la « rente nucléaire de rareté », calculée comme étant la différence entre le prix du kilowattheure sur le marché de gros (calé sur le coût d’une centrale thermique fonctionnant au gaz) et le coût réel du kilowattheure nucléaire alors largement amorti. La seconde était d’aider les entrants à acquérir de l’électricité nucléaire sur la base du coût réel dont bénéficiait alors EDF. Cela revient à mettre en place un système d’écluse : dans le premier cas, on hisse EDF au niveau du coût supporté par ses concurrents (le prix du marché) ; dans le second, on fait descendre les concurrents au niveau du coût supporté par EDF.
La commission Champsaur a opté pour la seconde solution mais en limitant cet accès au nucléaire historique à un montant « raisonnable » : 100 TWh sur les 400 TWh nucléaires produits annuellement (soit 25%). Chaque entrant qui le souhaite pouvait acheter de l’électricité nucléaire à ce tarif régulé sur la base du volume de consommation de ses clients. Le nucléaire historique devenait en quelque sorte une essential facility (« ressource essentielle ») que tous les fournisseurs devaient pouvoir acquérir15. À noter que la commission avait envisagé d’imposer le même mécanisme aux détenteurs de centrales hydrauliques au fil de l’eau qui, eux aussi, bénéficiaient d’un avantage comparatif en termes de coût. Mais les pouvoirs publics ont estimé que la mise aux enchères prochaine des concessions hydrauliques devait régler la question et rétablir la concurrence entre tous les producteurs. C’est comme cela que l’accès régulé à la base (ARB) est devenu l’ARENH, s’appliquant aux 58 réacteurs en fonctionnement (cela ne concerne pas l’EPR de Flamanville). Notons que la mise aux enchères des concessions hydrauliques n’a toujours pas été faite à ce jour. Les pouvoirs publics, après consultation de la commission Champsaur, ont choisi un niveau d’ARENH de 40 €/MWh (soit 0,40 €/kWh), pour son entrée en vigueur en juillet 2011 (chiffre valable jusqu’à fin décembre 2011), et ont décidé que le niveau serait de 42 €/MWh à compter de janvier 2012, chiffre toujours en vigueur en 2018. La commission Champsaur avait recommandé le chiffre de 39 €/MWh, mais cette proposition a été faite au moment de Fukushima et les pouvoirs publics ont estimé qu’EDF devrait procéder à des investissements supplémentaires de sûreté qui justifiaient un prix un peu supérieur. Le coût réel auquel le mégawattheure nucléaire revenait à EDF à cette période était par nature inférieur au coût moyen du mégawattheure nucléaire sur l’ensemble de la durée de vie des centrales, puisqu’une partie des investissements supportés avait déjà été récupérée par l’opérateur via le prix de vente de l’électricité. Le nucléaire historique était largement amorti à cette date et ce coût était donc sensiblement inférieur au coût moyen retenu dans les rapports de la Cour des comptes de 2012 et 2014 (entre 49,5 et 59,8 €/MWh si l’on se réfère au coût économique courant retenu par la Cour des Comptes dans ses rapports de 2012 et 2014)16.
Mais ce que ni la commission Champsaur ni les pouvoirs publics n’avaient envisagé, c’est que le prix du marché de gros pourrait tomber au-dessous du niveau de l’ARENH, ce qui a pourtant été le cas plusieurs fois entre 2012 et 2018, en 2016 tout particulièrement (nous reviendrons plus loin sur les raisons de cette baisse des prix de gros de l’électricité sur le marché européen). La souscription d’ARENH par les concurrents d’EDF n’a jamais dépassé le plafond de 100 TWh, même si elle s’en est rapprochée. Cette demande est corrélée au prix du pétrole et, par ricochet, à celui du gaz et à celui du charbon : si leur prix augmente, l’électricité thermique coûte plus cher et la demande d’ARENH augmente ; à l’inverse, cette demande s’effondre quand le prix de l’électricité thermique diminue. Certains se demandent d’ailleurs s’il ne faudrait pas abolir ce mécanisme17, comme l’a recommandé la Cour des comptes, mais les entrants souhaitent conserver cette assurance, d’autant qu’une augmentation prévisible des prix du CO² sur le marché européen des quotas devrait renchérir à terme le coût de l’électricité thermique.
On notera qu’à 42€/MWh, l’opérateur historique n’est pas perdant puisque sur la base d’un « coût cash » annoncé de 33 euros, cela lui procure une marge de 9€/MWh nucléaire, soit 0,90€/kWh. Il est normal que l’ARENH incorpore un taux de rentabilité du capital investi. Le « coût cash » est le prix de revient du mégawattheure nucléaire aujourd’hui, compte tenu des amortissements déjà récupérés.
Une autre exception de taille à la logique du marché sera introduite partout en Europe suite à l’adoption de la troisième directive européenne : l’instauration de prix d’achat garantis en faveur des énergies renouvelables. Ces prix régulés vont fortement perturber l’équilibre sur les marchés de gros de l’électricité.
La « vague verte », une option coûteuse qui perturbe le marché
Voir Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, Énergie…, cit. p. 82.
Loi nº 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Journal officiel, 18 août 2015, art. L.100-4
Après la « vague du marché », l’Union européenne a été submergée par la « vague verte ». La troisième directive de 2009, connue sous le nom du « paquet énergie-climat », avait fixé des objectifs ambitieux à chacun des pays membres à l’horizon 2020, les « trois fois 20 » : 20% d’efficacité énergétique du PIB par rapport à 1990, 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique. Un marché du carbone, l’European Union Emission Trading Scheme (EU ETS), a été mis en place en 2005, sur lequel les électriciens et quelques gros industriels peuvent s’échanger les quotas de CO² qui leur ont été attribués gratuitement. Les industriels vertueux peuvent vendre leurs quotas excédentaires, les autres peuvent acheter le montant de CO² qui leur fait défaut. Mais l’attribution laxiste de quotas gratuits, dans un contexte où la croissance économique s’est ralentie, a limité l’efficacité du dispositif et le prix de la tonne de CO², après avoir frôlé 30 euros à ses débuts, s’est effondré à moins de 10 euros (5 à 7 euros jusqu’en 2017). C’est seulement début 2018, après l’annonce d’un plan de retrait d’une partie des quotas disponibles, que le prix s’est un peu redressé (13 à 15 euros la tonne), mais cela reste insuffisant pour pénaliser fortement les énergies fossiles (le charbon, principalement), dominantes dans le mix électrique européen.
À cela s’ajoute le fait qu’après 2010 les prix du pétrole et du gaz naturel ont eu tendance à baisser, dans un contexte de surcapacité mondiale dû largement à l’envolée de la production de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis, entraînant avec elle la baisse des prix du charbon. Le gaz de schiste a eu tendance à remplacer le charbon dans la production électrique aux États- Unis, et le charbon américain qui ne trouvait plus de débouché sur place a eu tendance à être exporté à bas prix dans le reste du monde, en Europe notamment, où il a remplacé le gaz dans la production d’électricité (ce fut particulièrement vrai en Allemagne).
Comme on ne pouvait pas trop compter sur le prix du carbone pour pénaliser les sources fossiles, on avait deux solutions alternatives pour accélérer la pénétration des renouvelables (hydraulique, éolien, solaire, biogaz) : soit aider massivement la recherche-développement pour rendre ces énergies compétitives, soit les imposer en priorité sur le réseau en faisant fi des règles du marché que l’on avait pourtant voulu promouvoir comme seule « doxa libérale »18. C’est la seconde solution qui a été retenue car elle paraissait plus efficace rapidement. On a donc mis en place un peu partout en Europe le mécanisme des prix garantis, avec obligation d’achat (feed-in tariffs, FIT). Les objectifs de développement des renouvelables ont été réitérés en France dans la loi de transition énergétique pour une croissance verte votée en 2015 : la part des renouvelables doit être portée à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de cette consommation en 203019. Pour ce faire, il faut 40% d’énergies renouvelables au niveau de la production d’électricité en 2030, contre 20% environ en 2018 (sachant que l’hydraulique représente aujourd’hui 12 à 13% et les autres renouvelables 7 à 8% seulement). Ce sont des objectifs très ambitieux, probablement trop disent certains analystes…
Le mécanisme des prix garantis avec obligation d’achat
Cour des Comptes, Le Soutien aux énergies renouvelables, communication à la commission des finances du Sénat, mars 2018, p. 46.
Voir Commission de régulation de l’énergie (CRE), Évaluation du dispositif ARENH…, cit.
Voir Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois, Énergie…, cit., p. 512-518.
En France s’est donc mise en place une politique du « guichet ouvert » : EDF et les ELD ont l’obligation d’acheter à un prix fixé par arrêté ministériel (et après avis de la CRE) l’électricité renouvelable produite par ceux qui en font la demande. Le prix est différencié selon les technologies (très rémunérateur pour le solaire photovoltaïque et l’éolien) et le contrat d’achat est conclu pour une longue période (de quinze à vingt ans en général). Ce prix est stable sur la période où il décroît parfois au-delà de dix ans. Ce système donne une garantie de revenus au producteur d’électricité renouvelable mais il présente un inconvénient majeur : il est difficile d’anticiper la quantité d’électricité qui sera injectée sur le réseau. Le surcoût que représente ce prix garanti par rapport au prix de l’électricité sur le marché de gros est souvent très important, les énergies renouvelables étant mises sur le marché avant d’avoir atteint leur seuil de compétitivité, et il n’y a aucune raison que ce surcoût soit supporté par l’opérateur historique aujourd’hui en concurrence (EDF et les ELD). Il est donc mutualisé sur l’ensemble des consommateurs d’électricité via une taxe, la contribution au service public de l’électricité (CSPE), laquelle sert aussi à financer d’autres missions de service public comme la péréquation spatiale des tarifs ou l’aide à la précarité énergétique. Ce système, a priori vertueux, se révèle à l’usage coûteux et générateur d’effets pervers sur le marché de gros.
À titre d’exemple, le dernier tarif d’obligation d’achat publié pour l’éolien terrestre en juin 2014 prévoyait un contrat de quinze ans avec une rémunération de 82€/MWh sur les dix premières années, puis un tarif variable selon le nombre d’heures de fonctionnement sur les cinq années suivantes, alors qu’à cette époque le prix de gros de l’électricité se négociait aux alentours de 40€/MWh en moyenne. Ce tarif a été abrogé fin 2016 avec l’entrée en vigueur d’un nouveau système. Mais le tarif d’achat a été encore plus rémunérateur pour le solaire (on a atteint les 600€/MWh) et cela procure des rentes excessives aux producteurs (grandes surfaces, agriculteurs et même producteurs d’électricité conventionnelle comme EDF ou Engie) dans un contexte où les coûts des renouvelables sont plutôt orientés à la baisse du fait des économies d’échelle importantes observées dans le secteur (en Chine spécialement, pays qui produit l’essentiel des cellules photovoltaïques). La Cour des comptes s’en est fait l’écho dans un rapport publié en mars 2018 : le surcoût lié à ce mécanisme de FIT est de l’ordre de 4,9 milliards d’euros en 2018 et le cumul des engagements liés aux seuls contrats déjà signés devrait se monter à 121 milliards d’euros sur la période 2018-2045, avec un pic de plus de 7 milliards d’euros en 202520. On ne parle ici que du surcoût, c’est-à-dire de la taxe qui est supportée par le consommateur final et qui correspond à la différence entre le FIT et le prix spot du kilowattheure. En Allemagne, où les tarifs d’achat sont encore plus rémunérateurs, le surcoût payé par le consommateur domestique pour financer les renouvelables s’est élevé à 25 milliards d’euros en 2017, ce qui explique que le prix TTC du kilowattheure allemand (0,29 euro) est très supérieur au prix du kilowattheure français (0,17 euro).
Un autre effet pervers, non anticipé, doit également être signalé : l’apparition de prix négatifs sur le marché spot. Toute l’électricité produite ne passe pas par le marché de gros (marché spot). L’ouverture à la concurrence nécessite la mise en place d’un marché de gros dans la mesure où certains opérateurs perdent des clients et se retrouvent avec un excédent potentiel de production, tandis que d’autres opérateurs cherchent à acquérir des kilowattheures pour alimenter leurs nouveaux clients. On a donc mis en place un marché de gros où s’échange de l’électricité, heure par heure durant les 365 jours de l’année21. C’est un marché facultatif et une grande partie des échanges se fait hors marché via des contrats bilatéraux (over the counter, ou OTC) qui lient producteurs et fournisseurs. Le marché de gros ne représente que 30 à 40% de la production selon les pays européens, mais il s’agit d’un marché directeur car les contrats en « offre de marché » prévoient en général une indexation sur le prix spot (moyenne lissée). De plus, ces marchés sont interconnectés au sein de l’Union européenne, ce qui permet une relative convergence des prix de gros, hors situation de congestion aux frontières.
Notons que si l’on a pu observer une certaine convergence des prix de gros entre la France, l’Allemagne et le Benelux, zone dans laquelle les congestions sont faibles (à la différence des interconnexions avec l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni qui connaissent des congestions récurrentes), la convergence des prix TTC n’est pas la règle en Europe, puisqu’une partie importante (60 à 70%) du prix payé par le consommateur final est le fait de péages régulés d’accès aux réseaux et de taxes, et que ces péages, comme ces taxes, varient selon les pays. Sur le marché de gros, le prix d’équilibre se fixe heure par heure selon la loi de l’offre et de la demande, en respectant la logique du merit order : on appelle les centrales par ordre de coût marginal (c’est-à-dire de coût variable) croissant. Quand une centrale nucléaire est la centrale marginale, qui fait le prix sur le marché, elle récupère ses seuls coûts variables ; quand cette centrale nucléaire est inframarginale et que la centrale marginale qui fait le prix est une centrale à gaz dont le coût variable est plus élevé, la centrale nucléaire bénéficie d’une rente (mark-up) qui lui permet de financer ses coûts fixes. Ce système ne fonctionne que si le parc est optimal et, bien évidemment, il faut trouver un moyen de financer les coûts fixes de la dernière centrale marginale, la plus coûteuse, qui n’est appelée qu’aux heures les plus chargées de l’année. En période de tensions offre-demande, le prix spot peut s’envoler, ce qui assure le financement de ces installations22.
Des prix négatifs pour l’électricité
Voir Jacques Percebois, « Aides publiques aux énergies éolienne et photovoltaïque », Revue française d’économie, nº 4, avril 2015, 141-186.
Voir Cour des comptes, « L’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence : une construction inaboutie », in Rapport public annuel 2015, tome 1, vol. 1, février 2015, p. 165-223
Voir Jacques Percebois et Stanislas Pommeret, « Cross-subsidies tied to the introduction of intermittent renewable An analysis based on a model of the French day-ahead market », The Energy Journal, vol. 39, nº 3, mai 2018, p. 245-268.
Voir Cour des comptes, « L’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence… », cit.
L’injection massive d’énergies renouvelables (solaire et éolien) payées hors marché par le mécanisme du FIT a eu pour effet partout en Europe, notamment en Allemagne et, par contrecoup, dans les pays limitrophes en raison des interconnexions, de faire chuter les prix de gros dans un contexte où le marché était déjà en surcapacité (en base du moins), d’autant que la demande d’électricité demeure atone depuis plusieurs années. Certes, ces énergies renouvelables bénéficient d’un coût marginal nul ou quasi nul et elles seraient de toute façon appelées en priorité, mais elles ne pourraient pas récupérer leurs coûts fixes si elles devaient compter sur le seul prix du marché car leur facteur de charge est trop faible (le solaire ne fonctionne que 20% du temps et l’éolien, au mieux, 30% du temps en Europe) et, de plus, ces énergies ne sont pas ou rarement appelées lorsque les prix du marché sont rémunérateurs (le soir en hiver, en particulier). La conjonction de plusieurs facteurs (faible demande, surinvestissement dans les centrales à cycles combinés à gaz, injection d’énergies renouvelables intermittentes payées hors marché) a déstabilisé le marché de gros : les prix se sont effondrés et on a même observé des prix négatifs dans certaines périodes. Comme l’électricité ne se stocke pas, il faut que la quantité soutirée soit égale à la quantité injectée, et il a fallu payer des clients pour qu’ils débarrassent le marché de ce produit devenu encombrant : ce sont en général des opérateurs suisses qui, disposant de stations de pompage, peuvent utiliser de l’électricité pour pomper de l’eau à certaines heures et la turbiner quand c’est nécessaire.
On notera que plus on injecte des renouvelables, plus le prix du kilowattheure diminue sur le marché de gros et plus le différentiel entre le prix garanti (FIT) et ce prix de gros augmente. De fait, le surcoût des renouvelables s’accroît et la CSPE avec lui23. Il y a donc une contradiction à vouloir faire confiance au marché et à lui imposer en même temps des règles qui altèrent trop sa logique, même si c’est pour la bonne cause (protection de l’environnement). Notons que la surcapacité moyenne en période dite « de base » (heures creuses ou pleines) n’exclut pas des risques de black out aux heures les plus chargées de l’année, d’autant que les énergies renouvelables ne seront souvent pas disponibles alors. Le gestionnaire de réseau (RTE) doit s’assurer que la puissance disponible sera suffisante pour passer la pointe. L’erreur, avec les prix garantis, a été de ne pas chercher à contrôler les volumes injectés sur le réseau. Notons aussi qu’on ne peut pas imputer aux seules énergies renouvelables la responsabilité de ces prix négatifs. Mais, dans un contexte de surcapacité de l’offre, toute injection additionnelle d’électricité a un fort impact à la baisse sur le prix d’équilibre24.
On a observé avec l’électricité le même effet pervers que celui observé il y a quelques années avec la Politique agricole commune (Pac), qui avait instauré des prix garantis rémunérateurs et déconnectés du marché mondial pour les produits agricoles européens mais sans contrôle des volumes mis sur le marché. Les surplus agricoles avaient coûté cher en subventions à l’exportation et en stockage (les fameuses montagnes de beurre). L’électricité, à la différence des produits agricoles, ne se stocke pas, et il faut donc payer des clients pour qu’ils épongent instantanément le surplus. Lorsque la production d’artichauts est excessive, certains producteurs bretons détruisent une partie de la récolte pour limiter la chute des cours. On fait la même chose avec l’électricité : c’est une destruction « économique » car ces kilowattheures n’ont aucune valeur et il faut vendre à perte le trop-plein. Ces prix négatifs ont d’abord été observés en Allemagne (prix à moins de 500€/MWh dès 2009), mais cela a également été le cas en France pendant certaines périodes. Rappelons que le marché de gros est lui aussi partiellement régulé, car le prix d’équilibre ne peut pas tomber sous les 500€/MWh, ni dépasser 3.000€/MWh (les transactions sont alors arrêtées). Cette baisse des prix de gros a engendré des « coûts échoués » pour les opérateurs qui détiennent des centrales conventionnelles (nucléaires ou thermiques) et qui sont doublement pénalisés : l’électricité conventionnelle est partiellement évincée par les renouvelables qui, de facto, sont prioritaires (coût marginal nul oblige) et l’électricité conventionnelle vendue l’est à un prix plus faible qu’avant cette injection25.
Les centrales classiques (nucléaires et thermiques au gaz ou au charbon, voire les quelques centrales fonctionnant encore au fioul) ne pouvant plus récupérer les recettes nécessaires à la couverture de leurs coûts fixes, il a fallu mettre en place partout en Europe un « marché de capacité », entré en vigueur en 2017, afin de financer ces coûts fixes et s’assurer qu’il n’y aurait pas de black out aux heures de pointe. Comme le marché energy only ne permet plus d’amortir tous les investissements via la vente de kilowattheures, il faut un marché supplémentaire pour financer la capacité installée en kilowatts. C’est la double peine pour le consommateur, qui doit à la fois payer pour les énergies renouvelables qui font baisser les prix de gros du kilowattheure et pour financer les investissements des centrales à cause de cette baisse de prix. Des réformes sont donc nécessaires26.
Les réformes en cours
Voir Jacques Percebois, « Aides publiques aux énergies éolienne… », cit.
Voir International Renewable Energy Agency (Irena), European Commission, Renewable energy prospects for the European Union, février 2018.
Observatoire de l’industrie électrique (OIE), « Prix de l’électricité en France : les clés pour mieux comprendre », note de conjoncture, juin 2018, p. 4.
Ces réformes ont porté sur deux domaines : le mécanisme de soutien aux renouvelables et les modalités de financement du surcoût. À la demande de la Commission européenne, les pays membres tendent à remplacer le système des feed-in tariffs (FIT) par un système de feed-in premium (FIP) : les producteurs d’électricité renouvelable vendent leur énergie sur le marché de gros et encaissent le prix d’équilibre qui varie fortement selon l’heure et le jour en fonction de la loi de l’offre et de la demande. Mais ils perçoivent en plus un «complément de rémunération» (une prime) qui est soit fixé par les pouvoirs publics pour les petites installations, soit déterminé par enchères pour les grandes installations. Si la différence entre un «tarif dit de référence» fixé par les pouvoirs publics et le prix du marché de gros est positive, ils perçoivent la prime ; si cette différence est négative, ils doivent reverser le surplus perçu. Notons que les opérateurs qui bénéficient du mécanisme FIT peuvent y renoncer pour bénéficier du nouveau système.
La Commission européenne demande que dorénavant seules les installations de moins de 500 kW bénéficient d’un soutien de type FIT, les autres devant passer au système FIP avec ou sans appels d’offres pour déterminer le montant de la prime. Ce système FIP est très proche du système dit des contrats pour différences (contracts for differences, ou CFD) adopté au Royaume-Uni en faveur de la centrale nucléaire de Hinkley Point : le gouvernement britannique garantit une rémunération minimale à l’opérateur sur une très longue période. Si le prix du marché spot est insuffisant pour rentabiliser l’investissement, l’opérateur (EDF est son partenaire chinois) recevra une subvention publique ; si le prix est supérieur à l’objectif, l’opérateur versera le surplus au gouvernement. La différence c’est qu’avec ce système c’est le contribuable qui supporte la charge éventuelle du manque à gagner, alors qu’avec le FIP c’est le consommateur final d’énergie27. L’incertitude sur le niveau du prix de gros et le niveau variable et souvent révisable du montant de la prime incitent les opérateurs à plus de prudence et de sélectivité dans leurs choix d’investissements en faveur des renouvelables.
D’autres solutions sont également encouragées, en particulier l’autoconsommation individuelle ou collective pour les installations solaires. La chute des coûts du photovoltaïque permet dans certains cas d’être au niveau de la « parité réseau » : le coût de revient du kilowattheure solaire est alors inférieur ou au plus égal au coût de soutirage d’un kilowattheure du réseau, lequel comprend, outre le coût du kilowattheure à la sortie de la centrale, le coût d’acheminement par le réseau et les taxes assises sur le produit (TVA et CSPE). Mais, dans les pays tempérés comme la France, il est difficile pour un autoproducteur d’être autonome aujourd’hui en l’absence d’un système de stockage, du fait du faible facteur de disponibilité du solaire. Ce consommateur doit donc rester connecté au réseau, ce qui soulève un autre problème. Comme les péages d’accès aux réseaux sont largement fixés en fonction du volume de kilowattheures soutirés, ce consommateur participe peu au financement des coûts fixes du réseau (il se comporte un peu comme un « passager clandestin ») et il faut revoir la tarification d’accès aux réseaux en augmentant la part fixe du tarif (fonction de la puissance souscrite en kilowattheures) et en réduisant corrélativement la part variable (fonction du volume de kilowattheures soutirés). C’est en tout cas une demande d’Enedis, qui pour l’instant n’a pas été retenue mais qui s’avère nécessaire.
La meilleure solution serait évidemment de pouvoir stocker et déstocker l’électricité. À court terme, cela peut se faire avec des batteries pour le stockage journalier ou hebdomadaire ; à plus long terme, pour le stockage intersaisonnier, il faudrait recourir au power-to-gas et au gas-to-power : on fait l’électrolyse de l’eau avec l’électricité excédentaire pour obtenir de l’hydrogène et on utilise cet hydrogène dans des piles à combustibles pour produire de l’électricité. On peut aussi, en y associant du dioxyde carbone, produire du méthane et l’utiliser ensuite pour produire de l’électricité. Mais les coûts actuels des batteries et des électrolyseurs, compte tenu de leurs faibles rendements, sont encore prohibitifs, bien que des progrès sensibles aient été réalisés, surtout pour les batteries. Dans un futur proche, le développement des véhicules électriques devrait d’ailleurs favoriser cette solution28.
L’autre réforme porte sur les modalités de financement du surcoût des énergies renouvelables. Les pouvoirs publics vont chercher, d’une part, à stabiliser le niveau de la CSPE (TICFE, taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité) et, d’autre part, à appliquer à la lettre le principe du pollueur- payeur. Les charges liées à l’obligation d’achat des énergies renouvelables sont depuis 2016 financées par un compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS-TE), qui constitue une exception au principe de la non-affectation des recettes publiques. Au départ, ce CAS-TE était financé par la CSPE et supportée par les consommateurs d’électricité, comme cela a été indiqué précédemment, et accessoirement par la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), payée par les consommateurs de gaz. Le gouvernement a plafonné la CSPE à son niveau de 2016, soit 22€/MWh, et cette taxe alimente dorénavant le budget général de l’État. La loi de finances de 2017 prévoit que le CAS-TE sera dorénavant financé par la taxe intérieure sur les houilles, lignites et cokes (TICC), dont le niveau est modeste, et par la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) qui est assise pour l’essentiel sur la consommation de produits pétroliers et dont le montant est, lui, beaucoup plus élevé (une fraction d’environ 53% de cette taxe est affectée au soutien des énergies renouvelables). Les autres missions de service public (péréquation spatiale des tarifs et « chèque énergie », dont le coût est modeste) sont financées par le budget général. C’est le même système en 2018.
Ce sont donc principalement les consommateurs d’essence et de gazole qui financent dorénavant le surcoût des énergies renouvelables, ce qui semble plus logique et plus moral. Les pollueurs paient pour la promotion des énergies vertes. À terme, la consommation de produits pétroliers devrait baisser mais les aides aux énergies renouvelables devraient elles aussi être revues à la baisse avec le nouveau système de soutien. On notera que la CSPE (TICFE) n’a pas disparu pour autant, même si elle est plafonnée, et que les consommateurs d’électricité demeurent assez fortement taxés ; la seule différence est que cette taxe n’est plus affectée.
Une étude récente de l’Observatoire de l’industrie électrique (OIE) montre, en s’appuyant sur des données d’Eurostat, que le consommateur domestique français ne bénéficie plus des prix de l’électricité les plus bas d’Europe (il se situe dans la moyenne) et cela est largement dû à l’augmentation des taxes, plus élevées aujourd’hui en France, en Allemagne, en Belgique ou en Italie qu’en Europe du Nord ou que dans les pays de l’est européen : ainsi, en France, entre 2012 et 2016, « alors que le coût de fourniture d’électricité augmentait de 2% et que celui d’acheminement de l’énergie [péages sur les réseaux] de 5% en 4 ans, la fiscalité connaissait une croissance de plus de 40%29 ». Il est important de ne pas confondre le coût de production du kilowattheure à la sortie de la centrale, qui demeure bas en France grâce au nucléaire, avec le prix TTC payé par le consommateur final, qui s’envole à cause des taxes.
Les incertitudes technologiques et sociétales
Voir International Energy Agency (IEA), « World Energy Outlook 2017 », iea.org
Le contexte qui avait présidé à l’ouverture à la concurrence a fortement changé en vingt ans30. Dire ce que sera le panorama du secteur de l’électricité en Europe dans les prochaines années est difficile tant les incertitudes sont nombreuses, qu’elles soient technologiques, économiques ou institutionnelles. Cependant, vu les délais nécessaires pour construire et financer les infrastructures, des décisions doivent être prises aujourd’hui qui engageront le long terme. Ce sont les enjeux du débat en cours sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Incertitudes économiques
La principale incertitude porte sur l’évolution attendue de la demande d’électricité. La loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 a notamment pour objectif de « réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 201231 ». Cela suppose d’accroître fortement l’efficacité énergétique dans tous les secteurs, d’autant que la population française va continuer à croître et que le PIB devrait lui aussi augmenter. La consommation de produits pétroliers et de gaz naturel devrait baisser, mais qu’en sera-t-il pour l’électricité ? L’efficacité énergétique du secteur ne sera-t-elle pas compensée et au-delà par l’apparition de nouveaux usages, notamment au niveau des applications numériques (informatique, intelligence artificielle…) et de la mobilité électrique ? Certes, en France et en Europe, la demande d’électricité est remarquablement stable depuis 2011, mais cela va-t-il durer ? Le numérique envahit tout et il est fortement consommateur d’électricité (cas, par exemple, des data centers qui gèrent les bases de données). On estime à 56,5 TWh la consommation d’électricité liée aux usages du numérique en France (chiffre de 2015), soit environ 12% de la consommation totale d’électricité, et cette part devrait s’établir à 25% en 2030. Si la demande d’électricité baisse, il faudra organiser la « régression » de certaines activités, notamment la fermeture programmée de centrales nucléaires et il s’agit là d’un enjeu important. La France a connu la « régression » des mines de charbon au début des années 1960, à un moment où le pétrole bon marché coulait à flots, mais ce fut difficile socialement. Rappelons qu’il a fallu attendre quarante ans pour que ferme la dernière mine de charbon en France (La Houve, en 2004). Si la demande d’électricité s’envole, on pourra atteindre 50% de nucléaire dans le mix électrique sans fermer de centrales ou simplement en ne prolongeant pas l’activité de certaines d’entre elles au-delà de quarante ans.
À l’échelle mondiale, en 2017, l’électricité a mobilisé plus d’investissements que le pétrole et le gaz réunis (750 milliards de dollars contre 716), particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables, et cela s’explique, pour partie, par l’électrification rurale dans les pays en développement et, pour partie, par une « électrification » croissante des usages sur tous les continents32. L’hypothèse d’un développement soutenu des usages électriques semble aujourd’hui la plus probable en Europe comme en France.
La concurrence entre fournisseurs d’électricité devrait s’intensifier et les opérateurs historiques, comme EDF en France, Eon ou RWE en Allemagne, devront batailler sur deux fronts : d’une part, les concurrents déjà présents dans l’énergie comme Total ou ENI, pétroliers qui anticipent la fin lointaine du pétrole et veulent se positionner dans l’électricité ; d’autre part, les concurrents du numérique comme les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), qui voient dans l’électricité un vecteur idéal pour leurs applications numériques. Peut-être faut-il aussi tenir compte des BATX chinois (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) qui, demain, pourront concurrencer les GAFA. De nouvelles fusions-acquisitions, comme celle, récente, du rachat de Direct Énergie par Total, sont donc probables et le secteur de l’électricité pourrait dans un futur proche présenter une physionomie bien différente de celle d’aujourd’hui. Peut-on envisager une cartellisation du secteur, là où les ambitions étaient de promouvoir la concurrence ? Auquel cas, un oligopole privé se substituerait à terme à un monopole public. Le consommateur final n’en sortirait pas gagnant.
Par ailleurs, quel sera demain le poids de la Chine dans la fourniture des grands équipements énergétiques (cellules photovoltaïques, mais aussi batteries, centrales nucléaires, compteurs intelligents) ? L’Europe doit se coaliser si elle veut résister à la concurrence chinoise et éviter, comme cela a déjà été le cas dans le solaire et l’éolien, des fermetures de pans entiers de son industrie. C’est particulièrement vrai dans le secteur porteur des batteries. Une sorte de « programme Airbus » des batteries permettrait sans doute de faire obstacle à la concurrence souvent déloyale de la Chine, qui n’hésite pas à faire du dumping pour exporter ses produits.
De nouvelles contraintes sont-elles à prévoir au niveau de l’accès à des matières premières stratégiques comme certains métaux rares ou certaines «terres rares», indispensables au développement des nouvelles technologies de l’information qui envahissent aujourd’hui la filière électrique (compteurs et réseaux intelligents, notamment) ? La révolution numérique va entraîner un besoin croissant de matières premières, comme le lithium, et de « terres rares », dont la production est aujourd’hui contrôlée à 80% par la Chine33. Cela pourrait renchérir le coût de certaines applications et, là encore, la Chine est incontournable puisqu’elle détient une part élevée de certaines de ces ressources. Les « terres rares » sont un ensemble de dix-sept éléments rares indispensables pour la fabrication des ampoules basse consommation, des véhicules électriques et hybrides, des piles à combustible, des aimants nécessaires aux éoliennes mais aussi des écrans plats ou des téléphones portables. Certes, on peut en trouver un peu partout dans le monde si on en cherche mais il faudra y mettre le prix. Actuellement, c’est la Chine qui monopolise leur production. D’autres produits comme le cuivre ou le cobalt sont également stratégiques et leurs réserves sont parfois géographiquement concentrées. C’est le cas du cobalt, dont l’essentiel des réserves mondiales se situe au Congo.
Incertitudes technologiques
Il est toujours difficile d’anticiper les évolutions, voire les ruptures technologiques. Anticiper ce que sera 2050 est aussi périlleux que d’anticiper la situation de 2018 au moment du deuxième choc pétrolier (1979). Parmi les ruptures technologiques qui risquent de bouleverser le paysage, on peut cependant évoquer la mise au point de batteries performantes et bon marché, l’amélioration sensible des rendements du power-to-gas ou le développement à grande échelle de la capture et du stockage du carbone (CCS) qui pourrait donner une seconde vie à certaines centrales au charbon. Indiscutablement, c’est le stockage de l’électricité à grande échelle et dans des conditions économiques qui est le progrès majeur attendu puisqu’il devrait permettre de recourir plus aisément aux énergies renouvelables intermittentes. Mais le nucléaire n’est pas en reste et il y a dans les cartons beaucoup de projets – EPR « nouveau », de plus faible taille, mais aussi SMR (small modular reactors). On peut aussi parler des réacteurs nucléaires dits de « quatrième génération », du type surgénérateurs, qui permettraient de mieux valoriser le combustible uranium et rendraient la France totalement autonome en combustible. Ces réacteurs ont également le mérite de pouvoir mieux utiliser le plutonium et de transmuter une partie des déchets nucléaires (certains actinides mineurs comme l’américium), et donc de limiter certaines contraintes au niveau du stockage de ces déchets à haute activité. Tous les grands pays nucléaires, la Chine, la Russie, le Japon, les États- Unis et la France (avec le projet Astrid) s’intéressent à cette technologie. À terme, il y a bien sûr aussi le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (International Thermonuclear Experimental Reactor, ou ITER) mais en l’état actuel des choses c’est encore une option très incertaine car il subsiste encore de nombreux goulots d’étranglement scientifiques.
Incertitudes institutionnelles
La libéralisation du secteur de l’électricité s’est opérée de façon pragmatique en Europe, même si au départ a existé un certain dogmatisme pour justifier le recours au marché. Mais il a fallu compter avec des situations nationales très contrastées au niveau des mix électriques, et l’équilibre entre ce qui relève du marché et ce qui est du domaine de l’interventionnisme public est loin d’être figé. Il y a certes un consensus pour dire que demain l’électricité sera de plus en plus « décarbonée », digitalisée et décentralisée, mais chacun a parfaitement conscience que le marché ne peut pas seul organiser le « design » et la gouvernance d’une activité aussi complexe sur le plan technique et aussi stratégique pour la société. Les pouvoirs publics doivent intervenir pour fixer les grandes orientations nationales et réguler les activités qui doivent l’être, tels les monopoles naturels. Deux questions majeures restent ouvertes aujourd’hui : quel doit être le partage des compétences entre l’État et les collectivités locales ? Et quel doit être le contour du secteur régulé ? La frontière entre ce qui relève du marché et ce qui relève de la régulation peut-elle être fixée ne varietur ?
Décentraliser mais jusqu’où ?
Certaines collectivités locales, les Régions notamment, considèrent que certains choix énergétiques sont de leur compétence, et pas seulement au niveau de l’efficacité énergétique des bâtiments ou de la politique des transports régionaux et urbains. Elles entendent favoriser le développement de telle ou telle source d’énergie (le solaire, la biomasse ou l’éolien, le plus souvent) et, pourquoi pas, atteindre à terme leur « indépendance énergétique ». C’est le cas de la Région Occitanie qui souhaite devenir la première région française « à énergie positive ». Mais une politique nationale ne se réduit pas à la somme de politiques locales et toute l’histoire de l’électricité montre que les interconnexions sont profitables à tous, surtout si l’on veut profiter du «foisonnement» des usages. Il faut une vision cohérente des choix et cette vision ne se conçoit qu’à l’échelle nationale, voire européenne. Dans un moment où certaines voix se font entendre pour relancer la construction européenne à travers la mise en place d’un véritable gestionnaire européen des réseaux électriques (une sorte de RTE européen), le repli sur soi au niveau local peut sembler archaïque, même si les pouvoirs publics ne peuvent ignorer les sensibilités régionales. Certains veulent consommer localement ce qui est produit localement tandis que d’autres voient dans l’internationalisation croissante des économies et la conquête de marchés extérieurs la solution pour améliorer la compétitivité de l’économie.
Réguler mais jusqu’où ?
Il est évident que les activités en situation de monopole naturel (transport et distribution de l’électricité) doivent être régulées, ce qui n’implique pas que les opérateurs soient publics. On peut parfaitement réguler des entreprises privées concessionnaires de service public. Personne ne remet en cause cette régulation obligée des infrastructures. Mais faut-il maintenir des prix régulés de l’électricité pour certains consommateurs (tarif bleu en France), maintenir le système de l’ARENH qui permet à tous de bénéficier d’un kilowattheure amorti, laisser à EDF seule le droit de construire et gérer des centrales nucléaires, continuer à subventionner des énergies renouvelables tant que leur compétitivité n’est pas garantie ? Certains le contestent, d’autres le pensent nécessaire et veulent aller plus loin en régulant en totalité la production nucléaire, considérant que le choix nucléaire, qui n’a de sens que sur le très long terme, est difficilement compatible avec une logique de marché, laquelle se préoccupe d’abord de la rentabilité financière à court terme. On le voit d’ailleurs au Royaume-Uni, pays qui a été le leader européen de la libéralisation, où le choix de développer de nouvelles centrales nucléaires s’accompagne d’une régulation forte avec la mise en place d’un mécanisme de « contrats pour différences », lequel garantit aux opérateurs une rentabilité minimale des investissements sur trente-cinq ans.
On voit ainsi se dessiner aujourd’hui deux scénarios alternatifs concernant le devenir d’EDF, opérateur tiraillé entre les lois du marché pour certaines activités (fourniture d’électricité et de services associés, et développement des renouvelables) et les fortes contraintes imposées par les pouvoirs publics via l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour son activité principale (la gestion et le renouvellement du parc nucléaire). Le premier scénario consisterait à « sanctuariser » le nucléaire en sortant du marché l’exploitation des 58 réacteurs en activité (et de l’EPR en construction) ; cette activité serait assurée par un EPIC et le kilowattheure produit serait vendu à tous à un prix régulé. Cela reviendrait à scinder EDF en deux sociétés, la première s’occupant de la production nucléaire, la seconde reprenant les autres activités (production et commercialisation d’électricité renouvelable ou non, services liés au numérique et à l’efficacité énergétique). C’est un peu ce qui s’est produit en Allemagne pour Eon et RWE. Le risque c’est de voir dans cette scission la « mort annoncée » du nucléaire, l’EPIC se chargeant de programmer une sortie progressive et discrète du nucléaire. Le risque serait aussi de fragiliser la seconde société qui resterait cotée en Bourse et pourrait faire l’objet d’une offre publique d’achat (OPA) inamicale de la part de ses concurrents (Total, Engie, Enel, Eni…).
Le second scénario, plus ambitieux, consisterait à étendre le périmètre de l’activité régulée en créant un EPIC qui pourrait prendre le nom d’Électricité régulée de France (ERDF) et qui regrouperait, en plus de la production nucléaire, toutes les activités de réseaux (RTE et Enedis), voire la gestion de tarifs régulés comme le tarif bleu si ces tarifs subsistent. Les autres activités du groupe (commercialisation, services annexes) seraient rétrocédées au marché et, de fait, dispatchées entre les concurrents. On reconstituerait ainsi une entreprise publique intégrée construite autour du nucléaire et des réseaux, et dont la colonne vertébrale serait le service public. La frontière entre ce qui doit être régulé et ce qui peut être rétrocédé au marché serait cette fois tranchée et pérenne.
L’idée d’une scission d’EDF, soutenue jusque dans les sphères gouvernementales, traduit bien le sentiment que certaines activités doivent être protégées des aléas du marché. Derrière cette « sanctuarisation » du nucléaire, il y a la crainte que la gestion sur le très long terme des déchets nucléaires ne soit plus assurée si l’opérateur historique était fragilisé. Le principe du pollueur-payeur, inscrit dans la Constitution, et les dispositions de la loi qui rendent les producteurs de déchets nucléaires responsables de leur stockage à très long terme obligent à prendre des garanties afin d’éviter une disparition de l’opérateur historique. De ce point de vue, un EPIC est moins vulnérable qu’une entreprise cotée en Bourse.
Conclusion
L’électricité n’est pas une marchandise comme les autres du fait de ses caractéristiques physiques mais aussi en raison de son caractère stratégique. Une coupure d’électricité n’a pas les mêmes effets qu’une simple pénurie de beurre. L’introduction de la concurrence a été et demeure bénéfique, notamment parce qu’elle est un aiguillon d’innovations et d’efficacité. Mais le balancier est peut-être allé trop loin dans le sens de l’ouverture à la compétition et beaucoup de voix demandent un retour à plus de régulation.
La libéralisation de l’électricité a permis une meilleure interconnexion des réseaux européens, une assez bonne convergence des prix de gros de l’électricité, mais elle n’a pas entraîné une convergence des prix de détail pour le consommateur final et elle a pu fragiliser les opérateurs historiques du fait de certains « coûts échoués » qu’il leur faut supporter.
Le grand programme nucléaire français n’aurait sans doute pas été mené dans un contexte de marché. C’est l’État qui a porté ce choix, même si ce sont les consommateurs français qui en ont payé le prix à travers les tarifs de l’électricité. Le contribuable a tout de même payé pour la recherche-développement, mais il est vrai qu’à l’époque il était difficile de séparer les R&D civile et militaire, et la première a beaucoup profité de la seconde.
La compétition a des limites dans un secteur qui dépend autant des infrastructures que sont les réseaux de transport et de distribution pour la commercialisation du produit. La difficulté est de tracer la frontière entre ce qui doit être régulé et ce qui peut être cédé au marché, mais également de maintenir des incitations à l’efficience dans un secteur qui demeure régulé.













Aucun commentaire.