Quel avenir pour la dissuasion nucléaire ?
Introduction
Qu’est-ce que la dissuasion ?
Dissuasion et sécurité
La dimension nucléaire de la dissuasion
La stratégie nucléaire
Escalade et proportionnalité
Deux visions de la dissuasion
Les débats sur la dissuasion
La dissuasion nucléaire est-elle éthique ? Est-elle légale ?
La portée de la dissuasion nucléaire doit-elle être réduite à la réponse à une attaque nucléaire ?
La dissuasion nucléaire est-elle efficace ?
Que se passerait-il si la dissuasion échouait ?
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Quid de l’équilibre coût/bénéfices ?
Quel avenir pour la
dissuasion ?
L’avenir des armes nucléaires
L’avenir de la dissuasion
La France et l’arme nucléaire
La dissuasion française : idées reçues et questions posées
Conclusion
Résumé
Avec la guerre en Ukraine, la question de la dissuasion nucléaire a fait un retour spectaculaire en Europe. Ses principes et ses modes de fonctionnement restent valides. La dissuasion est un processus psychologique simple, dont les règles dans le domaine nucléaire ont été progressivement définies tout au long de la guerre froide. Les pays qui disposent aujourd’hui de l’arme nucléaire – Chine, Corée du Nord, États-Unis, France, Inde, Israël, Pakistan, Royaume-Uni, Russie – continuent de respecter globalement ces règles, et l’on peut dire que la dissuasion a contribué à l’absence d’affrontement militaire direct entre États détenteurs.
Les débats sur l’avenir de la dissuasion n’en sont pas moins légitimes dans un contexte géopolitique et technologique mouvant. Certaines des questions posées par la dissuasion, telles que son rapport bénéfices/risques ou sa moralité, existent depuis 1945. D’autres sont plus récentes : la dissuasion nucléaire garde-t-elle toute sa pertinence alors que les rapports de forces se développent dans de nouveaux champs – espace, cyber… – et avec de nouveaux moyens ? Peut-on toujours dire qu’il n’y a pas d’alternative réelle à l’arme nucléaire ?
Pour la France, la pérennité de la dissuasion semble être un choix raisonnable, mais son maintien à niveau exige des investissements substantiels dès la présente décennie. En outre, des questions nouvelles se posent à notre pays. Quelle peut être l’articulation nouvelle des forces nucléaires et classiques dans le contexte européen prévisible ? Des menaces géographiquement lointaines (Asie) peuvent-elles relever de la dissuasion nationale ? Désormais seul État nucléaire de l’Union européenne, la France peut-elle avoir un rôle plus marqué dans la protection de ses partenaires et alliés ? Cette note entend contribuer au débat légitime, voire nécessaire dans un État démocratique, sur l’avenir de la dissuasion française.
Bruno Tertrais,
Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et conseiller géopolitique à l’Institut Montaigne
Introduction
Le 27 février 2022, l’Europe, stupéfaite, se retrouvait subitement plongée dans l’atmosphère des pires moments de la guerre froide : dans une mise en scène glaçante et très délibérément télévisée, Vladimir Poutine venait apparemment de donner l’ordre de changer la posture de ses forces nucléaires. En fait, cette décision a été mal comprise. Aucune « mise en alerte » ne fut décidée ce jour-là – seule une simple augmentation des personnels servant dans les états-majors nucléaires. Et, en dépit d’une rhétorique parfois troublante, Moscou s’en est toujours tenu à la ligne officielle : tant que le conflit reste dans le domaine classique, la dissuasion nucléaire ne pourrait être mise en jeu qu’en cas de menace « existentielle » pour le pays. Aucun mouvement inquiétant de forces nucléaires n’a ainsi été observé. Les actions du Kremlin dans ce domaine sont ainsi restées, jusqu’à présent (septembre 2022), plutôt raisonnables, contrastant ainsi avec l’extrême brutalité du comportement militaire russe sur le territoire ukrainien.
L’invasion de l’Ukraine n’a nullement signé l’échec de la dissuasion nucléaire, ce pays n’étant couvert par aucun parapluie nucléaire. Au contraire, elle a plutôt confirmé que les pays qui ne sont pas protégés par la dissuasion peuvent subir un tel sort, alors qu’au contraire, ceux qui le sont restent à l’abri d’une attaque militaire majeure et frontale. La possession par l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) et la Russie d’armes nucléaires borne l’horizon de la conflictualité entre eux : les Occidentaux n’interviennent pas en Ukraine, Moscou épargne leur territoire.
Les mouvements favorables au désarmement nucléaire, qui avaient obtenu un succès diplomatique indéniable en parvenant à la conclusion d’un traité d’interdiction des armes nucléaires en 2017, paraissent singulièrement en décalage avec les réalités politiques et stratégiques. Bien évidemment, aucun État disposant de cette arme n’entend le signer (ni aucun État protégé par un parapluie nucléaire). Les neuf pays qui s’en sont dotés, dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) – Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie – ou en dehors de celui-ci – Corée du Nord, Inde, Israël, Pakistan – maintiennent à niveau leur arsenal, le modernisent parfois, voire le développent comme c’est le cas en Asie où la compétition stratégique bat son plein, alors qu’en Europe l’affaiblissement probable de l’armée russe laisse présager une importance accrue, à l’avenir, des armes nucléaires pour le Kremlin. Rappelons, par ailleurs, qu’à l’exception de l’Afrique du Sud lors de la chute du régime de l’apartheid, aucun des États ayant développé cette arme par lui-même ne s’en est jamais défait.
La guerre en Ukraine peut conduire toutefois à s’interroger sur la pertinence de la dissuasion telle que nous l’avons connue au temps de la guerre froide, dans un monde qui redécouvre ce que certains appellent la « grammaire nucléaire ». Cette dissuasion peut-elle toujours être efficace dans un monde à neuf États nucléaires – et peut-être davantage dans le futur –, dont certains semblent de plus en plus enclins à manifester de manière agressive ce que l’on pourrait appeler leur « nationalisme nucléaire » ? Cette dissuasion peut- elle fonctionner entre un Donald Trump et un Kim Jong-un ? Et la posture française est-elle toujours pertinente dans un tel univers stratégique ? À la demande de la Fondation pour l’innovation politique, cette note, après avoir rappelé les bases et les principes de la dissuasion, tente de répondre à ces questions.
Qu’est-ce que la dissuasion ?
Gn II, 16-17 (trad. École biblique de Jérusalem).
Lawrence Freedman, Deterrence, Cambridge, Polity Press, 2004. p. 116 (traduction de l’auteur).
Ibid., p. 5.
Voir Julien Damon, « Cesare Beccaria. La certitude de la peine », in Ibid., 100 penseurs de la société, Presses Universitaires de France, 2016. Voir aussi Bertrand Guillarme, Penser la peine, Presses Universitaires de France, 2003.
La dissuasion est un processus psychologique : il s’agit de convaincre un acteur de s’abstenir de faire quelque chose. Fondée sur l’une des émotions les plus fondamentales – la peur du châtiment –, la dissuasion est aussi vieille que l’humanité, et n’est d’ailleurs pas inconnue des animaux. Dans la Bible, Yahvé s’adresse ainsi à l’homme en ces termes : « Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car, le jour où tu en mangeras, tu mourras1. » Vu ce qui arriva ensuite, on peut dire que ce fut le premier échec de la dissuasion (même si le châtiment ne fut pas appliqué au sens propre).
La dissuasion diffère de la persuasion et de la coercition, qui consistent à convaincre un acteur de faire quelque chose : la première, par l’incitation ; la seconde, par la contrainte : exiger la paix, par exemple. La coercition peut être appliquée par le biais d’un ultimatum – comme la déclaration de Potsdam, qui menaçait d’une « destruction rapide et totale » le Japon s’il ne se rendait pas sans condition – ou par le recours à la force – comme les bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Elle se distingue également du « découragement » (dissuasion en anglais), qui consiste à persuader un acteur de faire quelque chose sans exercice de la contrainte.
Comme le dit Lawrence Freedman, « la dissuasion peut être une technique, une doctrine et un état d’esprit. Dans tous les cas, il s’agit de fixer des limites aux actions et d’établir les risques associés au franchissement de ces limites2 ». Ses fondements existent donc dans tous les domaines de l’activité humaine, y compris les relations internationales. La menace de sanctions économiques, par exemple, est une forme de dissuasion – qui échoua avec la Russie durant l’hiver 2021-2022.
La dissuasion ne suppose pas des acteurs totalement rationnels. Ces derniers doivent en revanche disposer d’un minimum de rationalité, c’est-à-dire de la capacité à évaluer les coûts et les avantages, fût-ce de manière erronée. Il faut également un « cadre normatif suffisamment partagé3 ». Les philosophes du XVIIIe siècle ont développé ce concept en mettant l’accent sur la certitude et la célérité de la punition (Cesare Beccaria) ou sur la clarté, la prévisibilité et la proportionnalité (Jeremy Bentham)4. La criminologie contemporaine atteste que la probabilité de la réponse est fondamentale – davantage en termes relatifs que la sévérité de la sanction en cas de transgression. Cela signifie que la réputation de la partie qui cherche à dissuader, qu’il s’agisse de la police ou d’un adversaire militaire, est primordiale. Mais la dissuasion repose aussi en partie sur la peur. Le mot anglais deterrence vient du latin terrere, qui signifie « affoler », « effrayer ». Elle n’exige pas que le destinataire soit parfaitement rationnel et peut même être renforcée lorsque l’émetteur ne semble pas être parfaitement rationnel. Richard Nixon appelait cela la « théorie du fou » et Donald Trump adopta lui aussi cette posture.
En somme, la dissuasion est donc un art plus qu’une science, et ressemble plus à une partie de poker qu’à une partie d’échecs.
Dissuasion et sécurité
« The convincing of a potential aggressor that the consequences of coercion or armed conflict would outweigh the potential gains. This requires the maintenance of a credible military capability and strategy with the clear political will to act.OTAN » (voir Nato Glossary of Terms and Desinitions, Allied Administrative Paper AAP-06, 2019, p. 42, définition adoptée en 1996).
« Destroying the target is incidental to the message the detonation conveys to the Soviet leadership » (voir Thomas C. Schelling, « Nuclear Strategy and the Berlin Crisis », 5 juillet 1961, in US Department of State, Office of the Historian, Foreign Relations of the United States, 1961-1963, vol. XIV, « Berlin Crisis, 1961- 1962 », document 56).
«The prevention of action by the existence of a credible threat of unacceptable counterac- tion and/or belief that the cost of action outweighs the perceived benefits» (voir United States Department of Defense, DOD Dictionary of Military and Associated Terms, décembre 2020, p.63).
Dans le domaine de la sécurité, la dissuasion vise à éviter une attaque armée ou toute autre forme d’agression majeure délibérée. L’OTAN la définit comme « le fait de convaincre un agresseur potentiel que les conséquences de la coercition ou d’un conflit armé l’emporteraient sur les gains potentiels. Cela exige le maintien d’une capacité et d’une stratégie militaires crédibles, ainsi qu’une volonté politique claire d’agir5 ».
La dissuasion appliquée au domaine militaire s’illustre déjà dans les textes de Thucydide. Elle repose sur deux éléments : d’une part, des capacités dont la crédibilité peut être démontrée : plates-formes, lanceurs et armes, ainsi que les moyens nécessaires tels que ceux de commandement, de contrôle, de communication et de renseignement (C3I) ; d’autre part, une volonté manifeste de les utiliser. La dissuasion passe donc par la communication : transparence sur les forces, tests et exercices, discours et textes, ainsi que des messages spécifiques en temps de crise. Les utilisations passées de la force sont également des éléments de dissuasion et peuvent construire ce que les politistes appellent la « réputation ». En somme, la simple comparaison quantitative des armées et des arsenaux n’est pas nécessairement un indicateur de l’efficacité de la dissuasion et l’histoire regorge d’acteurs plus faibles attaquant des acteurs plus forts. Même la quasi-certitude d’une défaite ne suffit pas à dissuader un pays de se lancer dans une agression, par exemple si l’objectif est de blesser le plus grand acteur. Et encore moins lorsque des valeurs telles que l’honneur sont en jeu (un exemple classique étant la décision de l’Égypte d’attaquer Israël en 1973 mais en se limitant aux territoires occupés).
La dissuasion non nucléaire est de plus en plus « multi-domaines » ou « inter-domaines », car les rivalités et les conflits s’étendent à de nouveaux domaines (cyberespace, espace extra-atmosphérique…). Une attaque dans un domaine peut être un signal dissuasif pour éviter une agression dans un autre domaine, ou une rétribution pour une attaque passée.
Si elle vise à prévenir les agressions, la dissuasion peut également être appliquée pendant un conflit. Israël et ses adversaires régionaux pratiquent une forme vivante de dissuasion vis-à-vis d’acteurs non étatiques en établissant des lignes rouges, en testant l’adversaire et en rétablissant la dissuasion si nécessaire. Cette idée a été introduite dans le domaine nucléaire par le stratège américain Thomas Schelling dans un article de 1961, dans lequel il affirmait que l’utilisation d’armes nucléaires pouvait servir principalement de dispositif de signalisation : « La destruction de la cible est accessoire au message que la détonation transmet aux dirigeants soviétiques6.» Cela s’inscrit dans un processus de négociation: les adversaires communiquent via la manière dont ils calibrent leur emploi de l’arme nucléaire, laissant idéalement une marge de manœuvre pour négocier.
La dissuasion « par interdiction » consiste à convaincre l’adversaire qu’il ne sera pas en mesure d’atteindre ses objectifs par des moyens militaires. Cela se fait par la mise en place d’obstacles (défenses actives et passives) ou encore par la résilience d’un État ou d’une société. La dissuasion par interdiction peut donc être définie comme une combinaison de défense et de résilience. Les armes nucléaires peuvent entrer en jeu en tant qu’instrument de combat – bien qu’aucune doctrine nucléaire contemporaine déclarée ne prévoie une telle option. La dissuasion « par représailles » consiste, elle, à convaincre l’adversaire que les coûts d’une agression seraient supérieurs à ses avantages. Dans ce cas, les armes nucléaires entrent en jeu et ajoutent un élément de terreur. La dissuasion par représailles est aujourd’hui la principale forme de dissuasion nucléaire, mais la dissuasion militaire en général fait souvent appel aux deux. Le département américain de la Défense la définit ainsi comme « la prévention d’une action par l’existence d’une menace crédible de contre-action inacceptable et/ou la conviction que le coût de l’action l’emporte sur les avantages perçus7 ».
On appelle parfois dissuasion « centrale » le face-à-face entre deux adversaires majeurs, par opposition à la dissuasion « élargie » qui, elle, fait référence à un jeu à trois protagonistes (ou plus), dans lequel un pays plus fort protège un pays plus faible – un allié ou un partenaire – contre un adversaire. Ce second mode est considéré comme plus difficile que le premier car le pays le plus fort doit démontrer à la fois à l’adversaire et à l’État protégé qu’il est prêt à défendre son allié autant que lui-même. Cela se fait par le biais d’une politique déclaratoire, de mécanismes de consultation, d’une présence physique – les forces du protecteur pouvant servir de « fil déclencheur » (trip-wire) pour garantir son intervention si ses forces sont attaquées. Un avantage de la dissuasion élargie est la « réassurance » : un État qui estime être protégé par une dissuasion crédible sera moins tenté d’engager un programme nucléaire. Si la dissuasion élargie est parfois formalisée par un traité engageant explicitement la défense d’un allié (OTAN, Japon, Corée du Sud…), elle peut aussi exister de facto sous la forme d’un ensemble de déclarations et de relations étroites.
La dimension nucléaire de la dissuasion
Personne ne peut être crédité d’avoir inventé la dissuasion nucléaire, bien que le physicien Józef Rotblat (qui quittera plus tard le projet « Manhattan ») ait été, au début des années 1940, l’un des premiers partisans du « non-emploi » de la bombe pour prévenir la guerre.
L’avènement des armes nucléaires est souvent décrit comme la cause d’une révolution dans les affaires militaires et mondiales. Les universitaires et les praticiens ont débattu de son ampleur et de sa rapidité. Jusqu’aux années 1960, les armes nucléaires étaient encore parfois considérées comme des instruments de guerre. Il semble juste de dire qu’au début des années 1960 les missiles balistiques et les armes thermonucléaires ont créé une combinaison sans précédent de quasi-certitude, de rapidité et d’ampleur de la réponse, à laquelle les radiations ont ajouté une aura de terreur. Comme le Dr Folamour le déclare au président américain dans le film éponyme de Stanley Kubrick, « la dissuasion est l’art de produire dans l’esprit de l’ennemi la peur d’attaquer ».
Avec les armes nucléaires, la dissuasion est devenue une stratégie (impliquant une planification) dans laquelle la crainte de représailles ultimes (souvent qualifiées de « dommages inacceptables ») occupe une place centrale. Étant donné qu’une guerre entre détenteurs d’armes nucléaires est aujourd’hui difficilement envisageable, il serait plus approprié de dire que la dissuasion fait désormais partie intégrante de la politique internationale. Toutefois, la stratégie nucléaire part du principe que, dans une guerre nucléaire hypothétique, la politique continuerait à fonctionner par le biais de signaux et de tentatives de « rétablissement » ou de « restauration » de la dissuasion.
Une autre caractéristique distincte de la dissuasion nucléaire est qu’elle est considérée comme n’étant pertinente qu’entre les États, et ce des deux côtés de l’équation : la décision ultime ne peut appartenir qu’à un gouvernement, et la menace nucléaire n’est applicable qu’aux acteurs étatiques adverses. L’essence de la dissuasion nucléaire est d’être un dialogue entre chefs d’État et de gouvernement.
La dissuasion nucléaire couvre les attaques ou agressions contre les intérêts les plus essentiels. Le seuil déclaré de première utilisation ou « seuil nucléaire », une forme de « ligne rouge », peut être élevé (pas de première utilisation d’armes nucléaires), bas (par exemple, « si nous sommes attaqués »), qualifié (« en cas d’agression majeure », « dans des circonstances extrêmes de légitime défense », « lorsque l’existence de l’État est menacée », « pour protéger des intérêts vitaux ») ou bien laissé en suspens. Le seuil déclaré par l’OTAN est le suivant : « Si, […] la sécurité fondamentale de l’un de ses États membres devait être menacée8. » Ces seuils ne font pas uniquement référence à une attaque armée traditionnelle : plusieurs pays considèrent qu’une attaque chimique, biologique ou cybernétique massive pourrait menacer leurs intérêts vitaux.
Les risques étant très élevés dans le cadre de la dissuasion nucléaire, le flou empêche l’adversaire de pouvoir calculer les conséquences exactes d’une agression (et donc de n’agir qu’en dessous du seuil si nécessaire) et permet également au défenseur de conserver une certaine marge de manœuvre et de liberté d’action si la dissuasion échoue. Pour les mêmes raisons, même si la réponse promise est parfois spécifique (« la destruction de toutes vos principales villes », par exemple), elle est généralement plus floue (une réponse « rapide et décisive », « écrasante et dévastatrice » ou encore « proportionnée »). Toute dissuasion efficace est un dosage subtil de clarté et d’ambiguïté calculée, mais c’est encore plus vrai dans le cas de la dissuasion nucléaire.
De telles déclarations ne permettraient cependant pas de dissuader facilement tous les cas d’agression majeure. Un adversaire pourrait tenter d’affecter progressivement les intérêts du défenseur sans donner l’impression de franchir le seuil nucléaire à un moment précis. C’est le cas pour toutes les lignes rouges, mais les enjeux élevés de l’utilisation de l’arme nucléaire rendent cette notion particulièrement pertinente.
La plupart des États ont restreint les circonstances dans lesquelles ils utiliseraient des armes nucléaires pour remplir des obligations de désarmement, pour soutenir la non-prolifération ou encore pour des raisons morales. À l’extrême, cela se traduit par une doctrine déclarée de « non-emploi en premier » telle que celle revendiquée par la Chine, par l’Union soviétique dans les années 1980, ainsi que par l’Inde (avec certaines réserves). Une déclaration proche mais généralement considérée comme différente est une hypothétique déclaration de « vocation unique » (sole purpose) : la seule raison de posséder des armes nucléaires serait de dissuader l’utilisation du nucléaire, même si la préemption, par exemple (du moins dans certaines interprétations), n’était pas exclue. Les cinq États dotés d’armes nucléaires au sens du TNP ont donné des « garanties de sécurité négatives » formelles, selon lesquelles ils n’utiliseraient pas d’armes nucléaires contre un État non doté, parfois assorties de réserves afin de préserver leur liberté d’action. En 2010, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient été tous deux proches d’adopter le principe de « vocation unique » en renforçant leurs garanties de sécurité négatives. L’administration Biden a dû y renoncer, prenant acte de l’évolution défavorable du contexte stratégique.
La stratégie nucléaire
Escalade et proportionnalité
L’IEM-HA est un effet induit de l’explosion d’une arme nucléaire en haute altitude. Il s’agit de l’émission de rayonnements qui affectent les composants électroniques, les communications, etc., au sol et dans l’espace.
« The threat that leaves something to chance » (voir Thomas C. Schelling, « The threat that leaves something to chance », Rand Limited Document, Rand Corporation, 10 août 1959).
La traduction de la dissuasion nucléaire en termes opérationnels (doctrine, plans et capacités) est l’objet de la stratégie nucléaire. Celle-ci est l’une des composantes de la politique nucléaire, les autres étant la politique de maîtrise des armements et de désarmement nucléaires, et la politique de non-prolifération nucléaire.
La stratégie nucléaire se concentre sur trois problèmes principaux : éviter une attaque majeure non nucléaire sur son territoire national ou celui d’un allié en promettant une riposte nucléaire à l’adversaire qui s’y risquerait ; éviter l’emploi de l’arme nucléaire par l’adversaire en cas de conflit, en le menaçant d’une riposte nucléaire au moins équivalente ; éviter une attaque nucléaire surprise contre ses forces nucléaires ou son territoire en envisageant à cet effet d’avoir recours à une frappe préventive, préemptive ou de « limitation des dommages », en déployant une défense antimissile, ou en promettant une riposte nucléaire massive.
« L’escalade » est le concept le plus important de la stratégie nucléaire. Le terme peut désigner un processus (délibéré ou involontaire) ou une stratégie (l’imposition progressive de niveaux de violence accrus). L’escalade nucléaire étant une entreprise particulièrement risquée, l’interaction entre deux pays dotés d’armes nucléaires a été comparée à un bras de fer (game of chicken) et souvent qualifiée de « politique de la corde raide ». L’objectif de l’escalade serait de mettre fin au conflit avec un niveau de violence le plus bas possible, par le biais d’un emploi initial, et également de signaler la volonté de recourir à une utilisation ultérieure – éventuellement à des étapes ultérieures – si nécessaire. L’emploi initial pourrait être un simple tir de démonstration, un tir visant à exploiter l’impulsion électromagnétique en haute altitude (IEM-HA) ou un nombre limité de frappes sur des cibles militaires9.
Une frappe limitée ou sélective (par opposition à majeure ou massive) pourrait être lancée par n’importe quel moyen. Certains font valoir que l’utilisation d’un missile balistique porteur d’une arme de faible énergie pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit de l’adversaire, étant donné que ces moyens – surtout lorsqu’ils sont lancés par un sous- marin – sont généralement réservés aux frappes massives ; cette question hypothétique est appelée le problème de la « discrimination ». Les partisans d’une telle option mettent l’accent sur sa rapidité, sa précision et la forte probabilité d’une détonation sur la cible, ce qui renforcerait la dissuasion ; ils suggèrent également qu’aucun adversaire majeur ne pourrait confondre un seul missile entrant avec une frappe massive, et qu’il est hautement improbable que le destinataire réponde par une frappe majeure sans en avoir préalablement évalué les conséquences.
L’escalade verticale peut prendre plusieurs formes : frapper un plus grand nombre de cibles, un type de cible différent (passer de cibles militaires à des cibles économiques, par exemple) ou dans un lieu différent (passer d’un théâtre étranger au pays de l’adversaire). L’escalade horizontale désigne l’ouverture d’un nouveau théâtre de conflit, même au même niveau de violence appliquée.
L’escalade est, par définition, asymétrique. Chercher « à dominer l’escalade » (escalation dominance) signifie, en général, être capable d’augmenter la mise après chaque mouvement adverse d’une manière qui serait perçue comme crédible par l’adversaire, le mettant ainsi en échec. Mais si la dissuasion échoue, une gestion plus subtile de l’escalade s’articulerait autour des notions de marchandage (bargaining) et de dissuasion pendant la guerre (intra-war deterrence). Inspirée par les théoriciens des années 1960, cette école de pensée préconise la retenue dans l’utilisation des armes nucléaires, afin de laisser à l’adversaire une porte de sortie ou du moins d’éviter une montée rapide aux extrêmes. Il s’agissait ainsi de passer d’une stratégie de « bord du précipice » à une stratégie de « pente douce ». Une façon de procéder serait d’égaler le geste de l’adversaire (détruire cinq bases aériennes en réponse à la destruction de cinq bases aériennes, par exemple). Une telle riposte indiquerait un désir de maintenir le niveau de violence aussi bas que possible. Par ailleurs, la crainte d’une escalade incontrôlée fait également partie de l’essence même de la dissuasion nucléaire : l’escalade doit être possible, mais pas certaine. C’est ce que Thomas Schelling appelait « la menace qui laisse quelque chose au hasard10 ».
L’objectif de l’escalade serait, du moins dans les doctrines occidentales, fondamentalement politique. Depuis au moins les années 1970, toute idée d’utiliser les armes nucléaires comme de purs instruments de combat a disparu des doctrines déclarées. Tout effet militaire que l’utilisation du nucléaire pourrait avoir serait subordonné à la réalisation d’un objectif politique : le rétablissement de la dissuasion et la fin du conflit.
Un autre problème est de dissuader une première frappe (qui ne serait pas nécessairement la première utilisation d’armes nucléaires dans un conflit), visant à désarmer l’adversaire ou au moins à dégrader son potentiel offensif (« limitation des dommages »). Elle pourrait être effectuée soit à froid (frappe préventive), soit à chaud si l’on craint que l’adversaire passe en premier (frappe préemptive). Ce risque peut être prévenu par des mesures d’alerte ou en présentant à l’adversaire des défis de planification difficiles à surmonter tels que la dispersion, la redondance, le durcissement et le camouflage, ou encore par une défense antimissile. La recherche de capacités de seconde frappe, via les sous-marins lanceurs d’engins (SNLE), par exemple, est une conséquence directe de ce problème.
La proportionnalité est un autre concept clé : une menace proportionnée peut être recherchée pour des raisons de crédibilité, pour des raisons juridiques ou éthiques, ou encore pour garantir un meilleur contrôle de l’escalade si la menace devait être mise à exécution. Elle peut être appliquée de deux manières différentes : la réponse envisagée peut être proportionnée à l’agression (voir plus loin la discussion sur le droit et l’éthique), mais la stratégie nucléaire est souvent fondée sur la menace de dommages proportionnels aux enjeux du conflit, qui peuvent finalement être l’existence même du pays en cas d’agression par un adversaire doté de l’arme nucléaire.
Personne ne sait comment un conflit nucléaire se développerait et les anticipations – on agit sur la base d’une action future hypothétique de l’adversaire – joueraient un rôle majeur dans la dynamique de l’escalade. Malgré les conceptions théoriques des années 1960, qui envisageaient la possibilité d’une escalade progressive, voire prolongée, vers les extrêmes (l’échelle de Herman Kahn ne comptait pas moins de quarante-quatre barreaux possibles), les experts qui se sont penchés sur les coupe-feu possibles n’en ont généralement identifié que deux : la première utilisation de l’arme nucléaire au cours d’un conflit, et la première frappe nucléaire sur le territoire de l’adversaire.
Deux visions de la dissuasion
La théorie des jeux est un domaine des mathématiques qui vise à aider la décision en modélisant l’interaction des agents. Les stratèges américains des années 1960 l’appliquèrent au domaine nucléaire en tenant de scénariser la réaction probable d’un adversaire à telle ou telle initiative.
« Mutual Assured Destruction is the foundation of deterrence » (voir John T. Correll, « The Making of MAD », airforcemag.com, 27 juillet 2018).
Voir Albert Wohlstetter, « The Delicate Balance of Terror », Papers P-1472, Rand Corporation, 1958.
Deux visions de la dissuasion nucléaire s’affrontent, qui correspondent à une distinction analytique entre une vision facile ou une vision difficile. La première met l’accent sur la manipulation du risque par l’incertitude, le marchandage avec l’adversaire et la crainte d’une escalade incontrôlée. Elle suggère que la dissuasion est stable lorsque les deux parties ont confiance dans leur capacité à riposter (la crédibilité étant plus importante que l’équilibre des forces). La « théorie des jeux » peut être utilisée comme outil d’appui11.
Parmi les analystes qui ont suggéré qu’un nombre relativement faible d’armes, associé à une stratégie simple, suffit à dissuader, figurent les experts américains Thomas Schelling, Bernard Brodie, Kenneth Waltz et Robert Jervis. Ils affirment que les armes nucléaires ont un effet important sur le risque d’attaque conventionnelle et qu’une capacité protégée de frappe en second est la clé de la stabilité. Les conditions de la dissuasion peuvent être la simple existence d’une telle capacité, rendant les représailles possibles, bien que la plupart des experts soutiennent qu’elles devraient être assurées, de préférence des deux côtés. Comme la capacité de détruire les forces adverses n’est pas nécessaire, de tels modèles ont été appelés dissuasion finie ou minimale. L’expression « destruction mutuelle assurée » (Mutual Assured Destruction, ou MAD) – mot-valise proposé ironiquement par Donald Brennan en 1969 – est souvent associée au modèle de dissuasion simple mais se réfère à une question spécifique, à savoir la condition de la stabilité stratégique. Elle traduit l’idée qu’une capacité de représailles assurée et massive des deux côtés est la clé de voûte de cette stabilité. Nombreux sont ceux, comme le secrétaire américain à la Défense Robert McNamara après son mandat, qui en sont venus à considérer la MAD comme « le fondement de la dissuasion12 ». Toutefois, contrairement à une idée reçue, la MAD en tant que stratégie délibérée n’a jamais été pleinement adoptée, ni par Washington ni par Moscou.
L’autre école, plus pessimiste, insiste sur la nécessité de disposer de solides capacités offensives et défensives, et sur la capacité de la partie défensive à contrôler l’escalade – et, si possible, à la dominer – à chaque étape. Elle accorde une grande importance à l’équilibre des forces et considère la stabilité comme un objectif difficile à atteindre. Les pessimistes estiment que la dissuasion nécessite une stratégie complexe, ainsi qu’un arsenal de plus haut niveau et plus diversifié. Parmi les partisans de ce point de vue figurent les experts américains Herman Kahn, Albert Wohlstetter, Colin Gray et Keith Payne. Son expression la plus symbolique est l’évaluation, souvent citée, d’Albert Wohlstetter selon laquelle l’équilibre de la terreur est « délicat13 ». Les territoires et les forces ne doivent pas être vulnérables, sauf à créer des incitations à la préemption des deux côtés. Les forces doivent être dispersées ou protégées et une défense antimissile peut être nécessaire. Cette école de pensée accorde également de l’importance à l’existence d’un large éventail d’options permettant de gérer, voire de dominer l’escalade. De ce point de vue, la MAD, si elle est pertinente, exige des efforts sérieux. Pour employer une analogie avec la physique fondamentale, appelons-la version forte de la MAD, par opposition à la version faible décrite plus haut.
Cependant, la plupart des analystes des deux écoles reconnaissent la nécessité de disposer d’une force de représailles sûre, ainsi que d’options de planification nucléaire non massives (sélectives ou limitées).
Les débats sur la dissuasion
Depuis 1945, les gouvernements, les planificateurs et les experts des pays dotés d’armes nucléaires n’ont cessé de se débattre avec un certain nombre de questions primordiales auxquelles il n’y a pas de réponse facile.
La dissuasion nucléaire est-elle éthique ? Est-elle légale ?
« There is no dishonour in deterrence » (voir Lawrence Freedman, « Introduction », in Frans Osinga et Tim Sweijs (dir.), Deterrence in the 21st Century – Insights from Theory and Practice, Breda, Asser Press, 2021, p. 2).
Cour internationale de justice (CIJ), « Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », 8 juillet 1996, avis consultatif, Recueil 1996, p. 266.
Ibid.
Ibid., p. 254.
La dissuasion est un mécanisme de prévention de la guerre, ce qui permet à Lawrence Freedman d’affirmer qu’« il n’y a pas de déshonneur dans la dissuasion14 ». Les opposants à la dissuasion nucléaire avancent, quant à eux, que l’utilisation de cette arme terrible ne saurait être compatible avec le droit international. Le jus ad bellum, qui définit les critères de la légalité du recours à la force (« entrée en guerre »), établit que la défense est légale (« légitime défense ») si elle est proportionnelle à l’attaque armée et nécessaire pour y répondre. Le jus in bello ou droit international humanitaire (DIH) interdit les attaques contre la population et les biens civils, ainsi que les « maux superflus ». Les partisans de la dissuasion nucléaire estiment que les principes fondamentaux du droit international peuvent être maintenus à condition que certaines directives de planification soient respectées. Dans son avis consultatif de 1996, la Cour internationale de justice estimait que « ni le droit international coutumier ni le droit international conventionnel ne comportent d’interdiction complète et universelle de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires en tant que telles15 » et qu’elle ne pouvait « cependant conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause16 ». En outre, la Cour déclarait qu’elle « n’entend[ait] pas se prononcer […] sur la pratique dénommée “politique de dissuasion”17 ». N’étant pas signé par les détenteurs d’armes nucléaires, le traité d’interdiction des armes nucléaires ne leur créera pas de nouvelles obligations juridiques, d’autant qu’ils agiront sans doute comme ce que les juristes appellent des « objecteurs persistants ».
La portée de la dissuasion nucléaire doit-elle être réduite à la réponse à une attaque nucléaire ?
Les cinq États dotés de l’arme nucléaire au sens du TNP ont donné des « garanties négatives de sécurité » réduisant d’une manière ou d’une autre la portée de la dissuasion nucléaire, dans le but d’encourager la non-prolifération. L’une des plus anciennes controverses sur la dissuasion porte sur ces garanties. Les partisans estiment que la menace d’un recours au nucléaire en réponse à une attaque non nucléaire – conventionnelle, chimique, biologique, cybernétique… – n’est pas crédible, n’est pas nécessaire, est immorale ou cherche à élever le seuil nucléaire à des fins éthiques ou stratégiques, arguant que souligner l’utilité des armes nucléaires peut en encourager la prolifération. Les opposants soulignent qu’en cas de conflit, les adversaires ne font pas confiance au concept de non-emploi en premier, qu’il peut être modifié en quelques secondes, qu’il peut encourager les agressions non nucléaires et qu’il est préjudiciable à la dissuasion élargie, notamment si les alliés s’y opposent. Certains font également la distinction entre politique déclaratoire et politique d’action. Parmi les variantes du principe de non-emploi en premier, citons celle qui propose d’interdire l’« utilisation en premier d’armes de destruction massive », un non-emploi en premier assorti de réserves (l’Inde depuis 2003, les États-Unis entre 2010 et 2018) ou une déclaration de « seule vocation » (sole purpose) qui pourrait laisser une place à la frappe préventive.
La dissuasion nucléaire est-elle efficace ?
« Any actor may choose its posture, but cannot choose their reputation » (UK Ministry of Defence, Deterrence: the Defence Contribution, Joint Doctrine Note 1/19, 2019, p. 23).
Jean-Maris Guéhenno, « Il est urgent qu’Emmanuel Macron lance une réflexion sur les leçons de la guerre en Ukraine », Le Monde, 30 août 2022 (en accès réservé).
L’expression a été suggérée à l’auteur par un ancien commandant des forces nucléaires françaises.
«Deterrence worked better in practice than in theory» (voir Lawrence Freedman, «Framing strategic seterrence. Old certainties, new ambiguities », The RUSI Journal, vol. 154, no 4, août 2009, p. 50).
Selon Oscar Wilde, « la beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Il en va de même pour la dissuasion. En définitive, seul le destinataire des menaces dissuasives peut décider si elles sont efficaces. Comme le dit le ministère britannique de la Défense, « un acteur peut choisir sa posture, mais ne peut choisir sa réputation18 ». Certains ont pu avancer l’idée que l’on « peut douter qu’il y ait aux États-Unis un seul responsable prêt à déclencher le feu nucléaire pour sauver d’une défaite un pays balte qui aurait été attaqué par la Russie [et qu’il] en va de même pour les dirigeants français ou britanniques19 ». Mais outre que la réponse n’est sûrement pas aussi évidente, cette affirmation n’a guère de pertinence, car en matière de dissuasion, seule compte la perception adverse. La dissuasion peut ainsi être considérée comme « un acte de foi20 », mais ses partisans affirment qu’il existe des preuves de son efficacité. Les preuves quantitatives comprennent l’absence, depuis 1945, de toute guerre entre grandes puissances (une exception historique pour laquelle les explications alternatives sont, de leur point de vue, insatisfaisantes), de toute guerre majeure entre pays dotés de l’arme nucléaire et de toute attaque militaire majeure contre des pays dotés ou protégés de cette arme. Les preuves qualitatives comprennent des archives et des témoignages qui montrent que les armes nucléaires ont induit un sentiment de prudence dans l’esprit des dirigeants, affectant leur calcul quant à l’entrée en guerre contre une nation dotée de l’arme nucléaire ou protégée par l’arme nucléaire. Cela va des mémoires de Nikita Khrouchtchev sur l’Union soviétique aux témoignages de responsables égyptiens ou irakiens. On a suggéré que la gestion brutale par Ronald Reagan de la grève des contrôleurs aériens américains lui valut la réputation d’un dirigeant résolu qui n’hésiterait pas à utiliser des armes nucléaires. Lawrence Freedman affirme que « la dissuasion a mieux fonctionné en pratique qu’en théorie21 ». Néanmoins, les archives et les témoignages montrent qu’il y a eu de nombreux malentendus entre Washington et Moscou, chacun étant convaincu que l’autre aurait pu attaquer. Non seulement l’Union soviétique craignait une agression américaine, mais elle se souciait du sort de sa population, malgré ce que pensaient les analystes américains. Elle pratiquait également l’« image en miroir » : étant un pays centralisé, les Soviétiques pensaient que la destruction de Washington pourrait infliger un coup fatal au pays. Toutefois, encore aujourd’hui, on constate que la Russie, la Chine, le Pakistan ou la Corée du Nord respectent globalement les règles de la dissuasion : ils n’ont jamais attaqué frontalement et massivement un État nucléaire ou protégé par un État nucléaire.
Que se passerait-il si la dissuasion échouait ?
« The nuclear threshold is not so weak that a single use of nuclear weapons would make anyone careless about crossing it a second time » (voir Herman Kahn, On Escalation. Metaphors and Scenarios [1965], Transaction Publishers, 2010, p. 97-98).
La dissuasion n’est pas infaillible. Elle peut échouer du fait d’un mauvais calcul de l’une des parties, notamment en temps de crise. Si c’était le cas, faudrait-il quand même franchir le pas ? Certains pensent que ce serait inutile.
D’autres soulignent que la dissuasion pourrait être « restaurée » par une telle utilisation. Herman Kahn affirmait que « le seuil nucléaire n’est pas faible au point qu’une seule utilisation d’armes nucléaires fasse tomber toute hésitation à le franchir une seconde fois22 ». Ceux qui croient à une « négociation pendant la guerre nucléaire » (intra-war bargaining) pensent que l’escalade peut être contrôlée. D’autres pensent que, tout comme le « jeu de la poule mouillée » (game of chicken), elle est tout simplement trop dangereuse et risquée. En définitive, la réponse est « peut-être », et cette incertitude est au cœur de la stratégie nucléaire. L’escalade nucléaire serait en tout cas une épreuve de volontés.
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
En supposant que la dissuasion nucléaire soit efficace, qu’en est-il de ses risques ? Il s’agit d’une question raisonnable, qui comporte deux dimensions différentes. Comme pour toute politique, il s’agit d’évaluer les risques. Certains affirment que l’avantage à court terme de la dissuasion d’une guerre entre grandes puissances ne suffit pas à justifier le risque à long terme d’une guerre nucléaire qui poserait des risques existentiels pour la civilisation humaine et le climat. D’autres soulignent que les avantages de la dissuasion sont si importants qu’un petit risque vaut la peine d’être couru. Conduire est l’une des choses les plus dangereuses que nous faisons au quotidien, et pourtant de nombreux parents emmènent leurs enfants faire de longs voyages en voiture. Une question connexe est celle de l’importance du risque que représente l’échec de la dissuasion. Bien qu’il y ait eu de nombreux incidents depuis 1945, s’agit-il d’avertissements que la dissuasion est susceptible d’échouer ou de preuves de la solidité de la dissuasion et de ses mécanismes associés ? Il n’y a guère de preuves que le monde ait souvent frôlé la guerre nucléaire ou que la chance soit une hypothèse nécessaire pour expliquer l’absence d’explosion accidentelle ou non autorisée, ou d’utilisation délibérée, depuis 1945 (la défense antimissile a souvent été justifiée par la nécessité de se protéger contre une utilisation accidentelle ou non autorisée).
Quid de l’équilibre coût/bénéfices ?
La possession d’armes nucléaires peut entraîner différentes catégories de coûts. Tout d’abord, les adversaires peuvent répondre en possédant leurs propres armes, comme cela s’est produit pendant la guerre froide, lorsque les États-Unis et l’Union soviétique ont accumulé des dizaines de milliers d’armes. C’est ce que l’on appelle généralement la « course aux armements », bien que ce terme ne fasse pas l’unanimité. Les armes nucléaires peuvent offrir « plus de rentabilité », en ce sens qu’elles peuvent assurer la protection d’intérêts vitaux à un coût moindre que les armes conventionnelles.
Ensuite, une autre catégorie est celle des coûts stratégiques. Les armes nucléaires peuvent entraîner les agressions à petite échelle ou les escarmouches de bas niveau (ainsi que les guerres par procuration), peut- être vers un point dangereux. C’est ce que l’on a appelé le « paradoxe de la stabilité/instabilité ». La peur de la guerre a peut-être modéré le comportement des superpuissances, retenu Washington et Moscou lors de crises majeures, mais les a en même temps encouragées à prendre des initiatives dangereuses. Elle peut avoir incité à la peur, à l’orgueil démesuré et à des perceptions erronées.
Enfin, certains auteurs ont même affirmé que les armes nucléaires ont peut- être perpétué la guerre froide. Elles auraient peut-être facilité la détente et la coexistence pacifique, mais rendu la paix réelle plus difficile, en plus de prolonger la vie du communisme.
Quel avenir pour la
dissuasion ?
L’avenir des armes nucléaires
« The United States uses its nuclear deterrent every day to maintain peace around the globe. The U.S. nuclear deterrent underwrites every U.S. military operation » (voir Office of the Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear Matters-ODASD(NM), Nuclear Matters Handbook 2020, p. 1).
« Nuclear actors are more likely to prevail when facing a non-nuclear state » (Kyle Beardsley et Victor Asal, « Winning with the Bomb », The Journal of Conflict Resolution, vol. 53, n° 2, avril 2009, p. 278).
Voir Jean-Louis Gergorin, « Quelles nouvelles menaces, quelles ripostes, quelle dissuasion ? », Revue Défense nationale (RDN), n° 532, juin 1992, p. 43-49.
« Our analysis of nineteen historical cases demonstrated that nuclear coercion rarely works at all » (Todd S. Sechser et Matthew Fuhrmann, Nuclear Weapons and Coercive Diplomacy, Cambridge University Press, 2017, p. 239).
Historiquement, on peut dire que les armes nucléaires ont limité ou borné l’horizon des conflits majeurs tout en donnant à leurs détenteurs un avantage stratégique. Tout détenteur d’une arme nucléaire étend une « ombre nucléaire ». Le département de la Défense des États-Unis affirme ainsi que « les États-Unis utilisent chaque jour leur dissuasion nucléaire pour maintenir la paix dans le monde. La dissuasion nucléaire américaine sous-tend chaque opération militaire américaine23 ». C’est une observation que de nombreux acteurs partageraient. Des études affirment également que « les acteurs nucléaires ont plus de chances de l’emporter lorsqu’ils sont confrontés à un État non nucléaire24 ».
Il est certain qu’un État détenteur de l’arme nucléaire peut profiter de sa liberté d’action pour faire avancer des projets néfastes. C’est ce que l’expert français Jean-Louis Gergorin a appelé, au début des années 1990, la « sanctuarisation agressive », permettant par exemple des provocations limitées ou des prises de terres dans les pays voisins25. Lorsqu’elle est appliquée aux deux parties, cette démarche est liée au paradoxe de la stabilité/ instabilité décrit plus haut. Mais l’effet fonctionne dans les deux sens. Un rôle clé des armes nucléaires occidentales aujourd’hui est de neutraliser la pression et le chantage en temps de crise, ce que l’on pourrait appeler une contre-dissuasion (un rôle que la Chine elle-même attribuait à sa force nucléaire dans les années 1960). Il s’agit de neutraliser de futures menaces de Moscou, de Pékin ou de Pyongyang. En tout état de cause, la coercition et le chantage nucléaires sont difficiles. L’idée que les armes nucléaires aident à contraindre les adversaires (ou les alliés) reste une affirmation contestée. « Notre analyse de dix-neuf cas historiques a démontré que la coercition nucléaire fonctionne rarement », ont pu ainsi constater deux chercheurs américains26.
La dissuasion élargie présente des avantages spécifiques. On considère généralement qu’elle réduit le risque de prolifération nucléaire : les alliés et partenaires protégés sont rassurés et donc moins tentés de se lancer dans leur propre programme nucléaire. L’impact de la possession d’armes nucléaires sur les alliances n’est pas à sens unique. Avant la conclusion du TNP, Washington s’est d’abord opposé à la prolifération au sein de l’OTAN, au motif qu’elle affaiblirait la solidarité de l’Alliance et compliquerait la gestion des crises. Par la suite, les États-Unis ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et le Conseil de l’OTAN a reconnu en 1974 que les dissuasions indépendantes du Royaume-Uni et de la France contribuaient à la dissuasion globale de l’Alliance.
Enfin, la possession d’armes nucléaires entraîne également des responsabilités : en tant que puissances nucléaires officielles reconnues au sens du TNP, les États non dotés d’armes nucléaires (ENDAN) ont un rôle particulier à jouer dans la promotion du désarmement et de la non- prolifération nucléaires.
Par ailleurs, les armes nucléaires restent fréquemment associées à la puissance, et conservent une aura sans équivalent dans les relations internationales – ce que certains appellent le prestige et d’autres le statut (bien que certains programmes puissent aussi transformer négativement l’image d’un pays). Ils peuvent projeter une image d’autosuffisance, de souveraineté et d’autonomie. On parle et on agit différemment face à un détenteur de l’arme nucléaire. En outre, lorsqu’elles sont associées à un « partage nucléaire » (cas de l’OTAN), les armes nucléaires peuvent être un symbole d’alliance et un moyen de partager les risques et les responsabilités.
Les armes nucléaires peuvent également présenter des avantages sur le plan intérieur. Un programme nucléaire peut contribuer à la consolidation du leadership politique et, éventuellement, assurer la survie non seulement du pays mais aussi du régime. Il peut aussi contribuer à la subordination des militaires, comme cela s’est produit en France ou en Inde (bien que certains prétendent que c’est l’inverse qui s’est produit au Pakistan). Il peut conduire à un « rassemblement autour du drapeau », y compris pour l’aventurisme international. L’expression « nationalisme nucléaire » vient à l’esprit lorsqu’on tente de décrire les politiques de certains pays. Enfin, un programme atomique entraîne des coûts budgétaires importants mais peut aussi générer des retombées technologiques et industrielles.
Les armes nucléaires ont, dans une large mesure, structuré les relations internationales, notamment en raison de la coïncidence entre le statut d’État doté au sens du TNP et celui de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies (même si la conclusion de la charte des Nations unies précède de quelques jours l’essai Trinity du 16 juillet 1945). C’est la base de ce que certains appelleraient un « ordre nucléaire », ordre qui a été remis en question par les pays développant des armes nucléaires en dehors du cadre du TNP ou cherchant à réformer le Conseil de sécurité.
Dans l’hémisphère Nord, où se trouvent tous les États détenteurs actuels, les armes nucléaires ont probablement consolidé le système westphalien des États-nations. Elles ont également contribué à la perception d’une « mondialisation des risques majeurs » (la portée des missiles intercontinentaux et l’impact mondial potentiel d’un échange nucléaire). Mais, en dépit des risques et de ses coûts, la dissuasion nucléaire ne peut- elle pas être considérée comme une forme de bien public mondial ? Si l’on part du principe que l’« obsolescence de la guerre majeure » (John Mueller) est en grande partie imputable à l’existence des armes nucléaires, on peut difficilement dire qu’elles n’ont joué aucun rôle dans la prospérité et le développement de la plupart des nations depuis 1945. Il est en effet à peine exagéré de suggérer que le succès du projet européen a été rendu possible par l’existence du parapluie nucléaire américain. L’existence des armes nucléaires a obligé les grandes puissances à s’asseoir et à se parler. Les dangers de la guerre nucléaire ont contribué à la prise de conscience de la nécessité du dialogue. Les armes nucléaires ont peut-être en fait accéléré la fin de la guerre froide, en donnant confiance aux dirigeants soviétiques que la survie du pays serait assurée même après la perte du glacis est-européen.
Tout ceci confirme que le rôle des armes nucléaires est fondamentalement politique. Mais la question de savoir si la dissuasion nucléaire est le mécanisme de prévention de la guerre le plus efficace (ainsi qu’une sorte d’assurance contre l’échec de la « paix démocratique ») ou l’instrument le plus dangereux et le plus contraire à l’éthique jamais conçu par l’être humain restera âprement débattue. Partisans et opposants continueront à ne pas être d’accord sur le rapport coût/bénéfice du maintien des armes nucléaires. Le poids des jugements de valeur de part et d’autre laisse peu de chances de réconcilier les points de vue.
L’avenir de la dissuasion
Aujourd’hui, la dissuasion est la fonction stratégique dominante des armes nucléaires, et les doctrines d’emploi ont été largement délégitimées : aucun État ne considère ces armes comme des moyens militaires anodins. En dépit de leurs rodomontades, ni Vladimir Poutine, ni Kim Jong-un, ni Donald Trump n’ont jamais donné aucun signe d’être sur le point d’appuyer sur le bouton. Contrairement à ce que certains commentaires peuvent laisser entendre, le développement annoncé d’armes de faible puissance (une notion d’ailleurs arbitraire : où commence la « faible » puissance ?) par le Pakistan ou la Corée du Nord n’est pas une nouveauté, et jusqu’à preuve du contraire se situe, pour les États qui le font, dans une logique de dissuasion.
Il y a près de vingt ans, dans son discours d’acceptation du prix Nobel d’économie, Thomas Schelling s’étonnait que les armes nucléaires n’aient pas été utilisées depuis 1945. La tradition de non-utilisation, sans être inébranlable, semble solide. Mais l’allongement constant du temps écoulé depuis Nagasaki rend-il l’utilisation des armes nucléaires de moins en moins probable ? A-t-il une incidence sur ce qu’un adversaire considérerait comme des dommages inacceptables ? Ou courons-nous le risque d’oublier, surtout en l’absence de tests visibles, la formidable puissance des armes nucléaires, rendant ainsi l’utilisation du nucléaire, avec le temps, plus probable ?
Une question connexe est de savoir si la dissuasion nucléaire devient plus difficile. Le nombre d’acteurs dotés de l’arme nucléaire est plus élevé aujourd’hui (neuf) qu’à la fin de la guerre froide (six). Cette multipolarité nucléaire croissante est généralement considérée comme rendant la dissuasion plus problématique : la dissuasion à plusieurs pourrait être une partie de poker dans le meilleur des cas, une partie de roulette russe dans le pire. Cela est d’autant plus vrai que les positions nucléaires en Asie évoluent rapidement mais ne sont pas encore mûres au point que les acteurs concernés disposent de capacités de deuxième frappe sûres. La montée en puissance de la défense antimissile pourrait rendre plus complexe le calcul offensif/défensif. Certains analystes préviennent que la technologie pourrait rendre les contre-attaques non nucléaires beaucoup plus facilement réalisables que par le passé. D’autres craignent le risque d’une guerre nucléaire par inadvertance, en raison de la vulnérabilité croissante des systèmes de commandement, de contrôle et de communication aux attaques non nucléaires. De nouvelles voies d’escalade ont été ouvertes par le développement des missiles classiques précis à longue portée, par l’utilisation accrue de tactiques de zone grise et de guerre hybride par de nombreux acteurs, ainsi que par le développement rapide des domaines du cyberespace et de l’espace. On parle ainsi volontiers de dissuasion intégrée ou de dissuasion stratégique, prenant en compte l’ensemble des instruments possibles de coercition depuis les sanctions économiques jusqu’aux armes nucléaires, en passant par la résilience qui peut contribuer à la dissuasion par interdiction. La guerre en Ukraine en a été un laboratoire. De plus, dans cette forme de dissuasion, l’acteur se réserve la possibilité de procéder à une escalade horizontale : une agression dans un domaine peut être contrée par une riposte dans un autre domaine.
Ceci ne signifie pas que l’on ait trouvé des alternatives à l’arme nucléaire, qui reste singulière, non seulement de par ses effets mais aussi par l’aura de terreur qui l’entoure. L’arme informatique, par exemple, ne présente pas les mêmes garanties en termes de probabilité d’effets prévisibles, massifs et quasi immédiats sur les biens et sur les populations à un coût acceptable. Mais cela diversifie les options de dissuasion pour les enjeux non vitaux et les possibilités de réponses aux actions adverses. Simultanément, l’essor de la guerre de l’information et de la désinformation, notamment par le biais des réseaux sociaux, pourrait rendre la gestion des crises encore plus difficile. Il reste à déterminer si ces évolutions affecteront fondamentalement le calcul stratégique et la dynamique de l’escalade nucléaire.
La France et l’arme nucléaire
La France s’est dotée depuis la fin des années 1960 d’une force de dissuasion nucléaire indépendante. Cette force est devenue l’un des fondements de la politique de défense du pays et, au-delà, de son identité politique : elle incarne la liberté d’action de la France face au monde extérieur. Tous les présidents successifs ont repris à leur compte les éléments principaux de la politique de dissuasion, chacun apportant sa touche à l’édifice, en fonction de l’évolution du contexte international et stratégique.
La France est, sur le plan nucléaire, une puissance moyenne ou de deuxième rang. Elle dispose d’un stock de quelque trois cents armes au total soit, probablement – les chiffres ne sont pas tous publics – un peu moins que la Chine et un peu plus que le Royaume-Uni. Suffisamment pour être prise au sérieux par tout adversaire potentiel, mais bien loin des arsenaux encore gigantesques – plusieurs milliers d’armes – de la Russie et des États-Unis, et donc peu concernée par la problématique du désarmement, même si elle affirme se conformer au TNP en adoptant une logique de « suffisance » qui l’a amené à réduire son arsenal à plusieurs reprises.
Ces armes sont emportées par des missiles tirés par des sous-marins et des bombardiers. La France dispose de quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de la force océanique stratégique (FOST) basée sur la presqu’île de l’Île longue, dans la rade de Brest. Chacun des trois bâtiments disponibles – un quatrième est toujours en entretien – peut être doté de seize missiles M51, emportant un nombre variable de têtes nucléaires. En complément, les chasseurs bombardiers Rafale des forces aériennes stratégiques (FAS) – au sein desquelles deux escadrons ont un rôle nucléaire – peuvent chacun emporter un missile air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA), doté d’une seule arme. Les caractéristiques de ces deux forces les rendent extrêmement complémentaires l’une de l’autre sur le plan technique, opérationnel et stratégique. De plus, si nécessaire, une force aéronavale nucléaire (FANu) peut être générée et embarquée par le porte-avions.
Trois principes gouvernent la force de dissuasion française :
– la permanence : la dissuasion s’exerce de façon continue, y compris en temps de paix. Cela se traduit par la présence d’au moins un, voire deux, SNLE qui patrouille sous les océans. À lui seul, ce bâtiment peut exercer à tout moment une frappe nucléaire susceptible d’occasionner des dommages massifs à tout adversaire potentiel. La mission des FAS s’exerce elle aussi en permanence ;
– la suffisance : l’idée consiste à limiter les moyens nucléaires français au strict nécessaire. La France ne s’est jamais dotée de moyens « antiforces », par exemple (destinés à détruire les forces nucléaires adverses). Elle a aussi renoncé à développer la bombe à neutrons, qui a une moindre puissance explosive et inflige des dommages par rayonnement, avec peu de retombées radioactives. À la fin de la guerre froide, elle avait démantelé ses missiles sol-sol, estimant qu’ils n’étaient plus aussi utiles que par le passé. Elle a également été la première à démanteler ses sites d’essais nucléaires et ses installations de production de matières fissiles ;
– la souplesse : elle consiste d’abord, dans un environnement géostratégique changeant, à pouvoir adapter la menace dissuasive au contexte : pays concerné, rapport de forces, etc. Il y a bien longtemps que la gamme des options ouverte au président de la République ne se réduit plus à la menace de destruction de villes adverses : les objectifs peuvent être ponctuels, militaires ou économiques. La souplesse consiste également à adapter l’outil de dissuasion au contexte technologique et militaire. L’un des enjeux les plus importants est de pouvoir en permanence s’assurer que les forces pénétreraient ou satureraient les défenses adverses (défenses antimissiles et antiaériennes), ce qui nécessite des investissements importants.
Seul le président de la République peut déclencher le feu nucléaire. Des procédures existent pour garantir qu’il pourrait le faire à tout moment – et qu’il serait le seul à pouvoir le faire. Il s’agit d’abord, bien sûr, de pouvoir garantir la survie du pays en dissuadant tout adversaire potentiel de s’en prendre à notre existence même. La guerre en Ukraine a rappelé à ceux qui en doutaient que la possibilité d’une agression militaire majeure sur notre continent n’avait pas disparu. Mais si la France s’est dotée d’une force de dissuasion nucléaire, c’est aussi pour se garantir une liberté d’action tout comme les deux seuls autres pays occidentaux, les États-Unis et le Royaume-Uni dont l’influence et les responsabilités, politiques et militaires, se situaient – et se situent toujours – à l’échelle mondiale. Cette garantie doit d’abord jouer vis-à-vis d’un adversaire. On pourrait appeler cela la « contre-dissuasion » : il s’agit de pouvoir neutraliser la dissuasion d’un pays adverse, qui chercherait à nous empêcher d’intervenir dans sa région, ou de soutenir un pays allié. Cela peut jouer vis-à-vis de la Russie, de la Chine ou de tout autre État. Mais cette force joue aussi, même si ce n’est pas de la même manière, vis-à-vis d’un allié – c’est-à-dire, dans les faits, des États-Unis. En fait, la toute première justification pour édifier une force nucléaire indépendante était d’affirmer aux yeux de Washington que la France ne voulait dépendre de personne dès lors que sa survie pouvait être mise en cause par un adversaire. Cette logique est l’un des soubassements de la politique extérieure française depuis 1960. Ainsi, n’aurait-il pas été plus difficile de s’opposer activement et frontalement aux États-Unis à propos de leur intervention en Iraq si la France avait été dans une situation de dépendance stratégique vis-à-vis de ce pays ?
Une fonction plus récente est de contribuer à la sécurité de pays alliés. Depuis 1974 (communiqué d’Ottawa), l’OTAN reconnaît que les forces indépendantes du Royaume-Uni et de la France participent au « renforcement global de la sécurité de l’Alliance ». L’idée est que ces forces compliquent le calcul d’un adversaire, qui doit compter avec trois centres de décision et non un seul. Plus récemment, la France a affirmé de plus en plus clairement que sa dissuasion protégeait aussi ses voisins européens : leur liberté et leur existence sont de plus en plus considérées comme un intérêt vital du pays. De manière générale, la dissuasion française crédibilise les engagements de défense pris par Paris en vertu de traités multilatéraux ou bilatéraux.
De fait, la possession d’une force de dissuasion contribue au rayonnement de la politique étrangère du pays : elle conforte l’image d’une puissance, et donc d’une diplomatie, indépendante. Cette fonction est peut-être encore plus utile depuis que la France a réintégré la structure militaire de l’OTAN en 2009, plus de quarante ans après l’avoir quittée.
Il n’en reste pas moins que la dissuasion nucléaire est centrale dans l’identité politique moderne de la France. C’est vrai à l’extérieur, comme on vient de le voir, mais c’est aussi vrai à l’intérieur, dans la mesure où – on le sait peu – l’une des raisons pour lesquelles le général de Gaulle tenait à ce que le président de la Ve République soit élu au suffrage universel direct était justement la possession d’une force nucléaire indépendante. Cela garantissait que lui- même et ses successeurs disposent de la légitimité populaire nécessaire pour engager le feu nucléaire et soient perçus ainsi par un adversaire potentiel.
Tout ceci à un coût relativement supportable pour l’économie française : la force de dissuasion représente bon an mal an une dépense d’environ 5 à 6 milliards d’euros, soit un peu plus de 20% des crédits d’équipement de la défense et de 10% du budget total. Elle est plus chère que la dissuasion britannique, mais celle-ci dépend bien davantage de l’étranger. Et, en contrepartie, les programmes nucléaires français ont des retombées importantes dans les autres domaines de l’industrie de défense : les exigences d’innovation, de fiabilité et de sûreté contribuent à l’amélioration de nombreuses technologies d’usage militaire.
Si la force française de dissuasion reste légitimement associée au nom du général de Gaulle, il convient de ne pas oublier que le programme nucléaire militaire français avait été lancé par les responsables de la IVe République. À l’époque, toutefois, il n’était pas question d’une force totalement indépendante : il s’agissait plutôt de donner à la France les mêmes moyens que les États-Unis et le Royaume-Uni. Le gouvernement était à l’époque convaincu qu’il ne serait pas possible de demeurer une grande puissance militaire sans l’arme atomique. Sans le général de Gaulle, toutefois, il n’est pas certain que la France aurait pu disposer d’une force nucléaire opérationnelle complète : il fallut en effet pour cela mobiliser des crédits significatifs.
Si le général de Gaulle a posé les fondements de la force nucléaire, ce n’est qu’au cours du double septennat de François Mitterrand (1981-1995) que la maturation de la dissuasion française est arrivée à son terme, avec trois composantes (terre, air, mer) solides et une doctrine bien définie. Cette doctrine s’inspirait à l’origine largement des « représailles massives » (d’après le surnom donné à la doctrine Dulles, doctrine nucléaire américaine à partir de 1953) adoptées par les États-Unis et le Royaume-Uni dans les années 1950. L’adoption de cette posture par les Britanniques avait attiré très tôt l’attention des stratèges français, au premier rang desquels le colonel Pierre Gallois. Elle reposait justement sur l’idée que le faible (la France) pouvait dissuader le fort (l’Union soviétique). Était également empruntée aux Américains et aux Britanniques la notion de « dommages inacceptables », comme critère clé de ce que doit pouvoir faire la force de dissuasion. Sous François Mitterrand, la doctrine fut consolidée autour de trois notions clés :
– la dissuasion nucléaire ne protège que les intérêts vitaux du pays. La définition de ces intérêts comporte une part de flou et est laissée à l’appréciation du président de la République, mais on considère généralement que le territoire, la population et la souveraineté de la France en constituent le cœur. La dissuasion serait susceptible de jouer quels que soient les moyens employés par l’adversaire – autrement dit, la force nucléaire n’est pas seulement destinée à empêcher une attaque nucléaire ;
– au cas où un adversaire se méprendrait sur la définition de ces intérêts vitaux ou semblerait s’approcher du seuil de ces intérêts, la France se réserve la possibilité de délivrer un avertissement nucléaire, c’est-à-dire une frappe unique (au moyen d’une ou plusieurs armes) et non renouvelable, sans doute sur un objectif militaire, destinée à convaincre l’adversaire de cesser son agression et ainsi à rétablir la dissuasion ;
– à titre de garantie ultime, la force de dissuasion doit pouvoir exercer des dommages inacceptables sur le territoire adverse, au moins équivalents, si ce n’est supérieurs, à ce que serait l’enjeu du conflit, et ce en toutes circonstances, c’est-à-dire même après une première frappe nucléaire adverse sur le sol français.
Les successeurs du président Mitterrand apportèrent naturellement leur pièce à l’édifice, tenant compte de l’évolution du contexte politique, stratégique et technologique. Jacques Chirac (président de 1995 à 2007) supprima les missiles sol-sol à moyenne portée du plateau d’Albion et mit un terme à toute distinction entre armes tactiques et armes stratégiques. On considère depuis lors que tout emploi de l’arme nucléaire aurait nécessairement un caractère stratégique, en ce qu’il ne manquerait pas de transformer profondément la nature d’un conflit. Jacques Chirac diversifia par ailleurs la doctrine nucléaire française, en variant la nature des objectifs possibles, au point qu’il ne fut plus possible de la qualifier d’« anti-cités » ou d’« antidémographique » (c’est-à-dire d’entendre que la planification française visait exclusivement les villes et les populations). La possibilité de cibler les centres de pouvoir politiques, économiques et militaires d’un adversaire régional fut ouverte, de même que celle d’exercer l’ultime avertissement au moyen d’un tir en haute altitude (pour affecter les systèmes électroniques adverses, voire paralyser un État). Ces décisions furent accompagnées d’une transformation majeure du complexe nucléaire français (fin des essais et passage à la simulation) et par la diversification des charges nucléaires dans le but de donner au président le maximum d’options possible en temps de crise. Pendant son mandat à la présidence de la République entre 2007 et 2012, Nicolas Sarkozy tira bénéfice de l’entrée en service d’un nouveau missile air-sol plus performant (ASPMA) pour réduire d’un tiers la composante nucléaire aéroportée en vertu du principe de suffisance. Il chercha par ailleurs à affirmer la conformité de la dissuasion avec le droit international en proclamant que l’ouverture du feu nucléaire ne pourrait se faire que dans des « circonstances extrêmes de légitime défense ». Son successeur François Hollande (2012-2017) laissa entendre que les objectifs de la force nucléaire seraient désormais exclusivement les centres de pouvoir de l’adversaire. Depuis 2017, le président Emmanuel Macron a, pour sa part, résolument confirmé, voire amplifié, la dimension européenne de la dissuasion : si Paris n’exerce pas une « dissuasion élargie » au sens américain du terme, la France n’en estime pas moins que ses intérêts vitaux sont désormais indissociables de ceux de ses voisins. En 2020, sans guère de succès, il a proposé d’approfondir le dialogue européen sur la dissuasion nucléaire. Son attachement à la dissuasion ne fait guère de doute : il est de notoriété publique qu’au début de la guerre en Ukraine, il a ordonné la mise à la mer d’un troisième SNLE (alors qu’habituellement pas plus de deux sont en mer), ce qui n’était pas arrivé depuis la fin de la guerre froide.
La dissuasion française : idées reçues et questions posées
Livre blanc sur la défense nationale, ministère de la Défense, tome I, juin 1972, p. 17 (www.defense-et-republique.org/1Fichiers/defense textes/1972_00_00_LB_V1.pdf).
Défense et Sécurité nationale. Le Livre blanc, Odile Jacob/ La Documentation française, 2008, p. 65.
« Discours du Président Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de dissuasion devant les stagiaires de la 27ème promotion de l’Ecole de guerre, elysée.fr, 7 février 2020 ».
Jean-Marie Guéhenno, art. cit.
Quelques idées reçues se retrouvent fréquemment dans le débat français.
• « La dissuasion pour la France est une question de prestige international. » Si, jusque dans les années 1970, la possession d’une force nucléaire était bel et bien associée dans notre pays, à un certain prestige, il y a bien longtemps que ce n’est plus le cas – notamment du fait des craintes de prolifération nucléaire. Les dirigeants français n’utilisent plus ce vocabulaire. Rappelons par ailleurs qu’il n’y a aucun lien direct entre le statut de puissance nucléaire et celui de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Les cinq pays concernés (la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France) disposaient de ce statut avant d’accéder à la puissance nucléaire. Et Paris soutient depuis longtemps une réforme du Conseil.
• « La France a une conception spécifique de la dissuasion nucléaire. » Cette idée ignore plusieurs points importants. Comme on l’a vu plus haut, nombre d’éléments de la doctrine française sont d’importation anglo-saxonne. À l’inverse, on a vu Washington et Londres adopter des idées françaises, comme le vocable « intérêts vitaux » ou encore l’idée selon laquelle, à l’époque moderne, tout emploi de l’arme nucléaire aurait nécessairement une vocation stratégique. Les trois puissances nucléaires alliées s’accordent sur les grands principes doctrinaux, mentionnés dans les déclarations et documents publics de l’OTAN. Il reste deux points de différenciation : le concept d’ultime avertissement, qui est par définition non renouvelable alors que nos alliés préfèrent garder, du moins sur le papier, une certaine souplesse dans l’escalade en cas d’échec de la dissuasion ; et la non-participation de la France aux instances nucléaires intégrées de l’OTAN.
• « La France n’imagine pas de dissuasion autre que nucléaire. » Il est vrai que la France s’est toujours méfiée de la dissuasion conventionnelle comme alternative à la dissuasion nucléaire. Pour autant, elle a endossé une conception globale de la dissuasion dans certains documents officiels tels que les Livres blancs sur la défense de 1972 (« l’effet dissuasif global de notre politique militaire27 ») ou de 2008 (« l’ensemble des capacités et des ressources, humaines et technologiques, militaires et civiles, contribue à dissuader des adversaires potentiels de s’en prendre à la sécurité de la France28 »), ou encore les textes officiels de l’OTAN.
• « La France n’est pas transparente sur sa force de dissuasion. » Ce reproche est très exagéré. La France fut même longtemps la seule puissance nucléaire à donner publiquement un ordre de grandeur sur l’ensemble de son arsenal. Le budget du CEA-DAM (Commissariat à l’énergie atomique-Direction des applications militaires) est public, ce qui n’est pas le cas pour toutes les institutions homologues étrangères. Les exercices conduits par les FAS sont délibérément visibles car ils participent à la démonstration de la dissuasion. Les installations nucléaires françaises, y compris les bases militaires, ont été largement ouvertes aux visites. On peut sans doute regretter en revanche l’absence d’un document officiel substantiel qui réunirait l’ensemble des éléments politiques et techniques non classifiés.
• « Le budget de la dissuasion est immunisé contre les coupes. » Il est exact que la dépense de dissuasion fait l’objet en France d’un traitement politique particulier : toutes les décisions dans ce domaine sont en effet pilotées directement par le président de la République. Mais ce budget a connu de nombreux ajustements à la baisse depuis la fin de la guerre froide : après 1991, il baissa en valeur relative (sa proportion dans le budget de la défense diminuant), puis en valeur absolue (sa proportion était maintenue mais le budget de la défense baissa). Ce n’est qu’à partir du milieu des années 2010 que la dépense nucléaire est remontée, la France entrant dans un nouveau cycle de rénovation de sa force nucléaire, avec notamment la mise en chantier d’une troisième génération de SNLE devant entrer en service au début des années 2030. Dans la loi de programmation militaire 2019-2023, la dissuasion est ainsi dotée de 25 milliards d’euros (soit en moyenne 5 milliards d’euros par an). Son budget pour 2022 a vu une forte hausse des autorisations d’engagement (6,2 milliards d’euros) qui s’explique par le passage au troisième incrément du missile M51 (M51.3) en 2025.
• « Le poids de la dissuasion dans le budget de la défense empêche la modernisation des moyens classiques. » L’idée d’une concurrence entre moyens classiques et nucléaires est populaire, notamment dans les armées. Elle est pourtant sujette à caution. Rappelons d’abord que la dissuasion est censée promouvoir la liberté d’action militaire de la France : les forces classiques sont adossées à cette dissuasion. Par ailleurs, l’importance de la dissuasion pour la France garantit des capacités développées pour protéger la dissuasion nucléaire qui sont à l’abri des coupes budgétaires disponibles pour les opérations classiques. Ce sont les sous-marins nucléaires d’attaque (qui, au demeurant, n’existeraient pas sans les compétences de propulsion nucléaire développées pour la dissuasion), les frégates anti-sous-marines, les avions de patrouille maritime, les avions ravitailleurs… Enfin, on peut dire que, du point de vue des performances techniques et humaines, les exigences du nucléaire tirent vers le haut l’ensemble de l’appareil de défense et de son industrie.
À court et moyen terme, la pérennité de la dissuasion nucléaire française semble assurée. Le durcissement des rapports de forces internationaux est de nature à inciter la France à la prudence plutôt qu’au désarmement. Ceci est d’autant plus vrai que les mouvements favorables à l’abolition des armes nucléaires ont toujours été assez faibles en France et qu’aucun parti ou responsable politique de haut rang n’appelle au désarmement unilatéral.
Il n’en demeure pas moins que certaines questions restent ouvertes :
• Que signifie ainsi exactement l’idée, évoquée par le président de la République en 2020, selon laquelle « notre stratégie de défense est un tout cohérent : forces conventionnelles et forces nucléaires s’y épaulent en permanence29 » ? On peut dire que la dualité des moyens (aériens en particulier) introduit une ambivalence bienvenue dans la dissuasion.
Les exercices des FAS sont des démonstrations d’aptitude classique et nucléaire. La présence des Rafale dans les cieux baltes ou sur le territoire émirati est celle d’une puissance nucléaire. L’opération Hamilton contre la Syrie, en 2018, fut une véritable démonstration de capacité à mener un raid nucléaire, défenses antiaériennes russes comprises. Encore faut-il rappeler que cette dualité pourrait impliquer des arbitrages en temps de crise grave : à quel moment faudrait-il réserver des Rafale, des SNA pour l’éventuel exercice de la dissuasion ? Enfin, imaginer une situation dans laquelle les forces classiques auraient pour rôle de retarder, par la bataille, l’attaque des intérêts vitaux du pays et le test des intentions adverses – soit le scénario principal de la guerre froide – demande une bonne dose d’imagination. Dans quel scénario contemporain précis verrait-on la France seule « prendre le risque d’une situation où la défaite conventionnelle ne pourrait être évitée qu’au prix de l’escalade nucléaire30 » ? Et si elle était engagée auprès de ses alliés aux marges de l’Europe, l’attrition de son corps de bataille relèverait- elle vraiment de l’atteinte aux intérêts vitaux, si loin du territoire national ? Dans de telles circonstances, la menace d’ouverture du feu nucléaire serait- elle crédible aux yeux de l’adversaire ?
• Jusqu’où la France devra-t-elle investir pour garantir l’efficacité dissuasive de sa force nucléaire ? Elle doit en effet s’adapter en permanence aux défenses adverses en investissant dans des technologies de pointe, notamment la vitesse hypersonique, qui sera en France une caractéristique du futur missile aérobie ASN4G, et dans la discrétion acoustique des SNLE. Elle devra également continuer à protéger ses systèmes de commandement et de communication contre toute intrusion cybernétique. Ces adaptations seront-elles toujours accessibles à un coût raisonnable ?
• Jusqu’où la France doit-elle prendre en compte, dans ses capacités et sa planification, les potentielles menaces lointaines (Chine, Corée du Nord), afin de parer à un chantage ou à une tentative de coercition de la part de ces pays ? Faut-il pouvoir exercer de manière autonome des dommages inacceptables sur ces pays, et ce quelles que soient les circonstances ? Les FAS, qui ont démontré depuis une dizaine d’années leur capacité à mener des opérations à très grande distance du territoire métropolitain, doivent-elles y jouer un rôle ?
• La transparence sur nos capacités techniques et opérationnelles est-elle suffisante pour garantir la dissuasion ? Alors qu’elle avait précisément décrit publiquement les caractéristiques de ses forces en 1994, la France reste peu diserte sur les adaptations consenties dans les années 1990 et 2000 (diversification des énergies, panachage des armes emportées par les missiles M51, possibilité de tir fractionné sur les SNLE…), dans le but de diversifier ses options de planification et ainsi affermir la dissuasion et la liberté d’action du président de la République. Nos adversaires potentiels les connaissent-elles ?
• Quelles seraient les conséquences pour la dissuasion française d’une rupture du contrat de confiance transatlantique, en cas de retour à la Maison-Blanche d’une personnalité du type de celle de Donald Trump ? Il n’y a pas de place aujourd’hui pour une dissuasion européenne mais, si le contexte évoluait, la France serait-elle prête à donner une garantie nucléaire formelle à ceux de ses voisins et alliés qui la souhaiteraient ? Et les adversaires potentiels la jugeraient-elle crédible ?
• Le volume de l’arsenal français devra-t-il être réévalué au vu de l’évolution du contexte stratégique et technologique ? C’est ce qu’ont fait les Britanniques en 2021, au vu notamment du développement des défenses antiaériennes et antibalistiques, ainsi que du raidissement simultané des politiques russe et chinoise (un éventuel abaissement du seuil nucléaire russe n’aurait en revanche aucune raison d’avoir des conséquences mécaniques sur le volume de cet arsenal). Une telle réévaluation pourrait aussi être opportune pour crédibiliser la protection nucléaire française vis-à-vis de ses alliés européens – même s’il n’y a aucun lien mécanique entre volume d’armes et crédibilité de la protection nucléaire. Aucune réponse ne peut être apportée de l’extérieur à cette question : d’abord, parce que les paramètres de la suffisance sont multiples (et hautement classifiés pour certains) ; ensuite, parce que cette suffisance reste fondamentalement tributaire des choix personnels du président de la République. Il n’en reste pas moins qu’affichant depuis quinze ans un arsenal de moins de trois cents armes, la France serait, dans l’hypothèse envisagée, contrainte d’ajuster son langage public.
Quelles recommandations en découlent :
1. L’articulation des forces classiques et des forces nucléaires mériterait d’être explicitée. De plus, la France ne devrait pas s’interdire de rappeler qu’elle reconnait (et pratique) d’autres formes de dissuasion, tout en continuant de souligner que la dissuasion nucléaire en est une forme particulière et unique.
2. Il n’y a sans doute pas lieu, en revanche, de faire évoluer significativement la doctrine française. Celle-ci est suffisamment simple et souple pour s’adapter aux changements de contexte. D’un côté, on pourrait imaginer de ne plus qualifier l’avertissement nucléaire d’« ultime » (c’est d’ailleurs ce que faisait Nicolas Sarkozy) afin de maximiser la liberté d’action du président – ce qui aurait comme avantage supplémentaire de mieux synchroniser notre doctrine avec celle de nos alliés –, mais une telle évolution serait-elle comprise ? De l’autre, suggérer que la dissuasion nucléaire devrait être réservée à prévenir la seule menace nucléaire serait singulièrement en décalage avec l’évolution du contexte contemporain (et n’aurait aucun impact sur les dynamiques de désarmement ou de non-prolifération).
3. Au lieu d’attendre que ses partenaires viennent vers elle, la France devrait nouer sans attendre un dialogue bilatéral discret avec ses alliés qui sont susceptibles d’être intéressés par une forme de « garantie complémentaire », du fait notamment des risques de rupture du contrat transatlantique.
4. L’évolution des risques nucléaires contemporains, notamment le rappro- chement stratégique constant entre la Russie et la Chine, rend pertinent l’intensification des concertations nucléaires officielles à trois (Londres, Paris, Washington), ainsi que l’établissement, s’il n’existe pas déjà, d’un lien de communication très protégé entre les trois capitales.
5. Paris aurait sans doute plus à gagner qu’à perdre en communiquant davantage et de manière plus précise que ce n’est le cas aujourd’hui sur les adaptations consenties à ses capacités nucléaires au cours des deux dernières décennies.
6. La France devrait envisager la publication d’un document officiel substantiel réunissant l’ensemble des éléments publics relatifs à la politique de dissuasion et à l’arsenal français, traduit dans les cinq langues officielles de l’ONU. Cet effort de communication aurait également des vertus sur le plan national, parce que l’effort budgétaire significatif qui sera consenti dans les années qui viennent pour préparer la dissuasion française aux défis du XXIe siècle devra être justifié auprès des opinions et parce que les acteurs de la dissuasion, et ceux qui s’y intéressent à un titre ou à un autre – y compris dans les milieux industriels –, doivent être convaincus de la détermination des autorités à maintenir l’effort nucléaire français.
Conclusion
Voir Jean-Luc Mélenchon et Bastien Lachaud, « La garantie de la dissuasion nucléaire n’est-elle pas déjà contournée par les moyens techniques contemporains ? », Le Monde, 11 janvier 2022.
La guerre en Ukraine est venue nous rappeler que les périls nucléaires restaient bien présents. Mais elle a également confirmé que les États qui disposent de forces de dissuasion sont des adversaires redoutables que l’on ne peut affronter aisément. On peut gloser à l’infini, comme le font certains experts, sur la question de savoir si nous vivons un deuxième, un troisième, voire un quatrième âge nucléaire. Il semble plus utile de prendre conscience au moment où commence à se dessiner l’horizon de la fin du premier siècle nucléaire (2045), de la pérennité des éléments fondamentaux de la dissuasion en dépit des transformations profondes des contextes politique, stratégique et technologique depuis la première explosion nucléaire dans le désert d’Alamogordo le 16 juillet 1945, tout en étant conscient de la fragilité intrinsèque de l’ordre nucléaire international. Celui-ci est fondé sur trois éléments : la limitation du nombre d’États détenteurs de l’arme ultime, la coïncidence entre le statut d’État doté et celui de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, et la tradition de non-utilisation. Ce dernier point est de loin le plus important. En dépit de sa très faible probabilité, l’hypothèse du troisième emploi de l’arme nucléaire ouvrirait alors véritablement un deuxième âge nucléaire, et personne ne peut dire à quoi il ressemblerait.
Entre-temps, rien ne prouve qu’un autre instrument militaire puisse se substituer totalement à la dissuasion nucléaire. Aucune autre technologie en vue n’offre la même combinaison de destruction instantanée, aussi redoutable et prévisible à grande échelle. On voit mal comment, par exemple, la « dissuasion spatiale » (depuis et vers l’espace) prônée par certains politiques français, notamment Jean-Luc Mélenchon, pourrait couvrir les intérêts vitaux d’un pays de manière aussi crédible – sans compter le coût phénoménal d’une telle réorientation (qui, au demeurant, irait à l’encontre de tous les efforts de la France pour limiter la militarisation de l’espace extra-atmosphérique)31.
Cela ne met pas fin aux interrogations légitimes sur l’acceptabilité morale de se fier à la dissuasion nucléaire à long terme. Ce qui peut être considéré comme un compromis valable entre les risques et les coûts présumés en tant que mesure temporaire peut ne pas être satisfaisant ad vitam æternam.

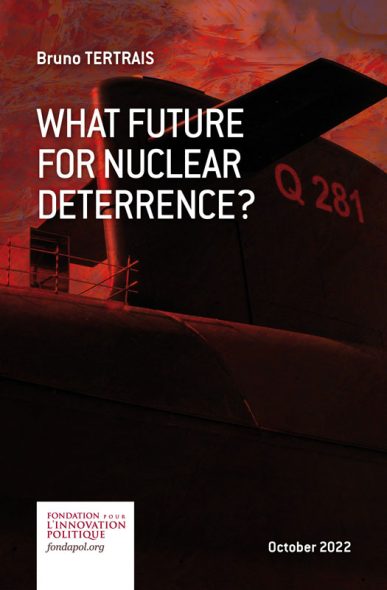

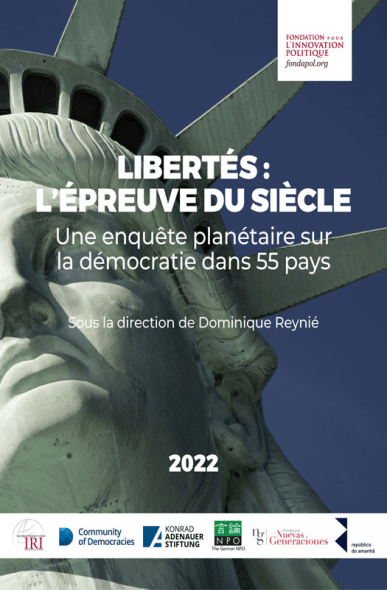















Aucun commentaire.