Reconquérir la biodiversité, mais laquelle ?
Introduction
La diversité biologique en Europe : une coconstruction entre processus spontanés et activités anthropiques
Une biodiversité appauvrie par les glaciations
Une anthropisation très ancienne
L’équilibre de la nature : un concept écologique équivoque
L’héritage culturel et la représentation mécaniste de la nature
Les systèmes écologiques sont dynamiques et adaptatifs
Des futurs incertains et la difficulté de prévoir
Les espèces qui dérangent
Les espèces nuisibles : un qualificatif litigieux
Peut-on se protéger des pathogènes ?
Les services écosystémiques : des biais surprenants
L’être humain détruit-il la nature ?
Des ambiguïtés concernant la notion de nature
Des discours paradoxaux
Les aménagements détruisent-ils la biodiversité ?
Reconquérir quoi ?
Penser différemment : des « nouveaux écosystèmes »
Comment construire le futur ?
Des situations hétérogènes
Anticiper les réponses à apporter par une diversité d’approches adaptées aux contextes écologiques locaux
Les aires protégées ne sont pas la solution universelle
Pour un droit de l’environnement flexible et réactif
L’auteur de la présente note déclare ne pas avoir de conflit d’intérêts avec le sujet traité. Les opinions exprimées n’engagent pas les instances auxquelles il appartient.
Résumé
Adoptée en 2016, la loi sur la biodiversité parle de « reconquérir » la biodiversité. Mais laquelle ? La biodiversité en France métropolitaine est le produit d’une coconstruction entre processus spontanés et aménagements qui se sont succédé au cours des siècles. Elle a changé en permanence sous l’effet des changements climatiques, de l’anthropisation des territoires et des nombreuses espèces introduites volontairement ou accidentellement. Il n’y a donc pas de situation historique qui puisse servir de référence à des projets de restauration. Et s’il n’y a pas d’équilibre de la nature, il n’est pas possible non plus d’établir de normes en la matière sur lesquelles s’appuyer pour élaborer des lois.
Pour gérer notre biodiversité, il est donc nécessaire de répondre à la question : quelle(s) nature(s) voulons-nous ? Il faut se fixer des objectifs réalistes qui tiennent compte à la fois de la préservation de ce patrimoine naturel et de considérations économiques et sanitaires, tout en anticipant les changements à venir qui sont inéluctables (réchauffement climatique, naturalisation d’espèces…). L’avenir étant incertain, il faut privilégier une démarche adaptative et pragmatique, en fonction d’objectifs qui peuvent être réactualisés si nécessaire. Nous devons en effet intégrer la prise en compte du changement et le rôle des événements aléatoires dans nos politiques environnementales *.
Christian Lévêque,
Directeur de recherches émérite de l’Institut de recherches pour le développement (IRD), ex-directeur du programme interdisciplinaire « Environnement, Vie et Sociétés » du CNRS, président honoraire de l’Académie d’agriculture de France.

Glyphosate, le bon grain et l'ivraie

Les biotechnologies en Chine : un état des lieux

OGM et produits d'édition du génome : enjeux réglementaires et géopolitiques
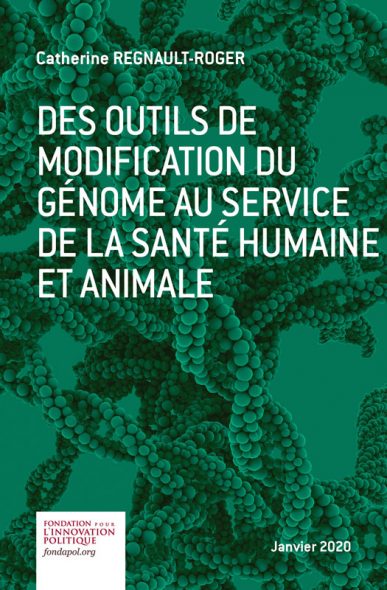
Des outils de modification du génome au service de la santé humaine et animale

Des plantes biotech au service de la santé du végétal et de l'environnement

L'Affaire Séralini l'impasse d'une science militante

L’eau : du volume à la valeur

Productivité agricole et qualité des eaux

Gestion de l’eau, vers de nouveaux modèles

L’irrigation pour une agriculture durable

Eau : défis mondiaux, perspectives françaises

Eau : comment traiter les micropolluants ?
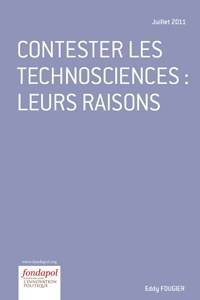
Contester les technosciences : leurs raisons

Contester les technosciences : leurs réseaux
Introduction
Loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Journal officiel, 9 août 2016.
Le préjudice écologique est un principe juridique selon lequel la dégradation d’un écosystème et des services qu’il nous rend constitue un préjudice qui justifie des réparations ou des compensations matérielles ou financières le cas échéant.
Voir Christian Lévêque, L’écologie est-elle encore scientifique ?, Quæ, 2013.
Voir Pierre Athanaze, Le Retour du sauvage, Buchet-Chastel, 2015.
Voir Patrick Blandin, De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité, Quæ, 2009 ; Christian Lévêque, La Biodiversité : avec ou sans l’homme ? Réflexions d’un écologue sur la protection de la nature en France, Quæ, 2018.
Voir Jacques Lepart, Pascal Marty et Jocelyn Fonderflick, « Naturalité ou biodiversité ! Quels enjeux de conservation, quels modes de mise en œuvre ?», in Daniel Vallauri, Jean André, Jean-Claude Génot, Jean-Pierre De Palma et Richard Eynard-Machet (dir.), Biodiversité, naturalité, humanité. Pour inspirer la gestion des forêts, Lavoisier, 2010, p. 73-80.
Voir Paul Arnould et Éric Glon, « Wilderness, usages et perceptions de la nature en Amérique du Nord », Annales de géographie, n° 649, mai-juin 2006, p. 227.
Le terme « diversité biologique » désigne l’ensemble des différentes formes de vie et de leurs habitats existant sur la Terre. L’expression «biodiversité » est, quant à elle, née dans les années 1980, dans le cadre de débats sur l’impact croissant de l’être humain sur la nature et de l’inquiétude de voir disparaître définitivement des espèces et des systèmes écologiques. Elle a connu un succès indéniable, au point que la protection de la diversité biologique est devenue l’un des grands enjeux de société, et qu’elle a fait l’objet d’une Convention internationale sur la diversité biologique, au même titre que la Convention sur le changement climatique.
La biologie de la conservation est une discipline scientifique issue de l’écologie scientifique qui se donne pour objectif de développer des outils et des méthodes en vue de protéger la diversité biologique et de restaurer les systèmes écologiques dégradés par les activités humaines. Elle inspire les politiques environnementales telles que la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, promulguée le 8 août 2016 1, après de longs débats. Cette loi introduit notamment les concepts de préjudice écologique 2, de non-régression du droit de l’environnement ou encore de compensation avec « absence de perte nette de biodiversité », qui ne sont pas sans conséquences sur notre vie quotidienne et nos économies.
Cependant, si nombre de citoyens affichent une réelle empathie vis-à-vis de la nature et sont favorables à la protection de la biodiversité, ils ne savent pas toujours pour autant à quoi les engage la loi de 2016. Il est vrai que la progression démographique de l’espèce humaine et le développement de moyens techniques de production toujours plus puissants ont conduit inexorablement à une emprise croissante de nos sociétés sur la planète, sur les ressources naturelles et sur le monde vivant en général. Il est donc légitime que cette situation crée des inquiétudes et que l’on essaie d’y remédier. Mais derrière le slogan « protéger la biodiversité », nous ne partageons pas nécessairement la même analyse de la situation et des solutions à apporter. Celles-ci doivent reposer sur des bases objectives et transparentes. C’est bien sur la question de la philosophie qui sous-tend la loi et de la prise en compte effective des connaissances scientifiques qu’il y a débat.
En effet, de nombreux mouvements de protection de la nature privilégient l’image d’un « paradis perdu », d’une nature bonne et généreuse, pourvoyeuse de biens et de services, dans laquelle tout est harmonie. Par contraste, ils portent un regard particulièrement négatif sur l’être humain, accusé d’être l’ennemi de la biodiversité et de dégrader la nature, par le canal de messages anxiogènes. Mais ils sont beaucoup moins diserts sur le fait que la nature est également une source inépuisable de nuisances. Les citoyens, exposés aux maladies, aux ravageurs de culture ou aux aléas climatiques, n’ignorent pas cette face cachée de la nature, et ils ont depuis longtemps compris qu’elle avait un double visage. Le succès de l’espèce humaine est probablement lié à ses capacités à utiliser les ressources de la nature mais également à se protéger des méfaits dont elle est aussi prodigue. Or si la loi parle de retrouver une harmonie avec la nature, elle est étrangement muette sur les autres aspects. Dans ce contexte, les sciences de la nature sont souvent instrumentalisées pour mener des recherches à charge dénonçant les impacts de l’espèce humaine sur la nature, tout en occultant le fait qu’il existe aussi des situations où la nature aménagée et sécurisée est appréciée des citoyens 3.
La loi de 2016 est d’autre part ambiguë sur les objectifs à atteindre. Que signifie concrètement l’expression « reconquête de la diversité biologique » qui figure dans le titre ? Quelle(s) nature(s) voulons-nous recréer ? Pour certains, il s’agit de retrouver une nature « sauvage », celle qui existerait si l’homme ne la détruisait pas 4. Un projet qui semble en décalage avec la réalité vécue car, en France métropolitaine, pays de tradition agricole, la « nature » que nous apprécions est une nature coconstruite au fil des siècles par les activités humaines et les processus spontanés 5.
C’est cette nature patrimoniale, jardinée, qui dépend pour partie du maintien des pratiques agricoles, que de nombreux citoyens souhaitentprotéger 6.
Les politiques de protection de la biodiversité ne s’appuient que partiellement sur les connaissances scientifiques car, de toute évidence, des considérations politiques, culturelles et idéologiques sont également à l’œuvre. Si la biodiversité est devenue si populaire, c’est qu’elle n’est pas seulement un objet naturaliste. Les êtres humains ont des rapports complexes à la nature, lesquels, au-delà de l’utilitaire, relèvent aussi du domaine des émotions, de l’éthique ou de l’esthétique. Comme l’expriment très bien les deux géographes Paul Arnoud et Éric Glon, « s’il est un terme “piégé”, c’est bien celui de nature. De prime abord il semble aller de soi, couler de source, comme dans l’expression “c’est tout naturel”. En fait il est surchargé de perceptions, de représentations, de connotations qui font que la nature des uns n’est jamais vraiment celle des autres, que la nature d’hier n’est pas toujours celle d’aujourd’hui et que la nature d’ici n’a pas grand-chose à voir avec celle d’ailleurs 7 ».
Diverses idées fausses en matière de restauration de la biodiversité continuent de circuler, comme le concept très populaire d’« équilibre de la nature », qui nous conduit irrémédiablement à des impasses. Nous savons en effet que l’histoire de la diversité biologique est une succession d’aléas, d’opportunités et de hasards. Les systèmes écologiques sont en perpétuelle transformation et la biodiversité est le produit du changement, pas du statu quo. Le futur n’est donc pas dans la stricte conservation de l’existant, ni dans un retour vers le passé. Pourtant, cette idée selon laquelle la nature est stable et en équilibre sous-tend encore nos politiques de restauration des systèmes écologiques dans l’objectif souvent affiché de retrouver un état antérieur. L’objectif « zéro perte de biodiversité » illustre également la persistance de cette vision fixiste de la nature, quand bien même la biodiversité est éminemment dynamique. Dans un système écologique, des espèces disparaissent alors que d’autres apparaissent, en fonction des changements de l’environnement. Sans compter qu’en Europe de nombreuses espèces venues de différents continents se sont naturalisées et que d’autres continuent d’arriver. Elles font maintenant partie intégrante de notre flore et de notre faune, qui s’en trouvent ainsi enrichies. Cette conception comptable de la biodiversité, en décalage avec la réalité du terrain, ne repose donc pas sur les connaissances scientifiques mais sur une représentation idéologique d’une nature supposée vierge.
La mise en application d’un tel principe ne répond pas à la réalité observée et ne peut que nous mener à des impasses.
Les débats existent également en écologie entre des scientifiques qui, eux aussi, ont différentes représentations du fonctionnement des systèmes écologiques. Il n’y a là rien d’anormal puisque l’écologie s’intéresse à des systèmes particulièrement complexes, dont la dynamique est soumise à de nombreux paramètres que l’on a souvent des difficultés à bien appréhender. Il n’en reste pas moins que certains écologues, parfois tentés d’anticiper le futur, franchissent la ligne jaune en matière de déontologie qui veut que toute déclaration s’appuie sur des données vérifiées et validées. Nous devons rester modestes quant à nos capacités de prévisions.
| Les systèmes écologiques sont des systèmes complexes
« L’écologie n’est pas une science facile : c’est probablement aujourd’hui la science la plus difficile. Elle exige des connaissances de haut niveau en mathématiques et en physique. Elle demande de connaître l’histoire naturelle, avec la chaîne alimentaire, ou encore la biochimie. C’est une science tellement difficile qu’on a du mal à maîtriser ses concepts. Et en face de la science la plus difficile, je vois naître l’idéologie la plus facile ! J’entends des politiciens, qui se déclarent écologistes, dire des choses d’une naïveté et d’une platitude telles que je ne peux pas les croire, étant donné qu’ils ne connaissent pas la science en question. D’autre part, je vois des écologues, des spécialistes, qui dévoilent toute sa complexité. Ceux-là hésitent à s’engager dans l’arène politique, ce qui fait que je me pose des questions. » Michel Serres, « Science, biodiversité, écologie et mondialisation », conférence prononcée à l’occasion du colloque annuel de l’association Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse de l’environnement (Farre), 11 janvier 2006. |
Enfin, si la nature peut se passer des humains, ces derniers ne peuvent pas vivre sans utiliser les ressources que leur procure la nature. Il est évident que l’existence de l’espèce humaine implique des usages de l’eau, des sols et des ressources naturelles avec des conséquences sur les systèmes écologiques. Il reste bien entendu à trouver des compromis pour parvenir à une cohabitation durable. Peut-on faire autrement ? Le projet de restaurer une nature vierge est incompatible avec la présence des hommes. Cela pose la question de l’extension des aires protégées desquelles les êtres humains sont exclus, réclamée par certains militants de la protection de la nature et adoubée par les décideurs politiques.
| Retour sur le mouvement One Planet
Le mouvement One Planet a été créé en décembre 2017 à l’initiative conjointe de la France, de l’Organisation des nations unies (ONU) et de la Banque mondiale. Son objectif est de soutenir la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la nature au plus haut niveau politique afin de mobiliser les acteurs de la vie publique et du monde économique. Ce que l’on a appelé la « diplomatie verte » reprend en bonne partie le discours des collapsologues selon lequel la survie de l’humanité dépend de la protection de la biodiversité. À l’instar de toutes les réunions internationales sur le sujet, celle du 11 janvier 2021 a fait le constat qu’aucun des objectifs fixés pour la décennie écoulée en matière de protection de la biodiversité n’a été atteint. Une proposition majeure est d’œuvrer à la protection de 30% des espaces terrestres et marins d’ici à 2030, malgré les mises en garde de nombreuses organisations et experts alertant sur les graves conséquences pour les peuples autochtones concernés par ces mesures de conservation, en l’absence de normes contraignantes en matière de droits humains. On ne peut plus fermer les yeux, en effet, sur les exactions qui ont eu lieu dans la mise en place des parcs naturels africains*. Il est donc légitime de s’interroger sur les raisons pour lesquelles des chefs d’État soutiennent des politiques totalement écocentrées qui font peu de cas des humains concernés par ces mesures. * Voir Guillaume Blanc, L’Invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le mythe de l’Éden africain, Flammarion, 2020. |
Dans cette étude, il sera surtout question de la gestion de la biodiversité en France métropolitaine, dans le contexte européen. En effet, la composition et le mode de fonctionnement des systèmes écologiques sont étroitement dépendants des contextes locaux et régionaux dans lesquels ils se situent, ainsi que des relations que les êtres humains ont entretenues, dans l’histoire, avec leur environnement. Autrement dit, les questions et les solutions aux problèmes qui se posent dans un pays européen ne sont pas comparables avec ceux que l’on rencontre, par exemple, à Bornéo ou dans la forêt congolaise. Cela permet de s’affranchir des discours généraux et décontextualisés qui alimentent actuellement la doxa de l’érosion de la biodiversité et qui prennent beaucoup de liberté avec la rigueur scientifique.
La diversité biologique en Europe : une coconstruction entre processus spontanés et activités anthropiques
Une biodiversité appauvrie par les glaciations
Voir Christian Lévêque, La Biodiversité…, op. cit.
Pour discuter de l’état et de l’avenir de la diversité biologique en Europe, il faut d’abord savoir dans quel contexte cette diversité s’est constituée. Toutes les régions du monde n’ont pas la même histoire évolutive. L’Europe, en particulier, a connu une histoire climatique mouvementée et nos systèmes écologiques ont été transformés par les êtres humains depuis des millénaires 8.
Durant les deux derniers millions d’années, l’Europe a connu des cycles de glaciation au cours desquels les calottes polaires descendaient plus ou moins loin vers le sud, suivies de périodes de réchauffement. Lors des avancées des glaciers, la flore et la faune qui ont survécu ont trouvé refuge dans le sud de l’Europe. De là, elles ont progressivement recolonisé les terres libérées par les glaces au cours des périodes de réchauffement. Ces cycles de grande ampleur (100.000 ans en moyenne) étaient eux-mêmes ponctués de nombreuses fluctuations du climat, parfois rapides. Ces mouvements ont fragilisé certaines espèces et ont parfois entraîné leur disparition. Ce fut le cas pour la mégafaune que nos ancêtres avaient dessinée sur les parois des grottes (lions, mammouths, rhinocéros, tigres, etc.). Quoi qu’il en soit, la recolonisation de terres libérées par les glaces à l’issue de la dernière période glaciaire a été un long processus, en fonction des capacités de chaque espèce à retrouver les conditions écologiques favorables à sa réinstallation mais aussi des opportunités de déplacement.
Une anthropisation très ancienne
Une espèce commensale est une espèce sauvage qui vit à proximité des êtres humains en se nourrissant de leurs déchets ou de leurs productions agricoles, à l’exemple des blattes, des moineaux, des pigeons, des rats, etc.
Les messicoles (coquelicots, bleuets…) sont des plantes annuelles à germination préférentiellement automnale ou hivernale présentes dans les champs de céréales d’hiver (blé, orge, avoine, seigle).
Voir Clélia Sirami, Lluis Brotons et Jean Louis Martin, « Vegetation and songbird response to land abandonment: from landscape to census plot », Diversity and Distributions, vol. 13, n° 1, janvier 2007, p. 42-52.
La reconstruction de la diversité biologique après la dernière période glaciaire doit également beaucoup au rôle des humains. D’une part, les agriculteurs venus du Croissant fertile ont amené avec eux les espèces qu’ils cultivaient mais aussi les espèces commensales 9 ou les plantes messicoles 10. Dans l’Antiquité, les plantes ont circulé dans le Bassin méditerranéen (la vigne, notamment) grâce aux échanges commerciaux, et les croisés ont ramené d’Orient nombre de plantes médicinales ou ornementales. Puis, durant la période des Grandes Découvertes, des naturalistes voyageur ont ramené vers le Vieux Continent des espèces utiles à notre économie, que l’on a élevées et préservées dans les différents jardins européens, par exemple au Jardin d’acclimatation, à Paris. Les Amériques nous ont ainsi fourni la plupart des espèces actuellement cultivées non seulement en Europe mais partout dans le monde. Avec ces espèces sont également venus leurs parasites.
La diversité biologique en France métropolitaine est ainsi un melting-pot d’espèces qui ont survécu aux glaciations ou qui ont recolonisé les terres lors du réchauffement et auxquelles sont venues s’ajouter de nombreuses espèces introduites volontairement ou accidentellement par les êtres humains au cours des millénaires. Le flux d’espèces venues d’autres continents par le biais d’échanges commerciaux et qui se naturalisent en Europe est par ailleurs en augmentation.
Mais il n’y a pas que les espèces. On peut penser que si l’Europe n’avait pas été colonisée par l’espèce humaine, elle aurait été en grande partie couverte de forêts et de marécages. L’agriculture a créé des systèmes écologiques dits ouverts et introduit de l’hétérogénéité dans les paysages. La valorisation des territoires a créé de nouveaux systèmes écologiques qui nous sont familiers, comme les bocages, les alpages ou de nombreuses zones humides telles que la Camargue, la Dombes, la Sologne, etc. Tout cela a créé une grande diversité d’habitats par rapport à la relative monotonie des systèmes forestiers. Si l’on observe aujourd’hui que la forêt regagne du terrain, c’est au détriment d’autres systèmes écologiques que nous cherchons par ailleurs à préserver. Par exemple, les terrains pastoraux, créés par l’être humain, qui ne sont plus utilisés sont recolonisés par une flore arbustive, puis par des reboisements spontanés. Avec pour résultat la régression des espèces dites de milieux ouverts qui leur étaient inféodées et qui, pour certaines, ont un intérêt patrimonial 11.
En résumé, on peut dire qu’en Europe la diversité biologique a sans cesse évolué sous l’influence du climat et des activités anthropiques. Depuis la dernière période glaciaire, la diversité biologique, très appauvrie en métropole, s’est fortement enrichie, en partie grâce aux hommes. Cette biodiversité hybride, coconstruite par des processus spontanés et des pratiques agricoles dont nous avons hérité, n’a rien d’une nature vierge. Elle continuera sans aucun doute à se transformer sous l’influence de nouvelles naturalisations d’espèces et des changements climatiques. Il est donc illusoire de se référer à une situation historique qui pourrait servir de modèle dans le cadre de projets de reconquête. Le passé explique l’état présent mais le futur ne sera jamais le passé.
L’équilibre de la nature : un concept écologique équivoque
Michel Serres, « Science, biodiversité, écologie et mondialisation », conférence prononcée à l’occasion du colloque annuel de l’association Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse de l’environnement (Farre), 11 janvier 2006.
L’idée selon laquelle la nature est en équilibre est fortement ancrée dans la culture populaire et c’est un concept fondateur de la science écologique. Pourtant, tous les travaux des paléontologues et des paléo-écologistes montrent que les systèmes écologiques se sont modifiés en permanence au fil du temps.
Dans l’une de ses conférences, le philosophe Michel Serres disait à ce propos : « Les écologistes mentionnent souvent le terme d’“équilibre”, alors que dans la science écologique, il n’y a que des “déséquilibres”, comme d’ailleurs dans les équations chimiques et biochimiques. La nature est toujours en évolution, donc toujours en déséquilibre. Sauver un équilibre est un concept politique, ce n’est pas un concept savant. Et là aussi, j’ai une difficulté à réunir ce que dit la société et ce que disent les savants. Voilà un mariage bien difficile à célébrer ! 12 » En effet, nous pensons bien souvent, et de manière erronée, que la nature réagit de la même manière qu’un culbuto, ce jouet en forme de petit personnage qui repose sur une base arrondie et lestée, et qui, quand on le bouscule, revient toujours en position verticale. Par analogie, on imagine qu’il suffirait d’interrompre les pressions que l’être humain exerce sur un système écologique pour que ce dernier revienne à son état supposé initial, c’est-à-dire à un état antérieur. La réalité est pourtant bien différente.
L’héritage culturel et la représentation mécaniste de la nature
Voir Christian Lévêque, Jean-Claude Mounolou, Alain Pavé et Claudine Schmidt-Lainé, « À propos des introductions d’espèces. Écologie et idéologies », Études rurales, n° 185, janvier-juin 2010, p. 219-234.
Voir Frederic Clements, Plant Succession. An Analysis of the Development of Vegetation, Carnegie Institution of Washington, 1916.
Donald Worster, Les Pionniers de l’écologie, Sang de la Terre, 2009.
Voir Daniel Botkin, The Moon in the Nautilus Shell. Discordant Harmonies Reconsidered, Oxford University Press, 2012.
Très populaire, l’idée d’équilibre de la nature est en réalité un héritage de la croyance selon laquelle la nature créée par Dieu est nécessairement parfaite et immuable, et qu’elle se perpétue identique à elle-même. La représentation créationniste, toujours vivace, d’une nature idéalisée s’est perpétuée avec les mouvements romantiques au XIXe siècle, puis dans les paradigmes fondateurs de l’écologie scientifique. Cette dernière s’était donnée pour objectif la découverte de lois générales régissant le fonctionnement des systèmes écologiques.
Dans les années 1960, l’écologue américain Eugene Odum comparait les systèmes écologiques à une horloge ou à une machine dans laquelle chaque pièce joue un rôle et participe au fonctionnement global de l’ensemble.
L’écologie, qui ambitionnait de copier les sciences physiques, cherchait à intégrer les principes de la cybernétique, avec la notion d’équilibre régulé par des mécanismes de rétroaction 13. On parle alors d’équilibre dynamique entretenu par des flux d’énergie, mais aussi de « résilience », qui traduit la capacité d’un système à subir, dans certaines limites, des déformations et à revenir à un état proche de l’état initial. Depuis, le terme « équilibre » et son contraire, « déséquilibre », sont ainsi très largement utilisés dans le langage écologique, de même que l’expression « dysfonctionnement des écosystèmes ». Autant d’expressions qui laissent penser qu’il existerait un état idéal auquel on puisse se référer en matière de gestion de la nature. C’est ce qu’avait suggéré le botaniste américain Frederic Edward Clements au début du XXe siècle avec la notion de « climax », qu’il définissait comme le stade ultime et supposé idéal de l’évolution des écosystèmes lorsqu’ils ne sont pas perturbés par les activités humaines 14. Une autre manière de parler de nature vierge.
Ce concept, très discuté par les scientifiques, a néanmoins un fort pouvoir évocateur. Donald Worster, un historien de l’écologie, écrivait en 1992 que « l’écologie du climax avait l’avantage de rappeler l’existence d’un monde idéal capable de servir de point de référence à la civilisation humaine 15 ». Par cet exemple, on voit à quel point la politique et l’imaginaire peuvent interférer avec la science.
L’attrait exercé par les lois de la physique et la thermodynamique a pu laisser penser que les phénomènes observés en écologie étaient également reproductibles et réversibles. L’expérience a montré que ce n’était pas le cas. Parmi d’autres, l’Américain Daniel Botkin a souligné la fracture radicale qui existe entre ce mythe de l’équilibre de la nature, qui domine la pensée environnementale, et la réalité, en mettant l’accent au contraire sur les notions d’incertitude, d’imprévisibilité, de changement et de complexité 16.
Les systèmes écologiques sont dynamiques et adaptatifs
La résilience rend compte de la capacité d’un écosystème à s’adapter au changement, à se rétablir et à se réorganiser après Elle rend compte de l’ampleur des perturbations qui peuvent affecter un écosystème sans que ce dernier passe à un nouvel état, différent de structure et de fonctionnement.
Henri Décamps, « Les écosystèmes : foire aux questions », Institut de France-Académie des sciences, 2013, p. 16.
Voir Bernard Riéra, « Rôle des perturbations actuelles et passées dans la dynamique et la mosaïque forestière », Revue d’écologie, vol. 50, n° 3, juillet-septembre 1995, p. 209-222.
On sait que les écosystèmes sont des systèmes ouverts et dynamiques, dont les caractéristiques ainsi que les espèces qu’ils abritent varient dans le temps. Les changements difficilement perceptibles sur de courtes périodes et qui donnent une fausse impression de stabilité deviennent néanmoins apparents sur le long terme. C’est ce que l’écologue américain John Magnuson appelait, de manière imagée, le « présent invisible ». En effet, l’histoire de la biosphère telle que reconstituée par les paléontologues est fondamentalement chaotique et la diversité biologique est le produit de cette histoire marquée de périodes de crises.
En réalité, deux conceptions de l’organisation et du fonctionnement des écosystèmes s’affrontent depuis longtemps en écologie. Selon l’hypothèse dite déterministe, héritière de la pensée fixiste de la nature, il existe une organisation intrinsèque des écosystèmes et le fonctionnement d’un écosystème est déterminé par l’interaction de ces éléments constitutifs (les espèces) qui en assurent la régulation. Par assimilation à la machine, toutes les espèces sont indispensables au fonctionnement du système. On peut ainsi lire sous la plume d’un biologiste : « Chaque espèce est un produit unique de l’évolution, fonctionnellement complémentaire des autres espèces de l’écosystème, et donc potentiellement indispensable à sa résilience 17 face aux perturbations actuelles et à venir 18. » En d’autres termes, chaque espèce joue son rôle dans l’écosystème de telle sorte que la conservation de toutes les espèces est nécessaire pour maintenir un système écologique fonctionnel.
L’évolution des connaissances en écologie a remis en question cette manière de se représenter l’écosystème. Comme ce fut le cas pour la génétique, où l’on a mis l’accent sur le rôle du hasard, les facteurs aléatoires jouent un rôle important dans l’évolution des systèmes écologiques. Selon l’hypothèse dite stochastique, les peuplements se sont constitués de manière opportuniste, en fonction des stratégies individuelles des espèces et des fluctuations de l’environnement. Si ces espèces cohabitent, c’est qu’elles ont trouvé de manière conjoncturelle, dans le système écologique considéré, les conditions favorables à leur reproduction. Quand les conditions écologiques se modifient, des espèces disparaissent, mais elles seront remplacées par d’autres. Le peuplement est donc par essence évolutif et adaptatif, comme l’a montré la reconstitution de la biodiversité européenne après la dernière période glaciaire.
Il existe donc une opposition fondamentale entre une représentation qui privilégie l’existence d’un ordre de la nature et une autre qui parle d’une nature opportuniste, adaptative, sans projet précis. Deux conceptions philosophiques, a priori peu compatibles, qui divisent les scientifiques mais aussi les gestionnaires de l’environnement. Selon l’hypothèse privilégiée, on ne verra pas de la même manière la question des introductions d’espèces, ni les modifications des peuplements résultant des changements climatiques ou des activités humaines. Dans le premier cas, on parlera de perturbation du système, alors que dans le second on parlera des capacités d’adaptation. Mais, pour les gestionnaires, ouvrir la porte au hasard et à l’instabilité reviendrait, dans une certaine mesure, à ouvrir la boîte de Pandore car il est alors difficile de faire des prévisions.
De manière paradoxale, c’est à présent le rôle positif des perturbations qui est mis en avant par les écologues, qui montrent que les fluctuations de l’environnement favorisent la diversité biologique en réduisant la pression des espèces dominantes sur les autres espèces, permettant ainsi à ces dernières de se développer 19. Autrement dit, la coexistence d’un grand nombre d’espèces serait plutôt le résultat dephénomènes de non-équilibre que de phénomènes d’équilibre. C’est ainsi le cas pour les chablis, ces trouées forestières formées d’arbres déracinés ou cassés qui participent à la régénération naturelle de la forêt et créent une hétérogénéité des paysages favorable à l’entretien et au renouvellement de la biodiversité.
Des futurs incertains et la difficulté de prévoir
Nos systèmes écologiques sont évolutifs et, disent les écologues, leur dynamique s’inscrit sur des trajectoires spatiales et temporelles. Ces trajectoires sont sous le contrôle de nombreux paramètres, anthropiques et non anthropiques, à l’exemple notamment du climat. Dans ce contexte, les événements aléatoires, donc non prévisibles, vont jouer un rôle important. Ces événements sont pris en compte dans les exercices de prospective sous la rubrique « scénarios de rupture ». Difficile, en effet, d’anticiper les conséquences d’événements climatiques exceptionnels ou d’une épidémie, ou encore d’une politique environnementale sur la dynamique d’un système écologique. Difficile aussi de prévoir la disparition d’espèces ou, au contraire, la naturalisation de nouvelles espèces qui vont modifier la structure et le fonctionnement des systèmes écologiques. En d’autres termes, l’évolution à moyen et long terme de ces systèmes n’est pas prévisible. Elle est tout au plus spéculative et les modèles ont bien évidemment du mal à les prendre en compte, ce qui relativise beaucoup leur pourvoir supposé prédictif.
Comment faire si nous n’avons plus de repères fixes ? Et, pour les gestionnaires qui ont besoin de repères, quelle(s) nature(s) voulons-nous reconstruire ? On touche ici au cœur des politiques de restauration. Si tout est dynamique, il n’est plus question de prendre comme référence un état historique.
Alors sur quelle autre référence appuyer ces politiques ? Derrière ce débat se profile toute la question des normes dont on a besoin pour légiférer ou fixer des objectifs opérationnels aux gestionnaires.
On comprend que la remise en cause du paradigme de l’équilibre de la nature est un exercice difficile qui dérange les habitudes et bouscule les politiques environnementales, et notamment de restauration écologique, bâties pour beaucoup sur ces normes appelant à retrouver un état antérieur, avant perturbation.
| Restauration écologique
« Au sens strict, la restauration écologique a été définie par la Society for Ecological Restoration International comme “le processus d’assister l’auto-régénération des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits”. Il s’agit donc d’une activité intentionnelle qui initie ou accélère le rétablissement d’un écosystème antérieur (ancien ou récent) par rapport à sa composition spécifique, sa structure communautaire, son fonctionnement écologique, la capacité de l’environnement physique à supporter son biote (ensemble des organismes vivants) et sa connectivité avec le paysage ambiant. » James Aronson, définition de la « restauration écologique », universalis.fr. |
Voir Patrick Blandin, op. cit.
Catherine Larrère, « La nature, la science et le sacré », in Catherine Larrère et Bérangère Hurand (dir.), Y a-t-il du sacré dans la nature ?, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 159.
Ibid., p. 160-161.
Patrick Blandin voit dans l’abandon de la théorie des équilibres naturels la promesse de nouveaux modes de protection de la nature et la possibilité d’échapper aux impasses d’une trop grande opposition homme-nature 20. Mais, pour d’autres, faire savoir qu’il n’y a pas d’ordre intrinsèque de la nature, c’est ouvrir la porte à tous les débordements et à l’idée que l’on peut tout faire sans contraintes. Pour Catherine Larrère : « Si tout est instable, que la nature n’est que changement, il n’y a plus moyen de distinguer ce qui est bon (les équilibres naturels) et ce qui est mauvais (les déséquilibres introduits par les actions humaines) 21 », ajoutant que c’est peut-être parce que l’on ne conçoit pas d’autre modèle d’action que prométhéen 22. On persiste alors dans l’erreur, mais encore faut-il disposer de solutions alternatives.
Les espèces qui dérangent
Voir, par exemple, Marcel Lachiver, Les Années de misère. La famine au temps du Grand Roi, Fayard, 1991.
Si les milieux conservationnistes ont tendance à appuyer leurs discours sur une vision romantique de la nature, parée de tous les attributs positifs, de nombreux citoyens ont cependant un vécu plus contrasté. L’histoire des sociétés humaines est en effet jalonnée de crises, dont certaines sont attribuables aux calamités dites naturelles, qu’elles soient la conséquence des aléas climatiques (inondations, sécheresses, tempêtes, etc.), des épidémies (choléra, malaria, etc.) ou des famines dues aux ravageurs des cultures 23.
Pour s’en prémunir, l’humanité a mis en place des mesures de protection. Celles-ci peuvent concerner la transformation des habitats – digues pour se protéger des crues, barrages pour le stockage de l’eau, assèchement des marais pour éradiquer le paludisme… – ou bien la lutte contre les espèces indésirables – élimination des prédateurs, contrôle des vecteurs de maladies et des ravageurs de culture par des moyens physiques ou chimiques. Il est courant que ces activités, nécessaires pour protéger notre santé et notre économie, soient dénoncées dans certains médias comme des atteintes à l’environnement.
Les espèces nuisibles : un qualificatif litigieux
Voir Rémi Luglia, Sales bêtes ! Mauvaises herbes ! Nuisibles, une notion en débat, Presses universitaires de Rennes, 2018.
Voir Serge Lambert, « Quand l’écologie et la biologie s’appelaient histoire ou sciences Application aux animaux utiles ou nuisibles », Courrier de l’environnement de l’Inra, n° 38, novembre 1999, p. 23-40.
Voir Christian Lévêque, L’écologie est-elle…, op. cit.
André Micoud, « Comment en finir avec les animaux dits nuisibles », Études rurales, n° 129-130, janvier-juin 1993, p. 88-89.
« Biological invasions are natural and necessary for the persistence of life on Earth, but some of the worse threats to biological diversity are from biological invasions » (Daniel Botkin, « The naturalness of biological invasions », Western North American Naturalist, vol. 61, n° 3, juillet 2001, p. 261).
Voir Jacques Tassin, La Grande Invasion. Qui a peur des espèces invasives ?, Odile Jacob, 2014.
Voir Jean-Nicolas Beisel et Christian Lévêque, Introductions d’espèces dans les milieux aquatiques. Faut-il avoir peur des invasions biologiques ?, Quæ, 2010.
Voir Loïc Marion, « Is the Sacred ibis a real threat for biodiversity? Long-term study of its diet in non-native areas compared to native areas », Comptes Rendus Biologie, vol. 336, n° 4, avril 2013, p. 207-220.
Voir, par exemple, Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, « Tour du Valat. Rapport d’activité 2017 », p. 13 et 33.
Depuis plus d’un siècle la notion de « nuisible » fait l’objet d’une vive contestation. Pourtant il ne s’agit pas d’un simple qualificatif théorique mais d’un réel problème de nuisance, ainsi que d’un concept opérationnel qui donne une certaine légitimité pour gérer et contrôler éventuellement l’espèce sauvage considérée comme indésirable 24 et couramment désignées par l’expression espèces nuisibles.
Cette expression est en grande partie issue du monde agricole confronté aux espèces sauvages qui détruisaient les récoltes. Dans les manuels scolaires du début du XXe siècle, les animaux étaient classés d’emblée en animaux « nuisibles » et en animaux « utiles » car la survie du monde rural en dépendait 25. Ils ne manquaient jamais de rappeler que le moustique est un véritable fléau dans les pays marécageux, alors que les manuels récents le considèrent comme un modèle biologique d’insecte piqueur-suceur, sans insister sur son rôle de vecteur de l’une des maladies les plus invalidantes dans le monde.
Les espèces considérées comme nuisibles par les ruraux et les épidémiologistes trouvent des défenseurs chez les urbains, pour des raisons éthiques ou esthétiques. Au nom du droit des espèces à exister, ceux-ci développent une argumentation sur le rôle indispensable de ces espèces dans le fonctionnement des systèmes écologiques. Ce qui renvoie au débat ci-dessus sur la nature déterministe ou stochastique des systèmes écologiques 26. Ainsi certains écologistes affirment-ils que le moustique est indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes et qu’il doit donc être protégé car il sert notamment de proie aux oiseaux. Mais le loup, dont on a dit également qu’il est indispensable au bon fonctionnement de nos systèmes écologiques, a été éradiqué des îles Britanniques au cours des siècles derniers. Or les systèmes écologiques anglais ne semblent pas pour autant désorganisés : ils fonctionnent toujours, un peu différemment que par le passé sans aucun doute, même en l’absence de cette espèce réputée clé de voûte des systèmes.
La loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité a voulu bannir l’expression « animaux nuisibles » de la partie législative du code de l’environnement pour le remplacer par « animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ». Mais ce changement de nom ne résoudra pas pour autant la question des nuisances auxquelles nous sommes exposés. Comme le résume André Micoud : « Les articles dans lesquels se trouve cette argumentation ont tous la même structure : il n’y a pas d’animaux nuisibles, tous ont droit à la vie, mais n’importe quelle espèce sauvage, lorsqu’elle devient proliférante, justifie et même exige une intervention régulatrice 27. » Peut-on prétendre toujours protéger la nature aux dépens des considérations humaines, sanitaires et économiques ? Il y a là un vrai sujet de société qui est loin d’avoir trouvé une réponse.
Selon Daniel Botkin, « les invasions biologiques sont un phénomène naturel et nécessaire à la persistance de la vie sur terre, mais certaines des pires menaces à la diversité biologique proviennent aussi d’invasions biologiques 28 ». En effet, les espèces voyagent. Elles utilisent pour cela différents moyens de dissémination, tels que le vent ou l’eau, ou s’accrochent aux poils des mammifères et aux plumes des oiseaux. Elles utilisent aussi de nos jours différents moyens de transport que l’homme met à leur disposition : containers, ballast des bateaux, ou encore bagages des voyageurs. Ce phénomène s’est logiquement accéléré depuis l’intensification des échanges commerciaux.
Les espèces que l’on qualifie d’invasives sont des espèces issues d’autres régions du monde qui sont, volontairement ou non, transférées par l’être humain et qui se naturalisent dans nos systèmes écologiques, souvent dans l’anonymat. Certaines d’entre elles se mettent à proliférer et créent des nuisances. Ce sont celles que nous appelons « espèces envahissantes ». Mais bien d’autres, à l’exemple du coquelicot ou du mimosa, sont devenues des espèces patrimoniales. La plupart des plantes cultivées en Europe, rappelons-le, sont originaires d’autres continents.
Les espèces introduites font l’objet de nombreuses critiques de la part des mouvements conservationnistes qui les accusent d’entrer en compétition avec les espèces autochtones et de les éliminer. Ce phénomène a été effectivement observé dans les îles, mais il est loin d’être généralisable aux milieux continentaux 29. Ainsi l’histoire de la diversité biologique européenne nous montre que les naturalisations d’espèces venues d’autres régions du monde ont largement contribué à la reconstitution de la flore et de la faune décimées par les épisodes glaciaires. Sait-on, par exemple, que dans les cours d’eau, un tiers des espèces de poissons ont été volontairement introduites depuis le XIXe siècle ? Ces naturalisations n’ont pourtant pas été suivies de la disparition d’espèces autochtones 30.
La réponse des pouvoirs publics à ces questions traduit un réel embarras. Il faudrait selon eux interdire l’accès à notre sol de nouvelles espèces (prévention) et les éliminer si elles y parviennent. Mais comment éliminer un poisson ou un crustacé de nos cours d’eau une fois qu’il s’y est installé ? Comment empêcher un moustique introduit en Italie d’envahir le sud de la France ?Personne n’a le mode d’emploi, de telle sorte que les injonctions et les directives restent vaines et s’assimilent à des recommandations incantatoires.
Un autre argument souvent entendu est que les espèces qui se naturalisent viennent perturber l’ordre de la nature et dérangent nos espèces autochtones. C’est ainsi au nom de la protection de la faune autochtone que certaines associations ont demandé d’éliminer les ibis sacrés qui s’étaient installés en Bretagne après s’être échappés d’un parc animalier. Ils auraient dérangé la reproduction de certaines espèces d’oiseaux autochtones. Une affirmation qui n’a pas été confirmée par des ornithologues compétents 31. Curieusement, le droit des espèces à la vie n’est plus invoqué ici et, sans que le mot soit prononcé, il existerait donc des espèces nuisibles pour la biodiversité ? Comme il en existe pour les agriculteurs ? Il serait légitime d’éradiquer les premières mais pas les autres ? Cet argumentaire peut prêter à discussion.
Bien entendu, il ne s’agit pas de faire l’apologie des introductions d’espèces mais de regarder la réalité en face. À moins de mettre fin aux échanges internationaux, il n’y a guère de solutions simples pour éviter que de nouvelles espèces viennent s’installer chez nous. L’une serait la quarantaine, mesure fortement contraignante. Encore faudrait-il que tous les pays d’Europe appliquent avec rigueur la législation car, dans l’espace Schengen, une espèce introduite en un point quelconque du continent a de fortes probabilités de se disperser sans en demander l’autorisation. Sans compter les introductions illégales dans les bagages des voyageurs, ce qui n’est pas anodin. Les incivilités dans ce domaine sont nombreuses.
Certaines mesures sectorielles prises en faveur d’espèces menacées peuvent même se révéler négatives dans la lutte contre les espèces envahissantes. Ainsi, le concept de trames vertes et bleues issues du Grenelle de l’environnement, au départ destinées à faciliter la circulation de certaines espèces autochtones, a créé par là même des autoroutes pour la circulation des espèces envahissantes qui les empruntent pour mieux se disperser. Dans nos cours d’eau, qui pour beaucoup sont reliés entre eux par des canaux créés pour la navigation, formant ainsi une grande trame bleue européenne, les espèces n’ont aucun mal à se déplacer. Depuis l’ouverture d’un canal entre le bassin du Danube et celui du Rhin en 1992, on a vu apparaître dans nos rivières de nombreuses espèces ponto-caspiennes, originaires de la mer Noire, de la mer Caspienne et des secteurs avals des fleuves qui s’y jettent (Danube, Don, Volga), ce qui n’est pas sans rappeler l’arrivée d’espèces originaires de la mer Rouge en Méditerranée après l’ouverture du canal de Suez. Ces espèces sont là et bien installées, et il y a peu de chance de les éradiquer. On ne peut continuer à faire comme si elles n’existaient pas et continuer à vouloir restaurer des systèmes « historiques ».
De même, ces espèces, parfois abondantes, jouent maintenant un rôle important dans le fonctionnement des systèmes aquatiques. Que signifie alors le concept de « bon état écologique » des cours d’eau qui sert de référence à la directive européenne sur l’eau ?
Le changement climatique en cours va lui aussi provoquer l’installation de nouvelles espèces qui étendront spontanément leur aire de répartition. C’est ainsi le cas de la lampourde d’Italie, une plante annuelle qui colonise à présent les marais camarguais. Il est symptomatique d’apprendre que des opérations d’arrachage manuel de cette plante sont réalisées en Camargue pour y maintenir une hypothétique flore autochtone 32. Devant un changement inéluctable, il faut faire preuve de réalisme.
Peut-on se protéger des pathogènes ?
Si l’intérêt ou non de la naturalisation des espèces peut s’apprécier par une démarche du type coûts/avantages – car on peut aussi trouver à certaines d’entre elles des aspects positifs –, il n’en demeure pas moins que l’un des phénomènes préoccupants de nos jours est la prolifération des pathogènes introduits, responsables de la mauvaise santé de nos végétaux, de nos animaux domestiques, ainsi que des êtres humains comme l’a montré la pandémie du Covid-19.
Beaucoup d’arbres en particulier sont malades. On se souvient de la graphiose de l’orme, un champignon d’origine asiatique qui a décimé les populations dans les années 1970. Et que dire de la pyrale du buis, un papillon asiatique détecté pour la première fois en Europe en 2007, arrivé dans des pots de buis importés de Chine. De même, les palmiers dépérissent dans le sud de la France et sont même menacés de disparaître à cause d’un charançon et d’un papillon introduits avec des palmiers malades.
Qu’on le veuille ou non, des espèces vont continuer à se naturaliser sur le territoire, même si nous prenons des mesures pour en limiter le nombre. Ce n’est pas du fatalisme, c’est tout simplement le fil de l’histoire dans le contexte économique actuel. Il faut prendre des mesures concrètes et ne pas entretenir l’illusion que nous allons y remédier en légiférant, alors que c’est souvent impossible une fois que les espèces se sont installées. Renforcer les mesures de quarantaine et responsabiliser les importateurs seraient un premier pas positif.
Les services écosystémiques : des biais surprenants
Voir Robert Costanza et al., « The value of the world’s ecosystem services and natural capital », Nature, vol. 387, n° 6630, 15 mai 1997, p. 253-260.
Certains économistes ont entrepris de donner une valeur monétaire à la biodiversité en pensant que ce serait un argument comptable qui serait mieux compris des dirigeants politiques pour les inciter à la protéger. Il s’agit du concept de « biens et de services rendus par les écosystèmes », devenu populaire et auquel on fait souvent référence 33. Si cette idée est stimulante, elle se heurte néanmoins à de grandes difficultés méthodologiques afin d’évaluer en termes monétaires les services rendus par la biodiversité. Mais ce qui pose réellement question dans cette démarche, c’est le biais systématique, apparemment assumé, de ne prendre en considération que ce que nous considérons comme positif dans nos rapports à la biodiversité, en écartant de l’analyse, par exemple, tous les coûts liés à la protection contre des maladies et les ravageurs des cultures. Cette question de ce que nous devons dépenser pour nous protéger des méfaits de la nature émerge timidement dans la littérature scientifique. Les zones humides sont ainsi des endroits producteurs de méthane – gaz à effet de serre très actif – et des lieux privilégiés pour la transmission des maladies parasitaires, mais la plupart des discours concernant la protection des zones humides marginalisent ces questions. Ce qui peut amener à penser que, sous couvert de démarche scientifique, la réalité se trouve parfois travestie.
La nature et la biodiversité sont à la fois source de richesse et source de nuisances. On ne peut parler des bienfaits de la nature sans évoquer en même temps sa face sombre. Pour être légitimées par les citoyens, les politiques de gestion de la biodiversité doivent prendre en compte cette dualité.
| Les êtres humains ont aussi à lutter contre la nature
« La nature que nous croisons autour de nous, elle continue à nous damer le pion sur le plan physique, climatique, géologique. Elle n’est ni bonne ni mauvaise, elle est indifférente : elle mène contre nous une guerre impitoyable, elle nous programme pour vivre mais aussi pour disparaître, nous offre les plus riantes perspectives, nous soumet aux pires tortures, se montre merveilleuse et abjecte. […] Toute l’aventure humaine est une lutte sans merci contre les fatalités physiques, biologiques, psychiques imposées à notre espèce. Nouer un “pacte de courtoisie” avec les éléments ? demande Michel Serres. Essayez donc la courtoisie avec un tsunami, une tornade ! Il faut protéger la nature, il faut se protéger de la nature. » Pascal Bruckner, Le Fanatisme de l’Apocalypse. Sauver la Terre, punir l’Homme, Grasset, 2011, p. 155-156. |
L’être humain détruit-il la nature ?
Voir Christian Lévêque, La Biodiversité… op. cit.
L’écologie scientifique est régulièrement confrontée au discours souvent anxiogène, parfois apocalyptique, selon lequel les activités humaines détruisent la nature et seraient responsables d’une érosion massive mettant en danger, à terme, l’avenir de la planète et de l’humanité. On parle même d’une sixième extinction de masse de la biodiversité, à l’image de celles que les paléontologues ont mises en évidence dans un lointain passé. On peut citer, par exemple, parmi bien d’autres, Anne Ehrlich et Paul Ehrlich, professeurs à Stanford, qui annonçaient, en 1982, que 100% des espèces tropicales auraient disparu en 2025. Pour faire bonne mesure, ils prédisaient aussi la disparition de 250.000 espèces par an, soit la disparition attendue d’environ la moitié de la diversité biologique en 2000. Le biologiste Edward O. Wilson, considéré comme l’un des pères du terme biodiversité, s’est également commis dans la prédiction. En 1992, il annonçait que 27.000 espèces tropicales disparaîtraient chaque année et que la moitié des espèces actuellement présentes sur Terre pourrait avoir disparu d’ici à un siècle 34. Ces propos ont été repris par d’autres scientifiques, sans que l’on se pose sérieusement la question des données qui pourraient corroborer de telles affirmations. Notons qu’il n’y a pas eu de démenti une fois avéré que ces prédictions étaient fausses. Bien au contraire, on y fait encore référence afin de convaincre de la nécessité d’agir rapidement.
Des ambiguïtés concernant la notion de nature
Voir, notamment, Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005.
Notamment Gn I, 26 : « Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre » (La Bible de Jérusalem, sous la direction de l’École biblique de Jérusalem, 1998, Éditions du Cerf/Pocket, p. 34).
Les rapports que les êtres humains entretiennent avec la nature sont complexes. Ils ont donné lieu à de nombreuses exégèses 35. Dans nos sociétés occidentales, imprégnées de culture judéo-chrétienne, des philosophes ont développé l’idée d’une opposition nature-culture en faisant référence aux textes de la Genèse pour justifier le comportement prédateur des humains 36. Selon l’anthropologue Philippe Descola, qui parle à ce propos de « naturalisme », la nature serait ce qui ne relève pas de la culture et des savoir-faire humains. Autrement dit, la nature serait, en théorie, ce qui n’est pas artificialisé. Cette image de « nature vierge », non dégradée par les hommes, est toujours présente, comme nous l’avons vu, dans de nombreux travaux scientifiques ainsi que dans les pratiques des services gestionnaires de l’environnement. Mais elle ne correspond pas à la réalité européenne, ni au vécu de nos concitoyens. C’est une image d’Épinal entretenue par les mouvements romantiques du XIXe siècle, elle-même héritière de la pensée créationniste d’un monde parfait et immuable que Dieu nous a donné.
Des discours paradoxaux
Sylvie Brunel, Géographie amoureuse du monde, JC Lattes, 2011, p. 25.
Voir Nicole Mathieu et Marcel Jollivet (dir.), Du rural à l’environnement. La question de la nature aujourd’hui, L’Harmattan, 1989.
Voir Bernard Picon, « La Histoire de la construction sociale et symbolique d’un espace “naturel” », Progressistes. Sciences, Travail & Environnement, n°11, janvier-février-mars 2016, p. 52-53.
En réalité, les propos concernant l’érosion de la biodiversité amalgament des situations très différentes de l’état de la biodiversité à la surface du globe. Il est ainsi indubitable que la forêt de Bornéo connaît une érosion importante et qu’il s’agit là d’un véritable sujet de préoccupation. Mais cette situation n’est pas comparable à celle de l’Europe où la biodiversité est le produit de plusieurs siècles de coconstruction.
Dans ce contexte, on peut se poser la question suivante : un système modifié par l’être humain est-il nécessairement un système dégradé ? Si l’on prend l’exemple du bocage, avec ses haies, dont on vante l’intérêt pour la biodiversité, il s’agit d’un paysage qui résulte de la transformation d’espaces forestiers en espaces agricoles au cours des siècles derniers. C’est sans aucun doute un système patrimonial mais c’est aussi, historiquement, un système forestier dégradé. Ce n’est pas une nature vierge, mais c’est néanmoins un système fonctionnel sur le plan écologique que nous cherchons à protéger. Cette nature vécue et aménagée constitue notre cadre de vie que nous cherchons à préserver. C’est ce que résume Sylvie Brunel quand elle écrit : « C’est la façon dont l’homme habite la terre qui l’a rendue agréable à vivre. Toute l’histoire de la présence de l’homme sur la terre est celle d’un combat permanent pour survivre, en dépit du déchaînement de forces aveugles et soudaines 37. »
Mais nous sommes confrontés à une situation paradoxale : pour la grande majorité des Français, la nature, c’est le milieu rural, celui qui leur est familier 38. Ce sont les bocages, les alpages ou les grandes zones humides comme la Sologne ou la Camargue. Cette dernière, labellisée parc naturel et emblème national de la nature « sauvage », est en effet le produit d’aménagements réalisés en vue de pratiquer la riziculture et la production de sel 39. Ce n’est pas un système « naturel » au sens où il est artificialisé, mais ce sont des systèmes écologiques emblématiques qui fonctionnent et qui accueillent une flore et une faune considérées comme patrimoniales.
Il est vrai que, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons connu d’importants changements. D’une part, la « révolution verte » a suscité un accroissement considérable des pollutions en milieu agricole ; d’autre part, la destruction des habitats naturels affecte nos territoires. Une grande opération de remembrement des terres agricoles a entraîné la disparition d’un important linéaire de haies et la réduction des zones humides. Par ailleurs, chaque année, de l’ordre de 70.000 hectares de terres, agricoles ou autres sont affectées à l’urbanisation. Chaque Français est légitime dans son aspiration à la propriété, immobilière ou foncière, et dans ses exigences en matière de routes, de moyens de transports ou encore de zones commerciales à la périphérie des villes. Tout cela a un coût écologique.
| Une sémantique anxiogène
Le choix des mots n’est pas anodin. Dans la littérature médiatique et scientifique, quand on parle de l’action des êtres humains sur les systèmes écologiques, on trouve fréquemment employés des mots comme « altération », « dégât », « dégradation », « détérioration », « dysfonctionnement », « érosion », « impact », etc. Ces termes à connotation fortement négative traduisent un état d’esprit général où est acceptée la prémisse selon laquelle l’être humain détruit la nature. |
Les aménagements détruisent-ils la biodiversité ?
Tout aménagement d’un système écologique entraîne automatiquement des modifications dans sa composition et dans son fonctionnement. Un système modifié par des aménagements peut être fonctionnel sur le plan écologique. Pour les tenants d’une vision fixiste des écosystèmes, ces aménagements sont considérés comme des impacts qui détruisent la nature. Pour les écologues qui ont une vision plus dynamique, un aménagement a pour conséquence des changements que l’on peut évaluer positivement ou négativement selon les valeurs que l’on privilégie. L’exemple du lac du Der-Chantecoq montre que la création d’un lac de barrage artificiel, qui a détruit un bocage (autre système artificiel), a finalement été paradoxalement couronnée d’un label international de conservation de la nature.
Le lac du Der-Chantecoq est un barrage réservoir situé dans le bassin de la Marne qui participe à réduire le débit de la Seine en période de crue afin d’éviter d’inonder Paris. Il a été créé au début des années 1970 sur un territoire agricole bocagé, suscitant à l’époque des réactions qui n’ont pas empêché sa construction : il s’agissait de protéger Paris. Depuis, la zone humide qui s’est installée – la plus grande de l’Hexagone – est devenue un lieu d’accueil privilégié pour les oiseaux d’eau migrateurs, dont la grue cendrée, qui attirent de nombreux spectateurs.
L’économie régionale y a trouvé son compte avec la pêche et les loisirs. Mais, surtout, ce système artificiel est devenu un lieu emblématique de protection de la nature puisqu’il a reçu de nombreux labels, dont celui de site Ramsar, la consécration internationale dans ce domaine. On ne parle plus ici de l’homme destructeur de la nature, alors que c’était un argument avancé avant la création – aux effets finalement très positifs – du lac. Pourtant, quand s’est posée la question de construire un barrage à Sivens, dans le Tarn, c’est encore l’argument de l’humanité destructrice d’une nature figée qui a été mis en avant par les mouvements militants. Poussons encore la réflexion. La construction du lac du Der-Chantecoq a supprimé un bocage et ses habitats pour les espèces d’oiseaux des champs. Une petite goutte d’eau parmi d’autres qui contribue peut-être à la régression des populations de ce groupe d’oiseaux. Mais on y a gagné un habitat pour les oiseaux d’eau. On a donc transformé un système écologique en un autre tout aussi intéressant, semble-t-il. Pour l’écologie scientifique, on n’a pas détruit la biodiversité, on l’a modifiée. Savoir si c’est bien ou mal relève de jugements de valeur qui sont des critères sociaux ou d’ordre culturel, non pas des critères scientifiques.
Des exemples de ce type sont nombreux. Bien entendu il y a aussi des contre-exemples. Il ne s’agit pas de nier que les êtres humains n’ont pas d’impact sur la nature, mais de relativiser des discours trop manichéens et de savoir pondérer. Mettre en avant des exemples jugés positifs est un moyen de repositiver notre relation à la nature. De tels exemples, que l’ingénierie écologique nous encourage à développer, peuvent être des substituts à l’absence de référence dont nous avons parlé dans les programmes de restauration.
Reconquérir quoi ?
Andre Clewell et James Aronson. La Restauration écologique, Actes Sud, p. 22.
« En quoi consiste l’écologie de la restauration ? », futura-sciences.com, s.d.
Voir Bertrand Morandi et Hervé Piégay, « Les restaurations des rivières sur Internet : premier bilan », Nature, Sciences, Sociétés, vol. 19, n° 3, juillet-septembre 2011, p. 224-235.
Voir Jean-Paul Bravard et Christian Lévêque (dir.), La Gestion écologique des rivières françaises. Regards de scientifiques sur une controverse, L’Harmattan, 2020.
Les objectifs de reconquête ou de restauration manquent de référence claire. Comme nous l’avons vu précédemment, un des principes fondamentaux de la restauration écologique serait de retrouver l’état des systèmes écologiques considérés comme dégradés, avant la perturbation qu’ils ont subie. Selon Clewell et Aronson, « la restauration écologique permet de ramener un écosystème à un stade antérieur pour peu que ce stade soit connu et atteint ensuite grâce aux pratiques de la restauration. De cette manière la restauration écologique satisfait le profond désir humain de retrouver un élément de valeur perdu 40 ». Dans l’esprit collectif, restaurer c’est retrouver l’état initial, comme l’exprime la définition suivante, assez représentative de cet état d’esprit : « L’écologie de la restauration, appelée également restauration écologique, est le fait de restaurer des écosystèmes qui ont été endommagés voire détruits par les activités humaines.
Le but est de restituer un écosystème donné tel qu’il était à l’origine, avant d’être impacté par l’industrie, l’agriculture ou l’artificialisation des surfaces 41. »
Mais cette pétition de principe se voit confrontée à une réalité : l’anthropisation ancienne de nos territoires dont les paysages ont été maintes fois refaçonnés et dont la faune et la flore sont le produit de nombreuses naturalisations d’espèces. Afficher de retrouver une nature vierge en Europe est pour le moins incantatoire car il n’y a pas de référence historique dans ce domaine. On a d’ailleurs du mal à imaginer ce qu’aurait pu être cette nature vierge en Europe si les êtres humains ne l’avaient pas transformée. Elle aurait probablement été bien plus pauvre qu’aujourd’hui étant donné son histoire climatique.
Se pose ainsi la question de la référence qui pourrait servir d’objectif à atteindre et qui permettrait de juger du succès ou non des projets de restauration. Ce qui signifie que beaucoup de projets de restauration ne sont que de vagues déclarations d’intention et n’ont pas d’objectifs précis, autre que de « renaturer », c’est-à-dire de reconstituer un décor paysager attrayant. Pour les systèmes aquatiques, la plupart des projets de restauration sont motivés par des raisons esthétiques, économiques ou sécuritaires, et non pas pour protéger la diversité biologique 42. La restauration de la continuité écologique des cours d’eau prend ainsi comme argument de restaurer les populations de quelques poissons migrateurs en effaçant les aménagements hydrauliques anciens, en feignant d’ignorer que ces derniers ont créé des habitats dont la disparition sera préjudiciable aux batraciens et à de nombreux invertébrés 43.
On doit s’interroger également sur ce que deviendrait notre environnement si, selon l’expression populaire, on laissait la nature reprendre ses droits. De nombreux travaux convergent sur le fait que, dans les territoires agricoles abandonnés, la forêt se réinstalle et que les espèces de milieux ouverts disparaissent. On peut penser alors que nous irions vers une homogénéisation des territoires en matière d’habitats, au détriment d’une hétérogénéité des paysages résultant des pratiques agricoles et gage d’une grande richesse biologique.
Penser différemment : des « nouveaux écosystèmes »
« The “novel ecosystem” concept simply puts a name to a class of ecosystem that is not historical but without the heavy baggage of the term “degraded”» (James Miller et Brandon T. Bestelmeyer, « What’s wrong with novel ecosystems, really? », Restoration Ecology, vol. 24, n° 5, septembre 2016, p. 579).
Voir Richard Hobbs et al., « Managing the whole landscape: historical, hybrid, and novel ecosystems », Frontiers in Ecology and the Environment, vol. 12, n°10, décembre 2014, p. 557-564.
Voir David Richardson et Mirijam Gaertner, « Plant invasions as builders and shapers of novel ecosystems », in Richard J. Hobbs, Eric S. Higgs et Carol Halls (dir.), Novel Ecosystems. Intervening in the New Ecological World Order, Wiley-Blackwell, 2013, p. 102-113.
L’ eutrophisation est « [l’]enrichissement d’une eau en sels minéraux (nitrates et phosphates, notamment), entraînant des déséquilibres écologiques tels que la prolifération de la végétation aquatique ou l’appauvrissement du milieu en oxygène. Ce processus, naturel, ou artificiel (dans ce cas, on parle aussi de dystrophisation), peut concerner les lacs, les étangs, certaines rivières et les eaux littorales peu » (« Eutrophisation », larousse.fr).
Voir David Foster et al., « The importance of land-use legacies to ecology and conservation », BioScience, vol. 53, n° 1, janvier 2003, p. 77-88.
Voir Patrick Blandin, op. cit., p. 85.
Des scientifiques ont bousculé les dogmes et parlent de plus en plus de l’existence de « nouveaux écosystèmes », que d’autres appellent aussi « écosystèmes culturels ». Il s’agit de systèmes aménagés par l’être humain, que l’on doit étudier en tant que tels sans a priori négatifs. En effet, l’écologie scientifique n’est pas seulement dévolue à la connaissance des milieux supposés vierges. Les systèmes artificialisés sont eux aussi fonctionnels et hébergent eux aussi une flore et une faune parfois abondantes, à l’instar de la Camargue ou de la forêt des Landes. Pour les chercheurs James Miller et Brandon Bestelmeyer, « le concept de “nouvel écosystème” est une manière de désigner une catégorie d’écosystème qui n’a pas d’analogue historique, sans la connotation négative du terme “dégradé” 44. » C’est le cas de la plupart de nos systèmes écologiques en France métropolitaine plusieurs fois remaniés au cours de l’histoire pour répondre à des nouveaux usages.
Mais on peut aussi créer de nouveaux habitats, à l’exemple des récifs artificiels qui permettent le développement d’une flore et d’une faune variées sur des fonds qui ne leur sont pas propices a priori. Ainsi, la Ville de Marseille a mené une opération pilote en immergeant 400 récifs de six types différents répartis sur 200 hectares, entre le Frioul et la Corniche. Les résultats confirment un effet très positif sur la biodiversité marine.
En outre, les activités humaines ont facilité la propagation de nombreuses espèces à travers le monde, donnant lieu à de nouvelles combinaisons inédites d’espèces végétales et animales qui auraient eu peu de chances d’exister autrement 45. Ces espèces non indigènes peuvent également remplir de nouvelles fonctions utiles dans les écosystèmes 46. Un exemple parmi d’autres est celui de la moule zébrée originaire d’Europe de l’Est et qui a été introduite accidentellement dans les grands lacs américains. Après avoir déploré les perturbations consécutives à cette invasion biologique, des scientifiques se sont aperçus qu’en raison de son fort pouvoir filtrant la moule zébrée rendait des services appréciables dans la lutte contre l’eutrophisation 47, permettant ainsi à de nombreuses espèces aquatiques qui avaient disparu de se réinstaller. De manière plus générale, on doit garder à l’esprit que les changements climatiques en cours vont entraîner des processus d’extinction et de recolonisation, et donc des changements possibles dans les services écosystémiques 48.
Pour Patrick Blandin, la reconnaissance des systèmes anthropisés en tant que systèmes fonctionnels différents et non pas « dégradés » est nécessaire : « Pourquoi se limiter à la réalisation de copies à peu près conformes des systèmes écologiques du passé, cette belle vraie nature que connaissaient nos aïeux ? Pourquoi ne pas envisager aussi la création de systèmes écologiques nouveaux rassemblant de nouvelles biodiversités ? 49 ».
Comment construire le futur ?
Cité in Pierre Barhélémy, « Qui a peur des espèces invasives ? », entretien avec Jacques Tassin, lemonde.fr, 16 février 2014.
En 2014, le chercheur Jacques Tassin faisait le constat suivant : « On traîne une vision obsolète de la nature, aujourd’hui décalée avec la réalité de notre monde et de notre savoir. Même si la science révèle toujours davantage qu’il n’y a ni équilibre ni ordre dans la nature, que le hasard y joue à plein et que tout n’y est que perpétuel changement, rien n’y fait. On en reste toujours attaché à cette idée, héritée du romantisme allemand, d’une nature fonctionnant comme un Tout, à l’image d’un organisme vivant dont il nous reviendrait de préserver l’intégrité et la santé 50. »
Des situations hétérogènes
C’est un fait que les activités humaines ont une influence sur la biodiversité, au même titre que les feux de forêt, les tsunamis, les sécheresses, les éruptions volcaniques ou les alternances de périodes climatiques telles que l’Europe les a vécues. Il est tout aussi exact que, selon des critères éthiques, certaines activités conduisent à la destruction d’un héritage de l’évolution et qu’il est nécessaire d’y prêter attention. Mais la question de la protection de la biodiversité se pose différemment selon les régions du monde, lesquelles n’ont pas la même histoire climatique et évolutive et qui en sont à des degrés d’anthropisation très différents. À ce titre, la biodiversité européenne, qui a connu plusieurs cycles de glaciation et une forte emprise des civilisations agricoles depuis des millénaires, n’est pas comparable à celle de la forêt de Bornéo ni à celle de la forêt amazonienne. Tenir des discours globalisants et généraux sur l’érosion de la biodiversité et sa protection n’est donc pas correct. Même en France, les problèmes ne sont pas comparables entre la Bretagne et la Corse ou entre la Guyane et la Réunion. Ces situations conjoncturelles nécessitent d’envisager des politiques adaptées aux contextes régionaux. Par analogie avec la génétique, chaque région a son « empreinte écologique » dont il faut tenir compte.
Anticiper les réponses à apporter par une diversité d’approches adaptées aux contextes écologiques locaux
Voir Serge Moscovici, La Société contre nature, Union générale d’éditions, 1972, p.35.
Le terme « forçage climatique » (ou « forçage radiatif ») désigne une perturbation d’origine extérieure au système climatique qui impacte son bilan Par analogie, on parle de facteur de forçage pour des perturbations extérieures au système écologique qui vont influer sur sa dynamique.
Voir, par exemple, le programme Explore 2070, réalisé de juin 2010 à octobre 2012.
Sylvie Brunel, op. cit. p. 23.
Nous vivons dans un pays où la nature que nous aimons est une nature anthropisée. Comme l’analysait déjà fort bien Serge Moscovici en 1972, nous sommes passés « d’une nature qui nous a faits à une nature que nous faisons 51 ». La question est alors de savoir comment gérer cette nature anthropisée dans un contexte de changement global, où les usages des ressources et des systèmes écologiques se modifient, où le climat se réchauffe, où les espèces voyagent, où nos sociétés occidentales accordent plus d’importance qu’autrefois à leur cadre de vie et à la protection de la nature, etc. Pour compliquer les choses, nous savons que les nombreux aléas associés à ces facteurs de forçage 52 rendent toute prévision bien difficile.
Que vont devenir nos bocages si nous mangeons moins de viande et si l’élevage périclite ? Si la forêt regagne du terrain et que l’urbanisation grignote nos territoires, que deviendront les espèces de milieu ouvert ? Si, comme l’envisagent certaines études 53, la pluviométrie diminue sur une grande partie de l’Hexagone alors que l’évapotranspiration augmente en raison de l’élévation de la température, que vont devenir les zones humides dont la protection est devenue un enjeu national et qui sont particulièrement sensibles aux bilans hydriques ? Va-t-on laisser faire la nature ? Ou allons-nous essayer de les maintenir en eau ? Et, dans ce cas, comment procéder ? De même, on peut probablement anticiper le fait que certains de nos cours d’eau vont devenir intermittents, comme c’est le cas actuellement pour certains cours d’eau d’Europe du Sud.
Nombre de projets pèchent par un manque d’anticipation. Les réponses nécessitent une diversité d’approches adaptées aux contextes écologiques locaux et aux diverses attentes de la société. Il faut adopter une démarche qui fasse appel à l’intelligence collective et se garder d’un certain jacobinisme qui est de mise actuellement. Comme l’écrit Sylvie Brunel : « Pour construire des solutions durables, il faut changer de regard. Ne pas accabler, mais proposer. Ne pas dresser d’intolérables constats en blâmant des boucs émissaires tous trouvés, mais puiser dans la géographie des éléments de comparaison et d’analyse qui permettent de trouver les bonnes solutions 54. »
Les aires protégées ne sont pas la solution universelle
Voir Guillaume Blanc, L’Invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le mythe de l’Éden africain, Flammarion, 2020.
La gestion doit être tournée vers l’avenir et non pas vers le passé, avec la réelle difficulté de se donner des objectifs réalistes. Le futur est à construire, mais sur quelles bases ? La biodiversité est loin d’être un simple objet naturaliste. La gestion de la biodiversité doit alors prendre en compte de nombreux critères, notamment des critères culturels et émotionnels, voire passionnels ou mystiques.
Si l’on s’inscrit dans une perspective écocentrée de protection de la biodiversité, considérée essentiellement comme un objet naturaliste, alors il faudrait créer de plus en plus de zones protégées dans lesquelles l’homme serait exclu et laisser, selon l’expression consacrée, la nature « reprendre ses droits ». C’est ce que certains suggèrent sous l’appellation de « naturalité » (wilderness), expression qui valorise la nature spontanée, indépendante des activités humaines. C’est une option clairement affichée par certaines ONG qui réclament de plus en plus de mesures protectionnistes. C’est aussi celle que reprend à son compte le One Planet Summit, qui affiche dans sa feuille de route vouloir transformer 30% des terres en espaces protégés.
Le principe des aires protégées peut faire partie d’une gestion d’ensemble de la biodiversité. Ainsi, les aires protégées marines ont fait preuve de leur efficacité dans la gestion de la biodiversité et des ressources marines et des aires protégées terrestres peuvent se justifier pour protéger des espèces endémiques. Mais il est difficile de penser qu’on puisse en faire une politique généralisée. L’une des raisons, notamment en milieu terrestre, tient aux changements susceptibles d’intervenir avec le réchauffement climatique. Ainsi, avec une remontée du niveau marin d’un mètre, la moitié de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine serait sous les eaux, et elle disparaîtrait totalement si le niveau marin remontait de deux mètres.
Quant aux zones humides, ce sont des milieux labiles sensibles aux modifications de la pluviométrie qui peuvent rapidement disparaître si la sécheresse devient chronique dans certaines régions. Sans compter que les changements de température entraînent des modifications dans l’aire de répartition des espèces.
L’extension des surfaces protégées ne va pas sans poser des problèmes sociaux, trop souvent passés sous silence. Car il faut alors résoudre l’équation suivante : comment augmenter la surface des aires protégées dans des pays où la croissance démographique est forte et où la demande en espaces agricoles s’accroît en proportion ? Que faire alors des populations humaines qui ne peuvent pas être considérées comme un simple facteur d’ajustement et qui vont se concentrer dans des zones de plus en plus restreintes ? Les politiques de mise en place des parcs nationaux africains donnent à réfléchir 55. On peut, de manière incantatoire, regretter la croissance démographique, mais elle existe et on ne sait pas la gérer. La Chine et l’Inde s’y sont essayées, avec un succès pour le moins mitigé.
En revanche, si l’on s’inscrit dans la perspective de développement durable, de bien-être humain ou, plus précisément, d’une coconstruction à avantages réciproques pour l’humanité et la biodiversité, alors il faut nécessairement rechercher des compromis. Dans ce cadre, différentes pistes sont possibles. Par exemple, le choix de privilégier l’échelle territoriale avec le souci d’adapter les actions à mener au contexte local semble préférable à des politiques centralisées et normatives qui gomment les spécificités. Il faut pour cela accepter que les objectifs et les priorités puissent différer selon les territoires, ce qui implique une décentralisation des politiques environnementales.
Pour un droit de l’environnement flexible et réactif
Voir Raphaël Mathevet et Matthieu Guillemain, Que ferons-nous des canards sauvages ? Chasse, nature et gestion adaptative, Quæ, 2016.
Voir Christian Lévêque et Sander van der Leeuw (dir.), Quelles natures voulons-nous ? Pour une approche socio-écologique du champ de l’environnement, Elsevier Masson, 2003.
Sur ce thème, voir Christian Buson (dir.), Réponses à l’écologisme. Comment la connaissance permet de réfuter les peurs entretenues, L’Harmattan, 2016 ; Gérald Bronner, L’Empire des croyances, PUF, 2e éd., 2015 ; Sylvie Brunel, Toutes ces idées qui nous gâchent la vie. Alimentation, climat, santé, progrès, écologie…, JC Lattes, 2019 ; Patrick Lesaffre, Un écologiste ne devrait pas dire Entre croyances et vérités scientifiques, Fauves Éditions, 2018.
Voir Bernard Chocat (coord.), Ingénierie écologique appliquée aux milieux Pourquoi ? Comment ?, Astee, Onema et ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, décembre 2013, p. 23.
Dans ce contexte, la voie qui semble s’imposer est celle d’une gestion adaptative, c’est-à-dire apprendre en faisant, agir en utilisant les informations de nature scientifique mais aussi les connaissances empiriques et les expériences accumulées 56. C’est l’antithèse de la gestion jacobine et normative telle que nous la pratiquons le plus souvent.
Il n’en reste pas moins que si l’on se fixe des objectifs, il faut aussi accepter de modifier le cap selon les circonstances. Et il faudrait pour cela une législation flexible et réactive. Or le droit de l’environnement actuel s’applique difficilement à des situations évolutives par essence.
La nature se voit protégée mais contrainte à demeurer en l’état car on n’a pas imaginé qu’elle pouvait changer spontanément. En l’absence de réflexion sur les futurs possibles, cela conduit inéluctablement à bloquer de nombreux projets de développement sur la base de principes périmés. Or nombre de sites d’intérêt pour la conservation de la nature et labellisés en tant que tels sont des sites anthropisés, à l’exemple de ces « nouveaux écosystèmes » que sont la Camargue, la forêt des Landes ou le lac du Der- Chantecoq cités dans notre étude.
La protection de la biodiversité ne peut donc plus faire abstraction des dimensions économiques, sociales et culturelles, et de leur intégration dans les politiques d’aménagement du territoire, de développement économique et de cadre de vie des habitants. Autrement dit, la gestion de la biodiversité n’est pas seulement l’apanage de spécialistes des sciences de la nature ou de mouvements militants, elle concerne aussi l’ensemble des citoyens quant aux décisions à prendre à l’échelle territoriale, compte tenu des autres enjeux qui en découlent 57. Il faut gérer la nature ou la « piloter » en fonction d’objectifs que nous aurons définis, sur des bases concrètes et pragmatiques, et non pas sur des bases théoriques, voire idéologiques. Il faut ici prendre garde à ne pas tomber dans l’illusion du « se réconcilier » avec la nature : celle-ci ne cherche pas à négocier car elle fonctionne sans but préconçu. Laisser la nature reprendre ses droits, c’est en réalité se mettre à sa merci.
Pour sensibiliser les citoyens à la protection de la biodiversité, nous avons besoin d’objectifs réalistes et concrets, ainsi que d’une vision plus positive de nos rapports à la nature. Sans pour autant éluder le fait que nous exerçons des pressions jugées négatives sur la nature, il serait bon de mieux valoriser les situations qui nous paraissent exemplaires et qui pourraient servir de références dans nos projets de gestion et de restauration, en l’absence d’une hypothétique référence que l’on ne peut pas définir objectivement. Nous devrions aussi, pour définir des politiques, nous appuyer sur les faits, non pas sur des croyances 58. En d’autres termes, « il ne s’agit pas de privilégier la nature au détriment de l’homme, mais de travailler de façon à rendre compatibles usages et préservation des écosystèmes 59 ».













Aucun commentaire.